|
|
Re: Présentation |
|
Modérateur  
Inscrit:
21/03/2013 20:08
De Belgique
Niveau : 44; EXP : 15
HP : 215 / 1078
MP : 1072 / 35550
|
Bonjour AliceG, ou plutôt Marion,
Je te souhaite la bienvenue sur l'Orée des rêves. Tu es jeune mais ton bagage littéraire est impressionnant.
Tu trouveras ici de nombreuses lectures divertissantes et didactiques (la page d'accueil notamment). Tes commentaires sont les bienvenus.
Nous serons tous heureux de te découvrir au travers de tes oeuvres.
N'hésite pas à te promener sur les divers forums.
Au plaisir !
Couscous
Posté le : 08/09/2013 11:12
|
|
|
|
|
Les bons mots de Philippe Bouvard et la pensée de la semaine |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
22/01/2012 16:15
De Alsace
Niveau : 16; EXP : 64
HP : 0 / 391
MP : 105 / 14214
|
De Philippe Bouvard :
-" J'ai peur que l'état ne dépense moins bien mon argent que je ne le ferais... "
-" Le piston ne marche qu'avec les huiles ... "
-" Dieu n'existe pas, mais il faut faire semblant d'y croire, ça lui fait tellement plaisir ! "
-" Pas étonnant qu'on se reproduise comme des lapins dans des bâtiment qui ressemblent à des clapiers ! "
-" Les royalistes refusent d'être gouvernés par des gens dont ils ne connaissent pas les parents ... "
-" Un homme politique est cuit quand il cesse d'être cru ... "
( Jeanne d'Arc aussi )
De Marc Escayrol :
-" Mieux vaut habiter une maison en L qu'un château hanté "
La pensée de la semaine :
"Vous ne pouvez choisir comment et quand vous allez mourir, mais vous pouvez choisir comment vous allez vivre maintenant .... ( Joan Baez)
Posté le : 08/09/2013 09:31
|
|
|
|
|
Présentation |
|
Débutant  
Inscrit:
06/09/2013 20:42
De Poitiers
Niveau : 3; EXP : 9
HP : 0 / 52
MP : 6 / 1651
|
Bonjour à toutes et tous.
J'arrive sur ce site avec plaisir.
Lire de nombreux écrits, publier.
Je suis une jeune femme de 23 ans, actuellement à Poitiers, finissant un contrat dans les ressources humaines.
Mon père, libraire, m'a initiée à la lecture dès mes 5 ans et depuis, je lis je lis je lis. J'écume toutes les brocantes pour renflouer ma bibliothèque, je lis tout ce qui a trait à la psychologie, la philosophie, l'absurde, l'abstrait, l'histoire (surtout la 2nd GM et la Guerre Froide)...
Mes écrivains favoris, au hasard : Kundera, Juliet, Semprun, Jauffret, Baudelaire... J'en oublie, j'en oublie, je reviendrai compléter ma liste plus tard.
Heureuse de découvrir ce site.
J'écris actuellement une petite autobiographie (oui je sais, à 23 ans c'est très jeune, mais elle est justifiée), et je commence un roman imaginaire.
J'aime écrire même si je débute juste, et j'aime LIRE LIRE LIRE.
Bises à tous.
Alice Gauguin, de son vrai prénom Marion.
Posté le : 08/09/2013 09:22
|
|
|
|
|
Re: Les belgicismes |
|
Modérateur  
Inscrit:
21/03/2013 20:08
De Belgique
Niveau : 44; EXP : 15
HP : 215 / 1078
MP : 1072 / 35550
|
Pour Iktomi, j’ai un peu enquêté. Il s’avère, en effet, que dans la région où je vis (Mouscron – Tournai), nous employons couramment « essuie » seul afin de désigner plus précisément « un essuie-main » ou un « torchon » (essuie de vaisselle) selon le lieu de résidence habituelle de l’objet en question. Cette abréviation est analogue à celle de « réveil » que nous utilisons pour « réveille-matin ».
Maintenant, il y a aussi l’essuie-tout, parfois dénommé « Sopalin » chez vous, en référence à une grande marque, inexistante en Belgique.
J’espère avoir ainsi essuyé vos questions !
A bientôt !
Posté le : 08/09/2013 06:51
|
|
|
|
|
Page du 1 Septembre l'étoile jaune, Invasion Pologne, J. Cartier, Louis XIV, Gassman, F. Mauriac |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Posté le : 08/09/2013 00:34
|
|
|
|
|
Carlo Gesualdo |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 8 Septembre 1566 meurt Carlo Gesualdo Prince de Venosa,
seigneur italien de la fin de la Renaissance, compositeur de musique de la renaissance polyphonique, profane et religieuse, il est connu sous le surnom de "musicien assassin"
Le prince de Venosa appartient à l'une des plus anciennes et des plus nobles familles du royaume des Deux-Siciles, remontant au roi normand Roger II.
Sa vie tourmentée — qui a inspiré à Anatole France l'une des nouvelles du Puits de Saint-Claire est celle d'un grand seigneur de la Renaissance italienne, passionné d'art et de poésie, violent, ombrageux. Marié en 1586 à la belle et ardente Maria d'Avalos, il la tue quatre ans plus tard, de sa propre main semble-t-il, ainsi que son amant Fabrizio Carafa, duc d'Andria : tous les poètes du temps, de Marino au Tasse, composèrent sur ce drame qui fit pleurer Naples entière, "Le Tasse".
Pendant deux ans, Gesualdo se terre dans son château de Venosa, et c'est durant cette réclusion que la musique cesse d'être pour lui un simple passe-temps de dilettante infiniment doué.
Descendant des rois normands de Sicile, prince de Venosa et comte de Conza, Gesualdo défraya la chronique pour avoir perpétré le meurtre de sa première épouse et de l'amant de celle-ci, tous deux en situation d'adultère. Représentant, aux côtés de Luca Marenzio, Luzzasco Luzzaschi et Claudio Monteverdi, le madrigal italien à son apogée, il a marqué l'histoire de la musique tant par sa vie excessive que par ses compositions, parmi les plus innovantes de cette période.
En 1593, il reparaît à la cour de Ferrare, alors l'un des plus brillants centres artistiques de l'Italie, fréquenté par les poètes, et par les musiciens de l'Europe entière qui y séjournèrent tour à tour : Obrecht, Lassus, Josquin des Prés, Dowland....
Gesualdo s'y remarie avec Éléonore d'Este et publie ses quatre premiers livres de madrigaux, à cinq voix, déjà très personnels.
C'est la période la plus pacifiée de sa vie.
Mais à la mort du duc Alphonse II en 1597), Ferrare cesse d'être un foyer artistique ; les artistes s'éloignent.
Gesualdo retourne dans ses États du Sud, où il va mener une existence de plus en plus renfermée, peu aimé si ce n'est haï, bizarre et sombre.
C'est alors qu'il compose les Ve et VIe livres de Madrigaux, à cinq voix en 1611, les plus pathétiques et les plus fascinants, d'un livre de madrigaux à six voix, il ne reste q'une seule œuvre.
Simultanément, sa vie intérieure se tourne vers un mysticisme violent, dramatique, et il écrit un ensemble d'œuvres religieuses aussi grandioses et aussi pathétiques que ses madrigaux profanes.
C'est un être hors du commun, au sens social aussi bien que psychologique.
Une personnalité étrange, inquiétante : une sorte de Cenci doublé d'un Maître de Santiago.
Une œuvre tombée au milieu du tissu de l'histoire de la musique comme un météore : pas d'antécédents, pas de postérité.
Un langage violent, excessif, bouleversant. Une sensibilité baroque — et c'est en cela que Gesualdo tient à son temps — au sens précis où l'on entend ce mot dans l'histoire des arts plastiques : goût du contraste, de l'irrationnel, du mouvant, de l'équivoque.
Mais ces caractères, qui sont communs à l'Italie de ces années 1600, sont ici sous-tendus par ceux de l'homme, cette sensibilité authentiquement inquiète, instable, fiévreuse, pathétique. Le baroque n'est ainsi pas seulement pour lui une forme, c'est un langage.
En outre, cet artiste baroque est en même temps un grand seigneur, un aristocrate qui ne doit rien à personne, et en tout cas pas au public.
En cette époque de mécénat et de profonde intégration de l'art à la vie sociale, lui peut se laisser guider par un individualisme hautain, il a la liberté d'aller où il veut, et jusqu'au bout de la moindre de ses impulsions.
Ainsi sa situation sociale, sa personnalité farouche, violente et mélancolique à la fois, et les tendances de l'art italien de ce temps se recoupent et se renforcent pour donner jour à cette œuvre unique en son espèce.
Les poèmes sur lesquels sont construits les madrigaux sont d'inégale valeur ; les plus beaux textes du Tasse y voisinent avec d'insipides versifications. Peu importe ; il suffit à Gesualdo qu'ils puissent lui fournir les quelques mots clés dont il a besoin : crudele, ardente, dolorosa, et surtout : morire, morte, et les paires : amarti o morire :"t'aimer ou mourir"...
Dans un contexte musical mouvant, révolutionnaire par son chromatisme ou ses dissonances, ces mots déclenchent aussitôt des modulations imprévisibles, des cadences étranges, des contrastes inouïs, des conclusions inattendues, qui apparaissent et s'évanouissent en une harmonie perpétuellement équivoque et instable.
Un madrigal comme le Moro, lasso, al mio duolo du VIe livre apparaît ainsi comme une œuvre totalement hors du temps, hors de la trame historique, hors de l'évolution des styles et de l'harmonie. Parmi les textes liturgiques, nulle surprise à voir Gesualdo s'attacher par prédilection aux plus pathétiques, ceux de la semaine sainte en particulier. Le O vos omnes, déjà traité si dramatiquement par Victoria ou l'Ave dulcissima Maria sont parmi les pages les plus extraordinaires que la foi ait jamais inspirées à un musicien
Biographie
Enfance et éducation musicale
Carlo Gesualdo, prince de Venosa et comte de Conza, naquit très probablement dans la ville éponyme en 1566, au sein d'une famille aristocratique ayant des liens étroits avec l'Église : on trouve, parmi ses oncles, les cardinaux Alphonso Gesualdo et saint Charles Borromée, ainsi que le Pape Pie IV parmi ses grands-oncles.
Gesualdo est le dernier des quatre enfants nés du prince Fabrizio Gesualdo et de Geronima Borromeo : Luigi est né en 1563, Isabella, en 1564, et Vittoria en 1565.
En tant que tel, il n'est pas appelé, a priori, à succéder comme prince de Venosa.
La cour napolitaine de son père était constituée, entre autres, de musiciens tels Scipione Dentice, Pomponio Nenna, et Giovanni de Macque, et de théoriciens comme Mutio Effrem. Carlo Gesualdo fut initié dès son plus jeune âge à la musique - notamment au luth et à la composition.
En 1584, son frère Luigi fait une chute de cheval et meurt subitement.
Âgé de vingt et un ans, il n'était pas encore marié, et ne laissait aucun héritier mâle. Carlo, âgé de dix-huit ans, devient l'héritier des titres et domaines de son père, qui le presse de se marier.
Le choix se porte sur Maria d'Avalos, fille du duc de Pescara et cousine germaine du compositeur, choix motivé par le fait que Maria, ayant eu deux maris auparavant, avait donné des signes suffisants de fécondité .
Ces considérations de la part de la famille Gesualdo, la nouveauté des devoirs imposés à Carlo, auxquels son éducation ne l'avait guère préparé et le fait que Maria soit quatre ans plus âgée que son époux ne sont pas sans conséquence pour les suites de ce mariage, qui donnera naissance à la légende noire du compositeur.
Le mariage entre Carlo Gesualdo et Maria d'Avalos fut célébré le 28 avril 1586 dans l'église San Domenico Maggiore de Naples.
Premier mariage : un crime d'honneur
Le mariage se termina sordidement, quatre ans après, par l'assassinat de Maria et de son amant Fabrizio Carafa, duc d'Andria. L'issue tragique de ses noces contribua à la postérité de Gesualdo, qui est devenu le compositeur meurtrier de l'histoire de la musique…
Cette scène se déroula le 17 octobre 1590.
On en connaît deux versions bien différentes. La première est celle que l'on peut reconstituer par le témoignage de Bartodo, serviteur de Gesualdo au moment des faits, version contenue dans les comptes rendus de l'enquête instruite par les juges de la Grand-Cour du Vicariat de Naples.
Dans cette version des faits, le meurtre eut lieu à la sixième heure de la nuit c'est-à-dire environ à une heure du matin, la septième heure sonna peu de temps après. Bartodo fut réveillé par son maître qui lui demanda de lui apporter de l'eau.
Ce faisant, le serviteur s'aperçut que le petit porche de la porte donnant sur la rue était ouvert. Bartodo apporta l'eau à son maître et l'aida à s'habiller. Étonné, Bartodo demanda à son maître ce qu'il souhaitait faire, et celui-ci lui répondit qu'il partait chasser.
Plus surpris encore, il lui fit remarquer qu'il n'était pas l'heure, ce à quoi Gesualdo répondit Tu verras quelle sorte de chasse je fais !.
Bartodo alluma ensuite sur ordre de son maître deux torches dans la chambre de celui-ci, et Gesualdo tira de sous son lit une épée bien affutée, une dague, un poignard et une petite arquebuse d'environ deux paumes.
Puis ils montèrent tous deux l'escalier menant aux appartements de l'épouse, et à la porte se trouvaient trois hommes armés chacun d'une hallebarde et d'une arquebuse longue de trois palmes.
Ces derniers enfoncèrent la porte, et entrèrent dans la chambre de Maria d'Avalos. Bartodo maintenait la servante Silvia et une nourrice dans l'antichambre.
Il y eut deux coups de feu, des insultes.
Les trois jeunes hommes ressortirent, et ce fut ensuite Carlo Gesualdo, les mains recouvertes de sang.
Il désira savoir où se trouvait Laura, l'entremetteuse, celle-ci étant absente. Bartodo et Gesualdo retournèrent dans la chambre où ce dernier acheva le couple agonisant.
Cette version est la plus fidèle dont on dispose, insérée dans une enquête administrative et officielle.
L'événement en lui-même fit couler beaucoup d'encre, et ce jusqu'au XIXe siècle.
Au-delà du scandale impliquant trois grandes familles de la noblesse et, par alliances, toute l'aristocratie napolitaine, le meurtre devint bientôt un sujet poétique, selon le degré de compassion accordé aux victimes.
Torquato Tasso, dit Le Tasse, évoque les derniers instants des amants dans plusieurs sonnets.
Mais le poète faisant partie de l'entourage de la famille du duc d'Andria, il s'agit plus d'une apologie que d'un récit basé sur les faits.
Une autre version datant, faute de source précise, d'avant 1728, devint plus célèbre, et fut citée davantage par la suite. Elle est cependant plus subjective, mettant en scène les derniers mots des amants, faisant passer l'épouse pour une dame peu vertueuse face aux inquiétudes du duc, et enchaînant de nombreux dialogues dans un style trop moderne pour le XVIe siècle, dont l'authenticité est impossible à prouver.
Tout le royaume de Naples, et la noblesse romaine du Vatican, se passionna pour cette affaire.
Si certains détails sont corroborés par plusieurs témoignages, comme le fait que Gesualo soit revenu vers Maria en s'écriant "Elle ne doit pas être encore morte !"
avant de lui porter d'autres blessures dans la région du bas-ventre, il est impossible d'affirmer si les corps des amants ont été jetés dans la rue ou sont restés pendus jusqu'à ce que la pourriture trop avancée de leurs corps oblige à les enterrer afin d'éviter une épidémie…
La culpabilité de Maria d'Avalos ne faisait aucun doute.
Son époux, disposant du droit de justice haute et basse, avait seulement vengé son honneur et celui de sa famille.
Cette condamnation si sévère de l'adultère, communément admise à l'époque, l'obligea cependant à se retirer dans la ville de Gesualdo, dans ses domaines qu'il ne quitta plus guère, pour se prémunir contre les effets de la colère d'une des deux familles. Cet exil s'accompagne d'ailleurs d'autres retraites forcées parmi les membres de sa famille.
Son père meurt loin de Naples, dans son château de Calitri, le 2 décembre 1591. Carlo Gesualdo devient, à ving-cinq ans, prince de Venosa et chef de famille.
Second mariage
Gesualdo épousa, en secondes noces, Leonora d'Este, cousine du duc Alphonse II d'Este, en 1594, à Ferrare, important centre musical où l'art du compositeur trouva son plein épanouissement. Ses deux premiers livres de madrigaux furent publiés à Ferrare cette même année.
Ce mariage, décidé par un oncle de Gesualdo et le duc de Ferrare pour des motifs politiques complexes, fut un nouvel échec.
Très impatient et désireux de rencontrer sa future épouse, montrant en ceci un caractère très napolitain, il apparaît bien vite que Gesualdo montrait plus d'intérêt envers les activités musicales de la cour d'Alphonse II qu'envers cette seconde épouse.
Celle-ci avait d'ailleurs trente-deux ans, soit cinq ans de plus que son mari.
Le contrat de mariage fut signé le 20 mars 1593.
Gesualdo avait eu un fils de son premier mariage, Emmanuele, né en 1588. Un autre fils naît de son second mariage, Alfonsino, en 1595.
Sa mort, le 22 octobre 1600, par étouffement selon la correspondance d'Alessandro d'Este, le frère de Leonora, a parfois été attribuée à Gesualdo lui-même, dans les récits qui lui furent consacrés - sans preuve, cependant.
Les lettres conservées entre Cesare et Alessandro d'Este, l'un et l'autre très hostiles envers Gesualdo, ne font pas mention d'un pareil crime.
Les relations entre le prince et la princesse de Venosa n'en sont pas moins détériorées irrémédiablement.
Leonora n'avait pas quitté Ferrare lorsque Gesualdo se retire dans ses terres en 1596. Elle ne le rejoint qu'à la mort d'Alphonse II, en 1597. Par la suite, elle s'absentera de la cour de Gesualdo pour rejoindre celle de sa famille, à Modène, de 1607 à 1608 puis de 1609 à 1610.
Les rapports très étroits entre Leonora, ses frères et l'un de ses demi-frères ont fait l'objet d'allusions malveillantes. De son côté, Gesualdo reconnaît la naissance d'un fils illégitime, Antonio, auquel il attribuera une rente mensuelle de quarante ducats dans son testament.
Ni l'un ni l'autre n'était particulièrement fidèle ou vertueux.
Le 22 octobre 1607, le fils du prince, Emmanuele, se marie avec Marie Polixène de Fürstenberg, princesse de Bohême.
Leur fils Carlo naît en 1610 mais meurt la même année, ce qui désole le compositeur. La même année, son oncle Charles Borromée est canonisé.
Ces différents événements le marquent profondément, et pourraient être le point de départ des séances de pénitence si particulières qu'il s'infligea par la suite, avec les scènes de flagellation qui contribuèrent à sa célébrité posthume.
Scènes de flagellation
Dans l'imaginaire populaire, les crimes de Gesualdo seraient revenus le hanter vers la fin de sa vie.
La mort de son second fils fut-elle considérée par cet homme très religieux comme l'œuvre de la justice divine, la condamnation de ses péchés ?
Aurait-elle déclenché en lui le besoin d'expier ses fautes ? Cela expliquerait les pratiques presque masochistes du compositeur, se soumettant à la flagellation par des garçons adolescents, engagés exprès pour cet emploi - selon sa propre expression, pour chasser les démons.
Ces pratiques de pénitence, sévères sinon extravagantes, étaient encouragées à l'époque par la spiritualité née de la Contre-Réforme, entre autres exercices de mortification de la chair .
Elles resteront assez répandues jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Il est possible de rattacher ces procédés, et ces séances de flagellation, à la fervente dévotion qui s'empara de Gesualdo à la fin de sa vie, plutôt qu'à un plaisir morbide ou pervers.
En 1611, puis encore l'année suivante, il obtient des reliques de Saint Charles Borromée, devenu non seulement son parrain mais son saint patron. Dans une lettre du 1er août 1612, il remercie son cousin, le cardinal Federico Borromeo :
"Je ne pouvais attendre ni recevoir aujourd'hui de la bonté de Votre Seigneurie Illustrissime une grâce plus précieuse, ni plus désirée que celle que vous avez daigné me faire avec la sandale que le glorieux saint Charles utilisait pontificalement. Je l'ai accueillie et embrassée avec une grande allégresse et consolation, mais elle sera conservée et tenue avec la vénération et la dévotion qu'il convient".
Dans ce même esprit, Gesualdo offrait à sa chapelle, longtemps après son double crime, un tableau représentant le Jugement Dernier où il est représenté avec sa seconde épouse, suppliant le Christ, et dans lequel se trouvent également son oncle maternel Saint Charles Borromée, Marie-Madeleine, la Vierge Marie, Saint François d'Assise, Saint Dominique et Sainte Catherine de Sienne, qui tous interviennent en faveur du Prince.
En 1611 toujours, Gesualdo compose son œuvre la plus longue, les Tenebrae Responsoria "ou Répons des Ténèbres" à six voix, où la figure du Christ martyr s'exprime musicalement de manière absolument personnelle.
Une mort désespérée
Le 20 août 1613, le fils de Gesualdo meurt des suites d'une chute de cheval. Son épouse est enceinte de huit mois.
Le couple n'avait eu, après leur fils Carlo, qu'une fille, Isabella, alors âgée de deux ans.
Le prince, privé de son dernier fils légitime, l'héritier de ses titres et de ses domaines, se retire dans l'antichambre de la camera del Zembalo, la chambre au clavecin.
Il meurt dix-huit jours plus tard, le 8 septembre 1613. Marie Polixène accouchera d'une fille. La lignée des Gesualdo de Venosa s'éteint donc avec le compositeur...
Le testament du prince, rédigé quelques jours avant sa mort par Don Pietro Cappuccio, constituait une dernière tentative de conserver l'intégralité des titres, terres et domaines féodaux dans la famille, à défaut d'une filiation masculine directe :
"Si l'enfant posthume qui naîtra de ladite donna Polissena est une fille, j'institue comme héritière universelle de tous mes biens ladite donna Isabella, ma petite-fille. .. Je veux, j'ordonne et commande qu'elle prenne comme mari l'aîné de Don Cesare Gesualdo ou, à défaut, son deuxième ou troisième fils, ou un autre dans cet ordre, et si la lignée dudit Don Cesare venait à s'éteindre, qu'elle prenne, dans le même ordre, un des fils de Cesare Gesualdo, fils de Michele Gesualdo, et si pareillement la lignée de Cesare venait à s'éteindre, qu'elle prenne pour époux un autre de la maison Gesualdo, le plus proche de ladite famille.
Ces dispositions ne furent pas respectées. La princesse Isabella épousa, en 1622, Don Nicolò Ludovisi, un neveu du pape Grégoire XV issu de la noblesse romano-bolonaise, sans affiliation avec la maison de Gesualdo.
Le prince fut enterré aux côtés de son fils Emanuele, dans la chapelle de Santa Maria delle Grazie, puis son corps fut transféré dans l'église del Gesù Nuovo à Naples, aux pieds de l'autel de Saint Ignace de Loyola, dont la construction avait été projetée par Gesualdo avant sa mort.
Une mort mystérieuse
La rapide succession d'événements tragiques, l'activité panique déployée par Gesualdo durant ses derniers jours et les volontés adressées avec autorité dans son testament sont peu compatibles avec la figure du solitaire en proie à la folie que peindra bientôt la légende. Les circonstances de sa mort n'en sont pas moins obscures.
En 1632, le chroniqueur Ferrante della Marra déclare :
"Carlo Gesualdo fut assailli et malmené par une grande multitude de démons qui, pendant plusieurs jours, l'empêchèrent de se reposer sauf si dix ou douze jeunes gens, qu'il employait exprès comme bourreaux, ne le couvraient et il souriait trois fois par jour de coups très durs.
C'est dans cet état misérable qu'il mourut à Gesualdo".
Il aurait ainsi été retrouvé mort, nu, suite à une des séances de pénitence, au caractère si particulier, qu'il affectionnait.
Selon certains, cette mort aurait pu être volontaire, désirée - entre autres - par les garçons qui se prêtaient à ces séances de flagellation.
De toute évidence, cette image du prince torturé marqua l'inconscient populaire. Michele Giustiniani, de passage à Gesualdo, peut ainsi écrire dans une lettre du 10 octobre 1674 plus de soixante ans après les faits ! :
"Dans ce lieu, le 3 septembre 1613, s'ensuivit la mort de Don Carlo Gesualdo, chevalier napolitain, prince de Venosa et musicien très-excellent, comme en témoignent ses œuvres publiées, et joueur d'archiluth. Celle-ci fut précipitée par une étrange maladie, qui lui rendait agréables les coups qu'il se faisait donner sur les tempes et sur d'autres parties du corps, en se protégeant avec quelques torchons enroulés".
Première légende noire
La naissance de Leonora, la deuxième petite-fille de Gesualdo, fut accueillie avec désolation.
La veuve du prince, revenant à Venosa pour assister à l'accouchement de la princesse Maria Polissena, en rapporte la nouvelle à son frère Cesare :
"J'ai fait baptiser la petite fille, et on lui a donné le nom de Leonora et Emanuela. Elle est jolie, et elle est née avec les cent mille écus de dot que lui a laissé le prince mon seigneur. Mais l'aînée, qui hérite de tous les états, aura pour dot plus d'un million en or sans compter le reste."
Leonora d'Este meurt en 1637.
Entre temps, la perte de la fortune et des domaines seigneuriaux s'accompagne de rumeurs visant à expliquer de si grands malheurs par l'effet de quelque châtiment divin.
De l'avis général, la faute tombe sur Carlo Gesualdo qui s'était mis à déraisonner et à traiter ses vassaux non seulement avec avarice et concupiscence, mais aussi tyranniquement, provoquant la colère de Dieu contre lui.
Quelques jours à peine après la mort de Gesualdo, un chroniqueur de Modène, Giovan Battista Spaccini, donne le départ de la légende noire qui s'attachera désormais à la mémoire du prince déchu :
"Il avait une très belle concubine qui l'avait ensorcelé à tel point qu'il ne pouvait plus voir la princesse Leonora. Quand la princesse était loin, il mourait d'envie de la voir, mais ensuite, il ne faisait jamais plus attention à elle.
Il ne pouvait dormir sans que quelqu'un ne soit avec lui en l'embrassant et en lui tenant chaud aux reins. C'est pourquoi il avait avec lui un certain Castelvietro de Modène, qui lui était très cher, et qui dormait continuellement avec lui quand la princesse n'était pas là ".
La cour de la famille d'Este s'était repliée sur Modène, chassée de Ferrare par les troupes du pape.
Le souvenir des négociations manquées entre Alphonse II et le cardinal Gesualdo, oncle du prince, entraînait certainement du ressentiment à l'égard de Gesualdo.
De telles déclarations ne devaient donc pas être écoutées sans réserve.
Elles se répandirent cependant de Modène à Naples, à Rome, et dans toute l'Italie. On observe d'ailleurs que, même dans les récits les plus noirs du temps de la réclusion de Gesualdo dans son château, il n'est jamais fait allusion qu'à la seconde épouse du prince et non à la première, Donna Maria d'Avalos dont l'assassinat, déjà lointain, semble même oublié de tous…
Personnalité
Le voile de mystère qui entoure Carlo Gesualdo est, toutes proportions gardées, le même qui ombre les visages de certains de ses contemporains, tels Rodolphe II de Habsbourg - un prince mélancolique, coupé du monde dans son château, et se donnant à lui-même le spectacle de sa maîtrise du monde par des artifices magiques - Le Caravage, 1571-1610 et Christopher Marlowe, 1564-1593 - artistes ambigus, brillants, excessifs, assassins et mourant dans d'étranges circonstances.
Des tels personnages achèvent de représenter, pour un observateur du XX1e siècle, les incertitudes, les nobles aspirations, les chimères et les violences de la Renaissance, entre traditions figées, guerres de religion, renouveau artistique et révolution copernicienne…
Il nous faut faire un effort pour envisager le caractère et l'œuvre de Gesualdo, et leur donner leur importance véritable - ainsi, l'aborder plutôt par Josquin Desprez que par Debussy.
Caractère
Portrait
Détail du Perdono di Gesualdo.
Trois portraits permettent de poser un visage en frontispice des œuvres de Gesualdo.
Tous montrent le prince vêtu de noir et portant la fraise espagnole, le regard sombre, les cheveux et la barbe coupés court, l'air austère ou en prière, presque toujours les mains jointes. Cette image du compositeur est figée pour la postérité.
Si l'on admet que Gesualdo a porté l'armure d'apparat offerte par la famille d'Este lors de son mariage à Ferrare, le compositeur était de taille moyenne, dans la norme de son époque donc entre 1m65 et 1m70.
Mince, habile à manier l'épée et se proclamant, devant le comte Fontanelli, expert dans les deux arts de la chasse et de la musique, il est de complexion fragile. Les dix dernières années de sa vie c'est-à-dire : alors qu'il n'a que trente ans sont marquées par de nombreux ennuis de santé, qui lui interdisent de quitter ses terres de Gesualdo, et dont il se plaint souvent dans sa correspondance.
Les grands évènements de la vie de Gesualdo sont connus, dans une certaine mesure.
Ses lettres conservées et les témoignages obtenus de ses contemporains éclairent également son quotidien. Le milieu dans lequel évoluait le prince de Venosa était celui des cours napolitaines, romaines et ferraraises : un monde fermé sur lui-même, ombrageux, jaloux de ses privilèges, violent et querelleur, attaché aux traditions et à toutes sortes de signes extérieurs de richesse, de noblesse et de domination.
Patrimoine : la fortune et le devoir
Forts de leur statut de prince et de leur alliance avec le pape, qui les préserva du sort réservé à la majorité des grands barons napolitains progressivement ruinés et assujettis à la famille royale espagnole, le grand-père et le père de Gesualdo accumulèrent une vaste fortune, dont on peut mesurer l'importance au moment du mariage avec Maria d'Avalos, en 1586.
Les bijoux qu'elle reçut de sa belle-famille témoignent de la magnificence dans laquelle le compositeur avait grandi :
"Du seigneur comte, Carlo Gesualdo, un collier de quarante-neuf perles et une fleur de joie avec une émeraude, tous deux d'une valeur de mille six cents ducats, une demi-lune de diamants avec trois perles de la valeur de mille trois cents ducats, et du prince son père, Fabrizio, un aigle avec des émeraudes et des rubis, ainsi qu'un perroquet en émeraude, et de l'Illustrissime seigneur cardinal Gesualdo, un rubis de paragonite et un spinelle monté sur des anneaux d'or. »
Pour se donner une idée de la valeur de tels présents, il suffira de rappeler qu'un musicien célèbre tel que Giovanni de Macque, organiste de la Santissima Annunziata de Naples, recevait un salaire mensuel de dix ducats en 1591, année de la mort de Fabrizio Gesualdo.
Le testament de ce dernier apporte d'autres éléments pour estimer la valeur du patrimoine familial, et mesurer le poids de responsabilités qui pesa dès lors sur Gesualdo :
"Il est de ma volonté que les biens des Gesualdo reviennent au chef de famille et à ses successeurs qui descendront de mon lignage et qu'ils soient les maîtres de mes états ; ils devront se contenter de les servir, et d'en avoir l'usufruit, mais que la propriété reste toujours debout et solide, et inaliénable, tant que durera mon susdit lignage, et ses aînés mâles".
Le même document stipule, en effet, que si son fils ne réussissait pas à obtenir un héritier, la somme de 300 000 ducats devrait être versée à l'ordre des jésuites, et que les hôpitaux des Incurabili et de l'Annunziata auraient à se partager encore 200 000 ducats.
Devenu prince, Gesualdo ne ménagera pas ses efforts pour procurer une épouse à son fils Emanuele.
Peut-être rencontra-t-il des difficultés du fait de sa réputation personnelle : le futur époux était orphelin de mère depuis l'âge de trois ans, par la faute de son père… De même qu'il avait contracté son second mariage, non parmi la noblesse napolitaine mais dans une cour plus septentrionale, Gesualdo trouve hors d'Italie sa future belle-fille.
Et il se complaît à en décrire les qualités dans une lettre à l'épouse de son beau-frère - qui lui avait refusé à plusieurs reprises l'une et l'autre de ses deux filles.
Le mariage est célébré en Bohème, le 22 octobre 1607, et la naissance du fils d'Emmanuele et de Maria Polissena de Fustemberg en 1610 donne au prince la satisfaction d'un devoir accompli, rapidement obscurcie par la mort prématurée de l'enfant…
Un seigneur attaché à ses domaines
À la suite du meurtre de Maria d'Avalos, en 1591, Gesualdo s'était retiré dans son fief de Gesualdo. La mort de son père, survenue un peu plus d'un an après cet évènement, met à sa disposition l'ensemble des terrains, châteaux et autres possessions liées à sa principauté.
Gesualdo se lance alors dans une vaste entreprise de restauration de la demeure familiale, transformant l'ancienne citadelle normande en une résidence fortifiée, pouvant accueillir une cour digne de ce nom.
Ces travaux sont associés à une vaste entreprise de déboisement de la forêt de sapins, sur la colline entourant le château - ce qui a été souvent interprété, de façon un peu romanesque, comme une opération de dissuasion, destinée à se protéger d'une éventuelle attaque de la famille Carafa.
Ces travaux font, en réalité, partie d'un programme d'urbanisme de grande ampleur, dotant la cité de places, de fontaines et de bâtiments religieux.
Gesualdo s'emploie en particulier à la construction de deux couvents, l'un dominicain, l'autre capucin, ainsi qu'à l'édification de leurs églises respectives, Santissimo Rosario, achevée en 1592, et Santa Maria delle Grazie, qu'il ne vit jamais achevée.
Grâce au témoignage du comte Fontanelli, qui l'accompagna lors de son voyage dans ses terres napolitaines, en 1594, nous disposons d'une description objective des domaines de Gesualdo, "un pays très agréable et aussi gracieux au regard que l'on puisse le souhaiter, avec un air très sain et doux », et « des vassaux viscéralement attachés à leur seigneur".
La série de lettres qu'il envoie au duc d'Este fait découvrir un prince veillant à la prospérité de ses domaines et à la bonne gestion de ses affaires. Les archives de la ville révèlent également son habileté dans l'administration de ses biens, ce qui inciterait à nuancer le portrait d'un compositeur toujours rongé par le remords, en proie à la folie et perdu dans la musique.
L'importance du milieu social
Les deux mariages successifs de Gesualdo permettent de surprendre sur le vif la noblesse au sein de laquelle il vécut.
Dans leur correspondance, officielle ou privée, ce ne sont que protestations d'attachement éternel, serments non tenus, engagements réciproques, alliances familiales de même rang, ventes et achats de terrains, marchandages continuels et contrats où les sentiments humains n'ont aucune place.
Cesare d'Este, frère de la seconde épouse du compositeur, taxe Gesualdo d'avarice dans ses lettres, tout en refusant de payer la dot de Léonora…
Même les membres du Clergé - à commencer par l'oncle du prince, le cardinal Alfonso Gesualdo, doyen du Sacré-Collège - se montrent d'une habileté redoutable pour manipuler leur entourage. On sent ainsi, en de nombreuses occasions, que Gesualdo a été dominé par ses parents, la cour où il était tenu de paraître et les membres de sa famille occupant de hautes fonctions auprès du Pape.
Il est permis de penser que Gesualdo trouvait à s'évader dans la composition de madrigaux harmonieux, ingénieux, où il était véritablement le maître. L'esprit d'émulation, voire de surenchère dans les premières œuvres, et la volonté de rivaliser avec les musiciens les plus estimés de son temps, pourrait se comprendre également comme une revanche sur ce monde étouffant des cours. Avec le duc de Ferrare, Alphonse II, il ne parlera que de musique.
Prince et compositeur
Les Gesualdo de Venosa :gloire et déclin
Armes de Carlo Gesualdo.
Blasonnement : d'argent au lion de sable, cantonné de fleurs de lys de gueules, qui est Gesualdo de Venosa.
Ce n'est pas comme musicien, mais en tant que prince italien, allié à la maison d'Este et lié au destin du duché de Ferrare, que Carlo Gesualdo est mentionné par Saint-Simon dans ses Mémoires, Charles Gesualdo, prince de Venose au royaume de Naples.
La noblesse des Gesualdo est remarquablement ancienne et illustre.
Le fief et le château de Gesualdo remontent au XIIe siècle. Les origines de leur sang royal remontent au très noble Roger de Normandie, duc des Pouilles et de Calabre , et à Robert Guiscard, le légendaire aventurier normand qui conquit la Sicile au xie siècle.
La vie du compositeur occupe une position tout à fait particulière dans cette lignée.
Sa naissance coïncide avec le plus haut période de gloire et de fortune de sa famille, et sa mort, faute d'héritier mâle, en marque la fin…
Le mariage de ses parents, le 13 février 1561, marque le début d'une formidable ascension sociale de toute sa maison : la mère du compositeur est nièce du pape Pie IV, et la politique de népotisme traditionnelle au Vatican offre des postes importants à certains de ses oncles.
Alfonso Gesualdo est créé cardinal dès le 1er mars 1561.
D'autre part, le grand-père du compositeur, Luigi IV, obtient la même année la principauté de Venosa du roi d'Espagne Philippe II.
Ce titre vient s'ajouter à celui de comte de Conza, octroyé par le roi Alphonse V d'Aragonnote 8 à Sansonetto Gesualdo en 1453.
Carlo Gesualdo ne serait pourtant qu'un nom parmi d'autres dans la généalogie des maisons régnantes, s'il n'avait dérogé en publiant ses livres de madrigaux et sa musique religieuse.
Mécénat musical
L'intérêt que Gesualdo portait envers la musique n'est pas sans précédent parmi les membres de sa famille.
L'éducation d'un prince encourageait une bonne connaissance des auteurs classiques et de la poésie contemporaine, la pratique du chant et celle d'un instrument.
Le grand-père du compositeur, Luigi IV, était le protecteur du poète Bernardo Tasso, père du Tasse.
Son père, Fabrizio, entretenait une cour où les musiciens figuraient en grand nombre. Giovanni de Macque, qui fut vraisemblablement le professeur de Carlo, dédie au prince son deuxième livre de madrigaux à six voix en 1589.
Le compositeur Giovan Leonardo Pocaterra offre, en 1585, son septième livre de madrigaux à Carlo en témoignant dans sa préface de sa dette envers Fabrizio.
Carlo Gesualdo ne manquera pas de poursuivre cette tradition familiale. Ses noces avec Leonora d'Este sont l'occasion de publications de poèmes et de chansons, publiées par Baldini, l'éditeur ducal de Ferrare.
Il encourage ainsi Luzzasco Luzzaschi à publier, chez le même éditeur, ses quatrième 1594, cinquième 1595 et sixième 1596 livres de madrigaux lorsqu'il le rencontre. Luzzaschi lui témoigne sa gratitude dans la préface et dédicace du quatrième livre :
"Votre Excellence ayant de diverses manières montré au grand jour qu'il estimait de près et de loin mes compositions malgré leurs faiblesses, et ne sachant comment vous rendre grâce d'avoir, par votre valeur, propagé cette renommée si heureuse en mon honneur, j'ai résolu de vous adresser ces madrigaux nouvellement composés".
Même Alfonso Fontaneli, qui avait suivi Gesualdo en ambassade pour le compte du duc de Ferrare, depuis Naples et jusqu'à Venise, publie en 1585 un premier livre de madrigaux de sa composition. Cependant, conformément à l'usage aristocratique selon lequel la composition musicale est indigne de la noblesse, Fontanelli intitule cette publication premier livre de madrigaux sans nom d'auteursenza nome.
Une passion pour la musique
Selon plusieurs témoignages, à commencer par celui de Fontanelli, L'attitude de Gesualdo à l'égard de la composition musicale manquait totalement de ce détachement aristocratique, la sprezzatura, qui voulait qu'une personne de haute condition sache beaucoup sans jamais le montrer.
L'usage en était déjà ancien parmi les membres de la noblesse, certains exemples remontant à l'antiquité grecque et latine. Le livre du courtisan de Baldassar Castiglione 1528 engageait ainsi à fuir un trop grand désir de montrer que l'on sait beaucoup.
Cette pratique n'a d'ailleurs rien de spécifiquement italien. Dans ses Mémoires 1739-1749, Saint-Simon observe encore cet usage, et rend hommage à Madame de Sévigné en ces termes :
"Cette femme, par son aisance, ses grâces naturelles, la douceur de son esprit, en donnait par sa conversation à qui n'en avaient pas, extrêmement bonne d'ailleurs, et savait extrêmement de toutes sortes de choses sans vouloir jamais paraître savoir rien".
Un ouvrage contemporain de Stefano Guazzo, La civil conversatione 1577, recommandait ainsi de ne pas se perdre dans cet honnête et vertueux divertissement, la musique, dont il faut définir des limites convenables, et qu'il faut finalement pratiquer juste assez pour soulager son âme ". Au contraire, Gesualdo entendait montrer au grand jour son savoir et son art. Les témoignages de Fontanelli sur ce point sont éloquents :
"Le prince de Venosa, qui ne voudrait rien faire d'autre que chanter et jouer, m'a forcé aujourd'hui à rester avec lui.
il m'a retenu de la vingtième heure à la troisième heure de la nuit, de midi à 19 heures environ, de telle sorte que je crois que je n'écouterai plus de musique avant deux mois."
"Il fait ouvertement profession, d'être musicien et expose ses compositions mises en partition à tout le monde afin de les faire s'émerveiller de son art".
Cette attitude peu commune donne à Gesualdo un statut tout à fait particulier, parmi les cours royales et ducales de Naples et de Ferrare dans un premier temps, puis parmi les grands compositeurs de la fin de la Renaissance.
Un engagement personnel
Libre de composer selon son bon plaisir, sans souci d'avoir à répondre aux goûts d'un mécène ou patron, à la différence d'un Monteverdi, par exemple, Gesualdo souffrait cependant d'un évident complexe de légitimité. Aux yeux de ses contemporains, sa musique semblait devoir témoigner d'un métier sûr et digne d'un professionnel.
Vincenzo Giustiniani parle ainsi de madrigaux pleins d'artifices et de contrepoint exquis, avec des fugues difficiles et gracieuses dans chacune des parties, et imbriquées les unes dans les autres :
"Il s'ingéniait avec tous ses efforts et tout son art à choisir des fugues qui, bien que difficiles à composer, soient chantantes et apparaissent douces et fluides afin qu'elles semblent à tous faciles à composer lorsqu'on les chante, mais qu'en s'y penchant de plus près, on les trouve difficiles et pas du premier compositeur venu."
La seule distance observée par Gesualdo tient à l'absence de signature officielle lors de la publication de ses madrigaux.
Les six livres lui sont d'abord dédiés, et la mention madrigali del prencipe di Venosa atteste un caractère ambigu de propriété, voilant à peine celui de la création pure.
La première composition connue de Gesualdo, le motet Ne reminiscaris Domine, paraît en 1585 dans une collection présentée et signée par Stefano Felis, maître de chapelle à la cathédrale de Bari.
Les deux premiers livres de madrigaux sont adressés à mon seigneur et patron illustrissime et excellentissime, Don Carlo Gesualdo, prince de Venosa » par Scipione Stella, un jeune prêtre et musicien de l'entourage du compositeur, en mai 1594. Les troisième et quatrième sont offerts de la même façon par Hettore Gesualdo, également proche du prince, en 1595 et 1596.
Les lettres de dédicace des deux derniers livres sont signées par Don Pietro Cappuccio en juin 1611, et sont exceptionnellement riches d'informations, parmi lesquelles la revendication par Gesualdo de ses qualités musicales.
Celle du cinquième livre précise que certains compositeurs ont voulu suppléer à la pauvreté de leur génie par un art frauduleux en s'attribuant à eux-mêmes de nombreux beaux passages des œuvres de Votre Excellence, ainsi que de vos inventions, comme cela est advenu tout particulièrement dans ce cinquième livre de vos merveilleux madrigaux.
Avec ses derniers madrigaux, plus originaux et audacieux, Gesualdo entend être considéré véritablement comme un compositeur, un maître dont l'œuvre est appelée à compter dans l'histoire de la musique.
L'art du madrigal
Composition et publication
Un premier livre de madrigaux aurait d'abord été imprimé sous un pseudonyme, Gioseppe Pilonij, en 1591.
Par la suite, le prince-compositeur poursuivit une sorte de politique personnelle, faite d'exigence technique et de raffinement dans l'écriture.
Si le résultat n'est jamais froidement anonyme, dans les premiers livres, c'est par le choix des textes mis en musique - choix déterminant, puisque Gesualdo pratique le canto affetuoso, où la musique façonne ou colore les mots du poème.
La publication des quatre premiers livres de madrigaux eut lieu à Ferrare, de 1594 à 1596, le compositeur ayant confié l'ensemble de sa production présente à l'éditeur ducal, Vittorio Baldini.
En l'espace de trois ans, l'essentiel de l'œuvre établissant la renommée de Gesualdo est ainsi publié et diffusé en Italie.
En 1611, le prince fit transférer l'atelier d'un imprimeur de musique napolitain, Giovan Giacomo Carlino, dans son palais de Gesualdo.
C'est ainsi qu'il supervisa lui-même l'édition des cinquième et sixième livres de madrigaux à cinq voix, et des Responsoria et alia ad officium hebdomadae Sanctae spectantia à six voix.
Gesualdo avait également fait imprimer des conducteurs de ses madrigaux, ce qui permettait à un musicien averti de saisir à la lecture de la partition les subtilités de contrepoint et d'harmonies. Les compositeurs ne diffusaient généralement que les parties de chant séparées, suffisantes pour une audition en public.
Cette pratique analytique fut continuée par l'abbé Molinaro qui réalisa la première édition intégrale des six livres, l'année de la mort de Gesualdo.
Les compositeurs des générations suivantes étaient invités à considérer ces pièces, au-delà du charme dégagé par leur exécution, comme des objets d'étude.
Ces compositions respectent certains des canons de l'époque, restant attachées dans l'ensemble au langage modal. Elles en éprouvent souvent les limites, cependant, et les font parfois éclater de l'intérieur, ce qui donne au final l'une des œuvres les plus originales, étranges et surprenantes de la Renaissance italienne.
Entre Renaissance et Baroque
Gesualdo apparaît d'abord comme un compositeur traditionnel . Si Monteverdi, son contemporain, réalise la transition entre le madrigal maniériste et l'opéra par l'invention du madrigal dramatique, véritable charnière entre Renaissance et Baroque, Gesualdo n'a pas modifié fondamentalement les formes existantes.
Il a composé à la manière déjà vieillissante de l'époque, selon un style très personnel, reflétant sa personnalité exacerbée : riche en chromatismes, en dissonances et en ruptures rythmiques et harmoniques.
Les démarches concourantes de Gesualdo et Monteverdi se complètent, en portant le madrigal à un tel degré de puissance musicale que le genre lui-même s'effondre sur ses bases. L'opéra de Monteverdi apportait à son époque une nouvelle forme de divertissement, répondant à la demande d'un public dont le goût avait changé.
Le succès en fut immédiat, et durable. En comparaison, Gesualdo livrait des compositions exigeantes, édifiantes, mais dont les musiciens à venir, non initiés, ne sauraient que faire…
Inspiration poétique
Gesualdo mettait un grand soin dans le choix des textes de ses madrigaux. Il portait une grande admiration envers Le Tasse, par exemple, qu'il rencontra à Ferrare et dont il mit neuf madrigaux en musique. Cependant, il semble que ce soit plutôt le poète qui ait tâché de répondre aux exigences du musicien.
Sa musique s'attache aux moindres détails du texte, l'accompagne littéralement mot à mot et peut passer d'un extrême à l'autre de la lumière à l'obscurité, de la joie à la tristesse avec les changements adéquats au niveau de l'harmonie, du tempo - en quelques notes, si le texte l'exige - ce qui était à l'opposé du goût de l'époque précédente, où les mélodies se devaient principalement d'être belles, et pouvaient s'accommoder pratiquement sur n'importe quel poème.
Gesualdo a également puisé dans les textes de Giovanni Battista Guarini, très populaires auprès des compositeurs de madrigaux.
Rencontres et influences
Lors des fêtes données en l'honneur de son second mariage, Gesualdo eut l'occasion d'entrer en relations avec la camerata Bardi de Florence. Giulio Caccini témoigne que Jacopo Corsi, Ottavio Rinuccini et Giulio Romano s'étaient rendus à Ferrare afin de jouir des mascarades, de la musique et des noces de cette cour .
Mais le prince montrait plus de goût pour les prouesses instrumentales et vocales de Luzzaschi, polyphoniques et chromatiques, qu'envers les débuts de l'opéra de la grande accademia fiorentina, où triomphe la monodie accompagnée80.
En effet, Luzzasco Luzzaschi a certainement influencé Gesualdo dans la manière expressionniste de ses madrigaux, au moins à partir de son quatrième livre.
À Ferrare se trouvaient également Le Tasse et Guarini, dont les poèmes étaient très prisés pour leur mise en musique, ainsi que le fameux Concerto delle Donne, qui lui ont fourni d'importants exemples pour son inspiration et ses méthodes de composition.
De passage à Venise, en 1595, il exprima également le désir de rencontrer Giovanni Gabrieli.
Œuvre;
Œuvre profane
Madrigali a sei voci, édition originale de 1626, frappée aux armes du prince Gesualdo et de son épouse Este.
Article détaillé : Madrigaux de Carlo Gesualdo.
Les madrigaux de Gesualdo, au contenu sensuel et douloureux, sont à l'origine de sa postérité. On distingue ses deux premiers livres de madrigaux à cinq voix, à l'écriture conventionnelle et au style proche de ceux de Marenzio et des premiers livres de Monteverdi, des œuvres ultérieures où abondent harmonies inhabituelles, chromatismes et figuralismes.
Premier livre de madrigaux à cinq voix (1594),
Deuxième livre de madrigaux à cinq voix (1594),
Troisième livre de madrigaux à cinq voix (1595),
Quatrième livre de madrigaux à cinq voix (1596),
Cinquième livre de madrigaux à cinq voix (1611),
Sixième livre de madrigaux à cinq voix (1611),
un livre de madrigaux à six voix, posthume (1626), publié par Mutio Effrem, musicien au service du prince de Venosanote 13,82.
Œuvre sacrée
N'étant nullement tenu de composer de la musique religieuse, on pourrait s'étonner - après avoir lu l'histoire de sa vie, si éloignée de celle attendue d'un croyant , et après avoir écouté ses œuvres profanes, si sensuelles - de trouver des œuvres sacrées dans le catalogue de Gesualdo. Elles sont presque aussi nombreuses que les pièces profanes…
Leur existence ne peut donc s'expliquer que par un besoin, un choix personnel, Gesualdo étant aussi passionné dans ses amours profanes que dans sa foi envers Dieu.
Les pièces religieuses de Gesualdo sont aussi des œuvres de maturité assurant la transition, au moins pour ce qui est de l'édition, entre les quatre premiers livres de madrigaux et les deux derniers. Le compositeur s'y exprime avec une maîtrise et une liberté de langage remarquable - et souvent surprenante, étant données les exigences du répertoire ecclésiastique.
deux livres de Sacræ Cantiones, le premier à cinq voix, le second à six et sept voix (1603),
le cycle des Tenebrae Responsoria (ou Répons des Ténèbres) pour la semaine sainte, à six voix (1611).
Œuvre instrumentale
Article détaillé : Musique instrumentale de Carlo Gesualdo.
Trois ricercares à quatre voix 1586,
Gagliarde del principe di Venosa, à quatre voix,
Canzone francese, pour luth ou clavecin.
Œuvres publiées dans des recueils collectifs
Ne reminiscaris Domine, motet à cinq voix inclus dans le Liber Secundus Motectorum de Stefano Felis, publié par Gardano, à Venise, en 1585,
T'amo mia vita et La mia cara vita, deux madrigaux à cinq voix inclus dans le Theatro de madrigali a cinque voci publié par Guagano et Nucci, à Naples, en 1609,
Ite sospiri ardenti, canzonetta à cinq voix incluse dans le troisième livre de canzonette de Camillo Lambardi publié par Vitale, à Naples, en 1616,
All'ombra degli amori et Come vivi cor mio, deux canzonette à cinq voix incluses dans le huitième livre de madrigaux de Pomponio Nenna publié par Robletti, à Rome, en 161887,
In te domine speravi, motet à cinq voix inclus dans le Salmi delle compiete de diversi musici napolitani publié par Beltrano, à Naples, en 162088.
Il convient de signaler encore deux pièces manuscrites, non publiées mais conservées à la Biblioteca Queriniana de Brescianote 16,87 :
Il leon'infernal
Dove s'intese mai
Postérité
XVIIe siècle : l'éloge des contemporains
Avec un peu de malice, il serait facile de suggérer que le prince de Venosa imposait sa musique à sa cour, et que le plus sûr moyen de lui plaire était d'en faire la louange. Il est curieux de constater, cependant, que les témoignages des proches du compositeur n'abondent pas dans ce sens.
Fontanelli se borne à écrire qu'il est clair que son art est infini.
Il prend cependant des poses et se meut de façon extraordinaire, mais tout est une affaire de goût .
Ce n'est pas de l'enthousiasme, à proprement parler…
En revanche, le nombre de rééditions de ses livres de madrigaux, et leur diffusion à travers la péninsule italienne, atteste que le public à tout prendre, les « connaisseurs appréciait sa musique - et ceci se vérifie pour l'ensemble des madrigaux.
L'année même de la mort du prince, 1613, une édition complète des six livres était en préparation. En 1626 paraît un unique livre de madrigaux à six voix. Pour un seigneur sans descendants à honorer ou à flatter, n'était-ce pas la reconnaissance de ses qualités de musicien ?
Il est plus significatif de trouver son influence sur les œuvres de compositeurs napolitains, des contemporains comme Giovanni de Macque, Scipione Dentice et Pomponio Nenna, et ceux de la génération suivante comme Sigismondo d'India, Giacomo Tropea, Crescenzio Salzilli, Scipione Lacorcia, Antonio Cifra, Michelangelo Rossi, et jusqu'à Frescobaldi96 qui tâcheront de prolonger les recherches expressives de Gesualdo dans le sens du chromatisme.
Les théoriciens de la musique n'avaient pas manqué, comme Adriano Banchieri, de saluer la maîtrise du compositeur dans la rhétorique des passions, le plaçant au côté de Monteverdi pour la force expressive de son discours oratione. Pietro Della Valle, dans son traité Della musica dell'età nostra 1640 lui rend un magnifique hommage posthume, doublé d'une fine analyse musicale :
Il faut bien savoir les règles d'art et qui ne les sait est très ignorant, mais celui qui ne se risque pas de temps en temps à les transgresser pour faire mieux ne sait absolument rien.
Les premiers qui, en Italie, ont suivi louablement cette voie ont été le prince de Venosa, qui a sans doute donné l'exemple à tous les autres en termes de canto affettuoso, Claudio Monteverdi, Jacopo Peri…
xviiie siècle : l'époque classique
La révolution harmonique apportée par Rameau, l'avènement de la tonalité et du tempérament égal chez Jean-Sébastien Bach occultent, pour un temps, la compréhension de l'esthétique polyphonique, expressive, modale et chromatique.
Les madrigaux de Gesualdo et leur esprit de recherche, voire de transgression, n'avaient plus droit de cité au temps de Mozart, où les dissonances ne font plus guère que de timides apparitions et où les progressions harmoniques se sont figées selon des règles arbitraires.
Les préjugés des philosophes du Siècle des lumières, la méconnaissance de la vie et de l'œuvre de Gesualdonote comme des canons esthétiques de son époque, portent un grave préjudice à sa musique.
Le musicologue anglais Charles Burney, 1726–1814 ne trouvait dans l'œuvre du prince-compositeur « pas la moindre régularité de dessin mélodique, de phrasé, ou de rythme, et rien de remarquable dans ses madrigaux sinon une succession de modulations à l'encontre des principes, témoignant du perpétuel embarras et du manque d'expérience d'un musicien amateur, et considérait le madrigal Moro, lasso al mio duolo comme un spécimen caractéristique de son style : dur, cru et plein de modulations lascives, véritablement répugnant selon les règles de transition établies à présent, mais aussi extrêmement choquantes et dégoûtantes pour l'oreille…
XIXe siècle : la seconde légende noire
Les critiques anglais seront les premiers à porter un véritable intérêt envers les artistes italiens de la Renaissance, peintres et sculpteurs. Walter Pater consacre des essais à Léonard de Vinci (1869), Botticelli (1870), Michel-Ange (1871) et Pic de la Mirandole (1872) - repris dans son étude Studies in the History of the Renaissance (1873). Ces ouvrages mêlent des considérations biographiques, parfois romancées, à des théories esthétiques. D'abord parus dans la presse quotidienne et dans des revues mensuelles ou hebdomadaires, ils ont un grand retentissement auprès du public et des intellectuels.
Les conférences d'Oscar Wilde contribueront aussi à la célébrité d'artistes brillants et innovants, mais ambigus, torturés par leur sexualité ou leur génie, et souvent assassins comme Le Caravage et Benvenuto Cellini.
L'hypocrisie sociale dominante s'accommodait parfaitement d'un tel goût pour les turpitudes de créateurs perçus avant tout comme des marginaux.
La célébrité de Gesualdo est ainsi liée, dans un premier temps, non à sa musique, mais au fait qu'il tient parfaitement le rôle qu'on attend de lui.
La notion même de « génie » est romantique, et suppose un certain désordre.
Alors que l'adultère commence à être perçu avec plus d'indulgence, la culpabilité du compositeur change de visage.
De prince tyrannique frappé par le châtiment divin, Gesualdo devient le musicien meurtier, le sanguinaire torturé par sa conscience et le spectre de sa première épouse.
Cecil Gray et Philip Heseltine lui consacrent un livre, publié en 1926, le premier ouvrage entièrement dédié à cette nouvelle légende noire de Gesualdo.
En parallèle, les musicologues associent de manière systématique les étrangetés harmoniques de ses madrigaux et le traumatisme lié à l'assassinat de Donna Maria d'Avalos, où les contemporains du prince voyaient plutôt un paradoxe
Quelle récompense étrange que le prince qui, avec la mélodie et la douceur de son chant et de sa musique, avait provoqué l'admiration et la satisfaction de l'assistance, ait, au contraire, trouvé du réconfort et du calme à ses angoisses intérieures dans de cruels coups.
En revanche, les audaces du langage gésualdien trouvent un écho parmi la génération des grands musiciens romantiques. Les oxymores sur lesquels sont composés ses madrigaux prennent une couleur hugolienne.
En s'opposant au bon goût classique sévèrement délimité par Charles Burney, en s'éloignant de la juste mesure mediocritas, Gesualdo paraît soudain étonnamment moderne.
XXe siècle : la résurrection
Les regards portés sur Gesualdo ont grandement changé à partir de la redécouverte et de la diffusion de son œuvre au XXe siècle.
De compositeur marginal, déséquilibré, dont la musique avait sombré dans l'oubli, il accéda pour de nombreux critiques à un statut de visionnaire : le premier, plusieurs siècles avant Berlioz, Wagner et les post-romantiques, à faire un usage important de chromatismes et de libres dissonances, tout en étant un précurseur des modernes par son utilisation de contrastes extrêmes et de ruptures dynamiques originales.
C'est à ce titre que Gesualdo a inspiré certains compositeurs du XXe siècle :
Le Monumentum pro Gesualdo de Stravinsky, composé en hommage envers un maître dont le compositeur russe a également restauré des partitions dont le matériel était en partie perdu dans les Sacræ Cantiones principalement.
Tenebrae Super Gesualdo de Peter Maxwell Davies 1972, pour mezzo-soprano et ensemble instrumental, flûte alto, clarinette basse, violon, alto, violoncelle, glockenspiel, guitare, clavecin, marimba et celesta,
Tenebre de Scott Glasgow 1997, pour orchestre à cordes,
Carlo, 1997, pièce pour orchestre à cordes et bande magnétique du compositeur australien Brett Dean, qui reprend et sample les premières mesures du célèbre madrigal Moro lasso al mio duolo.
Le voci sottovetro - elaborazioni da Carlo Gesualdo da Venosa de Salvatore Sciarrino 1998 pour voix et ensemble instrumental,
Tenebrae de John Pickard 2008,
Les Gesualdo Variations 2010, où le guitariste et compositeur David Chevallier fusionne, autour de six madrigaux des cinquième et sixième livres, ensemble vocal, écriture contemporaine et musique improvisée.
XXIe siècle : un compositeur pré-moderne
Pour la génération post-moderne, moins attachée à des critères théoriques et musicologiques, la musique de Gesualdo possède un charme particulier. L'originalité de son langage, mieux assimilée, n'en est pas moins reconnaissable dès la première écoute.
Des enregistrements sur CD, réalisés par des ensembles vocaux professionnels, permettent de juger de la qualité de ses madrigaux et de sa musique religieuse.
D'autre part, si la légende persiste autour de sa mémoire, les jugements portés sur le prince compositeur ont évolué à mesure que les documents d'époque sont devenus accessibles105.
La musique de Gesualdo nous est devenue plus proche, et sa figure étrangement plus lointaine : il est devenu un « personnage », quasi théâtral. Dans Les portes de la perception 1954, Aldous Huxley voyait déjà en lui un personnage fantastique digne d'un mélodrame de Webster.
Plusieurs opéras ont été consacrés à la figure mystérieuse et à l'existence agitée du compositeur :
Maria di Venosa de Francesco d'Avalos 1992, prince d'Avalos et lointain parent de la première épouse de Gesualdo,
Gesualdo d'Alfred Schnittke 1993, sur un livret de Richard Bletschacher,
Gesualdo de Franz Hummel 1996,
Le prince de Venosa de Scott Glasgow 1998,
Luci mie traditrici de Salvatore Sciarrino 1998 en deux actes, sur un texte du compositeur et inspiré par Il tradimento per l'onore de Giacinto Andrea Cicognini (1664),
Gesualdo de Bo Holten 2003,
Gesualdo de Marc-André Dalbavie 2010, sur un livret de Richard Millet.
Hommages
Dans le domaine de la littérature, Anatole France évoqua le meurtre de la première femme de Gesualdo dans Le Puits de Sainte-Claire 1875. La vie du compositeur fut ensuite romancée dans Madrigál trad. française Madrigal de l'écrivain hongrois László Passuth 1968, trad. française 1971 et Le Témoin de poussière de Michel Breitman prix des Deux-Magots 1986.
Mort à cinq voix, un docu-fiction réalisé par Werner Herzog en 1995, évoque la vie tourmentée, la légende et l'œuvre visionnaire du compositeur, de manière plus romancée fondée sur des témoignages d'habitants actuels de Naples, de Gesualdo, et de descendants des familles princières impliquées dans le meurtre de Maria d'Avalos qu'historiquement juste ou rigoureux
Liens
http://youtu.be/Fs_AgCTovik Musique sacrée à 5 voix
http://youtu.be/CoQCPSlQsVs Quinto libro di madigali - La Venexiana
http://youtu.be/nz16thVOuxQ Gesualdo - O Doloroso Giogia - Nenna, Montella, Luzzaschi
http://youtu.be/i3JwLnK6Efw Miserere
http://youtu.be/Zx8pv5PZqj4 "Plange quasi virgo".m4v
http://youtu.be/JZAs9LjJAHU Tristis est anima mea
http://youtu.be/J803Db6sqYY Sacrae Cantiones I 17 Tribulationem et dolorem - Score
 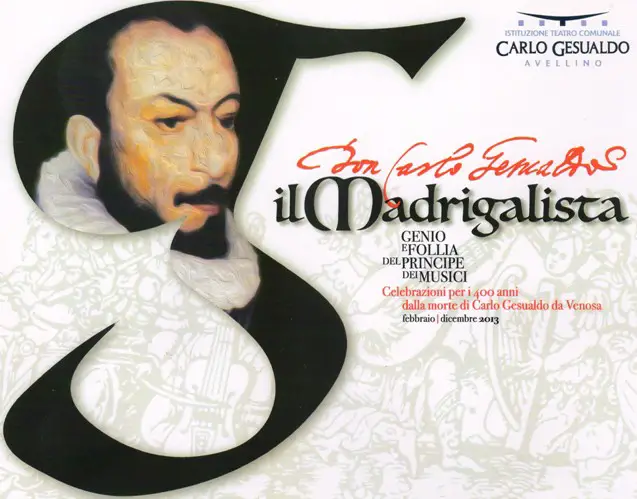 
Posté le : 08/09/2013 00:18
|
|
|
|
|
Re: Les belgicismes |
|
Modérateur  
Inscrit:
11/01/2012 16:10
De Rivière du mât
Niveau : 23; EXP : 75
HP : 0 / 568
MP : 227 / 20726
|
A l'occasion fais-nous donc un petit article sur l'essuie, censé, à ce que j'ai compris, se trouver dans toute salle de bain belge qui se respecte, et dont l'utilisateur sait d'instinct ce que ça essuie.
Nous en France on est moins malins, on a besoin d'un suffixe ("glace", ou "mains", voire "tout") pour être renseignés sur l'usage exact de l'objet.
Bien à toi.
Posté le : 07/09/2013 22:11
|
|
|
|
|
Frédéric Mistral |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 8 septembre 1830 naît Frédéric Mistral Poète
écrivain et lexicographe français de langue d'oc, il naît à Maillane dans les Bouches-du-Rhône, où il est mort le 25 mars 1914 et où il est inhumé.
Mistral fut membre fondateur du Félibrige, membre de l'Académie de Marseille, Maîtres ès-Jeux de l'Académie des Jeux floraux de Toulouse et, en 1904, Prix Nobel de littérature.
Son nom en provençal est Frederi Mistral (ou Mistrau).
Mistral n'est pas, comme on l'a dit, le poète de la Provence. Il est le poète d'une idée de la Provence.
À cette idée, il a consacré sa vie d'homme et voué son œuvre d'écrivain. Pour illustrer et défendre cette idée, il a élaboré ce que ses disciples ont appelé la doctrine mistralienne, doctrine assez fluctuante pour que des familles d'esprit fort différentes aient pu se réclamer de lui.
Quel que soit le jugement porté sur l'influence intellectuelle de Mistral, une chose est assurée : il a pris place parmi les grands poètes de l'humanité.
Il aurait pu devenir notaire, avocat, magistrat, député, ministre peut-être.
Mais ne supportant pas de voir sa langue maternelle reléguée au rang de patois, Frédéric Mistral préfère se faire poète. Mieux encore ! Il fait voeu de restaurer son idiome par la poésie, se faisant l'apôtre des pays d'Oc.
De tous les grands écrivains et poètes, il est le seul au monde qui, par la poésie chantant sa province et composée dans sa langue régionale répudiée par les écoles de France, ait été couronné du prix Nobel de Littérature.
Au fil des ans, si le nom du Mistral survit, le souvenir de son oeuvre s'estompe.
Les écoles ont depuis longtemps évincé ses écrits. Pour cause : ses poèmes et sa prose, dont toute la sève coule de sa langue maternelle, sont exagérément rangés sur les étagères des langues minoritaires, du folklore. Aussi, chaque citation, chaque article, chaque ouvrage nouveau s'élève en barricade contre l'oubli de sa mémoire, contre l'oubli d'une langue, contre l'oubli tout simplement.
Sa vie
Sa famille, ancienne et anoblie, originaire du Dauphiné, était fixée à Saint-Remy de Provence depuis le XVIe siècle.
Il naquit du second mariage d'un propriétaire rural qui avait été aux guerres de la République et faisait valoir son bien. Il est le fils de ménagers aisés : François Mistral et Adélaïde Poulinet, par lesquels il est apparenté aux plus anciennes familles de Provence : Cruvelier, Expilly, Roux nés Ruffo di Calabria, elles-mêmes très étroitement apparentées entre elles ; marquis d'Aurel.
Mistral porte le prénom de Frédéric en mémoire "d'un pauvre petit gars qui, au temps où mon père et ma mère se parlaient, avait fait gentiment leurs commissions d'amour, et qui, peu de temps après, était mort d'une insolation."
Il a conté lui-même sa jeunesse biblique dans le mas de ce patriarche, avec une émotion large et simple qui en fait le récit inoubliable comme un poème légendaire , préface des Iles d'or, 1re éd.,1875.
Son éducation dans ce milieu traditionnel, parmi ces moeurs antiques, fut exceptionnellement populaire.
Son père, qui l'avait eu à cinquante-cinq ans, était pour lui le Sage, le Maître austère et vénéré. Sa jeune mère l'éleva tout près d'elle, avec la poésie d'une âme chrétienne, hantée de rêves et de douces chansons.
Vers dix ans, après cette libre et saine enfance parmi les travailleurs des champs, il fut mis à l'école, puis envoyé dans un pensionnat d'Avignon pour y faire ses études classiques.
D'abord tristement dépaysé, le petit Provençal ne tardait pas à s'attacher aux peintures des poètes anciens où il retrouvait les tableaux éternels de la vie rurale.
Il y pratiqua lou plantié, école buissonnière comme il le narre dans ses Memòri e raconte, où au chapitre IV, il part cueillir des fleurs de glai, des iris d'eau pour sa mère.
Puis, en 1839, il est inscrit au pensionnat de Saint-Michel-de-Frigolet. Il n'y resta que deux ans, cet établissement ayant fermé, et fut placé au pensionnat Millet d'Avignon.
En 1845, il fut logé au pensionnat Dupuy, où entrait dans ce pensionnat, comme professeur, un jeune homme de Saint-Remy, Joseph Bonmanille, qui écrivait des vers provençaux.
Il avait fait ses premières armes dans un recueil périodique de Marseille, Lou Boui-abaisso, où il s'était bien vite distingué par son souci des sujets nobles et de l'épuration linguistique.
On ne peut guère faire exception, parmi les innombrables rimeurs provençaux du Boui-abaisso, dans cette préoccupation de la dignité de la langue et du style, que pour lui et Crousillat, de Salon, qui "retrempait déjà sa lame dans les fontaines antiques", a dit Mistral.
Mais Crousillat devait rester un rêveur et un isolé, tandis que Roumanille était impatient d'action.
Dès L'âge de douze ans, Mistral, instinctivement révolté du mépris où il voyait tenu son parler natal par les fils de bourgeois qui l'entouraient, s'était essayé en cachette à des vers provençaux.
Sa rencontre avec Roumanille, qui avait fait ses preuves, décida de sa vocation. Roumanille achevait alors ses Margarideto en 1847.
Durant cette période, il suivit ses études au Collège royal d'Avignon, dans l'actuelle rue Frédéric Mistral, et passa, en 1847, son baccalauréat à Nîmes.
Reçu bachelier, il fut enthousiasmé par la révolution de 1848 et se prit d'admiration pour Lamartine.
Ce fut au cours de cette année qu'il écrivit Li Meissoun, Les Moissons, poème géorgique en quatre chants, qui resta inédit6.
Sa famille le voyant bien devenir avocat, il étudia le droit à Aix-en-Provence de 1848 à 1851, où il sortit de la Faculté avec sa licence en droit.
Il se fait alors le chantre de l'indépendance de la Provence et surtout du provençal " première langue littéraire de l'Europe civilisée".
C'est au cours de ses études de droit qu'il apprit l'histoire de la Provence, jadis État indépendant.
Émancipé par son père, il prit alors la résolution « de relever, de raviver en Provence le sentiment de race … ; d'émouvoir cette renaissance par la restauration de la langue naturelle et historique du pays … ; de rendre la vogue au provençal par le souffle et la flamme de la divine poésie.
Pour Mistral, le mot race désigne un "peuple lié par la langue, enraciné dans un pays et dans une histoire" .
L'éveil du provençal
A peine m'eut-il montré, dans leur nouveauté printanière, ces gentilles fleurs de pré, a écrit Mistral dans préface des Îles d'or, qu'un beau tressaillement s'empara de mon être et je m'écriai : Voilà l'aube que mon âme attendait pour s'éveiller à la lumière! J'avais bien jusque-là lu quelque peu de provençal, mais ce qui me rebutait, c'était de voir que notre langue était toujours employée en manière de dérision ... Roumanille, le premier sur la rive du Rhône, chantait, dans une forme simple et fraîche, tous les sentiments du coeur .... Embrasés tous les deux du désir de relever le parler de nos mères, nous étudiâmes ensemble les vieux livres provençaux et nous nous proposâmes de restaurer la langue selon ses traditions et caractères nationaux ; ce qui s'est accompli depuis avec l'aide et le bon vouloir de nos frères les félibres."
A l'exemple de Roumanille, Mistral, rentré à Maillane, ses classes terminées, s'essaya donc en provençal, et rima un poème en quatre chants, Li Meissoun en 1848.
Il en a conservé quelques strophes parmi les notes de Mireille et dans les Îles d'or. Mais son père, devinant que la vocation le portait plus aux travaux de l'esprit qu'à l'agriculture, l'envoya faire son droit à Aix-en-Provence. Il y retrouva le premier confident de ses rêves, Anselme Mathieu, poète comme lui. C'était le compagnon songeur, naïf et soumis qu'il fallait à ce futur chef de peuple.
Les trois ans fructueux passés à étudier et à rêver, dans la vieille capitale de la Provence, confirmèrent chez Mistral la résolution d'honorer son pays en restituant au provençal sa dignité perdue.
Roumanille groupait alors tous les poètes vivants de langue d'oc dans le feuilleton d'un petit journal d'Avignon, la Commune.
Sa culture classique, entée sur un vif instinct populaire, devait communiquer à tant d'éléments disparates l'impulsion directrice et l'épuration critique nécessaires à une restauration. Son disciple Mistral, devenu le confident et l'intelligent auxiliaire de ses projets, ne tardait pas à concevoir un réveil national par la réhabilitation de l'idiome de son pays.
C'est ce qu'un éminent lettré, ami et conseiller de Roumanille, Saint-René Taillandier, pressentait déjà dans ces lignes d'une lettre (1851) :
"Je comprends que vous soyez forcés d'admettre de braves gens qui ont plus de bonne volonté que d'inspiration; mais la colère de M. Mistral me charme: voilà un vrai poète qui prend au sérieux comme vous cette renaissance de la poésie provençale. Il sent vivement les tristes destinées de cette langue qui a donné l'essor à toutes les littératures nationales de l'Europe, et il siffle les mauvais poètes. Voilà un digne héritier des maîtres du XIIe siècle."
Roumanille et Mistral publièrent ainsi le premier recueil collectif des poètes d'oc, Li Prouvençalo (1852).
Roumanille les avait rassemblés; Mistral, avec les deux courts poèmes qui encadraient le choeur, semblait conduire la campagne, tandis que Saint-René Taillandier, en une chaleureuse introduction, savante pour l'époque, justifiait litterairement l'entreprise, en invoquant les droits séculaires de la langue ressuscitée.
De cette publication sortit le premier "congrès des poètes provençaux", à Arles, 1852, où plus de trente écrivains "patois" répondirent à l'appel de Roumanille. Celui-ci ne tardait pas à publier le manifeste attendu relatif à la réforme orthographique, préface des Sounjarello, 1852, question capitale pour l'établissement de la restauration linguistique. Mistral avait collaboré à la dissertation : l'orthographe rationnelle en sortait à peu près fixée.
-
Frédéric Mistral 1830-1914.
Un nouveau congrès, dû à l'initiative de J.-B. Gaut, eut lieu à Aix-en-Provence, 1853, suivi d'un nouveau recueil collectif, Lou Roumavagi dei Troubaire. Ainsi s'appelaient encore les rénovateurs provençaux. Mistral leur donna le nom mystérieux de félibres, dans l'assemblée restée légendaire de Fontségugne, le 21 mai 1854. C'est là qu'entre sept poètes amis, du pays d'Avignon, furent jetées les bases de la renaissance linguistique, littéraire et sociale du Midi, appelée dès ce jour Félibrige.
Elle se manifesta d'abord par la fondation, due à Théodore Aubanel, 1854, d'un organe populaire, l'Armana prouvençau. Roumanille et Mistral devaient, pendant plus de quarante ans, en être les principaux rédacteurs, y faire évangéliquement l'éducation de leur peuple, et, joyeux ou graves, sincères toujours, lui enseigner son âme.
Tout en collaborant à l'Armana, et en étudiant le passé provençal Mistral incarnait le rêve de sa jeunesse dans une création où se reflétaient peu à peu les mille aspects de nature et de moeurs de son pays natal, transfigurés par la divine exaltation de son coeur.
C'était Mirèio en 1859, poème en 12 chants, vaste idylle épique où la Provenceput saluer son poète, et la France découvrir, dans le génie d'un inconnu, des trésors ignorés de son propre génie. Pour les félibres eux-mêmes, ce fut une révélation.
Adolphe Dumas et Reboul se firent les parrains de Mireille, qui, présentée par eux à Lamartine, éveilla l'émotion solennelle chez le vieil Orphée endormi. Tout le mondes sait quel baptême de gloire fut pour Mistral l'"Entretien littéraire que lui consacra Lamartine :
"Un grand poète épique est né! ... Un vrai poète homérique dans ce temps-ci; un poète né, comme les hommes de Deucalion, d'un caillou de la Crau; un poète primitif dans notre âge de décadence; un poète grec à Avignon ; un poète qui crée une langue d'un idiome, comme Pétrarque a créé l'italien : un poète qui, d'un patois vulgaire, fait un langage classique d'images et d'harmonie, ravissant l'imagination et l'oreille."
Et à ces litanies géniales succédait un. enthousiaste résumé de Mireille, confirmé par ces conclusions :
" Oui, ton poème épique est un chef-d'oeuvre, que dirais-je plus? il n'est pas de l'Occident, il est de l'Orient; on dirait que, pendant la nuit, une île de l'Archipel, une flottante Délos, s'est détachée de son groupe d'îles grecques ou ioniennes et qu'elle est venue sans bruit s'annexer au continent de la Provence embaumée, apportant avec elle un de ces chanteurs divins de la famille des Mélésigènes".
Tout a été dit sur l'art concis, sobre, attique, simple et savant, éloquent et objectif de l'incomparable poème rustique. Mais il est un côté de cette couvre, genuine entre toutes, que la généralité des critiques, étrangers à la Provence pour la plupart, n'a su ni pu comprendre. C'est la poésie propre au au pays provençal, ce que les troubadours nommaient amor.
Telle chose qui paraît grossière ou vulgaire au lecteur parisien fait tressaillir un Provençal. La vue des collines bibliques du pays arlésien, "cette aridité aromatique qui enivre les ermites et suscite les mirages ", comme a dit Mistral, peut offusquer un franchimand : elle exalte un coeur méridional... Ce qu'on aura, du moins, reconnu sans conteste à Mistral et à ses meilleurs disciples, c'est l'originalité : ils évitent les banalités générales; ce qu'ils ont chanté n'était pas encore dans l'horizon.
Mireille
L'unanimité des suffrages accordés à Mireille sanctionnait la renaissance provençale, donnait à Mistral lui-même la foi résolue en sa mission.
Jusque-là, il avait pu dire, comme dans l'invocation du poème, "qu'il ne chantait que pour les pâtres et les gens des mas" . - "Qu'en dira-t-on en Arles ?" pensait-il anxieux en composant Mireille.
Mais l'aspect de l'oeuvre achevée élargit l'ambition qu'il avait formée pour sa langue. Les notes de Mireille en témoignent.
Déjà la conscience du rôle, qu'il pouvait apporter à l'oeuvre de Fontségugne lui était apparue.
L'école de Roumanille, dont Mireille le sacrait chef et prophète, faisait chaque jour plus d'adeptes.
La langue était fixée, créée la "langue des félibres", et, grâce à l'Armana, peu à peu adoptée par le peuple, ce vulgaire illustre dont, nouveau Dante, il avait doté son pays en épurant et enrichissant son dialecte natal, était immortel ayant suscité un chef-d'oeuvre.
Il restait à imprimer au mouvement une direction "nationale".
C'est en exaltant le sentiment régional et en y entraînant les félibres, c'est en prouvant à son pays l'existence d'une culture méridionale à travers les siècles, c'est en mettant en lumière les droits imprescriptibles de son peuple, qu'il est parvenu à faire d'une renaissance littéraire une "Cause" sociale.
Avec l'Ode aux Catalans en 1859 et le Chant de la Coupe Mistral scella le rapprochement des Provençaux et des Catalans, leurs frères de langue; son sirvente fameux, et resté longtemps suspect, de la Comtesse, allégorie véhémente à la Centralisation; ses discours aux jeux floraux d'Apt en 1862, première sortie officielle des félibres, où fut rédigé le premier statut de l'association, de Barcelone en 1868, alors qu'il accourait avec Roumieux, Paul Meyer et Bonaparte Wyse à l'appel de la Catalogne ressuscitée, enfin de Saint-Remy, la même année, devant les Catalans chaudement accueillis à leur tour et la presse parisienne convoquée pour la première fois.
Ainsi, du félibrige populaire de Roumanille, - engendré par ses pamphlets politiques, ses Noëls et ses Contes, - Mistral faisait peu à peu un félibrige national. Ceci était apparu clairement dans son second ouvrage, Calendau, poème en douze chants 1867, qui, pour les Provençaux, balançait désormais la gloire de Mireille.
Mais combien différents, les deux poèmes!
Mireille, c'était la Provence de la Crau, de la Camargue et du Rhône; Calendal, la Provence de la montagne et de la mer.
Mireille c'était le miel vierge, Calendal la moelle du lion. Célébrant les hauts faits d'un jeune pêcheur de Cassis pour la délivrance et l'amour d'Esterelle, dernière princesse des Baux, mariée à l'infâme aventurier Severan, Mistral avait tenté de peindre tout le paysage, trop vaste, cette fois, de son Iliade agreste, en accumulant les évocations nostalgiques et passionnées du passé provençal.
Ce souci oratoire et encyclopédique, écueil des plus grands poètes, avec la longueur d'un récit qui en rendait peut-être inharmonique l'ordonnance, restreignirent le succès de Calendal dans le public, malgré l'incomparable maîtrise de l'exécution.
Peu à peu, grâce à l'impulsion souveraine de Mistral, le félibrige passait le Rhône.
Après avoir suscité de chauds prosélytes comme Louis Roumieux et Albert Arnavielle, à Nîmes et à Alès, il provoquait à Montpellier, par les soins du baron de Tourtoulon et de son groupe, la création d'une Société pour l'élude des langues romanes, dont les travaux devaient justifier scientifiquement ce relèvement de la langue d'oc (occitan).
Fort de l'appui des savants et des lettrés officiels, jusque-là réfractaires, le mouvement félibréen, déjà catalan-provençal, ne tardait pas à devenir latin. La fête mémorable du centenaire de Pétrarque à Avignon en 1874, due à l'initiative de Berlue-Pérussis et effectivement présidée par Aubanel, fut la première consécration internationale de la nouvelle littérature, et de la gloire de Mistral.
Un grand concours philologique de la Société romane en 1875, puis les Fêtes Latines de Montpellier en 1878, où la jeune femme du poète fut proclamée reine du félibrige, affirmèrent définitivement l'importance d'une renaissance poétique, familiale à ses débuts, que le père de Calendal et de Mireille avait élargie aux proportions d'un mouvement social.
Trois ans auparavant, la royauté intellectuelle de Mistral s'était imposée à tout le midi de la France par la publication du recueil de ses poésies, Lis Iselo d'or (les Îles d'or, 1875), où éclatait le génie du maître dans sa sérénité, sa variété puissante et son autorité de représentant d'un peuple.
Peu après, le félibrige s'organisait en Avignon, 1876, et le poète proclamé grand maître : capoulié de la fédération littéraire des provinces méridionales, devenait, aux yeux des initiés, le chef incontesté d'une croisade de l'Occitanie pour la reconquête de sa dignité historique.
L'espèce de pontificat dont il était désormais investi n'arrêtait pas l'essor de sa production. Un nouveau poème, de forme plus légère, dans le style des épopées chevaleresques de la Renaissance, Nerto, chronique d'histoire provençale du temps des papes d'Avignon, ramenait soudain sur Mistral l'attention de la critique, pour la séduction et l'infinie souplesse de son génie. Après s'être vu comparer à Homère, à Théocrite et à Longus, il évoquait maintenant le charme fuyant d'Arioste.
Un voyage qu'il faisait à Paris en 1884, après vingt ans d'absence, mettait le sceau à sa notoriété française et à sa gloire provençale. Il apparut environné d'une armée d'adeptes. Paris, qui ne connaissait que le poète, salua une littérature dans la personne de son chef.
L'Académie française couronna Nerte comme jadis Mireille. Mistral n'hésita pas à célébrer devant la capitale le quatrième centenaire de la réunion de la Provence à la France : "Comme un principal à un autre principal", selon les termes du contrat historique.
Et il rentra dans sa Provence, consacré chef d'un peuple.
Renaissance provençale
La Renaissance provençale s'étendait chaque jour.
Mistral lui donnait enfin l'instrument scientifique et populaire qui lui manquait pour sa défense, le dictionnaire de son langage national. C'était l'oeuvre bénédictine de sa vie, le Trésor du félibrige. Les divers dialectes d'oc sont représentés dans ce prodigieux inventaire d'un idiome illustre, riche, harmonieux, bien vivant, sauvé et restitué dans son honneur ethnique par d'intransigeants défenseurs, au moment où tout conspirait pour hâter sa décrépitude. Toutes les acceptions, accompagnées d'exemples tirés de tous les écrivains d'oc, tous les termes spéciaux, tous les proverbes sont patiemment recueillis dans ce répertoire encyclopédique qu'on ne remplacera pas. L'Institut lui attribua un prix de 10.000 F.
En 1890, Mistral publia une oeuvre dramatique longtemps caressée, la Rèino Jano, "tragédie provençale".
Malgré son éloquence picturale et la rare beauté de quelques chansons qui reposent le lecteur de l'alexandrin monotone, cette « suite » lumineuse d'évocations de la Provence angevine du XIVe siècle n'obtint auprès du public que le demi-succès de Calendal.
Les franchimands n'ont pas comme les félibres la religion de la reine Jeanne.
Si cette tragédie, essentiellement nationale pour les Provençaux, fut jugée à Paris médiocrement dramatique, il en faut attribuer le reproche à ce qu'on n'a pas tenu compte à l'auteur de la popularité familière qu'il accorde à la légende de son héroïne parmi son public naturel.
En attendant, de voir représenter sa Reine Jeanne sur le théâtre d'Orange restauré par les félibres, Mistral poursuivait sa tâche de poète d'action. La cause s'étendait, appelant des organes plus vivants que le livre ou l'almanach.
Après avoir contribué pendant quarante ans au succès de l'Armana prouvençau et présidé à la fondation de la Revue félibréenne en 1885, il se fit rédacteur principal d'un journal provençal d'Avignon, l'Aioli, créé en 1890, devenu par ses soins le moniteur trimensuel du félibrige.
Tout en gardant ainsi la direction effective du mouvement méridional, - officiellement présidé par Roumanille de 1888 à 1891 et depuis sa mort par Félix Gras, - Mistral publiait çà et là quelque chapitre de ses futurs Mémoires, quelque exhortation à son peuple, discours, poésie ou chronique.
Enfin il donnait le jour à un nouveau poème, sept ans porté comme les précédents, le Poème du Rhône, 1897.
C'est à la fois le plus raffiné et le plus ingénument épique de ses livres.
Capital dans son oeuvre, tant pour la profondeur et l'étendue de la pensée que pour l'originalité de la versification, il apparaît aussi comme le plus symbolique de son génie.
C'est avec les traditions d'un pays qu'il a tramé la soie chatoyante, vivante, éternelle du Rhône, ce poème du cours d'un fleuve. Ces traditions, il a exalté son peuple à en restaurer l'honneur par l'exemple radieux, le labeur fécondant de sa vie.
Et son génie même de poète, clair, lumineux, limpide, avec ses regrets du passé, telle l'inconsciente nostalgie des Alpes qui, par un lointain atavisme, hante sa sérénité, ce génie, autant que provençal, n'est-il pas rhodanien?
On en connaîtra mieux les racines profondes par les Mémoires qui paraîtrront en 1906 sous le titre de Moun espelido, Memòri e Raconte. Dans un exposé de sa vie harmonieuse, il dira tous ses souvenirs d'écrivain célèbre et de campagnard provençal. Des portraits de grands hommes et de grands paysans se dresseront dans son récit. D'autres ouvrages paraîtront encore; Discours e dicho en 1906, Lis óulivado en 1912.
Fin de vie
Entre-temps, Mistral aura été couronné du prix Nobel de Littérature en1904. Il consacrera le montant de ce prix à la création du Museon Arlaten à Arles.
Frédéric Mistral y habita jusqu'en 1875, année ou il put aménager dans la maison qu'il avait faite construire à Maillane, juste devant la Maison du Lézard.
Un an plus tard, le 27 septembre 1876, il épousait à Dijon, Marie Louise Aimée Rivière.
Ce fut ici qu'ils vécurent.
Frédéric Mistral y meurt le 25 Mars 1914.
La maison devint, après la mort du poète le 25 mars 1914 et celle de sa veuve, le 6 février 1943, le Museon Frederi Mistral.
Dans son testament du 7 septembre 1907, Mistral avait légué à sa commune de Maillane, sa maison avec les terrains, jardin, grille, murs, remise et constructions qui l'entourent ou en dépendent... avec les objets d'art, les tableaux, les gravures, les livres et la bibliothèque qu'elle contient, afin qu'on en fasse le musée et la bibliothèque de Maillane, et aussi les meubles qui sont dans la maison à condition qu'ils n'en soient pas enlevés ». Il spécifiait en outre que la commune n'entrerait en possession qu'après la mort de son épouse.
Le Museon est classé monument historique depuis le 10 novembre 1930, son mobilier depuis le 10 février 1931, ce qui à permis à cette demeure de conserver l'aspect qu'elle avait du vivant de Frédéric Mistral5.
L'Action aura été son plus beau poème. C'est pour faire triompher cet idéal, le relèvement de sa Provence, qu'il a été tour à tour poète, orateur, philologue, mais surtout Provençal.
La vita nuova que son action latente infuse au corps apostolique du Félibrige, n'a pas seulement régénéré sa Provence, en l'érigeant à la hauteur d'un idéal social. Elle a provoqué une exaltation du sentiment provincialiste, devenue tendance générale en France, qu'on l'appelle fédéralisme ou simplement décentralisation. On sait les idées de Mistral sur ce régionalisme qui permettrait aux énergies locales de s'épanouir librement.
On ne devait y parvenir, selon lui, que par une Constituante, les élus du système actuel étant trop intéressés à ménager les répartitions départementales pour toucher au morcellement de l'abbé Sieyès.
Mais il a toujours refusé de devenir le chef effectif d'un mouvement politique.
"Qui tient sa langue tient la clef qui de ses chaînes le délivre ",
a-t-il dit, entendant bien que dans une langue vit l'âme même d'un peuple. Et, se réservant la direction du mouvement linguistique, il a voulu rester poète. C'est la pureté de sa gloire qui en aura fait la puissance.
Il n'est pas jusqu'à sa personne qui n'ait su conquérir les foules, alors que son oeuvre charmait les lettrés et le peuple.
Car il eut toujours le sens profond de la vitalité de sa langue, la foi dans un renouveau de sa gloire.
Tout différent en ceci de Jasmin qui se proclamait le dernier poète de la langue d'oc. Si Mistral n'est pas l'unique ouvrier de la renaissance provençale, du moins doit-elle à son oeuvre d'avoir pu prendre essor et de vivre.
Félibre mainteneur depuis 2006, Gérard Baudin fonde dès 1979 le Conservatoire documentaire et culturel Frédéric Mistral. Auteur de nombreux ouvrages d'histoire locale et régionale, il est également le créateur de la revue Échos de Provence. La curiosité de l'auteur et sa soif de rassembler une collection complète sur le père du Félibrige permettent de présenter ici la première biographie illustrée de Frédéric Mistral.
Son oeuvre
Par son œuvre, Mistral réhabilite la langue d'oc en la portant aux plus hauts sommets de la poésie épique : la qualité de cette œuvre sera consacrée par les plus hauts prix.
Il se lance dans un travail de bénédictin pour réaliser un dictionnaire et, à l'instar des troubadours, écrire des chants, et des romans en vers, à l'imitation d'Homère, comme il le proclame dans les quatre premiers vers de Mirèio, se définissant comme un humble élève du grand Homère:
"Cante uno chato de Prouvènço,
Dins lis amour de sa jouvènço,
A través de la Crau, vers la mar, dins li blad,
Umble escoulan dóu grand Oumèro, iéu la vole segui."
"Je chante une jeune fille de Provence,
Dans les amours de sa jeunesse,
À travers la Crau, vers la mer, dans les blés,
Humble élève du grand Homère."
Lexicographie : Lou Tresor dóu Felibrige
Frédéric Mistral et le Félibrige
Mistral est l'auteur du Tresor dóu Felibrige , qui reste à ce jour le dictionnaire le plus riche de la langue d'oc, et l'un des plus fiables pour la précision des sens. C'est un dictionnaire bilingue provençal-français, en deux grands volumes, englobant l'ensemble des dialectes d'oc.
Mireille et le prix Nobel de 1904
" Mirèio".
Son œuvre capitale est Mirèio Mireille, publiée en 1859 après huit ans d'effort créateur.
Mirèio, long poème en provençal, en vers et en douze chants, raconte les amours contrariées de Vincent et Mireille, deux jeunes provençaux de conditions sociales différentes. Le nom Mireille, Mirèio en provençal, est un doublet du mot "meraviho" qui signifie "merveille ".
Mistral trouve ici l'occasion de proposer sa langue mais aussi de faire partager la culture d'une région en parlant entre autres des Saintes-Maries-de-la-Mer, qui d'après la légende auraient chassé la Tarasque, et de la fameuse Vénus d'Arles.
Mistral fait précéder son poème par un court Avis sur la prononciation provençale.
Mireille, jeune fille à marier d'un propriétaire terrien provençal tombe amoureuse de Vincent, un pauvre vannier qui répond à ses sentiments.
Après avoir repoussé trois riches prétendants, Mireille, désespérée par le refus de ses parents de la laisser épouser Vincent, court aux Saintes-Maries-de-la-Mer afin de prier les patronnes de la Provence de fléchir ceux-ci.
Mais ayant oublié de se munir d'un chapeau, elle est victime d'une insolation en arrivant au but de son voyage et meurt dans les bras de Vincent sous le regard de ses parents.
Mistral dédie son livre à Alphonse de Lamartine en ces termes :
Vincent et Mireille, par Victor Leydet
Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature à la une du magazine Le Petit Journal en 1904 :
"À Lamartine
Je te consacre Mireille : c'est mon cœur et mon âme ;
C'est la fleur de mes années ;
C'est un raisin de Crau qu'avec toutes ses feuilles
T'offre un paysan ".
Et Lamartine de s'enthousiasmer : "Je vais vous raconter, aujourd'hui, une bonne nouvelle ! Un grand poète épique est né. …Un vrai poète homérique, en ce temps-ci ; ... Oui, ton poème épique est un chef d'œuvre ; … le parfum de ton livre ne s'évaporera pas en mille ans."
Mirèio a été traduite en une quinzaine de langues européennes, dont le français par Mistral lui-même.
En 1863, Charles Gounod en fait un opéra.
Le prix Nobel de littérature attribué à Frédéric Mistral, en 1904, pour Mirèio récompensait une œuvre en langue d’oc, langue minoritaire en Europe et constitue de ce fait une exception.
Déjà, en 1901, lors de la première session du prix Nobel de littérature, il faisait figure de favori fort du soutien des intellectuels romanistes de l'Europe du Nord dont l'Allemagne.
Pourtant, en dépit des rumeurs qui couraient, le comité suédois décerna le premier Nobel à Sully Prudhomme, candidat officiel de l'Académie française10.
Élu en 1904, le prix faillit pourtant lui échapper à cause d'une mauvaise traduction suédoise de son œuvre.
Il dut cependant partager sa distinction avec José Echegaray.
Son prix Nobel qui récompensait une langue minoritaire, resta unique jusqu'en 1978, où Mistral fut rejoint par Isaac Bashevis Singer pour son œuvre écrite en Yiddish. L’Académie suédoise accompagna l'attribution du Nobel à Mistral en ces termes :
"en considération de sa poésie si originale, si géniale et si artistique, ..., ainsi qu’en raison des travaux importants dans le domaine de la philologie provençale".
La légitimité poétique de la langue provençale était reconnue à l’échelle internationale puisque le prix Nobel signalait sa valeur universelle et la sortait de l’a priori régionaliste.
Principales œuvres
Mirèio (1859) - en ligne graphie mistralienne, graphie classique - version française
Calendau (1867) - en ligne
Coupo Santo (1867)
Lis Isclo d’or (1875) - en ligne : partie I, partie II
Lou Tresor dóu felibrige ou Dictionnaire de provençal-français, (1879) - [1]
Nerto, nouvelle (1884) - en ligne
La Rèino Jano, drame (1890) - en ligne
Lou Pouèmo dóu Rose (1897) - en ligne
Moun espelido, Memòri e Raconte (Mes mémoires) (1906) - en ligne
Discours e dicho (1906) - en ligne
La Genèsi, traducho en prouvençau (1910) - en ligne
Lis óulivado (1912) - en ligne
Proso d’Armana (posthume) (1926, 1927, 1930) - en ligne
Postérité
Sa célébrité doit beaucoup à Lamartine qui chante ses louanges dans le quarantième entretien de son Cours familier de littérature, à la suite de la parution du long poème Mirèio.
Alphonse Daudet, avec qui il était lié d'amitié, lui consacre, d'une manière fort élogieuse, l'une de ses Lettres de mon moulin, Le Poète Mistral11.
Plusieurs établissements scolaires portent son nom comme le Lycée Mistral d'Avignon. De nombreuses voies portent aussi son nom, à Nice, Aix-en-Provence, Saint-Gence, Noiseau, Figeac etc.
Musée Frédéric-Mistral
Musée Frédéric-Mistral sa maison de Maillane ou il vécut de 1876 à sa mort en 1914.
(Ouvert tous les jours sauf les lundis et jours fériés
Philatélie
En 1941, la poste émet un timbre postal de 1 franc, brun carminé.
En 1980, la poste émet un deuxième timbre postal grand format de 1,40 franc surtaxé 30 centimes, noir qui fait partie de la série Personnages célèbres
Numismatique
L'écrivain est l'effigie d'une pièce de 10 € en argent éditée en 2012 par la Monnaie de Paris, pour la collection « Les Euros des Régions » afin de représenter la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région où il a vécu.
- diverses Voies, collèges, bibliothèques ... portent le nom de Frédéric Mistral
Sites, lieux et établissements portant le nom de Frédéric Mistral
Citations
-Les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut.
-Les cinq doigts de la main ne sont pas tous égaux.
-Quand le Bon Dieu en vient à douter du monde il se rappelle qu'il a créé la Provence.
-Chaque année, le rossignol revêt des plumes neuves, mais il garde sa chanson.
-Le soleil semble se coucher dans un verre de Tavel aux tons rubis irisés de topaze. Mais c'est pour mieux se lever dans les cœurs.
-La Provence chante, le Languedoc combat
-Qui a vu Paris et pas Cassis, n'a rien vu. (Qu'a vist Paris e noun Cassis a ren vist.)
Liens
http://youtu.be/l29GMGkiBio Hommage à F. Mistral à Maillane
http://youtu.be/VxgFVm2e-LA Frédéric Mistral
http://youtu.be/rxnAIv9v9OA Vincent et Mireille spectacle
http://youtu.be/EBM7Ubulg28 Mireille Marcel Amont
http://youtu.be/E_3sJ4r9nM4 Le chapeau de Mireille
 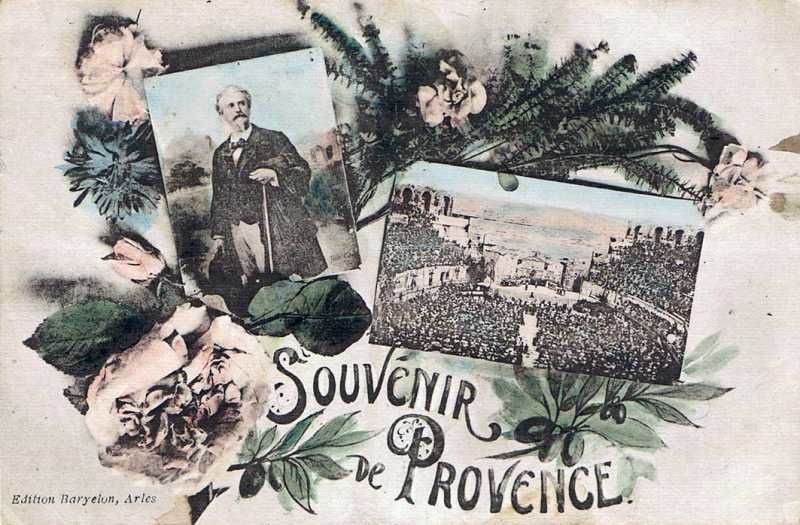
Posté le : 07/09/2013 20:42
Edité par Loriane sur 10-09-2013 10:31:58
|
|
|
|
|
Frédéric Mistral |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 8 septembre 1830 naît Frédéric Mistral Poète
écrivain et lexicographe français de langue d'oc, il naît à Maillane dans les Bouches-du-Rhône, où il est mort le 25 mars 1914 et où il est inhumé.
Mistral fut membre fondateur du Félibrige, membre de l'Académie de Marseille, Maîtres ès-Jeux de l'Académie des Jeux floraux de Toulouse et, en 1904, Prix Nobel de littérature.
Son nom en provençal est Frederi Mistral (ou Mistrau).
Mistral n'est pas, comme on l'a dit, le poète de la Provence. Il est le poète d'une idée de la Provence.
À cette idée, il a consacré sa vie d'homme et voué son œuvre d'écrivain. Pour illustrer et défendre cette idée, il a élaboré ce que ses disciples ont appelé la doctrine mistralienne, doctrine assez fluctuante pour que des familles d'esprit fort différentes aient pu se réclamer de lui.
Quel que soit le jugement porté sur l'influence intellectuelle de Mistral, une chose est assurée : il a pris place parmi les grands poètes de l'humanité.
Il aurait pu devenir notaire, avocat, magistrat, député, ministre peut-être.
Mais ne supportant pas de voir sa langue maternelle reléguée au rang de patois, Frédéric Mistral préfère se faire poète. Mieux encore ! Il fait voeu de restaurer son idiome par la poésie, se faisant l'apôtre des pays d'Oc.
De tous les grands écrivains et poètes, il est le seul au monde qui, par la poésie chantant sa province et composée dans sa langue régionale répudiée par les écoles de France, ait été couronné du prix Nobel de Littérature.
Au fil des ans, si le nom du Mistral survit, le souvenir de son oeuvre s'estompe.
Les écoles ont depuis longtemps évincé ses écrits. Pour cause : ses poèmes et sa prose, dont toute la sève coule de sa langue maternelle, sont exagérément rangés sur les étagères des langues minoritaires, du folklore. Aussi, chaque citation, chaque article, chaque ouvrage nouveau s'élève en barricade contre l'oubli de sa mémoire, contre l'oubli d'une langue, contre l'oubli tout simplement.
Sa vie
Sa famille, ancienne et anoblie, originaire du Dauphiné, était fixée à Saint-Remy de Provence depuis le XVIe siècle.
Il naquit du second mariage d'un propriétaire rural qui avait été aux guerres de la République et faisait valoir son bien. Il est le fils de ménagers aisés : François Mistral et Adélaïde Poulinet, par lesquels il est apparenté aux plus anciennes familles de Provence : Cruvelier, Expilly, Roux nés Ruffo di Calabria, elles-mêmes très étroitement apparentées entre elles ; marquis d'Aurel.
Mistral porte le prénom de Frédéric en mémoire "d'un pauvre petit gars qui, au temps où mon père et ma mère se parlaient, avait fait gentiment leurs commissions d'amour, et qui, peu de temps après, était mort d'une insolation."
Il a conté lui-même sa jeunesse biblique dans le mas de ce patriarche, avec une émotion large et simple qui en fait le récit inoubliable comme un poème légendaire , préface des Iles d'or, 1re éd.,1875.
Son éducation dans ce milieu traditionnel, parmi ces moeurs antiques, fut exceptionnellement populaire.
Son père, qui l'avait eu à cinquante-cinq ans, était pour lui le Sage, le Maître austère et vénéré. Sa jeune mère l'éleva tout près d'elle, avec la poésie d'une âme chrétienne, hantée de rêves et de douces chansons.
Vers dix ans, après cette libre et saine enfance parmi les travailleurs des champs, il fut mis à l'école, puis envoyé dans un pensionnat d'Avignon pour y faire ses études classiques.
D'abord tristement dépaysé, le petit Provençal ne tardait pas à s'attacher aux peintures des poètes anciens où il retrouvait les tableaux éternels de la vie rurale.
Il y pratiqua lou plantié, école buissonnière comme il le narre dans ses Memòri e raconte, où au chapitre IV, il part cueillir des fleurs de glai, des iris d'eau pour sa mère.
Puis, en 1839, il est inscrit au pensionnat de Saint-Michel-de-Frigolet. Il n'y resta que deux ans, cet établissement ayant fermé, et fut placé au pensionnat Millet d'Avignon.
En 1845, il fut logé au pensionnat Dupuy, où entrait dans ce pensionnat, comme professeur, un jeune homme de Saint-Remy, Joseph Bonmanille, qui écrivait des vers provençaux.
Il avait fait ses premières armes dans un recueil périodique de Marseille, Lou Boui-abaisso, où il s'était bien vite distingué par son souci des sujets nobles et de l'épuration linguistique.
On ne peut guère faire exception, parmi les innombrables rimeurs provençaux du Boui-abaisso, dans cette préoccupation de la dignité de la langue et du style, que pour lui et Crousillat, de Salon, qui "retrempait déjà sa lame dans les fontaines antiques", a dit Mistral.
Mais Crousillat devait rester un rêveur et un isolé, tandis que Roumanille était impatient d'action.
Dès L'âge de douze ans, Mistral, instinctivement révolté du mépris où il voyait tenu son parler natal par les fils de bourgeois qui l'entouraient, s'était essayé en cachette à des vers provençaux.
Sa rencontre avec Roumanille, qui avait fait ses preuves, décida de sa vocation. Roumanille achevait alors ses Margarideto en 1847.
Durant cette période, il suivit ses études au Collège royal d'Avignon, dans l'actuelle rue Frédéric Mistral, et passa, en 1847, son baccalauréat à Nîmes.
Reçu bachelier, il fut enthousiasmé par la révolution de 1848 et se prit d'admiration pour Lamartine.
Ce fut au cours de cette année qu'il écrivit Li Meissoun, Les Moissons, poème géorgique en quatre chants, qui resta inédit6.
Sa famille le voyant bien devenir avocat, il étudia le droit à Aix-en-Provence de 1848 à 1851, où il sortit de la Faculté avec sa licence en droit.
Il se fait alors le chantre de l'indépendance de la Provence et surtout du provençal " première langue littéraire de l'Europe civilisée".
C'est au cours de ses études de droit qu'il apprit l'histoire de la Provence, jadis État indépendant.
Émancipé par son père, il prit alors la résolution « de relever, de raviver en Provence le sentiment de race … ; d'émouvoir cette renaissance par la restauration de la langue naturelle et historique du pays … ; de rendre la vogue au provençal par le souffle et la flamme de la divine poésie.
Pour Mistral, le mot race désigne un "peuple lié par la langue, enraciné dans un pays et dans une histoire" .
L'éveil du provençal
A peine m'eut-il montré, dans leur nouveauté printanière, ces gentilles fleurs de pré, a écrit Mistral dans préface des Îles d'or, qu'un beau tressaillement s'empara de mon être et je m'écriai : Voilà l'aube que mon âme attendait pour s'éveiller à la lumière! J'avais bien jusque-là lu quelque peu de provençal, mais ce qui me rebutait, c'était de voir que notre langue était toujours employée en manière de dérision ... Roumanille, le premier sur la rive du Rhône, chantait, dans une forme simple et fraîche, tous les sentiments du coeur .... Embrasés tous les deux du désir de relever le parler de nos mères, nous étudiâmes ensemble les vieux livres provençaux et nous nous proposâmes de restaurer la langue selon ses traditions et caractères nationaux ; ce qui s'est accompli depuis avec l'aide et le bon vouloir de nos frères les félibres."
A l'exemple de Roumanille, Mistral, rentré à Maillane, ses classes terminées, s'essaya donc en provençal, et rima un poème en quatre chants, Li Meissoun en 1848.
Il en a conservé quelques strophes parmi les notes de Mireille et dans les Îles d'or. Mais son père, devinant que la vocation le portait plus aux travaux de l'esprit qu'à l'agriculture, l'envoya faire son droit à Aix-en-Provence. Il y retrouva le premier confident de ses rêves, Anselme Mathieu, poète comme lui. C'était le compagnon songeur, naïf et soumis qu'il fallait à ce futur chef de peuple.
Les trois ans fructueux passés à étudier et à rêver, dans la vieille capitale de la Provence, confirmèrent chez Mistral la résolution d'honorer son pays en restituant au provençal sa dignité perdue.
Roumanille groupait alors tous les poètes vivants de langue d'oc dans le feuilleton d'un petit journal d'Avignon, la Commune.
Sa culture classique, entée sur un vif instinct populaire, devait communiquer à tant d'éléments disparates l'impulsion directrice et l'épuration critique nécessaires à une restauration. Son disciple Mistral, devenu le confident et l'intelligent auxiliaire de ses projets, ne tardait pas à concevoir un réveil national par la réhabilitation de l'idiome de son pays.
C'est ce qu'un éminent lettré, ami et conseiller de Roumanille, Saint-René Taillandier, pressentait déjà dans ces lignes d'une lettre (1851) :
"Je comprends que vous soyez forcés d'admettre de braves gens qui ont plus de bonne volonté que d'inspiration; mais la colère de M. Mistral me charme: voilà un vrai poète qui prend au sérieux comme vous cette renaissance de la poésie provençale. Il sent vivement les tristes destinées de cette langue qui a donné l'essor à toutes les littératures nationales de l'Europe, et il siffle les mauvais poètes. Voilà un digne héritier des maîtres du XIIe siècle."
Roumanille et Mistral publièrent ainsi le premier recueil collectif des poètes d'oc, Li Prouvençalo (1852).
Roumanille les avait rassemblés; Mistral, avec les deux courts poèmes qui encadraient le choeur, semblait conduire la campagne, tandis que Saint-René Taillandier, en une chaleureuse introduction, savante pour l'époque, justifiait litterairement l'entreprise, en invoquant les droits séculaires de la langue ressuscitée.
De cette publication sortit le premier "congrès des poètes provençaux", à Arles, 1852, où plus de trente écrivains "patois" répondirent à l'appel de Roumanille. Celui-ci ne tardait pas à publier le manifeste attendu relatif à la réforme orthographique, préface des Sounjarello, 1852, question capitale pour l'établissement de la restauration linguistique. Mistral avait collaboré à la dissertation : l'orthographe rationnelle en sortait à peu près fixée.
-
Frédéric Mistral 1830-1914.
Un nouveau congrès, dû à l'initiative de J.-B. Gaut, eut lieu à Aix-en-Provence, 1853, suivi d'un nouveau recueil collectif, Lou Roumavagi dei Troubaire. Ainsi s'appelaient encore les rénovateurs provençaux. Mistral leur donna le nom mystérieux de félibres, dans l'assemblée restée légendaire de Fontségugne, le 21 mai 1854. C'est là qu'entre sept poètes amis, du pays d'Avignon, furent jetées les bases de la renaissance linguistique, littéraire et sociale du Midi, appelée dès ce jour Félibrige.
Elle se manifesta d'abord par la fondation, due à Théodore Aubanel, 1854, d'un organe populaire, l'Armana prouvençau. Roumanille et Mistral devaient, pendant plus de quarante ans, en être les principaux rédacteurs, y faire évangéliquement l'éducation de leur peuple, et, joyeux ou graves, sincères toujours, lui enseigner son âme.
Tout en collaborant à l'Armana, et en étudiant le passé provençal Mistral incarnait le rêve de sa jeunesse dans une création où se reflétaient peu à peu les mille aspects de nature et de moeurs de son pays natal, transfigurés par la divine exaltation de son coeur.
C'était Mirèio en 1859, poème en 12 chants, vaste idylle épique où la Provenceput saluer son poète, et la France découvrir, dans le génie d'un inconnu, des trésors ignorés de son propre génie. Pour les félibres eux-mêmes, ce fut une révélation.
Adolphe Dumas et Reboul se firent les parrains de Mireille, qui, présentée par eux à Lamartine, éveilla l'émotion solennelle chez le vieil Orphée endormi. Tout le mondes sait quel baptême de gloire fut pour Mistral l'"Entretien littéraire que lui consacra Lamartine :
"Un grand poète épique est né! ... Un vrai poète homérique dans ce temps-ci; un poète né, comme les hommes de Deucalion, d'un caillou de la Crau; un poète primitif dans notre âge de décadence; un poète grec à Avignon ; un poète qui crée une langue d'un idiome, comme Pétrarque a créé l'italien : un poète qui, d'un patois vulgaire, fait un langage classique d'images et d'harmonie, ravissant l'imagination et l'oreille."
Et à ces litanies géniales succédait un. enthousiaste résumé de Mireille, confirmé par ces conclusions :
" Oui, ton poème épique est un chef-d'oeuvre, que dirais-je plus? il n'est pas de l'Occident, il est de l'Orient; on dirait que, pendant la nuit, une île de l'Archipel, une flottante Délos, s'est détachée de son groupe d'îles grecques ou ioniennes et qu'elle est venue sans bruit s'annexer au continent de la Provence embaumée, apportant avec elle un de ces chanteurs divins de la famille des Mélésigènes".
Tout a été dit sur l'art concis, sobre, attique, simple et savant, éloquent et objectif de l'incomparable poème rustique. Mais il est un côté de cette couvre, genuine entre toutes, que la généralité des critiques, étrangers à la Provence pour la plupart, n'a su ni pu comprendre. C'est la poésie propre au au pays provençal, ce que les troubadours nommaient amor.
Telle chose qui paraît grossière ou vulgaire au lecteur parisien fait tressaillir un Provençal. La vue des collines bibliques du pays arlésien, "cette aridité aromatique qui enivre les ermites et suscite les mirages ", comme a dit Mistral, peut offusquer un franchimand : elle exalte un coeur méridional... Ce qu'on aura, du moins, reconnu sans conteste à Mistral et à ses meilleurs disciples, c'est l'originalité : ils évitent les banalités générales; ce qu'ils ont chanté n'était pas encore dans l'horizon.
Mireille
L'unanimité des suffrages accordés à Mireille sanctionnait la renaissance provençale, donnait à Mistral lui-même la foi résolue en sa mission.
Jusque-là, il avait pu dire, comme dans l'invocation du poème, "qu'il ne chantait que pour les pâtres et les gens des mas" . - "Qu'en dira-t-on en Arles ?" pensait-il anxieux en composant Mireille.
Mais l'aspect de l'oeuvre achevée élargit l'ambition qu'il avait formée pour sa langue. Les notes de Mireille en témoignent.
Déjà la conscience du rôle, qu'il pouvait apporter à l'oeuvre de Fontségugne lui était apparue.
L'école de Roumanille, dont Mireille le sacrait chef et prophète, faisait chaque jour plus d'adeptes.
La langue était fixée, créée la "langue des félibres", et, grâce à l'Armana, peu à peu adoptée par le peuple, ce vulgaire illustre dont, nouveau Dante, il avait doté son pays en épurant et enrichissant son dialecte natal, était immortel ayant suscité un chef-d'oeuvre.
Il restait à imprimer au mouvement une direction "nationale".
C'est en exaltant le sentiment régional et en y entraînant les félibres, c'est en prouvant à son pays l'existence d'une culture méridionale à travers les siècles, c'est en mettant en lumière les droits imprescriptibles de son peuple, qu'il est parvenu à faire d'une renaissance littéraire une "Cause" sociale.
Avec l'Ode aux Catalans en 1859 et le Chant de la Coupe Mistral scella le rapprochement des Provençaux et des Catalans, leurs frères de langue; son sirvente fameux, et resté longtemps suspect, de la Comtesse, allégorie véhémente à la Centralisation; ses discours aux jeux floraux d'Apt en 1862, première sortie officielle des félibres, où fut rédigé le premier statut de l'association, de Barcelone en 1868, alors qu'il accourait avec Roumieux, Paul Meyer et Bonaparte Wyse à l'appel de la Catalogne ressuscitée, enfin de Saint-Remy, la même année, devant les Catalans chaudement accueillis à leur tour et la presse parisienne convoquée pour la première fois.
Ainsi, du félibrige populaire de Roumanille, - engendré par ses pamphlets politiques, ses Noëls et ses Contes, - Mistral faisait peu à peu un félibrige national. Ceci était apparu clairement dans son second ouvrage, Calendau, poème en douze chants 1867, qui, pour les Provençaux, balançait désormais la gloire de Mireille.
Mais combien différents, les deux poèmes!
Mireille, c'était la Provence de la Crau, de la Camargue et du Rhône; Calendal, la Provence de la montagne et de la mer.
Mireille c'était le miel vierge, Calendal la moelle du lion. Célébrant les hauts faits d'un jeune pêcheur de Cassis pour la délivrance et l'amour d'Esterelle, dernière princesse des Baux, mariée à l'infâme aventurier Severan, Mistral avait tenté de peindre tout le paysage, trop vaste, cette fois, de son Iliade agreste, en accumulant les évocations nostalgiques et passionnées du passé provençal.
Ce souci oratoire et encyclopédique, écueil des plus grands poètes, avec la longueur d'un récit qui en rendait peut-être inharmonique l'ordonnance, restreignirent le succès de Calendal dans le public, malgré l'incomparable maîtrise de l'exécution.
Peu à peu, grâce à l'impulsion souveraine de Mistral, le félibrige passait le Rhône.
Après avoir suscité de chauds prosélytes comme Louis Roumieux et Albert Arnavielle, à Nîmes et à Alès, il provoquait à Montpellier, par les soins du baron de Tourtoulon et de son groupe, la création d'une Société pour l'élude des langues romanes, dont les travaux devaient justifier scientifiquement ce relèvement de la langue d'oc (occitan).
Fort de l'appui des savants et des lettrés officiels, jusque-là réfractaires, le mouvement félibréen, déjà catalan-provençal, ne tardait pas à devenir latin. La fête mémorable du centenaire de Pétrarque à Avignon en 1874, due à l'initiative de Berlue-Pérussis et effectivement présidée par Aubanel, fut la première consécration internationale de la nouvelle littérature, et de la gloire de Mistral.
Un grand concours philologique de la Société romane en 1875, puis les Fêtes Latines de Montpellier en 1878, où la jeune femme du poète fut proclamée reine du félibrige, affirmèrent définitivement l'importance d'une renaissance poétique, familiale à ses débuts, que le père de Calendal et de Mireille avait élargie aux proportions d'un mouvement social.
Trois ans auparavant, la royauté intellectuelle de Mistral s'était imposée à tout le midi de la France par la publication du recueil de ses poésies, Lis Iselo d'or (les Îles d'or, 1875), où éclatait le génie du maître dans sa sérénité, sa variété puissante et son autorité de représentant d'un peuple.
Peu après, le félibrige s'organisait en Avignon, 1876, et le poète proclamé grand maître : capoulié de la fédération littéraire des provinces méridionales, devenait, aux yeux des initiés, le chef incontesté d'une croisade de l'Occitanie pour la reconquête de sa dignité historique.
L'espèce de pontificat dont il était désormais investi n'arrêtait pas l'essor de sa production. Un nouveau poème, de forme plus légère, dans le style des épopées chevaleresques de la Renaissance, Nerto, chronique d'histoire provençale du temps des papes d'Avignon, ramenait soudain sur Mistral l'attention de la critique, pour la séduction et l'infinie souplesse de son génie. Après s'être vu comparer à Homère, à Théocrite et à Longus, il évoquait maintenant le charme fuyant d'Arioste.
Un voyage qu'il faisait à Paris en 1884, après vingt ans d'absence, mettait le sceau à sa notoriété française et à sa gloire provençale. Il apparut environné d'une armée d'adeptes. Paris, qui ne connaissait que le poète, salua une littérature dans la personne de son chef.
L'Académie française couronna Nerte comme jadis Mireille. Mistral n'hésita pas à célébrer devant la capitale le quatrième centenaire de la réunion de la Provence à la France : "Comme un principal à un autre principal", selon les termes du contrat historique.
Et il rentra dans sa Provence, consacré chef d'un peuple.
Renaissance provençale
La Renaissance provençale s'étendait chaque jour.
Mistral lui donnait enfin l'instrument scientifique et populaire qui lui manquait pour sa défense, le dictionnaire de son langage national. C'était l'oeuvre bénédictine de sa vie, le Trésor du félibrige. Les divers dialectes d'oc sont représentés dans ce prodigieux inventaire d'un idiome illustre, riche, harmonieux, bien vivant, sauvé et restitué dans son honneur ethnique par d'intransigeants défenseurs, au moment où tout conspirait pour hâter sa décrépitude. Toutes les acceptions, accompagnées d'exemples tirés de tous les écrivains d'oc, tous les termes spéciaux, tous les proverbes sont patiemment recueillis dans ce répertoire encyclopédique qu'on ne remplacera pas. L'Institut lui attribua un prix de 10.000 F.
En 1890, Mistral publia une oeuvre dramatique longtemps caressée, la Rèino Jano, "tragédie provençale".
Malgré son éloquence picturale et la rare beauté de quelques chansons qui reposent le lecteur de l'alexandrin monotone, cette « suite » lumineuse d'évocations de la Provence angevine du XIVe siècle n'obtint auprès du public que le demi-succès de Calendal.
Les franchimands n'ont pas comme les félibres la religion de la reine Jeanne.
Si cette tragédie, essentiellement nationale pour les Provençaux, fut jugée à Paris médiocrement dramatique, il en faut attribuer le reproche à ce qu'on n'a pas tenu compte à l'auteur de la popularité familière qu'il accorde à la légende de son héroïne parmi son public naturel.
En attendant, de voir représenter sa Reine Jeanne sur le théâtre d'Orange restauré par les félibres, Mistral poursuivait sa tâche de poète d'action. La cause s'étendait, appelant des organes plus vivants que le livre ou l'almanach.
Après avoir contribué pendant quarante ans au succès de l'Armana prouvençau et présidé à la fondation de la Revue félibréenne en 1885, il se fit rédacteur principal d'un journal provençal d'Avignon, l'Aioli, créé en 1890, devenu par ses soins le moniteur trimensuel du félibrige.
Tout en gardant ainsi la direction effective du mouvement méridional, - officiellement présidé par Roumanille de 1888 à 1891 et depuis sa mort par Félix Gras, - Mistral publiait çà et là quelque chapitre de ses futurs Mémoires, quelque exhortation à son peuple, discours, poésie ou chronique.
Enfin il donnait le jour à un nouveau poème, sept ans porté comme les précédents, le Poème du Rhône, 1897.
C'est à la fois le plus raffiné et le plus ingénument épique de ses livres.
Capital dans son oeuvre, tant pour la profondeur et l'étendue de la pensée que pour l'originalité de la versification, il apparaît aussi comme le plus symbolique de son génie.
C'est avec les traditions d'un pays qu'il a tramé la soie chatoyante, vivante, éternelle du Rhône, ce poème du cours d'un fleuve. Ces traditions, il a exalté son peuple à en restaurer l'honneur par l'exemple radieux, le labeur fécondant de sa vie.
Et son génie même de poète, clair, lumineux, limpide, avec ses regrets du passé, telle l'inconsciente nostalgie des Alpes qui, par un lointain atavisme, hante sa sérénité, ce génie, autant que provençal, n'est-il pas rhodanien?
On en connaîtra mieux les racines profondes par les Mémoires qui paraîtrront en 1906 sous le titre de Moun espelido, Memòri e Raconte. Dans un exposé de sa vie harmonieuse, il dira tous ses souvenirs d'écrivain célèbre et de campagnard provençal. Des portraits de grands hommes et de grands paysans se dresseront dans son récit. D'autres ouvrages paraîtront encore; Discours e dicho en 1906, Lis óulivado en 1912.
Fin de vie
Entre-temps, Mistral aura été couronné du prix Nobel de Littérature en1904. Il consacrera le montant de ce prix à la création du Museon Arlaten à Arles.
Frédéric Mistral y habita jusqu'en 1875, année ou il put aménager dans la maison qu'il avait faite construire à Maillane, juste devant la Maison du Lézard.
Un an plus tard, le 27 septembre 1876, il épousait à Dijon, Marie Louise Aimée Rivière.
Ce fut ici qu'ils vécurent.
Frédéric Mistral y meurt le 25 Mars 1914.
La maison devint, après la mort du poète le 25 mars 1914 et celle de sa veuve, le 6 février 1943, le Museon Frederi Mistral.
Dans son testament du 7 septembre 1907, Mistral avait légué à sa commune de Maillane, sa maison avec les terrains, jardin, grille, murs, remise et constructions qui l'entourent ou en dépendent... avec les objets d'art, les tableaux, les gravures, les livres et la bibliothèque qu'elle contient, afin qu'on en fasse le musée et la bibliothèque de Maillane, et aussi les meubles qui sont dans la maison à condition qu'ils n'en soient pas enlevés ». Il spécifiait en outre que la commune n'entrerait en possession qu'après la mort de son épouse.
Le Museon est classé monument historique depuis le 10 novembre 1930, son mobilier depuis le 10 février 1931, ce qui à permis à cette demeure de conserver l'aspect qu'elle avait du vivant de Frédéric Mistral5.
L'Action aura été son plus beau poème. C'est pour faire triompher cet idéal, le relèvement de sa Provence, qu'il a été tour à tour poète, orateur, philologue, mais surtout Provençal.
La vita nuova que son action latente infuse au corps apostolique du Félibrige, n'a pas seulement régénéré sa Provence, en l'érigeant à la hauteur d'un idéal social. Elle a provoqué une exaltation du sentiment provincialiste, devenue tendance générale en France, qu'on l'appelle fédéralisme ou simplement décentralisation. On sait les idées de Mistral sur ce régionalisme qui permettrait aux énergies locales de s'épanouir librement.
On ne devait y parvenir, selon lui, que par une Constituante, les élus du système actuel étant trop intéressés à ménager les répartitions départementales pour toucher au morcellement de l'abbé Sieyès.
Mais il a toujours refusé de devenir le chef effectif d'un mouvement politique.
"Qui tient sa langue tient la clef qui de ses chaînes le délivre ",
a-t-il dit, entendant bien que dans une langue vit l'âme même d'un peuple. Et, se réservant la direction du mouvement linguistique, il a voulu rester poète. C'est la pureté de sa gloire qui en aura fait la puissance.
Il n'est pas jusqu'à sa personne qui n'ait su conquérir les foules, alors que son oeuvre charmait les lettrés et le peuple.
Car il eut toujours le sens profond de la vitalité de sa langue, la foi dans un renouveau de sa gloire.
Tout différent en ceci de Jasmin qui se proclamait le dernier poète de la langue d'oc. Si Mistral n'est pas l'unique ouvrier de la renaissance provençale, du moins doit-elle à son oeuvre d'avoir pu prendre essor et de vivre.
Félibre mainteneur depuis 2006, Gérard Baudin fonde dès 1979 le Conservatoire documentaire et culturel Frédéric Mistral. Auteur de nombreux ouvrages d'histoire locale et régionale, il est également le créateur de la revue Échos de Provence. La curiosité de l'auteur et sa soif de rassembler une collection complète sur le père du Félibrige permettent de présenter ici la première biographie illustrée de Frédéric Mistral.
Son oeuvre
Par son œuvre, Mistral réhabilite la langue d'oc en la portant aux plus hauts sommets de la poésie épique : la qualité de cette œuvre sera consacrée par les plus hauts prix.
Il se lance dans un travail de bénédictin pour réaliser un dictionnaire et, à l'instar des troubadours, écrire des chants, et des romans en vers, à l'imitation d'Homère, comme il le proclame dans les quatre premiers vers de Mirèio, se définissant comme un humble élève du grand Homère:
"Cante uno chato de Prouvènço,
Dins lis amour de sa jouvènço,
A través de la Crau, vers la mar, dins li blad,
Umble escoulan dóu grand Oumèro, iéu la vole segui."
"Je chante une jeune fille de Provence,
Dans les amours de sa jeunesse,
À travers la Crau, vers la mer, dans les blés,
Humble élève du grand Homère."
Lexicographie : Lou Tresor dóu Felibrige
Frédéric Mistral et le Félibrige
Mistral est l'auteur du Tresor dóu Felibrige , qui reste à ce jour le dictionnaire le plus riche de la langue d'oc, et l'un des plus fiables pour la précision des sens. C'est un dictionnaire bilingue provençal-français, en deux grands volumes, englobant l'ensemble des dialectes d'oc.
Mireille et le prix Nobel de 1904
" Mirèio".
Son œuvre capitale est Mirèio Mireille, publiée en 1859 après huit ans d'effort créateur.
Mirèio, long poème en provençal, en vers et en douze chants, raconte les amours contrariées de Vincent et Mireille, deux jeunes provençaux de conditions sociales différentes. Le nom Mireille, Mirèio en provençal, est un doublet du mot "meraviho" qui signifie "merveille ".
Mistral trouve ici l'occasion de proposer sa langue mais aussi de faire partager la culture d'une région en parlant entre autres des Saintes-Maries-de-la-Mer, qui d'après la légende auraient chassé la Tarasque, et de la fameuse Vénus d'Arles.
Mistral fait précéder son poème par un court Avis sur la prononciation provençale.
Mireille, jeune fille à marier d'un propriétaire terrien provençal tombe amoureuse de Vincent, un pauvre vannier qui répond à ses sentiments.
Après avoir repoussé trois riches prétendants, Mireille, désespérée par le refus de ses parents de la laisser épouser Vincent, court aux Saintes-Maries-de-la-Mer afin de prier les patronnes de la Provence de fléchir ceux-ci.
Mais ayant oublié de se munir d'un chapeau, elle est victime d'une insolation en arrivant au but de son voyage et meurt dans les bras de Vincent sous le regard de ses parents.
Mistral dédie son livre à Alphonse de Lamartine en ces termes :
Vincent et Mireille, par Victor Leydet
Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature à la une du magazine Le Petit Journal en 1904 :
"À Lamartine
Je te consacre Mireille : c'est mon cœur et mon âme ;
C'est la fleur de mes années ;
C'est un raisin de Crau qu'avec toutes ses feuilles
T'offre un paysan ".
Et Lamartine de s'enthousiasmer : "Je vais vous raconter, aujourd'hui, une bonne nouvelle ! Un grand poète épique est né. …Un vrai poète homérique, en ce temps-ci ; ... Oui, ton poème épique est un chef d'œuvre ; … le parfum de ton livre ne s'évaporera pas en mille ans."
Mirèio a été traduite en une quinzaine de langues européennes, dont le français par Mistral lui-même.
En 1863, Charles Gounod en fait un opéra.
Le prix Nobel de littérature attribué à Frédéric Mistral, en 1904, pour Mirèio récompensait une œuvre en langue d’oc, langue minoritaire en Europe et constitue de ce fait une exception.
Déjà, en 1901, lors de la première session du prix Nobel de littérature, il faisait figure de favori fort du soutien des intellectuels romanistes de l'Europe du Nord dont l'Allemagne.
Pourtant, en dépit des rumeurs qui couraient, le comité suédois décerna le premier Nobel à Sully Prudhomme, candidat officiel de l'Académie française10.
Élu en 1904, le prix faillit pourtant lui échapper à cause d'une mauvaise traduction suédoise de son œuvre.
Il dut cependant partager sa distinction avec José Echegaray.
Son prix Nobel qui récompensait une langue minoritaire, resta unique jusqu'en 1978, où Mistral fut rejoint par Isaac Bashevis Singer pour son œuvre écrite en Yiddish. L’Académie suédoise accompagna l'attribution du Nobel à Mistral en ces termes :
"en considération de sa poésie si originale, si géniale et si artistique, ..., ainsi qu’en raison des travaux importants dans le domaine de la philologie provençale".
La légitimité poétique de la langue provençale était reconnue à l’échelle internationale puisque le prix Nobel signalait sa valeur universelle et la sortait de l’a priori régionaliste.
Principales œuvres
Mirèio (1859) - en ligne graphie mistralienne, graphie classique - version française
Calendau (1867) - en ligne
Coupo Santo (1867)
Lis Isclo d’or (1875) - en ligne : partie I, partie II
Lou Tresor dóu felibrige ou Dictionnaire de provençal-français, (1879) - [1]
Nerto, nouvelle (1884) - en ligne
La Rèino Jano, drame (1890) - en ligne
Lou Pouèmo dóu Rose (1897) - en ligne
Moun espelido, Memòri e Raconte (Mes mémoires) (1906) - en ligne
Discours e dicho (1906) - en ligne
La Genèsi, traducho en prouvençau (1910) - en ligne
Lis óulivado (1912) - en ligne
Proso d’Armana (posthume) (1926, 1927, 1930) - en ligne
Postérité
Sa célébrité doit beaucoup à Lamartine qui chante ses louanges dans le quarantième entretien de son Cours familier de littérature, à la suite de la parution du long poème Mirèio.
Alphonse Daudet, avec qui il était lié d'amitié, lui consacre, d'une manière fort élogieuse, l'une de ses Lettres de mon moulin, Le Poète Mistral11.
Plusieurs établissements scolaires portent son nom comme le Lycée Mistral d'Avignon. De nombreuses voies portent aussi son nom, à Nice, Aix-en-Provence, Saint-Gence, Noiseau, Figeac etc.
Musée Frédéric-Mistral
Musée Frédéric-Mistral sa maison de Maillane ou il vécut de 1876 à sa mort en 1914.
(Ouvert tous les jours sauf les lundis et jours fériés
Philatélie
En 1941, la poste émet un timbre postal de 1 franc, brun carminé.
En 1980, la poste émet un deuxième timbre postal grand format de 1,40 franc surtaxé 30 centimes, noir qui fait partie de la série Personnages célèbres
Numismatique
L'écrivain est l'effigie d'une pièce de 10 € en argent éditée en 2012 par la Monnaie de Paris, pour la collection « Les Euros des Régions » afin de représenter la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région où il a vécu.
- diverses Voies, collèges, bibliothèques ... portent le nom de Frédéric Mistral
Sites, lieux et établissements portant le nom de Frédéric Mistral
Citations
-Les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut.
-Les cinq doigts de la main ne sont pas tous égaux.
-Quand le Bon Dieu en vient à douter du monde il se rappelle qu'il a créé la Provence.
-Chaque année, le rossignol revêt des plumes neuves, mais il garde sa chanson.
-Le soleil semble se coucher dans un verre de Tavel aux tons rubis irisés de topaze. Mais c'est pour mieux se lever dans les cœurs.
-La Provence chante, le Languedoc combat
-Qui a vu Paris et pas Cassis, n'a rien vu. (Qu'a vist Paris e noun Cassis a ren vist.)
Liens
http://youtu.be/l29GMGkiBio Hommage à F. Mistral à Maillane
http://youtu.be/VxgFVm2e-LA Frédéric Mistral
http://youtu.be/rxnAIv9v9OA Vincent et Mireille spectacle
http://youtu.be/EBM7Ubulg28 Mireille Marcel Amont
http://youtu.be/E_3sJ4r9nM4 Le chapeau de Mireille
Posté le : 07/09/2013 20:40
|
|
|
|
|
Alfred Jarry |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 8 Septembre 1873 naît Alfred jarry,
écrivain, romancier et dramaturge français, créateur du mouvement de la "pataphysique"
Auteur au comique grinçant, il met en scène de façon insolite les traits humains les plus grotesques.
Il est l’inventeur du terme de "Pataphysique", science qui cherche à théoriser la déconstruction du réel et sa reconstruction dans l’absurde.
Jarry est l’un des inspirateurs des surréalistes et du théâtre contemporain. Une statue signée Zadkine consacre l’hommage de sa ville natale.
C'est lui qui a lancé lé théâtre de l'absurde.
Cet auteur est transformé par André Gide en personnage de roman dans Les Faux-monnayeurs.
Ubu est entré dans le ciel mythologique : ce qu'il y eut de prophétique dans les dits de ce "maroufle", abondamment illustrés par les événements de ce temps, manifeste une nécessité historique dont Alfred Jarry s'est trouvé l'instrument privilégié.
Tandis que les créateurs d'emblèmes universels, Cervantès ou Goethe, s'abritaient dans les coulisses d'où ils manœuvraient don Quichotte ou Faust, l'écrivain français s'est appliqué à faire de tout un pan de sa vie une interprétation théâtrale du rôle d'Ubu, pour révéler en ce personnage l'instance centrale de l'esprit humain.
Affirmation dénuée d'humilité, sur laquelle s'articulent les thèmes très divers du poète, du dramaturge et du romancier.
Sa vie
Alfred Jarry est le fils d’Anselme Jarry, négociant puis représentant en commerce, et de Caroline Quernest. Né d'une famille petite-bourgeoise, il étonne son entourage, dès son plus jeune âge, par une curiosité multidisciplinaire et la facilité avec laquelle il assimile les connaissances.
En 1878, il est inscrit comme élève dans la division des minimes du petit lycée de Laval.
L’année suivante, sa mère déménage à Saint-Brieuc avec ses deux enfants.
C’est donc au lycée de Saint-Brieuc que Jarry poursuit ses études jusqu’en 1888.
Dès 1885, il compose des comédies en vers et en prose, comme les Brigands de la Calabre en 1885, le Parapluie-Seringue du Docteur Thanaton, le Procès, les Antliaclastes, 1re version 1886, 2e version, 1888.
Il manifeste déjà le besoin de se distinguer, qu'il portera au plus haut point par l'utilisation quotidienne d'objets insolites, comme un revolver ou le port de tenues extravagantes, celle de cycliste par exemple.
Jarry entre en rhétorique au lycée de Rennes, actuel Lycée Émile-Zola de Rennes en octobre 1888.
Après des études brillantes aux lycées de Laval, de Saint-Brieuc et de Rennes, Jarry se rend à Paris dans l'intention de préparer l'École normale ou l'École polytechnique.
Mais il se plaît davantage dans la fréquentation des milieux symbolistes. Il entre au Mercure de France et se lie d'amitié avec Remy de Gourmont, Alfred Vallette, directeur du Mercure et Rachilde.
Il publie différents morceaux de vers et de prose, qu'il recueillera en 1894 dans les Minutes de sable mémorial, auquel succédera en 1895 César Antéchrist.
Jusque-là, rien ne distingue littérairement ce jeune homme curieux, excentrique, doué, avide de gloire.
Là, M. Hébert, professeur de physique, incarne aux yeux de ses élèves "tout le grotesque qui est au monde".
L'enseignant devient le héros d’une littérature scolaire abondante, dont un texte intitulé Les Polonais que Jarry, en classe de première, va mettre en forme de comédie : c’est la plus ancienne version d'Ubu roi.
En 1891-1892, il est élève d’Henri Bergson et condisciple de Léon-Paul Fargue et d’Albert Thibaudet au lycée Henri-IV.
Il échoue au concours d'entrée à l’École normale supérieure, trois échecs successifs suivis de deux échecs pour la licence ès lettres.
Le scandale d'Ubu roi
Le 10 décembre 1896, au théâtre de l'Œuvre, dirigé par A. Lugné-Poe, est présenté Ubu roi de Jarry, musique de Claude Terrasse, avec F. Gémier dans le rôle d'Ubu. Cette représentation provoque un chahut dans la salle et, parmi les critiques, les polémiques les plus vives.
Jules Lemaitre s'interroge : "C'est bien une plaisanterie, n'est-ce pas ?", pendant qu'Henry Bauër déclare :
"De cette énorme figure d'Ubu, étrangement suggestive, souffle le vent de la destruction, l'inspiration de la jeunesse contemporaine qui abat les traditionnels respects et les séculaires préjugés. Et le type restera…".
Tout commença, en effet, par une plaisanterie, un canular de collégiens du lycée de Rennes, qui tournèrent en ridicule leur ridicule professeur de physique, M. Hébert. C'est ainsi qu'on c'est à dire C. Chassé a pu accuser Jarry d'avoir usurpé à un de ses camarades, Ch. Morin, la paternité d'Ubu.
Que Jarry ait utilisé les idées de ses condisciples, cela ne fait aucun doute.
Mais c'est à lui que revient le privilège d'avoir distingué et porté à la connaissance du public – après l'avoir réécrite – cette farce énorme que Morin considérait comme une "connerie", lui donnant une qualité littéraire, enrichissant la langue française d'un mot nouveau : ubuesque.
Le succès de scandale d'Ubu roi sert à la gloire de Jarry, mais surtout à l'affirmation de plus en plus résolue de l'originalité de sa personne, qu'il fignole désormais comme une œuvre d'art.
Sans adopter l'idéologie du Père Ubu, stigmatisant la bêtise humaine, Jarry emprunte à son héros les formes excessives de son comportement pour pouvoir aller jusqu'au bout de lui-même : Aut numquam tentes, aut perfice, n'essaye rien ou va jusqu'au bout ; telle est sa devise.
Dans cette juxtaposition permanente de l'œuvre exemplaire et de la vie, celle-ci devient un théâtre où Jarry lance des répliques devenues fameuses.
À une dame qui se plaignait de la menace que faisait planer sur ses enfants les coups de revolver qu'il aimait à dispenser inconsidérément, Jarry répondra « Si ce malheur arrivait, nous vous en ferions d'autres. »
Une imagination qui va jusqu'à déformer les êtres et les choses ainsi que les mots
En 1900 paraît Ubu enchaîné, qui ne sera joué qu'en 1937 ; en 1901, c'est l'Almanach illustré du Père Ubu et, en 1906 Ubu sur la butte.
Mais si le ventripotent personnage d'Ubu qu'il avait lui-même dessiné le poursuit, il ne suffit pas à combler une imagination sans repos.
Dès 1897, Jarry a fait paraître les Jours et les Nuits, roman d'un déserteur ; en 1898, l'Amour en visites ; en 1901, Messaline ; en 1902, le Surmâle.
Cette série de romans se caractérise par une désinvolture qui permet à l'auteur de prendre une distance par rapport aux personnages envisagés.
Ceux-ci sont campés de telle sorte qu'ils semblent agir comme des automates.
Jarry décrit leur comportement avec une objectivité rigoureuse qui les érige en type universel. Il se sépare de la phraséologie symboliste et de la complaisance des romantiques, essentiellement par l'humour, et pose les premiers jalons de ce qu'il a appelé lui-même, à propos du Surmâle, le "roman moderne".
On ne peut passer sous silence le contenu social et éthique de l'œuvre de Jarry.
Ubu ridiculise le pouvoir abusif ; Sengle, le déserteur, refuse l'armée. Le Surmâle rejette les restrictions de l'être sous quelque forme que ce soit.
"Il importe au Surmâle de dépasser le rythme habituel de l'homme, des actes auxquels l'homme pense être naturellement limité".
Le Surmâle, comme Jarry lui-même, tend à l'appropriation de lui-même dans sa totalité, quitte à scandaliser.
Il n'est nullement question d'un surhomme dominateur, mais d'un homme qui combat le sous-développement aussi bien physique que moral infligé par la société à l'homme.
Dans l'Amour absolu (1899), Jarry use plus particulièrement d'une imagination qui va jusqu'à déformer les êtres et les choses ainsi que les mots.
Le formidable Merdre qui inaugure Ubu roi n'est qu'une préfiguration significative de la transformation à la fois des mots et du monde.
L'Amour absolu, "roman de la métamorphose", laisse la porte ouverte à tous les absolus, et plus particulièrement à celui de l'être libéré pulvérisant les limites d'ordre social, moral ou esthétique.
Il s'agit de cette "pataphysique" formulée dans Gestes et Opinions du docteur Faustroll (1911).
La pataphysique est la "science du particulier" et des "solutions imaginaires".
Elle conduit à une physique nouvelle qui démontrerait qu'il n'y a ni jours ni nuits et que "la vie est continue".
Surréaliste, Jarry l'est non seulement dans l'absinthe, comme l'affirme Breton, mais aussi dans sa vision du monde.
Préoccupé par ses créations, celles de ses œuvres, de son personnage et d'un monde à venir, il ne néglige pas pour autant la vie de ses contemporains.
Dans l'obligation de subvenir à ses besoins – après dilapidation inconsidérée de l'héritage familial – il fait paraître des articles dans la Revue blanche, le Canard sauvage, la Plume, articles qui seront réunis dans Gestes et Spéculations. Il peut ainsi faire valoir sa curiosité, portant un intérêt aux sujets les plus divers, inventions, mode, sport, sciences, arts.
Il fut aussi un cycliste et un escrimeur fervent.
Jarry ne se ménage pas dans sa résolution d'aller jusqu'au bout de lui-même.
Dans l'ouvrage Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, édité après sa mort, il définit la "Pataphysique comme la science des solutions imaginaires, qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité.
Science que perpétue le Collège de 'Pataphysique fondé en 1948.
S’identifiant à son personnage et faisant triompher le principe de plaisir sur celui de réalité, Jarry a vécu comme il lui plaisait avec ses trois attributs :
la bicyclette, le revolver et l’absinthe.
Il leur sacrifiera la respectabilité et le confort. Dans une petite baraque proche d’une rivière, à côté d’un lit-divan, Rabelais composait l’essentiel de sa bibliothèque.
L’humour lui a permis d’accéder à une liberté supérieure.
Jarry jouant Ubu, non plus sur scène mais à la ville, tend ainsi un terrible miroir aux imbéciles, il leur montre le monstre qu’ils sont. Il dit "Merdre aux assis".
Le 28 mai 1906, Jarry écrit à Rachilde :
"Le Père Ubu n’a aucune tare ni au foie, ni au cœur, ni aux reins, pas même dans les urines ! Il est épuisé, simplement et sa chaudière ne va pas éclater mais s’éteindre. Il va s’arrêter tout doucement, comme un moteur fourbu."
Épuisé, malade, harcelé par ses créanciers, malgré l'aide financière d'Octave Mirbeau et de Thadée Natanson, Jarry fait des allers et retours Paris-Laval.
L'"herbe sainte" : l'absinthe aura raison de ses jours et de ses nuits, et, malgré les efforts de ses amis, qui tentent de le soustraire par des séjours campagnards à cette vie qui l'épuise à Paris, il meurt d'une méningite tuberculeuse six mois plus tard, le 1er novembre 1907 à l’hôpital de la Charité, à Paris.
fidèle à lui-même : son dernier vœu, sa dernière volonté, sera qu'on lui apporte un cure-dent.
Il est enterré au cimetière parisien de Bagneux où sa tombe, aujourd'hui anonyme et non entretenue, est toujours en place
Postérité :
Une salle de l'Université Rennes 2 porte son nom.
Œuvres littéraires
Le Surmâle (dessin de Pierre Bonnard). éditeur CFL 1963
Les Antliaclastes (1886-1888) et premiers poèmes repris dans Ontogénie
La Seconde Vie ou Macaber (1888), repris dans Les Minutes de sable mémorial
Onénisme ou les Tribulations de Priou (1888), première version d’Ubu cocu
Les Alcoolisés (1890), repris dans Les Minutes de sable mémorial
Visions actuelles et futures (1894)
« Haldernablou » (1894), repris dans Les Minutes de sable mémorial
« Acte unique » de César-Antéchrist (1894)
Les Minutes de sable mémorial (1894), poèmes. Texte en ligne
César Antéchrist (1895) Texte en ligne
Ubu roi (1896, rédigé vers 1888) Texte en ligne
L’Autre Alceste (1896).Texte en ligne
Paralipomènes d’Ubu (1896)
Le Vieux de la montagne (1896)
Les Jours et les Nuits (1897), roman. Texte en ligne
Ubu cocu ou l'Archéoptéryx (1897)
L’Amour en visites (1897, publié en 1898), poème
Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien (achevé en 1898, publié en 1911), roman. Texte en ligne
Petit Almanach (1898)
L’Amour absolu (1899)
Ubu enchaîné (1899, publié en 1900)
Messaline (1900)
Almanach illustré du Père Ubu (1901)
« Spéculations », dans La Revue blanche (1901)
Le Surmâle (1901, publié en 1902), roman. Texte en ligne
« Gestes », dans La Revue blanche (1901). Publié en 1969 avec les « Spéculations » sous le titre La Chandelle verte.
L’Objet aimé (1903)
« Le 14 Juillet », dans Le Figaro (1904)
Pantagruel (1905, opéra-bouffe d'après Rabelais créé en 1911, musique de Claude Terrasse)
Ubu sur la Butte (1906)
Par la taille (1906), opérette
Le Moutardier du pape (1906, publié en 1907), opéra-bouffe
Albert Samain (souvenirs) (1907)
Publications post-mortem
La Dragonne (1907, publié en 1943)
Spéculations (1911)
Pieter de Delft (1974), opéra-comique
Jef (1974), théâtre
Le Manoir enchanté (1974), opéra-bouffe créé en 1905
L’Amour maladroit (1974), opérette
Le Bon Roi Dagobert (1974), opéra-bouffe
Léda (1981), opérette-bouffe
Siloques. Superloques. Soliloques Et Interloques De Pataphysique (2001), essais et écrits divers
Paralipomènes d'Ubu/Salle Ubu (2010), livre d'artiste
Ubu marionnette (2010), livre d'artiste
Traductions
La ballade du vieux marin (1893, d’après The ancient mariner de Coleridge)
Les silènes (1900, théâtre, traduction partielle d’une œuvre de l’allemand Christian Dietrich Grabbe)
Olalla (1901, nouvelle de Stevenson)
La papesse Jeanne (1907, traduit du grec d’après le roman d’Emmanuel Rhoïdès)
Principales collaborations à des revues
Écho de Paris
L’Art de Paris
Essais d’art libre
Le Mercure de France (dont «De l'inutilité du théâtre au théâtre» en septembre 1886).
La Revue Blanche
Le Livre d’art
La Revue d’art
L’Omnibus de Corinthe
Renaissance latine
Les Marges
La Plume
L'Œil
Le Canard sauvage (articles de 1901 à 1903)
Le Festin d'Ésope
Vers et prose
Poésia
Le Critique
Dessins et gravures
Gravures sur bois :
Ce est le Centaure vers 1890
Minutes de sable mémorial
Sainte Gertrude, 1895, signé sous le pseudonyme d'Alain Jans.
Dans L'Ymagier, revue trimestrielle qu'il fonde en 1894 avec Rémy de Gourmont, Alfred Jarry,
vise à publier des images et les études sur les images et les imagiers anciens et nouveaux , présentant des graveurs et gravures sur bois depuis Dürer jusqu'aux images d'Épinal.
Cette revue cessa sa publication dès 1896 et Alfred Jarry créa une nouvelle revue Perhinderion, à l'existence éphémère.
Liens
http://youtu.be/FznOszLTsfg UBU roi par JC. Averty
http://www.youtube.com/watch?v=FznOsz ... e&list=PL280D7C8516295D0A 8 vidéos
http://youtu.be/pw2voylmHuM Alfred Jarry lui même
http://youtu.be/XWmAWjrtBLQ Chronique sur Jarry
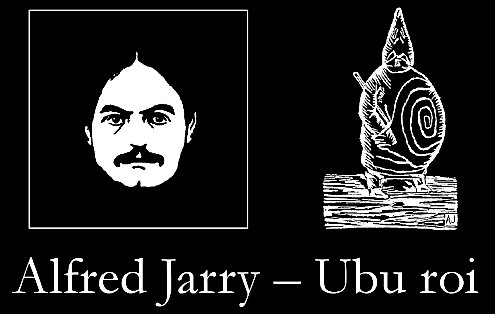 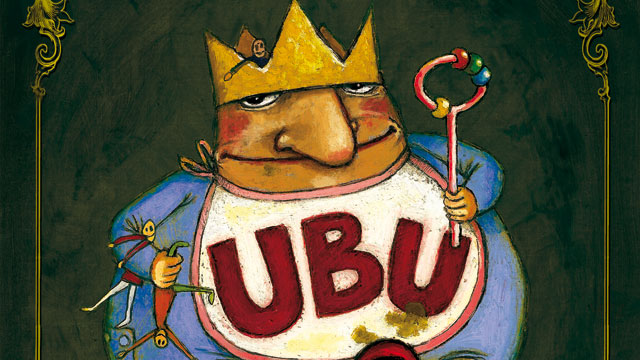
Posté le : 07/09/2013 18:29
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
46 Personne(s) en ligne ( 26 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 46
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages