|
|
Re: Les expressions |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
« Brève de comptoir »
Histoire très courte et amusante, typique d'une conversation de bistrot.
Le mot 'brève' a ici le sens qui lui est donné dans les publications journalistiques : il s'agit d'une nouvelle brève, tenant sur à peine quelques lignes.
L'expression brève de comptoir semble avoir été imaginée ou, en tous cas, popularisée par Jean-Marie Gourio en 1988 lorsqu'il a ainsi titré ses premières anthologies de bon mots directement captés au cours de ces conversations de bistrot où les interlocuteurs, généralement installés au comptoir du bar, passent leur temps à commenter l'actualité et la météo à leur manière et à refaire le monde.
Pour ceux qui n'auraient pas idée de ce que ces recueils contenaient, en voici quelques extraits hautement philosophiques :
Le plus grand silence, c'est quand on est mort, sauf des fois y'a une taupe qui se cogne...
Ma mère ne buvait pas, mon père ne buvait pas, je suis autodidacte.
Pas d'eau dans mon vin, je préfère le boire a capella
L'eau est transparente pour qu'on voie bien en quoi c'est fait.
Elle se f'ra jamais violer, parce que violer c'est quand on veut pas
Ma femme peut pas me quitter, je suis jamais là !
Je n'achète rien quand c'est fabriqué par des enfants du tiers-monde, ça se casse tout de suite.
Je suis chômeur occasionnel et en ce moment c'est l'occasion.
Quand tu tues ta femme, c'est pas la peine de prendre la fuite, elle va pas te courir après.
Ça m'inquiète de prendre la voiture bourré mais en ce moment j'ai pas le choix, je suis tout le temps bourré.
L'eau conduit l'électricité, mais si tu mets du vin dedans, elle a plus le droit de conduire.
Posté le : 28/09/2014 12:45
|
|
|
|
|
P 21/9/14S.King,PhilippeOrléans,HGWells, W.Scott,Schopenhauer, F.Giroud,Virgile,Montherlant |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Posté le : 27/09/2014 21:11
|
|
|
|
|
Confucius 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 28 septembre 551 av.JC naît à Zou 陬 dans le pays de Lu en Chine.
Confucius
en chinois simplifié : 孔子 ; pinyin : Kǒng Zǐ ; Wade : K'ung³-tzu³, de son patronyme Kong et de son prénom Qiu, son nom social étant Zhongni, mort le 11 mai 479 av. J.-C. à Qufu 曲阜 dans l’actuelle province du Shandong, personnage historique ayant le plus marqué la civilisation chinoise, considéré comme le premier éducateur de la Chine. Son enseignement d'éthique et politique inspiré de Zi Chan, Lao Zi, Zhou Gong
à influencé Mencius, Xun Zi, Zhu Xi et a donné naissance au confucianisme, doctrine politique et sociale érigée en religion d'État dès la dynastie Han et qui ne fut officiellement bannie qu'au début du XXe siècle, avec une résurgence en 1973, voir Critique de Lin Piao et de Confucius.
Il est généralement appelé Kǒngzǐ 孔子 ou Kǒng Fūzǐ 孔夫子 par les Chinois, ce qui signifie Maître Kong et a été latinisé en Confucius par les Jésuites. Les Coréens l'appellent Kong-ja, et les Japonais, Kô
Sa figure mi-historique, mi-légendaire est retracée dans sa première biographie issue de Shiji, 史記 / 史记, Shǐjì, œuvre de l'historien chinois Sima Qian écrite de -109 à -91, soit plus de quatre siècles après sa disparition.
Il avait pour nom personnel Kong Qiu 孔丘, en vieux chinois Khong Khwe, Kʰˤoŋʔ Kʷʰə et pour nom social Zhongni 仲尼, en vieux chinois Drunghnrei druŋhnrǝj. Aussi appelé respectueusement Kongfuzi 孔夫子, en vieux chinois Khongpace Kʰˤoŋʔpacǝ́ ou simplement Kongzi 孔子, en vieux chinois Khongce Kʰˤoŋʔcǝ́.
Origines
La famille Kong chinois archaïque Khong, était originaire de l'état de Song. Son arrière-grand-père était le ministre de la guerre de l'état de Song, Kong Fu Jia. Après que celui-ci fut assassiné, son fils Fang Shu, se réfugia dans l'état de Lu, où il mena une carrière militaire. Son fils, Shu Liang He allait suivre ses traces et aussi faire une brillante carrière militaire. La famille Kong était une famille de grands guerriers et Confucius fut le premier de sa lignée à abandonner la voie des armes.
Confucius, est né le 28 septembre 551 avant notre ère, à Zou 陬 ville dont son père était le gouverneur, non loin de la ville de Qufu 曲阜, pays de Lu, actuelle province de Shandong. Sa mère Zheng Zai étant allée prier sur le mont Qiū 丘, le prénomma ainsi.
Une naissance légendaire
D'après la légende, des événements extraordinaires auraient précédé sa naissance; une licorne aurait en outre, prédit sa naissance. Elle vomit une tablette de jade qui prédisait la naissance d'un enfant qui soutiendrait la déclinante dynastie Zhou. Au cours de la nuit de sa naissance, deux dragons se seraient posés sur le toit de sa maison. Cinq vieillards, qui restituaient les essences des Cinq Planètes, arrivèrent dans sa cour. Des chants célestes se seraient fait entendre. Puis finalement, des voix prophétisèrent; Le Ciel favorisera la naissance d'un fils saint.
Les historiens chinois, depuis deux mille ans, parlent de ce temps très ancien comme étant celui des Printemps et des automnes 春秋, faisant ainsi référence à une chronique racontant ce qu'il advint entre 771 et 481 avant J.-C. précisément dans cette région, que l'on nommait alors le pays de Lu.
Famille
Selon la tradition, son père Shu Liang He 叔梁紇 était un descendant de Yi Yin 伊尹, premier ministre de Cheng Tang 湯, le fondateur de la dynastie Shang 商. Gouverneur de la principauté de Lu 鲁, dans le sud-est de l’actuelle Shandong, il épousa en secondes noces à l'âge de 65 ans la jeune Zheng Zai, alors âgée de 15 ans. Il mourut alors que Confucius n’avait que trois ans, laissant sa famille dans la pauvreté.
Selon le Shiji, Confucius faisait neuf pieds six pouces de haut. Ce qui équivaut aujourd'hui à deux mètres quinze. Non seulement Confucius était un grand homme, mais il était en plus un homme grand. Cette haute stature lui venait de son père qui était un vrai colosse, lui-même mesurant plus de deux mètres vingt.
Enfance et jeunesse
Dès l’âge de dix-sept ans, grâce à un goût précoce pour les livres et les rites, Confucius serait devenu précepteur. Il se maria à dix-neuf ans et eut son premier fils, Kong Li 孔鯉, un an plus tard. Celui-ci fut suivi de deux filles. Pour vivre, il effectuait probablement des tâches administratives pour le chef de province.
Rencontre avec Lao Tseu
La légende veut qu’il ait rencontré Lao Zi (老子), père du taoïsme. Il serait allé le trouver, à Luoyi, pour s'enrichir de connaissances concernant les rites du deuil. Ils auraient eu un long échange et au moment où Confucius allait le quitter, Lao Dan lui aurait dit;
"Selon les traditions, les gens fortunés donnent des présents à leur hôte et les gens pauvres donnent des mots. N'étant pas aisé, je puis néanmoins vous donner des mots; Un homme intelligent, grand observateur, se trouvera toujours en danger de mort, car il se plaît à parler des autres. Par son vaste savoir et son solide jugement, il en vient à découvrir ce que les autres ont de plus méprisable. Être fils comme être un simple sujet dépossède du soi."
Après, Confucius resta sidéré et renonça à parler pendant trois jours ou un mois, tellement Lao Zi l'avait troublé.
Carrière
Après la mort de sa mère en -530, il enseigna sa connaissance des textes anciens au petit groupe de disciples qui le suivait. Après quelques emplois subalternes à la cour du duc de Lu, il devint Grand Ministre de la Justice de Lu à l'âge de 53 ans. Cependant, après que ce duc eut préféré prendre du plaisir trois jours durant avec des danseuses au lieu d'assurer sa tâche de gouvernement, Confucius décida de quitter son poste de ministre et, en -496, partit pour quatorze années d’errance, à la recherche d’un souverain capable de l’écouter. Il rentra définitivement à Lu pour se consacrer jusqu’à sa mort, le 11 mai -479, à l’enseignement et à la compilation de textes anciens.
Les années d'errance Séjour au pays de Wei Piégé entre Chen et Cai
Confucius et ses disciples étaient alors dans l'état de Chen, quand le roi de Chu envoya des cadeaux à Confucius. Le roi Zhao de Chu voulait solliciter Confucius à exercer une charge dans son gouvernement. Cependant, Chen et Cai, qui étaient des ennemis de Chu, voulaient empêcher cela de se produire et cernèrent Confucius et ses disciples, les amenant dans un état de siège. Le roi de Chu l'ayant appris, qui tenait son camp à Chengfu, détacha un corps d'armée pour les dégager de leur position fâcheuse. L'opération fut un succès et Confucius et ses disciples purent s'échapper. Confucius était tout disposé à exercer une charge au sein du pays de Chu et voulut rencontrer son roi. Mais Zixi, grand conseiller de Chu, sentant sa position au sein du gouvernement de Chu menacée, ne ménagea pas ses efforts pour faire changer d'idée au roi de Chu qui, finalement, renonça.
Les dangers du bourg de Kuang, Le retour au pays de Lu et mort, Le piège de Yang Huo
Tombe de Confucius
Yang Huo — tyran qui vivait en ce temps — était déterminé à rencontrer Confucius ; aussi décida-t-il de lui envoyer un cadeau au moment où Confucius n'était pas chez lui. D'après la tradition, un lettré qui n'est pas chez lui et qui reçoit un cadeau d'un seigneur doit aller chez ledit seigneur à pied le remercier de ses bonnes grâces. Or Confucius s'est résolu à ne pas le voir, estimant qu'il s'agissait d'un piège tendu par cet homme fourbe et cruel. Aussi décide-t-il d'aller le remercier au moment où il n'est pas chez lui, pour ne pas le voir. Cependant Yang Huo anticipe la manœuvre et prend les devants, tant et si bien que les deux se rencontrent sur le chemin. Quand il voit Yang Huo, il réalise qu'il est bel et bien piégé. Sa vivacité d'esprit le sort de cette mauvaise situation. Yang Huo voulait en fait solliciter Confucius à exercer des charges dans son pseudo-gouvernement, dans le but de semer le trouble dans le gouvernement légitime du prince Ting.
Sa pensée
L'essentiel de la pensée de Confucius nous est parvenu à travers les Analectes, ou Entretiens, recueil de propos de Confucius et de ses disciples ainsi que de discussions entre eux, compilés par des disciples de deuxième génération.
Bien qu’il n’ait jamais développé sa pensée de façon théorique, on peut dessiner à grands traits ce qu’étaient ses principales préoccupations et les solutions qu’il préconisait. Partant du constat qu’il n’est pas possible de vivre avec les oiseaux et les bêtes sauvages, et qu’il faut donc vivre en bonne société avec ses semblables, Confucius tisse un réseau de valeurs dont le but est l’harmonie des relations humaines. En son temps, la Chine était divisée en royaumes indépendants et belliqueux, les luttes pour l’hégémonie rendaient la situation instable et l’ancienne dynastie des Zhou avait perdu le rôle unificateur et pacificateur que lui conférait le mandat du Ciel. Confucius voulait donc restaurer ce mandat du Ciel qui conférait le pouvoir et l’efficacité à l’empereur vertueux. Cependant, bien qu’il affirme ne rien inventer et se contenter de transmettre la sagesse ancienne, Confucius a interprété les anciennes institutions selon ses aspirations, il a semé les graines de ce que certains auteurs appellent l'humanisme chinois.
Mettant l’homme au centre de ses préoccupations et refusant de parler des esprits ou de la mort, Confucius n’a pas fondé de religion au sens occidental du terme, même si un culte lui a été dédié par la suite. Cherchant à fonder une morale positive, structurée par les « rites » et vivifiée par la « sincérité », mettant l’accent sur l’étude et la rectitude, Confucius représente pour les Chinois d’avant la Révolution l’éducateur par excellence, mais la lecture attentive des Entretiens montre qu’il n’a pas voulu s’ériger en maître à penser, et qu’au contraire il voulait développer chez ses disciples l’esprit critique et la réflexion personnelle : Je lève un coin du voile, si l’étudiant ne peut découvrir les trois autres, tant pis pour lui.
À une époque où l'éducation et la culture, dans l'ancienne Chine, n'étaient plus le privilège de la haute aristocratie émergea une classe de lettrés dont Confucius est représentatif. Avec lui se mit en place une école philosophique dont la doctrine fut celle de l'État pendant deux millénaires.
La vie d'un lettré
En réalité, Confucius connaît le sort des intellectuels de l'époque – celle des cent écoles philosophiques –, se déplaçant de principauté en principauté pour proposer, sans réussite durable, ses services de conseiller à différents seigneurs. Mais aucun d'entre eux ne mettra réellement en pratique ses idées. Son enseignement, en revanche, se propagera grâce à de nombreux disciples, qui compileront, après la mort du Maître, un recueil de ses préceptes : le Lunyu Entretiens. La tradition veut qu'il ait classé et arrangé les Classiques qui existaient de son vivant. Il est en revanche très improbable qu'il ait pris part à leur rédaction.
Le projet confucianiste
Former l'homme
Les grands problèmes de l'époque de Confucius sont d'ordre politique : comment gouverner ? Comment faire régner l'ordre dans un État et dans l'empire tout entier ? Comment assurer au peuple une vie prospère et heureuse ? La solution que propose Confucius est celle d'un précepteur, d'un éducateur : éduquer l'homme, aussi bien celui qui gouverne que celui qui est gouverné. Pour sauver la société, il faut d'abord sauver les hommes.
Gouverner par la vertu
Aussi gouverner est-ce, en premier lieu, éduquer le peuple, former les individus. Celui qui gouverne a la responsabilité d'un éducateur. Mais, pour pouvoir former les autres, il faut être formé soi-même. Et, en formant les autres, on se forme à son tour. Un prince idéal gouverne par sa vertu. Mais le prince qui ne sait pas se gouverner lui-même ne saurait gouverner les autres.
Le seigneur Ji Kang, interrogeant Confucius sur la manière de gouverner, lui dit : Ne ferais-je pas bien de mettre à mort les malfaiteurs afin de rendre le peuple vertueux ? Confucius répondit : Pour gouverner le peuple, avez-vous besoin de la peine de mort ? Soyez vous-même vertueux et votre peuple sera vertueux. La vertu du prince est comme le vent ; celle du peuple est comme l'herbe. Au souffle du vent, l'herbe se courbe.
Trouver en soi le ren
Or, qu'est-ce qu'être vertueux ? Qu'est-ce que former l'homme ? La vertu ne saurait être imposée de l'extérieur ; au contraire, c'est une force innée que nous pouvons découvrir en nous-même. Former l'homme, c'est réveiller cette force intérieure et la développer. Confucius appelle cette qualité le ren. On traduit ce terme de différentes façons : amour, altruisme, bonté, humanité, vertu parfaite, etc. La difficulté de lui trouver un équivalent tient au fait que Confucius lui-même l'emploie dans des sens très différents.
Le ren est l'essence de l'homme. Confucius ne l'affirme pas, mais sa pensée philosophique l'implique. En général, quand le Maître parle de l'homme qui possède le ren, il veut dire celui qui est conscient de le posséder et a, par conséquent, l'ardent désir de se perfectionner tout en aidant les autres à se perfectionner. Le célèbre aphorisme Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse est l'aspect négatif du ren, que Confucius nomme shu. L'aspect positif du ren est Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse, que Confucius nomme zhong.
Formuler un programme d'éducation
En tant qu'éducateur, Confucius a un programme précis. Il veut faire de ses disciples des hommes accomplis, utiles à l'État et à la société. Il affirme que son enseignement n'apporte rien de nouveau et qu'il se contente de transmettre la culture ancienne, ce qui n'est qu'à moitié vrai. Il enseigne les six Classiques : le Yijing, Livre des mutations, le Shijing, Livre des odes, le Shujing, Livre des documents, le Liji, Mémoire des rites.
Ces Classiques, qui ont été les fondements de l'éducation aristocratique, Confucius les enseigne à tout le monde, que le disciple soit noble ou non. Car, pour être un homme accompli, il faut, d'une part, posséder le ren et, d'autre part, être cultivé. Il arrive à Confucius de faire des remaniements dans la composition des textes afin d'en donner des interprétations dérivées de ses propres concepts moraux. Il veut justifier la culture existante par une pensée philosophique. Plus encore, il cherche à dégager le sens de la culture de son temps et à y insuffler une nouvelle vie.→ confucianisme.
Confucius
Un apport très important, et révolutionnaire en quelque sorte, de Confucius, est à chercher dans la notion de Junzi, gentilhomme qui, avant lui, dénotait une noblesse de sang et dont il a modifié le sens pour le transformer en noblesse du cœur, un peu comme le mot anglais gentleman. Son enseignement, bien que principalement orienté vers la formation de futurs hommes de pouvoir, était ouvert à tous, pas seulement aux fils de princes. On peut faire remonter à cette impulsion de départ la longue tradition des examens impériaux, chargés de pourvoir l’État en hommes intègres et cultivés, que le plus humble paysan pouvait, en théorie tenter. Bien que cette institution méritocratique ait subi différents avatars et distorsions, elle a certainement joué un rôle prépondérant dans la pérennité de la culture chinoise et dans la relative stabilité de l’Empire Céleste pendant deux millénaires.
Selon Confucius, la soumission au père et au prince va de soi et garantit la cohésion des familles et du pays, mais elle s’accompagne d’un devoir de respectueuses remontrances si le père ou le prince vont dans la mauvaise direction. De très nombreux lettrés chinois, se réclamant à juste titre de l’enseignement de leur Maître, ont péri ou été bannis, pour avoir osé critiquer l’empereur quand celui-ci, sous l’influence de courtisans ou de prêtres taoïstes, ne prenait plus soin de son peuple et laissait le pays sombrer dans la famine ou la guerre civile.
Sa postérité
La postérité de Confucius, en Chine et en Extrême-Orient, ne saurait être sur-évaluée. Ses commentateurs et ses continuateurs proches comme Mencius et Xun Zi ont formé un corps de doctrine, appelé confucianisme, choisi comme philosophie d’État en Chine pendant la dynastie Han.
Les Jésuites en Chine réalisent un transfert culturel de la pensée confucéenne aux élites européennes du XVII au XVIIIe siècles, favorisant la sinophilie, voire la sinomanie des intellectuels. Ils font de Confucius un saint, ce qui est un des éléments déclencheurs de la Querelle des rites
Jusqu’à la fin de l’Empire, en 1911, le système des examens, basé sur le corpus confucéen, est resté en vigueur. Certains analystes, chinois ou occidentaux, pensent que l’influence du confucianisme est toujours prépondérante à l’époque actuelle. La Corée du Sud (cf. art. I I) et Singapour se réclament toujours de cette doctrine politique 2007. Le Japon se revendique également de cette doctrine pour les bases de sa société, depuis la transformation de la société par Hayashi Razan, sous l'ère Edo, et aujourd'hui encore, on considère que les racines de la société nippone sont shinto-confucianistes. Une seconde mondialisation après celle des jésuites est véhiculée après la Seconde Guerre mondiale par le sinologue James Legge en ou le philosophe pragmatiste Herbert Fingarette en auteur de Confucius, The Secular as Sacred, Confucius, le séculier en tant que sacré, paru en 1972.
Cette continuité apparente du confucianisme en Chine ne doit cependant pas cacher les constants renouvellements, suivis de retours aux sources ou d’éclipses temporaires, qui ont animé l’histoire de la pensée chinoise. Ainsi le renouveau du confucianisme, instauré par Zhu Xi pendant la dynastie Song, après une relative mise en retrait durant la dynastie des Tang, a intégré les apports anciens de la pensée taoïste et les apports plus récents du bouddhisme en une orthodoxie restée relativement incontestée depuis lors. C'est depuis la fondation de la République de Chine que l’enseignement des Quatre Livres et des Cinq Classiques confucéens n'est plus obligatoire :
Les Quatre Livres 四書 Sì shū sont
La Grande Étude, 大學 Dà Xué.
L’Invariable Milieu 中庸 Zhōng Yóng.
Les Entretiens de Confucius 論語 Lùn Yǔ.
Le Mencius Livre 孟子 Mèng Zǐ.
Le Livre des Rites.
Les Cinq Classiques 五經 Wǔ jīng sont
Le Canon des Poèmes 詩經 Shī Jīng.
Le Canon de l'Histoire 書經 Shū Jīng.
Le Livre des mutations ou Yi King 易經 Yì Jīng.
Le Livre des Rites 禮記 Lǐ Jì.
Les Annales des Printemps et des Automnes 春秋 Chūn Qiū, alias 麟經 Lín Jīng.
Un sixième classique a été perdu : Le Canon de la musique 樂經.
Deux mouvements inverses s'observent actuellement : développement en Chine continentale d’écoles confucéennes privées qui inculquent aux élèves l'apprentissage par cœur des classiques de Confucius dont la figure est reconstruite et réinventée ; à l'opposé, surtout chez les sinologues occidentaux, un mouvement de déconstruction de la figure de Confucius et du texte des Entretiens.
Bibliographie
Publications anciennes
Tous ses livres moraux ont été mis en latin et paraphrasés par Prospero Intorcetta, Christian Herdtrich, François de Rougemont et Philippe Couplet, sous le titre de Confucius, Sinarum philosophus, Paris, 1687, in-folio.
Le Shū Jīng a été traduit en français, par le Père Antoine Gaubil, 1770; le Zhōng Yóng a été publié en chinois, avec traduction latine et française, par Abel-Rémusat, 1817, in-4; le Ta hio, par Guillaume Pauthier (chinois, latin et français), 1837, in-8.
On trouve aussi plusieurs des ouvrages de Confucius dans les Sinensis imperii libri classici sex du Père François Noël, Prague, 1711, collection traduite en français par l'abbé François-André-Adrien Pluquet, 1784, 7 volumes in-18.
La Vie de Confucius a été écrite par le Père Joseph-Marie Amiot dans les Mémoires sur les Chinois. On a publié la Morale de Confucius, Amsterdam, 1688, 1 volume in-8.
Traductions
Philosophes confucianistes, Gallimard, coll. "La Pléiade", 1536 p. Les Entretiens Lun Yu de Confucius, Meng Zi, La Grande Étude (Da Xue), La pratique équilibrée (Zhong Yong), Le classique de la piété filiale Xiao-jing, Xun Zi.
Anne Cheng, Entretiens de Confucius, Paris, 2004 1re éd. 1981
Pierre Ryckmans, Les Entretiens de Confucius, Paris, 2005 1re éd. 1987
André Lévy, Confucius, Entretiens avec ses disciples, Paris, 1993
Source ancienne
Sima Qian, Kong zi, chapitre 47 du Shiji, traduction Édouard Chavannes 1905 : Mémoires historiques volume 5, réédition Adrien-Maisonneuve, Paris, 1967; en ligne : université du Québec et Wikisource
Études Ouvrages généraux
Anne Cheng, Histoire de la pensée chinoise, Paris, 2002, p. 61-93
Ouvrages sur Confucius
Pierre Do-Dinh : Confucius et l'humanisme chinois Éditions du Seuil Collection Maîtres Spirituels, 1958.
Karl Jaspers, Confucius. Éditions Noé 2006
Etiemble, Confucius, Gallimard 1966. Édition augmentée 1985 Folio-Essais
Yasushi Inoue, Confucius, Éditions Stock pour la traduction française
Lin Yutang, La sagesse de Confucius, éd. Picquier poche, 2008
Yu Dan : Le bonheur selon Confucius Éditions Belfond 2009
Michèle Moioli : "Apprendre à philosopher avec Confucius", Éditions Ellipses, 2011
Danielle Elisseeff, Confucius, Les Mots en Action, Paris, 2003
Jean Lévi, Confucius, Paris, 2003
Jean-Paul Desroches et al., Confucius, à l'aube de l'humanisme chinois, Paris, 2003
José Frèches, Moi, Confucius, XO édition, 2013
Livres-audio
Dialogue avec ses disciples de Confucius, Éditions Thélème, Paris, 2007.
Confucius et confucianisme
Deux millénaires et demi durant, ou peu s'en faut, la pensée, la fable et l'influence de Kongzi, notre Confucius, ont formé une grande part des Chinois, des Coréens, des Vietnamiens, des Japonais et jusqu'à certains Européens. Si même on la compare à celle de Mahomet ou du Bouddha, la marque de ce moraliste semble exceptionnellement tenace :
Il ne parla qu'en sage, et jamais en prophète Cependant on le crut, et même en son pays.
Voltaire avait raison : il est vrai qu'on le crut, hélas, au lieu de s'en inspirer. Au milieu du XXe siècle, notamment, à l'heure même où le président Mao vouait le vieux maître aux gémonies, alors que dans Comment devenir un bon communiste ? Liu Shaoqi se référait aux empereurs modèles de la doctrine, Yao et Shun, une société d'études confucéennes, un peu naïve peut-être, mais à plus d'un égard digne de sympathie, s'organisait discrètement à Genève, sous l'impulsion d'un citoyen suisse. Si peu nombreuse qu'on la sût, et si peu efficace, on remarquait avec des sentiments mêlés qu'elle écrivait à ses correspondants en restaurant un comput censément confucéen. Vers le même temps, le sinologue américain Herrlee Glessner Creel publiait Confucius, the Man and the Myth, pour célébrer en Kongzi un précurseur de la démocratie libérale.
Qu'on la juge mauvaise ou bonne, une action aussi générale, aussi durable, aussi profonde, aussi tyrannique parfois, hélas, mérite qu'on l'examine avec objectivité.
Confucius et son temps Le trop célèbre auteur du Lun yu
Du mythe...
De l'homme, on ne sait presque rien : des dates 551-479 avant notre comput ; des anecdotes fabuleuses cette licorne, avant la naissance du Maître, qui vomit un livre orné de pierres précieuses ; cette autre licorne, qui lui présage sa mort, etc. ; un nom lui-même qui prête aux gloses abigotantes n'y trouve-t-on pas le caractère hirondelle ? Or le fondateur de la dynastie des Shang ou Yin, à laquelle remonterait notre homme, naquit de Jiandi, laquelle fut agréablement fécondée par un œuf d'hirondelle qu'en jouant elle déglutit. Quant au nom personnel du philosophe, Qiu, Marcel Granet prouva qu'il est en rapport, ainsi que faire se doit, avec la nature de celui qui le porte : ce mot veut dire tertre ; or Confucius avait le crâne relevé sur les bords et creux au centre, anomalie qui s'éclaire très bien si l'on se rappelle que sa mère, après avoir conclu avec un vieillard un mariage disproportionné – selon la traduction d'Alexis Rygaloff – s'en fut prier sur le tertre Ni qiu. Or ni signifie tertre à sommet renversé, qui recueille les eaux.
D'autres preuves par l'étymologie sont ainsi laïcisées dans les travaux de Granet. De sorte que, si Voltaire n'a point tort de célébrer en son idole un homme qui ne se donnait nullement pour un prophète, la sociologie contemporaine a raison de découvrir en lui un système d'allusions à toutes sortes de mythes. Les dates de sa vie elles-mêmes nous deviennent suspectes. Si Confucius naquit en 551, s'il avait cinquante ans lors de l'entrevue de Jiagu au cours de laquelle il transforma un traquenard en véritable paix, s'il mourut à soixante-douze ans, ne serait-ce point parce qu'il fallait qu'un si grand homme naquît cinq cents ans tout juste après le duc de Zhou, autre grand sage ; parce que cinquante ans, c'est en Chine l'âge de la plénitude, de la perfection, et que soixante-douze, dans le système classificatoire et protocolaire de la numération chinoise, constitue un repère d'importance capitale. Si donc Maître Kong naquit en 551, c'est peut-être parce que l'entrevue en question eut lieu en 500, à moins que l'entrevue n'ait eu lieu en 500 que parce que Confucius était né en 551. Ainsi du reste. Henri Maspero estime qu'on ne peut dater au juste ce philosophe, dont le nom et la vie officielle sont décidément trop chargés de fables. Quand on ne pousserait pas l'évhémérisme aussi loin que nos meilleurs sinologues, comment admettre avec la légende que Laozi, l'auteur présumé du Dao de jing, ait ridiculisé le jeune Confucius ? Cet ouvrage composite est bien postérieur à l'œuvre de celui-ci.
L'œuvre
L'œuvre ? De même que nous devons renoncer à prendre pour documents d'histoire la biographie que nous transmet Sima Qian, il nous faut consentir à ne plus attribuer au Maître tout ce qui compte avant lui dans les lettres chinoises. Ni le Canon des poèmes, qu'il est censé avoir classé, ni le Canon des documents, qu'il aurait compilé, ni le Canon des mutations, dont on lui attribue les « dix ailes » ou appendices, ne sont de lui ; non plus que les Printemps et les Automnes, cette chronique du pays de Lu dont il serait originaire.
Pour parler de son œuvre avec prudence et probité, il faut donc se borner à examiner le Lun yu, les Entretiens familiers : anecdotes, maximes, brèves paraboles et propos familiers, en effet, arbitrairement répartis en vingt sections, et le plus souvent mal situés historiquement ; oui, des anas, sans plus : recueillis par des disciples, ou des disciples de disciples.
Sous un empire décadent
En ce temps-là, l'empire chinois des Zhou agonisait : des principautés rivales s'entre-déchiraient ; durant cette décadence politique à quoi mit fin en 256, avant notre comput le fondateur de l'empire centralisé mais totalitaire Qin Shi Huangdi, une société féodale se survivait plutôt mal que bien. Libres, affiliés à un clan, les nobles s'adonnaient au tir à l'arc, à la guerre, célébraient des sacrifices minutieux et fréquents, raffinaient sur le luxe ; à côté de cette aristocratie vivotaient certaines familles pourvues d'émoluments héréditaires, nobles peu fortunés dont sortirent, si l'on en croit Maspero et Creel, presque tous les scribes de cette période, y compris Confucius. Le reste de la société – plébéiens illettrés, artisans, marchands, esclaves – était universellement méprisé. De la femme, on ne se souciait guère : encore qu'elle contribuât aux sacrifices domestiques, elle « ne doit point se mêler des affaires publiques Canon des poèmes. Malheur à qui épouse une femme audacieuse et forte ! Canon des mutations.
Tel était le milieu dont sortait et sur lequel voulut agir, si jamais il vécut, celui que les Chinois appelaient Maître Kong, ou Kongfuzi, nom que les jésuites latinisèrent en Confucius.
Contrairement à certaines allégations d'un marxisme simplet, ces lettrés issus de la noblesse pauvre n'étaient nullement des valets de la haute aristocratie : très souvent, nous les voyons qui contredisent un noble, contrecarrent l'action d'un prince, adressent des remontrances, se déclarent prêts à mourir pour exercer le privilège de rappeler aux puissants qu'ils se doivent de gouverner dans l'intérêt des petits sires, des xiao ren. Au reste, la diversité des philosophies alors combattantes nous garantit la liberté d'esprit de beaucoup de ces prétendus serviteurs de l'aristocratie. La solution que propose Confucius n'est en effet ni la seule, ni, convenons-en, la plus efficace.
Par dégoût d'un monde atroce, ceux qu'on appellera les taoïstes refuseront toute intervention de l'homme dans le cours naturel des choses ; d'autres, avec Mozi, organiseront une façon de féroce république platonicienne, aussi pacifiste que militarisée, hostile elle aussi aux arts, à la poésie, et qui oppose aux valeurs féodales un amour mutuel sans charité ; ceux qui finiront par l'emporter – les réalistes, légalistes ou légistes – se réclament d'un empirisme organisateur, remplacent les liens personnels par une bureaucratie centralisée, fondent l'État sur la notion de loi qu'appuient rudement, à l'intérieur une police méticuleuse, à l'extérieur une armée bien entraînée.
Parce qu'il voulait résoudre par la seule morale toutes les difficultés d'un monde finissant, Confucius, il faut l'avouer, échoua politiquement : c'est en vain qu'on veut nous persuader qu'il lui suffit d'exercer en 496 la charge de Premier ministre et de faire exécuter un prédécesseur incapable pour qu'aussitôt les bouchers vendent la viande au juste prix. Nous ne sommes pas dupes de cette fable. Mais quoi ! en un siècle d'anarchie, de félonie, de cruautés, il offrit aux hommes des recettes de bien public, une politique fondée sur la morale. Ce n'est pas rien.
Une doctrine ouverte
Dissipons à ce propos une légende. Sur la foi d'une belle image qui présente l'enfant Confucius plein de zèle pour ranger des vases rituels, on condamne parfois en lui un maniaque de l'étiquette. Quelle erreur ! Soit qu'il rendît visite à une princesse de mauvaise vie, soit qu'il pleurât ses amis plus longuement que ne le prescrivaient les rites, il montra, par son exemple, que la droiture du cœur et de l'esprit l'emporte sur les simagrées, et même sur l'étiquette : Trop de manières ennuie ; ou bien : Plus de vertus naïves que de manières, tu es un rustre ; plus de manières que de vertus naïves, tu es un cuistre ; autant de manières que de vertus, voilà l'homme de qualité.
La morale du junzi
Mais la vertu, la correction morale dépendent strictement de la qualité, de l'ordre du langage. Quand tout va mal dans une principauté, quand les mœurs y sont corrompues, les princes indignes de leur fonction, et que par conséquent le peuple ne sait plus où situer le bien et le mal, un seul remède : Rendre correctes les dénominations. Une fois définis les concepts, l'homme de qualité veille toujours à y conformer ses paroles et ses actes. Si le père agit en père, le fils en fils, tout va bien ; si le fils échange sa dénomination avec celle du père, s'il se comporte en père, comme avec sa mère le fils de la princesse Nanzi, c'est l'inceste : le désordre, le crime.
La réforme langagière garantit donc la cohésion du groupe humain : en se conformant au concept de prince, le prince gouvernera dans l'intérêt de tous, et sera le plus efficace. Du point de vue machiavélien, Confucius est probablement dans l'erreur : Saint Louis perd sa croisade, mais Louis XI accroît la France. Du point de vue de la morale personnelle, assurément il a raison : point de junzi qui ne se conforme aux dénominations correctes.
Qu'est-ce au juste que ce junzi, ce modèle humain proposé par Confucius, cet équivalent chinois du καλ̀ος κ́αγαθ́ος des Grecs, ou du cortigiano ? Les Anglais le traduisent souvent par gentleman. Pour Granet, c'est le Sage. J'incline à préférer homme de qualité, qui marque mieux la révolution politico-morale proposée par Maître Kong. Avant lui, on était junzi par droit de naissance ; avec et après lui, la naissance n'est rien où la vertu n'est pas. Bien qu'il prétende avant tout s'attacher aux anciens avec confiance et affection, il s'efforça de préparer un avenir où les qualités du cœur et de l'esprit l'emporteraient sur la naissance. Fidélité aux principes de notre nature : zhong, et application bienveillante à autrui de ces principes : shu, voilà quelques-unes des vertus dont l'heureuse conjonction compose la vertu suprême, celle de ren, terme si malaisé à définir que Confucius doit recourir au je ne sais quoi. J'y discerne l'essentiel de cette générosité que proposera chez nous Charles Sorel dans le Francion, que Descartes définira plus explicitement et dont, tel que nous le présentent ses Entretiens familiers, le Maître nous offre un modèle.
Nul système en lui ; nulle orthodoxie, en dépit du fameux texte II, 16, que le père Couvreur traduisit à dessein fort mal : Le Maître dit : étudier des doctrines différentes, des enseignements des anciens sages, c'est nuisible ; texte qui veut dire tout autre chose : S'appliquer aux doctrines extravagantes, voilà qui fait du mal. Interprétation que confirme plus d'un autre ana, celui en particulier où l'on rapporte qu'il ne parlait jamais des prodiges, des esprits, de la mort. Au reste : Toi qui ne sais rien de la vie, que saurais-tu de la mort ?
Morale qui fait confiance, un peu trop sans doute, à la nature humaine ; point de village de dix feux où l'on ne puisse trouver, c'est du moins sa conviction, un homme au cœur généreux. Ce qui manque aux humains, c'est de connaître les vertus vraies et de s'y appliquer humblement, inlassablement. Tel en effet ne naît pas vertueux qui, par une étude appropriée, par un constant effort sur soi, peut acquérir toutes celles des qualités humaines qui ne sont pas incompatibles avec son tempérament. Trois de ces vertus font de vous un bon père de famille ; six, un prince acceptable ; neuf, un grand roi.
Cette morale, du moins, n'est pas déduite d'une foi, d'une métaphysique, ou descendue d'un Sinaï.
L'agnosticisme
On a disputé, on dispute encore, sur l'agnosticisme ou non de Confucius. Max Weber le considérait comme un rationaliste qui, dégagé de toute métaphysique, de toute tradition religieuse, a construit une morale fondée sur la nature de l'homme et les besoins de la société. Morale que nos contemporains, épris de mystère, de vague à l'âme, considèrent souvent comme un peu courte. C'est pourquoi sans doute H. G. Creel essaya de contester l'agnosticisme du philosophe. Tout dépend d'un texte qu'on traduit d'ordinaire : le sage respecte les esprits et garde à leur égard les distances requises, tant par les rites que par l'horreur sacrée. Convenons que tel qui extrait l'idée de bien de l'expérience que filtre la raison peut sauver en soi un coin secret pour les sentiments ou les pratiques religieuses. À tel de ses disciples qui protestait contre le sacrifice d'un mouton, nous savons qu'un jour Confucius répliqua : Vous aimez les moutons, et moi la cérémonie. Apparemment convaincu que nulle société ne peut subsister sans des fêtes, il ne voyait aucune raison d'éliminer celles des traditions religieuses qui ne blessaient point sa morale positive. Toujours est-il que, lorsque, le voyant sur le point de mourir, ses disciples lui proposèrent de célébrer des sacrifices, il répondit altièrement : Il y a beau temps que ma prière est faite. Quant aux principales notions métaphysiques dont il daigne parler – le tian, le dao, le ming –, voici sa position : le tian, le ciel, garde chez lui le sens cosmique et lyrique à la fois qu'il a souvent dans les textes chinois ; le décret du ciel, le ming, tantôt ce serait notre destin biologique, tantôt notre fatum, tantôt le hasard ou l'accident ; le dao, lui, coïncide avec l'ordre du monde, qui est ordre en mouvement : Le Maître, qui se trouvait au bord d'une rivière, déclara : tout passe comme cette eau ; rien ne s'arrête, ni jour ni nuit. Sur quoi, un glossateur officiel : L'homme de qualité imite ce mouvement.
Maître et disciples
Que Kongzi ait formé trois mille disciples, c'est douteux. Qu'il en ait conduit soixante-douze jusqu'à la perfection de la vertu de ren, disons de la générosité, au sens que donnèrent à ce mot Charles Sorel, puis Descartes, c'est évidemment fabuleux, autant que les douze disciples du Christ. En Chine, soixante-douze est le nombre caractéristique des confréries Granet.
Mais que son enseignement fût avant tout modeste, empirique et moral, voilà qui semble assuré : Le Maître enseignait quatre choses, les lettres, la morale, la loyauté et la bonne foi. Se référait-il au Canon des poèmes, jamais il n'en commentait la beauté ; toujours il en éludait l'érotisme pourtant charmant, et vif à l'occasion ; il n'en retenait, au prix de quelle virtuosité, qu'un cours rimé de vertu : le Canon nous enseignerait à cultiver en nous des intentions droites.
Gardons-nous cependant d'imaginer un enseignement solennel et gourmé. Les Entretiens familiers nous permettent d'imaginer le maître avec ses disciples : tout se passe à la bonne franquette ; à propos de n'importe quoi, un disciple interroge ; ou bien c'est le maître qui pose une question. Il advient que, durant la conversation, l'un des auditeurs continue à toucher son luth. Déférents, mais curieux, les disciples écoutent. On répond à la chinoise : par des anecdotes, des images exemplaires. Point de jargon d'école, de sophismes, d'arguments abstrus, d'arguties logiques ou théologiques. L'expérience, elle seule, enseigne. Zilu avait si parfaitement assimilé la méthode qu'il ne recevait aucune idée neuve avant de l'avoir vérifiée dans la pratique : bien avant les marxistes, Kongzi enseignait donc ce qu'on appelle maintenant la dialectique de la théorie et de la praxis.
Morale insoucieuse à l'excès de la technique administrative, et, plus généralement, de toutes les techniques, et qui, par conséquent, n'avait guère de prise sur une civilisation en pleine mue économique. Tout au plus insistait-on sur une technique, celle de la politesse, des manières, ou, si l'on préfère, des rites li, dans la mesure où cette technique-là contribue à former les gens de qualité, les junzi. Le sage confucéen, l'homme qui incarne la vertu de ren, jamais ne sera réduit au statut de technicien. Zigong lui ayant demandé : Que pensez-vous de moi ? – Tu es un qi », répliqua Kongzi, c'est-à-dire : un outil, quelqu'un qui ne sert qu'à une fin ; par conséquent, tu n'es pas ou pas encore un homme accompli. Cette formation, grâce à laquelle Confucius s'efforçait de révéler à chacun ce que Montaigne appellera plus tard sa forme maîtresse, n'était point destinée à fabriquer en série des cerveaux interchangeables. C'est tout le contraire. Ici, chacun dit ce qu'il pense, déclarait le Maître ; ou bien : Les traînards, je les pousse ; les fougueux, je les retiens. Persuadé que sa discipline rendait les bénéficiaires habiles à gouverner les hommes, il estimait qu'il est contraire à la justice de refuser les charges publiques. Dans un pays alors avant tout agricole, il refusait pourtant d'enseigner l'agriculture. On lui en fait grief, surtout de nos jours, où prévaut le technicien, et règne le technocrate. Peut-être ferait-on mieux de louer en lui celui qui condamnait son disciple Ran Qiu parce que, profitant de ses fonctions, il avait prévariqué.
Hélas, pour peu qu'on l'admire et le propage, tout enseignement, et le moins contraignant, et le moins cérémonieux, finit par se durcir en dogmes et se figer en rites. Bien qu'il pensât que toute notre vie, intime et officielle, que tout ordre familial et social sont garantis par l'ordre du langage, la droiture du cœur, un difficile équilibre de quelques vertus et de quelques manières, bien qu'il se souciât plutôt d'expériences vécues que de référence autoritaire à des livres, à des gloses, assuré que la vertu agit d'autant plus efficacement que plus discrètement, Confucius, comme tant de moralistes réformateurs, fut trahi, sinon par ses disciples immédiats – ce qui est difficile à déceler –, du moins par les disciples de ses disciples.
L'histoire sainte du confucianisme veut que, sitôt mort le héros, ses disciples prirent son deuil comme celui d'un père, pour trois ans, et que Zigong resta trois autres années près de la tombe. D'après le Canon des documents, les mêmes disciples se dispersèrent comme selon nous après la Pentecôte les disciples du Christ ; les meilleurs, en cela fidèles à leur maître les uns comme les autres, se faisant nommer ministres, ou du moins conseillers de princes, à moins qu'ils ne choisissent la retraite.
Mais, au bourg de Kong, un culte bientôt s'organise : on vénère des reliques. Le duc de Lu y célèbre des sacrifices. Le petit-fils du Maître est censé avoir joué un rôle décisif en rédigeant cette Grande Étude Da xue et ce Milieu juste Zhong yong, ouvrages par lesquels Zhu Xi conseillera plus tard d'aborder l'étude de la doctrine. Ainsi commence une dynastie qui se perpétuera jusqu'au XXe siècle.
Tant s'en faut que ces traités transmettent le pur esprit confucéen ; d'autres doctrines affleurent, celle en particulier qu'on lui oppose d'ordinaire, le taoïsme. Tant s'en faut également que tout soit clair dans ces pages. Ainsi la Grande Étude enseigne en particulier qu'il faut ge wu, formule en chinois très ambiguë et dont certains glossateurs déduiront : scruter la nature concrète des êtres et des choses ; d'autres, en revanche, concluront qu'il importe de scruter le mystère de l'Être. Deux écoles, ou deux tendances divergentes peuvent sortir, sortent en effet de ces deux mots : l'une qui aurait pu fonder les sciences de la nature, l'autre qui s'oriente vers la métaphysique. Dans le Milieu juste, une proposition taoïsante nuance heureusement, au point de la contredire, la thèse du Maître sur les femmes : homme ou femme, peu importe, tout être humain désormais peut connaître la norme, et y atteindre, du moins en principe. Autre déviation taoïsante, le sage devrait imiter les saisons, l'eau, la terre, etc.
On ne saurait tirer au fixisme, au conservatisme, une pensée morale fondée sur un ordre en mouvement, et qui recommande un constant effort sur soi-même. Regrettons toutefois que le Maître ait accepté sans gêne apparente le statut qui était en son temps celui de la femme ; déplorons chez lui une propension puritaine à gloser de travers mais pudibondement les chansons d'amour du Canon des poèmes. De l'anecdote ou de la poésie, on aimerait, quand on l'aime qu'il sût mieux goûter la beauté. Telle n'était point sa vocation : s'il est d'accord pour reconnaître, avec les taoïstes proprement dits, que le dernier mot de la sagesse c'est probablement de vivre en paix dans la montagne, il pense que l'avant-dernier, c'est de transformer le monde : Si l'Empire était bien gouverné, aurais-je besoin de le changer ?
Premières mues du confucianisme Les écoles combattantes
Après la mort de Confucius, sa pensée fut violemment prise à partie, et de tous côtés. Le plus âpre et l'un des plus doués parmi ses adversaires, Mozi, condamnait en lui un ennemi du genre humain : rites funèbres, relations de clan, arts libéraux tenaient à son avis trop de place chez Kongzi, qui, d'autre part, néglige de former le peuple. Dans une période de guerres civiles et féodales, Mozi tenta d'opposer au confucianisme une confrérie de moines-soldats disciplinés, fanatisés : l'amour universel qu'il prônait exigeait une organisation tyrannique de la société !
Les taoïstes, eux, reprochaient aux mohistes et aux confucéens de se planter sur leurs jambes, de retrousser leurs manches et de se cogner aussi dur que possible au lieu de contribuer non pas tant à reconstruire la société qu'à restaurer l'ordre du monde, en se soumettant à la dialectique de la nature, ainsi qu'au chacun pour soi» d'un égoïsme contemplatif et joyeusement ascétique.
Comme il arrive toujours en ces périodes où le pouvoir spirituel et temporel tombe en décrépitude, la pensée prospère : contre le confucianisme combattaient encore les sophistes chinois, à tant d'égards comparables à ceux de la Grèce ; cette fois, c'était au nom de l'épistémologie et de la philosophie du concept. Il est vrai que Kongzi n'avait guère traité d'épistémologie, sinon en définissant la théorie des dénominations correctes, celle du zheng ming. Mais Huizi et Gongsun Long tentèrent d'élaborer contre le confucianisme, ou du moins en marge de lui, une philosophie du concept, avec sa compréhension et son extension ainsi qu'une philosophie de la contradiction. Sous les Royaumes combattants, les sophistes s'appelaient les philosophes du xing ming, c'est-à-dire ceux qui établissent des rapports entre les noms (ming) et les substances xing ; moins contestable est leur autre désignation : bianzhe, les disputeurs, les dialecticiens. Ces hommes florissaient entre 350 et 250 avant notre comput : Huizi avait réponse à tout, déclare un ouvrage ancien, au point que Guo Moruo voit en lui un homme très proche denos savants et logiciens. De fait, il s'intéressait à la géographie, à l'astronomie, à tous les savoirs de son temps en cela, fort peu confucéen ; mais c'est surtout sa philosophie du concept et de la contradiction qui l'oppose aux ru, aux lettrés confucéens.
Le confucianisme de Mencius
Au milieu de ces violentes polémiques, un philosophe doublé d'un écrivain, Mengzi, que les jésuites latinisèrent en Mencius 370-290, avait élaboré et sur plus d'un point renouvelé la doctrine. Comme son maître, il entendait préparer un gouvernement fondé sur la bienveillance : Tous les grands officiers de la Chine tout entière accourront se mettre à vos ordres, tous les laboureurs voudront cultiver vos terres en friche ; les marchands fourniront vos marchés de leurs produits ; tous les voyageurs emprunteront vos routes ; tous ceux qui ont à se plaindre de leurs princes viendront vous soumettre leurs griefs, annonçait-il au prince qui accepterait d'être un vrai roi. Mais, contre son maître, il accordait à l'économie politique un rôle que Confucius avait trop négligé : pour Mencius, la morale ne commence qu'une fois rempli l'estomac : À chaque famille donnez cinq arpents de mûriers et nul quinquagénaire ne manquera de vêtements de soie. Donnez-lui le moyen d'élever des poules, des chiens, des porcs, et nul septuagénaire ne manquera de viande. Avec cent arpents de terre, si vous lui laissez le loisir de les cultiver, une famille de huit personnes jamais ne connaîtra la faim .... Quand les gens d'âge sont vêtus de soie et mangent de la viande, quand les petits sires ne souffrent ni la faim ni le froid, ne seriez-vous pas encore un vrai roi, vous le deviendrez, disait-il à quelque hégémon seigneur, dont il voulait faire un bon prince, un vrai roi. Un autre prince l'ayant, dit-on, consulté parce que ses sujets ni ne croissaient ni ne multipliaient : Sire, lui répondit Mencius, vous aimez trop la guerre ; sur ce, il lui administra un nouveau cours, très judicieux, d'économie politique : laissez aux champs les laboureurs ; organisez la conservation des eaux et forêts ; réglementez la pêche de sorte qu'on n'emploie plus de filets à mailles trop serrées ; distribuez avec attention les coupes de bois ; dès lors, les vivants vivront bien, les morts mourront avec les honneurs nécessaires.
Alors que Confucius avait surtout insisté sur la justice et les vertus de l'homme, Mencius, qui vivait en un siècle où la décadence de l'empire des Zhou ne faisait que s'aggraver, avait tenté fort éloquemment – car il écrivait mieux que son maître ne parlait – de définir ce que serait une économie raisonnable. Il exposa un système de tenure à la fois collective et individuelle, celui qu'on appelle en chinois jing : huit champs privés enveloppent un champ public ; chaque famille de la communauté cultive à son profit le champ privé qui lui est alloué, et participe à la mise en valeur du champ public, dont le prince perçoit les revenus. Non content d'opposer aux hégémons les vrais rois, aux tyrans, dirions-nous, les souverains éclairés, Mencius pousse plus avant que son maître l'analyse du concept de junzi, de généreux, ou, encore, d'homme de qualité. À son avis, et, sous le régime communiste, le président de la République chinoise Liu Shaoqi reprendra mot pour mot la formule, n'importe qui peut devenir Yao et Shun, les souverains parfaits de la légende dorée. Avant Pascal, il distingue des grandeurs d'établissement, qu'il appelle terrestres, la vraie grandeur, celle du sage, qu'il qualifie de céleste. Et qui donc avant lui osa dire aux princes que, deviennent-ils des tyrans, le premier venu a le droit de les tuer, car un brigand, un scélérat, ce ne sont que simples particuliers ?
Son maître lui avait néanmoins légué la conviction que la nature de l'homme est foncièrement bonne, qu'il ne faut qu'en développer les rudiments. Sous un bon prince, tout le monde serait vertueux.
Le confucianisme deXunzi
La pensée de Mencius éclipsa longtemps celle de Xunzi ; les confucéens ultérieurs reprochaient à celui-ci d'avoir contribué à ruiner le confucianisme ; nous voyons les choses d'un autre œil, et le sinologue américain Homer H. Dubs a pu écrire tout un ouvrage qui définit Xunzi comme l'organisateur du confucianisme sous sa forme ancienne. Durant sa vie, env. 300-237, l'État de Qin commençait la longue entreprise qui allait le rendre maître des principautés chinoises affaiblies par leurs luttes intestines. Tout ce que le jeune Xunzi a pu voir, guerres incessantes, avec leurs séquelles de cruautés, de félonies, de misère, le persuade sans peine que tant s'en faut que les hommes possèdent ces quatre rudiments de vertu, compassion, vergogne, modestie, sens du juste que discernait en eux Mencius. Plus proche de nos psychiatres que de l'optimisme confucéen, Xunzi voit en chaque humain un pervers capable de tout. Pour lui, c'est l'étude, sans doute aussi la contrainte, c'est-à-dire la société, qui conduisent l'homme vers la justice et les bienséances. Outrant les thèses de Mencius, il ose écrire, ce qui l'honore : Telle est la nature de l'homme que, s'il a faim, il s'empiffre ; s'il a froid, il veut se chauffer ; s'il travaille, il a envie de se reposer. Il pense lui aussi que n'importe qui peut devenir Yu le Grand, un démiurge ; mais, alors que Mencius s'en remet naïvement à la nature et à la culture du moi, qui n'est pas culte du moi, Xunzi préférait se fier à l'intelligence critique et à l'éducation.
Voici percer son scepticisme, ou sa prudence : « Il est vrai que le premier venu peut devenir un Yu, mais il y a peu de chance qu'il le devienne. » Aussi, les anciens rois ont-ils été contraints d'instituer une morale, un savoir-vivre, des lois, des récompenses et des châtiments. Morale positiviste, on le voit, utilitariste, et qui, plutôt qu'à l'individu – chargé par Confucius et même par Mencius de travailler sur soi –, confie à la société, c'est-à-dire à la répression, le soin de diriger l'homme, de corriger ce qu'il recèle de méchant, ou du moins de mauvais.
Pour la première fois dans l'histoire du confucianisme, la doctrine tend à se figer, à se durcir en système, à requérir l'obéissance au lieu de solliciter la réflexion. On feint par conséquent que les sages d'autrefois connaissaient toute la vérité, et que les hommes d'aujourd'hui n'ont qu'à se conformer aux canons anciens : surtout, qu'on ne les discute pas ! Quand il voit ses contemporains jouer du tambour afin de chasser l'éclipse, Xunzi est assez intelligent pour les traiter d'idiots. N'espérez pas qu'il fasse confiance à des nigauds pareils.
Ni cette insistance sur les châtiments, ni le peu de cas qu'il fait de l'intelligence des hommes en général ne devaient le mettre au ban de la pensée chinoise. Des siècles durant, ce fut néanmoins son lot, par une décision délibérée des confucéens orthodoxes. Son crime ? Avoir formé deux hommes, Han Feizi et Li Si, qui s'illustrèrent comme théoriciens de l'école de la loi, ou du légisme, et qui furent les conseillers du terrible Qin Shi Huangdi. On le tient donc en Chine, ce Xunzi, pour responsable de la persécution qui s'ensuivit contre les disciples du Maître.
Du martyre au triomphe
On a tort en un sens ; car s'il ne se cacha point d'admirer la poigne du roi de Qin, et l'ordre que ce prince imposait à ses sujets, il était trop marqué d'esprit confucéen pour ne pas réprouver la tyrannie patente, et pour ne pas souffrir de constater que la terreur fascine ceux-là mêmes qu'elle opprime. Il vécut assez vieux pour ne pas douter du succès de Qin, mais fut assez heureux pour ne pas assister aux épreuves que ses disciples Li Si et Han Feizi firent subir aux lettrés confucéens.
Le confucianisme sur la sellette
Comme on a pu déduire de Hegel un hégélianisme de droite, disons Croce et un de gauche, disons Marx, rien n'était plus facile que de tirer de Xunzi des conclusions cyniques. Puisque l'homme n'est point naturellement bon, puisque son propre serait plutôt la méchanceté, puisque le Ciel n'est qu'un mot, il n'appartient ni au Ciel ni à l'individu de fixer les normes de la vertu. D'ailleurs, la vertu, pour quoi faire ? Le seul fondement de la morale, c'est la crainte de la police et du magistrat. La seule fin de la société, l'ordre et le rendement. Le prince légifère. Les fonctionnaires fixent les châtiments. Au lieu de gouverner par les rites, les bienséances, on dominera par les codes et la peur.
Lorsque le roi de Qin eut enfin unifié sous son autorité les dernières principautés qui lui résistaient encore, le ministre Li Si choisit d'appliquer à l'ensemble de la Chine les méthodes qui avaient rendu invincible le Qin. On convoqua donc les fonctionnaires, pour leur demander un avis sur cette révolution autoritaire et centralisatrice. Un confucéen crut de son devoir de critiquer les projets de Qin Shi Huangdi, et de se référer aux fameux anciens rois, à Yao et à Shun. C'est qu'il savait par cœur le chapitre du Li ji sur la conduite du lettré : Si tyrannique soit le gouvernement, le lettré ne change point ses principes ; encore : ils pourront bien lui faire perdre la vie : ils ne pourront lui arracher sa volonté. Li Si répliqua très durement, accusa ces prétentieux confucéens d'attaquer en toute occasion un gouvernement qu'ils devraient admirer, et auquel ils se bornent à opposer les mœurs, les manières des anciens : Ô mon maître, prenez garde, ces gens-là sont plus à craindre que vous ne le pensez. Il les accuse donc de complot contre Qin Shi Huangdi, d'exciter le peuple à une révolte ouverte, de se constituer en caste, ou classe spéciale , tandis que ce ne sont que pédants inutiles à toute société bien gérée. Le ministre conseilla donc au prince de jeter au feu tous les écrits pernicieux du confucianisme, et de ne sauver que les ouvrages traitant de médecine et d'agriculture, de divination, et ceux des ouvrages d'histoire qui célèbrent la glorieuse dynastie de Qin.
L'empereur approuva ; mais on découvrit bientôt que les confucéens connaissaient par cœur les classiques, et pouvaient les transmettre de la bouche à l'oreille. À quoi bon détruire tous les écrits sauf un exemplaire de chaque titre, qui figurait dans la bibliothèque personnelle du souverain ? Il fallait faire disparaître ces bibliothèques circulantes, les lettrés confucéens. On assure que Li Si fit arrêter en masse les confucéens et que quatre cent soixante d'entre eux furent enterrés vifs. Les tyrans n'ont guère d'imagination : ils tuent qui pense. Mais l'Empire cette fois dura trop peu pour obtenir les résultats qu'il se proposait. Après onze ans de règne, Qin Shi Huangdi mourut ; son débile successeur disparut au bout de quatre ans. En 206 avant notre ère, un homme du peuple, Liu Bang, dirigea une rébellion qui mit fin à la dynastie de Qin et fonda la sienne, celle des Han, non sans avoir pillé la capitale de Qin Shi Huangdi et mis le feu à cette bibliothèque impériale où l'on avait entreposé une collection de tous les livres condamnés.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=6821#forumpost6821
Posté le : 27/09/2014 21:07
Edité par Loriane sur 28-09-2014 17:17:57
|
|
|
|
|
Confucius 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Les classiques confucéens
Qu'étaient-ce donc que ces classiques confucéens qui faisaient trembler Li Si ?
«Je m'attache aux Anciens avec confiance et affection , disait prudemment Kongzi. Tout en se proposant de corriger le désordre présent, ce novateur se défendait de rien changer à l'ordre ancien.
L'ordre ancien, tel que l'avaient consigné quelques livres : le Yi jing ou Canon des mutations, le Shu jing ou Canon des documents, le Shi jing ou Canon des poèmes, le Yi li, Cérémonial, et le Li ji, Mémorial des rites, le Yue jing ou Canon de la musique. À quoi Confucius était censé avoir ajouté le Chunqiu, Les Printemps et les Automnes, chronique de l'État de Lu. Comme le Canon de la musique s'est perdu à l'exception d'un chapitre, sauvé dans le Mémorial des rites, et d'un autre qui se trouve dans le Zhou li ou Rituel des Zhou, cet ensemble forma ce qu'on appela les six puis les cinq classiques.
À l'exception du Canon des mutations qui traitait de divination, et qui pour cette raison fut sauvé du feu, tels sont les ouvrages qu'en 213 on proscrivit.
Les plus anciens d'entre eux, les Canons des mutations, des documents et des poèmes, datent vraisemblablement de 800 à 600 et même d'un peu plus tard. Au Ve siècle avant notre ère, les « cent écoles » de pensée s'y réfèrent constamment. Dérivé d'un vieux système de divination par les branches de l'achillée sternutatoire, le Canon des mutations est constitué de soixante-quatre hexagrammes commentés en termes abstrus. Outre les commentaires des hexagrammes et certains poèmes yao, probablement dérivés de dictons paysans, le Canon des mutations comporte des textes plus tardifs qu'on attribue parfois à Confucius, et dont l'un des plus anciens – peut-être le plus important philosophiquement – s'appelle le Xici. Pour la première fois, on y trouve élaborée une philosophie de l'alternance dialectique du yin et du yang avec la formule fameuse yi yin yi yang zhe wei dao : Un temps de yin, un temps de yang, voilà le dao. Avec leurs combinaisons de lignes pleines yang, mâles, et de lignes brisées yin, femelles, les hexagrammes exprimeraient en quelque sorte la dialectique chinoise de la nature.
Recueil de documents de dates et de valeur diverses, le Canon des documents fut censément compilé, classé par Confucius. Il ne s'agit point de documents historiques, au sens que nous donnerions à ce mot, mais d'élaborations littéraires, morales et philosophiques ; on y trouve en particulier un exposé de la doctrine du mandat céleste, sans laquelle on ne comprend rien à la monarchie chinoise. Conformément à cette doctrine, Yu le Grand, le fondateur de la première dynastie chinoise, celle des Xia, obtint l'empire parce que sa vertu parfaite lui mérita l'investiture céleste. Un temps vint où les souverains de sa dynastie manquèrent à leurs devoirs ; lorsque Jie exerça, non plus l'empire, mais la tyrannie, il perdit le mandat céleste, que le Ciel confia au fondateur des Shang, ou Yin, Tang le Victorieux. Cela se serait passé en 1400 avant notre ère. La vertu déclina dans cette famille, si bien qu'un vilain jour le pouvoir échut à l'indigne Shouxin que le Ciel abandonna en 1122 pour confier le mandat au roi Wu, fondateur supposé de la dynastie des Zhou.
Une seule vertu, mais essentielle, qualifie un souverain pour le mandat céleste : l'imitation des anciens souverains, les parfaits, en qui s'incarnaient toutes les vertus cardinales. Théorie capitale, puisque chaque fois que décline un pouvoir l'usurpateur peut invoquer en sa faveur le mandat céleste. Thèse en tout cas plus satisfaisante pour les sujets que notre philosophie du droit divin, que ne corrige qu'imparfaitement – sauf chez certains théologiens – une théorie du tyrannicide.
Outre une morale dynastique, le Canon des documents propose, dans le Hong fan, la Grande Règle, une vue philosophique de l'univers, par une généralisation radicale des correspondances avec spéculations numériques ; cinq éléments forment l'univers : l'eau = 1, le feu = 2, le bois = 3, le métal = 4, la terre = 5. Ces éléments constituent autant de classificatoires : espace, temps, saveurs, viscères, activités, régulateurs, vertus, bonheurs, tout se distribue selon ce système à cinq entrées. La société reflète la nature. Symbole de cette correspondance entre le Ciel et la Terre, entre les Temps, les Orients et les Saisons, un temple appelé ming tang signalait la capitale et permettait l'exercice de la fonction politique et cosmique du souverain. Encore que des sinologues aussi grands que Paul Pelliot et Marcel Granet souvent aient divergé touchant le rôle et la fonction du ming tang, on peut considérer que Granet n'a pas tort de voir en ce temple une maison du calendrier, un concentré de l'univers. Carrée, comme la Terre dans la cosmologie des anciens Chinois, coiffée d'un toit circulaire de chaume, parce que le Ciel est rond, la Maison du calendrier est ainsi disposée que le souverain, en y circulant, anime l'espace et favorise la ronde des saisons. C'est donc dans les salles de ce ming tang qu'il promulgue les ordonnances mensuelles qui harmonisent les tâches des hommes et les rythmes de la nature.
Quant au Canon des poèmes, dont, d'après une tradition, Confucius aurait choisi les trois cent cinq textes, il se compose de chansons populaires, de petites et grandes odes, d'hymnes enfin, au style plus majestueux que les chansons : si gracieuses, si lestes parfois celles-ci, qu'il faut tout le moralisme confucéen pour en tirer des enseignements édifiants. Comme le Canon des documents, le Canon des poèmes fut condamné au feu par les ministres de Qin Shi Huangdi.Encore qu'on les range parmi les classiques, les rituels confucéens ne furent composés, dans certains groupes qui se réclamaient du Maître, que vers le IIIe siècle avant notre comput. Le Yi li et le Li ji échappèrent, semble-t-il, à la proscription de 213, et ce bien que les rites aient joué un rôle dans la morale confucéenne : rôle moins impérieux qu'on ne le prétend parfois : Confucius n'hésitait pas à les violer chaque fois que l'intensité du sentiment l'y invitait. En revanche, on mit au feu Les Printemps et les Automnes, la chronique du royaume victorieux – celle de Qin – ayant seule paru digne de passer à la postérité : ainsi écrit-on l'histoire. Par bonheur, ce document qui nous renseigne sur la Chine entre 722 et 481 survécut à la proscription, le vainqueur ayant bientôt succombé, ce qui permit au confucianisme de renaître et de prospérer.
Le seul ouvrage sur lequel on puisse raisonnablement se fonder pour fixer ce que fut l'enseignement de Confucius, les Entretiens familiers, fut condamné lui aussi, et brûlé, de sorte que le Lun yu que nous étudions n'est pas le texte ancien et fut reconstitué à partir de deux versions différentes retrouvées sous les Han. Au feu, également, le Canon de la piété filiale, le Xiao jing, qui fut restauré à partir d'un exemplaire prétendument caché par un confucéen courageux, et d'un texte ancien miraculeusement retrouvé dans les murs de la maison de Confucius, avec un texte ancien des Entretiens familiers. Ne soyons pas dupes de ces miracles : conjuguées avec la proscription de 213, les idées que les Chinois anciens se faisaient de la littérature nous imposent quelque prudence touchant l'authenticité et par suite l'interprétation de ce premier canon confucéen.
En tout cas, Paul Demiéville pense que l'incinération de 213 et la tyrannie de Qin Shi Huangdi mettent fin une fois pour toutes dans l'histoire chinoise à l'exceptionnelle liberté de pensée qu'avait favorisée la décadence politique des Zhou.
La situation peut se comparer à ce que fut la conquête de la Grèce par Rome, conquête assurément qui permit l'hellénisation des vainqueurs, mais qui remplaça par un État pragmatique, organisé, impérialiste, l'anarchie de cités combattantes. Ainsi l'Empire des Han, qui allait succéder en 206 à celui de Qin Shi Huangdi et, durant quatre siècles, de 206 avant notre ère à 220 de notre ère, donner à la Chine une organisation qui la marquera pour deux millénaires au moins.
Le confucianisme sous les Han
Paradoxalement, cet Empire centralisateur et conquérant allait pourtant accorder au confucianisme un rôle quasi officiel dans l'État, ce dont la doctrine allait pâtir autant que profiter. Si l'édit de proscription resta en vigueur sous le régime de l'usurpateur Liu Bang qui régna sous le nom de Gaozu, et bien que ses premiers successeurs aient marqué plus de sympathie personnelle pour deux doctrines, le taoïsme et le bouddhisme, fort étrangères à l'esprit confucéen, l'empereur Wu 140-87, par intérêt politique, choisit de s'appuyer sur une philosophie qui, pourvu qu'il eût des vertus, faisait un sort à l'homme de basse extraction : ainsi appliquait-il déjà une politique qui sera en gros celle de Louis XIV, quand, pour contrebalancer l'influence des féodaux, celui-ci confia le pouvoir réel à des bourgeois. En adoptant la doctrine, on l'adapta il est vrai aux conditions sociales et politiques nouvelles. Reste qu'on choisit de préférence les fonctionnaires parmi les gens formés par le confucianisme. Ainsi prenait forme ce qui allait devenir le système des examens et le mandarinat, qui consacre ou suppose la compétence administrative de qui sait par cœur le canon confucéen.
C'est en grande partie à Dong Zhongshu que la doctrine officielle doit son succès, et le rôle qu'elle joua sous les Han. Unifiant la théorie du yin yang et celle des cinq éléments, il élabora une philosophie syncrétiste et prétendit découvrir dans Les Printemps et les Automnes des sens secrets, qu'il révéla dans sa Rosée abondante des Printemps et des Automnes. Non moins tyrannique en son ordre que Li Si, il tenta d'obtenir que l'empereur interdît tout autre enseignement que le sien : Il faut éliminer tout ce qui n'est pas du domaine des six classiques. Sans aller jusque-là, l'empereur Wu créa en 124 avant notre comput une École d'administration où l'on enseignait les Six Canons pour former de bons fonctionnaires. Il refusa pourtant de proscrire les autres écoles ; car sa préférence – et quel homme d'État ne le comprendrait ? – le portait vers la doctrine du fajia, celle des légistes. En fait, la doctrine confucéenne devint sous les Han une grande religion syncrétique, où s'amalgament des superstitions populaires et le culte de l'État, le tout sommairement rationalisé et vaguement camouflé de textes confucéens, Hu Shi, au XXe siècle. Textes sur lesquels on discutait ferme entre partisans du texte moderne et tenants de l'ancien. Si l'on en juge par les textes classiques gravés sur stèles de pierre que l'on peut encore lire à Luoyang, le texte moderne d'abord l'emporta. Après la chute des Han, la dynastie des Wei donna la préférence au texte ancien, et fit à son tour inscrire dans la pierre cette version du Canon des documents, ainsi que Les Printemps et les Automnes.
Ancienne ou moderne, la version du confucianisme qui s'impose alors, et qu'on imposa par la suite, s'interpose entre le lecteur d'aujourd'hui et ce que fut sans doute la forme première de l'enseignement confucéen ; ainsi en va-t-il de toute orthodoxie : il s'agit toujours de se rapprocher autant que possible d'un idéal, d'un dieu, d'un paradis, exaltés dans le plus lointain passé. Quand la dynastie des Han perdit le mandat céleste, l'orthodoxie confucéenne était à peu près constituée, excluant pour son interprétation tout recours à tout autre ouvrage qu'officiel. De sorte qu'une pensée qui avait eu pour objet de développer en chacun sa forme maîtresse allait devenir, en conquérant la Chine, un dogmatisme, une sorte de pensée, pour ne pas dire de religion d'État. Ces querelles de sectes, cette volonté de restaurer l'orthodoxie eurent au moins l'heureux effet de développer là-bas l'érudition, la glose et la critique de textes. Aux environs de l'ère chrétienne, deux bibliothécaires, Liu Xiang et son fils Liu Xin, furent pour beaucoup dans cet effort, dont l'équivalent ne se retrouve guère dans notre civilisation qu'avec l'école alexandrine.
Le privilège d'administrer l'Empire se payait parfois cher, d'autant que, rendons-leur cette justice, les confucéens recrutés par examen avaient souvent le courage d'exercer la périlleuse fonction de remontrance. Ajoutons que, sous couleur de penser selon le confucianisme, un esprit aussi libre et agile que Wang Chong, le Voltaire ou le Lucien de cette Chine, allait opposer aux dogmes un scepticisme sans illusion, cependant que, devançant de plus d'un millénaire et demi le dictionnaire philosophique et critique de Bayle, le Chinois Xu Shen, auteur du premier grand dictionnaire chinois, le Shuo Wen, allait exposer, dans ses Incompatibilités entre les cinq canons, toutes les incohérences qu'on pouvait déjà déceler dans les textes devenus sacrés d'un confucianisme dont il démontrait avec acuité qu'ils ne pouvaient constituer une doctrine homogène. On serait donc inique en ne célébrant pas ceux des confucéens que les empereurs Han condamnèrent à mort parce que fidèles à la conduite du lettré qui impose à celui-ci de ne jamais oublier les souffrances du peuple, ils avaient censuré les iniquités des princes. N'oublions pas non plus que, sous le règne de Wudi, quand l'empereur transformait en esclaves cent mille sujets, appliquait un code conforme à l'esprit des légistes et prenait pour ministre un membre de cette école d'administrateurs implacables, il feignait de favoriser en la personne de Dong Zhongshu la doctrine de Confucius. Comment le peuple aurait-il su à qui imputer ses malheurs ? À l'idéologie officielle, ou à ceux qui exerçaient en fait le pouvoir, mais sans souci des principes confucéens ? Comment aurait-il décidé s'il devait s'en prendre au souverain en titre, ou plutôt à celui que sous les Han on appelait officiellement le « roi sans couronne », l'infortuné Confucius ? Et puis, bien que ceux qui se réclamaient de lui se soient très tôt scindés en groupes, dont l'un se réclamait du patronage de son disciple Zigong, tel autre de Ziyou, le troisième de Zixia, et ainsi de suite, l'école confucéenne, de loin, semblait un tout. Dès le temps de Sima Qian, les jeux sont faits : Ceux qui se livrent à l'étude le considèrent comme leur chef. Depuis le fils du Ciel, les rois et les seigneurs, tous ceux qui dans le royaume du Milieu dissertent sur les six arts libéraux se décident et se règlent d'après le Maître. C'est là ce que l'on peut appeler la parfaite sainteté ! Tels sont les derniers mots de la biographie de Kongzi dans les Mémoires historiques.
Vers le mandarinat
Lorsque les Han postérieurs perdirent le mandat céleste, le bouddhisme avait pénétré en Chine depuis plus d'un siècle, assurément, et depuis plus longtemps encore, sans doute. Dans le chaos qui s'aggravait, tandis qu'une douzaine de dynasties se combattaient puis se partageaient les lambeaux de ce qui avait été un Empire centralisé, puissant, bien administré, une doctrine de l'impermanence des choses humaines avait de quoi séduire les masses, qui souffraient plus que jamais. Quelques souverains de la dynastie des Wei, au IIIe siècle, certains autres de la dynastie des Jin, entre le IVe et le Ve, tentèrent en vain de rouvrir des écoles confucéennes. Avec une habileté scandaleuse, certains essayaient même de démontrer que le confucianisme n'est qu'un déguisement du taoïsme, et le bouddhisme une métamorphose de ce taoïsme-là. Cette subtile façon d'accommoder les pensées s'appelait alors ge yi, analogisme. Elle s'apparente à notre teilhardechardinisme, qui se donne pour une synthèse du marxisme et du catholicisme. Comme quoi, dès qu'on abandonne la raison, l'esprit critique, on est mûr pour le syncrétisme, l'analogisme, l'œcuménisme : la confusion mentale.
Le système des examens
Pour redresser la situation, il fallut attendre le VIe siècle et la dynastie des Sui. Les Tang, qui lui succédèrent en 618, achevèrent la restauration. Les Sui avaient déjà institué l' examen de lettré accompli, et l'examen sur les classiques ; on les conserva sous les Tang en y ajoutant trois nouveaux examens : ceux de droit, de mathématiques et d'écriture purent conférer le doctorat. L'examen sur les classiques comportait plusieurs variantes : sur cinq, sur trois, sur deux classiques ; sur un seul classique, mais étudié à fond ; sur les rituels ; sur les historiens... On proposait aux candidats des citations à identifier ; on les interrogeait sur le sens général des textes ; on leur posait enfin de longues questions auxquelles ils devaient répondre sous forme de ce que nous appellerions des dissertations, dont un certain nombre nous sont parvenues. Grâce aux Traités des examens, des fonctionnaires et de l'armée, du Xin Tang shu, ou Nouvelle Histoire des Tang, que traduisit et publia R. Des Rotours, nous pouvons étudier dans le dernier détail ce que fut alors ce confucianisme figé en fonctionnariat.
Les grands romans chinois ultérieurs, comme le Jin Ping Mei ou le Rulin wai shi, la Chronique indiscrète des mandarins, et nombre de documents littéraires tant chinois qu'européens, nous ont familiarisés avec le type du mandarin cruel, vaniteux, incompétent, prévaricateur. On avait pourtant pris mainte et mainte précaution pour éviter ce genre de dégénérescence.
D'abord en élargissant le recrutement de façon que les fils de grande famille ne fussent pas seuls à se présenter aux concours : enfants pauvres mais doués, ceux qu'on appelait le tribut des provinces, et que les sous-préfets ou préfets avaient déjà recrutés par examen dans leurs ressorts, participaient au grand concours, espèce d'équivalent de notre Concours général. Toutefois, à la différence de notre Concours général qui ne décerne que des prix honorifiques, ces examens chinois étaient de recrutement, comme nos agrégations de droit, de lettres, de médecine ou de sciences, comme notre inspection des Finances, nos anciens concours d'accès aux Affaires étrangères, qui du reste en sont une imitation délibérée, ainsi que le Civil Service des Anglais. Selon l'examen qu'on passait et le rang qu'on y obtenait, on entrait à un certain niveau dans la hiérarchie, laquelle comprenait de nombreuses classes, et, dans chaque classe, des échelons.
Ce n'est pas tout : une fois cadré, le fonctionnaire qui briguait une promotion subissait diverses épreuves théoriques ; après quoi, on lui faisait passer un oral : belle occasion de contrôler ses manières. On ne négligeait pas même son talent, sa vertu, ses mérites acquis. Réussissait-il, on lui offrait trois postes, comme chez nous, naguère encore, aux maîtres de conférences en faculté ; les refusait-il tous les trois, il perdait tous ses droits, comme le maître de conférences. En Chine, il devait en outre se présenter aux prochaines épreuves.
Ce n'est pas tout : chaque année, on notait tous les fonctionnaires, en les jugeant d'après les quatre qualités et les vingt-sept perfections imaginables, en tout cas imaginées. De supérieur-supérieur à inférieur-inférieur en passant par supérieur-moyen, supérieur-inférieur, etc., on vous évaluait selon un système minutieux qui vous destinait automatiquement à une promotion de rang ou de salaire, à moins que ce ne fût à une amputation de salaire, et à rétrograder. Système tatillon, tant qu'on voudra, mais qui semble supérieur aux nôtres où, veut-on se débarrasser d'un fonctionnaire incapable, on le promeut ; l'anglais dispose même d'un mot pour ça : to kick up faire progresser à coup de pied au derrière. En 800, l'un des sujets de dissertation pour le titre de lettré accompli proposait aux candidats un texte de Confucius Entretiens familiers, XVII, 2 qui affirme que les hommes se ressemblent par leur nature, se distinguent par leurs habitudes. Celui qui deviendra l'illustre poète Bo Juyi 771-846 remit une composition qui nous est parvenue, et que traduisit R. Des Rotours. Le ton poétique de la copie ne nous en cache pas le ressassement perpétuel, qui est la loi de toute orthodoxie.
Pour les élus, les fonctions ne manquent pas, dont plusieurs périlleuses : grands conseillers de droite de l'empereur, conseillers censeurs de droite de l'empereur, fonctionnaires de droite chargés de reprendre les omissions de l'empereur, fonctionnaires de droite chargés de reprendre les oublis de l'empereur, etc.
Conséquences et réactions
Tout ce qu'on peut dire en faveur de ce système, et le peuple à ce propos ne se trompait guère, qui faisait aux concours une confiance excessive peut-être, mais significative, c'est que ce mode de recrutement et de promotion évitait de confier le privilège d'administrer à la seule aristocratie héréditaire ; qu'il réalisait – malgré tout – une forme de sélection, qu'on ne peut dire démocratique au sens rigoureux du mot, puisqu'elle ne donne au peuple aucun pouvoir et que le fonctionnaire n'est qu'un serviteur du prince, mais qui ne condamnait pas le peuple à ne jamais fournir ses propres magistrats. Dans cette tchine à la chinoise, que subsistait-il de l'esprit du confucianisme, de ces libres propos échangés au bord d'une rivière, entre maître et disciples, sur la culture intime ou les réformes politiques ? Devenu ministre de la Justice, Bo Juyi demeura fidèle aux exigences les plus rigoureuses de la doctrine, car il n'oublia jamais le petit peuple dont il sortait, dont il évoqua la misère en poèmes émus, en proses vengeresses. Néanmoins, on peut et doit se demander si la récitation par cœur des classiques et leur commentaire orthodoxe constituaient la meilleure préparation possible à gouverner un immense Empire, bureaucratique et centralisé. Et comment une philosophie de la bienveillance pouvait-elle tolérer le code pénal, si féroce parfois, de la Chine impériale ? Du point de vue technique, la réponse d'Étienne Balazs dans sa traduction du Traité juridique du Souei chou est tout à fait pertinente : La ratification des peines était de la plus haute importance pratique. Dans un régime où l'exercice de la justice était confié à des fonctionnaires-lettrés sans formation juridique spéciale, le tarif des pénalités, avec sa gradation numérique exacte, permettait de trouver rapidement et sans difficulté la peine correspondant aux différents délits. Soit. Mais du point de vue moral ? Du point de vue de ce généreux que doit tendre à devenir un disciple de Confucius ?
Chez certains hommes de qualité, le confucianisme survivait cependant comme état d'esprit et discipline morale. Au moment même où le bouddhisme semblait triompher, il se trouva au moins un Kong Yingda 574-648 pour proposer des textes confucéens un commentaire, ou plus exactement un sous-commentaire, de tendance matérialiste (accusant par conséquent ce qu'on peut considérer comme le positivisme du maître, et un Han Yu 767-824 pour célébrer le confucianisme dans son essai Sur l'origine de la voie ; pour déplorer, dans son Discours sur les maîtres à penser, qu'on ne transmette plus de maître à disciple le dao confucéen ; pour souhaiter qu'on ne jure point par les paroles d'un seul maître, puisque Confucius, lui, était le disciple de six maîtres au moins ; et pour censurer, au péril de sa vie, l'empereur qui avait participé à une procession au devant d'une relique du Bouddha. Ce même confucéen n'hésitait pas, en sa qualité de préfet, à défier jusqu'aux crocodiles qui avaient envahi la province : Devant des crocodiles, consentirais-je à baisser la tête et ravaler mon cœur ... afin de conserver si indignement ma vie ? Il proposait de restaurer dans toute leur vigueur les doctrines de Confucius et de Mencius, ce qui pour lui signifiait séculariser tous les moines et toutes les nonnes, confisquer leurs temples et monastères. Amis de Han Yu, les écrivains Liu Zongyuan et Li Ao annoncent eux aussi le jour où la vérité, si longtemps offusquée, délaissée, pourra bientôt se transmettre à nouveau.
Le néo-confucianisme
Après la proscription du bouddhisme en 845, suivie d'une laïcisation des religieux – mesures que commandait la puissance économique et financière monstrueuse qu'avaient acquise des couvents théoriquement voués à la pauvreté –, un confucianisme retrouva l'occasion de se transmettre, mais méconnaissable, à quel point métamorphosé sous l'influence de la pensée bouddhiste.
Formation de la doctrine
P. Demiéville a signalé que Han Yu lui-même, qui condamne sans nuance ni réserve le bouddhisme, n'aurait probablement point écrit comme il fit en faveur de la « voie » confucéenne si une littérature bouddhiste en langue vulgaire, d'où sortiront le théâtre et le roman chinois n'avait profondément agi sur les lettres traditionnelles.
De la même façon, Zhu Xi ne condamnera le bouddhisme que pour mieux présenter un confucianisme imprégné de cette métaphysique qu'apparemment il réprouve.
Précurseur de ce néo-bouddhisme, Zhou Dunyi 1017-1073 écrivit un Traité du faîte suprême qui s'ouvre sur une phrase longuement controversée : wu ji er tai ji, mais où il semble bien qu'il faille comprendre que le sans-faîte, wu ji des bouddhistes l'illimité, l'infini, c'est, en fait, er, le faîte suprême, tai ji, où les confucéens voient leur absolu. Bref, les deux absolus censément ennemis ne le seraient point du tout. Ce penseur n'était ni le premier, ni même le second à vouloir réformer le confucianisme. D'autres avant lui venaient de le tenter dans un tout autre sens : Hu Yuan 993-1059 et Sun Fu 992-1057 par exemple, qui condamnent le système des examens tel qu'on le pratiquait alors. Fortifier les frontières, irriguer les terres, nourrir et vêtir le peuple, voilà qui importait infiniment plus que la récitation de formules quasi sacrées. Et foin d'une culture exclusivement littéraire, car elle ne prépare pas à bien gouverner l'Empire !
Sous les Song, certains hommes d'État tentèrent d'appliquer ces principes : le Premier ministre Fan Zhongyan 989-1052 notamment, qui décida que les copies des examens seraient anonymes, et donna le pas à l'histoire sur la poésie, à la science politique sur la littérature dans la formation des futurs fonctionnaires. Un peu plus tard, les deux frères Cheng demandèrent qu'on en revînt à la vraie pensée de Confucius et de Mencius, et, du même mouvement, qu'on en finît avec la grande propriété, qu'on adoptât le système du puits, qu'on luttât efficacement contre la misère et la famine. Plus radicale encore la réforme la révolution, pour mieux dire préconisée puis commencée par un contemporain de Zhou Dunyi, ce Wang Anshi 1021-1086 sous qui, d'après les chroniques chinoises, la terre trembla. Il fit notamment rédiger une édition glosée à neuf des classiques confucéens, qui devint la seule orthodoxe ; mais il se trouva bientôt en butte aux attaques de ceux des confucéens pour qui la bienveillance l'emporte sur la justice, et qui n'acceptaient pas les moyens énergiques, c'est-à-dire peu vertueux, dont le ministre entendait se servir pour réaliser des réformes qu'on qualifie parfois de socialistes, et que le régime du président Mao présentait en effet comme une première étape vers la justice sociale. Il dut céder le pouvoir.
Dès lors, au lieu de se rappeler constamment que partage, distribution, voilà les fleurs de l'humanisme, les néo-confucéens de la dynastie Song, échaudés par cet échec de l'action politique, se replient vers la métaphysique. C'est le temps de Zhu Xi 1130-1200, dont les éditions et les commentaires des classiques remplaceront, dès 1313 et jusqu'au XXe siècle, dans tous les concours officiels, les gloses de Wang Anshi ; Zhu Xi qui non seulement mit au point un nouveau corps de classiques, le Si shu, les Quatre Livres Mencius y devient enfin canonique, ainsi que le Da xue et le Zhong yong ; Zhu Xi qui compila en outre la Petite Étude, ou Xiao xue, pour vulgariser l'enseignement du Da xue, la Grande Étude.
Quand il mourut, en 1200, après les tribulations à quoi pouvait s'attendre tout fonctionnaire scrupuleux, un annaliste bien pensant écrivit que tous les hérétiques de l'Empire se sont rassemblés pour accompagner à sa tombe l'hérétique par excellence. Quiconque pense est hérétique, dira plus tard Bossuet, fort judicieusement. Quand Descartes mourut : Un sot vient de mourir décréta un bon esprit faut-il croire !. Zhu Xi n'est pas Descartes ; ce serait plutôt le saint Thomas de la Chine : de même que saint Thomas, condamné de ce chef à son époque, voulut concilier la sensibilité chrétienne et la pensée aristotélicienne, le messianisme juif et la logique hellène, Zhu Xi tenta de concilier un absolu bouddhiste, le li, avec la tradition morale de Confucius et de Mencius. Sa conduite calquait celle du lettré, telle que nous la propose le chapitre Ru xing du Mémorial des rites ; mais, comme l'écrivit P. Demiéville, « le vieux naturalisme chinois ne se laissait pas si aisément marier à l'immanentisme indien ». De fait, la dialectique du li et du qi, que l'on peut essayer de traduire en termes platoniciens idée-chose, ou mieux encore aristotéliciens forme-matière, nul jamais ne pourra la déduire d'un texte confucéen, d'une page de Mencius. De même en interprétant le fameux ge wu de la Grande Étude comme si cette expression signifiait : retrouver le li de chaque chose, c'est-à-dire son essence, son en soi, et par là s'approcher du li suprême, obtenir la clarté parfaite, Zhu Xi s'éloigne délibérément d'une pensée qui se réfère toujours à l'expérience et à la réflexion, plutôt qu'à l'illumination, laquelle, en revanche, est bouddhiste.
Il ouvre dans le confucianisme une voie si neuve que bien habile qui saurait y reconnaître la pensée des pères fondateurs, et si peu orthodoxe qu'elle aboutira tout naturellement à l'attitude de Wang Shouren 1472-1529, plus connu sous le nom que lui donnèrent ses étudiants, Wang Yangming. À force de persévérer dans la direction suggérée par Zhu Xi on prétend que sept jours et sept nuits durant il s'efforça de scruter le li du bambou, il obtint l'illumination et sut que ge wu, scruter les êtres, revient à s'analyser soi-même, chacun de nous étant à la fois le sujet et l'objet de la connaissance intuitive : Lorsque vous ne voyez pas ces fleurs, elles et votre esprit entrent en repos. Quand vous les voyez, leurs couleurs deviennent manifestes. Vous savez du coup que les fleurs ne sont pas extérieures à votre esprit. Nous voilà loin du pragmatisme de Confucius, ou des tentations rationalisantes et matérialistes élaborées par certains de ses disciples. Alors que, pour utiliser notre terminologie, le confucianisme de Zhu Xi se rapproche du conceptualisme réaliste de saint Thomas d'Aquin, celui de Wang Yangming – est-ce encore du confucianisme ? – tend à l'idéalisme absolu, au solipsisme. La connaissance intuitive devint l'alpha et l'oméga de sa pensée.
Sous l'influence du bouddhisme, la leçon de choses que constituait l'enseignement de Confucius évoluait en recherche de l'absolu.
Une nouvelle orthodoxie et ses critiques
À la mort de Maître Wang, l'empereur interdit d'enseigner cette doctrine qu'il estimait subversive ; cinquante ans plus tard, les tablettes des deux hérétiques Zhu Xi et Wang Yangming étaient religieusement déposées au temple de Confucius. L'interprétation qu'ils suggéraient du vieux maître deviendra, jusqu'en 1911 et la suppression des examens, le dogme d'une orthodoxie souvent hélas complice de tyrans.
Les esprits libres ne manquèrent point de l'attaquer. Gu Yanwu 1613-1682 condamna chez Wang Yangming des affinités bouddhistes, et des spéculations abstruses sur des notions elles-mêmes hasardeuses. Tous ces néo-confucéens qui discutent de ce que nous appellerions le sexe des anges ne lui disent rien qui vaille, et, à son jugement, ne valent rien : que font-ils pour soulager la misère des petites gens ? Plusieurs autres confucéens de la dynastie mandchoue, que leur audace écarta souvent des histoires officielles de la pensée chinoise – et notamment ou peu s'en faut de la meilleure, celle de Feng Youlan – affirment des thèses analogues : Huang Zongxi 1610-1695, dont le Traité de la monarchie réaffirme les idées confucéennes sur les devoirs du souverain et tient les empereurs mandchous pour des particuliers qui ne méritent et n'obtiennent aucune allégeance ; ou encore Yan Yuan 1635-1704, ennemi du savoir livresque, matérialiste soucieux des humbles, partisan de la tenure des terres selon Mencius, et soucieux d'étendre la terre chinoise au point d'exalter la carrière des armes, ce qui est rare en son pays, mais qui peut à la rigueur s'appuyer sur une au moins des anecdotes que nous livre Sima Qian dans sa vie de Confucius ; Dai Zhen 1724-1777 enfin, qui critiqua vivement la dialectique du li et du qi, et, sous l'influence des jésuites installés à Pékin, se passionna pour les sciences, les techniques, revenant ainsi aux leçons de choses. Tout son savoir ne l'empêcha pas d'être huit fois collé aux examens. Voilà ce que c'est que de faire la mauvaise tête et de ne pas donner dans l'idéalisme quand le souverain a décidé que c'était la seule vérité.
Tels sont pourtant les confucéens authentiques, ceux qui ramènent à la sagesse, à l'action morale, sociale et politique des contemporains, tentés par l'évasion vers la forme, la matière, l'illumination, voire l'illuminisme.
Diffusion du confucianisme
L'impérialisme chinois porta le confucianisme jusque dans la péninsule indochinoise au sud ; au nord-est, dans la péninsule coréenne, d'où la doctrine gagna le Japon. Au XXe siècle encore, le Vietnam en est marqué. Le culte des ancêtres y demeure un des premiers soucis, la piété filiale reste admise comme valeur suprême. On dit parfois que la « grande famille » vietnamienne n'a jamais eu le pouvoir tyrannique que le romancier chinois contemporain Bajin condamne dans sa triologie Jia, La Famille. Un illustre roman vietnamien, le Kim van kiêu, montre pourtant jusqu'où peut se porter chez une fille l'excès de piété filiale : jusqu'à se vendre en qualité de prostituée pour payer les dettes des siens.
Dès le IIe siècle de notre ère, des lettrés vietnamiens allaient briguer dans la Chine des Han les titres officiels. À l'occasion de la seconde invasion chinoise 1405-1427, la diffusion des livres canoniques, interdite jusque-là dans les pays feudataires, y devint obligatoire. La doctrine de Zhu Xi fut inscrite au programme des concours triennaux de recrutement ; elle y resta même en vigueur après l'évacuation du Vietnam par les colonisateurs.
Sous l'impulsion de la politique mongole, le néo-confucianisme se diffusa également vers la Corée, sous le nom de Tjou Tja Hak Étude de la théorie de Zhu. En 1401 monta sur le trône le roi Htai Tjong, qui chassa de sa cour les bonzes, laïcisa une part des biens de l'Église bouddhiste ; grâce à quoi, il fonda des écoles confucéennes. Si la Corée alors dépassa la Chine dans l'art de l'imprimerie, sans doute le doit-elle à ce vrai roi qui abdiqua en 1419 afin de se modeler sur la perfection confucéenne du souverain. Stimulé par cet exemple, Syei Tjong ne toléra plus que trente-six pagodes, fit célébrer selon le rituel confucéen les funérailles de son royal prédécesseur, réforma les instruments de musique et divulgua le confucianisme jusque dans les campagnes, ce que facilita sa réforme de l'écriture, qui réduisait à vingt-huit les caractères 1446. Par la vertu de ces deux vrais rois, au sens confucéen du terme, la Corée prouva que le confucianisme, pareil à bien des institutions humaines, s'il est capable du pis, l'est aussi du meilleur.
C'est même à l'heureuse influence de la doctrine de Confucius que certains historiens attribuent l'essor du Japon au XIXe siècle. Le néo-confucianisme s'insinua dans ces îles dès la fin du XVe, à la faveur d'une confusion ingénieusement entretenue entre confucianisme et bouddhisme. La doctrine se partagea en plusieurs sectes, dont l'une se réclamait de Zhu Xi, l'autre de Wang Yangming en japonais Yōmei, la troisième de l'école chinoise des Han ; Itō Jinsai l'illustra. Asaka Gonsai 1785-1860 restaura la doctrine des dénominations correctes, refusa l'orthodoxie et n'oublia pas le sort des petites gens ; mais un adepte de la doctrine idéaliste de Yōmei, Yoshida Shōin, s'efforça de lier connaissance avec les marins américains de Perry 1854. Il le paya de sa vie. Sakuma Shozan et Katsu Awa continuèrent à soutenir qu'un peuple qui construit des navires capables de marcher contre le vent ne saurait être entièrement barbare. Une fois encore, des hommes de progrès s'inspiraient de Confucius, et le payèrent de leur vie.
S'il est facile de dauber sur les mœurs des mandarins de la dynastie mandchoue, quelle injustice d'oublier que le confucianisme fournit aux Coréens leurs deux rois les plus populaires et les plus grands à la fois, ouvrit l'esprit de certains Japonais aux valeurs des civilisations étrangères, produisit en Chine même des penseurs audacieux, des fonctionnaires intègres, ou héroïques ! Le mot confucianisme recouvre tant de doctrines divergentes, contradictoires, qu'au nom du principe confucéen des dénominations correctes on devrait évidemment y renoncer, ou alors il faudrait préciser en chaque circonstance de quelle variété de confucianisme on parle. On doit donc s'interdire de le condamner en bloc, ce qui ne saurait être que le fait du fanatisme politique, ou de louer en vrac, comme firent nos jésuites des XVIIe et XVIIIe siècles, à des fins apologétiques. Et puis, si la doctrine ne disons point la pratique du confucianisme selon Confucius et Mencius était inéluctablement génératrice d'arriération mentale et de tyrannie, comment expliquer que l'Europe des Lumières s'engoua du Vieux Maître et s'en inspira pour combattre les tyrannies jumelles de l'Église catholique et de l'absolutisme politique ? De La Mothe Le Vayer à Voltaire et aux physiocrates, c'est à qui sera le plus confucéen, parmi ceux qui, pensant mal, pensent mieux que ceux qui pensent bien. C'est à qui fera de Confucius le Socrate, puis le Spinoza de l'Asie.
On comprend que les Chinois de la dynastie mandchoue aient eu, au XIXe siècle et au début du XXe, un sentiment tout contraire : nos Lumières ne considéraient que les lumières de la doctrine ; soumis à des préfets incompétents, à des juges cupides, les Chinois ne voyaient, eux, que les ombres et les vices de la pratique. En vain essaya-t-on de les persuader que les principes restaient vastes et profonds.
Confucius et Mao
Une fois supprimés les examens après la révolution de 1911, Kang Youwei, soucieux de revenir à Confucius et Mencius, voulut en vain faire adopter leur pensée, constitutionnellement, comme religion d'État ; c'est en vain également que Zhen Huanzhang prétendit déduire du confucianisme des principes économiques capables de « moderniser l'Empire du Milieu ». Le confucianisme se releva d'autant plus difficilement des coups que lui porta le philosophe libéral Hu Shi que les meilleurs écrivains de la Chine contemporaine, Luxun, Guo Moruo, Mao Zedong et Bajin en ridiculisaient ou condamnaient la décadence, dont le titre de Maurice Dekobra, Confucius en pull-over, porte chez nous témoignage, cependant que la comédie légère de Lin Yutang, Confucius et Nancy, confirmait en Chine cette désaffection. Encore que Guo Moruo ait brocardé en ses Mémoires le batteur d'estrade qui venait au village marmonner le Saint Édit promulgué en 1671 par Kangxi, il soutiendra en 1945 que Confucius fut champion du menu peuple, voire un partisan de la rébellion armée contre le pouvoir injuste. Plus sévère est Mao Zedong ; élevé par un père confucéen, il conçut contre la doctrine une haine vigilante et se proposa d'en libérer les Chinois ; non toutefois sans s'y référer à l'occasion, comme dans La Nage, poème composé en 1956, et qui s'achève sur ces mots :
Le Maître l'a bien dit, sur les bords d'un cours d'eau :
Allons de l'avant, comme le flot s'écoule !
Le maître, c'est Confucius. Fidèle aux directives de Yan'an, selon lesquelles il faut conserver l'héritage culturel en lui donnant un sens nouveau, le président-poète interpréta en activiste le texte confucéen. Un ancien commentateur ayant glosé la même anecdote en ces termes : L'homme de qualité imite ce mouvement, on voit que, bien éloigné de violer la tradition, le président Mao en perpétua cette fois l'esprit. Radicale, en revanche, la critique de Luxun : dans un essai de 1925 sur L'Étude des classiques, il se félicita qu'il y ait en Chine des analphabètes pour échapper aux dissertations rituelles à huit jambes, dont seul un abruti, à l'en croire, pourrait venir à bout. Il ajouta se démentant : J'ai moi-même étudié les treize classiques, tous. Dix ans plus tard, dans Confucius et la Chine moderne, il reprocha au vieux Maître de s'être momifié en roi très parfait et très saint d'une culture frelatée au nom de laquelle on interdisait aux Chinois l'étude des sciences exactes et des techniques. Il l'accusa également d'avoir écrit que les rites ne descendent pas jusqu'au peuple et de n'être plus que « le saint des puissants ou de ceux qui veulent le devenir. Depuis la révolution culturelle, il semble que le président Mao adopta ces idées outrancières : qu'est-ce que le Petit Livre rouge, sinon le Xiao xue de ce néo-marxisme ? Or, par un retournement dialectique dont nul ne devrait s'étonner, les sujets du président Mao furent invités c'est peu dire à étudier par cœur ce catéchisme de persévérance, comme on faisait jadis et naguère les cinq ou les treize classiques ; à le réciter en famille, cette fois sous la surveillance des enfants, comme jadis on ânonnait par piété filiale les articles du Saint Édit. Des sinologues aussi avertis que MM. Ryckmans et Vandermeersch concluent donc à bon droit que l'essentiel du confucianisme inspire encore le maoïsme : la parole est le fondement de tout, la vertu l'emporta sur la technique. Alors que Staline, dont Mao se feignit sectateur, affirmait qu'en période de construction socialiste « la technique décide de tout, le président Mao enseigna qu'il faut d'abord être rouge et qu'ipso facto on devient compétent. Pour Mao, comme pour sa bête noire, l'homme de qualité n'est pas seulement un spécialiste.
En dépit de tant de secrètes affinités, le maoïsme condamna donc les vestiges du confucianisme. Paradoxalement, le régime de Jiang Jieshi Tchiang Kai-chek célébra pompeusement les anniversaires d'un moraliste qu'il bafoua, alors que la Chine communiste proscrit une doctrine qu'elle illustre à plus d'un égard. Ce ne sont pas les moins curieuses métamorphoses du vieux sage. En tout cas, communiste ou non, la Chine aurait grand tort de renier celui qui fut son instituteur, et à qui tout homme de qualité, toujours et en tous lieux, saura gré d'avoir inspiré la généreuse conduite du lettré.
Ce fut pourtant le cas, durant les saturnales qui se baptisèrent, où qu'on baptisa, révolution culturelle, le moment le plus extravagant étant celui où Lin Biao, préfacier du Petit Livre rouge et dauphin désigné de l'infaillible président Mao, se vit accusé de confucianisme. Il vaut la peine, hélas, de lire ce qu'imprimait Pékin Information dans le numéro du 11 février 1974 : À travers des discussions, tout le monde a bien vu que critiquer Confucius est une partie composante de la stigmatisation de Lin Biao, et que cela constitue une importante lutte politique. En imitant Confucius pour se modérer et en revenir aux rites, Lin Biao tentait vainement de restaurer le capitalisme .... En colportant vertu, bienveillance et justice, fidélité et indulgence, vertus notoirement confucéennes, il attaquait la dictature du prolétariat ; avec se tenir dans le juste milieu, contresens délibéré pour milieu juste, ce qu'atteint l'archer qui frappe le centre de la cible, ... il contrecarrait la philosophie marxiste de la lutte ; en se servant de la philosophie réactionnaire de la vie que professaient Confucius et Mencius, il complotait et menait des activités inavouées ...; en recommandant à son fils le culte de Confucius et l'étude du canon confucéen, il rêvait d'établir la dynastie héréditaire des Lin, et ainsi de suite. Bref, Lin Biao est bien le disciple de Confucius et de Mencius.
Toutes ces inepties furent récitées, amplifiées en France par les maos, les intellectuels surtout, alors qu'il aurait suffi de savoir lire pour tirer de Critique de Lin Piao et de Confucius, paru en 1975, l'humble, l'évidente vérité : la clique au pouvoir, atteinte de paranoïa, accusait de la rage tous ceux qu'elle voulait perdre, et vouait aux gémonies ceux qui, comme le signataire de cet article, avaient durement condamné Lin Biao quand il était encore l'idole numéro deux de la prétendue révolution culturelle... Pour les esprits curieux, qu'ils se reportent donc à l'annexe bibliographique de cette édition renouvelée : Les Saturnales de la révolution culturelle.
Liens
http://www.ina.fr/video/VDD09029987/l ... ciete-chinoise-video.html Retour de Confucius en chine
http://youtu.be/el3i3TfNg-I Confucius le film (Anglais)
http://youtu.be/XTk1fOSeLik Cours de Anne Cheng sur Confucius           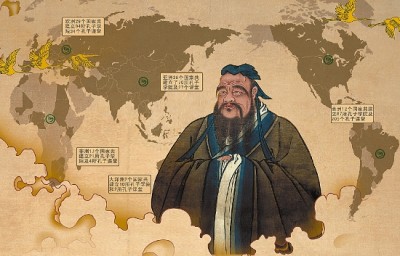 
Posté le : 27/09/2014 21:05
|
|
|
|
|
Pompée empereur |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 28 septembre de l'an 48 av. J.-C. à Péluse, en Égypte orientale meurt
Pompée,
dit Pompée le Grand latin: Cnaeus Pompeius Magnus général et homme d'État romain, né le 29 septembre de l'an 106 av. J.-C dans le Picenum, dans l'actuelle région des Marches en Italie Pompée. Il se marie cinq fois et épouse notamment Julia, la fille de Jules César.
Il commence sa carrière militaire sous les ordres de son père, puis, remarqué par Sylla qui lui accorde sa confiance, il remporte ses premiers succès militaires importants en Sicile et en Afrique en 82 av.J.-C.
De 77 av. J.-C. à 72 av. J.-C., Pompée est chargé de mener en Hispanie une guerre difficile contre Sertorius, qui a constitué dans la péninsule ibérique un État indépendant.
S'étant couvert de gloire par sa victoire sur les pirates en Méditerranée en 67 av. J.-C puis par ses conquêtes en Orient l'année suivante en étant imperator, il conclut avec César et Crassus le premier triumvirat, par lequel les trois se partagent le pouvoir à Rome en 60 av. J.-C.
En 52 av. J.-C., il est nommé par le Sénat consul unique de Rome — fait exceptionnel — pour rétablir l'ordre et le calme dans la cité, en proie à des affrontements.
Il est l'adversaire de César lors de la guerre civile qui éclate en 49 av. J.-C. En dépit de l'opposition de Caton, inquiet de son influence grandissante dans les affaires de l'État, la majorité des sénateurs se range derrière lui et déclare César ennemi public.
Après une campagne difficile en Grèce en 48 av. J.-C., qui se termine par sa défaite lors de la bataille de Pharsale, Pompée se réfugie en Égypte, où il est assassiné sur l'ordre de Ptolémée XIII, sur la plage du Péluse le 28 septembre 48 av. J.-C.
Brillant général, il a célébré trois triomphes au cours de sa vie. Il est surnommé par Sylla et par ses soldats Pompée le Grand en référence à Alexandre le Grand.
En tant qu'administrateur, Pompée se veut un brillant bâtisseur. Il fonde Nicopolis, dans la province du Pont. Il revendique la création de bien d'autres cités en Orient, comme Pompéiopolis, en Cilicie, et également en Hispanie. À Rome, il fait construire le théâtre de Pompée ainsi que plusieurs temples. Il est également l'instigateur de la création des provinces romaines de Syrie et de Pont-Bythinie.
En bref
Issu d'une famille de noblesse récente, riche propriétaire de terres dans le Picenum, il participe très jeune à la lutte contre les partisans de Marius en Sicile et en Afrique ; il est proclamé imperator par ses troupes, qui lui donnent le surnom de Magnus le Grand ; Sulla ne peut lui refuser le bénéfice du triomphe à 25 ans. Il combat Sertorius en Espagne 72, puis écrase avec Crassus les bandes de Spartacus 70. Il est élu consul sans avoir accompli la carrière traditionnelle des magistratures. En 67, il réussit une campagne contre les pirates. En 66, il reçoit la direction de la guerre contre Mithridate, laquelle se transforme en une conquête de l'empire séleucide.
De retour à Rome janvier 61, il doit restaurer sa position politique par une entente avec Crassus et César. C'est le premier triumvirat : il épouse Julia, fille de César 60. Le renouvellement de cet accord à Lucques, en 56, est un partage du monde : la péninsule Ibérique est attribuée à Pompée. Mais il reste à Rome, où il est en 52 consul sans collègue. Contre César vainqueur en Gaule, il s'accorde avec le sénat. Quand César franchit le Rubicon, Pompée préfère abandonner l'Italie. Il regroupe ses forces en Illyrie. Mais la bataille de Pharsale 9 août 48 est un échec sans rémission. Il s'enfuit en Égypte, où il est assas
Sa vie
Pompée est le fils de Gnaeus Pompeius Strabo, originaire du Picenum, une région située en Italie centrale. Strabo possède des domaines si vastes qu'il est en mesure de lever lui-même des troupes parmi ses tenanciers. Consul en 89 av. J.-C., il se fait remarquer par ses succès lors de la guerre sociale et, par la suite, par la haine que devait lui vouer le peuple de Rome pour son avarice, ce qui fera dire à Plutarque : Jamais père n'aura réussi à obtenir tant de haine et son fils tant de gloire. La fortune de Pompée Strabo était déjà considérable, celle de Pompée est une des plus importantes de son temps, estimée à au moins deux cents millions de sesterces.
Jeunesse et formation
Pompée est, dès son plus jeune âge, entraîné au maniement de l'épée ou au lancer de javelot à cheval. Il reçoit des éléments d'éducation hellénique, destinée à lui enseigner l'éloquence, mais, amené très tôt à partager avec son père la vie rude des camps militaires, il n'a pas l'occasion de terminer cette éducation. Si Plutarque parle de son éloquence persuasive Cicéron tempère ce jugement : Pompée, se serait fait un nom plus grand dans l'éloquence, si une autre ambition ne l'eût entraîné vers la gloire plus éclatante des guerriers.
En 90 av. J.-C, la Guerre sociale éclate en Italie. En effet, les alliés italiens se révoltent contre Rome après l'assassinat du tribun de la plèbe Livius Drusus, qui avait déposé une motion au Sénat dans le but de faire accéder ces peuples à la citoyenneté romaine. Pompée est aux côtés de son père lors de cette guerre en tant que tribun militaire. Il assiste et prend part au siège d'Asculum qui offre à son père un butin extraordinaire lors du pillage de la ville par ses troupes, lui valant le poste de consul pour l'année 89. C'est au cours de ce siège que Pompée rencontre le jeune Cicéron, qui a le même âge que lui.
Pompée est ensuite témoin des premières guerres civiles, qui opposèrent le parti populaire de Marius au conservateur Sylla. En -87, son père décède, frappé par la foudre selon Plutarque, ou peut-être plus simplement touché par la dysenterie qui faisait des ravages dans son armée. Lors des obsèques, une foule hostile donne libre cours à sa haine pour le défunt et arrache le corps de son lit funèbre.
Pompée et Sylla
Le décès de son père coïncide avec le triomphe des populares de Cinna et Marius, qui font régner la terreur à Rome. Plus de 10 000 morts sont à déplorer sur le Forum. Pompée, comme optimate, est contraint de ne pas se faire remarquer. Sa maison romaine est mise à sac par les gardes du corps de Cinna. Lorsqu'il retourne à Rome, il est poursuivi pour détournement du butin du pillage pendant le sac d'Asculum. Ses fiançailles avec la fille du juge, Antistia, lui assurent une rapide absolution.
Sylla revient d'Orient en -83 avec ses légions et débarque à Brindes pour marcher sur Rome. En effet, il a conclu la paix avec le roi Mithridate à Dardanos. Il peut maintenant retourner en Italie pour affronter les populares. Sylla dispose de plus de 40 000 hommes.
Pompée, quant à lui, se trouve dans son domaine du Picenum et se range dans le camp de Sylla. Il lève par conséquent une armée dans la région et parvient à réunir trois légions, quelque 15 000 hommes. Avec son armée, il chasse les partisans de Marius du Picenum, ralliant ainsi toute la région à Sylla. Le consul Carbo envoie ses légats Carrinas, Brutus et Celius pour mettre fin aux agissements de Pompée. Ce dernier livre bataille et se distingue pendant le combat. Plutarque rapporte que Pompée, en abattant le premier ennemi, un chef gaulois faisant partie de la cavalerie marianiste, qui s'avançait, provoque la débandade de ses adversaires. Pompée fait sa jonction avec Sylla en 83 av. J.-C. Ce dernier apprécie le ralliement de Pompée, dont les troupes constituent un appoint non négligeable. Parmi eux se trouve Crassus, qui devient très vite le rival de Pompée au cours de cette guerre. Sylla, quant à lui, et avec les renforts de Pompée, marche sur Rome, où le fils de Marius fait assassiner tous ceux qu'il soupçonne de sympathie pour Sylla. Parmi les victimes se trouve Antistius, le beau-père de Pompée. Le consul Carbo, lui, s'enfuit en Sicile.
Lucius Cornelius Sulla
Alors que Sylla entre dans Rome, la moitié de son armée, dont Pompée, affronte les troupes marianistes dans le centre de l'Italie. Pompée n'a pas l'occasion de se distinguer particulièrement au cours des dernières opérations dans la péninsule italienne. Pour s'attacher Pompée, Sylla lui offre sa belle-fille, Æmilia Scaura, comme épouse. Æmilia est déjà mariée et est enceinte mais divorce de son mari. Pompée fait de même avec sa femme Antistia. Bien qu'Æmilia meure en couches peu de temps après, le mariage confirme la fidélité de Pompée à Sylla, ce qui contribue fortement à l'avancement de sa carrière.
En 82 av.J.-C, Pompée est chargé de chasser les troupes marianistes de Sicile ainsi que d'Afrique. Il bat les partisans de Caius Marius en Sicile puis débarque en Afrique. De cette époque date son surnom de Adulescentulus Carnifex l'Adolescent boucher à cause de sa froideur et de sa cruauté sur le champ de bataille. On lui reproche notamment l'exécution ignominieuse du consul Carbo en Sicile, qui l'avait pourtant soutenu alors qu'il était accusé de détournement quelques années plus tôt. En Afrique, il affronte le marianiste Domitius. Dès qu'il débarque dans la région, plus de 7 000 soldats de Domitius se joignent à lui, ce qui lui fait une armée de plus de 40 000 hommes. Après avoir vaincu Domitius, Pompée pénètre en Numidie pour rétablir l'infuence romaine dans ce royaume car Domitius y avait placé un souverain favorable aux populares. Pompée sort victorieux de cette campagne.
Allant de victoire en victoire, il est acclamé imperator par ses troupes, alors qu'il n'est encore qu'un chevalier, ce qui est un fait exceptionnel pour l'époque. Il ne possédait en effet aucune charge officielle. Après la Numidie, Sylla lui ordonne de revenir à Rome. Revenu victorieux de ses campagnes contre les derniers partisans du parti de Marius, il reçoit de Sylla le surnom cognomen de Magnus, ce qui signifie le Grand en référence à Alexandre le Grand. Ce surnom sans doute sarcastique à cause de l'âge de Pompée le flattait discrètement et il jugera bon de l'utiliser plus tard, lorsque sa gloire militaire atteindra son apogée. Sylla alors dictateur de Rome décide de lui accorder un triomphe. Ce jour-là, Pompée tente d'éclipser ses aînés avec un char de triomphe tiré par quatre éléphants, rappelant ses conquêtes africaines, mais les éléphants n'arrivent pas à franchir la porte de la ville, pour le plus grand embarras de Pompée et le divertissement du public. C'est au cours de cette période qu'il a une liaison avec une courtisane nommée Flora, qui ne dure cependant pas car Sylla lui offre une nouvelle épouse, Mucia Tercia, la femme de Marius le Jeune, le fils de Marius lui-même.
En 80 av. J.-C, Sylla en a terminé avec la politique et se retire dans sa villa de Campanie. Il meurt en -78. Pompée est exclu de son testament: malgré la désapprobation de Sylla, il avait appuyé la candidature au consulat de Lépide. Sylla lui avait alors prédit que Lépide serait un trouble-fête. Les événements lui donnent raison.
Pompée contre Lépide
Après la mort de Sylla, le consul Lépide et ses partisans s'opposent à ce qu'on lui fasse les obsèques qui convenaient à un homme de son rang. Pompée, utilisant son prestige, veut se distinguer par lui-même, et les oblige à renoncer à leur projet et fait rendre à Sylla tous les honneurs. Ces obsèques sont le premier exemple de funérailles nationales romaines.
Lépide, qui se trouve en Gaule Cisalpine avec ses partisans, entre en conflit avec le sénat. Les sénateurs confient à son collègue Catulus la tâche de réprimer la rébellion et lui adjoignent Pompée, sans que l'on sache exactement à quel titre, soit comme légat de Catulus, soit indépendamment. En 77 av. J.-C. Pompée réunit des légions, marche contre Mutina et y assiège un des lieutenants de Lépide, Brutus, le père de Marcus Junius Brutus, l'assassin de Jules César Brutus est tué dans des circonstances obscures. L'épisode met en lumière un des aspects parfois sombres de Pompée : on lui reproche d'avoir fait exécuter Brutus, alors que celui-ci s'était rendu.
Pendant ce temps, Lépide décide de marcher sur Rome en évitant Pompée. Catulus, à la nouvelle de la victoire de Pompée, réunit une armée et affronte celle de Lépide aux portes de Rome. L'armée de Lépide, peu motivée, se débande et s'enfuit en Etrurie. Pompée, qui s'était mis en route avec son armée en direction de Rome, croise les fuyards et en massacre un grand nombre. Lépide, quant à lui, s'enfuit en Sardaigne où il meurt peu après.
Pompée en Espagne
En 77 av. J.-C., principal représentant des optimates, Pompée est envoyé en Hispanie pour lutter contre les derniers partisans de Marius conduits par Sertorius et Marcus Perperna Veiento. La mission n'est pas facile car Sertorius bénéficie du soutien des populations locales. Il dispose de 60 000 hommes, principalement recrutés parmi la population locale ainsi que de 8 000 cavaliers. De son côté, Pompée traverse les Alpes par une route fort longue, à la tête de 30 000 fantassins et de 1 000 cavaliers. Au printemps de 76 av. J.-C., après avoir remis de l'ordre en Gaule transalpine, il passe en Espagne et fait sa jonction avec Quintus Caecilius Metellus Pius, proconsul d'Hispanie ultérieure. Sertorius est un excellent général qui tient Pompée en piètre estime, qu'il appelle "l'écolier de Sylla". La fortune des armes change plusieurs fois de camp : Pompée est d'ailleurs plusieurs fois vaincu par Sertorius comme à Lauro, à Sucro ou encore à Sagonte et est blessé lors des affrontements. Après avoir adressé au sénat une lettre menaçante évoquant sa possible défaite au cas où des renforts et du blé ne lui seraient pas envoyés, Pompée reçoit deux légions de plus en 74 av. J.-C..
Devant la possible défaite de Sertorius face aux troupes de Pompée et de Metellus, Perpenna, son principal lieutenant, l'assassine au cours d'un banquet en 72 av. J.-C., ce qui précipite la chute des marianistes dans la région. La mort de Sertorius permet donc à Pompée de l'emporter et de terminer peu après la pacification de l'Hispanie.
Après quoi il retourne en Italie par les Pyrénées. À la frontière entre la Gaule et l'Espagne, il fait construire un monument connu sous le nom de Trophée de Pompée retrouvé en 1984, rappelant les cités et les peuples soumis lors de ces campagnes.
Pompée contre Spartacus
En 71 av. J.-C, il revient en Italie avec ses légions alors que la péninsule tremble face à la révolte servile dirigée par Spartacus. Ce dernier s'est enfui d'une école de gladiateurs de Capoue et a saccagé le Picenum, région natale de Pompée, avec 100 000 hommes en armes.
Crassus, qui est chargé de le vaincre, connaît quelques déboires. Il commet alors une erreur, qu'il regrettera : demander au sénat de donner l'ordre à Pompée de lui venir en aide. Au bout du compte il anéantit le principal groupe de révoltés et Spartacus est tué. De son côté, gagnant par là à bon compte l'affection du peuple de Rome, Pompée disperse la dernière bande errante, quelque 5 000 hommes, qui tente de s'enfuir par le nord.
Crassus, qui venait de tailler en pièces la principale bande de révoltés sans susciter un tel enthousiasme, en conçoit une certaine amertume. Si cet épisode engendre des tensions entre les deux rivaux, leurs intérêts convergents les poussent néanmoins à s'allier contre le Sénat.
Le consulat de Pompée et de Crassus
De retour à Rome, Pompée se présente au consulat pour l'année suivante. Sa candidature est totalement anormale puisqu'il n'a pas suivi le cursus honorum, chemin obligé pour accéder au consulat. Sa popularité est telle qu'on ne peut faire autre chose que de lui accorder une dispense. Crassus pose également sa candidature. Les deux hommes sont élus consuls pour l'année 70 av. J.-C.. Les deux généraux, contrairement à la tradition, plutôt que de licencier leurs soldats, les maintiennent campés en armes à proximité de Rome. Pompée assure qu'il licenciera ses légions après son triomphe. Crassus, quant à lui, affirme qu'il ne licenciera les siennes que si Pompée le fait d'abord. Pompée célèbre alors son triomphe, tandis que Crassus doit se contenter d'une ovation, honneur moindre. Les deux hommes se rendent finalement aux supplications du peuple et se réconcilient en public sur le Forum puis démobilisent leurs troupes, ce qui écarte le spectre d'une nouvelle guerre civile.
Au cours de son mandat consulaire, Pompée gagne la faveur du peuple en rendant aux tribuns de la plèbe les pouvoirs qui leur avaient été retirés sous Sylla, c'est-à-dire l'initiative législative et le droit de veto sur les décisions d'autres magistrats ou du Sénat. Il restitue également aux chevaliers le droit de siéger dans les tribunaux. Bien qu'aucun historien ne le mentionne, il y a tout lieu de supposer que les chevaliers ont dû lui témoigner financièrement leur reconnaissance. Ce faisant, Pompée, qui a contribué à la victoire des optimates sous Sylla, se repositionne sur l'échiquier politique. Il s'attire cependant la méfiance de beaucoup de sénateurs, hantés par la dictature.
À la fin de leur mandat, tant Pompée que Crassus renoncent au proconsulat qui leur revient. Le commandement d'une province est pour un ancien consul l'occasion soit de se couvrir de gloire par l'un ou l'autre exploit militaire, soit de s'enrichir aux dépens de ses administrés. Crassus est déjà immensément riche. Quant à Pompée, il a déjà fait ses preuves militairement. Il se contente de siéger au Sénat, dont il est, à 37 ans, un des plus jeunes membres, en attendant qu'on lui attribue un commandement militaire à sa mesure. Il devra patienter quelque peu.
Pompée contre les pirates
Durant l'hiver 67 av. J.-C., Pompée reçoit, par la lex Gabinia , la motion portant le nom du tribun de la plèbe Gabinius, un imperium exceptionnel pour éliminer la piraterie de Méditerranée. En effet, par leurs raids incessants, les pirates qui perturbaient considérablement le transport de vivres vers Rome depuis la Sicile et l'Égypte, menacent d'affamer la péninsule italienne.
Les sénateurs, parmi lesquels Quintus Lutatius Catulus, l'un des deux consuls de l'année 78, qui craignent une nouvelle dictature, sont réticents à lui accorder de tels pouvoirs. La loi est pourtant adoptée sous la pression du peuple. Pompée s'acquitte de sa fonction méthodiquement. Il dispose de 500 navires de guerre et de 120 000 hommes, l'équivalent de vingt légions. La Méditerranée est divisée en treize zones, chacune confiée à un des 24 légats à la tête d'une flotte. La mer est rapidement nettoyée d'ouest en est et les pirates sont refoulés vers leurs repaires de Cilicie dans l'est du bassin méditerranéen. C'est à ce moment que Pompée se rend pour la première fois à Athènes. Très populaire, Pompée est acclamé par la foule athénienne car il n'a pas dérobé les biens des temples de la ville.
Pour vaincre les pirates définitivement, Pompée lui-même, à la tête de soixante navires, bientôt rejoints par de nombreux autres, leur porte alors le coup final en attaquant le port de Coracesium. Il obtient leur capitulation et sait se montrer magnanime envers ceux qui se rendent, en installant un grand nombre d'entre eux avec leurs familles dans la ville de Soli, qui est rebaptisée Pompeiopolis. En effet, cette ville, fondée par Mithridate, a été saccagée et détruite au cours de la dernière guerre contre le Pont. Pompée recolonise alors cette ville avec les pirates repentis. Il a accompli sa mission en trois mois et s'est prodigieusement enrichi en mettant la main sur le butin que les pirates avaient accumulé depuis des années.
Pompée en Orient
Alors qu'il séjournait en Grèce après sa victoire sur les pirates, Pompée se met à lorgner vers l'Orient, où Lucullus peine à vaincre le roi du Pont Mithridate VI Eupator. En 66 av. J.-C., la lex Manilia, initiée par le tribun de la plèbe Caius Manilius, appuyé notamment par Cicéron, accorde à nouveau à Pompée des pouvoirs d'imperium exceptionnels en Asie mineure. De nombreux sénateurs alarmés par la tendance à la croissance du pouvoir personnel des généraux, s'y opposent en vain
Le Royaume du Pont à son apogée, le Royaume d'Arménie est en vert
Pompée se rend en Galatie pour relever Lucullus de son commandement. Selon Dion Cassius, sa première action aurait été de proposer la paix à Mithridate. Il lui aurait envoyé un messager, sans obtenir de réponse. Pompée conclut alors une alliance avec le roi des Parthes Phraatès et lui offre les territoires de l'Arménie. Effrayé, Mithridate aurait alors demandé la paix. Face aux exigences exorbitantes de Pompée, ses soldats se révoltent et le roi ne peut les calmer qu'en prétendant que ses émissaires n'avaient pas été chargés de négocier, mais d'observer ce que faisaient les Romains. Pompée se rend en Galatie pour relever Lucullus de son commandement. L'entrevue est d'abord polie, mais le ton monte entre les deux hommes, et il s'en faut de peu qu'ils n'en viennent aux mains, retenus par leurs gardes du corps. Après cette rencontre, Lucullus doit rentrer à Rome et laisse le commandement des deux légions d'Asie mineure à Pompée. Ce dernier dispose ainsi de plus de 60 000 hommes et de 3 000 cavaliers, soit une dizaine de légions, sans compter les nombreux auxiliaires, pour venir à bout du roi du Pont.
Tout d'abord, Mithridate évite le combat et détruit les régions traversées par les troupes de l'imperator pour les affamer. Plutôt de que de poursuivre Mithridate, Pompée oblique vers l'Arménie Mineure, une province fertile du Royaume du Pont. Mithridate, pour sauver ce qui reste de son royaume, est contraint de livrer bataille. Il est rapidemment vaincu par Pompée mais réussit à s'enfuir. Il décide d'attirer Pompée en Arménie pour provoquer l'hostilité du roi Tigrane II envers les Romains. Pompée rattrape le roi du Pont et livre une bataille de nuit contre ses forces. Les armées de Pompée font plus de 10 000 morts. Mithridate semble vaincu et s'enfuit dans le Royaume du Bosphore, sur les bords de la Mer d'Azov, avant d'avoir ordonné à toutes les places fortes pontiques de résister aux romains. En quelques mois, Pompée est venu à bout du vieux roi.
Pompée se trouve aux confins du royaume d'Arménie et décide d'en faire un État-client de Rome. Conscient de l'inutilité de toute résistance, Tigrane II, un monarque vieillissant, cède à Rome une partie de ses possessions, la Syrie et la Phénicie, une partie de la Cappadoce et de la Cilicie ainsi que la Sophène et consent à Pompée une importante contribution financière après une rencontre avec ce dernier. Par la seule voie diplomatique, Pompée a soumis entièrement l'Arménie et a annexé bon nombre de territoires. Il peut donc se lancer à la poursuite de Mithridate, en passant par le Caucase.
Descendant l'Araxe et en remontant le cours du Cyrus, Pompée pénètre dans le royaume des Albains, et vainc le roi Orosès. En 65 av. J.-C., après avoir hiverné chez les Albains et les avoir vaincus, il soumet le royaume voisin des Ibères sous le règne d'Artokès. Peu après, Orosès, le roi des Albains, se révolte et reprend les hostilités, et lève une armée de 60 000 hommes et de 12 000 cavaliers. Cependant, cette armée n'est composée que de bergers et de paysans sans formation militaire, que Pompée écrase à nouveau. Jamais une armée romaine ne s'était aventurée aussi loin. Ces victoires éclatantes permettent à Rome de s'étendre vers la Bithynie, le Pont et la Syrie, posant ainsi les bases de la future domination de l'Empire romain en Orient.
La campagne est terminée. Bien que Mithridate soit toujours en fuite, Pompée a soumis les Arméniens, les Albains et les Ibères du Caucase. Il peut procéder au rétablissement de la paix dans cette région morcelée par les guerres. Tout d'abord, il met fin à la guerre entre l'Empire parthe et le Royaume d'Arménie par la voie diplomatique. Il rejoint ensuite avec toutes ses légions son légat Afranius en Syrie. En cours de route, il se rend à Zéla, où une armée romaine a été défaite par Mithridate. Pompée tient à faire enterrer les restes des soldats romains qui jonchent encore le champ de bataille. Une fois en Syrie, Pompée fonde la province de Syrie, un nouveau territoire de la République. Il y promulgue des lois et fait venir de nombreux magistrats romains, responsables de cette nouvelle province. Avant de rentrer en Italie, Pompée souhaite régler deux problèmes : mettre de l'ordre en Judée, plongée dans la guerre civile, et mettre au pas Arétas III, roi des Nabatéens.
Pompée en Judée
En 63 av. J.-C., Pompée est à Damas pour régler le problème de la Judée, plongée dans la guerre fratricide qui oppose Aristobule II à son frère Hyrcan II. Chacun des deux frères demande l'aide de Pompée pour vaincre l'autre. Comme Aristobule a eu beaucoup de complaisance pour Mithridate et pour les pirates alors que Hyrcan était plutôt favorable à Rome, Pompée prend alors fait et cause pour ce dernier. Il se met en marche pour vaincre Aristobule qui s'est retranché dans la forteresse d'Alexandreion. Au terme d'un nouvel arbitrage, Pompée ordonne à Aristobule de rendre toutes les places qu'il occupe. Après une nouvelle volte-face d'Aristobule, il s'apprête à prendre Jérusalem. En cours de route, les légions de Pompée font une halte à Jéricho et leur imperator étudie les plans de la forteresse de Jérusalem.
C'est à ce moment qu'un messager lui apprend que Mithridate, qui s'est réfugié dans le Bosphore, s'est suicidé. La guerre contre le Pont est enfin terminée et l'objectif de Pompée en Orient est atteint. Il veut cependant en finir avec Aristobule. Une fois entré à Jérusalem, dont la population est divisée, il assiège les partisans d'Aristobule retranchés sur le Mont du Temple. Celui-ci est emporté d'assaut et, de cet épisode, l'histoire retiendra que Pompée pénétra dans le Saint des Saints du temple de Jérusalem, ce qui constituait un sacrilège pour les Juifs, mais ne toucha à rien. L'assaut du Temple fait plus de 12 000 morts, mais très peu du côté de Pompée. La Judée est tout de suite soumise. Pompée ne restaure cependant pas la royauté : il se borne à réintégrer Hyrcan dans ses fonctions de grand prêtre du temple de Jérusalem.
Pompée, qui est sans doute à l'apogée de sa gloire en Orient, aspire à de nombreux projets pour asseoir sa puissance, comme marcher vers la mer Rouge, ou bien entreprendre une expédition en Egypte. Le Pharaon Ptolémée XII lui demande de mater une révolte dans son pays. Cependant Pompée renonce à tous ces desseins, et décide de repartir vers la Syrie.
Pompée administrateur
Après sa campagne éclair en Judée, Pompée transforme les régions qu'il a conquises au profit de Rome. Il obtient la capitulation des dernières places fortes du Pont et peut ainsi procéder à la réorganisation politique de l'Orient. Il laisse deux légions en Judée sous le commandement de Scaurus. Installé à Sinope, Pompée crée les provinces de Syrie et de Bithynie-Pont, constituée de la Bithynie et de la moitié occidentale du royaume du Pont. Son organisation de cette province restera un de ses legs les plus durables: Pline le Jeune en fait encore mention au ier siècle. Il agrandit également la Cilicie. À Amisos, il reçoit douze princes et rois des régions conquises. À ceux qui étaient favorables à Rome, Pompée conserve leur titre de souverain en faisant de leur territoire un État-tampon, client de Rome. Ils devront lui verser de fortes sommes d'argent et lui fournir des soldats. C'est ainsi que le Royaume du Bosphore, le Royaume de Cappadoce, le Royaume d'Arménie, les principautés de Galatie et la principauté de Colchide deviennent des État vassaux de la République romaine.
Pompée souhaite rivaliser avec Alexandre le Grand en fondant de nouvelles villes. Il revendique notamment la création de huit villes en Cappadoce, plus de vingt en Cilicie. Il y a là une large part d'exagération : dans la plupart des cas, il s'agit de localités existantes rebaptisées et agrandies, comme Magnopolis, dont la construction avait été commencée par Mithridate. Nicopolis, fondée à l'endroit où Pompée avait vaincu Mithridate, constitue sans doute l'exception. Il procède en outre à la reconstruction de plusieurs cités détruites par la guerre en Cilicie, en Cappadoce et en Coelé-Syrie. De plus, il promulgue des lois et accorde la citoyenneté romaine à des notables locaux et ordonne la destruction de toutes les forteresses de la région pour éviter la création de foyers de résistance. Toutes ses mesures le rendent populaire en Orient et obtiennent l'adhésion des chevaliers romains établis dans la région. Sa mission est terminée en Orient et il est temps de retourner à Rome.
Retour de Pompée à Rome
Pompée rentre en Italie en décembre 62 av. J.-C. Il débarque à Brindes avec ses légions et, avant même de recevoir l'ordre du Sénat, licencie ses troupes, à l'étonnement et au soulagement général. L'historien Velleius Paterculus traduit ce sentiment : Bien des gens, en effet, avaient affirmé qu'il ne rentrerait pas à Rome sans être accompagné de son armée, et qu'il limiterait à sa guise la liberté des citoyens. Le soulagement est tel qu'on vient l'acclamer de toutes parts. Sa popularité est alors à son zénith. Le Sénat était effrayé à l'idée que Pompée puisse prendre le pouvoir avec ses légions et instaurer une nouvelle dictature. En outre, Pompée est maintenant très riche grâce aux trésors accumulés en Orient.
Dès son retour à Rome, il divorce de son épouse Mucia Tertia, dont l'inconduite est notoire. Il cherche ensuite à contracter une nouvelle union et sollicte la main d'une nièce de Caton pour s'attirer à nouveau les faveurs des optimates. À Rome les mariages font l'objet de savantes manœuvres politique. Par cette union, Pompée cherche donc à se concilier des sénateurs les plus conservateurs. C'est un échec, il se heurte à un refus cinglant de Caton, qui ne veut pas voir sa liberté politique aliénée de cette façon et lui fait dire que ...ce n'est point par les femmes qu'on peut prendre Caton... . Plutarque reproche à Caton son manque de sens politique en cette occasion, puisque, par son refus, il finira par jeter Pompée dans les bras de César, qui lui offrira sa fille en mariage, avec des conséquences désastreuses pour l'État: ...c'était obliger Pompée de se tourner du côté de César, et de contracter un mariage qui, en réunissant la puissance de Pompée à celle de César, manqua de renverser l'empire de Rome, et perdit au moins la république.
Le jour de son quarante-cinquième anniversaire, il célèbre son triomphe de orbi universo, sur le monde entier, qui a été retardé de six mois par le Sénat qui regarde toujours avec méfiance ce général victorieux couvert de gloire et de succès.
Pompée souhaite faire attribuer des terres à ses vétérans et ratifier les actes qu'il a posés en Orient. Confiant dans sa popularité, il croit y arriver facilement. Il se heurte à l'opposition de nombreux sénateurs, notamment celle de Caton, dont l'opinion est faite, mais aussi celle de Lucullus, qui n'a pas oublié l'humiliation que Pompée lui a infligée en Orient. Cette alliance de la vertu et de la rancœur irrite Pompée. Maintenant très riche, il croit pouvoir arriver à ses fins en pesant sur l'élection des consuls de l'année 60 . Il finance l'élection de son ancien légat Afranius. Ce dernier est effectivement élu consul en 60 av. J.-C. mais il a pour collègue Metellus Celer, du clan des Metelli, que Pompée a heurtés en divorçant de leur demi-sœur Mucia. Une fois élu, Afrianus ne se révèle pas un appui très efficace, constamment contré par Metellus Celer. Pompée demande alors au tribun de la plèbe Flavius de déposer une motion en vue d'acheter des terres en Italie pour les distribuer à ses légionnaires. Metellus Celer s'y opposant obstinément, commence alors une affaire des plus saugrenues. Le tribun Flavius ajoute à sa motion une loi agraire qui permet l'attribution de terres à des simples citoyens, ce qui provoque la colère des optimates. Devant l'opposition de Metellus Celer et en toute légalité, Flavius le fait mettre en prison. Celer réunit le Sénat dans la prison, mais Flavius s'assoit devant l'entrée pour empêcher les sénateurs de passer. Comme Flavius, en tant que tribun de la plèbe, est intouchable, Metellus riposte en perçant un trou dans le mur pour écouter les sénateurs devant les menaces de Flavius. S'il faut en croire Dion Cassius, Pompée rougit en apprenant cet événement. Lorsque Flavius menace Celer de le priver de proconsulat après son mandat si il ne cède pas, ce dernier s'obstine. Pompée, impuissant, doit provisoirement renoncer.
Le premier triumvirat
Peu après, César revient en Italie à la fin de son mandat de propréteur d'Hispanie. Il revient certes endetté, mais il devient très populaire à Rome. Il aspire à être consul de l'année 59. Pour asseoir son projet, il a besoin de soutiens. C'est vers Crassus et Pompée qu'il se tourne. À défaut de pouvoir être le premier dans Rome, Pompée voit cette alliance d'un œil favorable, car il souhaite toujours obtenir des terres pour ses vétérans et voir ses actes en Orient ratifiés.
En 60 av. J.-C., Pompée conclut donc le premier triumvirat avec Jules César et Crassus, un pacte que l'écrivain Varron appelle le monstre à trois têtes. Grâce à cette alliance contre l'oligarchie sénatoriale dirigée par Caton, Crassus et Pompée arrivent à faire élire César consul en 59 av. J.-C.. La violence devient omniprésente à Rome, où l'on assiste à de véritables batailles rangées. Pompée a rameuté ses vétérans, qui terrorisent les partisans des optimates. Pour obliger son nouvel ami Pompée, César fait alors passer une loi agraire et ratifier ses actes en Orient, en dépit de l'opposition de son collègue conservateur Bibulus, moins habile que ne l'avait été Metellus Celer. Face aux violences quotidiennes, Bibulus s'enferme chez lui jusqu'à la fin du consulat.
Julia, fille de César, femme de Pompée
Pour renforcer l'alliance, en mai 59 av. J.-C., Pompée épouse Julia, la fille de Jules César.
Bien qu'en apparence il ait atteint ses objectifs, Pompée ne sort pas véritablement gagnant des événements. Il semblerait qu'il éprouve de réels sentiments pour sa nouvelle épouse Julia : comme elle est enceinte, il se retire avec elle dans sa villa d'Albe. D'après Plutarque, Pompée délaisse la politique au profit de Julia et se laisse emporter par " l'amour que lui inspire sa jeune épouse ". Sa popularité est au plus bas - le temps est loin où on l'appelait Magnus - tandis que César, très actif, tire les marrons du feu.
A la fin de l'année 59 av. J.-C., le climat politique est lourd: un certain Lucius Vettius prétend qu'on l'a chargé, avec l'aide de quelques gladiateurs, d'assassiner Pompée. Il dit avoir renoncé à cet acte et dénonce tour à tour des instigateurs différents. Il aurait peut-être été manipulé par César.
En 58 av. J.-C., César part de Rome à l'issue de son consulat en tant que proconsul de Gaule Cisalpine et d'Illyrie. Crassus, s'occupant de ses affaires, est en dehors de Rome. Pompée est le seul triumvir présent dans la cité. Il est immédiatement pris dans une tempête politique.
Le nouveau tribun de la plèbe, Clodius Pulcher attaque les sénateurs optimates, notamment Caton et Cicéron. Il veut surtout se venger de Cicéron, qui avait témoigné contre lui dans une affaire de sacrilège en 62. Pompée, fort isolé, s'allie inprudemment avec ce dangereux personnage, qui fait régner la terreur en recourant aux services de bandes armées. Clodius parvient à faire exiler Cicéron pour procédés illégaux contre les partisans de Catilina, exécutés sans procès régulier. Cicéron est sacrifié par Pompée, qui est pourtant censé être son allié. S'il faut en croire Plutarque, lorsque Cicéron se rend chez Pompée pour implorer son aide, ce dernier, honteux, s'échappe par une porte de derrière. Le 11 mars 58, Cicéron quitte Rome pour échapper à une condamnation.
Pompée a tout lieu de se repentir de la lâcheté dont il a fait preuve dans cette affaire, car Clodius se retourne contre lui. Il attaque Pompée et le consul en poste Gabinius, un ancien légat de Pompée. Il fait poursuivre en justice certains clients de Pompée. Ce dernier est vivement insulté par Clodius et ses partisans sur le Forum lorsqu'il vient soutenir ses clients. Les hommes de Pompée et ceux de Clodius en viennent rapidement aux mains en plein milieu du Forum. Furieux et humilié, Pompée est maintenant décidé à faire revenir Cicéron à Rome. Il fait venir en masse à Rome ses clients de toute l'Italie. Le 4 août 57 av. J.-C., il obtient un vote annulant l'exil de Cicéron. La leçon n'a pas échappé aux sénateurs conservateurs, las des désordres, qui se rapprochent de Pompée
Comme Rome est menacée de famine - une situation dans laquelle Clodius, qui avait fait passer une loi prévoyant la distribution gratuite de blé au peuple, portait une part de responsabilité -, des émeutes éclatent dans la ville. Cicéron propose que Pompée soit chargé de remédier à la situation. On lui confie la tâche de s'occuper de l'annone, c'est-à-dire le ravitaillement en blé de la ville, pendant cinq ans. Pompée rétablit rapidement le ravitaillement en blé depuis l'Afrique ce qui lui vaut une augmentation rapide de sa cote de popularité au sein du peuple.
En 57 av. J.-C., Pompée reçoit dans sa villa d'Albe la visite du pharaon d'Égypte Ptolémée XII. Celui-ci a été chassé du pouvoir par un soulèvement populaire et vient demander l'aide de Rome pour retrouver son trône. Pompée l'accueille chaleureusement.
Au début de l'année 56 av. J.-C., toute l'attention du sénat est absorbée par l'affaire d'Égypte. Un oracle sibyllin vient compliquer l'affaire : il ne faut pas refuser son amitié au roi d'Égypte, mais ne pas lui accorder d'armée, ce qui exclut d'accorder à celui qui sera chargé de restaurer Ptolémée XII sur son trône un commandement militaire. Différentes motions se succèdent au Sénat, le nom de pompée étant avancé, mais l'affaire est finalement abandonnée. Le prestige de Pompée n'en sort pas grandi. Il se rapproche à nouveau de ses deux compères du triumvirat.
Alors que César se trouve à Lucques, Crassus et Pompée l'y rejoignent en avril. Cette fameuse entrevue ou conférence de Lucques a fait couler beaucoup d'encre. Chacun entend protéger ses intérêts. Les grandes lignes de l'accord sont connues : Crassus et Pompée souhaitent obtenir un deuxième consulat en 55, tandis que César souhaite voir renouveler son commandement en Gaule.
En 55 av. J.-C.,les élections consulaires, qui ont été repoussées, se déroulent non sans difficultés dans un climat d'extrême violence. Une fois élus, Pompée et Crassus tiennent parole et font voter la loi Licinia Pompeia qui proroge les pouvoirs de césar en gaule pour une durée de cinq ans.
Pompée inaugure le premier théâtre romain en pierre de Rome ainsi qu'un portique et une exèdre qui abrite une statue le représentant en triomphateur du monde. Ptolémée XII Aulète est toujours à Rome et Pompée charge Gabinius, alors proconsul de Syrie, de marcher sur l'Égypte afin de mater la révolte du peuple, sans l'accord du Sénat. Gabinius en sort vainqueur et remet Ptolémée XII sur le trône, par l'entremise de Pompée, en échange de 10 000 talents.
L'année suivante, à l'issue de son mandat consulaire, Pompée devient proconsul de l'Hispanie pour cinq ans et prend le commandement de quatre légions. Crassus quant à lui, obtient le proconsulat de Syrie. Bien qu'il soit proconsul, Pompée reste en Italie et charge ses légats d'administrer la province à sa place. Selon la loi, il ne peut pas entrer dans Rome en étant proconsul. Peu de temps après, sa femme, Julia, après une première fausse couche, est de nouveau enceinte. Malheureusement, la fille unique de César meurt en couches et le bébé ne survit pas. Pompée et César partagent leur tristesse et condoléances, mais la mort de Julia rompt leurs liens familiaux. Lucain en résume par un vers les conséquences politiques catastrophiques : Ta mort Julia a rompu leur foi Pompée et César et permis aux chefs de susciter la guerre..
L'année suivante, Crassus, proconsul de Syrie, son fils Publius et la plus grande partie de son armée sont anéantis par les Parthes à Carrhes en 53 av. J.-C. Le triumvirat n'existe plus.
Pompée comme recours au désordre
César, et non Pompée, est maintenant le nouveau grand général de Rome du fait de ses victoires en Gaule, et le fragile équilibre du pouvoir entre eux est menacé. L'anxiété du public augmente, des rumeurs circulent que Pompée se verrait offrir la dictature pour rétablir la loi et l'ordre. César propose une deuxième alliance matrimoniale à Pompée : il lui offre sa petite-nièce Octavia la sœur du futur empereur Auguste. Cette fois, cependant, Pompée refuse. En 52 av. J.-C., il épouse Cornelia Metella, la très jeune veuve de Publius, le fils de Crassus, et la fille de Scipion, l'un des plus grands ennemis de César. Pompée est entraîné de plus en plus vers le camp des optimates. On peut présumer que ces derniers pensaient qu'il était le moindre de deux maux.
Denier à l'effigie de Pompée.Date : c. 49-48 AC. Description avers : Tête de Numa Pompilius à droite, ceinte d’un bandeau inscrit Description revers : Proue de galère à droite .Traduction revers : “Magnus pro consul”, Le grand, Pompée proconsul.
Le 18 janvier 52, Clodius est assassiné par Milon. Lorsque, en représailles, ses partisans brûlent la Curie, où siège le Sénat, commence une période d'anarchie. Le sénat, en proie à la panique, fait alors appel à Pompée. Une majorité de sénateurs est prête à lui octroyer la dictature, mais sous l'influence de Bibulus et de Caton, le Sénat adopte un compromis et fait voter une loi qui nomme Pompée consul unique consul solus en 52 av. J.-C., tout en lui conservant son mandat de proconsul d'Espagne, ce qui lui donne des pouvoirs extraordinaires mais limités. Le peuple accepte cette nomination et Pompée entame un troisième consulat, à l'encontre du principe de collégialité et d'une loi de Sylla qui exigeait un délai de dix ans entre deux consulats. Un dictateur ne pouvait pas légalement être puni pour les mesures prises pendant son gouvernement. Par contre, comme consul unique, Pompée est responsable de ses actions. Il réagit avec rapidité et efficacité, faisant entrer des légionnaires dans Rome pour rétablir l'ordre et voter deux lois : de vi, pour lutter contre la violence, et de ambitu, pour lutter contre la corruption électorale.
En avril, lorsque Milon est inculpé pour l'assassinat de Clodius, Pompée se rend au tribunal avec des soldats qui dispersent les partisans de Milon. Leur présence perturbe tellement Cicéron, l'avocat de Milon, qu'il bâcle sa plaidoirie. Milon est condamné et est contraint à l'exil. Lors de son consulat, Pompée offre des jeux à la plèbe pour faire oublier les tensions politique de Rome. Son théâtre est, selon lui, la raison de ses festivités.
Pompée se donne pour collègue son nouveau beau-père Metellus Scipion durant les cinq derniers mois de son consulat.
À l'issue de son mandat, il s'est assuré la gratitude du Sénat pour avoir rétabli l'ordre sans user de la force légionnaire. Les élections consulaires sont organisées pour l'année 51 et Pompée laisse la place à ses successeurs Sulpicius Rufus et Claudius Marcellus.
De la confrontation à la guerre
Le pouvoir proconsulaire accordé à César aurait dû se terminer le 31 décembre 50 av. J.-C., après la prolongation de cinq années qui lui avait été consentie à la rencontre de Lucques. Mais en mars 51 av. J.-C., César envoie une lettre au Sénat demandant une prolongation de son imperium : de cette manière celui-ci se serait terminé en 49 av. J.-C., sans qu'il y eût d'interruption entre la fin du proconsulat et le début de son second consulat prévu le 1er janvier 48 av. J.-C.. Pompée ayant obtenu cette faveur du sénat, César souhaite avoir le même avantage. L'intransigeance de Caton fait échouer ce compromis. Le consul Marcus Claudius Marcellus rend la situation encore plus tendue en proposant de remplacer le proconsul des Gaules et de l'Illyricum avant l'expiration de son mandat, la victoire sur les Gaulois étant acquise. Officiellement, Pompée s'oppose à cette proposition : selon lui, la question ne doit pas être abordée avant le 1er mars 50, date de l'expiration du proconsulat de César.
En 50 av. J.-C., la guerre des Gaules est terminée. Pour se rapprocher de la politique romaine, César se rend à Ravenne en Gaule cisalpine avec une seule légion. Grâce au butin gaulois, il débauche secrètement le tribun de la plèbe Caius Scribonius Curio, en qui Pompée avait placé sa confiance, en payant toutes ses dettes.
Sous le prétexte de la nécessité du renforcement de l'armée en Orient en vue d'une guerre avec les Parthes, le Sénat ordonne à César et à Pompée de lui envoyer une légion chacun. Pompée réclame habilement la légion qu'il avait prêtée à César pour la guerre des Gaules. Ce dernier accepte et remet au Sénat la le et la XVe légion. La guerre contre les Parthes n'a pas lieu et les deux légions sont stationnées à Capoue.
Jules César
Dans le courant de l'année Pompée tombe gravement malade. Son rétablissement est accueilli partout en Italie par des manifestations de joie, qui flattent sa vanité et lui inspirent un sentiment de sécurité bien peu fondé. A cette occasion il fait la déclaration fameuse, se vantant qu'en quelque endroit de l'Italie qu'il frappe du pied, il en sortirait des légions.
Le 1er décembre, passé ouvertement dans le camp de César, Curion propose que César et Pompée abandonnent tous deux leur commandement. Sa motion est adoptée par 370 voix contre 22. Tout semble donc indiquer qu'une majorité de sénateurs souhaitent encore éviter le pire. Furieux, Metellus Scipion pousse alors Pompée au conflit en lui enjoignant de prendre la tête des deux légions stationnées à Capoue et de lever d'autres troupes.
Le 1er janvier 49 av. J.-C. Curion remet au Sénat une lettre de César : celui-ci est prêt à se démettre de son commandement si Pompée en fait autant. La lettre irrite les optimates qui pourtant ne peuvent contester la logique légale de la demande. Metellus Scipion propose néanmoins qu'ordre soit donné à César de congédier son armée dans un délai prescrit pour éviter d'être déclaré ennemi du peuple; hostis à l'issue de son mandat de proconsul. Lors de la séance au Sénat, Marc Antoine et l'autre tribun, Cassius, opposent leur veto à cette motion mais ils sont rapidement expulsés du Sénat. Toutefois, Cicéron essaye d'éviter la guerre en proposant à Pompée d'autoriser César à gouverner les deux provinces dont il a la charge jusqu'aux élections consulaires. Les versions de cet épisode divergent. Selon Appien, Pompée en aurait été satisfait, mais les consuls s'y seraient opposés, tandis que selon Plutarque, Pompée aurait refusé. Cicéron aurait alors fait une ultime proposition, César ne conservant que l'Illyricum et une seule légion. Toujours selon Plutarque, Pompée est sur le point d'accepter mais les sénateurs, notamment Scipion, Lentulus et Caton, s'opposent à cette solution. La guerre civile devient inévitable.
La guerre civile
La situation se précipite et à la fin, le Sénat, sur proposition de Pompée, déclare que l'État est en danger et confie la République aux consuls et aux proconsuls, la mettant pratiquement dans les mains de Pompée. Pompée fait déclarer César hors-la-loi le 7 janvier 49 av. J.-C. par l'intermédiaire d'un senatus consultum ultimum. Marc Antoine, Cassius et Curion, dont la sécurité ne peut plus être garantie à Rome, s'enfuient à Ravenne pour rejoindre César, qui réunit son armée et demande à ses légions leur appui pour combattre le Sénat.
César marche alors sur Rome, franchissant le Rubicon avec la XIIIe légion. Pompée, de son côté, réunit en toute hâte deux légions en Italie, mais il sait qu'elles ne feront pas le poids face aux vétérans aguerris de César. La panique règne à Rome. La plèbe ne veut plus de bain de sang, traumatisée par la guerre entre Sylla et Marius. Les sénateurs sont effrayés et comptent sur Pompée. Ce dernier envoie des messagers aux quatre coins de la République pour mobiliser ses légions: en Orient, en Hispanie et en Afrique.
Mais Pompée, à court de temps, car César est déjà à Ariminium, quitte Rome le 17 janvier et rejoint ses légions de Campanie avec sa famille et bon nombre de sénateurs, comme Cicéron, Caton, les deux consuls de Rome ainsi que Brutus. En route vers Capoue sur la Via Appia, le bruit court que toutes les villes du nord de l'Italie ouvrent leurs portes à César. Une fois à Capoue, Pompée est rejoint par Titus Labiénus, un lieutenant de César, qui lui explique que l'action de son chef est une folie et présente à Pompée la situation au nord de l'Italie. Pompée envoie un messager à César dans le but de mettre fin à cette guerre. Cependant, devant l'avance rapide de César, Pompée ne peut rester à Capoue et se rend donc à Brundisium, où il est rejoint par ses partisans, des sénateurs et des consuls. Il renonce aussi à lever des légions en Italie, et préfère aller les chercher en Orient.
Partant de Brindes le 17 mars, Pompée embarque pour la Grèce et traverse l'Adriatique avant l'arrivée de César aux portes de la ville avec 30 000 hommes. Pompée échappe de peu à César grâce aux pièges qu'il a installés dans la ville. Arrivé dans la région, Pompée installe son camp à Beroia en Macédoine et envoie sa femme Cornelia et son fils Pompée le Jeune à Mytilène.
De son côté, César, maître de l'Italie, n'a pas de flotte. Pour assurer ses arrières, il entreprend d'abord de réduire les forces de Pompée stationnées en Hispanie: sept légions sous le commandement d'Afranius et de Varron. César assiège également Massilia qui a refusé de lui ouvrir ses portes. Pompée envoie donc son légat Domitius Ahenobarbus pour défendre la cité, mais celle-ci capitule après la reddition des légions d'Hispanie. César, qui use de la clémence comme d'une arme psychologique, renvoie à Pompée ses légats, Afranius, Varron et Domitius. Les Pompéiens remportent quelques succès en Illyrie et en Afrique, où les troupes césariennes commandées par Curion sont anéanties. Ces victoires pèsent néanmoins peu au regard de la perte de l'Espagne.
Malgré ce sérieux revers, Pompée dispose des immenses ressources de l'Orient et profite d'une année entière de répit pour rassembler sous son commandement une grande armée. Aux cinq légions qu'il a amenées d'Italie viennent s'en ajouter quatre autres provenant de l'Orient. Sa flotte, forte de plus de 600 navires, constitue un de ses principaux atouts. Elle lui assure le contrôle de la mer Adriatique.
César, qui a regagné l'Italie, s'embarque à Brindes et échappe à la flotte pompéienne. Il débarque en Épire avec ses légions le 4 janvier 48 av. J.-C.. Il demande à Marc Antoine, qui est en Italie, de le rejoindre en Grèce avec ses trois légions. Il réussit à débarquer à Lissus. Pompée se retrouve encerclé par les armées ennemies, César au sud, Marc Antoine au nord. Lorsque les deux armées s'apprêtent à marcher contre lui, Pompée se retranche derrière des fortifications près de Dyrrachium. César vient les assiéger. Le face-à-face se poursuit dans des conditions très dures pour les adversaires, qui souffrent tous deux de problèmes de ravitaillement. César est incapable de prendre le camp de Pompée d'assaut, tandis que le tempérament précautionneux de Pompée le pousse à éviter une bataille rangée et à attendre que le dénuement vienne à bout des forces de César. Guetté pourtant lui-même par la famine, il finit par rompre l'encerclement de Dyrrachium et par mettre César en mauvaise posture. Selon Plutarque, il s'en faut de peu que César ne périsse au cours de la bataille. Toujours selon lui, Pompée ne poursuit pas son avantage, ce qui aurait fait dire à César que ses ennemis l'auraient emporté ce jour-là si leur chef avait su vaincre. César se replie à Apollonia pour reconstituer son armée et assurer son ravitaillement. Plutôt que de viser la reconquête de l'Italie, qui en ce moment, était privée de défenses réelles, Pompée gagne la Thessalie par la via Egnatia pour joindre ses troupes à celles de son beau-père Scipion qui lui amène deux légions levées en Syrie. César, de son côté, prend une route plus courte, par le Pinde et rejoint les troupes de Domitius Calvinus, qu'il a envoyées à la rencontre de Scipion.
La bataille de Pharsale
Sur le trajet, César emporte Gomphi d'assaut et reçoit la reddition de Metropolis avec victuailles et finances. Le 29 juillet 48 av. J.-C., César arrive dans la plaine de Pharsale, une ville de Thessalie. Deux jours après, il est rejoint par Pompée qui a reçu de Scipion des troupes fraîches. Pompée tente de fatiguer les troupes réduites de César et également d’épargner les forces sénatoriales par une action d'usure, une série de feintes et de déplacements brefs. Les nobles présents dans l’entourage de Pompée, certains de la victoire au point de se quereller pour de futurs et excellents postes dans la politique, lui forcent la main et le persuadent d’affronter César à terrain découvert.
Le 9 août dans la matinée, les deux armées romaines se rencontrent à la bataille de Pharsale. Au cours de la bataille, Pompée essaye de prendre à revers les troupes de César. Finalement, grâce à la formation d'une quatrième ligne, César contre la cavalerie adverse et prend à revers les forces de Pompée, qui tour à tour, prennent la fuite. Cette bataille se révèle décisive : les forces pompéiennes sont sévèrement battues, les pertes de César sont à peine de 1 200, contre, 6 000 morts et 24 000 prisonniers du côté de Pompée. Les prisonniers sont graciés par le vainqueur.
Beaucoup de pompéiens rejoignent l'Espagne et l'Afrique, comme Caton et Scipion, qui ne suivent plus Pompée. Quant à lui, il s'enfuit à Larissa et vogue vers Mytilène pour rejoindre sa femme et son fils. Il compte se rendre à Rhodes pour ensuite aller à Antioche pour lever une autre armée. Cependant, toutes les portes de l'Orient lui sont fermées. Il confère avec ses proches de différentes options : soit gagner le royaume des Parthes, soit se réfugier chez le roi de Numidie Juba, soit encore se rendre auprès du pharaon Ptolémée XIII d'Égypte, qui lui doit beaucoup, car c'est grâce à lui que son père avait retrouvé le pouvoir en 55 av. J.-C. Il se laisse finalement convaincre d'adopter la troisième solution.
La mort de Pompée
La venue de Pompée plonge les conseillers du jeune pharaon, Photin Achillas et Théodote, dans l'embarras. Deux options, le chasser ou l'accueillir, leur paraissent également dangereuses. C'est Théodote qui propose alors de le tuer, disant qu'ainsi ils feraient plaisir à César et n'auraient plus rien à craindre de Pompée.
À son arrivée en Égypte le 28 septembre 48 av. J.-C, il approche la plage de Péluse sur une trière. Il peut apercevoir les navires de guerres égyptiens mais, à sa grande suprise, il n'y a pas de comité d'accueil, mais une simple barque. Bien qu'il soupçonne un traquenard, Pompée y monte et se trouve face à Achillas et un certain Septimus.
Pompée reconnaît Septimus, qui était un de ses centurions lors de la guerre contre les pirates. Lorsque la barque égyptienne atteint le rivage, Pompée sort un petit discours en grec qu'il avait préparé et commence à le lire. À ce moment, Septimus sort son glaive et transperce Pompée par derrière. Achillas quant à lui, sort son poignard et le frappe plusieurs fois, tandis que les centurions de Pompée sont neutralisés. Pompée s'effondre et couvre son visage de sa toge en poussant un gémissement. Achillas le décapite ensuite et jette le corps sans tête sur le rivage. Les soldats égyptiens s'empressent par la suite de saisir le cadavre et arrachent ses vêtements.
L'un des plus grands généraux de Rome restera sur ce bout de plage sans sépulture pendant quelques jours. La famille et les derniers fidèles de Pompée, qui sont restés au large, font voile vers le large et s'enfuient. Achillas quant à lui, conserve la tête de Pompée pour la montrer à César. Un esclave de Pompée, Philippus, lavera le corps nu de son maître et fera un bûcher funeste pour lui rendre hommage.
César, qui s'était lancé à la poursuite de Pompée depuis Pharsale, arrive à son tour en Égypte. Ptolémée XIII pensait faire plaisir à César en assassinant Pompée et en lui offrant en cadeau la tête de son vieil ennemi. Mais César, soit par pitié, soit par calcul politique, soit les deux, est pris d’un immense chagrin et offre des funérailles à son défunt ennemi. Il exécute tous les instigateurs de l'assassinat de Pompée : Achillas, l'eunuque Pothin ainsi que le tribun Septimus.
La mort de Pompée a à moyen terme des conséquences importantes en Égypte puisque, par la suite, César déposera Ptolémée XIII et mettra Cléopâtre, sa soeur et épouse, sur le trône d'Égypte. César élève un tombeau sur la plage de Péluse en l'honneur de Pompée le Grand et remet à sa femme Cornelia sa tête, qui sera inhumée dans sa villa d'Albe, en Italie.
Consulats
v · d · m
Consul de la République romaine liste
Précédé par En fonction Suivi par
P. Cornelius Lentulus et Gn. Aufidius Orestes 71 av. J.-C.
Gn. Pompeius Magnus I avec M. Licinius Crassus I 70 av. J.-C.
Q. Caecilius Metellus et Q. Hortensius Hortalus 69 av. J.-C.
Cn. Cornelius Lentulus et L. Marcius Philippus 56 av. J.-C.
Gn. Pompeius Magnus II avec M. Licinius Crassus II 55 av. J.-C.
Ap. Claudius Pulcher et L. Domitius Ahenobarbus 54 av. J.-C.
M. Valerius Messalla et Gn. Domitius Calvinus I 53 av. J.-C.
Gn. Pompeius Magnus III avec Q. Caecilius Metellus 52 av. J.-C.
Ser. Sulpicius Rufus et M. Claudius Marcellus 51 av. J.-C.
Postérité
Pour les historiens de son époque et ceux des périodes romaines postérieures, Pompée correspond à l'image de l'homme qui réalisa des triomphes extraordinaires par ses propres efforts, mais perdit le pouvoir et est, à la fin, assassiné par trahison.
Il était un héros de la République, qui autrefois semblait tenir le monde romain dans sa paume, seulement pour être réduit porté bas par son propre manque de jugement et par César. Pompée a été idéalisé comme un héros tragique presque immédiatement après la bataille de Pharsale et son assassinat. Plutarque le dépeint comme un Alexandre le Grand Romain, pur de cœur et d'esprit, détruit par les ambitions cyniques de ceux autour de lui. Ce portrait a perduré pendant la Renaissance et le Baroque, par exemple dans la pièce de Corneille, La Mort de Pompée 1642.
La mort de Pompée, pièce tragique de Corneille 1642
Pompée est apparu dans plusieurs romans modernes, pièces de théâtre, films et d'autres adaptations audiovisuelles souvent comme un des personnages principaux dans les œuvres de fiction inspirées par les vies de Jules César et Cicéron et comme personnage secondaire dans celles inspirées par la vie de Spartacus. Une représentation théâtrale fut exécutée par John Masefield dans La Tragédie de Pompée le Grand 1910. Chris Noth y incarne le personnage dans Jules César. Interprété par Kenneth Cranham, il est l'un des principaux protagonistes de la première saison de la série télévisée de HBO Rome 2005. En 2006, il est interprété par John Shrapnel dans le docufiction diffusé sur BBC, Ancient Rome: The Rise and Fall of an Empire.
Il est un des personnages principaux des romans Imperium et Conspirata de Robert Harris et de la série littéraire Les Maîtres de Rome de Colleen McCullough. Dans les Maîtres de Rome les exploits de jeunesse de Pompée sont racontés dans Le Favori des dieux et La Colère de Spartacus, la formation du premier triumvirat et son mariage avec Julia est une grande partie de l'intrigue de Jules César, la violence et la passion et Jules César, le glaive et la soie et sa perte de Julia, la dissolution du premier triumvirat, les suites de sa carrière politique, la guerre civile entre César et lui, son éventuelle défaite et sa trahison et assassinat en Égypte sont tous racontés dans La Conquête gauloise et César imperator.
Dans la bande dessinée Alix, rival de César, il cherchera souvent à éliminer Alix, sans y parvenir.
Dans la bande dessinee Astérix, Pompée était consul au Sénat avant de s'en faire chasser par César.Il essaie de lever une armée contre lui dans Astérix et Latraviata avant de se faire voler son glaive et son casque qui atterriront dans les mains d'Astérix et d'Obélix.
Dans la scène d'ouverture du film Le Roi des Rois, son rôle est joué est par l'acteur Conrado San Martin.
Dans la série télévisée Xena, la guerrière, il est interprété par l'acteur Jeremy Callaghan.
Dans le téléfilm Spartacus, il est interprété par l'acteur George Cali.
Dans la série télévisée Spartacus : La Guerre des damnés, il est interprété par l'acteur Joel Tobeck.
Mariages et descendance
Première épouse: Antistia, fille du préteur L. Antistius
Deuxième épouse: Aemilia Scaura, la belle-fille de Sylla
Troisième épouse: Mucia Tertia, il divorça d'elle pour adultère, selon les lettres de Cicéron
Pompée le Jeune, exécuté en 45 av. J.-C., après la bataille de Munda
Pompeia Magna, mariée à Faustus Cornelius Sulla, ancêtre de Pompée Magnus le premier mari de Claudia Antonia. Son fils, Cinna le petit-fils de Pompée, complotera contre l'empereur Auguste, mais ce dernier usera de clémence envers lui
Sextus Pompée, qui se rebelle en Sicile contre Auguste
Quatrième épouse: Julia, fille de César
Son enfant, un garçon selon certains auteurs, une fille selon d'autres58,59, ne lui survit que quelques jours.
Cinquième épouse: Cornelia Metella, fille de Metellus Scipion
Liens
http://youtu.be/5dBVXBd4n9Q Pompée 1
http://youtu.be/kvIb2KUj8UY Pompée 2
http://youtu.be/BXcve8mJy8g Pompée 3
http://youtu.be/2OcqH8Uc-W8 Pompée 4
http://www.ina.fr/video/CPF86612191/la-mort-de-pompee-video.html La mort de Pompée   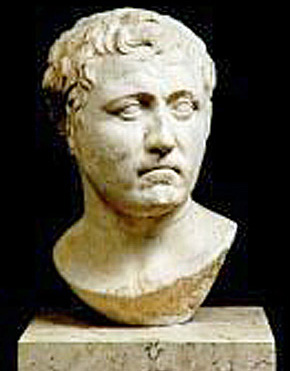        [img width=300]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Campus_Martius_-_Theatre_of_Pompeius.jpg/370px-Campus_Martius_-_Theatre_of_Pompeius.jpg[/img6
Posté le : 27/09/2014 20:50
|
|
|
|
|
Re: Défi du 27/09/14 |
|
Modérateur  
Inscrit:
21/03/2013 20:08
De Belgique
Niveau : 44; EXP : 15
HP : 215 / 1078
MP : 1072 / 35550
|
Ce texte est inspiré de mes grands-parents qui ont toujours été très importants pour moi.
D'accord Donald, relevons ce défi ! Mais je ne suis pas sûre d'arriver à être aussi précise que toi dans les détails techniques qui m'échappent un peu.
Merci pour ta fidélité à nos défis qui se voient un peu désertés en ce moment...
Bises
Couscous
Posté le : 27/09/2014 19:19
|
|
|
|
|
Florent Schmitt |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 28 septembre 1870 à Blâmont, Meurthe et Moselle naît Florent Schmitt
compositeur français de musique classique entre 1904 et 1957, il collabore avec Maurice Ravel,
Gabriel Fauré, Émile Vuillermoz, Louis Aubert, Charles Koechlin, Jean Huré, il reçoit sa formation au Conservatoire de Paris, où il a pour maîtres Jules Massenet, et Gabriel Fauré, il reçoit le prix de Rome et les distinctions honorifiques deCommandeur de la Légion d'honneur, de l'académie des beaux-arts, de l'académie royale de Belgique,il est mort à 87 ans, à Neuilly-sur-Seine le 17 août 1958; Il reçoit le surnom de sanglier des Ardennes
En bref
D'origine lorraine, né à Blâmont Meurthe-et-Moselle, élève de Massenet et de Fauré au Conservatoire de Paris, Florent Schmitt débute assez lentement dans la carrière musicale. Premier grand prix de Rome en 1900, il consacre les années qui suivent à de longs voyages en Europe et au Moyen-Orient. Dès ses premières œuvres Quintette, 1901-1908 ; Psaume XLVII, 1904 ; La Tragédie de Salomé, ballet, 1907), il affirme une forte personnalité. Schmitt est un indépendant : il n'appartient à aucune école, à aucune chapelle, et aucune influence n'est déterminante sur lui. Membre de la Société musicale indépendante, S.M.I. dès 1909, président de la Société nationale de musique 1938 et membre de l'Institut 1936, il n'occupe d'autre poste officiel que la direction du conservatoire de Lyon, de 1921 à 1924, préférant se consacrer exclusivement à la composition, ainsi qu'à la critique musicale, La France, Le Courrier musical, Le Temps.
Son œuvre est très abondante, toujours rigoureuse, brillante, large, voire passionnée. Que ce soit dans son Quintette pour piano et cordes, œuvre ambitieuse, d'écriture et de structure complexes, où il fait craquer les cadres de la musique de chambre et fait sonner cinq instruments comme un grand orchestre, ou encore dans son Psaume XLVII pour soprano, chœur, orgue et orchestre, énorme construction d'une puissance et d'une couleur violentes, sa maîtrise des formes se double d'un sens inné de la mélodie qu'il fait sortir du moule de la mesure traditionnelle. Sa musique est dotée d'une pulsation interne très forte reposant sur une rythmique puissante et audacieuse, Antoine et Cléopâtre, suites symphoniques, 1920 ; Salammbô, d'après Flaubert, 1925 ; Oriane et le prince d'Amour, ballet, 1934 ; Symphonie concertante pour piano et orchestre, 1930. Florent Schmitt connaît aussi une veine plus légère, voire humoristique : il aime le calembour, le coq-à-l'âne, Les Canards libéraux, Fonctionnaire MCMXII ; les dernières œuvres, enfin, semblent tendre au dépouillement sinon à la simplicité, Suite en rocaille pour flûte, alto, violon, violoncelle et harpe, 1935 ; Hasards pour piano et trio à cordes, 1944 ; Suite sans esprit de suite, pour orchestre, 1938 ; Clavecin obtempérant, 1947 ; Trio à cordes, 1946. Son Quatuor opus 112, écrit en 1948, semble reprendre la voie du Quintette composé quarante ans auparavant.
La générosité de l'inspiration mélodique, la sensualité du langage harmonique, la richesse de l'invention rythmique, particulièrement dans la Tragédie de Salomé, la virtuosité de l'écriture orchestrale et instrumentale son Trio à cordes en est un exemple significatif, la maîtrise des formes sous une apparente liberté, l'abondance, voire la prodigalité, telles sont les composantes du style de ce musicien qui était un ennemi de la mièvrerie et de la préciosité, autant que du formalisme desséchant. Florent Schmitt avait une personnalité assez rude, que caractérisaient l'indépendance et la franchise. Debussy, Stravinski, Schönberg n'ont eu sur lui aucune influence, bien qu'il ait connu parfaitement leurs œuvres et les ait, à l'occasion, vigoureusement défendues. Il n'a jamais caché ses opinions, dussent-elles lui faire du tort. Humoriste à ses heures, s'amusant à donner à certaines de ses partitions des titres mystificateurs, il était foncièrement un romantique, et, si, par pudeur, il préférait parfois la boutade à la confidence, le ton de certaines de ses œuvres ne trompe pas : son Petit Elfe Ferme-l'Œil révèle le poète de l'enfance et son Quatuor à cordes est d'une grande intériorité.
Sa vie
Florent Schmitt étudia à Nancy puis au Conservatoire de Paris où il fut élève de Massenet et Fauré. En 1900, il reçut le Premier Grand Prix de Rome pour sa cantate Sémiramis. En 1904, Schmitt acheva son grandiose et tonitruant Psaume XLVII, qui lui valut le succès lors de sa création. Pour Norbert Dufourcq, L'apparition en 1906 du Psaume XLVII a été l'événement le plus important de la musique française depuis Pelléas. L'humour vache du Sanglier des Ardennes, libre et franc, voire rude et sa facétie à la Satie s’exprimaient aussi en titres mystificateurs : Suite en rocailles, Çançunik, Suite sans esprit de suite, Fonctionnaire MCMXII inaction musicale, Sonate libre en deux parties enchainées, Habeyssée, etc.
Marqué dans sa jeunesse par les mouvements symboliste et impressionniste autant que par Chopin, il développa une esthétique opulente, appuyée sur un savant contrepoint. L’emploi d’effets de percussion primitive l'apparente avant la lettre aux recherches de la musique russe moderne. Son art sans demi-teinte fut à l’image de son caractère dont l’esprit caustique n'excluait nullement la bienveillance. En 1924, la création à l'Opéra du ballet Le Petit Elfe ferme-l'œil révéla un délicieux peintre de l'enfance tandis qu’Antoine et Cléopâtre 1920, Salammbô 1925 et le somptueux Oriane et le Prince d’Amour 1938 consacraient l’orientaliste inspiré et le symphoniste héritier des classiques purs. Membre de la Société des Apaches, Schmitt fut cofondateur en 1909 de la Société musicale indépendante avec Maurice Ravel, Gabriel Fauré, Émile Vuillermoz, Louis Aubert, Charles Koechlin, et Jean Huré. Il fut le directeur du conservatoire de Lyon de 1921 à 1924, chroniqueur du journal Le Temps de 1929 à 1939.
Personnalité assez rude, indépendante, ennemie des dogmes et des systèmes, avec une fécondité rare due à sa longue vie, il composa dans tous les domaines excepté l'opéra. Sa musique vigoureuse, caractérisée par un dynamisme rythmique et une ligne mélodique sensuelle, possède un langage harmonique riche et suave d'inspiration aussi bien classique que romantique. L'exotisme apprécié à l'époque se ressent dans plusieurs de ses compositions, tel le lyrique poème symphonique La Tragédie de Salomé, dédié à Igor Stravinski et honoré par Diaghilev. Ces deux œuvres furent les plus appréciées avec son Quintette pour piano et cordes qui recueillit l'admiration, entre autres, d'un Georges Enesco. Sa Deuxième Symphonie fut créée par Charles Münch quelques semaines avant sa mort.
Florent Schmitt fut nommé membre de l'Académie des beaux-arts en 1936, reçut le Grand Prix musical de la ville de Paris en 1957. Mais cet artiste majeur du XXe siècle qui a laissé une œuvre monumentale est aujourd'hui encore méconnu du grand public français. Sa grande indépendance et son faible attachement à la renommée et aux suiveurs de modes ne sont pas étrangers à ce fait. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il a fortement marqué l'histoire de la musique française de la première moitié du XXe siècle, au même titre que Debussy, Ravel et Roussel. Il est reconnu comme "l'un des piliers du répertoire musical pour le quatuor de saxophones".
Il est enterré au cimetière parisien de Bagneux.
Polémique
En dehors de son activité musicale, Florent Schmitt est aussi connu pour ses positions favorables à l'Allemagne dans les années trente. L'épisode du Vive Hitler lancé par Schmitt durant un concert parisien programmant trois extraits d'une opérette de Kurt Weill, le 26 novembre 1933, a notamment été rapporté par Robert Brasillach, cité par Lucien Rebatet, deux auteurs qui, eux même sympathisants du nazisme, savaient de quoi ils parlaient. Selon Rebatet, Schmitt aurait ajouté Nous avons déjà assez de mauvais musiciens pour avoir à accueillir les Juifs allemands.
La vie tout entière de Florent Schmitt est rythmée par les voyages qui s'inscrivent dans le cadre de son activité musicale : Italie, Suisse, Autriche, Espagne, Maroc, Grèce, Turquie, Orient3. Parmi ses voyages, il s'est aussi rendu en Allemagne pendant les années trente puis sous l'Occupation où il a été membre de la Section musicale du Comité France–Allemagne, créé en 1935. Il a assisté à une réunion de musiciens français et allemands organisée à Vienne, en décembre 1941 pour rendre hommage à Mozart, et a été le coprésident d'honneur de la Section musicale du Groupe Collaboration à partir de décembre 1941.
À la Libération, pour avoir prêté son nom au Groupe Collaboration, des poursuites judiciaires ont été engagées contre Florent Schmitt pour indignité nationale par Joseph-Eugène Szyfer de la section Musique du Comité d'épuration. Cependant, après enquête, s'étant toujours positionné d'un point de vue musical, ces poursuites ont été classées sans suite. Toutefois, il a été condamné dans le cadre de l'épuration professionnelle : le 7 janvier 1946, le Comité national d'épuration des gens de lettres, auteurs et compositeurs a prononcé contre lui une peine d'interdiction d’éditer ou de faire jouer ses œuvres d'une durée d’un an, interdiction partant du 1er octobre 1944
Florent Schmitt a expliqué son voyage en Allemagne par la volonté de revoir son fils, resté prisonnier dans le stalag XXIII de Pirmasens depuis juin 1940. Il a justifié son appartenance au Groupe Collaboration par son souci de défendre la musique française. Sa position lui permettant également de signer des pétitions en faveur de musiciens israélites tels que la cantatrice Madeleine Grey, le pianiste François Lang, le compositeur Fernand Ochey ou de soutenir ses amis Paul Dukas, Alexandre Tansman ou Arnold Schönberg qu'il appréciait et défendait vigoureusement. Il a indiqué son absence d'implication politique.
Honneurs
Chevalier de l'Ordre de Léopold, Commandeur de la Couronne de Roumanie, Schmitt était membre de la Société musicale indépendante depuis 1909, de l'Académie royale de Belgique depuis 1932 et présidait la Société nationale de musique depuis 1938. En 1952, il a été promu Commandeur de la Légion d'honneur. En 1957, un an avant sa mort, il se vit décerner le Grand Prix musical de la Ville de Paris. Il fut membre du Comité d'honneur de l'Association du Foyer de l’Abbaye de Royaumont.
Principales œuvres
Musique orchestrale :
3 symphonies : Symphonie concertante pour orchestre et piano, Deuxième Symphonie, Janiana, symphonie pour cordes
Antoine et Cléopâtre
Enfants
Introït, récit et congé pour violoncelle et orchestre
Kermesse-Valse tiré de l'éventail de Jeanne, ballet, collectif, 1926
Le Palais hanté
Le Petit Elfe Ferme-l'œil
Légende pour saxophone alto ou alto ou violon et orchestre
Musique de scène pour Antoine et Cléopâtre, deux suites d'orchestre
Musique en plein air
Ronde burlesque
Rhapsodie viennoise
Rêves
Scherzo vif, pour violon et orchestre
Scènes de la vie moyenne
Sélamlik, divertissement pour musique militaire
Çançunik
Dionysiaques, pour orchestre d'harmonie militaire
Salammbô musique de film, dont seront tirées trois suites d'orchestre
Musique de chambre :
Chants Alizés
À tour d'anches'
Pour presque tous les temps, pour flûte et trio avec piano
Quatuor pour saxophones
Quatuor pour flûtes
Quatuor à cordes
Quintette avec piano
Sonate libre en deux parties enchaînées pour violon et piano
Sonatine en trio pour flûte, clarinette et clavier
Trio à cordes
Nombreuses pièces pour vents, piano, piano à quatre mains ou deux pianos.
Musique vocale :
Nombreuses mélodies et chœurs
Le chant de nuit, pour solistes, chœur et orchestre
Messe pour quatre voix et orgue
Psaume XLVII, pour soprano, chœur, orgue et orchestre 1906
Ballets :
La Tragédie de Salomé 1907
Oriane et le prince d'amour
Piano :
Reflets d'Allemagne opus 28 1905
Musiques foraines opus 22
Ombres opus 64
Mirages op. 70
Bibliographie Ouvrages généraux
Paul Pittion, La Musique et son histoire : tome II — de Beethoven à nos jours, Paris, Éditions Ouvrières, 1960
Monographies
Pierre-Octave Ferroud, Autour de Florent Schmitt, Paris, Éditions Durand, 1927, Texte disponible sur www.imslp.org
Madeleine Marceron, Florent Schmitt, Paris, Ventadour, coll. Paroles sans musique, 1959,
Catherine Lorent, Florent Schmitt, Paris, Bleu nuit éditeur, coll. Horizons, 2012.
Discographie
Musique de chambre
Pièces pour piano : Pièces romantiques, Enfants, Crépuscules, Petites Musiques, Chaîne Brisée : Alain Raës piano, enreg. 1985, Solstice
Pièces pour piano : Pièces romantiques, Trois valses nocturnes, Mirages : Pascal Le Corre piano, enreg.?, Cybélia
Quintette pour piano et cordes en si mineur op.51 : Bartschi, Quatuor de Berne, enreg. 1981, Accord
Andante et scherzo pour harpe et quatuor à cordes : Sandrine Chatron harpe et le Quatuor Elias, enreg. 2004, Ambroisie compléments = Caplet, Debussy, Renié
Suite en rocaille pour flûte, alto, violoncelle et harpe, op.84 : Lardé, Sulem, Gagnepain, M-C. Jamet, enreg. 1999, Pierre Verany compléments = Ibert : Trio, Roussel : Impromptu pour harpe, trio, sérénade
Suite en rocaille pour flûte, alto, violoncelle et harpe, op.84 : Leroy, Grout, Boulmé, P.Jamet, enreg. 1936, Timpani compléments = Debussy, Françaix, d'Indy, Mozart, Pierné, Ravel, Roussel
Musique lyrique
À contre-voix, six chœurs pour voix mixtes a cappella, op.104 : Groupe Vocal de France, dirigé par John Alldis, enreg. 1991, EMI compléments = Debussy, Milhaud, Ravel, Sauguet
Musique symphonique et chorale
Dionysiaques op.62 n°1 : Musique des gardiens de la Paix, dirigée par Désiré Dondeyne, enreg. 1976/74, Calliope compléments = Berlioz, Fauré, Koechlin
Étude pour "Le Palais Hanté" d'Edgar Allan Poe, op.49 : Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Georges Prêtre, enreg. 1983, EMI compléments = Caplet, Debussy
Symphonie concertante pour orchestre et piano op.82 + Rêves op.65 + Soirs op.5 : Sermet piano, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dirigé par David Robertson, enreg. 1993, Naïve
Oriane et le Prince d'Amour, suite de ballet + In Memoriam + Légende pour alto et orchestre : Schloifer alto, Orchestre Philharmonique d'Etat de Rhénanie-Palatinat dirigé par Pierre Stoll, enreg. 1985, Cybélia
Andante religioso + Suite sans esprit de suite + Soirs + Fonctionnaire MCMXII : Orchestre Philharmonique d'État de Rhénanie-Palatinat dirigé par James Lockhart, enreg. ?, Cybélia
Antoine et Cléopâtre op.69 + Rêves op.65 n°1 : Orchestre Philharmonique d'État de Rhénanie-Palatinat dirigé par Leif Segerstam, enreg. 1987/88, Cybélia
Antoine et Cléopâtre op.69 + Mirages op.70 : Orchestre national de Lorraine, dirigé par Jacques Mercier, enreg. 2007, Timpani
Danse d'Abisag + Habeyssée + Rêves + Symphonie n°2 op.137 : Orchestre Philharmonique d'État de Rhénanie-Palatinat dirigé par Leif Segerstam, enreg. 1987/88/92, Naxos "Vive la France"
Salammbô, trois suites d'orchestre op.76 : Chœur de l'Armée Française et Orchestre National de l'Île-de-France, dirigés par Jacques Mercier, enreg. 1991, Adès
La tragédie de Salomé, op.50 : Detroit Symphony Orchestra, dirigé par Paul Paray, enreg. 1958, Mercury compléments = Liszt, Saint-Saëns, R. Strauss, Weber
La tragédie de Salomé, version originale de 1907 : Orchestre Philharmonique d'Etat de Rhénanie-Palatinat dirigé par Patrick Davin, enreg. 1991, Naxos
La tragédie de Salomé op.50 + Psaume XLVII op.38 : Guiot soprano
La tragédie de Salomé op.50 + Psaume XLVII op.38 + Suite sans esprit de suite : Buffle, Ch. Wales, BBC National Orchestra, dirigés par Thierry Fischer, enreg. 2006, Hypérion
Psaume XLVII pour soprano, chœurs, orgue et orchestre, op. 38 : Duval soprano, Duruflé orgue, Chœurs Brasseur, Orchestre du Conservatoire dirigés par Georges Tzipine, enreg. 1952, EMI Honegger, Roussel, Tailleferre...
Liens
http://youtu.be/DEhpP__5iXA Crépuscule part 1
http://youtu.be/ezalW1_rPxQ sonate pour violon et piano
http://youtu.be/suD8DEz1w-0 Psumes XLVII Choeur, orgues et orchestre
http://youtu.be/e85frffybko Dyonisiaques
http://youtu.be/yAL3vtFwWgo chant élégiaque
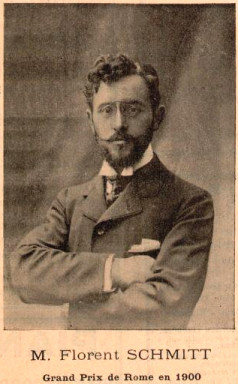   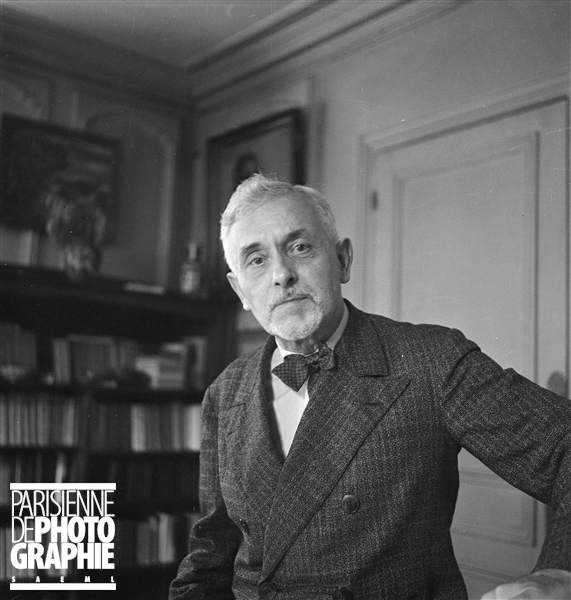 [img width=600]http://www.orchestre-ile.com/images/473.jpg?var=1277478535[/img] [img width=600]http://florentschmittdotcom.files.wordpress.com/2012/10/florent-schmitt-symphonie-concertante-valois.jpg?w=461[/img]   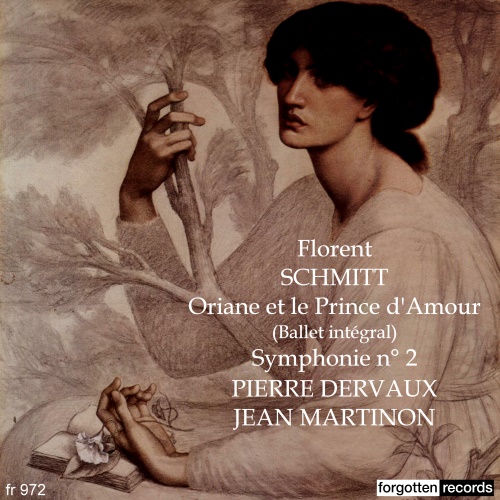 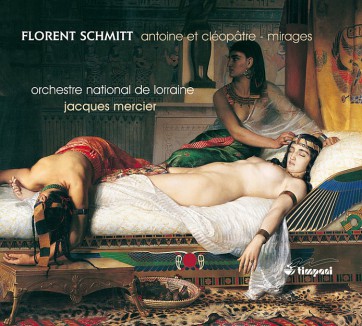 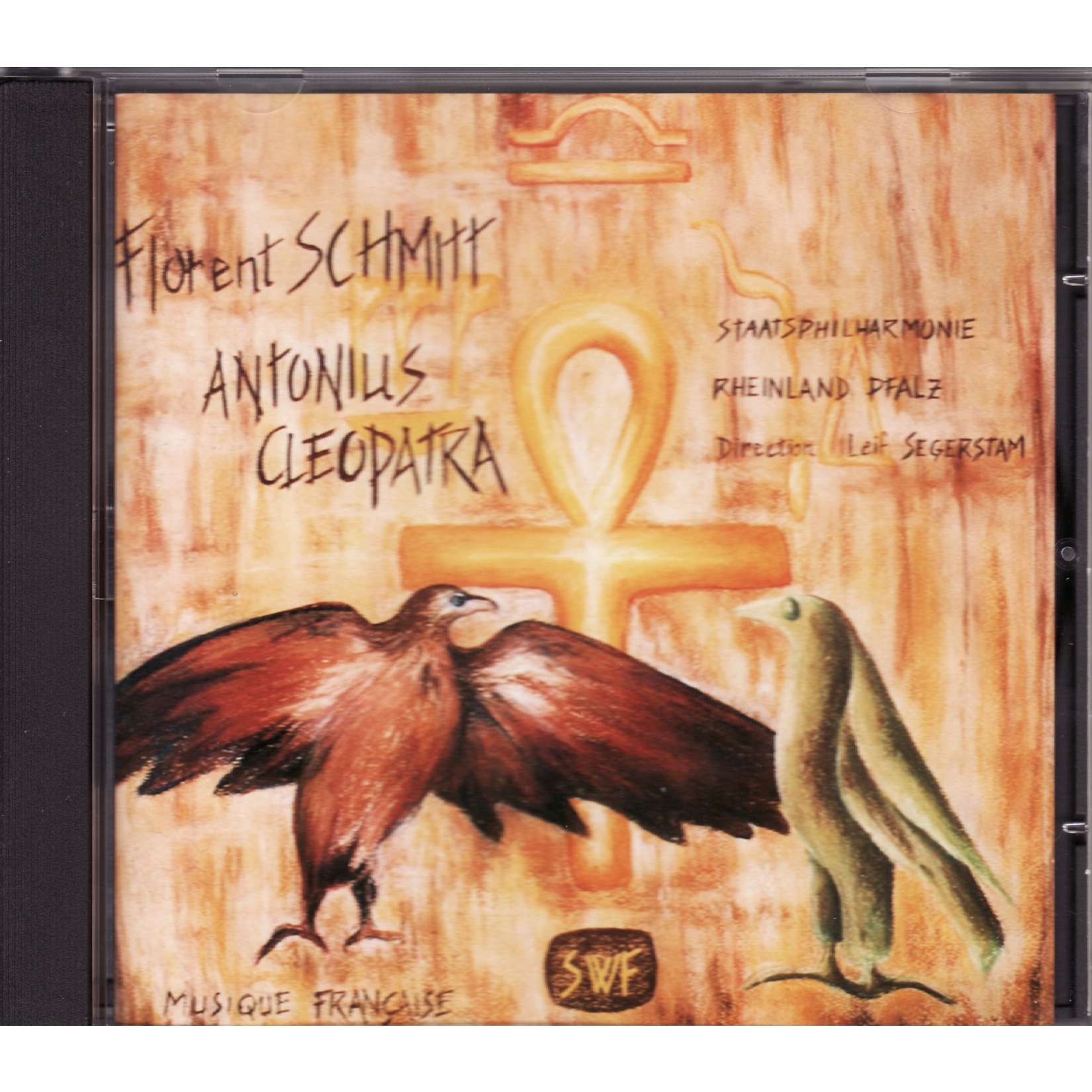 
Posté le : 27/09/2014 19:12
|
|
|
|
|
Re: Défi du 27/09/14 |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
14/03/2014 18:40
De Paris
Niveau : 29; EXP : 25
HP : 0 / 706
MP : 370 / 21252
|
Eh bien Couscous, voilà un texte bien émouvant. Je ne m'attendais pas à ça et il m'a fort surpris, dans le bon sens du terme.
Merci pour ce moment d'émotion.
Bises
Donald.
PS: la science-fiction, ce sera pour un autre défi, d'accord ? Et moi je ferais des textes à la sauce 'couscous'.
Posté le : 27/09/2014 19:00
|
|
|
|
|
Prosper Mérimée |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 28 septembre 1803 à Paris naît Prosper Mérimée,
écrivain, Nouvelles, romans, contes, historien et archéologue français, ses Œuvres principales sont La Vénus d'Ille, en 1837, Colomba en 1840, Carmen en 1845, Mateo Falcone en 1829 il meurt, à 66 ans, le 23 septembre 1870 à Cannes
Issu d'un milieu bourgeois et artiste, Prosper Mérimée fait des études de droit avant de s'intéresser à la littérature et de publier dès 1825 des textes, en particulier des nouvelles, qui le font connaître et lui vaudront d'être élu à l'Académie française en 1844.
En 1831, il entre dans les bureaux ministériels et devient en 1834 inspecteur général des Monuments historiques. Il effectue alors de nombreux voyages d'inspection à travers la France et confie à l'architecte Eugène Viollet-le-Duc la restauration d'édifices en péril comme la basilique de Vézelay en 1840, la Cathédrale Notre-Dame de Paris en 1843 ou la Cité de Carcassonne, à partir de 1853. Proche de l'impératrice Eugénie, il est fait sénateur en 1853 et anime les salons de la cour, par exemple avec sa fameuse dictée en 1857. Il publie alors moins de textes littéraires, pour se consacrer à des travaux d'historien et d'archéologue et initiant, à partir de 1842, un classement des monuments historiques auquel la Base Mérimée créée en 1978 rend hommage.
L’œuvre littéraire de Prosper Mérimée relève d'une esthétique du peu et son écriture se caractérise par la rapidité et l'absence de développements qui créent une narration efficace et un réalisme fonctionnel adaptés au genre de la nouvelle, mais ce style a parfois disqualifié les œuvres de Mérimée auxquelles on a reproché leur manque de relief, ainsi Victor Hugo qui écrit : Le paysage était plat comme Mérimée. Si le Théâtre de Clara Gazul n'a pas marqué l'époque, il n'en va pas de même pour ses nouvelles qui jouent sur l'exotisme la Corse dans Mateo Falcone et Colomba ou l'Andalousie dans Carmen, que popularisera l'opéra de Georges Bizet en 1875, sur le fantastique, Vision de Charles XI, La Vénus d'Ille, Lokis ou sur la reconstitution historique L'Enlèvement de la redoute, Tamango. L'Histoire est d'ailleurs au centre de son seul roman : Chronique du règne de Charles IX 1829.
En Bref
Contemporain des grands romantiques français, Mérimée n'a eu de cesse de se distinguer d'eux. Sans doute l'influence de Stendhal, de vingt ans son aîné et son meilleur ami, a-t-elle joué en faveur d'un scepticisme, d'une désinvolture, qui n'étaient pas dans le ton de l'époque et les rattachaient tous deux au XVIIIe siècle rationaliste. Mérimée portait une bague avec cette devise : Souviens-toi de te méfier.
Ennemi de toute sensiblerie, Mérimée reste cependant romantique par le choix des sujets de son théâtre, de ses nouvelles et de son unique roman, Chronique du règne de Charles IX. Écrivain précoce, il ne sera pas qu'un homme de lettres. Il consacre la plus grande partie de sa vie à la sauvegarde et à la restauration des chefs-d'œuvre de l'art gothique et même roman. Cette activité, à laquelle s'ajoutera, sous Napoléon III, une vie d'homme de cour, ne l'empêche pas de donner, à quarante-quatre ans, son chef-d'œuvre, Carmen, suivi d'autres nouvelles, dont l'admirable Lokis, récit qui prouverait assez que Mérimée appartient au romantisme et à ses ombres.
Né de parents cultivés et artistes, voltairien de goût et de formation, il fait son droit, fréquente les salons, où il se lie avec Stendhal, et, très vite, se lance dans la littérature. Il se signale d'abord par un ouvrage apocryphe dont il se donne pour le simple traducteur : le Théâtre de Clara Gazul 1825, dix brillantes saynètes au ton violent et passionné, dont le style vigoureux est rehaussé de couleurs fortes et qui seraient mélodramatiques si leur auteur ne leur avait apposé un sceau d'ironie qui les situe à la limite du pastiche. Ces pièces, que Mérimée ne destine pas à la scène, sont un échec commercial. La critique, en revanche, s'enthousiasme pour cette création originale dans la production littéraire contemporaine. Elle se laissera encore mystifier quand, deux ans plus tard, Mérimée, récidiviste, publiera la Guzla, recueil de ballades prétendument illyriennes, accompagnées d'un apparat critique fort savant. Mérimée s'oriente alors vers un genre très en vogue, l'histoire, avec une Chronique du règne de Charles IX pour laquelle il s'inspire de Walter Scott tout en s'en démarquant par un refus de description inutile et un souci de véracité dans sa reconstitution du passé. Ainsi que l'indique le titre, il s'agit moins de donner le précis des événements historiques de l'année 1572 que de retrouver les mœurs et les caractères de l'époque ; dès lors toutes les critiques adressées à l'auteur à propos de ses inexactitudes tombent d'elles-mêmes. En effet, à travers les aventures du huguenot Bernard de Mergy et de son frère, George, converti mais fondamentalement indifférent à toute croyance, Mérimée a cherché à retrouver les constantes affectives de l'humanité – amour, haine, intolérance, etc. – bien plus qu'à démonter le mécanisme ayant conduit aux massacres de la Saint-Barthélemy. Toile de fond – couleur locale comme disaient les romantiques –, l'Histoire cède donc le pas au romanesque, de même que les personnages historiques s'effacent derrière les héros de la fiction ; matériaux, les événements et les faits permettent de créer l'illusion de vérité : tout est ainsi manipulé par un narrateur omniprésent qui intervient pour dialoguer avec son lecteur et le laisser finalement libre de terminer le roman à son gré, dernière phrase. Pirouette ultime qui confirme que Mérimée est avant tout un faiseur de contes préface.
Sa vie
Prosper Mérimée est né le 28 septembre 1803 à Paris dans une famille bourgeoise. Son acte de naissance dans l'état civil de Paris indique qu'il est né le 5 vendémiaire an XII, vers 22 heures au 7 carré Sainte-Geneviève, division du Panthéon, dans le 12e arrondissement ancien. Sa maison natale sera démolie quelques années plus tard lors du percement de la rue Clovis et des travaux autour du Panthéon.
Son père, Jean François Léonor Mérimée 1757-1836, est originaire de Normandie : né le 16 septembre 1757 à Broglie et baptisé le 18 septembre 1757 dans l'église de cette ville nommée alors Chambrois, il devient ensuite professeur de dessin à l'École polytechnique, et sera plus tard secrétaire perpétuel de l'École des Beaux-Arts. Sa mère, Anne Moreau 1775-1852, elle aussi en partie d'origine normande, est portraitiste, et enseigne aussi le dessin. Du côté de sa mère, Prosper Mérimée est l'arrière-petit-fils de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont 1711-1780.
Les parents de Prosper, qui se sont mariés à Paris 12e le 22 juin 1802, ont un solide bagage intellectuel et artistique datant du xviiie siècle, mais ne s'engagent guère dans les courants culturels naissants. De l'éducation parentale, Mérimée retiendra l'horreur de l'emphase.
Études
Mérimée fait des études de droit, apprend le piano et étudie la philosophie et aussi de nombreuses langues : l'arabe, le russe, le grec et l'anglais. Il est l’un des premiers traducteurs de la langue russe en français. Il a obtenu son certificat musical de fin d'études à Rome où il remportee le premier prix international européen de piano puis le troisième prix de chant/chorale/direction de chœur à Paris.
Ses études au lycée Napoléon le mettent en contact avec les fils de l'élite parisienne ; entre eux, Adrien de Jussieu, Charles Lenormant et Jean-Jacques Ampère avec qui il traduit Ossian. En 1819, il s'inscrit à la faculté de droit, marchant ainsi dans les pas de son grand-père François Mérimée, éminent avocat du Parlement de Rouen et intendant du maréchal de Broglie. Il obtient sa licence en 1823. La même année, il est exempté du service militaire, pour faiblesse de constitution. Néanmoins, il sera incorporé en 1830 à la Garde nationale.
Monuments historiques
Après avoir fait ses études de politique, il se livre à la littérature. Il entre pourtant dans l’administration puis devient, après 1830, secrétaire du cabinet du comte d’Argout, passa rapidement par les bureaux des ministères du Commerce et de la Marine et succéda enfin à Ludovic Vitet en 1834 aux fonctions d'inspecteur général des Monuments historiques, où son père occupait la fonction de secrétaire, et qui lui permettait de poursuivre en toute liberté les travaux littéraires auxquels il devait sa précoce réputation.
C’est à ce moment qu’il demanda à l'un de ses amis d'enfance, l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, d’effectuer une de ses premières restaurations d’édifice en France. Ce poste lui donna en outre l’occasion de faire dans le Midi, l’Ouest, le Centre de la France et en Corse des voyages d'inspection, dont il publia les relations 1836-1841. Son action permet le classement, le 26 février 1850, de la crypte Saint-Laurent de Grenoble comme monument historique. À cette époque, il correspond avec nombre d'« antiquaires ou érudits locaux, comme M. de Chergé, président de la Société des antiquaires de l'Ouest à Poitiers, ville dont il sauva nombre de vestiges, en particulier le baptistère Saint-Jean menacé en 1850 de démolition. La même année, il découvre, dans la cathédrale du Puy-en Velay, la peinture murale des "arts libéraux" sous un épais badigeon, œuvre majeure de l'art français de la fin du Moyen Âge, dans ce qui est un acte fondateur de l’archéologie du bâti. Dans le département voisin des Deux-Sèvres, il confie à l'architecte niortais Pierre-Théophile Segretain 1798-1864 la restauration de plusieurs églises ; lors de ses tournées d'inspecteur des monuments historiques dans la région, il s'arrêtait parfois dans la maison de celui-ci, au-dessus de la place de La Brèche détruite, où, bon dessinateur, il se délassait à crayonner les chats de la famille. Il donne d'ailleurs des dessins afin d'illustrer Les Chats 1869 ouvrage de son ami l'historien d'art et collectionneur Champfleury.
Académicien
En 1844, il est élu membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres et, la même année, à l’Académie française en remplacement de Charles Nodier.
Ayant pris fait et cause pour son ami le comte Libri, Mérimée est condamné à quinze jours de prison et à mille francs d’amende. Il est écroué le 4 juillet 1852 à la Conciergerie.
Impératrice Eugénie
Mérimée, ami de la comtesse de Montijo, rencontrée en Espagne en 1830, lui envoie le 25 mai 1850 un croquis d'après un portrait de femme par Vélasquez de 55 sur 40 cm, acheté pour huit francs, qui paraît avoir été coupé d'une toile plus grande, et reconnu pour un original par tous les connaisseurs à qui je l'ai montré. Quand Eugénie devint l’impératrice Eugénie des Français en 1853, l’Empire le fit sénateur l’année même, avant de l’élever successivement aux dignités de commandeur et de grand officier de la Légion d'honneur. Pour distraire la cour de l'Impératrice et de Napoléon III, il écrit et dicte en 1857 sa célèbre dictée.
Auteur
Les honneurs lui vinrent au milieu de l’existence littéraire d’un homme ayant fait, pendant quarante ans de l’archéologie, de l’histoire et surtout des romans. Mérimée aime le mysticisme, l’histoire et l’inhabituel. Il a été influencé par la fiction historique popularisée par Walter Scott et par la cruauté et les drames psychologiques d’Alexandre Pouchkine. Les histoires qu’il raconte sont souvent pleines de mystères et ont lieu à l’étranger, l’Espagne et la Russie étant des sources d’inspiration fréquentes. Une de ses nouvelles a inspiré l’opéra Carmen.
Cultivant à la fois le monde et l’étude, Prosper Mérimée, qui travaillait, à ses heures et suivant ses goûts, de courts écrits, bien accueillis dans les revues avant de paraître en volumes, avait conquis la célébrité, dès ses débuts, avec deux ouvrages apocryphes, attribués à des auteurs imaginaires : le Théâtre de Clara Gazul, comédienne espagnole 1825 de Joseph Lestrange, et la Guzla, recueil de prétendus chants illyriens d’Hyacinthe Maglanovitch 1827.
La première de ces publications, l’une des plus complètes mystifications littéraires, précipita la révolution romantique en France, en stimulant les esprits par l’exemple de productions romantiques étrangères. Toutefois, les pièces de Clara Gazul ne paraissaient pas faites pour la scène et, lorsque plus tard Mérimée fut en position d’y faire accepter l’une d’elles, le Carrosse du Saint-Sacrement, elle n’eut pas de succès 1850.
Mérimée publia aussi sous le voile de l’anonyme : la Jacquerie, scènes féodales, suivie de la Famille Carvajal 1828, et la Chronique du règne de Charles IX 1829 ; puis il signa de son nom les nouvelles, petits romans, épisodes historiques, notices archéologiques ou études littéraires, d'abord dans la Revue de Paris puis dans la Revue des Deux Mondes, et qui formèrent ensuite un certain nombre de volumes, sous leurs titres particuliers ou sous un titre collectif.
On citera : Tamango, la Prise de la Redoute, la Vénus d'Ille, les Âmes du purgatoire, la Vision de Charles XI, la Perle de Tolède, la Partie de trictrac, le Vase étrusque, la Double méprise, Arsène Guillot, Mateo Falcone, Colomba 1830-1840 ; puis à un plus long intervalle : Carmen, 1847, in-8° ; Épisode de l’histoire de Russie, les Faux Démétrius 1852, in-18 ; les Deux héritages, suivis de l’Inspecteur général et des Débuts d’un aventurier 1853, in-8°.
Tous ces récits, pleins de mouvement, d’intérêt et d’originale invention, plaisaient surtout aux lecteurs délicats par la forme sobre et élégante dont l’auteur s’était fait une manière définitive.
Il faut citer encore, outre les Voyages ou Rapports d’inspection archéologique, réimprimés en volumes : Essai sur la guerre sociale 1841, in-8, avec pl. ; Histoire de don Pédre Ier, roi de Castille 1843, in-8° ; un volume de Mélanges historiques et littéraires 1855, in-18, contenant douze études diverses, puis des Notices, Préfaces et Introductions, entre autres ; Notice sur la vie et les ouvrages de Michel Cervantes 1828 et Introduction aux contes et poèmes de Marino Vreto 1855, etc. ; enfin, sans compter un certain nombre d’articles de revue non réimprimés, le recueil posthume de Lettres à une Inconnue 1873, 2 vol. in-8, qui excita une grande curiosité et qui fut suivie de Lettres à une Nouvelle inconnue 1875.
Un libéral conservateur
Comme les autres romantiques, Mérimée, né à Paris, a grandi, s'est formé sous la Restauration avec la nostalgie de la Révolution et de Napoléon. Son père, bonapartiste, était un peintre néo-classique devenu secrétaire de l'École des beaux-arts. Milieu tout à la fois artiste et fonctionnaire que Prosper Mérimée, au fond, ne trahira pas.
S'il fait sérieusement ses études de droit, il pense, comme les jeunes gens les plus doués de la génération de 1820, que la seule carrière qui lui soit ouverte est celle des lettres. Il a rencontré Stendhal, rentré d'Italie, en 1822. Il le retrouve, en même temps que Delacroix, dans les salons libéraux-bonapartistes où l'on s'exclamait sur la bêtise des Bourbons, et surtout dans le grenier de E. Delécluze, peintre raté et critique d'art 1781-1863, où, en 1825, à vingt-deux ans, Mérimée lit trois pièces de théâtre : Les Espagnols en Danemark, Le Ciel et l'enfer et Une femme est un diable, écrites sous l'influence des comedias du Siècle d'or espagnol.
C'est peut-être de Stendhal qu'il tient le goût des pseudonymes et des mystifications puisque, lorsqu'il publie ces pièces et celles qui suivent, il les attribue à une femme de lettres espagnole imaginaire, Clara Gazul – ce qui, par ailleurs, lui évite des ennuis avec la censure. Ce Théâtre de Clara Gazul est vraiment excellent. Toutes ces pièces, insolentes, rapides, intelligentes, sont trop peu jouées – à l'exception du Carrosse du Saint-Sacrement, écrit en 1828 et joué pour la première fois en 1850. L'une d'elles, La Jacquerie – sur les révoltes de paysans au Moyen Âge –, témoigne même d'une ambition dramaturgique plus grande que celle de ses contemporains.
Mérimée a vingt-sept ans quand il publie son premier et unique roman, cette Chronique du règne de Charles IX, roman de cape et d'épée, mais dont les intentions idéologiques ne sont pas absentes. En situant sa « chronique » au temps des guerres de religion, Mérimée donne une leçon de tolérance, de liberté, en même temps que de libertinage : les discussions théologiques ont lieu dans les alcôves.
Au même moment, ses premières nouvelles, réunies plus tard sous le titre de Mosaïque 1833, témoignent d'une diversité d'inspiration et d'une précision dans l'expression qui font de Mérimée le véritable classique du romantisme. Mateo Falcone, histoire corse, Tamango, aventure d'un esclave noir, La Vision de Charles XI, première approche du surnaturel à travers l'aventure d'un roi de Suède, et les autres nouvelles du recueil précèdent de peu ce petit chef-d'œuvre, La Double Méprise 1833, où Mérimée fait preuve de tant de virtuosité qu'il semble vouloir mettre dans sa poche à la fois Stendhal, Balzac et le Musset des Comédies et proverbes.
Sa nomination au poste nouvellement créé d'inspecteur général des monuments historiques, en 1834, due à Guizot et à Thiers mais surtout à l'intérêt du romantisme pour l'histoire et le gothique, va orienter Mérimée vers une nouvelle et fructueuse carrière. Pendant trente ans, il va inlassablement parcourir la France, décrivant dans de longs rapports l'état désastreux des plus belles cathédrales et abbayes. Mérimée entraînera dans son sillage un jeune architecte érudit, Viollet-le-Duc. On sait ce qu'il advint, pour le meilleur et pour le pire, de cette rencontre.
Mérimée voyage aussi hors de France. De tous les pays qu'il visitera – Italie, Grèce, Proche-Orient, Angleterre –, c'est l'Espagne qui le marquera le plus. C'est là qu'après 1830 il a rencontré, à la sortie de la cigarería de Séville, la jeune Carmen ou sa sœur gitane. C'est à Madrid qu'il a rencontré une famille d'afrancesados – des libéraux, ex-partisans de Napoléon –, les Montijo, dont l'une des filles, alors âgée de huit ans, deviendra, vingt-trois ans plus tard, l'impératrice des Français et fera de Mérimée son principal confident et l'un des personnages officieux du second Empire.
Une passion froide
En 1841, deux ans après un voyage en Corse, Mérimée publie Colomba, que l'on pourrait rapprocher d'une des Chroniques italiennes de Stendhal, si, là encore, il ne donnait la preuve d'une maîtrise qui se fera invisible dans Carmen, son récit à juste titre le plus célèbre, écrit, au dire de l'auteur, en huit jours et publié en 1847. Récit dans le récit, Carmen, dès qu'on cesse d'interposer l'image du bel opéra de Bizet, frappe par la modernité de la composition, par la froideur du ton qui contraste, en de surprenants effets, avec la violence du propos. C'est, avec Manon Lescaut et Les Hauts de Hurlevent, une des histoires d'amour les plus cruelles de l'histoire de la littérature.
Comme Mérimée est l'homme de tous les paradoxes, on n'aura garde d'oublier que cet hyper-Français, qui accumule en lui les qualités et les défauts de la race, a été l'introducteur en France de la littérature russe en ses commencements : Pouchkine et Tourgueniev. Et, de même que cet athée a été le grand sauveteur des églises de France, ce rationaliste, disciple d'Helvétius, a été fasciné par les légendes surnaturelles. Deux de ses nouvelles au moins, La Vénus d'Ille 1837 et surtout Lokis 1869, doivent figurer dans toutes les anthologies, imaginaires ou non, de la littérature fantastique. Ces deux beaux récits prouveraient assez que c'est de la logique et du réalisme le plus précis que peut naître l'épouvante.
Est-il besoin de dire que ce célibataire endurci, cynique et volontiers obscène dans ses propos comme dans sa Correspondance – un autre de ses chefs-d'œuvre – a été un grand amoureux ? Dans sa jeunesse, il se battait avec les maris outragés. Mais il savait, à l'occasion, les défendre. En 1852, il a été condamné à quinze jours de prison pour avoir diffamé la justice qui venait de s'en prendre à l'un de ces maris, un libéral. Le ministère auquel Mérimée appartenait alors lui avait accordé quinze jours de congé pour qu'il pût purger sa peine sans avoir d'ennuis avec l'administration.
La défaite de 1870 mit fin à ses jours encore plus que l'asthme dont il souffrait depuis longtemps. Il mourut à Cannes en ayant le temps de dire que les Français étaient des imbéciles, mais qu'il ne pouvait s'empêcher de les aimer.
L'oeuvre
L'intérêt constamment affirmé par Mérimée pour les Antiquités lui vaut d'être nommé en 1834 inspecteur général des Monuments historiques afin de préserver nombre de monuments menacés de ruine ou de démolition, tâche dont il s'acquittera avec un zèle et une compétence admirables, mais qui l'éloignera de la scène littéraire tout en lui fournissant matière à divers ouvrages d'érudition. Ses voyages en Corse et à l'étranger, notamment en Espagne, nourrissent ses deux récits les plus célèbres : Colomba 1840 et Carmen 1845. Le premier récit, afin qu'il ne se dilue pas dans une couleur locale gratuite ou dans l'anecdotique, est centré non sur la réalisation de la vendetta mais sur les clivages qu'elle révèle entre les personnages. Les caractères comptent dès lors moins que les idées qu'ils symbolisent : Colomba est moins « l'Électre rustique, P. Josserand que l'attachement aux traditions et au passé, la représentante d'une société archaïque ; de même Miss Nevil est moins le porte-parole du romanesque que le prosélyte de la civilisation moderne pour qui il serait glorieux de convertir un Corse. Ainsi, fidèle à son habitude, Mérimée élargit le problème du particulier au général en faisant de son récit, à travers quelques figures emblématiques, le portrait d'un pays ou d'un peuple autant que l'histoire de héros privilégiés ; et, même si le narrateur ne s'affuble ici ni du savoir de l'ethnologue ni des connaissances de l'historien, il n'en conte pas moins, au travers du drame d'Orso, sauvage trop civilisé, le déchirement d'une île tentée par la culture continentale mais incapable de renoncer à sa propre nature.
Quant à Carmen, elle présente une structure complexe où se mêlent les voix narratives, le récit que fait don José de ses amours tumultueuses avec Carmen venant s'enclaver entre la double rencontre du narrateur avec le brigand José Maria et la bohémienne Carmen d'une part, et la digression finale sur l'histoire, les mœurs, le caractère et la langue des bohémiens de l'autre. Il naît ainsi un effet stéréoscopique dans la présentation des personnages : à la vision externe du narrateur, qui voit en Carmen une beauté étrange et sauvage, répond le regard de don José, qui, saisissant cette diable de fille de l'intérieur, y décèle un démon, tandis que le dernier chapitre permet de comprendre ce qui chez l'héroïne ressortit à ses origines. Mais, au-delà du heurt de deux caractères et de l'intrigue amoureuse, nouvelle variation sur le thème mélodramatique de la déchéance par l'amour, Carmen est avant tout une tragédie née de la tension entre deux univers mentaux . Autant que l'envoûtement du brigadier par la bohémienne, la nouvelle conte la fascination de don José pour la liberté, fascination pour l'impossible – car on ne devient pas bohémien – et qui contraint le héros à une errance au bout de laquelle il trouvera le lieu le plus clos de l'ordre social : la prison. Histoire d'une illusion et de son échec, Carmen peut apparaître d'une certaine façon comme la condamnation d'un romantisme qui se plaît à exalter la rupture d'avec l'ordre et la marginalité.
Dans les deux cas, la force du récit tient beaucoup à la concentration permise par le genre de la nouvelle, dont Mérimée apparaît comme un des plus grands maîtres. On peut néanmoins se demander s'il a réellement pris au sérieux ce genre auquel il est venu de fait un peu par hasard : n'affirme-t-il pas que Carmen serait demeurée inédite si l'auteur n'eût été obligé de s'acheter des pantalons ?... Ce mépris peut sembler d'autant plus singulier qu'une telle forme d'expression, par ses limites mêmes, est incontestablement le terrain qui permettait le mieux à cet admirable technicien du récit de mettre en valeur son talent ; il s'explique en revanche aisément dès lors que l'on tient compte du dédain longtemps affiché par la critique à l'égard de ce qu'elle considérait comme un genre mineur. Comme tous les grands nouvellistes, Mérimée ne laisse rien au hasard. Son récit est placé sous le signe de la rigueur et de la concision. Pour qu'il converge mieux vers sa pointe, il l'épure de toute digression, quitte à faire explicitement affirmer au narrateur ce parti pris de couper court en s'en tenant aux seuls temps forts de l'anecdote. Les nouvelles de Mérimée, remarquables par l'intensité que leur procure la cristallisation autour d'une crise unique, ont pu, à tort, faire figure d'exception dans la production littéraire contemporaine au point de pousser certains critiques à considérer leur auteur comme un classique égaré en plein âge romantique. Elles ne font que s'inscrire dans une certaine tradition française qu'elles renouvellent, en privilégiant un détachement continu et ironique, tant à l'égard des personnages que des situations dramatiques dans lesquelles ils se trouvent plongés contre leur gré, et qui empruntent aux conteurs de la Renaissance comme au romantisme déchaînements passionnels, cruautés sentimentales et crimes de sang. Détachement aussi à l'égard des règles du récit par dérèglement des cadres narratifs, goût systématique de la suspension, de l'ellipse, au risque voulu de l'obscurité, manipulations langagières qui revendiquent le caractère foncièrement énigmatique non seulement des discours mais aussi des langues.
On comprendra dès lors qu'à côté de Carmen et de Colomba, récits promis à une gloire mondiale par leur puissance d'évocation, leur capacité à suggérer avec une extrême simplicité les ressorts des passions les plus universelles, c'est dans le genre fantastique que Mérimée devait le mieux s'illustrer et ce, tout au long de sa carrière avec Vision de Charles XI 1829, les Âmes du purgatoire 1834, la Vénus d'Ille 1837, Il Viccolo di Madama Lucrezia 1846, Lokis 1869 ou Djoûmane 1873, nouvelles dont certaines sont considérées comme des archétypes du genre. La Vénus d'Ille, reconnue par l'écrivain lui-même comme son chef-d'œuvre, a été depuis saluée par la critique comme un des sommets du récit fantastique. Il est vrai que tout y est dit sans jamais être affirmé : d'un bout à l'autre du texte, les signes se répondent, les mystères linguistiques s'enchaînent – l'inscription du socle, le serment de la bague – et conduisent tous à la Vénus sans que pour autant puissent être posées des interrogations informulées parce qu'indicibles : comment, en effet, parler de la statue autrement qu'en termes esthétiques à moins d'en faire un être objectivement surnaturel ? Comme dans Lokis et son homme-ours, le propre du fantastique de Mérimée est de construire une fiction qui s'enracine profondément dans le quotidien, tout en infiltrant des bribes de merveilleux dont l'existence n'est pas problématique en soi mais dont l'enchaînement se heurte à la cohérence et à la logique initiales. De fait, la froideur du regard et la minutie avec lesquelles l'inspecteur général des Monuments historiques relate les événements les plus invraisemblables sont d'autant plus propices à produire le doute fantastique que le narrateur est un scientifique objectif et digne de foi, que seul le hasard a rendu témoin de faits insolites pour lesquels une explication rationnelle, sans être totalement exclue, n'est guère satisfaisante. C'est par la création de cette indécision qui lui permet de s'éloigner en même temps tant d'un merveilleux frelaté que de la frénésie stérile d'un certain romantisme que Mérimée ouvre la voie à une longue lignée de conteurs fantastiques et s'assure ainsi une place enviable dans le panthéon littéraire
Mort à Cannes
Souffrant d'asthme, Prosper Mérimée meurt le 23 septembre 1870 vers 23 heures8 lors d'une de ses nombreuses cures à Cannes. Il est inhumé au cimetière du Grand Jas de Cannes.
Le romancier et critique d'art Louis Edmond Duranty, disciple de Champfleury et qui fut portraituré par Degas, serait son fils naturel. Sa mort avait été déclarée dans toute la capitale en 1869 alors qu’il n’était pas encore mort. La rumeur fut finalement démentie par le Figaro.
Lors de la Commune, ses livres et papiers furent détruits dans l'incendie de sa maison du 52 rue de Lille.
La base Mérimée
À partir de 1834, Prosper Mérimée commence à faire recenser sur l’ensemble du territoire français les ensembles architecturaux remarquables, annonçant avec un siècle d'avance l'Inventaire Général des Monuments et Richesses Artistiques de la France lancé par André Malraux.
C'est pourquoi, le Ministère de la Culture et de la Communication a créé en 1978 la base Mérimée, qui recense l’ensemble des monuments historiques et, au-delà, le patrimoine architectural remarquable.
La critique
Le critique Charles Du Bos juge inimitable son naturel dans la transcription des propos tout-à-fait quelconques qui s’échappent au cours d’une conversation, une sorte de banalité de bon aloi.
Citation de Victor Hugo : Pas un coteau, des prés maigres, peu de gazon ; / Et j’ai pour tout plaisir de voir à l’horizon / Un groupe de toits bas d’où sort une fumée, / Le paysage étant plat comme Mérimée. » Toute la lyre, recueil de poèmes de Victor Hugo.
Postérité
Carmen, le célèbre opéra de Georges Bizet est inspiré du roman de Mérimée.
Jean Renoir s'est librement inspiré de la pièce Le Carrosse du Saint-Sacrement pour son film Le Carrosse d'or.
Gérard Savoisien, dans sa pièce intitulée Prosper et George, imagine ce qu'a été la relation amoureuse entre Prosper Mérimée et George Sand.
Colomba a été adaptée pour la télévision française en 2005 par Laurent Jaoui.
Liste des œuvres de Prosper Mérimée
Roman
Chronique du règne de Charles IX 1829
Nouvelles
La Guzla 1827
La Jacquerie 1828
La Famille Carvajal 1828
Mateo Falcone 1829
Vision de Charles XI 1829
L'Enlèvement de la redoute 1829
Tamango 1829
Le Fusil enchanté 1829
Le Ban de Croatie 1829
Le Heydouque mourant 1829
La Perle de Tolède 1829
Federigo 1829
Histoire de Rondino 1830
Le Vase étrusque 1830
La Partie de trictrac 1830
Le Musée de Madrid 1830
Lettres d’Espagne 1832
Contient Les Combats de taureaux, Une exécution, Les Voleurs, Les Sorcières espagnoles
Mosaïque 1833, recueils de nouvelles
La Double Méprise 1833
Les Âmes du purgatoire 1834
La Vénus d'Ille 1837
Colomba 1840
Arsène Guillot 1844
L'Abbé Aubain 1844
Carmen 1845
Il Viccolo di Madama Lucrezia 1846
Les Deux Héritages 1850
Épisode de l'histoire de Russie. Les Faux Démétrius 1853
Marino Vreto, contes de la Grèce moderne 1865
La Chambre bleue 1866
Lokis 1869
Djoûmane 1870
Pièces dramatiques
Les Espagnols au Danemark 1825
Une Femme est un diable 1825
Le Théâtre de Clara Gazul 1825
La Jacquerie, scènes féodales, suivie de La Famille de Carvajal 1828
Le Carrosse du Saint-Sacrement, saynète 1829
L'Occasion, comédie 1829
Les Mécontents, proverbe 1833
Récits de voyages
Notes de voyages 1835 - 1840
Notes d'un voyage dans le midi de la France 1835
Notes d'un voyage dans l'Ouest de la France 1836
Notes d'un voyage en Auvergne 1838
Notes d'un voyage en Corse 1845
Essais et études historiques
Essai sur la guerre sociale 1841
Études sur l’histoire romaine 1845
Histoire de Don Pèdre Ier, roi de Castille 1847
Henry Beyle Stendhal 1850
La Littérature en Russie, Nicolas Gogol 1851
Épisode de l'Histoire de Russie, Les Faux Démétrius 1852
Des monuments de France 1853
Les Mormons 1853
La Révolte de Stanka Razine 1861
Les Cosaques de l'Ukraine et leurs derniers attamans 1865
Ivan Tourguénef sic 1868
Correspondance
Lettres à Panizzi recueil, 1856
Une correspondance inédite octobre 1854-février 1863, avertissement de Fernand Brunetière 3e édition, Calmannn-Lévy 1897 - publiée pour la première fois dans La Revue des Deux Mondes
Traductions
La Dame de pique de Pouchkine 1849
Le Coup de pistolet de Pouchkine 1856
Apparitions de Tourgueniev 1866
Le Juif de Tourgueniev 1869
Pétouchkof de Tourgueniev 1869
Le Chien de Tourgueniev 1869
Étrange histoire de Tourgueniev 1870
Posthume
Lettres à une Inconnue recueil de 1873, 2 vol. in-8
La dictée
"La dictée de Mérimée"
La dictée faisait partie des passe-temps de la cour de l'empereur Napoléon III. Mythe ou réalité, la dictée attribuée à Mérimée a mis à l'épreuve les souverains ainsi que leurs invités. Napoléon III commit 75 fautes, l'impératrice Eugénie, 62, Alexandre Dumas fils, 24. Seul un étranger, le prince de Metternich, ambassadeur d'Autriche, n'en fit que 3.
Voici le texte de "la fameuse dictée" publiée par Léo Claretie en 1900.
Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse, près du Havre, malgré les effluves embaumés de la mer, malgré les vins de très bons crus, les cuisseaux de veau et les cuissots de chevreuil prodigués par l'amphitryon, fut un vrai guêpier.
Quelles que soient et quelqu'exiguës qu'aient pu paraître, à côté de la somme due, les arrhes qu'étaient censés avoir données la douairière et le marguillier, il était infâme d'en vouloir pour cela à ces fusiliers jumeaux et mal bâtis et de leur infliger une raclée alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements avec leurs coreligionnaires.
Quoi qu'il en soit, c'est bien à tort que la douairière, par un contresens exorbitant, s'est laissé entraîner à prendre un râteau et qu'elle s'est crue obligée de frapper l'exigeant marguillier sur son omoplate vieillie. Deux alvéoles furent brisés, une dysenterie se déclara, suivie d'une phtisie.
- Par saint Martin, quelle hémorragie, s'écria ce bélître ! À cet événement, saisissant son goupillon, ridicule excédent de bagage, il la poursuivit dans l'église tout entière.
La dictée du bicentenaire de Mérimée
En septembre 2003, en hommage à Mérimée, Bernard Pivot a créé la dictée de Compiègne du bicentenaire de Mérimée, texte qui est publié dans l'ouvrage de Françoise Maison, La Dictée de Mérimée, Château de Compiègne, Séguier, 2003, 64p.
NAPOLÉON III : MA DICTÉE D'OUTRE-TOMBE
Moi, Napoléon III, empereur des Français, je le déclare solennellement aux ayants droit de ma postérité et aux non-voyants de ma légende : mes soixante-quinze fautes à la dictée de Mérimée, c'est du pipeau ! De la désinformation circonstancielle ! De l'esbroufe républicaine ! Une coquecigrue de hugoliens logorrhéiques !
Quels que soient et quelque bizarroïdes qu'aient pu paraître la dictée, ses tournures ambiguës, Saint-Adresse, la douairière, les arrhes versées et le cuisseau de veau, j'étais maître du sujet comme de mes trente-sept millions d'autres. Pourvus d'antisèches par notre très cher Prosper, Eugénie et moi nous nous sommes plu à glisser çà et là quelques fautes. Trop sans doute. Plus que le cynique prince de Metternich, à qui ce fieffé coquin de Mérimée avait probablement passé copie du manuscrit.
En échange de quoi ?
D'un cuissot de chevreuil du Tyrol ?
Liens
hhttp://www.ina.fr/video/CPA82050208/c ... a-venus-d-ille-video.html I jour I livre La vénus d'Ille
http://www.ina.fr/video/CPF86622239/colomba-video.html Colomba 1
http://www.ina.fr/video/CPA82050208/c ... erniere-partie-video.html Colomba 2
http://www.ina.fr/video/CAB92023115/d ... -pivot-a-l-onu-video.html La dictée de Pivot à L'ONU
        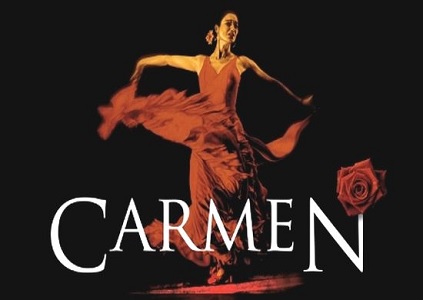   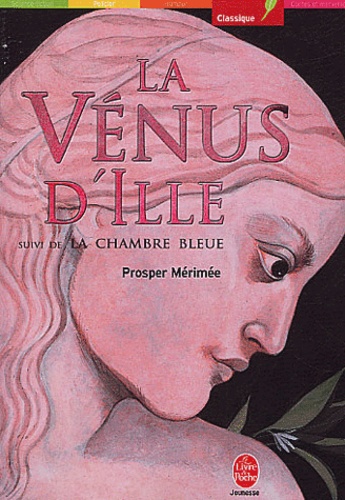 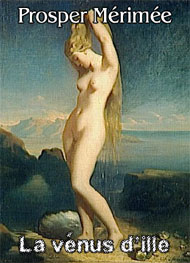 
Posté le : 27/09/2014 18:42
|
|
|
|
|
Louis Pasteur 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 28 septembre 1895 à Marnes-la-Coquette, Seine-et-Oise, à 72 ans
meurt Louis Pasteur
né à Dole Jura le 27 décembre 1822, scientifique français, chimiste microbiologiste et physicien de formation, il travaille à l'université de Strasbourg, de lille dans le Nord, il est diplomé de l'école normale supérieure il aura pour étudiant Charles Friedel qui soutient sa thése sous son parrainage, pionnier de la microbiologie, qui, de son vivant même, connut une grande notoriété pour avoir mis au point un vaccin contre la rage. Il est fait Chevalier de la Légion d'honneur en 1853 et commandeur en 1868, puis grand-officier en 1878
En bref
Pasteur est l'un des fondateurs de la biologie moderne, telle qu'elle s'est développée au XXe siècle. Son œuvre scientifique est à l'origine de quelques-unes des disciplines majeures des sciences de la vie : biochimie métabolique, microbiologie générale, étude des virus et bactéries pathogènes, immunologie. Sa théorie des germes, la pratique des vaccinations qu'il a lancée révolutionnèrent la médecine et la science vétérinaire. Si l'image de Pasteur, bienfaiteur de l'humanité, s'est finalement imposée, la vérité oblige à dire que ce grand savant a dû lutter toute sa vie, avec acharnement, pour obtenir les fonds nécessaires à la poursuite de ses travaux. Ses réussites scientifiques, ses luttes victorieuses en faveur de la recherche appliquée, l'ont entraîné, presque malgré lui, dans le mouvement scientiste des chantres du progrès, si puissant à la fin du XIXe siècle.
Élève de l'école primaire, puis externe au collège d'Arbois Jura, Louis Pasteur est fils de tanneur. C'est un élève moyen, mais il dénote un penchant très vif pour le dessin. Le principal du collège d'Arbois l'incite à s'orienter vers l'École normale supérieure. En octobre 1838, Louis Pasteur et son camarade Jules Vercel partent pour Paris afin de suivre les cours du lycée Saint-Louis. Très rapidement, Pasteur, qui ne supporte pas la séparation du milieu familial, retourne à Arbois, puis part pour le collège de Besançon, plus proche de ses parents que la capitale.
En 1840, Louis Pasteur est bachelier ès lettres. Il continue de peindre et de graver, et il se lie avec Charles Chappuis. En 1842, il est bachelier ès mathématiques ; admissible à l'École normale supérieure 14e sur 22, il décide de se représenter pour obtenir un meilleur rang et part pour Paris. Il est reçu à l'École normale quatrième en 1843.
Sa vie Pasteur chimiste : la recherche fondamentale
Dans la famille de Pasteur, on était patriote et même nationaliste. Son père, Jean-Joseph Pasteur, conscrit en 1811, avait fait la guerre d'Espagne dans les armées napoléoniennes. Sergent-major, il était chevalier de la Légion d'honneur. Après les Cent-Jours, il dut ouvrir à Dôle, dans le Jura, une tannerie pour permettre à sa famille de vivre dans une modeste aisance.
Louis Pasteur naquit à Dôle le 27 décembre 1822. Il était le troisième enfant de Jean-Joseph Pasteur et de Jeanne-Étiennette Roqui, une personne très pieuse. Il est baptisé dans la Collégiale Notre-Dame de Dole le 15 janvier 1823. Son père, après avoir été sergent dans l’armée napoléonienne, reprit la profession familiale de tanneur. En 1827, la famille déménage et quitte Dôle pour Marnoz lieu de la maison familiale des Roqui, pour finalement s'installer en 1830 à Arbois maison de Louis Pasteur à Arbois, localité plus propice à l'activité de tannage et où Pasteur passe toute son enfance. Jusqu'à sa mort, il gardera envers sa famille, ses amis, sa propriété familiale d'Arbois, sa province et son pays, un attachement sans faille.
Le jeune Louis va à l'école communale puis au collège d'Arbois. C'est un bon élève, qui manifeste de grands dons pour le dessin. En 1839, il entre au collège royal de Besançon ; il y passe le baccalauréat. Pour ne plus être à la charge de sa famille, il prend, dans le même collège, un poste de maître-répétiteur et se met à préparer le concours d'entrée à l'École normale supérieure, à Paris dans la section sciences. Il passe le concours une première fois en 1842 et est admis 16e sur 23. Ce rang était insuffisant pour obtenir une bourse ; Pasteur démissionne donc de l'École et décide de se représenter au concours pour obtenir un meilleur classement. Il suit la préparation du lycée Saint-Louis, à Paris, et, en 1843, est reçu 5e ce qui lui permet de devenir élève-boursier. De 1843 à 1846, Louis Pasteur poursuit de brillantes études à l'École normale et à la Sorbonne ; il est reçu 3e à l'agrégation de sciences physiques en 1846. Nommé immédiatement agrégé-préparateur à l'École normale, il pourra y passer deux ans et commencer des recherches en vue de l'obtention d'un doctorat ès sciences.
C'est à cette époque qu'il se fait connaître pour ses talents de peintre ; il a d'ailleurs fait de nombreux portraits de membres de sa famille et des habitants de la petite ville.
Il part au lycée royal de Besançon. Puis, en octobre 1838, il le quitte pour l'Institution Barbet à Paris afin de se préparer au baccalauréat puis aux concours. Cependant, déprimé par cette nouvelle vie, il abandonne cette idée, quitte Paris et termine son année scolaire 1838-1839 au Collège d'Arbois. À la rentrée 1839, il réintègre le collège royal de Franche-Comté, à Besançon. En 1840, il obtient le baccalauréat en lettres puis, en 1842, après un échec, le baccalauréat en sciences mathématiques. Pasteur retourne de nouveau à Paris en novembre. Logé à la pension Barbet où il fait aussi office de répétiteur, il suit les cours du lycée Saint-Louis et assiste avec enthousiasme à ceux donnés à la Sorbonne par Jean-Baptiste Dumas ; il a pu également prendre quelques leçons avec Claude Pouillet. En 1843 il est finalement admis – quatrième – à l'École normale. Plus tard il sera élève de Jean-Baptiste Boussingault au Conservatoire national des arts et métiers.
Pasteur avait suivi avec passion les cours de chimie de Jean-Baptiste Dumas 1800-1882, qu'il admirait beaucoup, et ceux de Jean-Baptiste Biot 1774-1862 qui avait découvert la polarisation rotatoire de la lumière par les cristaux. C'est donc en chimie, sous la direction du professeur de chimie de l'École normale, Antoine-Jérôme Balard 1802-1876, que Pasteur commence ses recherches. Balard, son directeur de thèse, était un chimiste très brillant : à vingt-quatre ans, il avait découvert le brome. Il était membre de l'Académie des sciences. Dans le laboratoire de Balard travaillait aussi un jeune chimiste plein d'avenir, Auguste Laurent, partisan convaincu de la théorie atomique, récemment formulée par Dalton, Proust ou Avogadro) et encore très contestée. Le jeune Pasteur discutait beaucoup avec son aîné Auguste Laurent et reprit nombre de ses idées dans ses premiers travaux. En août 1847, Pasteur présenta deux mémoires pour obtenir son doctorat.
Il se marie le 29 mai 1849 avec Marie Laurent, la fille du recteur de la faculté de Strasbourg7. Ensemble ils ont cinq enfants : Jeanne 1850-1859, Jean Baptiste 1851-1908 sans descendance, Cécile Marie Louise Marguerite -dite Cécile- 1853-1866, Marie-Louise 1858-1934)mariée en 1879 avec René Vallery-Radot, et Camille 1863-1865.
Marie Anne Laurent, dont Émile Roux dit qu'elle a été le meilleur collaborateur de Louis Pasteur écrit sous sa dictée, réalise ses revues de presse et veille à son image puis à sa mémoire jusqu'à son décès en 1910.
À l'École normale, Pasteur étudie la chimie et la physique, ainsi que la cristallographie. Il devient agrégé-préparateur de chimie, dans le laboratoire d'Antoine-Jérôme Balard, et soutient en 1847 à la faculté des sciences de Paris ses thèses pour le doctorat en sciences. Ses travaux sur la chiralité moléculaire lui vaudront la médaille Rumford en 1856.
Il est professeur à Dijon puis à Strasbourg de 1848 à 1853. Le 19 janvier 1849, il est nommé professeur suppléant à la faculté des sciences de Strasbourg ; il occupe également la suppléance de la chaire de chimie à l’école de pharmacie de cette même ville, du 4 juin 1849 au 17 janvier 1851. Marie Laurent, fille du recteur de l'université, épousée en 1849, sera pour le reste de sa vie une collaboratrice efficace et attentionnée, prenant des notes ou rédigeant des lettres sous sa dictée.
Sa vie professionelle:
En 1853 il est fait chevalier de la légion d'honneur.
En février 1854, pour avoir le temps de mener à bien des travaux qui puissent lui valoir le titre de correspondant de l'Institut, il se fait octroyer un congé rémunéré de trois mois à l'aide d'un certificat médical de complaisance. Il fait prolonger le congé jusqu'au 1er août, date du début des examens. Je dis au Ministre que j'irai faire les examens, afin de ne pas augmenter les embarras du service. C'est aussi pour ne pas laisser à un autre une somme de 6 ou 700 francs.
Il est ensuite en 1854 nommé professeur de chimie et doyen de la faculté des sciences de Lille nouvellement créée. C'est à cette occasion qu'il prononce la phrase souvent citée :" Dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés."
Pasteur, qui s'intéressait à la fermentation depuis 1849 voir plus loin, est stimulé dans ces travaux par les demandes des brasseurs lillois concernant la conservation de la bière. Après Frédéric Kuhlmann et Charles Delezenne, Pasteur est ainsi un des premiers en France à établir des relations fructueuses entre l'enseignement supérieur et l'industrie chimique. Les travaux qu'il réalise à Lille entre 1854 et 1857 conduisent à la présentation de son Mémoire sur la fermentation appelée lactique dans le cadre de la Société des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille le 8 août 1857.
En 1857, il est nommé administrateur chargé de la direction des études à l'École normale supérieure.
De 1861 à 1862, Pasteur publie ses travaux réfutant la théorie de la génération spontanée. L'Académie des sciences lui décerne le prix Jecker pour ses recherches sur les fermentations.
En 1862, il est élu à l'Académie des sciences,dans la section de minéralogie, en remplacement de Henri Hureau de Senarmont.
Il étudie sur les maladies du vin, à savoir la pasteurisation, en 1863, sur la fabrication du vinaigre.
En octobre 1865, le Baron Haussman, instituant une commission chargée d'étudier l'étiologie du choléra et les moyens d'y remédier, y nomme Pasteur, avec Dumas (président, Claude Bernard malade, il n'y prendra part que de loin, Sainte-Claire Deville et Pelouze. Les savants, qui cherchent le principe de la contagion dans l'air alors que Snow, dans un travail publié en 1855, avait montré qu'il était dans l'eau, ne trouvent pas18 le microbe, que Pacini avait pourtant fait connaître en 1854.
À l'École normale supérieure, Pasteur est jugé autoritaire aussi bien par ses collègues que par les élèves et se heurte à de nombreuses contestations, ce qui le pousse à démissionner, en 1867, de ses fonctions d'administrateur. Il reçoit une chaire en Sorbonne et on crée, à l'École normale même, un laboratoire de chimie physiologique dont la direction lui est confiée.
Ses études sur les maladies des vers à soie, menées de 1865 à 1869 à la demande de Napoléon III, triomphent de la pébrine mais non de la flacherie et ne permettent pas vraiment d'endiguer le déclin de la sériciculture. Pendant ces études, il demeure à Pont-Gisquet près d'Alès. Durant cette période, une attaque cérébrale le rend hémiplégique. Il se remet, mais gardera toujours des séquelles : perte de l'usage de la main gauche et difficulté à se déplacer. En 1868 il devient commandeur de la légion d'honneur. Cette même année l'Université de Bonn le fait docteur honoris causa en médecine.
La défaite de 1870 et la chute de Napoléon III sont un coup terrible pour Pasteur, grand patriote et très attaché à la dynastie impériale. Par ailleurs, il est malade. L'Assemblée nationale lui vote une récompense pour le remercier de ses travaux dont les conséquences économiques sont considérables.
Le 25 mars 1873, il est élu membre associé libre de l'Académie de médecine.
En 1874, ses recherches sur la fermentation lui valent la médaille Copley, décernée par la Royal Society, de Londres
En 1876, Pasteur se présente aux élections sénatoriales, mais c'est un échec. Ses amis croient qu'il va enfin s'arrêter et jouir de sa retraite, mais il reprend ses recherches. Il gagne Clermont-Ferrand où il étudie les maladies de la bière avec son ancien préparateur Émile Duclaux, et conclut ses études sur la fermentation par la publication d'un livre : Les Études sur la bière 1876.
En 1878 il devient grand-officier de la légion d'honneur.
Le 11 décembre 1879, Louis Pasteur est élu à l'unanimité à l'Académie vétérinaire de France.
En 1881, l'équipe de Pasteur met au point un vaccin contre le charbon des moutons, à la suite des études commencées en 1877.
En 1882, il est reçu à l'Académie française. Dans son discours de réception, il accepte pour la science expérimentale l'épithète positiviste, en ce sens qu'elle a pour domaine les causes secondes et s'abstient donc de spéculer sur les causes premières et sur l'essence des choses, mais il reproche à Auguste Comte et à Littré d'avoir voulu imposer cette abstention à toute la pensée humaine. Il plaide pour le spiritualisme et célèbre « les deux saintetés de l'Homme-Dieu, qu'il voit réunies dans le couple que l'agnostique Littré formait avec sa femme chrétienne. C'est dans ce discours que Pasteur prononce la phrase souvent citée : Les Grecs ... nous ont légué un des plus beaux mots de notre langue, le mot enthousiasme ... — un dieu intérieur.
Il reçoit, le 29 décembre 1883, le mérite agricole pour ses travaux sur les vins et la fermentation. Il se rend régulièrement aux réunions du Cercle Saint-Simon.
En 1885, Pasteur refusa de poser sa candidature aux élections législatives, alors que les paysans de la Beauce, dont il avait sauvé les troupeaux grâce au vaccin contre le charbon, l'auraient sans doute porté à la Chambre des Députés.
La découverte du vaccin antirabique 1885 vaudra à Pasteur sa consécration dans le monde : il recevra de nombreuses distinctions. L'Académie des sciences propose la création d'un établissement destiné à traiter la rage : l'Institut Pasteur naît en 1888. En 1892, la troisième république lui organise un jubilé triomphal pour son 70e anniversaire. À cette occasion, une médaille gravée par Oscar Roty lui est offerte par souscription nationale
Il meurt le 28 septembre 1895 à Villeneuve-l'Étang, dans l'annexe dite "de Garches" de l'Institut Pasteur. Après des obsèques nationales, le 5 octobre, son corps, préalablement embaumé, est déposé dans l’un des caveaux de Notre-Dame, puis transféré le 27 décembre 1896, à la demande de sa famille, dans une crypte de l'Institut Pasteur.
Ses recherches scientifiques Œuvre Découverte de la dissymétrie moléculaire
Pasteur sépare les deux formes de cristaux d'acide tartrique, pour former deux tas : la forme lévogyre, qui, en solution, dévie la lumière polarisée vers la gauche, et la forme dextrogyre qui dévie la lumière polarisée vers la droite. Un mélange équimoléculaire racémique des deux solutions ne dévie pas cette lumière.
Dans les travaux que Pasteur a réalisés au début de sa carrière scientifique en tant que chimiste, il résolut en 1848 un problème qui allait par la suite se révéler d'importance capitale dans le développement de la chimie contemporaine : la séparation des deux formes de l'acide tartrique. Le seul acide tartrique que l'on connaissait à l'époque était un sous-produit classique de la vinification, utilisé dans la teinturerie. Parfois, au lieu de l'acide tartrique attendu, on obtenait un autre acide, qu'on appela acide racémique puis acide paratartrique. Une solution de l'acide tartrique, comme de chacun de ses sels tartrates, tournait le plan de la lumière polarisée la traversant, alors qu'une solution de l'acide paratartrique, comme de chacun de ses sels paratartrates, ne causait pas cet effet, bien que les deux composés aient la même formule brute. En 1844, Mitscherlich avait affirmé que, parmi les couples tartrate / paratartrate, il y en avait un, à savoir le couple tartrate double de soude et d'ammoniaque / paratartrate double de soude et d'ammoniaque, où le tartrate et le paratartrate n'étaient discernables que par la propriété rotatoire, présente dans le tartrate et absente dans le paratartrate tartrate double de soude et d'ammoniaque était la façon dont on désignait à l'époque le tartrate – base conjuguée de l'acide tartrique – de sodium et d'ammonium. En particulier, ce tartrate et ce paratartrate avaient, selon Mitscherlich, la même forme cristalline. Pasteur eut peine à croire que deux substances fussent aussi semblables sans être tout à fait identiques. Il refit les observations de Mitscherlich et s'avisa d'un détail que Mitscherlich n'avait pas remarqué : dans le tartrate en question, les cristaux présentent une dissymétrie hémiédrie, toujours orientée de la même façon ; en revanche, dans le paratartrate correspondant, il coexiste deux formes de cristaux, images spéculaires non superposables l'une de l'autre, et dont l'une est identique à celle du tartrate. Il sépara manuellement les deux sortes de cristaux du paratartrate, en fit deux solutions et observa un effet de rotation du plan de polarisation de la lumière, dans un sens opposé pour les deux échantillons. La déviation du plan de polarisation par les solutions étant considérée, depuis les travaux de Biot, comme liée à la structure de la molécule, Pasteur conjectura que la dissymétrie de la forme cristalline correspondait à une dissymétrie interne de la molécule, et que la molécule en question pouvait exister en deux formes dissymétriques inverses l'une de l'autre. C'était la première apparition de la notion de chiralité des molécules. Depuis les travaux de Pasteur, l'acide racémique ou paratartrique est considéré comme composé d'un acide tartrique droit, l'acide tartrique connu antérieurement et d'un acide tartrique gauche.
Chiralité chimie.
Les travaux de Pasteur dans ce domaine ont abouti, quelques années plus tard à la naissance du domaine de la stéréochimie avec la publication de l'ouvrage la Chimie dans l'Espace par Van 't Hoff qui, en introduisant la notion d'asymétrie de l'atome de carbone a grandement contribué à l'essor de la chimie organique moderne.
Pasteur avait correctement démontré par l'examen des cristaux puis par l'épreuve polarimétrique que l'acide paratartrique est composé de deux formes distinctes d'acide tartrique. En revanche, la relation générale qu'il crut pouvoir en déduire entre la forme cristalline et la constitution de la molécule était inexacte, le cas spectaculaire de l'acide paratartrique étant loin d'être l'illustration d'une loi générale, comme Pasteur s'en apercevra lui-même. François Dagognet dit à ce sujet : la stéréochimie n'a rien conservé des vues de Pasteur, même s'il demeure vrai que les molécules biologiques sont conformées hélicoïdalement.
Gerald L. Geison a noté chez Pasteur une tendance à atténuer sa dette envers Auguste Laurent pour ce qui est de la connaissance des tartrates.
Études sur la fermentation De la dissymétrie moléculaire à la fermentation
En 1849, Biot signale à Pasteur que l'alcool amylique dévie le plan de polarisation de la lumière et possède donc la propriété de dissymétrie moléculaire. Pasteur estime peu vraisemblable que l'alcool amylique hérite cette propriété du sucre dont il est issu par fermentation, car, d'une part, la constitution moléculaire des sucres lui paraît très différente de celle de l'alcool amylique et, de plus, il a toujours vu les dérivés perdre la propriété rotatoire des corps de départ. Il conjecture donc que la dissymétrie moléculaire de l'alcool amylique est due à l'action du ferment. S'étant persuadé sous l'influence de Biot que la dissymétrie moléculaire est étroitement liée à la vie, il voit là la confirmation de certaines idées préconçues qu'il s'est faites sur la cause de la fermentation et qui le rangent parmi les tenants du ferment vivant.
Les idées de l'époque sur la fermentation
En 1787, en effet, Adamo Fabbroni, dans son Ragionamento sull'arte di far vino Florence, avait le premier soutenu que la fermentation du vin est produite par une substance vivante présente dans le moût. Cagniard de Latour et Theodor Schwann avaient apporté des faits supplémentaires à l'appui de la nature vivante de la levure. Dans le même ordre d'idées, Jean-Baptiste Dumas, en 1843 époque où le jeune Pasteur allait écouter ses leçons à la Sorbonne, décrivait le ferment comme un être organisé et comparait son activité à l'activité de nutrition des animaux.
Berzélius, lui, avait eu une conception purement catalytique de la fermentation, qui excluait le rôle d'organismes vivants. Liebig, de façon plus nuancée, avait des idées analogues : il voulait bien envisager que la levure fût un être vivant, mais il affirmait que si elle provoquait la fermentation, ce n'était pas par ses activités vitales mais parce qu'en se décomposant, elle était à l'origine de la propagation d'un état de mouvement vibratoire. Berzélius et Liebig avaient tous deux combattu les travaux de Cagniard de Latour et de Schwann.
Les découvertes de Pasteur
Pasteur dispose d'une première orientation donnée par Cagniard de Latour ; il la développe et montre que c'est en tant qu'être vivant que la levure agit, et non en tant que matière organique en décomposition. Ces travaux bénéficient de la mise au point des premiers objectifs achromatiques dépourvus d'irisation parasite. De 1857 à 1867, il publie des études sur les fermentations. Inaugurant la méthode des cultures pures, il établit que certaines fermentations lactique, butyrique où on n'avait pas aperçu de substance jouant un rôle analogue à celui de la levure ce qui avait servi d'argument à Liebig sont bel et bien l'œuvre d'organismes vivants.
Il établit la capacité qu'ont certains organismes de vivre en l'absence d'oxygène libre c'est-à-dire en l'absence d'air. Il appelle ces organismes anaérobies.
Ainsi, dans le cas de la fermentation alcoolique, la levure tenue à l'abri de l'air vit en provoquant aux dépens du sucre une réaction chimique qui libère les substances dont elle a besoin et provoque en même temps l'apparition d'alcool. En revanche, si la levure se trouve en présence d'oxygène libre, elle se développe davantage et la fermentation productrice d'alcool est faible. Les rendements en levure et en alcool sont donc antagonistes. L'inhibition de la fermentation par la présence d'oxygène libre est ce qu'on appellera l'effet Pasteur.
Débat sur le rôle exact des agents vivants dans la fermentation
Même si Liebig resta sur ses positions, les travaux de Pasteur furent généralement accueillis comme prouvant définitivement le rôle des organismes vivants dans la fermentation. Toutefois, certains faits comme le rôle joué dans l'hydrolyse de l'amidon par la diastase, ou alpha-amylase, découverte en 1833 par Payen et Persoz allaient dans le sens de la conception catalytique de Berzélius. C'est pourquoi Moritz Traube en 1858 et Marcellin Berthelot en 1860 proposèrent une synthèse des deux théories, physiologique et catalytique : la fermentation n'est pas produite directement par les êtres vivants qui en sont responsables couramment levures etc. mais par des substances non vivantes, des ferments solubles on disait parfois diastases et on dira plus tard enzymes, substances elles-mêmes sécrétées ou excrétées par les êtres vivants en question. En 1878, Berthelot publia un travail posthume de Claude Bernard qui, contredisant Pasteur, mettait l'accent sur le rôle des ferments solubles dans la fermentation alcoolique. Il en résulta entre Pasteur et Berthelot une des controverses célèbres de l'histoire des sciences.
Pasteur ne rejetait pas absolument le rôle des ferments solubles. Dans le cas particulier de la fermentation ammoniacale de l'urine, il considérait comme établi, à la suite d'une publication de Musculus, que la cause proche de la fermentation était un ferment soluble, dans ce cas, l'enzyme qu'on appellera uréase produit par le ferment microbien qu'il avait découvert lui-même. Il admettait aussi le phénomène, signalé par Lechartier et Bellamy, de l'alcoolisation des fruits sans intervention du ferment microbien alcoolique. Plus d'une fois, il déclara qu'il ne repoussait pas mais n'adoptait pas non plus l'hypothèse d'un ferment soluble dans la fermentation alcoolique. Toutefois, il écrivit en 1879, à propos du ferment soluble alcoolique : La question du ferment soluble est tranchée : il n'existe pas; Bernard s'est fait illusion. On s'accorde donc à penser que Pasteur fut incapable de comprendre l'importance des ferments solubles, consacrée depuis par les travaux d’Eduard Buchner et souligna le rôle des micro-organismes dans les fermentations proprement dites avec une insistance excessive, qui n'allait pas dans le sens du progrès de l'enzymologie. On met cette répugnance de Pasteur à relativiser le rôle des organismes vivants sur le compte de son vitalisme80, qui l'empêcha aussi de comprendre le rôle des toxines et d'admettre en 1881, lors de sa rivalité avec Toussaint dans la course au vaccin contre le charbon, qu'un vaccin tué pût être efficace.
Les travaux de Pasteur sur la fermentation ont fait l'objet d'un débat dans les années 1970 et 1980, la question étant de savoir si, en parlant de fermentations proprement dites, Pasteur avait commis une tautologie qui lui permettait de prouver à peu de frais la cause biologique des fermentations.
Réfutation de la génération spontanée
À partir de 1859, Pasteur mène une lutte contre les partisans de la génération spontanée, en particulier contre Félix Archimède Pouchet et un jeune journaliste, Georges Clemenceau; ce dernier, médecin, met en cause les compétences de Pasteur, qui ne l'est pas, et attribue son refus de la génération spontanée à un parti-pris idéologique Pasteur est chrétien. Il fallut à Pasteur six années de recherche pour démontrer la fausseté sur le court terme de la théorie selon laquelle la vie pourrait apparaître à partir de rien, et les microbes être générés spontanément.
Les questions précises
Depuis le XVIIIe siècle, partisans et adversaires de la génération spontanée aussi appelée hétérogénie cherchent à réaliser des expériences décisives à l'appui de leur opinion.
Les partisans de cette théorie appelés spontéparistes ou hétérogénistes soutiennent que, quand le contact avec l'air fait apparaître sur certaines substances des êtres vivants microscopiques, cette vie tient son origine non pas d'une vie préexistante mais d'un pouvoir génésique de l'air.
Pour les adversaires de la génération spontanée, l'air amène la vie sur ces substances non par une propriété génésique mais parce qu'il véhicule des germes d'êtres vivants.
En 1791 déjà, Pierre Bulliard avance, à la suite d'expériences rigoureuses, que la putréfaction ne donne pas naissance à des êtres organisés et que toute moisissure ne peut survenir que de la graine d'un individu de la même espèce.
En 1837, encore, Schwann a fait une expérience que les adversaires de la génération spontanée considèrent comme probante en faveur de leur thèse : il a montré que si l'air est chauffé puis refroidi avant de pouvoir exercer son influence, la vie n'apparaît pas.
En 1847 M. Blondeau de Carolles faisant état d'une expérience reprenant celles conduites par Turpin conclut : tout être organisé provient d'un germe qui, pour se développer, n'a besoin que de circonstances favorables, et que ce germe ne peut dévier de la mission qui lui est assignée, laquelle est de reproduire un être semblable à celui qui l'a formé.
Le 20 décembre 1858, l'Académie des Sciences prend connaissance de deux notes où Pouchet, naturaliste et médecin rouennais, prétend apporter une preuve définitive de la génération spontanée.
Le 3 janvier 1859, l'Académie des Sciences discute la note de Pouchet. Tous les académiciens qui participent à cette discussion : Milne Edwards, Payen, Quatrefages, Claude Bernard et Dumas, alléguant des expériences qu'ils ont faites eux-mêmes, s'expriment contre la génération spontanée, qui, d'ailleurs, est alors devenue une doctrine minoritaire.
Même après les discussions de l'Académie, il reste cependant deux points faibles dans la position des adversaires de la génération spontanée :
sous certaines conditions, ils obtiennent, sans pouvoir l'expliquer, des résultats apparemment favorables à la génération spontanée;
les procédés chauffage, lavage à l'acide sulfurique, filtrage par lesquels ils débarrassent l'air des germes qu'il pourrait véhiculer sont accusés par les spontéparistes de tourmenter l'air et de le priver de son pouvoir génésique. Personne, raconte Pasteur, ne sut indiquer la véritable cause d'erreur de ses expériences = de Pouchet, et bientôt l'Académie, comprenant tout ce qui restait encore à faire, propose pour sujet de prix la question suivante : Essayer, par des expériences bien faites, de jeter un jour nouveau sur la question des générations spontanées.
C'est Pasteur qui va obtenir le prix, pour ses travaux expérimentaux exposés dans son Mémoire sur les corpuscules organisés qui existent dans l'atmosphère. Examen de la doctrine des générations spontanées. 1861:
Les expériences de Pasteur
Ses expériences sont, pour l'essentiel, des versions améliorées de celles de ses prédécesseurs. Il comble de plus les deux desiderata signalés plus haut. Tout d'abord, il comprend que certains résultats antérieurs, apparemment favorables à la génération spontanée étaient dus à ce qu'on utilisait la cuve à mercure pour empêcher la pénétration de l'air ambiant : le mercure, tout simplement, est lui-même très sale.
Ensuite, il présente une expérience qu'on ne peut pas accuser de tourmenter l'air : il munit des flacons d'un col, col de cygne et constate que, dans un nombre appréciable de cas, l'air qui a traversé les sinuosités, sans avoir été ni chauffé, ni filtré ni lavé, ne provoque pas l'apparition d'êtres vivants sur les substances qui se trouvent au fond du flacon, alors qu'il la provoque sur une goutte placée à l'entrée du circuit. La seule explication de l'inaltération du fond est que des germes ont été arrêtés par les sinuosités et se sont déposés sur le verre. Cette expérience avait été suggérée à Pasteur par le chimiste Balard ; Chevreul en avait fait d'analogues dans ses cours.
Enfin, Pasteur réfute un argument propre à Pouchet : celui-ci, arguant de la constance avec laquelle, dans ses expériences, du moins la vie apparaissait sur les infusions, concluait que, si la théorie de ses adversaires était exacte, les germes seraient à ce point ubiquitaires que l'air dans lequel nous vivons aurait presque la densité du fer. Pasteur fait des expériences en divers lieux, temps et altitudes et montre que, si on laisse pénétrer l'air ambiant sans le débarrasser de ses germes la proportion des bocaux contaminés est d'autant plus faible que l'air est plus pur. Ainsi, sur la Mer de Glace, une seule des vingt préparations s'altère.
Dans l'expérience des ballons à col de cygne, l'air était de l'air normal, ni chauffé, ni filtré ni lavé chimiquement, mais la matière fermentescible était chauffée, ce dont un spontépariste aurait pu tirer argument pour prétendre que le résultat de l'expérience non-apparition de la vie ne provenait pas de l'absence des germes, mais d'une modification des propriétés de la matière fermentescible. En 1863, Pasteur montre que si on met un liquide organique tout frais sang ou urine en présence d'air stérilisé, la vie n'apparaît pas, ce qui, conclut-il, porte un dernier coup à la doctrine des générations spontanées.
Incomplétude de la démonstration de Pasteur
Il y avait toutefois une lacune dans la démonstration de Pasteur : alors qu'il se posait en réfutateur de Pouchet, il n'utilisa jamais une infusion de foin comme le faisait Pouchet. S'il l'avait fait, il se serait peut-être trouvé devant une difficulté inattendue. En effet, de 1872 à 1876, quelques années après la controverse Pasteur-Pouchet, Ferdinand Cohn établira qu'un bacille du foin, Bacillus subtilis, peut former des endospores qui le rendent résistant à l'ébullition.
À la lumière des travaux de Cohn, le pasteurien Émile Duclaux reconnaît que la réfutation de Pouchet par Pasteur devant la Commission académique des générations spontanées était erronée : L'air est souvent un autre facteur important de la réviviscence des germes .... Le foin contient d'ordinaire, comme Cohn l'a montré depuis, un bacille très ténu .... C'est ce fameux bacillus subtilis .... Ses spores, en particulier, peuvent supporter plusieurs heures d'ébullition sans périr, mais elles sont d'autant plus difficiles à rajeunir qu'elles ont été plus maltraitées. Si on ferme à la lampe le col du ballon qui les contient, au moment où le liquide qui les baigne est en pleine ébullition elles ne sont pas mortes, mais elles ne se développent pas dans le liquide refroidi et remis à l'étuve, parce que l'air fait défaut. Si on laisse rentrer cet air, l'infusion se peuple, et se peuplerait encore si on ne laissait rentrer que de l'air chauffé, car l'air n'agit pas, comme le croyait Pasteur au moment des débats devant la Commission académique des générations spontanées, en apportant des germes : c'est son oxygène qui entre seul en jeu. Émile Duclaux ajoute que Pasteur revint de son erreur.
L'air comme facteur de réviviscence de germes non pas morts, mais en état de non-développement, telle est donc l'explication que la science a fini par préférer à l'air convoyeur de germes pour rendre compte d'un phénomène que Pouchet, pour sa part, interprétait comme suit : les Proto-organismes, qui naissent spontanément ... ne sont pas extraits de la matière brute proprement dite, ainsi que l'ont prétendu quelques fauteurs = partisans de l'hétérogénie, mais bien des particules organiques, débris des anciennes générations d'animaux et de plantes, qui se trouvent combinées aux parties constituantes des minéraux. Selon cette doctrine, ce ne sont donc pas des molécules minérales qui s'organisent, mais bien des particules organiques qui sont appelées à une nouvelle vie.
On considère que c'est John Tyndall qui, en suivant les idées de Cohn, mettra la dernière main à la réfutation de la génération spontanée.
Pasteur estimait d'ailleurs que la génération spontanée n'était pas réfutée de façon absolue, mais seulement dans les expériences par lesquelles on avait prétendu la démontrer. Dans un texte non publié de 1878, il déclarait ne pas juger la génération spontanée impossible.
Critiques externalistes
Nous avons vu qu'on peut reprocher à Pasteur comme un manque de rigueur le fait de ne pas avoir cherché à répéter vraiment les expériences de Pouchet. Il y a une autre circonstance où, dans ses travaux sur la génération spontanée, Pasteur peut sembler tendancieux, puisqu'il admet avoir passé sous silence des constatations qui n'allaient pas dans le sens de sa thèse. En effet, travaillant à l'aide de la cuve à mercure alors qu'il n'avait pas encore compris que le mercure apporte lui-même des germes, il avait obtenu des résultats apparemment favorables à la génération spontanée : Je ne publiai pas ces expériences; les conséquences qu'il fallait en déduire étaient trop graves pour que je n'eusse pas la crainte de quelque cause d'erreur cachée, malgré le soin que j'avais mis à les rendre irréprochables. J'ai réussi, en effet, plus tard, à reconnaître cette cause d'erreur.
Se fondant sur ces deux entorses de Pasteur à la pure méthode scientifique, et aussi sur ce qu'ils considéraient comme l'évidente partialité de l'Académie des sciences en faveur de Pasteur, Farley et Geison, dans un article de 1974108, ont soutenu qu'un facteur externe à la science intervenait dans la démarche de Pasteur et de l'Académie des sciences : le désir de faire échec aux idées matérialistes et subversives dont la génération spontanée passait pour être l'alliée. Pasteur, qui était spiritualiste, voyait un lien entre matérialisme et adhésion à la génération spontanée, mais se défendait de s'être lui-même laissé influencer par cette sorte de considérations dans ses travaux scientifiques. Dans son livre de 1999, Geison reprend une bonne part de l'article de 1974, mais reconnaît que cet article était trop externaliste au détriment de Pasteur et faisait la part trop belle à Pouchet.
H. Collins et T. Pinch, en 1993, prennent eux aussi pour point de départ de leur réflexion les deux entorses de Pasteur à la pure méthode scientifique et la partialité de l'Académie des sciences, ils mentionnent eux aussi brièvement les enjeux religieux et politiques que certains croyaient voir dans la question, mais n'évoquent pas la possibilité que Pasteur lui-même ait cédé à de tels mobiles idéologiques. En fait, ils exonèrent Pasteur et blâment plutôt une conception aseptisée de la méthode scientifique : Pasteur savait ce qui devait être considéré comme un résultat et ce qui devait l'être comme une 'erreur'. Pasteur était un grand savant, mais la manière dont il a agi ne s'approche guère de l'idéal de la méthode scientifique proposé de nos jours. On voit mal comment il aurait pu transformer à ce point notre conception de la nature des germes s'il avait dû adopter le modèle de comportement stérile qui passe aux yeux de beaucoup pour le parangon de l'attitude scientifique.
Signalons cependant, à propos de cette apologie un peu cynique, que des voix se sont élevées contre la tendance de certains théoriciens externalistes ou relativistes des sciences à réduire l'activité scientifique, et notamment celle de Pasteur, à des manœuvres et à des coups de force où la rationalité aurait assez peu de part.
Dans un article de 1999 et un livre de 2003, D. Raynaud a réexaminé la controverse sur la génération spontanée en partant de la correspondance non publiée entre les membres de l'Académie des Sciences et Pouchet. À partir de quatre arguments principaux, il a conclu à l'inanité de l'apologie de Pouchet présentée par certains historiens et sociologues relativistes des sciences. Défaite de Pouchet. En 1862, après avoir déposé son mémoire pour le concours du prix Alhumbert, Pouchet décida de se retirer du concours, contribuant ainsi à assurer la victoire de Pasteur. En 1864, après avoir demandé que la controverse soit tranchée par une commission d'expertise MHNR, FAP 3978, Pouchet recula parce que les résultats seraient "compromis par les basses températures du printemps". Les expériences reportées au moins de juin, Pouchet refusa une nouvelle fois de se présenter à Paris. Dans une lettre du 18 juin 1864, Flourens devait lui laisser une dernière chance de faire ses expériences mais il se défaussa encore, laissant la commission expertiser les seuls travaux de Pasteur. Coalition anti-Pouchet. Raynaud note que la coalition anti-Pouchet au sein de l'Académie des Sciences a été plus supposée que réellement démontrée. La correspondance montre que Pouchet avait des relations suivies et amicales avec plusieurs académiciens, en particulier Geoffroy Saint-Hilaire, Serres, Coste et Flourens, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences. Qualités d'expérimentateur. Raynaud pondère les erreurs de méthode de Pasteur, qui sont souvent mises en exergue, par celles, moins connues, de son adversaire rouennais. L'argument du Bacillus subtilis est fragilisé par le fait que Pouchet porta le corps putrescible à 200 °C, 250°C et même plus, sans entraver l'apparition des micro-organismes. Pouchet pensait avoir démontré expérimentalement que la lumière rouge favorise l'apparition des micro-organismes d'origine animale, la lumière verte, celle des microphytes. Il admettait par ailleurs les pluies de grenouilles et les avalanches d'épinoches comme preuves irréfutables de la génération spontanée. Probité intellectuelle. En 1863, Pouchet, Joly et Musset tentèrent de reproduire les expériences de Pasteur dans les Pyrénées. Ils ouvrent quatre ballons A, B, C, D au village de Rencluse à 2083 m d'altitude; quatre autres ballons E, F, G, H sur les glaciers de la Maladeta à 3000 m d'altitude. À leurs yeux, tous les ballons contiennent des micro-organismes. La note des Comptes rendus de l'Académie des Sciences de 1863 ne décrivant pas le contenu des ballons un à un, Pasteur sommera Pouchet d'expliquer ce que sont devenus les ballons manquants B, C, G, H. Pouchet demande alors à Joly de répondre: Vous voyez où il veut en venir. Pondérez bien vos phrases. Par ailleurs, selon D. Raynaud, l'apologie de Pouchet se fonderait sur la prise en compte par les historiens et sociologues des sciences du témoignage de Pennetier, disciple de Pouchet, qui tire sa lecture de la controverse d'une lettre présumée d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire du 31 août 1859, qui est un faux de Pouchet.
Les maladies du vin et la pasteurisation
Études sur le vin Louis Pasteur, édition de 1866
En 1862, Pasteur confirme l'opinion formulée dès 1822 par Christiaan Hendrik Persoon, en établissant le rôle d'un microorganisme, le mycoderma aceti renommé Acetobacter aceti dans la formation du vinaigre.
En 1863, il y a déjà quelques années que les maladies des vins français grèvent lourdement le commerce. Napoléon III demande à Pasteur, spécialiste de la fermentation et de la putréfaction, de chercher un remède : Pasteur, qui transporta deux années de suite en automne son laboratoire à Arbois, publiera les résultats de ses travaux dans Études sur le vin en 1866 il avait publié un premier papier sur le sujet dès 1863. Il propose de chauffer le vin à 57 °C afin de tuer les germes et résout ainsi le problème de sa conservation et du transport, c'est la pasteurisation. Il a au sujet de ce procédé une querelle de priorité avec l'œnologue Alfred de Vergnette de Lamotte, dans laquelle les savants Balard et Thenard prennent parti respectivement pour Pasteur et pour Vergnette. Pasteur et Vergnette avaient d'ailleurs été tous deux précédés par Nicolas Appert qui avait publié le chauffage des vins en 1831 dans son ouvrage Le livre de tous les ménages. La découverte de la pasteurisation vaudra à Pasteur le Mérite Agricole, mais aussi le Grand Prix de l’Exposition universelle 1867.
Des dégustateurs opérant à l'aveugle avaient conclu que la pasteurisation n'altérait pas le bouquet des grands vins, mais Pasteur fut forcé de reconnaître la forte influence de l'imagination après avoir vu sa commission d'expertise renverser complètement ses conclusions sur le même vin en l'espace de quelques jours. Finalement, la pasteurisation du vin n'eut pas un grand succès et fut abandonnée avant la fin du XIXe siècle. Avant la Première Guerre mondiale, l'Institut Pasteur pratiqua sur le vin une pasteurisation rapide en couche mince qui ne se répandit guère mais fit plus tard un retour triomphal en France sous son nom américain de flash pasteurization.
En Bourgogne la pasteurisation du vin a été abandonnée dans les années 1930.
Les maladies microbiennes du vin ont été évitées par d'autres moyens que la pasteurisation : conduite rationnelle des fermentations, sulfitage des vendanges, réduction des populations contaminantes par différents procédés de clarification. D'un emploi malaisé au niveau du chai, où elle ne met pas en outre la cuvée à l'abri d'une contamination postérieure au chauffage, la pasteurisation a toutefois son utilité pour certains types de vins, - d'ailleurs plutôt de qualité moyenne et de consommation rapide - au moment de l'embouteillage où l'on préfère parfois les techniques de sulfitage et de filtration stérile, la Brasserie par contre recourt plus volontiers à ce procédé.
Pour sa mise en évidence du rôle des organismes vivants dans la fermentation alcoolique et pour les conséquences d'ordre pratique qu'il en a tirées, Pasteur est considéré comme le fondateur de l’œnologie, dont Chaptal avait posé les premiers jalons. Toutefois, en limitant l'action positive aux seules levures, Pasteur n'a pas pu voir le rôle de certaines bactéries dans le déclenchement de la fermentation malolactique, rôle qui, une fois redécouvert -en 1946- permettra une conduite beaucoup plus subtile de la vinification.
Contrairement à la pasteurisation du vin, la pasteurisation du lait, à laquelle Pasteur n'avait pas pensé, c'est le chimiste allemand Franz von Soxhlet qui, en 1886, proposa d'appliquer la pasteurisation au lait1, s'implanta durablement. Ici encore, d'ailleurs, on marchait sur les traces d'Appert
Les fermentations mènent aux maladies contagieuses
La théorie de l'origine microbienne des maladies contagieuses, appelée théorie microbienne ou théorie des germes, existait depuis longtemps, mais seulement à l'état d'hypothèse. La première démonstration de la nature vivante d'un agent infectieux est établie en 1687 par deux élèves de Francesco Redi, Giovanni Cossimo Bonomo et Diacinto Cestoni qui montrent, grâce à l'utilisation du microscope, que la gale est causée par un petit parasite, Sarcoptes scabiei. Cette découverte n'eut pourtant alors aucun écho. Vers 1835, quelques savants, dont on a surtout retenu Agostino Bassi, prouvent qu'une des maladies du ver à soie, la muscardine, est causée par un champignon microscopique. En 1836-37 Alfred Donné décrit le protiste responsable de la trichomonose : Trichomonas vaginalis. En 1839 Johann Lukas Schönlein identifie l'agent des teignes faviques : Trichophyton schoenleinii; en 1841 le suédois Frederick Theodor Berg identifie Candida albicans, l'agent du Muguet buccal et en 1844, David Gruby identifie l'agent des teignes tondantes, Trichophyton tonsurans, cette dernière découverte apparemment oubliée, fut faite de nouveau par Saboureau en 1894. Il s'agissait là toutefois de protozoaires ou d'organismes multicellulaires. En 1861 Anton de Bary établit le lien de causalité entre le mildiou de la pomme de terre - responsable notamment de la Grande famine en Irlande - et le champignon Botrytis infestans, qui avait déjà été observé par Miles Joseph Berkeley en 1845.
Dans un essai de 1840, Friedrich Gustav Jakob Henle, faisant écho aux travaux de Bassi sur la nature microbienne de la muscardine du ver à soie et à ceux de Cagniard de Latour et de Theodor Schwann sur la nature vivante de la levure, avait développé une théorie microbienne des maladies contagieuses et formulé les critères permettant selon lui de décider si telle maladie a pour cause tel micro-organisme.
La théorie, en dépit de ces avancées, rencontrait des résistances et se développait assez lentement, notamment pour ce qui est des maladies contagieuses humaines. Ainsi, la découverte du bacille du choléra était restée quasiment lettre morte quand Pacini l'avait publiée en 1854, alors qu'elle devait trouver immédiatement une vaste audience quand Koch la refit en 1883. À l'époque des débuts de Pasteur, donc, la théorie microbienne existe, même si elle est encore dans l'enfance. D'autre part, il est de tradition, surtout depuis le XVIIIe siècle, de souligner l'analogie entre les maladies fiévreuses et la fermentation. Il n'est donc pas étonnant, dans ce contexte, que les travaux de Pasteur sur la fermentation aient stimulé le développement de la théorie microbienne des maladies contagieuses. En 1860, après avoir réaffirmé le rôle des organismes vivants dans la putréfaction et la fermentation, Pasteur lui-même ajoutait : Je n'ai pas fini cependant avec toutes ces études. Ce qu'il y aurait de plus désirable serait de les conduire assez loin pour préparer la voie à une recherche sérieuse de l'origine de diverses maladies. Casimir Davaine, au début de ses publications de 1863 sur le charbon, qui sont maintenant considérées comme la première preuve de l'origine microbienne d'une maladie transmissible à l'homme, écrivait M. Pasteur, en février 1861, publia son remarquable travail sur le ferment butyrique, ferment qui consiste en petites baguettes cylindriques, possédant tous les caractères des vibrions ou des bactéries. Les corpuscules filiformes que j'avais vus dans le sang des moutons atteints de sang de rate = charbon ayant une grande analogie de forme avec ces vibrions, je fus amené à examiner si des corpuscules analogues ou du même genre que ceux qui déterminent la fermentation butyrique, introduits dans le sang d'un animal, n'y joueraient pas de même le rôle d'un ferment.
Pasteur lui-même, en 1880, rappelle ses travaux sur les fermentations et ajoute :
"La médecine humaine, comme la médecine vétérinaire, s'emparèrent de la lumière que leur apportaient ces nouveaux résultats". On s'empressa notamment de rechercher si les virus et les contages ne seraient pas des êtres animés. Le docteur Davaine 1863 s'efforça de mettre en évidence les fonctions de la bactéridie du charbon, qu'il avait aperçue dès l'année 1850.
On verra toutefois que Pasteur, quand il aura à s'occuper des maladies des vers à soie, en 1865, commencera par nier le caractère microbien de la pébrine, compris par d'autres avant lui. Quant aux maladies contagieuses humaines, c'est seulement à partir de 1877 qu'il participera personnellement au développement de leur connaissance., Dès 1873 Gerhard Armauer Hansen,porté par la conclusion de Pasteur dans le débat sur la génération spontanée certes, mais aussi lecteur de Charles Louis Drognat et de Davaine, identifie l'agent causal de la lèpre.Cette découverte ne sera toutefois pas immédiatement unanimement reconnue.
Recherches sur les capacités de saturation de l'acide arsénieux.
Étude des arsénites de potasse, de soude et d'ammoniaque.
2Application de la polarisation rotatoire des liquides à la solution de diverses questions de chimie.
Sa deuxième thèse avait suscité chez Pasteur un grand intérêt pour la polarisation rotatoire découverte par son vieux maître Biot, qu'il rencontrait souvent. Toutes les recherches du jeune docteur se concentrent alors, à partir de 1848, sur les rapports entre la dissymétrie des cristaux ou des molécules et le sens de rotation de la lumière polarisée après traversée soit d'un cristal soit d'une solution optiquement active. Pasteur a décrit lui-même, en termes simples, ses recherches au microscope sur la dissymétrie des cristaux de tartrate :
Je vis que le tartrate de soude et d'ammoniaque portait les petites facettes accusatrices de la dissymétrie ; mais quand je passai à l'examen de la forme des cristaux du paratartrate optiquement inactif, j'eus un instant un serrement de cœur ; tous ces cristaux portaient les facettes de la dissymétrie. L'idée heureuse me vint d'orienter mes cristaux par rapport à un plan perpendiculaire à l'observateur, et alors je vis que, dans cette masse confuse de cristaux de paratartrate, il y en avait de deux sortes sous le rapport de l'orientation des facettes de la dissymétrie. Chez les uns, la facette de dissymétrie la plus rapprochée de mon corps s'inclinait à droite, relativement au plan d'orientation dont je viens de parler, tandis que chez les autres, la facette de dissymétrie s'inclinait à ma gauche. En d'autres termes le paratartrate se présentait comme formé de deux sortes de cristaux, les uns dissymétriques à droite, les autres dissymétriques à gauche...
Les principes de la dissymétrie moléculaire étaient fondés. Il existe des substances dont le groupement atomique est dissymétrique et ce groupement se traduit au dehors par une forme dissymétrique et une action de déviation du plan de la lumière polarisée ; bien plus, ces groupements atomiques ont leurs inverses possibles dont les formes sont identiques à celles de leurs images et qui ont une action inverse sur le plan de la lumière polarisée.
L. Pasteur, Écrits scientifiques et médicaux
Pasteur tenait Biot, devenu presque aveugle, étroitement au courant de ses observations et l'on peut voir, dans le musée de l'Institut Pasteur, à Paris, les blocs de bois taillés pour représenter les cristaux que Pasteur soumettait à l'examen de son vieux maître. La passion de la recherche poussa Pasteur à se procurer, en de nombreux endroits d'Europe à Vienne, Dresde ou Trieste, des cristaux d'acide tartrique sous forme racémique optiquement neutre ou énantiomorphe faisant tourner d'un certain angle le plan d'une lumière polarisée.
Pendant ces années de formation et d'initiation à la recherche fondamentale, Louis Pasteur découvre un lieu magique : le laboratoire. Dans cette pièce réservée aux activités de recherche expérimentale, le chercheur s'isole du monde commun. Pour faire progresser les connaissances, il doit reconstruire ici un monde conventionnel, grandement protégé des aléas climatiques, des accidents imprévus et des rumeurs de la cité. Au laboratoire règnent l'ordre et le silence ; tout est propre ; les produits sont purs ; l'environnement est maîtrisé.
Un des aspects du génie de Pasteur consiste à ne pas avoir limité l'usage du laboratoire aux expériences de physique et de chimie. Depuis ses recherches sur les fermentations, les biologistes aussi y poursuivent leurs travaux. Les microbiologistes y disposent de ballons de verre pour cultiver leurs microbes en conditions contrôlées, de température, lumière et oxygénation, sur des milieux nutritifs de composition connue. Des animaleries permettant d'élever, en conditions également très contrôlées, des chiens, des lapins, des singes, des rats, des chevaux, etc., s'ajouteront par la suite aux laboratoires.
Plaidant pour le financement public de ces lieux de recherches, Pasteur écrira à Napoléon III : Les conceptions les plus hardies, les spéculations les plus légitimes, ne prennent corps et âme que le jour où elles sont consacrées par l'observation et l'expérience. Prenez intérêt, je vous en conjure, à ces demeures sacrées que l'on désigne du nom expressif de laboratoires. Demandez qu'on les multiplie et qu'on les orne : ce sont les temples de l'avenir, de la richesse et du bien-être.
On sait bien qu'à la fin de sa vie, Pasteur profita de sa gloire éclatante pour faire financer, par souscription nationale, la construction à Paris d'un grand Institut d'étude des maladies contagieuses, devenu aujourd'hui l'Institut Pasteur.
Antisepsie et asepsie Antisepsie
Le chirurgien anglais Joseph Lister, après avoir lu les travaux de Pasteur sur la fermentation, où la putréfaction est expliquée, comme la fermentation, par l'action d'organismes vivants, se convainc que l'infection postopératoire, volontiers décrite à l'époque comme une pourriture, une putréfaction est due elle aussi à des organismes microscopiques. Ayant lu ailleurs que l'acide phénique, phénol détruisait les entérozoaires qui infectaient certains bestiaux, il lave les blessures de ses opérés à l'eau phéniquée et leur applique un coton imbibé d'acide phénique. Le résultat est une réduction drastique de l'infection et de la mortalité.
Lister publie sa théorie et sa méthode en 1867, en les rattachant explicitement aux travaux de Pasteur140. Dans une lettre de 1874, il remercie Pasteur pour m'avoir, par vos brillantes recherches, démontré la vérité de la théorie des germes de putréfaction, et m'avoir ainsi donné le seul principe qui ait pu mener à bonne fin le système antiseptique.
L'antisepsie listérienne, dont l'efficacité triomphera en quelques années des résistances, est, au point de vue théorique, une branche importante de la théorie microbienne. Sur le plan pratique, toutefois, elle n'est pas entièrement satisfaisante : Lister, qui n'a pensé qu'aux germes présents dans l'air, et non à ceux que propagent l'eau, les mains des opérateurs ainsi que les instruments et les tissus qu'ils emploient, attaque les microbes dans le champ opératoire, en vaporisant de l'acide phénique dans l'air et en en appliquant sur les plaies. C'est assez peu efficace quand il faut opérer en profondeur et, de plus, l'acide phénique a un effet caustique sur l'opérateur et sur le patient. On cherche donc bientôt à prévenir l'infection, asepsie plutôt qu'à la combattre, antisepsie.
Asepsie
Pasteur est de ceux qui cherchent à dépasser l'antisepsie par l'asepsie. À la séance du 30 avril 1878 de l'Académie de médecine, il attire l'attention sur les germes propagés par l'eau, l'éponge ou la charpie avec lesquelles les chirurgiens lavent ou recouvrent les plaies et leur recommande de ne se servir que d'instruments d'une propreté parfaite, de se nettoyer les mains puis de les soumettre à un flambage rapide et de n'employer que de la charpie, des bandelettes, des éponges et de l'eau préalablement exposées à diverses températures qu'il précise. Les germes en suspension dans l'air autour du lit du malade étant beaucoup moins nombreux que dans l'eau et à la surface des objets, ces précautions permettraient d'utiliser un acide phénique assez dilué pour ne pas être caustique.
Certes, ces recommandations n'étaient pas d'une nouveauté absolue : Semmelweis et d'autres avant lui par exemple Claude Pouteau et Jacques Mathieu Delpech avaient déjà compris que les auteurs des actes médicaux pouvaient eux-mêmes transmettre l'infection, et ils avaient fait des recommandations en conséquence, mais les progrès de la théorie microbienne avaient tellement changé les données que les conseils de Pasteur reçurent beaucoup plus d'audience que ceux de ses prédécesseurs.
En préconisant ainsi l'asepsie, Pasteur traçait une voie qui serait suivie non sans résistances du corps médical par Octave Terrillon 1883, Ernst von Bergmann et William Halsted.
Lutte contre les maladies des vers à soie
Hommage aux travaux de Pasteur sur le ver à soie à Alès
En 1865, Jean-Baptiste Dumas, sénateur et ancien ministre de l'Agriculture et du commerce, demande à Pasteur d'étudier une nouvelle maladie qui décime les élevages de vers à soie du sud de la France et de l'Europe, la pébrine, caractérisée à l'échelle macroscopique par des taches noires et à l'échelle microscopique par les corpuscules de Cornalia . Pasteur accepte et fera cinq longs séjours à Alès, entre le 7 juin 1865 et 1869.
Erreurs initiales
Arrivé à Alès, Pasteur se familiarise avec la pébrine et aussi avec une autre maladie du ver à soie, connue plus anciennement que la pébrine : la flacherie ou maladie des morts-flats. Contrairement, par exemple, à Quatrefages, qui avait forgé le mot nouveau pébrine, Pasteur commet l'erreur de croire que les deux maladies n'en font qu'une et même que la plupart des maladies des vers à soie connues jusque-là sont identiques entre elles et à la pébrine. C'est dans des lettres du 30 avril et du 21 mai 1867 à Dumas qu'il fait pour la première fois la distinction entre la pébrine et la flacherie.
Il commet une autre erreur : il commence par nier le caractère parasitaire, microbien de la pébrine, que plusieurs savants notamment Antoine Béchamp considéraient comme bien établi. Même une note publiée le 27 août 1866155 par Balbiani, que Pasteur semble d'abord accueillir favorablement, reste sans effet, du moins immédiat. Pasteur se trompe. Il ne changera d'opinion que dans le courant de 1867.
Victoire sur la pébrine
Alors que Pasteur n'a pas encore compris la cause de la maladie, il propage un procédé efficace pour enrayer les infections : on choisit un échantillonnage de chrysalides, on les broie et on recherche les corpuscules dans le broyat; si la proportion de chrysalides corpusculeuses dans l'échantillonnage est très faible, on considère que la chambrée est bonne pour la reproduction. Cette méthode de tri des graines œufs est proche d'une méthode qu'avait proposée Osimo quelques années auparavant, mais dont les essais n'avaient pas été concluants. Par ce procédé, Pasteur jugule la pébrine et sauve pour beaucoup l'industrie de la soie dans les Cévennes.
La flacherie résiste
En 1884, Balbiani, qui faisait peu de cas de la valeur théorique des travaux de Pasteur sur les maladies des vers à soie, reconnaissait que son procédé pratique avait remédié aux ravages de la pébrine, mais ajoutait que ce résultat tendait à être contrebalancé par le développement de la flacherie, moins bien connue et plus difficile à prévenir. En 1886, la Société des agriculteurs de France émettait le vœu que le gouvernement examine s’il n'y avait pas lieu de procéder à de nouvelles études scientifiques et pratiques sur le caractère épidémique des maladies des vers à soie et sur les moyens de combattre cette influence. Decourt, qui cite ce vœu, donne des chiffres dont il conclut qu'après les travaux de Pasteur, la production des vers à soie resta toujours très inférieure à ce qu'elle avait été avant l'apparition de la pébrine et conteste dès lors à Pasteur le titre de sauveur de la sériciculture française .
Microbes et vaccins
À partir de 1876, Pasteur travaille successivement sur le filtre et l'autoclave, tous deux mis au point par Charles Chamberland 1851-1908, et aussi sur le flambage des vases.
Bien que ses travaux sur les fermentations, comme on l'a vu, aient stimulé le développement de la théorie microbienne des maladies contagieuses, et bien que, dans l'étude des maladies des vers à soie, il ait fini par se ranger à l'opinion de ceux qui considéraient la pébrine comme parasitaire, Pasteur, à la fin de 1876, année où l'Allemand Robert Koch a fait progresser la connaissance de la bactérie du charbon, est encore indécis sur l'origine des maladies contagieuses humaines : "Sans avoir de parti pris dans ce difficile sujet, j'incline par la nature de mes études antérieures du côté de ceux qui prétendent que les maladies contagieuses ne sont jamais spontanées ... Je vois avec satisfaction les médecins anglais qui ont étudié la fièvre typhoïde avec le plus de vigueur et de rigueur repousser d'une manière absolue la spontanéité de cette terrible maladie." Mais il devient bientôt un des partisans les plus actifs et les plus en vue de la théorie microbienne des maladies contagieuses, domaine où son plus grand rival est Robert Koch. En 1877, Pasteur découvre le vibrion septique, qui provoque un type de septicémie et avait obscurci l'étiologie du charbon; ce microbe sera nommé plus tard Clostridium septicum. En 1880, il découvre le staphylocoque, qu'il identifie comme responsable des furoncles et de l'ostéomyélite. Son combat en faveur de la théorie microbienne ne l'empêche d'ailleurs pas de reconnaître l'importance du terrain, importance illustrée par l'immunisation vaccinale, à laquelle il va consacrer la dernière partie de sa carrière.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=6812#forumpost6812
Posté le : 27/09/2014 17:28
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
126 Personne(s) en ligne ( 76 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 126
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages