|
|
Re: Les bons mots de Grenouille |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
22/01/2012 16:15
De Alsace
Niveau : 16; EXP : 64
HP : 0 / 391
MP : 105 / 14214
|
De l'humour sarcastique, ironique ou grinçant, il est des moments où il faut savoir rire de tout ... PAYER NOS IMPOTS AVEC HUMOUR :
===============================
Quelques citations pour faire passer la pilule au moment des prélèvements …
«[ [b] Rien ne fait plus mal que de devoir payer l'impôt sur le revenu, à part ne pas avoir à payer l'impôt sur le revenu. »
de Thomas Robert Dewar

« Je te prie d'agréer, Mon Trésor, l'expression de mes sentiments distingués. »
de Pierre Desproges
« Les fonctionnaires du fisc sont des personnes qui croient précisément le double de ce qu'on leur dit. »
de Ugo Tognazzi
« Le jour est proche où nous n'aurons plus que l'impôt sur les os. »
de Michel Audiard
« La réforme fiscale, c'est quand vous promettez de réduire les impôts sur les choses qui étaient taxées depuis longtemps et que vous en créez de nouveaux sur celles qui ne l'étaient pas encore. »
de Edgar Faure
« Si Dieu était élu démocratiquement par tous les fidèles, si sesrevenus étaient soumis à l'impôt et s'il était tenu de prendre saretraite à soixante cinq ans… Je deviendrais peut-être croyant. »
de Philippe Geluck

« Le bavardage ne paie pas d’impôt. »
de Proverbe anglais
« On fait les cadeaux avant les élections et on décide les impôts tout de suite après. »
de Jacques Chirac
« Payez moins d’impôts ! Enlevez un zéro. »
de François Cavanna
« J'ai gardé des preuves pour montrer que j'ai toujours payé mes impôts : regardez, j'ai gardé les chèques ! »
de Laurent Ruquier
« J'ai déjà essayé de payer mes impôts avec le sourire, ils préfèrent un chèque. »
de Jean Yanne
L'Impôt est un luxe que je ne peux plus me permettre...
Un grand économiste, c’est quelqu’un qui saura très bien expliquer demain pourquoi ce qu’il a prévu hier ne s’est pas produit aujourd’hui.
Jacques Attali
Si pour gagner deux fois plus, il faut travailler deux fois plus, je ne vois pas où est le bénéfice.
Raymond Castans
Il faut mépriser l’argent, surtout la petite monnaie.
François Cavanna
Banquier : Homme secourable qui vous prête un parapluie quand il fait beau, et qui vous le réclame dès qu’il commence à pleuvoir
René Bergeron,
« Un moyen de réduire les impôts serait d’organiser une élection chaque année, car il semble que l’année des élections il n’y ait jamais d’augmentation d’impôts. »
de Anonyme
« Il y a deux choses inadmissibles sur la terre : la mort - et les impôts. Mais j'aurais dû citer en premier les impôts. »
de Sacha Guitry
Un contribuable, c'est quelqu'un qui travaille pour l'État, mais qui n'a jamais eu besoin de passer un concours.
Ronald Reagan
Les conneries c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer.
Michel Audiard
Puisque l'impôt a une assiette, pourquoi mange-t-il toujours dans la nôtre ?
Pierre Véron
La France est un pays extrêmement fertile : on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts.
Clemenceau
Les impôts ont été inventés pour que tout le monde n'ait pas envie de réussir.
Philippe Bouvard
Mon percepteur des contributions m'abandonne généreusement une partie de ce que je gagne.
Hergé
La seule différence entre la taxation et la taxidermie est qu'avec la taxidermie on sauve sa peau.
Mark Twain
La fiscalité, c’est le vol et le brigandage par lesquels une partie de la population, à savoir la classe dirigeante, s’enrichit au détriment du reste de la population, à savoir les gouvernés.
Hans-Hermann Hoppe
L'impôt est tenu comme mieux réparti quand il est payé par les autres.
Alain Dumait
« L'argent n'a de valeur que quand il sort de votre poche. Il n'en a pas quand il y rentre. »
— Sacha Guitry
Le fraudeur fiscal est un contribuable qui s'obstine à vouloir garder un peu d'argent pour son propre usage.
Philippe Bouvard
C'est au moment de payer ses impôts qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas les moyens de s'offrir l'argent que l'on gagne.
Frederic Dard
Source : Les pensées de San-Antonio
Chaque fois que mon percepteur revenait, je payais un impôt sur le revenu.
Raymond Devos (Humoriste français)
Deux milliards d'impôts ! J'appelle plus ça du budget, j'appelle ça de l'attaque à main armée !
Michel Audiard
Source : Le film "La chasse à l'homme"
En trayant sans cesse la vache à lait, on tue la poule aux oeufs d'or.
Henri Jeanson
Rien ne rapproche plus une femme et son mari que l'arrivée de la feuille d'impôts.
Gil Stern
L'idéal, ce serait de pouvoir déduire ses impôts de ses impôts.
Jean Yanne[ Quels sont les différents impôts perçus par l’État ?
Dans la loi de finances initiale (LFI) de 2013, les recettes fiscales nettes, c’est-à-dire après les dégrèvements et remboursements d’impôts, du budget général de l’État, s’élèvent à 298,6 milliards d’euros (Mds€) (soit 95,5% des recettes nettes de l’État). Elles se répartissent comme suit :
- Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : 141,2 Mds€, soit près de la moitié des recettes fiscales nettes (47,28%) ;
- Impôt sur le revenu (IR) : 71,9 Mds€ (24,07%) ;
- Impôt sur les sociétés (IS) : 53,5 Mds€ (17,91%) ;
- Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) : 13,7 Mds€ (4,58%) ;
autres : 18,3 Mds€ (6,12%).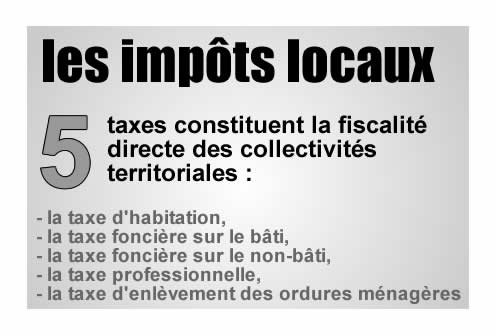 LA PLUS ANCIENNE ENTREPRISE DU MONDE : LA PLUS ANCIENNE ENTREPRISE DU MONDE :
( ne vous méprenez pas …)Hoshi Ryokan ou Hoshi ( 法師?) est un ryokan, une auberge traditionnelle japonaise, créée en 717 dans la ville de Komatsu, actuelle préfecture d'Ishikawa, sur l'île de Honshu.
Elle fut toujours une entreprise familiale. Aujourd'hui (mai 2014), elle en est à sa 46e génération et a 1296 ans d'exploitation continue. Elle est considérée comme l'entreprise la plus ancienne au monde1 depuis le dépôt de bilan de Kongō Gumi, une entreprise de construction japonaise en 2006. ET LES PLUS ANCIENNES DE FRANCE :Date de création : 1800
Garlock, après le train à vapeur, les centrales nucléaires
Nous faisons de l'étanchéité pour fluides à usage industriel". A écouter François Luneau, directeur commercial de Garlock France, on ne croirait pas que les joints de sa société équipent autant les moteurs de la fusée Ariane que les réacteurs des centrales nucléaires d'Areva, sans oublier les infrastructures de Total et autres EDF. Depuis sa création en 1800, ce qui en fait la plus ancienne des sociétés françaises de plus de 200 salariés, Garlock France, qui s'appelait à l'époque Vital-Fargère, a toujours travaillé avec les industries de pointe de son époque. Ce fut d'abord les machines à vapeur des trains puis le nucléaire. Dès le lancement du programme français dans les années 70, Garlock est le partenaire attitré du gouvernement. D'abord pour les cuves puis pour les dechets. Sur ce marché de la très haute étanchéité, "Garlock réalise 40% de son chiffre d'affaires à l'export", précise François Luneau. Une proportion en très forte croissance ces dernières années grâce au dynamisme du nucléaire, du gaz liquéfié et bien sûr du pétrole. En 2006, son chiffre d'affaires a augmenté de 10% à 36 millions d'euros grâce à l'international.
Effectifs : 280 salariés
--------------- Date de création : 1803Arthus-Bertrand, créé en même temps que la légion d'honneurSans la légion d'honneur, Arthus-Bertrand n'existerait probablement pas. La société parisienne ne fabriquerait aujourd'hui ni médailles et décorations, ni bijoux en or et argent, ni ne réaliserait des commandes aussi spéciales que des épées d'académiciens. C'est grâce à la plus haute distinction française, apparue en France en 1803, qu'Arthus-Bertrand s'est créée la même année. Jusqu'à la seconde guerre mondiale, les médailles, dont les très nombreuses médailles du travail, et décorations resteront son unique métier. Après le conflit, le père et le grand père de l'actuel PDG Nicolas Arthus-Bertrand se lanceront progressivement dans le monde de la bijouterie. Cette seconde activité, avec aujourd'hui 400 points de vente en France et bientôt trois magasins en propre à Paris et à Lille, représente le tiers de son activité, à égalité avec les médailles et décoration. La troisième activité, la création d'objets promotionnels, est apparue en 1983 quand Nicolas Arthus-Bertrand, après 25 ans passés dans la publicité, intègre l'entreprise et lance pour la première fois en France le pin's, à l'occasion d'un Roland Garros. Le succès phénoménal de ces petits bouts de métal -"Je ne pouvais plus aller nulle part sans que l'on m'en demande", raconte Nicolas Arthus-Bertrand- a permis à l'entreprise d'investir fortement. Enfin, il y un an et demi, la société s'est lancée dans la médaille souvenir, "une activité au potentiel de développement très important", explique Nicolas Arthus-Bertrand
Effectifs : 280 salariés--------------- [ ]Date de création : 1820Potel & Chabot, petites et grandes réceptions haut de gamme
Depuis 1820, Potel & Chabot organise petites et grandes réceptions haut de gamme pour particuliers et sociétés. Quelles sociétés ? "Presque toutes", répond l'entreprise parisienne. Bien sûr, elle ne parle que des plus grandes. Potel & Chabot ne fait que du sur-mesure. Elle peut se charger de fournir le lieu : elle gère cinq pavillons prestigieux. Elle peut proposer sa propre ligne de vaisselle : elle a ses propres ateliers de porcelaine et renouvelle chaque année une partie de sa gamme. Elle peut aussi concevoir la décoration florale ou même des sculptures de verre grâce à d'autres ateliers intégrés. Surtout, "Potel & Chabot travaille partout dans le monde, nous allons là où le client le souhaite", précise-t-elle. Depuis 1988, une filiale est installée en Russie. Une autre a suivi deux ans plus tard à New York
Effectifs : 400 salariés (1.200 en période de pointe)
--------------- BACCARAT, CRISTALLERIE AUTORISEE PAR LOUIS XV
DATE DE CRETATION : 1823
EFFECTIFS / 1.130 salariés - 800 en France
MARNIER-LAPOSTOLLE : SPIRITUEUX DONT LE GRAND MARNIER REPUTE DANS LE MONDE ENTIER
DATE DE CREATION : 1827
EFFECTIFS : 430 salariés.
BUREAU VERITAS : CONTRÔLE ET VERIFICATION
DATE DE CREATION : 18238
EFFECTIFS : 26.000 COLLABORATEURS
THELEM ASSURANCES
DATE DE CREATION: 1820
EFFECTIFS : 363 SALARIES
LAFARGE MATERIAUX DE CONSTRUCTION
DATE DE CREATION :1833
EFFECTIFS : 71.000 COLLABORATEURS
LES PEPEINIERES MINIER : HORTICULTURE
DATE DE CREATION 1833
EFFECTIFS :350 SALARIES
HERMES : MAROQUINERIE DE LUXE
DATE DE CREATION: 1831
EFFECTIFS: 6.150 SALARIES
------------ Les abus fiscaux ont suscité jadis maintes épigrammes. En voici une dans laquelle un vieux poète du temps d'Henri IV imagine un dialogue entre le roi et son ministre des finances, à propos des impôts :- Dans le besoin pressant qui vous menace,
Sire, il faudrait recourir aux impôts.
- Ah ! des impôts, laissons cela, de grâce,
Mon pauvre peuple a besoin de repos.
Le voulez-vous sucer jusqu'à la moelle ?
Je prétends, moi, qu'il n'en soit pas ainsi.
- Sire, songez quel est en tout ceci
Mon embarras ; songez que de la poêle
Qui tient la queue est le plus mal loti.
- Qui dit cela ? - Qui ? le proverbe, Sire.
- Ventre-Saint-Gris, le proverbe a menti,
Car, de par Dieu, c'est celui qu'on fait frire.
De tous les contrôleurs généraux des finances, le plus vilipendé par l'opinion fut, au XVIIIe siècle, l'abbé Terray. En ce temps-là, les hommes portaient manchon en hiver. A l'inauguration de l'hôtel des Monnaies, en 1775, Ferray arriva, portant, suspendu à son cou, un ample manchon de fourrure.
- Qu'a-t-il besoin d'un manchon ? s'écria la spirituelle Sophie Arnould, il a toujours les mains dans nos poches.
C'est pour Ferray qu'on fit cette épitaphe :
Ci-gît le père des impôts.
Dont chacun à l'âme ravie.
Que Dieu lui donne le repos
Qu'il nous ôta pendant sa vie !
Épigramme à propos de l'augmentation des impôts sous le ministère de Calonne :
Calonne fait la chattemite
Et nous promet la poule au pot
Mais il demande double impôt.
Or, comment profiter d'un présent hypocrite,
Quand chacun, pour payer, a vendu sa marmite ?
Des vers d'Ernest Legouvé :
L'impôt ressemble fort au chiendent. Dans un pot,
En plein champ, au soleil, au froid, à la rafale,
Il prospère partout, grandit partout, s'étale
En toute climature ... Un ennemi survient ?
L'impôt monte ! ... De nous la peste se souvient ?
L'impôt monte ! ... L'on part un jour pour la croisade ?
L'impôt ! ... On en revient ? Impôt ! ... Le temps malade
Fait tout sécher ? Impôt ! ... Fait tout moisir ? Impôt ! ...
Guerre, inondation, grand trouble, grand repos ?
Impôts ! Impôts ! Impôts ! ... Et le beau, dans l'espèce,
C'est qu'une fois monté jamais l'impôt ne baisse !
Autre épitaphe d'un contrôleur des finances, M. de Silhouette, qui avait exprimé le désir de ne pas mourir avant d'avoir éteint la dette nationale :Ci-gît un contrôleur digne qu'on le citât,
Aimant beaucoup la France et plus encor la vie,
Souhaitant seulement qu'elle lui fût ravie
Quand il aurait payé les dettes de l'État.
LES IMPOTS AU MOYEN - AGE:
==========================Les paysans payent beaucoup d’impôts au Moyen-Age.
il existe plusieurs catégories de paysans :
- Les serfs
- les alleutiers
- les vilains
Les paysans propriétaires de leurs terres et qui ne dépendent pas d’un seigneur s’appelle les alleutiers.
Ils sont peu nombreux.
Les serfs sont des paysans qui appartiennent corps et âme au seigneur qui peut les vendre ou les donner à un autre seigneur.
Ils doivent payer au seigneur le chevage, c’est une taxe qui leur est propre, seuls les serfs doivent la payer.
Ils payent aussi la mainmorte pour hériter de leurs parents et le formatage pour pouvoir se marier à l’extérieur de la seigneurie,
A partir du XI-XII°s, il y a de moins en moins de serfs car les seigneurs leurs donnent la liberté contre une somme d’argent.
Ils deviennent des vilains.
Les vilains :
Ils dépendent d’un seigneur , sont libres mais payent beaucoup d’impôts au seigneur.
Les tenures sont les terres accordées aux paysans par le seigneur. En échange de ces terres, les paysans doivent faire des corvées et payer le cens.
La corvée est un travail qui n’est pas payé par le seigneur. Les paysans travaillent alors sur les terres de la réserve qui sont réservées au seigneur. Ils travaillent sans être payés : par exemple, ils moissonnent les terres du seigneur gratuitement. Ils peuvent travailler jusqu’à 57 jours par an.
Les paysans doivent aussi payer le cens. Le cens est une taxe en argent versée par les paysans au seigneur pour pouvoir cultiver les tenures.
Ils doivent aussi payer des droits seigneuriaux pour être protégés par le seigneur.
Ils doivent enfin payer des banalités pour utiliser le four (qui sert à cuire le pain), le moulin (qui sert à écraser le blé pour la farine) et le pressoir (qui sert à écraser le raisin pour le vin) ; ce sont des outils qui appartiennent au seigneur.
Ils versent aussi un dixième de leur récolte à l’Eglise : c’est la dîme.
DE TOUT……UN PEU ….
======================
- Le tabou donne toujours naissance à des jumeaux
- La peau de l’ours blanc est noir
- La girafe est le selle mammifère qui naît avec deux cornes
- Les rats sont incapables de vomir
- L’ours koala a des empreintes digitales qi présentes de grandes similarités avec celles des humains
- La langue d’un caméléon fait presque deux fois la longueur de son corps
- Un nouveau né kangourou mesure environ 2.54 cm. de longueur
- Les chiens et es humains sont les seuls a avoir une glande de la prostate
- Les femelles des marsupiaux ont deux ovaires, deux trompes de Fallope et deux utérus qui s’ouvrants sur deux vagins séparés.LE DICTIONNAIRE DU DIABLE :
=========================
ANNEE : Période de trois cent soixante-cinq déceptions
ANTIPATHIE: Sentiment inspiré par l’ami d’un ami
BONHEUR : Sensation agréable qu’éveille la contemplation des misères d’autrui
GLOUTON: Personne qui échappe aux maux de modération en s’adonnant à la dyspepsie
PROJETER : Se soucier de la meilleure méthode à employer pour parvenir à un résultat accidentel
RESPECTABILITE : Fruit d’une liaison entre une calvitie et un compte en banque
SEUL : En mauvaise compagnie
DOUBLE VISION:
==============
 LA PHOTO : LA PHOTO :
========== bonne semaine bonne semaine
Grenouille
Posté le : 05/10/2014 07:28
Edité par Grenouille sur 05-10-2014 22:05:56
Edité par Grenouille sur 07-10-2014 14:42:10
Edité par Grenouille sur 08-10-2014 09:36:16
|
|
|
|
|
Jacques Offenbach |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 5 octobre 1880, à 61 ans, meurt à Paris Jacques Jacob Offenbach
surnommé, Le Petit Mozart des Champs-Élysées, compositeur et violoncelliste de musique classique et opérette, opéra-bouffe, français d'origine allemande, né à Cologne en Allemagne le 20 Juin 1819. Il est Directeur de la musique à la Comédie-Française, directeur de théâtre à Paris, Vienne et Baden-Baden de 1838 à 1880, il Collabore avec Ludovic Halévy, Henri Meilhac, il est édité par Brandus, Heugel et Choudens, il reçoit sa formation au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, il a pour élèves Léo Delibes. Ses Œuvres principales sont Orphée aux Enfers, La Belle Hélène, La Vie parisienne, La Grande-duchesse de Gérolstein, La Périchole, La Fille du tambour-major , Les Contes d'Hoffmann, il se produit seu les scènes du Théâtre des Bouffes-Parisiens il est directeur, du Théâtre de la Gaîté directeur, Théâtre des Variétés, Théâtre du Palais-Royal
En bref
Le père de l'opérette
Le nom d'Offenbach est indissociable de la forme musicale de l'opérette. Même s'il s'agit d'un genre dont il s'est progressivement détaché et qui n'est pas associé à ses plus grands succès, il en reste le créateur. Doué d'une étonnante invention mélodique, il sait rire et faire rire en musique car il observe et élabore, aidé de ses librettistes, des caricatures parfaites. Sa musique est divertissante mais elle réclame de ses interprètes une grande attention, car elle est difficile à restituer dans son authenticité. Pendant trop longtemps, elle fut l'apanage de « spécialistes » qui, vivant de traditions, portent de lourdes responsabilités dans la désaffection du public pour ce qui devenait un genre mineur et vieillissant.
À l'occasion du centenaire de la mort d'Offenbach, un nouveau courant s'est cependant dessiné, qui a remis en cause les traditions désuètes et les mutilations subies par ses ouvrages : la vieille passion du public français revit depuis lors.
Dans l'histoire de la musique, Offenbach est un cas. Né pour divertir, il adapte les formes de la musique à ses objectifs. Après quelques essais baptisés vaudeville, pantomime, anthropophagie ou bouffonnerie musicale, le mot opérette apparaît en 1855, pour qualifier une forme lyrique dérivée de l'opéra, courte, gaie et entrecoupée de dialogues. C'est l'époque de la création des Bouffes-Parisiens : elle voit la naissance d'une vingtaine de pièces en un acte, d'essence satirique, mettant en scène des personnages de la vie courante, sans trop s'attaquer aux grands de ce monde. Mais Offenbach voit plus loin et la forme évolue pour devenir le digne successeur de l'opera-buffa italien. L' opéra-bouffe est plus ambitieux que l'opérette : il comporte des intrigues plus consistantes, une satire des valeurs établies le bel canto, l'opéra historique, plus tard la cour et, très vite, l'acte unique et les quatre personnages sont abandonnés.
Dès 1856, Le Savetier et le financier porte ce nouveau qualificatif ; cette œuvre sera suivie d'une demi-douzaine d'ouvrages annonçant Orphée aux enfers 1858, opéra-bouffon, et Le Pont des soupirs 1861, premier opéra-bouffe de grande dimension. Le vocable est adopté ; l'opérette ne désignera plus – à deux exceptions près : La Jolie Parfumeuse 1873 et La Boîte au lait 1876 – que des pièces en un acte.
Parallèlement, le style évolue : Orphée marque le début d'une période dominée par une invraisemblance outrancière des personnages : la société du second Empire est déjà visée sous les traits d'une Antiquité caricaturale. À la verve comique s'ajoute l'entrain du cancan, qui a fait son apparition dans Croquefer et deviendra le symbole du divertissement parisien. Ce sont les débuts de la collaboration avec Halévy, qui formera dès 1863 un tandem fameux avec Meilhac, réalisant les meilleurs livrets d'Offenbach La Belle Hélène, Barbe-Bleue, La Vie parisienne, La Grande-Duchesse de Gerolstein, La Périchole, Les Brigands. Car on ne saurait dissocier le musicien de ses librettistes : les échecs qu'a connus Offenbach sont souvent imputables à des textes médiocres.
L'apogée de la carrière du musicien se situe à la fin du second Empire 1866-1870, lorsqu'il donne coup sur coup ses plus grands succès, composés sur mesure pour Hortense Schneider, actrice et chanteuse au timbre sombre dont les rôles restent toujours difficiles à attribuer, car ils réclament une forte présence scénique, une voix pas trop lourde et une tessiture, à la limite du mezzo-soprano, que possèdent peu de cantatrices. Les ouvrages de cette époque ne s'embarrassent pas de formes inutiles pour railler : chacun se reconnaît dans La Vie parisienne et la censure croit découvrir Catherine de Russie sous les traits de la Grande-Duchesse. Mais Offenbach est l'homme d'une époque. Après 1870, il ne retrouvera jamais sa verve satirique. Paradoxalement, il réussira là où il avait toujours échoué, dans le genre sérieux, avec Les Contes d'Hoffmann. Sur un livret de Jules Barbier, il reprend une idée vieille de plus de vingt-cinq ans et réalise un opéra fantastique. Le rire est toujours là, bien qu'à présent sarcastique. Le cynisme sous-jacent de la satire du second Empire est devenu grinçant. Offenbach est peut-être un peu aigri d'avoir été oublié ; mais la vie qu'incarne la mélodie demeure, symbole de celui que Rossini appelait le petit Mozart des Champs-Élysées.
Sa vie
De son vrai nom Jakob Eberst, Jacob Offenbach naît à Cologne en Allemagne, où son père, Isaac Judas Eberst 1779-1850, est cantor de la synagogue. Originaire d'Offenbach-sur-le-Main près de Francfort-sur-le-Main, Isaac adopte le patronyme d'Offenbach vers 1810, en vertu du décret napoléonien du 28 juillet 1808.Son père est un cantor de la synagogue. Il lui enseigne des rudiments de violon.Mais Jakob se tourne vers le violoncelle, qu'il vient étudier à Paris
Le jeune Jacob révèle très jeune ses dons pour le violoncelle, ce qui conduit son père à lui faire poursuivre ses études musicales à Paris dès 1833, seule ville dans laquelle un artiste juif peut faire carrière à cette époque. Offenbach est admis à titre dérogatoire au Conservatoire de Paris dans la classe de violoncelle d'Olivier-Charlier Vaslin. Indiscipliné, il quitte l'établissement au bout d'un an pour rejoindre l'orchestre de l'Ambigu-Comique puis de l'Opéra-Comique. Ayant francisé son prénom en Jacques, il mène parallèlement une carrière de soliste virtuose. En 1847, il devient directeur musical de la Comédie-Française, grâce à la notoriété acquise par ses mélodies. Il crée son propre théâtre en 1855, les Bouffes-Parisiens, alors situé sur les Champs-Élysées, afin qu'y soient exécutées ses propres œuvres. Il travaille entre autres avec les librettistes Henri Meilhac et Ludovic Halévy et y engage ses interprètes fétiches Hortense Schneider et Jean Berthelier.
Émule de Rossini et de Mozart, il est le créateur de l'opéra-bouffe français, que l'on confondit par la suite avec l'opérette, genre dans lequel il excelle également mais dont on doit la paternité à son rival – et néanmoins ami – le compositeur-interprète Hervé. Parmi la centaine d'œuvres qu'il compose en 40 ans d'activité, plusieurs sont devenues des classiques du répertoire lyrique, d’Orphée aux Enfers en 1858, son premier grand succès grâce notamment à son galop infernal, aux Contes d'Hoffmann, en passant par La Grande-duchesse de Gérolstein, La Belle Hélène, La Vie parisienne ou Les Brigands et le fameux bruit de bottes des carabiniers qui arrivent toujours trop tard. Son succès populaire est l'objet de nombreuses jalousies et critiques, Théophile Gautier propageant son image de jettatore, jeteur de sorts qu'il avait lui-même créée. "Je vis qu'il y avait quelque chose à faire pour les jeunes musiciens qui, comme moi, se morfondaient à la porte du théâtre lyrique. "
Des Bouffes-Parisiens à l'Opéra-Comique
L'occasion se présente en 1855 lors de l'Exposition universelle : Offenbach obtient, sur les Champs-Élysées, à côté du palais de l'Industrie, la concession d'un petit théâtre, qu'il baptise Bouffes-Parisiens. D'emblée, la bouffonnerie du compositeur enivre un public affamé de plaisir. Au mois de décembre, les Bouffes s'installent dans le théâtre du passage Choiseul. Une autorisation ministérielle permet à Offenbach de diriger les nouveaux Bouffes-Parisiens pendant cinq ans. Ses pièces ne doivent compter qu'un acte et quatre personnages au maximum. Il présente Der Schauspieldirektor de Mozart et organise un concours d'opérette remporté ex aequo par Georges Bizet et Charles Lecocq, tous deux auteurs d'un Docteur Miracle.
Mais les contraintes de la censure l'étouffent. Croquefer 1857 lui permet de tourner la difficulté en faisant intervenir un cinquième personnage, muet, qui s'exprime en brandissant des pancartes ! Rapidement, Offenbach se voit délivré de cette réglementation absurde et vole vers des ouvrages à grand spectacle. Le succès d'Orphée aux enfers 1858 arrive à point nommé pour l'arracher à des créanciers embarrassants, car sa gestion est assez catastrophique. Son vieux rêve resurgit alors ; il sollicite à nouveau les directeurs des théâtres impériaux et, cette fois, obtient satisfaction : en 1860, l'Opéra présente son ballet Le Papillon, que danse Emma Livry, et l'Opéra-Comique monte Barkouf ; deux échecs qui ne le guérissent pas. En 1864, à l'Opéra de Vienne, il donne Die Rheinnixen, opéra romantique en trois actes (où figure le thème qui deviendra celui de la barcarolle des Contes d'Hoffmann, et, à nouveau, s'égare hors de son domaine...
La Belle Hélène 1864 le ramène à la réalité : il continue d'exploiter la veine mythologique et construit un rôle sur mesure pour Hortense Schneider. Cette grande actrice, qu'il a engagée pour la première fois en 1855 dans Le Violoneux, devient sa tête d'affiche : La Vie parisienne 1866, La Grande-Duchesse de Gerolstein donnée en 1867, à l'occasion de l'Exposition universelle et La Périchole 1868 sont écrites pour elle. Cette époque est particulièrement faste pour Offenbach, qui a trouvé en Henri Meilhac et Ludovic Halévy des librettistes complices. Deux nouvelles tentatives à l'Opéra-Comique – Robinson Crusoé 1867 et Vert-Vert 1869 – précèdent Les Brigands 1869, où les bottes des carabiniers annoncent l'arrivée des Prussiens. Cette période est difficile pour Offenbach, attaqué de tous côtés : bien qu'il soit naturalisé français depuis 1860, les Français l'accusent d'être prussien de cœur et d'avoir composé des hymnes patriotiques pour l'empire allemand en 1848, et les Allemands trouvent dans son œuvre des attaques contre son pays natal !
[size=SIZE]La chute du second empire
[/size]
La chute du second Empire est un peu celle d'Offenbach. Les mentalités changent. Le plaisir et la frivolité cèdent le pas à un nouvel ordre moral qui veut effacer les souvenirs ; la popularité d'Offenbach décline ; pour la IIIe République, il est devenu le grand corrupteur. Il va d'échec en échec. Il remanie ses grands succès d'autrefois pour en faire des productions grandioses et faire rêver le public. En 1873, il prend ainsi la direction du Théâtre de la Gaîté ; mais sa gestion est toujours aussi déficiente et, deux ans plus tard, c'est la faillite. En 1876, il entreprend aux États-Unis une tournée, triomphale, qui assainit sa situation financière. L'Exposition universelle de 1877 est l'occasion d'un sursaut, mais son projet de pièce féerique ne voit même pas le jour. Son centième ouvrage, La Fille du tambour-major 1879, lui permet de renouer avec le succès. Il est bien davantage occupé, cependant, par Les Contes d'Hoffmann, que Carvalho s'engage à monter à l'Opéra-Comique ; mais la mort l'empêchera de mener à terme son premier ouvrage sérieux et d'importance, Ernest Guiraud en complétera l'orchestration et les récitatifs, qui deviendra l'une des pièces maîtresses du répertoire lyrique français.
La guerre franco-prussienne de 1870 met brutalement fin à cette fête impériale dont Offenbach est devenu en quinze ans l'une des figures emblématiques. Cible d'attaques virulentes des deux côtés du Rhin en raison de son origine germanique les uns l'accusant d'être un traître, les autres un espion, il quitte Paris quelques jours avant que l'armée prussienne n'en débute le siège 19 septembre 1870. Durant l'année qui suit, on le retrouve à Bordeaux, Milan, Vienne, Saint-Sébastien5.
Il est de retour à Paris en mai 1871, mais l'heure n'est plus à l'humour bouffon et son Boule-de-neige, créé aux Bouffes-Parisiens (d'après Barkouf, en fait les frais tout comme son opéra-comique Fantasio, d'après la pièce homonyme de Musset. Il lance alors vers un nouveau genre : l'opéra-bouffe-féerie : Le Roi Carotte sur un livret de Victorien Sardou attire à nouveau les foules au théâtre de la Gaîté, dont Offenbach prend la direction en juin 1873. Ses capacités de gestionnaire sont néanmoins inversement proportionnelles à ses qualités artistiques : le coût exorbitant des productions (par exemple le canon géant dans Le Voyage dans la Lune ou les costumes de La Haine le conduit à la faillite en 1875. Il règle ses dettes grâce à sa fortune personnelle et une tournée de concerts aux États-Unis en 1876.
Toujours à l'affût des aspirations du public, il adopte avec succès la mode de l'opéra-comique patriotique ou historique dans lequel Charles Lecocq est passé maître depuis l'immense succès de La Fille de madame Angot en 1873, en créant Madame Favart 1878 et La Fille du tambour-major 1879, qui est encore à ce jour une de ses œuvres les plus populaires.
Il meurt dans la nuit du 4 au 5 octobre 1880 à 61 ans des suites de la goutte, quatre mois avant la création de son opéra fantastique Les Contes d'Hoffmann, alors en répétitions à l'Opéra-Comique6, sans imaginer que cet ouvrage lui apportera enfin la reconnaissance officielle à laquelle il avait aspiré tout au long de sa carrière, devenant l'un des opéras français les plus joués au monde.
Il est enterré au cimetière de Montmartre dans la 9 ème division. Sa tombe a été réalisée par Charles Garnier et est ornée d'un buste à son effigie, sculpté par Jules Franceschi .
Postérité
La popularité d'Offenbach s'est manifestée, dès son époque, par l'adaptation de nombre de ses thèmes musicaux par d'autres compositeurs. Une importante quantité de musiques de danse quadrilles, polkas, valses a ainsi été fournie par les arrangeurs de l'époque, parmi lesquels Arban, Louis-Antoine Jullien, Olivier Métra, Philippe Musard, Léon Roques ou Isaac Strauss.
D'autres arrangements ont été réalisés dans des circonstances particulières, comme les ouvertures de concert, bien plus développées que les originales, souvent spécialement composées pour les créations autrichiennes des œuvres d'Offenbach, ou Les Contes d'Hoffmann, laissés inachevés à la mort du compositeur et complétés par plusieurs musiciens tels Ernest Guiraud, Raoul Gunsbourg, Karl-Fritz Voigtmann ou Fritz Œser avant que les partitions d'origine ne soient retrouvées par les musicologues Michael Kay et Jean-Christophe Keck dans les années 1990.
Cette habitude ne s'est pas démentie au fil des siècles, notamment pour le ballet, le plus célèbre étant la Gaîté parisienne composé par Manuel Rosenthal pour les Ballets russes en 1938.
Parmi les principales adaptations, on peut citer :
Ouvertures de concert :
Barbe-Bleue, La Grande-duchesse de Gérolstein, Vert-Vert, arrangées par Fritz Hofmann entre 1867 et 1870 ;
La Belle Hélène, arrangée par Friedrich Lehner ;
Orphée aux Enfers, arrangée par Carl Binder en 1860 ;
La Vie parisienne, arrangée par Antal Doráti puis par Bernhard Wolff.
Ballets :
Gaîté parisienne : arrangements que le compositeur et chef d'orchestre Manuel Rosenthal écrivit en 1938 pour les ballets de Monte-Carlo ;
Offenbachiana : arrangements de Manuel Rosenthal en 1953 ;
Barbe-Bleue : ballet arrangé par Antal Dorati pour Michel Fokine et l'American Ballet Theatre en 1941 ;
La Belle Hélène : ballet-bouffe sur des thèmes d'Offenbach adaptés par Manuel Rosenthal et Louis Aubert en 1957 pour l'Opéra de Paris.
Suites orchestrales :
Offenbachiana : pot-pourri orchestral composé en Autriche vers 1869, sans parenté avec l’Offenbachiana de Rosenthal ;
Offenbach in der Unterwelt Offenbach aux Enfers : suite pour orchestre d'harmonie contenant, entre autres, deux extraits de Fantasio, l'opéra-comique qu'Offenbach composa d'après l'œuvre de Musset;
Les Nuits parisiennes : suite pour orchestre de René Leibowitz et Janet Maguire.
Liste des œuvres de Jacques Offenbach.
Principales œuvres scéniques
1858 : Orphée aux Enfers, opéra-bouffe livret de Ludovic Halévy et Hector Crémieux- Suivi d'une 2e version en 1874
1864 : La Belle Hélène, opéra-bouffe livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy
1866 : Barbe-Bleue, opéra-bouffe livret de Meilhac et Halévy
1866 : La Vie parisienne, opéra-bouffe livret de Meilhac et Halévy - Suivi d'une 2e version en 1873
1867 : La Grande-duchesse de Gérolstein, opéra-bouffe livret de Meilhac et Halévy
1867 : Robinson Crusoé, opéra-comique livret d'Eugène Cormon et Hector Crémieux
1868 : La Périchole, opéra-bouffe livret de Meilhac et Halévy- Suivi d'une 2e version en 1874
1869 : Les Brigands, opéra-bouffe livret de Meilhac et Halévy - Suivi d'une 2e version en 1878
1869 : La Princesse de Trébizonde, opéra-bouffe livret de Charles Nuitter et Étienne Tréfeu, créé en juillet 1869 en deux actes, suivi d'une seconde version en trois actes en décembre 1869
1872 : Le Roi Carotte, opéra-bouffe-féerie livret de Victorien Sardou
1875 : Le Voyage dans la Lune, opéra-féerie livret d'Eugène Leterrier, Albert Vanloo et Alfred Mortier
1877 : Le Docteur Ox, opéra-bouffe livret d'Alfred Mortier et Philippe Gille
1878 : Madame Favart, opéra-comique livret d'Henri Chivot et Alfred Duru
1879 : La Fille du tambour-major, opéra-comique livret d'Henri Chivot et Alfred Duru
1881 : Les Contes d'Hoffmann, opéra fantastique livret de Jules Barbier - opus posthume, orchestration achevée par Ernest Guiraud
Mélodies
Espoir en Dieu sur le poème de Victor Hugo 1851, manuscrit inédit, réarrangé pour soprano et chœur puis utilisé dans une première version du finale des Contes d'Hoffmann.
J'aime la rêverie, romance sur des paroles de Mme la baronne de Vaux 1839
Jalousie !, romance dédiée à Mlle Léonie de Vaux 1839
Fables de La Fontaine, recueil de six fables 1842
Le Berger et la Mer
Le Corbeau et le Renard
La Cigale et la Fourmi
La Laitière et le Pot au lait
Le Rat de ville et le Rat des champs
Le Savetier et le Financier
Das deutsche Vaterland La Patrie allemande ou Vaterland's Lied deviendra Rêverie au bord de la mer pour violoncelle solo en 1848 pour être ensuite introduite dans le final des Fées du Rhin en 1864
Les Voix mystérieuses, six mélodies pour voix et piano 1852
Musique symphonique
Grande scène espagnole, op. 22 1840, manuscrit inédit
Concerto pour violoncelle et orchestre Concerto militaire 1847-1848
Polka des mirlitons pour cornet, trois mirlitons et orchestre 1857
Offenbachiana, pot-pourri 1876
Offenbach-Waltz ou American Eagle Waltz pour cornet à pistons et orchestre 1876
Musique pour violoncelle
Cours méthodique de duos pour violoncelles, op. 49 à 54 éd. Schoenberger, 1847
Fantaisies sur :
Jean de Paris de Boieldieu, op. 70
Le Barbier de Séville de Rossini, op. 71 ~1854
Les Noces de Figaro de Mozart, op. 72
Norma de Bellini, op. 73
Richard Cœur-de-Lion de Grétry, op. 69 ~1855
Guillaume Tell ou Grande fantaisie sur des motifs de Guillaume Tell de Rossini 1848
La Course en traîneau dédiée à Mme Léon Faucher, pour violoncelle et piano 1849
Les Chants du crépuscule, op. 29
Musette, musique de ballet du dix-huitième siècle pour violoncelle et orchestre à cordes, op. 24 1842
Musique pour piano
Le Décaméron dramatique, album du Théâtre-Français danses pour piano dédiées aux comédiennes de la Comédie-Française 1854
Les Arabesques 1841-1852
Les Roses du Bengale, six valses sentimentales 1844
Analyse de l'œuvre
Peut-on effectuer aujourd'hui une analyse de l'œuvre du compositeur? Jean-Christophe Keck préconisait la parution critique des ouvrages, puisque Ce n’est qu’à ce moment que les musicologues auront en main un matériel leur permettant de s’exprimer sérieusement sur Offenbach.
Étendue de l'œuvre
D'après le musicologue Jean-Christophe Keck, directeur de l'Offenbach Édition Keck , le catalogue de Jacques Offenbach compte plus de 650 opus14, dont environ 100 ouvrages lyriques mais aussi « de nombreuses pièces de musique de chambre, de musique de danse, ou encore de grands tableaux symphoniques ou concertants. Parmi celles-ci on peut citer, par exemple, sa mélodie Espoir en Dieu 1851, réécrite plus tard pour soprano solo et chœur, son ballet Le Papillon 1860 ou encore sa musique de scène pour La Haine 1874, drame de Victorien Sardou.
État des sources
À la mort de Jaques Offenbach, c'est à son fils Auguste que revenait naturellement la charge de veiller sur l'œuvre de son père mais il meurt le 7 décembre 1883, 3 ans après son père. À la mort d'Herminie, l'épouse de Jacques Offenbach, les manuscrits restent dans la famille, cachés, jusqu'à ce qu'en 1938 Jacques Brindejont-Offenbach en fasse un rapide inventaire dans sa biographie Offenbach, mon grand-père. L'accès à ces archives a donc été longtemps impossible et Jean-Claude Yon dans sa biographie note que La situation actuelle est du reste à peine plus favorable..
Nombre de partitions originales d'Offenbach n'ont pas survécu, ce qui explique la diversité des orchestrations utilisées au cours du XXe siècle, la seule référence étant la partition chant-piano, quand celle-ci était publiée et qui servait traditionnellement de conducteur pour le chef d'orchestre. Depuis les années 1990, les éditions Boosey & Hawkes ont entrepris la publication de l'intégralité des œuvres du compositeur partitions d'orchestre, chant-piano et livret au travers de l'Offenbach Édition Keck OEK. Ces matériels critiques donnent également des indications sur la genèse et les différentes versions de chaque œuvre. En 2010, seules 26 œuvres lyriques ont été éditées.
Le 15 juillet 2004, alors qu'on la croyait détruite, la partition d'orchestre de l'opéra fantastique Les Contes d'Hoffmann a été retrouvée dans les archives de l'Opéra de Paris. Cette partition, créée le 10 février 1881, avait disparu dans l'incendie de la salle Favart, le 25 mai 1887 ; la partition de la version allemande fut également réduite en cendres lors de l'incendie du Ringtheater de Vienne, en décembre 1881, conférant à l'œuvre une réputation maudite.
Le 3 mars 2009, le bâtiment des archives municipales de Cologne, où étaient conservés plusieurs manuscrits originaux d'Offenbach ainsi que la partition autographe du Tristan und Isolde de Richard Wagner, s'effondre causant la perte de nombreux documents.
Citations et avis
Le 18 mars 1857, après une soirée passée aux Bouffes-Parisiens, Léon Tolstoï note : Une chose véritablement française. Drôle.
En 1869, Richard Wagner - qui, après avoir loué son confrère, s'est fâché avec lui suite aux caricatures dont il avait fait les frais - écrit dans ses Souvenirs sur Auber : Offenbach possède la chaleur qui manque à Auber ; mais c'est la chaleur du fumier ; tous les cochons d'Europe ont pu s'y vautrer.
En 1876, Albert Wolff écrit dans la préface de Notes d'un musicien en voyage, publié par Offenbach à son retour des États-Unis : ... Il y a de tout dans son inépuisable répertoire : l’entrain qui soulève une salle, les gros éclats de rire qui plaisent aux uns, l’esprit parisien qui charme les autres et la note tendre qui plaît à tous, parce qu’elle vient du cœur et va droit à l’âme.
Bibliographie
Jacques Offenbach, Offenbach en Amérique. Notes d'un musicien en voyage, 1877
Arnold Mortier, Les Soirées parisiennes de 1874, 1875 - Préface de J. Offenbach
Biographies
André Martinet, Offenbach, sa vie et son œuvre, Dentu, Paris, 188722.
Siegfried Kracauer, Offenbach ou le Secret du second Empire, Paris, 1937.
Florian Bruyas, Histoire de l'opérette en France, 1855-1965, E. Vitte, 1974.
Claude Dufresne, Offenbach ou la Joie de vivre, Perrin, 1998.
Jean-Claude Yon, Jacques Offenbach, coll. Biographies, Gallimard, Paris, 2000.
Philippe Luez, Jacques Offenbach, musicien européen, Anglet, Séguier, 2001.
Jean-Claude Yon, Jacques Offenbach » in Dictionnaire de la musique en France au xixe siècle Joël-Marie Fauquet, dir., Fayard, 2003
,
Discographie sélective
Bien des œuvres d'Offenbach ne sont plus jouées en France. Les grands classiques mis à part, seuls des extraits sont en général disponibles. Certaines ne sont même disponibles que dans des adaptations en langue étrangère tel Robinson Crusoé, une des rares œuvres du compositeur créée à l'Opéra-Comique, uniquement en version anglaise direction Alun Francis chez Opéra Rara.
Néanmoins, depuis la mise en chantier de l'édition critique chez Boosey & Hawkes, on assiste à la publication de nouveaux enregistrements ou d'enregistrements historiques, la plupart réalisés par l'ORTF dans les années 1950-1960, jusque lors indisponibles.
Œuvres originales
Parmi les enregistrements historiques reparus en CD dans les années 1980, la plupart sont des productions de l'ORTF. Parmi elles :
Barbe-Bleue avec Henri Legay, Christiane Gayraud, Aimé Doniat, René Terrasson, Jean Doussard dir.– Bourg
Barbe-Bleue avec Anna Ringart, Janine Capderou, Michel Sénéchal, Jean Giraudeau, Luis Masson, Michel Fusté-Lambezat (ir. et Pépito avec Mady Mesplé, Yves Bisson, Albert Voli. Catherine Comet dir. – UORC
Les Bavards et Ba-ta-clan avec Lina Dachary, Huguette Boulangeau, Aimé Doniat, Raymond Amade, René Terrasson, Marcel Couraud dir.– Erato, 1967
La Belle Hélène avec Danièle Millet, Charles Burles, Jean-Christophe Benoît, Michel Dens, Jean-Pierre Marty – EMI, 1970
La Chanson de Fortunio, Lischen et Fritzchen et La Leçon de chant électromagnétique avec Lina Dachary, Freda Betti, Michel Hamel,Joseph Peyron,Jean-Claude Hartemann– Bourg
La Chanson de Fortunio et Madame l'Archiduc avec Lina Dachary, Jeannette Levasseur, Dominique Tirmont, Pierre Miguel, Jean-Claude Hartemann – Musidisc
Le Château à Toto et L'Île de Tulipatan avec Lina Dachary, Monique Stiot, Raymond Amade, Dominique Tirmont, Joseph Peyron – EJS
La Créole avec Huguette Boulangeot, Lina Dachary, Aimé Doniat, Michel Hamel, Marcel Cariven dir.– Bourg version révisée par George Delance et Albert Willemetz en 1934
Croquefer ou le Dernier des paladins et Tromb-al-ca-zar, Alfred Walter – TPL
L'Île de Tulipatan ; Pomme d'Api, Emmanuel Koch – TPL
Croquefer ou le Dernier des paladins, Les Deux Aveugles et Le Violoneux, Louis-Vincent Bruère – Bourg
Geneviève de Brabant, Marcel Cariven – Bourg
La Fille du tambour-major, avec Christiane Harbell, Étienne Arnaud, Louis Musy, Richard Blareau – Accord, 1962
Madame Favart, avec Suzanne Lafaye, Lina Dachary, Camille Maurane, Joseph Peyron, Marcel Cariven – Musidisc
La Périchole avec Suzanne Lafaye, Raymond Amade, Raymond Noguera, Igor Markevitch – EMI, 1959
Le Pont des soupirs avec Claudine Collart, Monique Stiot, Michel Hamel, Aimé Doniat, Joseph Peyron, Jean Doussard – Bourg
Une Anthologie d'enregistrements rares en 4 volumes est parue également aux éditions Forlane en 1997.
Le chef d'orchestre Michel Plasson a été le premier à réenregistrer avec des distributions prestigieuses les grandes œuvres d'Offenbach dans les années 1970-1980, la plupart chez EMI :
La Vie parisienne avec Régine Crespin, Mady Mesplé et Michel Sénéchal – 1976
La Grande-duchesse de Gérolstein avec Régine Crespin, Alain Vanzo et Robert Massard – CBS-Sony, 1977
Orphée aux Enfers avec Mady Mesplé, Jane Rhodes, Michel Sénéchal, Jane Berbié et Charles Burles – 1979
La Périchole avec Teresa Berganza, José Carreras et Gabriel Bacquier – 1982
La Belle Hélène avec Jessye Norman et John Aler, Gabriel Bacquier et Charles Burles – 1985
Parmi les autres enregistrements «odernes, on peut citer :
La Belle Hélène avec Jane Rhodes, Rémy Corazza, Jules Bastin, Jacques Martin, Alain Lombard, Barclay/Accord, 1978
Les Brigands avec Colette Alliot-Lugaz, Tibère Raffalli, Michel Trempont, John Eliot Gardin – EMI, 1989
Les Contes d'Hoffmann : nombreuses versions, de la traditionnelle Choudens dirigée par André Cluytens avec Raoul Jobin, Renée Doria, Vina Bovy, Géori Boué et Bourvil – EMI, 1948, à l'édition critique Kaye dirigée par Kent Nagano avec Roberto Alagna, José van Dam, Natalie Dessay, Leontina Vaduva et Sumi Jo – Erato, 1996.
Les Fables de la Fontaine, François Le Roux, Jeff Cohen– EMI, 1991
Le Financier et le Savetier, et autre délices, Jean-Christophe Keck – Accord, 2007
Die Rheinnixen en allemand, Friedemann Layer– Accord, 2003
La Périchole avec Régine Crespin, Alain Vanzo, Jules Bastin, Alain Lombar– Erato, 1977
Pomme d'Api ; Monsieur Choufleuri ; Mesdames de la Halle avec Mady Mesplé, Léonard Pezzino, Charles Burles, Jean-Philippe Laffont, Michel Trempont, Manuel Rosenthal – EMI, 1983
Vert Vert avec Jennifer Larmore, David Parry – Opera Rara, 2010
Robinson Crusoe – Opéra Rara, 1980 en anglais.
Le chef d'orchestre Marc Minkowski a entrepris depuis une dizaine d'années l'enregistrement de plusieurs œuvres-maîtresses, mises en scène par Laurent Pelly et basées sur le travail de l'édition critique OEK :
Orphée aux Enfers avec Natalie Dessay, Yann Beuron et Laurent Naouri – EMI Classics, 1998
La Belle Hélène avec Felicity Lott, Yann Beuron, Michel Sénéchal et Laurent Naouri – Virgin Classics, 2001
La Grande-Duchesse de Gérolstein avec Felicity Lott, Yann Beuron et François Le Roux – Virgin Classics, 2005
Parmi les œuvres instrumentales, on peut citer :
Concerto pour violoncelle et orchestre Concerto militaire, Jérôme Pernoo violoncelle– Archiv Produktion, 2006
Ballade symphonique, Jean-Christophe Keck, Orchestre national de Montpellier – Accor, 2006
Ouvertures, préludes et mélodrames La Vie parisienne, Barbe-Bleue, Les Bergers, Ba-ta-clan, La Périchole, Orphée, Sur un volcan, Souvenirs d'Aix-les-Bains
Le Papillon, Richard Bonynge – Decca, 1973
Cello Concertos – CPO, 2004,
Les miniatures Deux âmes au ciel, Introduction et Valse mélancolique et La Course en traîneau, originellement pour piano, sont orchestrées par Heinz Geese.
Cell'Offenbach, Ligia Digital
Piano Works 3 vol. – CPO, 2005-2008,
La plupart des œuvres de ce disque sont des réductions pour piano.
Offenbach romantique – Archiv produktion, 2008,
Adaptations
La Gaîté parisienne est certainement l'adaptation la plus enregistrée d'où généralement une confusion du public avec l'œuvre originale d'Offenbach
On peut citer :
Manuel Rosenthal, Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, EMI Classics ;
Arthur Fielder , Boston Pops Orchestra, RCA, 1954 ;
Herbert von Karajan , Philharmonia Orchestra, EMI Classics ;
Lorin Maazel, Orchestre national de France, Sony, 1980 ;
Charles Munch New Philharmonia Orchestra, Decca, 1964 ;
André Previn, Orchestre symphonique de Pittsburgh, Philips Classics, 1994 ;
Yutaka Sado , Orchestre philharmonique de Radio-France, Warner, 2006 ;
Autres adaptations
Offenbachiana + Gaîté parisienne Manuel Rosenthal , Orchestre de l'Opéra de Monte-Carlo, Naxos, 1997
Offenbachiana, Manuel Rosenthal Orchestre de l'Opéra de Paris, Accord, 2002
Operetten Zauber, Josef Drexler , Orchester der Wiener Staatsoper, Elite Special, 2005 – Enregistrement de l’Offenbachiana de 1869.
La Belle Hélène, ballet + Gaîté parisienne, Robert Blot , Orchestre de l'Opéra de Paris, EMI Classics, 1957
Offenbach Overtures, Bruno Weil, Wiener Symphoniker, Sony, 1993 – Ouvertures de concert et ouvertures originales.
Offenbach in America, Arthur Fielder, Boston Pops Orchestra, RCA, 1956 – Ouvertures de concert et musique de danse.
Folies dansantes chez Jacques Offenbach, Jean-Christophe Keck, Solistes de l'Orchestre Pasdeloup, Orphée 58, 2008 – Quadrilles et fantaisies par Strauss, Métra, Marx et Dufils.
Christopher Columbus, opéra-bouffe en 4 actes, livret en anglais de Don White, Opéra Rara, 1977
Pastiche reprenant des extraits d'œuvres rares d'Offenbach entre autres, Le Docteur Ox, La Princesse de Trébizonde, Fantasio, La Boîte au lait, Maître Peronilla, Vert-Vert, Les Bergers, Les Braconniers, La Boulangère a des écus, La Créole, Les Trois Baisers du Diable, Dragonnette, etc. auxquels les paroles sont substituées pour illustrer l'intrigue.
Liens
http://youtu.be/SNtAlXq6weg Offenbach
http://youtu.be/bFFyJW5wH0U La belle Héléne
http://youtu.be/f4_9wZd8YRA l'entrée des rois
http://youtu.be/4UYS_MU4ABY La grande duchesse de Gerolstein
http://youtu.be/jZnnUmhJz4U Les contes d'Hoffmann
http://youtu.be/EQThQv7Sadc La Périchole
http://youtu.be/UNLCdL2-HCI La vie Parisienne  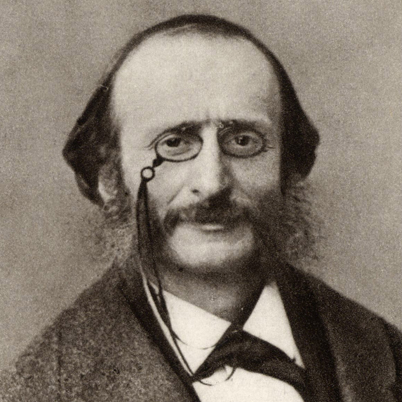 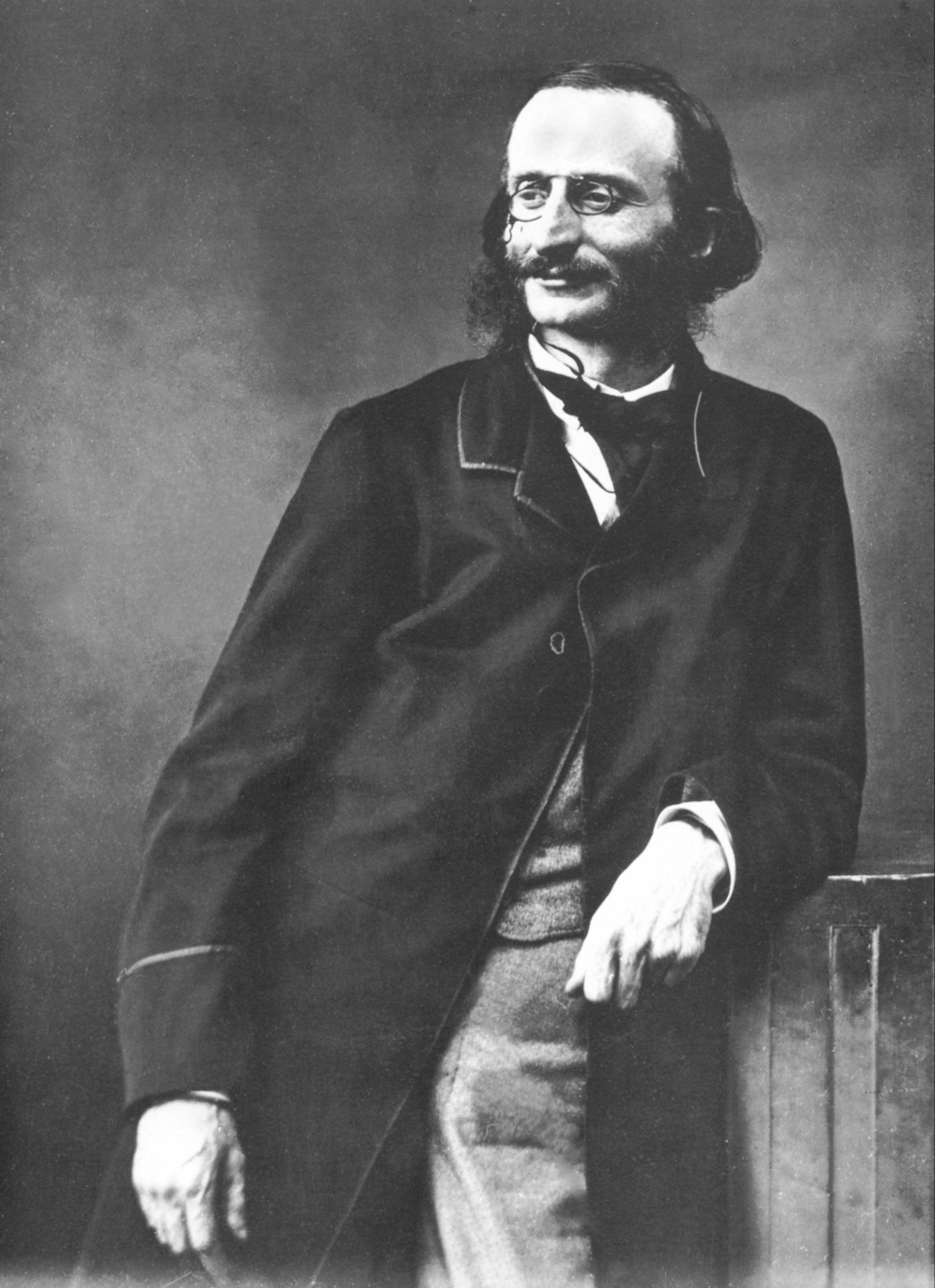 [img width=600]http://www.franceculture.fr/sites/default/files/2012/04/26/4430411/images/offenbach.jpg?1335446212[/img]   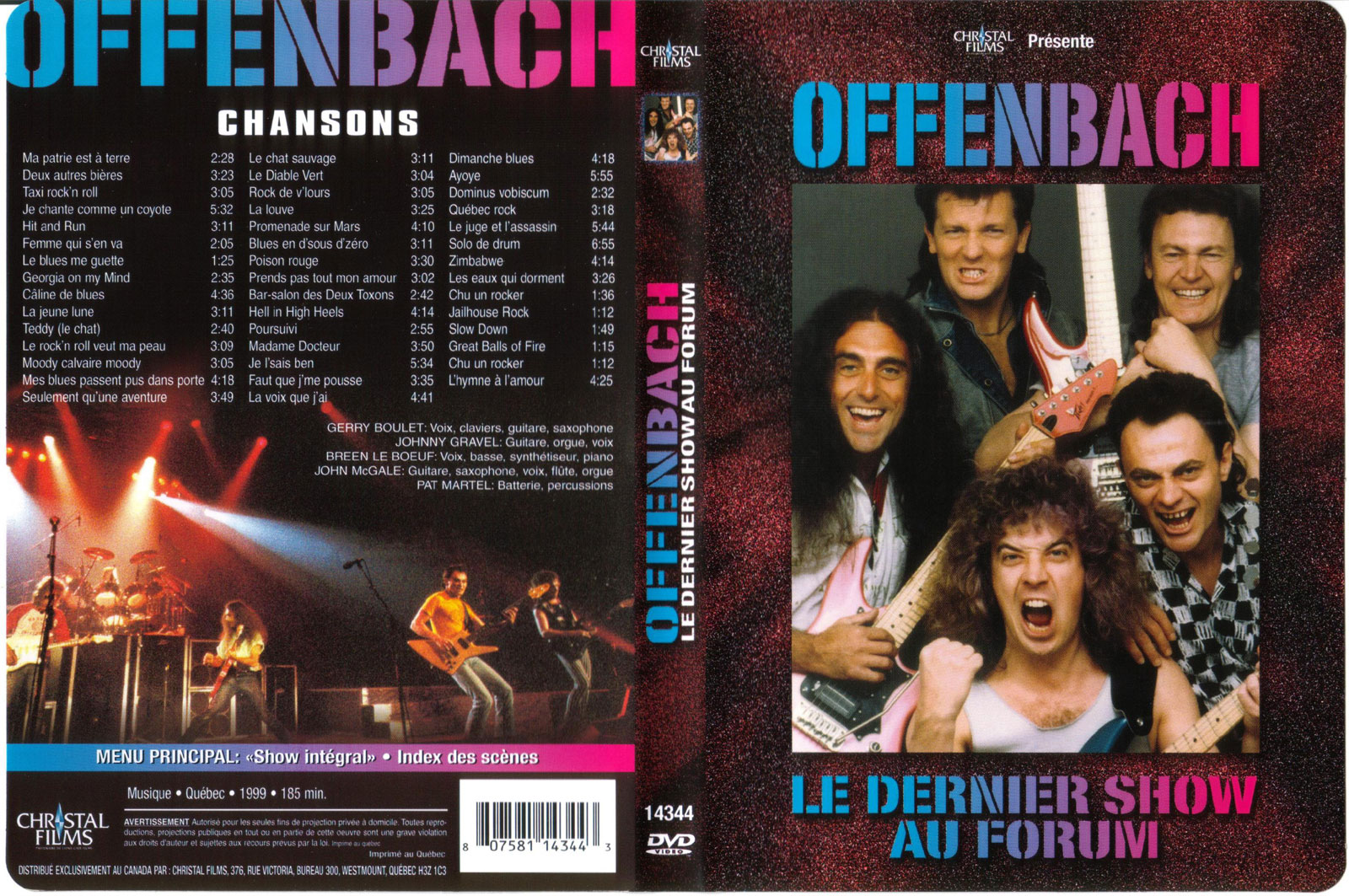     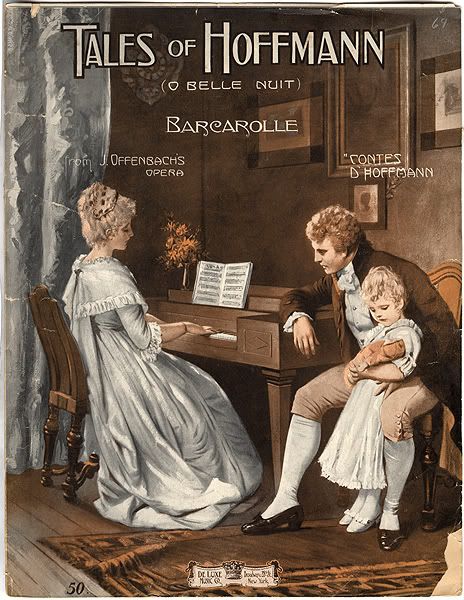
Posté le : 05/10/2014 00:24
Edité par Loriane sur 06-10-2014 00:05:01
|
|
|
|
|
Re: Défi du 04/10/2014 |
|
Modérateur  
Inscrit:
21/03/2013 20:08
De Belgique
Niveau : 44; EXP : 15
HP : 215 / 1078
MP : 1072 / 35550
|
Ah le petit Igor a des soucis. La Clotilde a dû passer un sale quart d'heure. N'oublie pas de rendre sa dépouille à Arielle, elle peut encore servir.
Finalement, il a bien fait de suivre ce gourou à la robe blanche. Mais il paraît que ce dernier a fugué...
Bon, je te préviens que je t'emprunte Igor pour ma nouvelle mais je l'expédie au paradis... Du moins artificiel ! Rendez-vous demain dès que ma rédactrice en chef aura donné son feu vert.
Merci
Couscous
Posté le : 04/10/2014 20:24
|
|
|
|
|
Re: Défi du 20-09-2014 |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
06/08/2013 20:30
De Le Havre
Niveau : 25; EXP : 53
HP : 0 / 613
MP : 268 / 19535
|
Profession : purificatrice Je regarde mon jardin et je me sens particulièrement bien. J’ai fait un rêve bizarre, un homme marchait dans la campagne, il avait un chien et un bâton de marche. Il m’abordait et m’annonçait que j’étais un ange, pas plus pas moins ! Comme je ne le prenais pas au sérieux, il m’expliquait le plus simplement du monde les raisons qui faisaient qu’il était temps que je m’en rende compte, que j’avais une mission à accomplir sur la terre, et qu’il était là pour m’aider. - Rendu compte de quoi ? Je n’ai pas d’ailes dans le dos, pas de pouvoirs surnaturels, et de toute façon je ne crois pas à ces bêtises. Il a semblé contrarié. - Tu n’as pas à croire ou ne pas croire, c’est un fait ! Comment t’appelles-tu ? Cet illuminé me raconte que je suis un ange, mais il ne sait pas comment je m’appelle… - Arielle, je pensais que vous le saviez ! - Bien sûr que je le sais. Mais tu es bien ignorante. Ariel est un ange, comme Raphaël. Je m’appelle Raphaël, et mon chien s’appelle Tobie. Nous devons travailler ensemble. - Ecoutez Raphaël, j’ai assez à faire comme ça, je n’ai pas besoin de missions supplémentaires. Ma préoccupation actuelle est de m’occuper de mes enfants et de pourvoir à nos besoins, c’est une occupation à plein temps, je vous assure ! - Bien sûr, mais le temps est venu. Tu accomplis déjà beaucoup de choses sans le savoir. Connais-tu la signification de ton prénom ? - La gardienne de l’Autel je crois. - Oui c’est cela. Le Lion de Dieu aussi. Quel est ton signe astrologique ? - Lion mais ça ne veut rien dire. - Peut-être, peut-être. L’ange Ariel apparait aux gens dans un halo de lumière rose pâle. Les humains savent qu’il s’adresse à eux, quand ils aperçoivent cette teinte, ou quand ils voient des représentations de lion. La mission d’Ariel est de protéger la Terre et tous les êtres vivants qui la peuplent. - Pas mal comme mission, et moi qui pensait adhérer à un parti politique qui défendrait l’écologie ! - Ce n’est pas un hasard. - Ecoute Raphaël, merci pour cette révélation. Les histoires d’anges gardiens, ce n’est pas trop mon truc. C’est très sympa, mais ce n’est pas quelques coïncidences qui font que j’y croirai. Des milliers de personnes s’appellent Ariel, ils seront peut-être plus motivés que moi. - C’est tout à fait vrai, mais tous ne sont pas comme toi. Tu ne peux rien faire contre. Je te laisse réfléchir. Nous nous reverrons, nous n’avons pas le choix. Tu verras c’est formidable. Raphaël me sourit, il a un visage spécial, radieux, des cheveux bouclés. Il a un visage d’ange. Je rêve, c’est donc normal. A mon réveil, le souvenir de mon nouvel ami est encore très présent. En ouvrant les volets, je me rends compte que de nouvelles fleurs sont encore apparues, c’est une explosion, de rose, rouge et mauve. Des merles ont élu domicile dans le laurier, ils doivent avoir des petits, il y a un bruit pas possible. J’ai vu un nid d’hirondelles sous le toit, et les chats du quartier semblent penser que mon carré de verdure fait partie de leur territoire. Depuis que j’habite dans cette maison, j’aurais pu adopter une dizaine de matous, ils semblent tous décidés à venir habiter chez moi. Si je me laissais faire, j’aurais aussi quelques chiens. A chaque fois que je me promène dans la campagne, je me retrouve avec un compagnon à quatre pattes sur mes talons. C’est vrai que je suis entourée de fleurs roses et d’animaux. C’est amusant. J’allume la radio : - Lion : belle journée en perspective. Restez près de la nature, c’est votre élément. Vos amis écouteront vos conseils avisés. Qu’on est bien à vos côtés ! Sympa cet horoscope ! J’ai bien fait de l’écouter, bon c’est un peu flippant aussi, j’ai l’impression d’entendre Raphaël me dire : - Tu vois bien que j’ai raison ! Je prends mon caddie et je pars au marché retrouver mes copains, le maraîcher, le boulanger et un ou deux clients qui viennent à la même heure que moi. On s’échange les potins, et des recettes de cuisine. Le stand de fruits et légumes est très coloré : - Le boulanger a perdu son chien, je préfère vous prévenir. Ça ne fait pas longtemps que je viens sur cette place, pourtant j’ai déjà l’impression que tout le monde me connait, on me sert la main et le boulanger me tutoie et me fait même la bise ! Le papy que je rencontre chaque samedi est là aussi. - Vous êtes radieuse ! Je suis impressionné par votre élégance ! Le rose de votre pantalon et le noir de votre blouson se retrouvent sur votre écharpe et même sur votre caddie à roulettes, bravo ! C’est vrai que je n’ai pas fait attention, mais toutes les couleurs de ma tenue sont assorties, j’aime beaucoup le rose, j’ai pas mal de vêtements et d’accessoires de cette teinte… Je vous entends, vous, lecteur, ça n’a aucun rapport !! Je fais le plein de végétaux comestibles, mon admirateur me donne la recette de la soupe glacée aux fanes de radis et me conseille d’acheter plutôt des kiwis jaunes qui sont plus sucrés que les verts. Le boulanger m’accueille avec les yeux rougis. - Bonjour, tu es lumineuse. Ça me fait du bien de te voir. Il me claque la bise. Lumineuse, hum. - J’ai perdu mon boxer de 12 ans, elle s’est couchée sur la pelouse hier soir, et elle est morte, c’est dur. Je compatis, le pauvre il a l’air si malheureux ! - Merci, tu vois rien que de t’en parler, je me sens déjà mieux. Ce rêve m’a vraiment perturbée, j’ai l’impression que tout ce que m’a dit Raphaël se vérifie. Il faut que je chasse ces idioties de mon esprit. Devant ma maison, je rencontre ma voisine. - Vous avez le temps ? Bien sûr que j’ai le temps, elle n’a pas l’air bien. - Mon mari a la maladie de Parkinson, c’est insupportable. Il veut tout repeindre dans la maison, je le laisse faire. Il perd le moral quelquefois, je dois le soutenir, mais j’avoue que je n’ai pas toujours l’énergie de le faire. Après une demi-heure de discussion sur le trottoir, elle a retrouvé le sourire, et arrive même à plaisanter. J’ai pris du retard sur mon planning. Cet après-midi je voudrais aller me balader sur les sentiers de randonnées de la région. J’ai prévu une marche de trois heures avec pique-nique. Je prépare mon sac : le fromage de la fermière du marché accompagné de ma baguette tradition, une banane, et une petite bouteille d’eau. C’est parti ! Il y a de superbes paysages, j’ai besoin de respirer l’odeur de l’herbe et des fleurs des champs, de voir des vaches dans des prés bien verts. C’est mon côté proche de la nature, vous l’avez deviné. Beaucoup de gens sont comme moi, ça n’a aucun rapport je vous dis ! En marchant sur les chemins, je me retourne plusieurs fois. Et si je rencontrais Raphaël avec son chien et son bâton de randonneur ? Heureusement, pas d’ange à l’horizon. J’ai un peu peur de perdre la boule. Je me sens bien après ma petite balade. Le soir, j’ai un mail d’une amie : « Merci d’avoir pris de mes nouvelles, tu es un ange ! » Aïe ! Ça continue ! Sur mon portable, j’ai deux messages que je n’ose pas lire jusqu’au bout : « Bonjour mon ange » « Tu es vraiment un ange » Ça suffit ! Il faut que je me renseigne un peu, voyons ce qu’internet dit de ce soi-disant ange, voilà un site : http://angels.about.com/« Dans le Livre de Salomon Ariel est décrit comme un ange qui punit les démons. Dans des textes plus récents, le rôle d’Ariel est de soigner la nature et dans La Hiérarchie des Anges, Ariel est appelé « Dieu de la Terre ». Ariel fait partie des anges appelés les Vertus, ils inspirent les gens sur Terre, créent l’Art et inspirent les grandes découvertes scientifiques. Ariel est le patron des animaux sauvages. Certains chrétiens considèrent qu’Ariel est le saint patron des nouveaux départs. » Le saint patron des nouveaux départs, je m’en serais bien passée de tous ces nouveaux départs que la vie m’a obligée à faire. « Dieu donnerait à Ariel la tâche d’éduquer ceux qui ont calomnié leur prochain. » C’est un sacré boulot ça ! Je ne vais pas chômer ! « Pour les punir, ils sont conduits devant Yaldabaoth et ses 49 démons. Ils sont fouettés violemment pendant onze mois et vingt-et-un jours. Ensuite, ils sont jetés dans des cours d’eau et des mers bouillonnants et brûlés pendant encore onze mois et vingt et un jours. » Joli programme ! «Après cela, ils seront amenés dans l’Ordre du Milieu où les dirigeants les châtieront à nouveau pendant onze mois et vingt et un jours. Ensuite, ils sont conduis devant la Vierge de la Lumière qui juge les vertueux et les pêcheurs. Ils sont plongés dans une eau qui se transforme en feu purifiant. Ce jugement n’est donc pas une punition mais une purification» Quel tissus de bêtises, comment est-ce que des gens saints d’esprit peuvent croire à des âneries pareilles ! Les pauvres, ça m’étonnerait que la Vierge de la Lumière en reçoive beaucoup, ils sont morts avant d’arriver jusqu’à elle. - Détrompe-toi, tout cela est symbolique. Ton travail est bien de purifier les personnes qui n’ont pas respecté la Terre et ses occupants. Tu dois leur enseigner la vertu. C’est Raphaël qui a parlé, je ne sais pas comment il est entré, mais il est bien présent dans mon salon avec son chien que mon chat n’attaque même pas. - Il y a bien des façons d’amener les gens à changer leur comportement, il faut être patient, et expliquer inlassablement. Une fois que tu t’es intéressée à eux, que le mal qu’ils font est identifié et qu’ils n’ont pas suivi tes conseils, le processus se met en branle. - Tu plaisantes j’espère ! Je ne vais plus oser parler aux gens. De toute façon, je ne crois pas à ces fadaises. Je dois avouer que quand même ça ne me déplairait pas de me venger de certaines personnes… - Il ne s’agit pas de vengeance mais de purification, et je suis chargé de t’aider dans cette tâche. Il entend tout ce que je pense celui-là ! Il me sourit malicieusement… - Tu enseignes aux gens ce qu’il faut faire pour ne plus faire de mal, c’est ton métier je crois ? Tu vois, c’est encore un signe. Je suis le « médecin du ciel », je suis chargé de les guérir. Tu comprends ? - Je comprends, mais si je suis déjà un ange, le travail a peut-être commencé ? - Il a commencé en effet. Il me tend une pile de journaux. J’y découvre des gens qui ont croisé mon chemin. Des personnes qui avaient fait du mal autour d’eux, que j’avais conseillé, mis en garde ou combattus. Ils ont tous subis des accidents ou des blessures psychologiques très graves, qui font que le cours de leur vie a complètement changé. Tiens mon ex ! Pas mal la purification qu’il a enduré, à mon avis il a compris la leçon. C’est sympa ce boulot finalement !
Posté le : 04/10/2014 18:10
|
|
|
|
|
Re: Défi du 04/10/2014 |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
14/03/2014 18:40
De Paris
Niveau : 29; EXP : 25
HP : 0 / 706
MP : 370 / 21252
|
Igor a le blues Igor avait le blues. Sa vie ne ressemblait pas à ses rêves de petit garçon, quand il courait pieds nus dans les champs de sa Transylvanie natale en faisant l'avion avec ses bras. Pourtant, il en avait parcouru du chemin depuis son enfance et désormais il travaillait pour le comte Donaldo, quelque part dans la banlieue parisienne. Igor savait qu'il était parti pour longtemps avec ce boulot, surtout depuis qu'il était devenu immortel. C'était d'ailleurs pour cette raison que son maître l'avait engagé. « Au moins, je n'aurais pas à vous pleurer le jour de votre enterrement » lui avait-il dit à la signature du contrat. Igor s'ennuyait ferme. L'immortalité, c'était mortel en fait. Il partageait ce triste constat avec le comte Donaldo, lui aussi affligé de cette plaie depuis qu'il avait croqué un buvard lysergique. Au début, lors de son installation dans le village, il s'amusait à faire peur aux manants. Avec son physique atypique, du haut de son double-mètre, il terrorisait les ignorants du coin, persuadés de l'origine démoniaque de l'aristocrate et de son régisseur. Le comte Donaldo avait alimentée leur légende, en organisant de bruyantes soirées sataniques avec de belles succubes, rythmées par le rock gothique des fils du Nephilim. « Qu'est-ce qu'on se marrait à cette époque. » disait son maître quand il évoquait cette période dorée. Tout avait changé depuis une dizaine d'années. Le comte Donaldo était rentré dans une profonde dépression, suite à la rencontre d'une ancienne amour de lycée. Il était devenu renfermé, lointain et peu sociable. C'en était fini des orgies du week-end et des blagues de potache ; l'aristocrate s'enfermait des heures dans son cercueil et s'abrutissait à coup de stupéfiants. Igor n'avait pas cette chance, celle de pouvoir échapper à la triste réalité grâce à des paradis artificiels. Il avait pourtant essayé à plusieurs reprises, sous l'impulsion de son maître mais il n'y avait rien à faire. Que ce soit en fumette, en boisson ou en suppositoire, aucune substance ne modifiait sa perception du monde extérieur. Inquiet de ce manque de réaction, Igor s'en était allé consulter des spécialistes. Les découpeurs de neurones, les géomètres de la cervelle et les attaqués du bulbe avaient résumé son mal par une conclusion simple : Igor n'était plus humain. Igor se souvint son retour de chez le dernier médecin. Il avait été déprimé et le comte Donaldo s'en était aperçu. — D'où vient cette tête de déterré, Igor ? — Je reviens de chez le docteur Gronk. — Qu'est-ce que vous êtes allé faire chez ce dingo ? — Je voulais un avis éclairé sur mon manque de réaction aux narcotiques et autres drogues. — Et alors, que conclut le taré de service ? — Que je ne suis plus humain. — Et c'est ça qui vous met le bourdon ? — Oui. Je ne peux même pas échapper à mon ennui avec des alcools ou des élixirs lysergiques. Je suis condamné à vivre éternellement, telle une machine. — Allez casser quelques têtes au village, ça vous dégourdira les synapses. A ce seul souvenir, Igor sentit la déprime le reprendre. Le comte Donaldo ne lui était d'aucune aide, tout simplement parce qu'il était lui-même trop loin, détaché des autres et enfermé dans sa propre immortalité. Igor avait suivi le conseil de son maître, plus par obéissance que par conviction et il n'en avait tiré aucun plaisir. Ce dernier indice lui avait montré à quel point il n'était plus humain. — Alors Igor, ça fait du bien de briser de la rotule, lui avait dit l'aristocrate à son retour. — Pas tant que ça. — Comment ça ? Vous n'avez pas savouré de rosser du gueux ou de décapiter du manant ? — Non. — C'est plus grave que je ne le croyais alors. — Je n'éprouve pas d'émotion à ces activités ludiques. — Vous avez essayé le sexe ? — Oui. Même constat. — Pareil avec les garçons qu'avec les filles ? — Idem. — Vous avez goûté à une de mes copines succubes ? — Oui, j'ai fait appel à la perverse Clotilde, celle que vous aimez tant fouetter. — Et ? — Résultat identique. — Elle n'a pas du apprécier de vous faire si peu d'effets, la Clotilde. — Je confirme. J'ai été obligée de la découper en deux et de l'enterrer au fond du jardin. — Elle s'en remettra. Igor avait pourtant tenté d'autres paradis artificiels. Les alcools, les stupéfiants et le sexe ne fonctionnaient pas avec lui mais il restait d'autres façons de s'occuper inutilement. — Et si vous essayiez le golf ? C'est aussi un paradis artificiel, proposa le comte Donaldo. — C'est fait. Pas mieux. — Et quand vous regardez la télévision, vous ne planez pas ? — Je ne comprends pas. — Je parle des émissions débiles, les jeux ou les shows de variétés du samedi soir. Moi, quand je les regarde, j'hallucine gravement et j'avoue que j'ai du mal à m'en remettre. Je vous conseille celle de l'autre abruti, le Corrézien au gros nez. Un must chez les beaufs. — Je m'ennuie quand j'allume le poste, quel que soit le programme. — Ne me dites pas que le foot ne vous fait pas marrer. Vous savez, ce truc sur un pré où des petits veaux courent bêtement derrière une sphère de cuir, devant des milliers de spectateurs avinés. — Pas plus que le tennis, l'équitation ou la Formule Un. — Vous êtes grave, Igor. — Le pire, c'est que je n'ai pas d'autre solution à l'ennui que de m'inventer un paradis artificiel. — Mais j'y pense, pourquoi un paradis ? Et si vous changiez de la routine, en créant un enfer artificiel ? — Je ne vous suis pas. — On rêve tous de ce qui est bon mais si on inverse le raisonnement, regardons ce qui est mauvais et souffrons. C'est du masochisme mais cela fonctionne pour les gars qui s'ennuient dans leur vie bien huilée. — Je sais que ça ne marchera pas avec moi. — Pourquoi ? — Je vous rappelle d'où je viens : la Transylvanie. La-bas, la vie est tellement pourrie que la Roumanie à côté c'est le Pérou. Souffrir, j'ai donné. C'est tout aussi ennuyeux. — Il ne vous reste qu'une option, puisque même le suicide vous est impossible. — Laquelle ? — Rentrer dans les ordres. Rejoindre un monastère et recopier les Saintes Écritures sur de vieux grimoires miteux, en priant le Seigneur douze fois par jour. Igor se signa et quitta la chapelle. « La religion est l'opium du peuple. » lui avait dit un jour le comte Donaldo. Igor l'avait pris au mot et il consacrait désormais son existence à Jésus-Christ, au sein d'une obscure confrérie, loin de l'immortel aristocrate. C'était toujours une vie ennuyeuse mais il espérait en gagner un peu d'humanité.
Posté le : 04/10/2014 15:24
|
|
|
|
|
Roberto Juarroz |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 5 octobre 1925 naît, Roberto Juarroz
à Coronel Dorrego dans la province de Buenos Aires, Argentine Roberto Juarroz, mort le 31 mars 1995 à Buenos Aires, poète argentin, considéré comme un des poètes majeurs de ce temps, dont l'œuvre est rassemblée sous le titre unique de " Poesía vertical ". Seul varie le numéro d’ordre, de recueil à recueil : Segunda, Tercera, Cuarta… Poesía Vertical. Nul titre non plus à aucun des poèmes qui composent chaque recueil.
Par ce titre unique et chargé de sens de Poésie Verticale qu'il a donnée à toute son œuvre depuis son premier livre, Roberto Juarroz a cherché à traduire la verticalité de la transcendance, « bien entendu incodifiable », précise-t-il dans un entretien. Sa poésie est une poésie différente, un langage de débuts et de fins, mais en chaque moment, en chaque chose. La verticalité s'exprime vers le bas et vers le haut, chaque poème se convertissant en une présence qui représente ce double mouvement, cette polarité qui définit la parole de l'homme lorsque cette parole ne se situe pas dans des limites conventionnelles.
Juarroz, en choisissant de donner ce titre unique à chacun de ses recueils, et en ne donnant pas de titre à ses poèmes, a voulu d'une certaine façon tendre vers l’anonymat des couplets ou des refrains populaires que l’on répète sans en connaître l’auteur, depuis longtemps disparu et oublié. Il explique qu'il a fait ce choix, parce que, selon lui chaque titre, surtout en poésie, est une espèce d’interruption, un motif de distraction qui n’a pas de vraie nécessité. Sans titre, le recueil s’ouvre directement sur les poèmes, un peu comme ces tableaux dont l’absence de titre vous épargne les détours de l’interprétation.
Dans l'un de ses derniers recueils, Treizième poésie verticale, publié en 1993, Roberto Juarroz forme le vœu de parvenir à dessiner les pensées comme une branche se dessine sur le ciel.
Sa vie
Roberto Juarroz était le fils du chef de gare de la petite ville de Coronel Dorrego, dans la Pampa Húmeda proche de Buenos Aires. Il a d'abord suivi des études de lettres et de philosophie à l’Université de Buenos Aires, où il s’est spécialisé dans les sciences de l’information et de la bibliothécologie. Il s'est ensuite rendu en France pour poursuivre ses études à la Sorbonne à Paris, où il obtient des diplômes en philosophie et en littérature.
Après avoir publié son premier recueil de « Poesia vertical à compte d’auteur en 1958, il a dirigé, avec le poète Mario Morales, la revue Poesia=Poesia , 20 numéros de 1958 à 1965, diffusée dans toute l'Amérique latine, tout en collaborant à de nombreux journaux, revues et périodiques. Il sera notamment critique littéraire du quotidien La Gaceta et critique cinématographique de la revue Esto Es. Dans un entretien avec Jacques Meunier, publié en avril 1993 dans Les Lettres françaises, Juarroz précise, à propos de la revue de poésie qu'il a dirigée : Nous voulions défendre, avec ce titre-manifeste, l’idée que la poésie n’est égale qu’à elle-même, qu’elle ne peut être politique, sociologique ou philosophique. Dans cette revue, il a publié de nombreux auteurs sud-américains, d’Octavio Paz à Antonio Porchia, ainsi que des traductions. Il s’y est révélé fin découvreur et subtil traducteur de poètes étrangers, notamment Paul Éluard ou Antonin Artaud.
En dehors de son œuvre poétique, Roberto Juarroz a publié divers essais sur la poésie, parmi lesquels on peut citer : Poésie et création, Dialogue avec Guillermo Boido ; Poésie et Réalité ; Poésie, littérature et herméneutique Conversations avec Teresita Saguí. Ses reflexions sur la poésie étaient d'une telle cohérence qu'il semblait parfois difficile de l'écarter de son discours.
Entre 1971 et 1984, il a été directeur du Département de Bibliothécologie et de Documentation à l’Université de Buenos Aires.
Contraint à l’exil sous le régime de Perón, il fut pendant quelques années expert de l’Unesco dans une dizaine de pays de l’Amérique latine.
En janvier 1991, les Rencontres des Écritures Croisées, organisées chaque année à Aix-en-Provence, ont rendu hommage à Roberto Juarroz, qui a profité de sa venue en France pour faire des lectures de ses poèmes au Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou à Paris, et à la Villa Gillet à Lyon.
Son œuvre
La poésie de Roberto Juarroz constitue une experience créatrice unique dans le domaine de la poésie moderne en langue espagnole.
Pour saisir la vision poétique particulière de Roberto Juarroz, il faut avoir à l’esprit une démarche proche de celle du poète romantique allemand Novalis 1772-1801, dont l'éducation religieuse stricte traverse l'œuvre et pour lequel la poésie est l’absolu réel, qui existe indépendamment de toutes conditions. Novalis unit le mysticisme à une explication allégorique de la nature. Chez Roberto Juarroz il n’y a pas d’approche théologique mais plutôt une démarche métaphysique, c’est-à-dire une approche transpoétique de l’être en tant qu’être placé dans un infini sans nom.
L'œuvre de Roberto Juarroz répond à « une sorte de loi de la gravité paradoxale », selon sa propre expression. Il explique que très tôt dans sa vie, il a eu le sentiment qu’il y avait en l’homme une tendance inévitable vers la chute. L’homme doit tomber. Et l’on doit accepter cette idée presque insupportable, l’idée de l’échec, dans un monde voué au culte du succès. Mais, symétriquement de la chute, il y a dans l’homme un élan vers le haut. La pensée, le langage, l’amour, toute création participent de cet élan. Il y a donc un double mouvement de chute et d’élévation dans l’homme. Entre ces deux mouvements, fait-il remarquer, il y a une dimension verticale. La poésie qui l’intéresse possède l'audace pour atteindre ce lieu où se produit le double mouvement vertical de chute et d’élévation. Parfois on oublie l’une des deux dimensions. Ses poèmes tentent de rendre compte de cette contradiction vitale. Le poème agit comme un temps d'une autre dimension, un temps vertical. C’est pourquoi, ajoute-t-il, Gaston Bachelard a écrit que le temps de la poésie est un temps vertical.
Silvia Baron Supervielle, à propos du style de Roberto Juarroz, fait remarquer, dans un article de la La Quinzaine littéraire 1er-15 avril 1993, publié après la parution des Douzième poésie verticale et Treizième poésie verticale, que chez Juarroz « de même qu’ils s’énoncent lentement, avec force, comme si les syllabes qui les composent s’eussent prolongées à l’intérieur d’elles-mêmes pas à pas, comme ceux du pèlerin rythmés de son bâton, les mots montrent le haut et le bas, le recto et le verso, la lumière et l’obscurité de chaque chose.
Roberto Juarroz précise que la poésie est une méditation transcendantale du langage, une vie non fossilisée ou défossilisée du langage.
La poésie, affirmait-il, est une tentative risquée et visionnaire d’accéder à un espace qui a toujours préoccupé et angoissé l’homme : l’espace de l’impossible qui parfois semble aussi l’espace de l’indicible.
Roberto Juarroz était un poète qui aura été salué par les plus importants de ses pairs : René Char, Vicente Aleixandre, Octavio Paz, Julio Cortázar, Philippe Jaccottet, entre autres… Pour Octavio Paz, « chaque poème de Roberto Juarroz est une surprenante cristallisation verbale : le langage réduit à une goutte de lumière, et il ajoute que Juarroz est un grand poète des instants absolus. Et Julio Cortázar affirme que les poèmes de Juarroz lui paraissent les plus hauts et les plus profonds l'un pour l'autre évidemment qui aient été écrits en espagnol ces dernières années. Et Antonio Porchia conclut, avec sa vision pénétrante que « dans ces poèmes chaque mot pourrait être le dernier, depuis le premier. Et cependant le dernier suit.
Traducteur de plusieurs poètes et écrivains français, et notamment d'Antonin Artaud, Roberto Juarroz dirige la revue Poesía-Poesía entre 1958 et 1965. À partir de 1958, il attribue à toutes ses œuvres un titre unique et énigmatique, Poésie verticale, les volumes se distinguant par leur seul numéro d'ordre. Nul titre non plus à ses poèmes, où la parole poétique prend naissance dans le sans-nom. De son œuvre, aujourd'hui largement traduite en français, principalement par Roger Munier et Fernand Verbesen, on se souviendra de Poésie verticale, Quinze Poèmes, Nouvelle Poésie verticale, Neuvième Poésie verticale, Fragments verticaux
Reconnu comme une des grandes voix poétiques de ce siècle par des écrivains de l'envergure de René Char, Julio Cortázar ou Octavio Paz, l'Argentin Roberto Juarroz, né à Coronel Dorrego province de Buenos Aires, a professé, tout au long de sa vie, une modestie et une discrétion qui ont parfois nui à la diffusion et à la reconnaissance de son œuvre. Sur le plan personnel, il y a très peu à dire d'un homme qui s'est toujours retranché derrière ses poèmes. Dans une interview de 1980, il déclarait que, ce qui est intéressant, c'est beaucoup moins les liens entre la poésie et la biographie que ceux qui unissent poésie et vie intérieure
En 1958, Juarroz publie son premier livre, intitulé Poésie verticale. Douze autres volumes suivront le dernier est paru en 1994, portant tous le même titre, avec pour seule variante un adjectif ordinal. Cette verticalité constamment affirmée illustre la volonté du poète de descendre au fond des choses ou de se hisser au cœur de la transcendance. Cette démarche, comme celle de Paz, est destinée à faire tomber les masques de nos habitudes les plus routinières, de nos mensonges les plus mesquins ou d'un langage dévoyé, afin de nous confronter à certaines réalités inéluctables : la mort, le doute sur le sens de l'existence, le vertige du vide, l'appel du sacré, la tenaille du souvenir et de l'oubli. D'où l'extrême dépouillement de l'expression poétique de Juarroz et aussi les multiples occurrences, dans ses poèmes, de néologismes précédés du préfixe dé : dénaître ,démourir, dévivre , se dénéantiser .
Une autre grande préoccupation est la double recherche des limites. Je me consacre aux marges de l'homme, Treizième Poésie verticale, 1994, mais aussi d'un centre, défini dès le premier livre comme ce lieu où commence l'autre côté . C'est dans la perte de lui-même que le poète se découvre et finit par percevoir un rythme secret et solitaire : J'ai atteint mes incertitudes définitives. Ici commence ce territoire où il est possible de brûler toutes les issues et de créer son propre abîme, afin d'y disparaître.
Inlassablement, Juarroz reprend sa quête et le redoublement, la réitération, l'anaphore sont au cœur même de sa création. Ici, toute chose renvoie à autre chose .... Peut-être tout renvoie-t-il à un centre ? ... Mais tout centre renvoie vers son extérieur Sixième Poésie verticale.
Juarroz, comme l'a noté Roger Munier, élabore de recueil en recueil une odyssée de l'absence , où la poésie apparaît comme génératrice, sinon de vérité, du moins de présence . Ses poèmes sont parcourus par une sorte de frisson, d'angoisse sourde, mais aussi d'émotion la poésie sera toujours proche de l'amour, qui en bannissent la froideur qu'on a parfois cru y déceler : Il n'y a pas de poésie sans silence et sans solitude. Mais la poésie est également la forme la plus pure pour dépasser le silence et la solitude.
L'œuvre de Roberto Juarroz été traduite en une vingtaine de langues étrangères.
Œuvres Poésies
Poesía Vertical, Buenos Aires, Equis, 1958.
Segunda Poesía Vertical, Buenos Aires, Equis, 1963.
Tercera Poesía Vertical, Préface de Julio Cortázar, Buenos Aires, Equis, 1965.
Cuarta Poesía Vertical, Buenos Aires, Aditor, 1969.
Quinta Poesía Vertical, Buenos Aires, Equis, 1974.
Poesía Vertical anthologie, Barcelona, Barral, 1974.
Poesía Vertical 1958-1975, incluant Sexta Poesía Vertical, Caracas, Monte Avila, 1976.
Poesía Vertical, Anthologie, Préface de Roger Munier, Buenos Aires, Carlos Lohlé, 1978.
Poesía Vertical : Nuevos poemas, Buenos Aires, Mano de obra, 1981.
Séptima Poesía Vertical, Caracas, Monte Avila, 1982.
Octava Poesía Vertical, Buenos Aires, Carlos Lohlé, 1984.
Novena Poesía Vertical - Décima Poesía Vertical, Buenos Aires, Carlos Lholé, 1987.
Novena Poesía Vertical, Mexico, Papeles Privados, 1987.
Poesía Vertical : Antología incompleta. Préface de Louis Bourne, Madrid, Playor, 1987.
Undécima Poesía Vertical, Buenos Aires, Carlos Lohlé, 1988.
Undécima Poesía Vertical, Valencia, Pretextos, 1988.
Poesía Vertical, 1958-1975, Mexico, Universidad Nacional Autónoma, 1988.
Duodécima Poesía Vertical, Buenos Aires, Carlos Lohlé, 1991.
Poesía Vertical Anthologie, Préface et choix de Francisco J. Cruz Pérez. Madrid, Visor, 1991.
Poesía Vertical 1958-1982, Buenos Aires, Emecé, 1993.
Poesía Vertical 1983-1993, Buenos Aires, Emecé, 1993.
Essais
Poesía y creación, Conversations avec Guillermo Boido, Buenos Aires, Carlos Lohlé, 1980.
Poesía y realidad, Discurso de incorporación, Buenos Aires, Academia Argentina de Letras, 1987.
Poesía y Iiteratura y hermenéutica, Conversaciones con Teresa Sagui, Mendoza, CADEI, 1987.
Poesía y realidad, Valencia, Pre-Textos, 1992.
Quelques poèmes
Y aura-t-il un rythme dans la mort,
au moins un rythme ?
Peut-il y avoir quelque chose sans rythme ?
Toute l’énigme, sans doute,
consiste à le trouver.
Nous pouvons commencer
par le silence .
Roberto Juarroz, Quinzième poésie verticale, traduction de Jacques Ancet, José Corti 2002
On frappe à la porte.
Mais les coups résonnent au revers,
Comme si quelqu’un frappait de l’intérieur.
Serait-ce moi qui frappe ?
Peut-être les coups de l’intérieur
Veulent-ils couvrir ceux de l’extérieur ?
Ou bien la porte elle-même
a-t-elle appris à être le coup
pour abolir les différences ?
Ce qui importe est que l’on ne distingue plus
frapper d’un côté
et frapper de l’autre .
Roberto Juarroz, Onzième Poésie Verticale, éditions Lettres vives, collection Terre de poésie, page 6.
Ils étaient pour un autre monde
Tout dialogue, rompu.
Tout amour, rapiécé.
Tout jeu, marqué.
Toute beauté, tronquée.
Comment sont-ils arrivés jusqu’ici ?
Tout dialogue, verbe.
Tout amour, sans pronoms.
Tout jeu, sans règles
Toute beauté, offrande.
Il y a sans doute une faille
dans l’administration de l’univers
Des créatures erronées ?
Des mondes égarés ?
Des dieux irresponsables ?
Ils étaient pour un autre monde .
Roberto Juarroz, Quatorzième poésie verticale, édition bilingue, traduction de Silvia Baron Supervielle, José Corti 1997, p. 35
Citations
-La nudité est antérieure au corps, et le corps quelquefois s'en souvient .Roberto Juarroz.
-Le sommeil est un amour perdu. Roberto Juarroz
-Le rêve possède en son fond une bobine encapsulée où il conserve avec une étrange précaution un repli avec le fil qui l'unit à la veille ». (Roberto Juarroz, 11e poème vertical.
"Tout communique avec quelque chose ... Absolument isolé, / un zéro n'existerait même pas."
Anthologies
On trouve des poèmes de Roberto Juarroz dans les revues et ouvrages :
Les Cahiers du Sud, no 356, 1960 ;
Le Journal des poètes no 3, trois poèmes extraits de Poesía Vertical 1958, traduction de Fernand Verhesen, Bruxelles, mars 1962./ no 4, 1966 / no 5, 1970 / no 8, 1972 / no 5-6, 1989 ;
Tel Quel, no 10, (huit poèmes, traduction de Roger Caillois, Paris, Été 1962 ;
Poésie vivante en Argentine, Le Cormier, 1962 ;
Rencontre, no 160, 1967 ;
Asphalte, no 3, 1967 ;
Dire, no 6, 1968 ;
Clefs pour le spectacle, no 9, 1971 ;
Marginales, no 144-145, Bruxelles, 1972 ;
America libre, Seghers, 1976 ;
Anthologie de la poésie latino-américaine contemporaine, Publisud, 1983 ;
Question de, « Poésie-L'alphabet de lumière », traduction de Roger Munier, Paris, 1984 ;
Nulle part, no 5, La poésie, la poésie, la réalité, traduction de Fernand Verhesen, éditions Les Cahiers des Brisants, Mont-de-Marsan, 1985 ;
Poésie 85, no 6, 1985
Poésie 90, no 35, 1990 ;
Poésie, no 34, dix poèmes extraits de Neuvième Poésie Verticale, traduction de Roger Munier, Paris, 1985, en bilingue ;
Recueil, cinq poèmes, traduction de Roger Munier, Paris, 1986, en bilingue;
Europe, no 690, 1986 ;
Nouvelle revue française, no 420, douze poèmes, traduction de Roger Munier, 1988 / no 460, 1991 ;
Phréatique, langage et création, deux poèmes manuscrites et entretien avec Ilke Angela Maréchal: Roberto Juarroz ou la vision du troisième terme, no 58-59, 1991;
L'Autre, no 1, 1990 / no 4, « Culture, poésie et écologie ». Traduction par l'auteur et Michel Camus, Paris, 1992 ;
Sud, onze poèmes, traduction de Roger Munier, présentation de Salah Stétié, Marseille, 1992 ;
Poésie argentine du xxe siècle, Patiño, 1996.
Bibliographie
Spirale Inkari no 7, s.d. : Roberto Juarroz Entretiens et poèmes de Roberto Juarroz, textes de Michel Camus, Jean-Louis Giovannoni et Roger Munier.
Michel Camus, Roberto Juarroz - Mais au centre du vide il y a une autre fête. Critique et interprétation , suivi d'un choix de textes de Roberto Juarroz, et d'une bibliographie. Paris, Éditions Jean-Michel Place, Poésie , 2001, 128 p.,
Martine Broda, Pour Roberto Juarroz. Paris, Éditions José Corti, En lisant, en écrivant, 2002, 112 p.
Ilke Angela Maréchal, La vision qui crée ce qu'elle voit , entretien, in Sciences et imaginaire, Albin Michel/Cité de la Science et de l'Industrie, 1994,
Ilke Angela Maréchal Une dernière heure avec Roberto Juarroz, entretien, in Revue Phréatique no 73
Prix
1984 Prix de la Fondation Argentina para la Poesía
1984 Premio Esteban Echeverría
1992 Prix Jean Malrieu, Marseille
1992 Prix de la Biennale Internationale de Poesie, Liège
1994 Grand Prix d'honneur de l'union des écrivains argentin
Vertige vertical
Vertige Vertical est un spectacle conçu d'après des textes de Roberto Juarroz, créé en France, qui a reçu le Label « Sélection Printemps des Poètes
Il s'agit de poèmes choisis dans la Poésie verticale de Roberto Juarroz, interprétés par deux comédiennes, Pascale Chemin et Cécile Magnet. Nicolas Judéléwicz a composé une musique originale à couleur électronique. C'est un voyage au cœur d'une réflexion poétique sur l'homme et l'univers.
Ce voyage électro-poétique dure une heure. Il mélange les voix en direct des comédiennes en français et celle pré-enregistrée de Roberto Juarroz, en espagnol et en français retrouvée dans les archives de la phonothèque de l’INA.
Vertige Vertical a été joué à plusieurs reprises en 2004 à Paris et a été diffusé sur France Culture pendant tout le mois d'août 2004, par petits modules, dans le cadre de la grille de programme de l'été.
En 2005, L'Orangerie de Cachan a organisé quatre concerts de Vertige Vertical, autour de l'exposition du plasticien argentin Julio Le Parc
Liens
http://youtu.be/_FjVNkZjQMM La Sibéria
http://youtu.be/9P6g_0BVeoY Présentation de Juarroz (espagnol)
.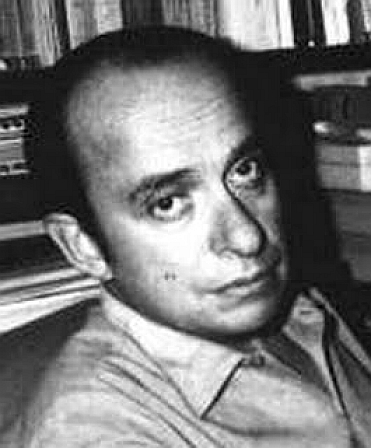 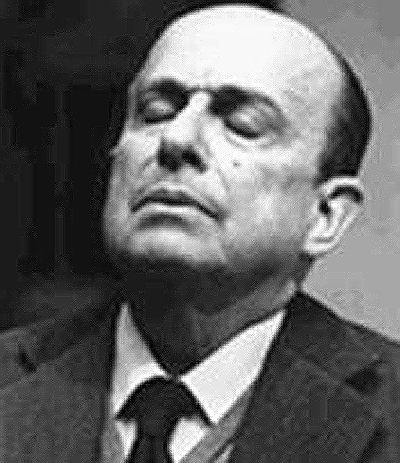 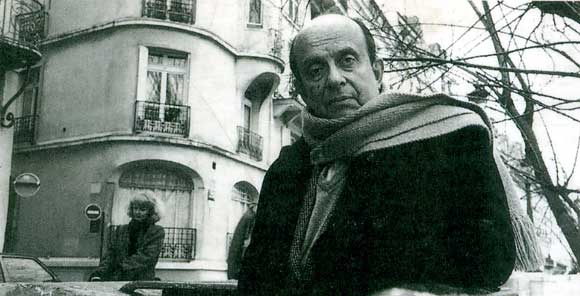    [img width=600]http://content.lsf.com.ar/getcover.ashx?ISBN=9789500427241&size=3&coverNumber=1[/img] [img width=600]http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTSa0DMmZdHW8VT5T36VVtGXbOgshKvs_y-72uXx1W00FSj17H5FPH6HeFy[/img] 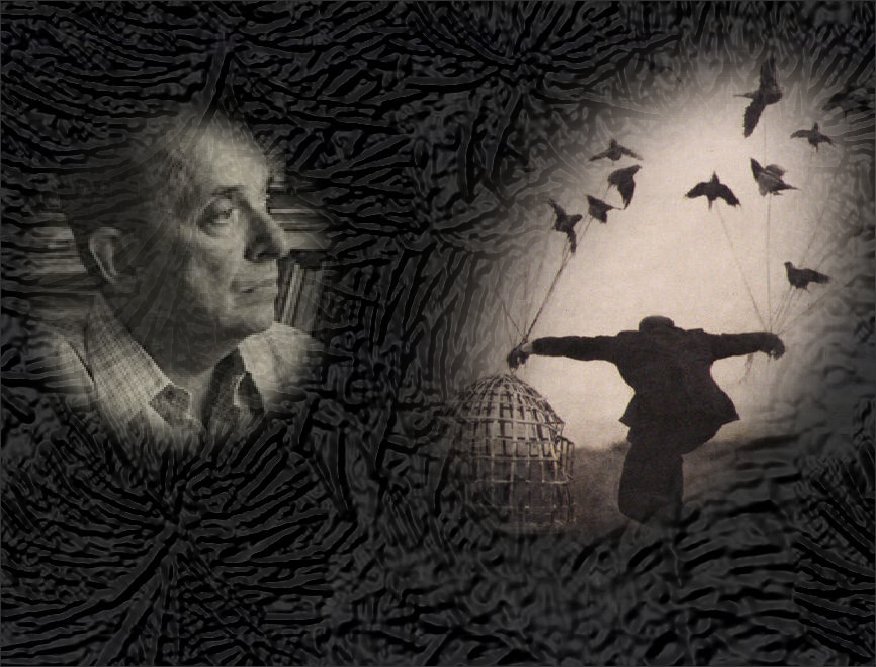 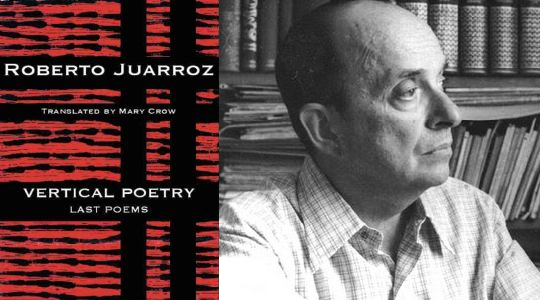 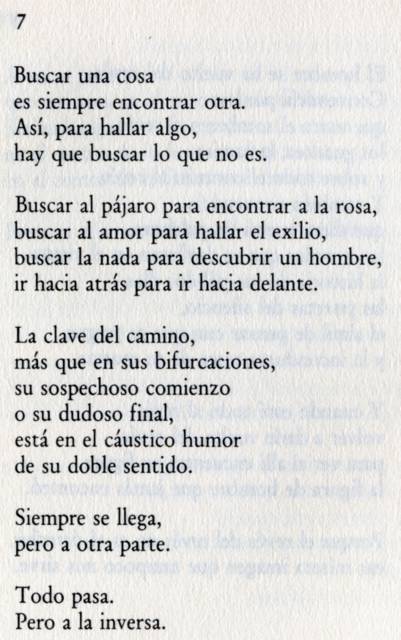 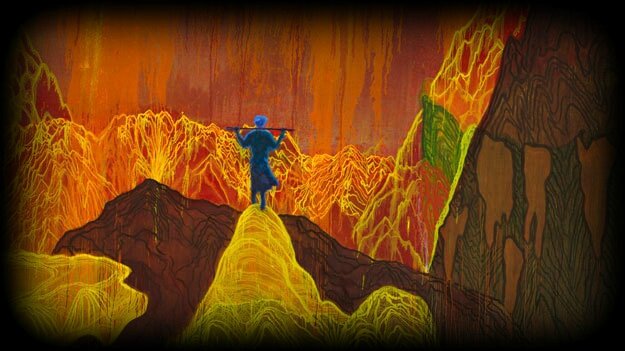 
Posté le : 04/10/2014 14:31
Edité par Loriane sur 05-10-2014 21:59:09
Edité par Loriane sur 05-10-2014 22:01:29
|
|
|
|
|
Philippe III le hardi |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 5 octobre 1285 à Perpignan, royaume de Majorque meurt, à 40 ans,
Philippe III le Hardi
dit Philippe le Hardi, né le 1er mai 1245 à Poissy, roi de France de 1270 à 1285, soit durant 15 ans, 1 mois et 10 jours, il est Couronné le 15 août 1271, en la cathédrale de Reims, son prédécesseur est Louis IX, son successeur est Philippe IV, lle est dixième de la dynastie dite des Capétiens directs. Il était le fils de Louis IX 1214-1270, dit Saint Louis, roi de France, et de Marguerite de Provence, il épouse
Isabelle d'Aragon 1262-1271, puis Marie de Brabant 1274-1285, il a pour enfants Louis de France, Philippe IV , Robert de France, Charles de France, Louis de France, Marguerite de France et Blanche de France, il a pour héritier Louis de France 1270-1276 et Philippe de France 1276-1285
En bref
Fils de Saint Louis et de Marguerite de Provence, Philippe III le Hardi a le malheur de succéder à un roi prestigieux et d'être finalement mal connu. Sa statue à Saint-Denis — image d'un roi vigoureux — ne correspond pas au portrait que tracent ses biographes : pieux, peu lettré, il aurait été le jouet de son entourage. En fait, les progrès de l'État sont tels que le roi a besoin de conseillers d'une autre trempe que ceux dont s'accommodait la royauté patriarcale. Leur activité fait douter du pouvoir réel du roi. Des noms sortent de l'ombre : Mathieu de Vendôme, abbé de Saint-Denis, et surtout Pierre de la Broce, ancien chirurgien et valet de chambre de Louis IX, parvenu au sommet des honneurs et de la fortune par la faveur de Philippe le Hardi. Bientôt, une violente cabale se déchaîne contre le favori ; elle n'hésite pas à utiliser les procédés les plus diffamatoires et parvient à le conduire au gibet 1278. Elle est menée par le cercle aristocratique de la jeune et jolie Marie de Brabant épouse du roi en 1274 après la mort d'Isabelle d'Aragon, où se fait remarquer Charles d'Anjou, image type du chevalier conquérant. Entre les grands soucieux de conserver leurs privilèges, mais divisés en deux clans — celui de la reine en faveur des Angevins et celui de la reine-mère en faveur des Anglais —, et les avis de prudence des conseillers inquiets des problèmes financiers que pose à la royauté la hausse accélérée des prix et des dépenses, le roi hésite. L'annexion du Midi languedocien à la mort d'Alphonse de Poitiers 1271 se réalise sans grosses difficultés ; seul le comte de Foix résiste. Il cède le comtat Venaissin au pape Grégoire X en 1274 et le roi d'Angleterre reçoit l'Agenais en 1279. Cependant, Charles d'Anjou, le pape Martin IV et les barons consultés entraînent le roi dans la première guerre de conquête hors du royaume : la croisade en Aragon. C'est un échec Girone, 1285. Philippe III meurt à Perpignan, victime d'une épidémie.
Sa vie
Cadet de famille, le prince Philippe n'était pas destiné à régner sur un royaume. C'est à la mort de son frère aîné Louis en 1260 qu'il devient le prince héritier. Il a alors quinze ans et présente beaucoup moins d'aptitudes que son frère, étant de caractère doux, soumis, timide et versatile, presque écrasé par les fortes personnalités de ses parents.
Sa mère Marguerite lui fait promettre de rester sous sa tutelle jusqu'à l'âge de trente ans, mais son père le roi Saint Louis fait casser le serment par le pape, préférant bonifier son fils par une éducation sans faille. C'est ainsi que le pape Urbain IV relève Philippe de son serment le 6 juin 1263. À cet effet, il lui adjoint à partir de 1268 pour mentor Pierre de La Brosse. Saint Louis se charge en outre de lui prodiguer ses propres conseils, rédigeant en particulier ses Enseignements, qui inculquent avant tout la notion de justice comme premier devoir de roi. Il reçut également une éducation très tournée vers la foi. Guillaume d'Ercuis était en outre son aumônier, avant d'être le précepteur de son fils, le futur roi Philippe IV.
Un avènement dans la douleur
Dans la mouvance du traité de Corbeil, conclu le 11 mars 1258 entre Jacques Ier d'Aragon et son père, Philippe fut marié en 1262 à Isabelle d'Aragon à Clermont par l’archevêque de Rouen Eudes Rigaud. Il en eut quatre garçons : Louis 1264-1276, Philippe, Robert, 1269-av. 1276 et Charles, ainsi qu'un fils mort-né fin janvier 1271. En 1270, il accompagne son père à la huitième croisade, à Tunis. Peu avant son départ, Saint Louis avait remis la régence du royaume entre les mains de Mathieu de Vendôme et Simon II de Clermont-Nesle, comte de Clermont, auxquels il avait en outre confié le sceau royal. Après la prise de Carthage, l'armée est frappée par une épidémie de dysenterie, qui n'épargne ni Philippe, ni sa famille. Son frère Jean Tristan meurt le premier le 3 août, puis, le 25, vers 15 heures, le roi Louis succombe à son tour. Pour empêcher la putréfaction de la dépouille du souverain, on a recours au mos Teutonicus.
Philippe est donc proclamé roi sous le nom de Philippe III à Tunis. Sans grande personnalité ni volonté, très pieux, mais bon cavalier, il doit davantage son surnom de Hardi à sa vaillance au combat qu'à sa force de caractère. Il se révèle incapable de commander aux troupes, affecté qu'il est de la mort de son père. Il laisse son oncle Charles Ier d'Anjou négocier avec Abû `Abd Allah Muhammad al-Mustansir, sultan hafside de Tunis, et conclure une trêve de dix ans qui lui permet de revenir en France. Ce dernier obtient le versement d'un tribut du calife de Tunis en échange du départ des croisés. Un traité fut conclu le 28 octobre 1270 entre les rois de France, de Sicile, de Navarre et leurs barons d'une part ; le calife de Tunis de l'autre.
D'autres morts endeuillent encore cette débâcle. En décembre, à Trapani, en Sicile, le beau-frère de Philippe, le roi de Navarre Thibaut de Champagne trouve la mort. À Trapani, son épouse, la sœur du souverain, Isabelle de France, rejoint inopinément son mari dans la mort[Quoi ?]12. Enfin, un mois plus tard, en Calabre, l'épouse du souverain, Isabelle d'Aragon, alors enceinte de son cinquième enfant, fait une malheureuse chute de cheval. Elle se brise la colonne vertébrale, fait une fausse-couche et meurt dans d'affreuses douleurs à Cosenza.
Philippe III arrive à Paris le 21 mai 1271, et rend avant tout hommage aux victimes, qui furent bien sûr nombreuses aussi parmi les soldats. Dès le lendemain ont lieu les funérailles de son père. Le nouveau souverain est sacré roi de France à Reims le 15 août 12711.
Un règne charnière
L'avènement de Philippe III s'accompagne rapidement d'un bouleversement dans le paysage politique : la mort du roi d'Angleterre Henri III et la fin d'une vacance du trône impérial longue de 19 ans. En outre, la préoccupation de l'Europe n'est plus aux croisades. Ainsi, alors que celles-ci avaient été des composantes majeures du règne de son père, le sien sera surtout marqué par des conflits territoriaux, des contestations d'héritages et des guerres de vassalité, phénomène qui va encore s'accentuer pendant le règne de son fils.
Conservant la plupart des conseillers de son père, ainsi que Eustache de Beaumarchès, sénéchal de Poitou, de Toulouse et d'Auvergne, Philippe III a pour grand chambellan Pierre de La Brosse qu'il fait pendre en 1278.
Politique intérieure
Par des héritages, annexions, achats, unions, et guerres, Philippe III s'attache sans cesse à agrandir le domaine royal et y affermir son autorité.
En 1271-1272, il opère sa première transaction territoriale en incorporant au domaine royal l'héritage de son oncle Alphonse de Poitiers : le comté de Toulouse, le Poitou et une partie de l'Auvergne. Par le traité d'Amiens de 1279, il est cependant contraint de céder l'Agenais, la Saintonge et le Ponthieu au roi d'Angleterre Édouard Ier. Il hérite également du comté du Perche et du comté d'Alençon de son frère Pierre décédé en 1283.
Donation de Philippe III le hardi à son écuyer Herlier de Montmartre en 1285.
Il a l'occasion de faire ses premiers faits d'armes personnels en 1272, quand il convoque l’ost royal contre les comtes de Foix et d'Armagnac qui lui contestent son pouvoir. Armagnac se rend, et Foix, battu, est emprisonné. Il lui restitue cependant ses terres en 1277. Il achète également les comtés de Nemours et de Chartres en 1274 et 1284. Il acquiert aussi diverses villes, telles Harfleur ou Montmorillon. Il retire également au roi de Majorque l'autorité sur Montpellier. En revanche, il cède au pape Grégoire X le comtat Venaissin en 1274.
Il mène une politique matrimoniale efficace, étant l'instigateur du mariage de sa cousine Mahaut d'Artois avec le comte Othon IV de Bourgogne, préparant ainsi le rapprochement de cette région, terre impériale, l'actuelle Franche-Comté, avec le royaume. Il intervient aussi en Navarre après la mort d'Henri Ier de Navarre qui laisse une fille Jeanne sous la tutelle de sa mère Blanche d'Artois et de Ferdinand de la Cerda. Blanche d'Artois fiance Jeanne au fils de Philippe, le futur Philippe le Bel. La Champagne et la Navarre sont administrées par les Français de par le traité d'Orléans de 1275, et la Champagne est définitivement rattachée au domaine en 1314. Le mariage a finalement lieu en 1284.
Du point de vue des institutions, Philippe III introduit plusieurs nouveautés. Il fixe la majorité des rois de France à quatorze ans. Il affermit la justice royale au détriment des justices seigneuriales, instituant un tribunal royal dans chaque bailliage ou sénéchaussée. Il frappe d’amendes les nobles ne répondant pas à la convocation à l'ost royal. Il crée un impôt sur les transmissions de fiefs. Enfin, il institutionnalise la ségrégation envers les juifs.
Politique extérieure
Gisant de Philippe III à Saint-Denis
En Castille, après la mort de son beau-frère Ferdinand de la Cerda en 1275, Philippe III prend sans succès le parti des enfants de celui-ci contre Don Sanche, désigné successeur par le roi Alphonse X.
En Italie, il soutient le pape Martin IV contre les gibelins, faisant une expédition punitive en Romagne. Il soutient également la politique sicilienne de son oncle Charles d'Anjou, après les massacres des Vêpres siciliennes en 1282. Pierre III d'Aragon, considéré comme l'instigateur du massacre, est excommunié par le pape qui lui enlève son royaume et le donne à Charles de Valois, lequel ne peut le conserver.
En 1285, après l'affaire de Sicile, Philippe III, sans son oncle Charles d'Anjou mort en début d'année, engage la croisade d'Aragon et attaque sans succès la Catalogne siège de Gérone du 26 juin au 7 septembre 1285. Son armée touchée par une épidémie de dysenterie, il est défait en septembre à la bataille des Formigues, et est obligé de faire retraite. Celle-ci est désastreuse, l'armée française est à nouveau défaite le 1er octobre à la bataille du col de Panissars, et lui-même meurt à Perpignan le 5 octobre 1285.
Mort loin de la capitale, se pose la question du traitement de son corps, la technique de l'embaumement antique ayant été perdue. La putréfaction du cadavre est alors limitée par l'éviscération et la technique funéraire du mos Teutonicus. Il est le premier roi de France à disposer de la tripartition du corps delaceratio corporis, division du corps en cœur, entrailles et ossements. Concernant le corps de Philippe III, il sera en fait divisé en quatre parties : ses chairs sont envoyées à la cathédrale de Narbonne et ses entrailles à l'abbaye de la Noë en Normandie, ses os rejoignant la nécropole royale de Saint-Denis, son cœur étant confié à son confesseur dominicain qui l'offre aux Jacobins de Paris16. Cette pratique de sépultures multiples, pourtant interdite par une décrétale du pape Boniface VIII en 1299, est reprise ensuite par les rois puis les reines et les proches de la dynastie capétienne car elle permet la multiplication des cérémonies funérailles du corps, la plus importante, puis funérailles du cœur et funérailles des entrailles et des lieux où honorer le roi défunt.
Pierre d'Aragon mourant un mois plus tard, Gérone se livre à son successeur, et le nouveau roi de France, Philippe IV le Bel décide le retour en France.
Unions et descendane
Le 28 mai 1262 à Clermont-Ferrand, il épouse en premières noces Isabelle d'Aragon (1247-1271), fille du roi Jacques Ier d'Aragon. Ayant accompagné le roi à la Huitième croisade, elle meurt tragiquement d'une chute de cheval, en Calabre, sur le chemin du retour, alors enceinte de son 5e enfant.
De cette union sont issus :
Louis 1264-1276, prince héritier du 25 août 1270 à sa mort ;
Philippe IV 1268-1314, dit Philippe le Bel, roi de France ;
Robert 1269-av. 1276 ;
Charles de France 1270-1325, comte de Valois .
De son mariage avec Marguerite d'Anjou 1273-1299 est issu Philippe de Valois, 1293-1350 futur roi de France en 1328 sous le nom de Philippe VI de France. Il est l'auteur de la Dynastie de Valois.
Le 21 août 1274 à Vincennes, Philippe III épouse en secondes noces Marie de Brabant 1254-1321, fille de Henri III, duc de Brabant, et d'Adélaïde de Bourgogne.
De cette union sont issus :
Louis de France 1276-1319, comte d'Évreux ;
Marguerite de France, épouse en 1299 Édouard Ier, roi d'Angleterre ;
Blanche de France 1278-1306, épouse en 1300 Rodolphe III, duc d'Autriche - postérité éteinte.
Liens
http://youtu.be/pdRWqahfdGE La guerre de 100 ans
http://youtu.be/ETUkY9d8dtA Les capétiens
       [img width=600]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHdNkB89MkBpHXUsZ045gmydSS7_7jvEVfg3b-WryotB1XsehwVdaP7uT33w[/img] [img width=600]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSIPfmdnHcsc4tUab2CYWncPt3_vDVu5AzHE0JurlMVrbnVTSYf4ckAG5UocQ[/img] 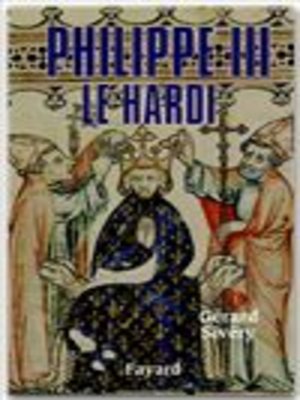 -
Posté le : 04/10/2014 14:05
Edité par Loriane sur 05-10-2014 00:29:02
Edité par Loriane sur 05-10-2014 23:32:57
Edité par Loriane sur 05-10-2014 23:35:05
|
|
|
|
|
Bernard Clavel |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 5 octobre 2010, à La Motte-Servolex à 87 ans meurt Bernard Clavel,
inhumé à Fontenay, né le 29 mai 1923 à Lons-le-Saunier, écrivain français principalement connu pour ses romans, mais qui s'est aussi adonné à l'écriture d'essais, de poèmes et de nombreux contes pour la jeunesse. Genres, romans, sagas,
poèmes et de nombreux contes pour la jeunesse. Genres, romans, sagas,
livres pour la jeunesse, il reçoit pour distinctions, le Prix Goncourt en 1968 Académie Goncourt 1971-1977, ses Œuvres principales sont Pirates du Rhône, Malataverne, Le Seigneur du fleuve, Cargo pour l'enfer, Les Roses dine Verdun, Le Carcajou, Le Soleil des morts, Le Cavalier du Baïkal, ses Contes et nouvelles, Les Légendes
Récits et essais, et Droits de l'homme, il s'engagement dans la Résistance, il est membre d'associations de non-violence, de La Coordination française pour la Décennie Non-Violence XXI.
Son premier roman L'Ouvrier de la nuit, publié en 1956, marque le début d'une production importante de près d'une centaine de titres avec des œuvres pour la jeunesse et de très nombreux romans, parfois constitués en sagas qui ont rencontré un vaste public comme La Grande Patience 4 volumes – 1962/1968, Les Colonnes du ciel, 5 volumes - 1976/1981 et Le Royaume du Nord, 6 volumes 1983/1989.
Associant l'enracinement régional, la Franche-Comté, Lyon et le Rhône, le Québec… et l'évocation historique conquête de la Franche-Comté au XVIIe siècle, la vie des canuts et des mariniers du Rhône au XIX e siècle, la guerre de 1914-1918, l'implantation française au Canada…, Bernard Clavel montre une constante attention aux humbles et défend des valeurs humanistes en contant des destins individuels et collectifs, souvent confrontés au malheur. Son sens de la nature et de l'humain, sa mise en question de la violence et de la guerre et son souci de réalisme ont fait de lui un écrivain récompensé par de nombreux prix dont le prix Goncourt pour Les Fruits de l'hiver en 1968.
En bref
Plus de vingt romans, de nombreux contes pour enfants et une quinzaine d'essais, récits, nouvelles, constituent aujourd'hui, l'œuvre de Bernard Clavel, sans nul doute l'un de nos écrivains les plus prolixes.
Sa vie, belle et mouvementée, il l'a racontée avec émotion dans La Grande Patience, série autobiographique de quatre volumes, La Maison des autres, 1962 ; Celui qui voulait voir la mer, 1963 ; Le Cœur des vivants, 1964 ; Les Fruits de l'hiver, 1968. Bernard Clavel naît à Lons-le-Saunier en 1923. Jusqu'en 1956, date où il publie son premier roman, L'Ouvrier de la nuit, que suivront bientôt Pirates du Rhône 1957 ou Malataverne 1960, il touche à divers métiers manuels, dont la pâtisserie. Treize années plus tard, Clavel se voit couronné par l'Académie Goncourt pour Les Fruits de l'hiver. En 1971, les Goncourt l'accueillent à leurs côtés. Mais il quitte l'Académie en 1976, arguant qu'il ne parvenait pas à lire chaque année les quelque deux cents romans publiés et pour dénoncer des procédés qu'il réprouve.
Jamais rien d'affecté ni d'artificiel dans la littérature clavélienne, qu'elle célèbre la Franche-Comté, Lyon et le Rhône, ou qu'elle se tourne vers l'évocation historique. Écrivain populaire – dans la meilleure acception du terme –, l'auteur du Silence des armes 1974 bannit les fioritures inutiles, combat l'égocentrisme intellectuel, pour se donner à corps perdu dans des livres simples, réalistes, fraternels. Dans Le Tambour du bief 1970, il dépeint la souffrance humaine, dans Le Seigneur du fleuve 1972, il s'irrite contre l'invasion terrifiante du modernisme, dans Qui m'emporte 1958, il se fait le chantre du retour justifié à la nature, aux sources vraies. Dans les cinq romans des Colonnes du ciel de La Saison des loups, 1976, aux Compagnons du Nouveau Monde, 1981, il transpose ses thèmes favoris au XVIIe siècle et ajoute à l'évocation des paysages francs-comtois et vaudois celle des forêts du Québec, un pays où il s'installera un temps et qui lui inspirera une autre suite romanesque, Le Royaume du Nord 1983-1989. Obstinément, Bernard Clavel dénonce les tueries et la haine. Il s'affirme chrétien en actes au même titre qu'écrivain. Peu d'hommes ont défendu avec autant de vigueur le pacifisme et la non-violence, décrié la peine de mort et les fascismes Le Massacre des innocents, 1970. Et son action concrète à Terre des Hommes fut un engagement sincère et lucide, tout comme le soutien qu'il apporta à Non-Violence XXI.
Dans Écrit sur la neige 1977, entretiens qu'il a réalisés avec Maurice Chavardès, Bernard Clavel évoque son enfance à Lons-le-Saulnier, son amour pour la peinture, la naissance de son pacifisme. Et il donne cette définition du roman : C'est une histoire qu'on raconte. C'est-à-dire une tranche de vie recréée et mise en forme. En un mot, c'est une œuvre d'art. Définition somme toute traditionnelle, mais qui montre pourtant à quel point ses livres sont faits pour être lus à haute voix, contes de veillées, histoires de jours et de nuits... Le cinéma et surtout la télévision ont puisé dans son œuvre maints sujets de films
Sa vie
Né dans une famille modeste, il devient apprenti pâtissier à 14 ans et se forme en autodidacte en exerçant différents métiers avant de devenir journaliste dans les années 1950.
Bernard Clavel, s'il est surtout connu comme romancier, a aussi écrit des Contes et nouvelles pour la jeunesse ainsi que de nombreux articles, préfaces et témoignages. Il passe aussi pour être un représentant de ce qu'on appelle le roman du terroir et tire son inspiration de sa vie et d'une observation aiguë du monde qui l'entoure. Il aime décrire les existences rudes et ses personnages évoluent souvent dans des milieux ruraux ou sauvages.
La Grande Patience est une fresque autobiographique dans laquelle il retrace son apprentissage sous la houlette d’un patron tyrannique et injuste. La Seconde Guerre mondiale bouleversera son existence. Dans le dernier ouvrage de cette série, il évoque de manière poignante la mort de ses parents.
La fresque Le Royaume du Nord est née d’une double passion : sa seconde femme Josette Pratte, écrivaine québécoise et le Québec, dont le climat et la géographie tourmentée servent à merveille son besoin de décors rudes et grandioses. Cette série relate la vie de pionniers canadiens qui peu à peu, tentent de s’approprier la terre du grand Nord canadien. Les Colonnes du ciel est une série dans laquelle il raconte la Franche-Comté aux prises avec la peste et la guerre. C'est un écrivain prolifique qui a écrit plus d’une centaine d’ouvrages pas tous disponibles malheureusement. Si ces grandes fresques ont marqué les esprits, il est aussi connu pour des romans tels que : L’Espagnol, Malataverne… ou des œuvres plus récentes comme Brutus ou La Retraite aux flambeaux.
Bernard Clavel est l'homme des émotions : celles qui réveillent les images de Dole, la dure réalité de l'apprenti-pâtissier, puis ses pérégrinations à travers la France pendant la guerre qu'il retrace dans La Grande Patience ; celles qui l'assaillent à Salins-les-Bains quand il prend conscience des horreurs de la guerre de Dix Ans dans son pays de Franche-Comté dont il raconte l'histoire dans Les Colonnes du ciel ; puis celles du Canada dans Le Royaume du Nord et ses pionniers aventureux dont il écrira dans la préface d'Harricana : Empruntant pour la première fois la route du nord au cours de l'hiver 1977-78, j'étais loin d'imaginer la place que ces terres allaient occuper en moi. Celles aussi que suscite sa rencontre avec l'homme de Terre des hommes qui lui fit si forte impression qu'il apparaît dans Les Colonnes du ciel à trois reprises sous les traits du père Boissy, d'Alexandre Blondel, le sauveur des enfants, et du père Delorimière. Il ressemble aussi à son personnage de L'Homme du Labrador qui vit ses rêves jusqu'à les faire partager par les autres et nous livre ainsi quelques clés sur la création romanesque.
Il s'inscrit dans les terroirs qui l'ont marqué, le Québecnotes 1 bien sûr et sa région natale de Franche-Comté mais aussi les pays du Rhône où il résida longtemps et écrivit ses premiers romans et y revint plus tard autour des années 2000 avec des romans comme La Table du roi ou Les Grands Malheurs.
Ses éléments, il le dit lui-même, ce sont la terre et l'eau : Je suis un homme de la terre, mais peut-être encore davantage un homme de l'eau. Le Saint-Laurent, l'Harricana après le Doubs, l'Ain et la Vallière m'ont marqué. À cette géographie sentimentale correspond une histoire sentimentale, d'abord l'histoire épique et romantique de la guerre racontée par les Anciens qui ont laissé en moi une trace profonde puis il eut cette chance de rencontrer d'autres hommes qui lui ont ouvert les yeux, car, écrit-il, nous avons besoin de bonté autant que de beauté. À ceux qui lui reprochaient de trop écrire, il répondait par cette citation de François Mauriac : Notre vie vaut ce qu’elle nous a coûté d’efforts.
Le fonds d'archives personnelles de Bernard Clavel et Josette Pratte est déposé et conservé auprès de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, BCU, en Suisse.
Bernard Clavel, qui êtes-vous ?
Il y a une résonance, une connivence entre ces deux ouvrages où Bernard Clavel égrène ses souvenirs et nous livre une partie de lui-même dans Les Petits Bonheurs et Bernard Clavel, qui êtes-vous, qui font l'objet de cette présentation. Évoquant des souvenirs, Bernard Clavel nous confie que ce sont des choses que l'on croit avoir oubliées, mais qui sommeillent en vous et ressortent quand quelqu'un s'avise de les aiguillonner.
Sa vocation d'écrivain transparaît, se dévoile quelque peu avec cette citation de Jean Guéhenno : Les impressions d'enfance marquent la couleur de l'âme, et son passé entre une mère conteuse-née et un père ressassant des souvenirs comme Henri Gueldry dans son roman Quand j'étais capitaine qu'on retrouve dans les tranchées creusées avec ses copains près du hangar. C'est lors d'un voyage à Lyon qu'il découvre le Rhône, qui va tant compter pour lui, certain que dès ce jour-là, le Rhône est entré en lui. Au cours de ses tournées, son père lui enseignait ce que Bernard Clavel nommera plus tard sa géographie sentimentale.
Son enfance est un pays de rêves, il plane en haut de l'arbre du jardin, suit avec passion les préparatifs de départ d'un voisin, Paul-Émile Victor, faisant des tours du monde imaginaires.
Mais le rêve de l'enfance s'éloigne brusquement avec La Maison des autres, roman largement autobiographique sur son apprentissage de pâtissier, dur apprentissage de la vie aussi pour cet adolescent pour qui la ville de Dole avait été liée au bonheur des repas de famille. Vision contrastée de cette ville qu'il décrira dans Le Tambour du bief avec le canal Charles-Quint et ses écluses. À travers une question sur le message que peut véhiculer un roman, c’est l’ouvrier de la nuit qui répond, celui qui déplore que les intellectuels ne soient pas considérés comme des travailleurs.
Après La Maison des autres, c’est le début de la guerre, chapitre qui commence par cette histoire de Voltaire : Le soldat tire à genoux, sans doute pour demander pardon de son crime. La guerre, vieille compagne, qui le hante dira-t-il en 2005, avec qui il a des comptes à régler : toujours la conviction que la guerre est dans le cœur de l’homme et qu’il faut opérer pour l’éradiquer, en passant comme il l’a fait, par une prise de conscience longue et douloureuse. De l’occupation, il retiendra surtout un grand amour malheureux et, dit-il, « j’ai passé l’essentiel de mon temps à poursuivre des chimères. C’est je crois, ce qui a rendu la vie si difficile à mes proches.
Il travaille d’arrache-pied et, comme un artisan têtu, remet constamment l’ouvrage sur son chevalet. Ainsi a-t-il traversé le temps de la guerre celui qui voulait voir la mer, part loin de chez lui, loin de ses parents, à la découverte de la France puis c’est à Castres que le cœur de vivants va vivre un grand amour. À l’héroïsme du soldat, il préfère le courage, celui qui consiste à savoir dire non au pouvoir lorsque ce pouvoir nous oblige à des actes condamnables. Credo pacifiste de celui qui a écrit Lettre à un képi blanc. Ses 'affinités électives' vont vers des pacifismes Romain Rolland, Jean Giono, Jean Guéhenno et Gilbert Cesbron, un frère pour moi. Puis ce fut Les Fruits de l’hiver, la disparition de ses parents, lui qui a été le déchirement de leurs dernières années.
Après la guerre, il se marie, vit le long du Rhône à Vernaison au sud de Lyon et peint plus qu’il écrit. Il côtoie les gens simples qui lui inspirent plusieurs romans comme Pirates du Rhône, ou La Guinguette et le Rhône, ce fleuve qui est aussi pour lui un 'personnage' qui peut être calme ou traitre, mais qui pique aussi de terribles colères comme dans La Révolte à deux sous ou Le Seigneur du fleuve. Peu à peu, il a délaissé la toile pour les mots.
Vernaison, la vie de famille, la société de sauvetage, son travail de salarié, la charge est énorme : le piège pour un écrivain. Bernard Clavel se qualifie lui-même de menteur-né, ne sachant vraiment plus la part de biographie dans son œuvre et cite Albert Camus : Les œuvres d’un homme retracent souvent l’histoire de ses nostalgies ou de ses tentations, presque jamais sa propre histoire.
Quand on lui parle du Rhône, le défenseur de la nature s’insurge contre les massacreurs de la nature qui, prédit-il, seront à long terme vaincus. Bernard Clavel connaissait bien 'le prix du temps', écrivant, une pièce radiophonique par semaine, un roman par an, des émissions sur les disques et les livres, des articles pour des revues comme Résonances… Telles sont ses 'années lyonnaises' de 1957 à 1964, quai Romain Rolland puis cours de la Liberté. Sa culture s’est forgée pendant ces années : Tout est dans le tempérament mais tout vient aussi des rencontres, de ce que la pratique des métiers et le côtoiement des êtres vous apportent.Être romancier, dit-il, c’est porter en soi un monde, et c’est vivre en ce monde beaucoup plus qu’en celui qui vous entoure. Malgré sa puissance de travail, Bernard Clavel plonge dans la dépression et il faudra l’intervention de son éditeur Robert Laffont pour qu’il arrive à tourner la page.
Le parc Bernard Clavel a été inauguré en octobre 2011 en bordure de Rhône sur la commune de Vernaison.
Rupture, l’éternel vagabond s’installe dans la région parisienne à Chelles de 1964 à 1969, puis à Brunoy. S’il reste fidèle au stylo plume et au papier, le cinéma s’intéresse à lui et achète les droits de Qui m’importe et de Le Voyage du père. Terrible déception. Il ne reconnaît rien de ses romans et préférera désormais les adaptations télévisées auxquelles il participe, et la première, L’Espagnol, réalisé en deux parties par Jean Prat et diffusé en 1967, est un gros succès. Parfois même, ses romans rejoignent la réalité, une réalité qu’il apprend bien sûr après coup : il en donne quelques exemples à propos de L’Hercule sur la place ou Le Voyage du père. Sans doute écrit-il d’abord pour exorciser la mort. Il confesse : Finalement, je me demande si l’on ne crée pas avant tout pour se survivre. Et puis, il y eut 1968, pas mai 68, mais la consécration : prix Goncourt surtout, mais aussi grand prix de la ville de Paris et prix Jean Macé. À la question classique, pourquoi écrivez-vous, il répond : Écrit-on jamais pour autre chose que pour aller au fond de soi ?
Retour au bercail : il s’installe dans la maison des abbesses à Château-Chalon près de Lons-le-Saunier où se déroule l’action de Le Silence des armes. voir Terre des écrivains : Bernard Clavel à Château-Chalon C’est l’époque où il écrit Le Seigneur du fleuve, Tiennot, Le Silence des armes et Lettre à un képi blanc. Avec ses deux derniers livres, c’est l’époque de la polémique, au côté des objecteurs de conscience, j’estime, dit-il, que je n’ai pas le droit de cesser de me battre pour que la justice et la paix s’imposent. S’il n’a aucun message à transmettre, il ne peut non plus écrire une œuvre dégagée. Il se veut comme son ami Roland Dorgelès anarchiste chrétien.
Sa nouvelle vie laisse augurer une grande stabilité, mais c’est le contraire qui se produit : début 1978, il s’installe au Québec avec Josette Pratte, Montréal, puis Saint-Télesphore, je suis un homme d’hiver dit-il, saison à laquelle il consacrera un album en 2005. Il revient en France à Paris, puis chez un ami à Bruxelles, le Portugal où il écrit Marie bon pain, Paris de nouveau chez des amis pour écrire La Bourrelle. Le périple se poursuit en 1979 dans une ferme du Doubs qu’il quitte en 1981 pour s’installer à Morges en Suisse sur les bords du lac Léman, renouer avec La lumière du lac, là où en 1985 ce deuxième volume du cycle romanesque Les Colonnes du ciel a été élaboré, avant de partir en Irlande.
Bernard Clavel se défend d’écrire des romans historiques - Les Colonnes du ciel sont faits de héros 'modernes' et l’histoire aurait pu se dérouler à notre époque, ou de mélanger réalité et fiction. Il précise : J’ai fini par acquérir la conviction profonde qu’il y a pour l’artiste un droit absolu d’adhérer de plus près à son œuvre qu’aux êtres qui l’entourent. Cette fois, il ne s’agit plus d’une simple rupture, c’est un second souffle, un homme résolument tourné vers l’avenir ; il a rencontré Josette Pratte, un grand amour avec qui j’ai des échanges constants. Quand on lui reproche un certain égoïsme, il répond que le métier d’écrivain est fatalement une longue solitude. Il parle de Harricana, cette rivière du Québec qui coule dans Le Royaume du Nord, des gens qu’il a rencontrés, qui sont devenus personnages, recomposés par son imaginaire. Et il conclut : Vous voyez : une fois de plus, je n’ai rien inventé et j’ai tout inventé.
Et s’il ne pouvait plus écrire, si on lui interdisait d’écrire, question cruciale : Je ne vous ai pas attendu pour me la poser, répond-il à Adeline Rivard, il y a près d’un demi-siècle qu’elle me poursuit…
Les petits bonheurs
À travers ce récit6, Bernard Clavel part à la rencontre de son enfance, de son passé. Il revoit ses terreurs d'enfant quand la lampe Pigeon de la salle à manger n'éclairait jamais certains recoins d'où pouvaient bondir des ogres, des loups ou des monstres. Frayeurs d'enfant qu'amplifie son imagination, visions d'animaux qui peupleront ses livres pour la jeunesse. Sa mère renforce cette tendance, elle qui appartenait au temps des veillées de contes populaires, née près de Dole dans le Jura où Marcel Aymé devait rencontrer La Vouivre. C'était leur univers, des personnages de contes… qui vivaient pour elle aussi bien que pour moi, un monde qu'il fera revivre dans ses livres sur les contes et légendes.Je sais, écrit-il, que c’est dans ces moments-là que sourd ce qui m’a nourri et m’a permis d’écrire.
Il y décrit le travail de ces humbles artisans aux mains d’or, Vincendon le luthier dont le père de Bernard Clavel conservera religieusement les outils, le père Seguin, cordonnier à l’échoppe qui exhalait des odeurs enivrantes de colle qui chauffait au bain-marie et des cuirs qui trempaient. Le jour où Nini la fille des Seguin, leur parle du Groenland, Bernard Clavel se souvient : Dès ce jour, ce fut comme si j’avais commencé à préparer mon sac à dos. Les souvenirs comme le départ sur le Pourquoi pas ? du commandant Charcot du fils Victor, se recomposent et se combinent pour déboucher un jour sur L'Homme du Labrador. Par nature, par instinct, nous confie-t-il, je me sentais déjà du nord. Bien sûr, dans ses souvenirs, on retrouve la tante Léa et l’oncle Charles, ce vieux baroudeur qui avait connu les campagnes d’Afrique et d’Extrême-Orient, héros de son roman Quand j'étais capitaine.
Tous ces récits, la fin tragique de la mère Magnin, les balades dans la vieille auto de la mère Broquin, les amis cheminots de son père, vont s’imprégner dans la mémoire du jeune homme, ‘oubliés’, endormis mais qui alimenteront peu à peu son imaginaire. Bernard Clavel profitait de leurs propos. Il vivait avec eux leur vie simple, parfois leurs aventures, c’est ainsi que je devais me rendre jusqu’à Istanbul dès l’âge de cinq ans à travers les récits d’un autre cheminot : le père Tonin. Il lui suffisait d’un chêne étêté qui devenait navire de haute mer et il était tour à tour Christophe Colomb, Vasco de Gama ou Charcot, Robinson Crusoé parfois quand mon bateau se muait en île.
Ce vieux chêne qu’il ne soumet à un sévère élagage que sur injonction de son père, a des airs de famille avec L’Arbre qui chante. C’est aussi cette absence de livres chez lui qui l’a marqué, et il se demande si tous les enfants qui ont vécu leurs jeunes années dans une maison sans livres sont, comme je l’ai été, fascinés par la chose imprimée. Il gardera des impressions profondes, rémanentes, des impressions de peintre avec ces reproductions de Bosch et de Pieter Bruegel dont ils retrouvent certains traits dans le visage de cette folle entrevue un jour en gare de Chaussin. En peinture, c’est sa tante Léa qui fut son initiatrice, l’aidant à développer ses dons naturels pour le dessin, lui présentant Delbosco, un voisin peintre.
À travers les menues distractions qui étaient autant de petits bonheurs, la joie de la retraite aux flambeaux, titre d’un de ses romans, se dessine L’Hercule sur la place qui doit ressembler à son oncle Paul, coiffeur à Dole. Dole, la ville de sa mère où il allait voir la maison natale de Pasteur et, sur le belvédère, admirer le panorama. Un jour de balade, il découvre, béat, le lac Léman dont il écrira Les Légendes. Nostalgie de l’almanach, nostalgie des textes de Roland Dorgelès, des bonheurs d’enfants qui peuvent déboucher sur de belles joies d’homme », des extraits de Maria Chapdelaine, de la neige, de la glace… nous parlions du Canada comme d’un paradis, avant-goût du Royaume du Nord. Des quelques livres entrés parcimonieusement chez lui, il dira c’est d’eux que me vient l’essentiel de ce qui a nourri mes romans.
Les souvenirs plus récents, c’est le temps de La Grande Patience, l’apprentissage à Dole chez un pâtissier « qui était une brute, c’est le temps des années noires que son ami Jean Guéhenno a si bien décrit dans son Journal, la montée du nazisme et la guerre. Les hommes sérieux murmuraient, écrit-il. Tout ça ne sent pas bon. Ces nazis sont en train de nous préparer de grands malheurs. Les Grands Malheurs, titre de son dernier roman.
Les Petits Bonheurs, c’est tout ça, les histoires, la vie quotidienne, les émotions qui l’ont marqué où l’on retrouve toute son iconographie, c’est d’abord une incursion dans ce qu’il appelait sa géographie sentimentale.
Écrit sur la neige
Ce livre où Bernard Clavel égrène ses souvenirs, ce qui a fait sa vie et nourri son œuvre, est né d’une série d’interviews recueillis par le journaliste Maurice Chavardès. Il y développe ses conceptions, disant qu'il écrit pour communiquer mes émotions à mes semblables et pour en provoquer le renouvellement, que ce métier requiert de la patience pour l'apprendre mais que ne deviendra romancier que celui qui est né romancier : c'est-à-dire celui qui porte en lui un monde et le désir profond de l'animer.
Il y évoque son enfance, son univers à Lons-le-Saunier avec ses parents, tout ce qui a disparu depuis, démoli, le jardin bétonné, saccageant ses souvenirs, qu’il ressent comme une blessure. Il revoit ces petits riens qui affleurent à sa mémoire comme la lampe pigeon de sa mère. Il voudrait retrouver les crépuscules d’hiver, le silence qui accompagne cette fuite de la lumière, il imprégnait les âmes et ce qui pénètre ainsi une âme d’enfant peut à jamais colorer l’existence d’un homme. Il était alors un rêveur invétéré.
Il y eut d’abord la peinture, cadeau de la tante Léa qui sera son initiatrice. Puis il rencontra à Lons-le-Saunier près de chez lui Roland Delbosco, un peintre-poète qui lui inocule le virus, lui fit découvrir le Rhône à Vernaison où il s’établit pour plusieurs années. Le Rhône, ce fleuve qui hante nombre de ses romans, de Pirates du Rhône jusqu’à La Table du roi. Vernaison est une étape essentielle, il s’y est marié, ses enfants y sont nés, là-bas il s’est colleté à la peinture puis à l’écriture. Là-bas, il fait la connaissance d’un amateur d’art Louis Mouterde chez qui il découvre la peinture de l’école lyonnaise. Ses goûts le portent aussi vers les impressionnistes et la peinture hollandaise, pays où il aime se rendre pour visiter les musées, surtout Rembrandt et Bruegel, le peintre qui l'a le plus marqué dans sa jeunesse.
Bernard Clavel n’aime pas évoquer le contexte de ses romans et des aspects biographiques qu’ils contiennent, tout vient de la vie, de ce que l’écrivain engrange de 'matière première', expériences faites d’événements et de sensations. L’art est fait d’impulsions mises en forme.
Généralement, ses œuvres il les porte longtemps, les laisse mûrir puis s’y invertit totalement jusqu’à oublier le présent et délaisser ses proches. Même s’il y répugne, il évoque la genèse de La Saison des loups, sa visite à Salins-les-Bains et le choc quand il découvre cette guerre oubliée quand la Franche-Comté, humiliée et dévastée, devient française, comment ses personnages l’ont amené à donner une suite à ce premier volume dans La Lumière du lac.
À la question de savoir s’il est un intellectuel, Bernard Clavel répond qu’un homme doit pouvoir changer de métier, lui se verrait plutôt menuisier ou charpentier. Sa vocation, même s’il n’aime guère ce mot, il l’a considère comme un 'bouillon de culture' : Je suis né sensible, j’ai été élevé par une mère qui l’était, par un père secret… notre entourage d’artisans raconteurs d’histoires m’a impressionné. Petit, on l’accusait de mentir alors que, dit-il, il ne faisait que raconter des histoires.
Son engagement s’est fait peu à peu, de façon naturelle, l’amenant à défendre un humanisme basé sur la sauvegarde de l’homme et de la nature, le recours à la non-violence. Pour lui, un fleuve, une terre, un vignoble, des forêts sont tellement liés à l’existence de l’homme qu’il me paraît impossible que l’humanité oublie ce lien sans courir à sa perte. Engagement pour l’écologie et les enfants martyrs, engagement contre l’État guerrier et marchand d’armes. Engagement aussi dans l’affaire Jean-Marie Deveaux ou l’affaire Buffet-Bontemps contre la peine de mort, contre les pratiques policières, l’impéritie de la justice et du système pénitentiaire. C’est un homme en colère qui fustige policiers et magistrats indifférents ou trop répressifs.
Tant que l’injustice sévira jusqu’aux plus hauts degrés de l’État, le problème de la délinquance restera entier. Mais il continuera malgré tout à se battre contre la violence et la haine. Ma vie est plantée de jalons en forme de clefs, confie-t-il à son interlocuteur. Sa rencontre avec Louis Lecoin en est un. Il écrit dans ses revues Liberté et Défense de l’homme, il participe avec lui à son combat pour le statut d’objecteur de conscience. Son pacifisme remonte à cette nuit d’août 1944, nuit de torture d’un pauvre type qui lui laisse dans la bouche un goût de fiel. C’est le souvenir de cette nuit qu’il utilisera dans L’Espagnol pour peindre une scène semblable. Mais le petit garçon jouait à la guerre et creusait une tranchée dans le jardin de son père : épisode qu’il rappelle à plusieurs reprises et reprend dans son roman Quand j'étais capitaine. Sa rencontre avec le père Maurice Lelong devait aussi l’influencer, évoquant ensemble Romain Rolland, défendant les insoumis et luttant contre la guerre d’Algérie.
Son rejet de la guerre l’amène à publier Le Silence des armes, puis sa Lettre à un képi blanc. Il aura d’ailleurs l’occasion de rencontrer son contradicteur le caporal Mac Seale, ouvert au dialogue, intelligent, et qui avait fort bien compris mon livre. Hasard de la vie, il retrouve en Allemagne Hans Balzer, soldat allemand qui pendant l’hiver 1942-43 se trouvait comme lui à la prison de Carcassonne. Immense émotion, surtout quand ils visitent Buchenwald et parlent de leur admiration pour Romain Rolland.
Son engagement, c’est aussi sauver les enfants à travers l’association Terre des Hommes et du livre Le Massacre des innocents qu’il écrit à son profit. Avec Claude Mossé et les medias suisses, il se bat pour les enfants du Bengale, se rend sur place et se bat pour acheminer le maximum de vivres. Il y a certes la violence individuelle, Bernard Clavel sait combien il est facile d’y succomber, combien aussi des jeunes comme les héros de son roman Malataverne peuvent en être victimes, mais la violence d’État est encore la plus pernicieuse. Pour lui, l’arme absolue est la non-violence, la seule utilisable sans enfreindre aucune loi morale.
Sur le plan littéraire, il reconnaît lire peu de romans et, en matière d’influence note son ami et biographe Michel Ragon, le rapprochement de tant d’auteurs, une dizaine, signifie qu’en réalité, il ne ressemble à personne. Le jour où il démissionne de l’Académie Goncourt, il skie dans le Jura avec des amis, la vraie vie, entre partage et amitié, nous écrivons toujours sur la neige, note-t-il, le tout est de savoir à quelle heure se lèvera la tempête.
Les décorations et les prix littéraires ne l’ont jamais intéressé, même s’il a obtenu le prix Goncourt dans des conditions assez rocambolesques auxquelles il est resté totalement étranger. Même s’il a obtenu de nombreux prix, il les juge plus néfastes qu’utiles. Ce qui l’a le plus marqué – et beaucoup aidé – ce sont les rencontres, ses premiers amis avec Delbosco qui, de fil en aiguille, vont lui permettre de devenir l’ami d’écrivains comme Hervé Bazin, Armand Lanoux, Roland Dorgelès, puis Jean Giono et Marcel Aymé. Ses livres lui valent l’amitié de philosophes comme Gaston Bachelard et Gabriel Marcel. Il se montre très critique envers les critiques, dénonçant le côté élitiste ou réactionnel de beaucoup d’entre eux. Mais il pense surtout à d’autres rencontres comme celle de Frédéric Ditis des Éditions J’ai lu ou avec le peintre Jean-François Reymond qui débouchera sur la publication du livre Bonlieu ou le silence des Nymphes.
Lors de ses débuts, Bernard Clavel a beaucoup travaillé pour la radio, excellent apprentissage pour lui à Radio-Lyon. S’il est déçu par les deux adaptations au cinéma Le Tonnerre de Dieu et Le Voyage du père, il s’enthousiasme pour la télévision et participe à l’adaptation de plusieurs de ses œuvres.
Il a également beaucoup écrit pour la jeunesse car dit-il, quel bonheur de retrouver un moment de sa propre enfance, rechercher ses propres sources d’émerveillement. Mais il est difficile de traiter de la réalité en édulcorant les côtés les plus négatifs, en évitant toute violence, à promouvoir de nobles sentiments tels que la droiture et l’honnêteté sans pour autant bêtifier.
Si l’attitude de l’Église l’a souvent agacé, si sa recherche de Dieu a toujours été difficile, il a réussi à retrouver la foi. Avec l’âge, il lui semble peu à peu apprivoiser la mort, vouloir une mort plutôt lente avec laquelle il puisse se confronter mais, dans les cas extrêmes, être favorable à l’euthanasie.
Á propos de la Franche-Comté et de ses nombreux déménagements, il admet être un déraciné et que c’est un constat très démoralisant. Ceci l’amène à développer l’un de ses thèmes favoris : l’écologie, la culture biologique, la défense de la planète et de la biodiversité. C’est aussi le cas précise-t-il pour le Jura où il s’était installé un moment dans le village de Château-Chalon près de Lons-le-Saunier, pollué par l’urbanisation et le tourisme. Pourtant, il pense déjà à l’époque, en 1977, à revenir près de ses racines, l’essentiel serait seulement que je puisse m’en rapprocher le plus possible.
Il le réalisera en 2002 lorsqu’il s’installera dans la commune de Courmangoux dans le Revermont bressan, avant que tout soit remis en cause par la maladie.
Œuvre
Bernard Clavel a écrit près de 40 romans, ainsi que des essais, des recueils de nouvelles et des livres pour enfants :
Romans
Série La Grande Patience
La Maison des autres , 1962
Celui qui voulait voir la mer, 1963
Le Cœur des vivants, 1964
Les Fruits de l'hiver, 1968
Série Les Colonnes du ciel 9
La Saison des loups, 1976, Robert Laffont
La Lumière du lac, 1977, Robert Laffont, dernière édition 1985
La Femme de guerre, 1978, Robert Laffont
Marie Bon pain, 1980, Robert Laffont, dernière édition 1985
Compagnons du Nouveau Monde, 1981, Robert Laffont, dernière édition 1985
Série Le Royaume du Nord
Harricana 1983
L’Or de la terre 1984, Albin Michel
Miséréré 1985
Amarok 1987
L’Angélus du soir 1988, Albin Michel
Maudits sauvages 1989, Albin Michel
Autres romans
Bernard Clavel a écrit de nombreux romans à partir de 1956 jusqu'aux années 2000 :
L'Ouvrier de la nuit, Julliard, 1956 ou Jura Robert Laffont, 1971
Pirates du Rhône, André Bonne, 1957 — Réédition chez Robert Laffont, 1974
Qui m'emporte, 1958, Robert Laffont, — Réédité à plusieurs reprises sous le titre Le Tonnerre de Dieu.
L'Espagnol, 195910
Malataverne, 1960, Robert Laffont
Le Voyage du père, 1965, Robert Laffont
L'Hercule sur la place, 1966, Robert Laffont
Le Tambour du bief, 1970 Robert Laffont
Le Seigneur du fleuve, 1972 Robert Laffont
Le Silence des armes, 1974 Robert Laffont
Tiennot ou l'île aux Biard, 1977
L'homme du Labrador, 1982, Balland
Quand j'étais capitaine, 1990 Albin Michel
Meurtre sur le Grandvaux, 1991 Albin Michel
La Révolte à deux sous, 1992 Albin Michel
Cargo pour l'enfer, 1993, Albin Michel
Les Roses de Verdun, 1994, Albin Michel
Le Carcajou, 1995 Robert Laffont
La Guinguette, 1997, Albin Michel
Le Soleil des morts, Albin Michel, 1998
Le Cavalier du Baïkal, Albin Michel, 2000
Brutus, 2001, Albin Michel
La Retraite aux flambeaux, Albin Michel, 2002
La Table du roi, 2003, Albin Michel
Les Grands Malheurs, 2004, Albin Michel
Contes, nouvelles et divers Récits et essais Clavel.
Image de conte
Bernard Clavel a écrit plusieurs livres concernant les légendes (Légendes des lacs et des rivières, des montagnes et des forêts, de la mer, du Léman) qui sont plutôt des œuvres pour la jeunesse, ainsi que deux autres ouvrages les Contes et légendes du bordelais et les Contes espagnols.
1969 L'espion aux yeux verts, Robert Laffont,
1978 L’ami Pierre, texte de Bernard Clavel, photos de Jean-Philippe Jourdrin, 78 pages, Duculot,
1979 L'iroquoise, L'instant romanesque, Éditions Balland,
1980 La Bourrelle, Éditions Balland,
1983 Georges Brassens, auprès de mon arbre, André Tillieu, préface de Bernard Clavel,
1992 Contes espagnols, Le pont du Llobregat - le pêcheur et le sabbat-la perle de la forêt, illustrations de August Puig, Le Choucas, 77 pages, Voir aussi et Clavel-Puig
1997 Contes et légendes du bordelais, éditions Mollat, 06/06/1997, 90 pages,
1997 Gandhi l'insurgé : l'épopée de la marche du sel, Jean-Marie Muller, préface de Bernard Clavel, Éditions Albin Michel,
2002 Rondes et Comptines, sur CD audio, chantées par Clémentine et ses amis, De Plein Vent - Frémeaux & Associés
2005 Le chien du brigadier, Sélection Du Reader's Digest, collection 50 Ans Sélection du Livre, 61 pages, 04/2005,
Essais et récits
Pour plus de détails, voir : Récits et essais Clavel.
1958 Paul Gauguin, Éditions du Sud-Est,
1962 Célébration du bois, Éditions Robert Morel,
1967 Léonard de Vinci, Éditions Club d’Art Bordas,
1968 Victoire au Mans, Éditions Robert Laffont,
1970 Le massacre des innocents, Éditions Robert Laffont,
1973 Bonlieu ou le Silence des nymphes, dessins de J.-F. Reymond, Éditions H.-R. Dufour, Lausanne,
1975 Lettre à un képi blanc, Éditions Robert Laffont
1977 Écrit sur la neige, Éditions Stock, interviews recueillies par Maurice Chavardès : voir présentation dans le chapitre III du sommaire.
1977 Fleur de sel, les marais salants de Guérande, texte de Bernard Clavel, photos de Paul Morin, Éditions Le Chêne, 1977 et 1985
1979 Le Rhône ou les métamorphoses d’un Dieu, Éditions Hachette Littérature, photos Yves-André David,
1984 repris sous le titre Je te cherche vieux Rhône, Éditions Actes Sud, 02/1984, couverture Christine Le Bœuf, réédité en avril 2000
1981 Arbres, par Bernard Clavel et Grégoire Curien, Éditions Berger-Levrault, réédition 1995,
1981 Terres de mémoire, le Jura, de Bernard Clavel, Georges Renoy, et Jean-Marie Curien, Éditions Jean-Pierre Delarge,
1999 les petits bonheurs, Éditions Albin Michel, 1999, Pocket 04/2000 : récit autobiographique, voir présentation dans le chapitre III du sommaire.
2000 Les Vendanges, texte de Bernard Clavel, photos de Janine Niepce, Éditions Hoebeke, 09/2000, 104 pages
2003 L'Hiver, Éditions Nathan, collection Voyages et nature, 10/2003, 192 pages
2003 Paroles de paix, texte de Bernard Clavel, illustrations de Michele Ferri, Éditions Albin Michel, 01/2003, 64 pages
2005 J'avais six ans à Hiroshima. Le 6 août 1945, 8h15, Nakazawa Keiji, précédé de La peur et la honte de Bernard Clavel, Éditions Le Cherche-Midi, 2005, 169 pages, voir Présentation du livre
Revues et collaborations diverses
Le Vieux Lyon est-il menacé ? par Bernard Clavel, revue Le Jardin des arts no 86, janvier 1962
Vienne par Bernard Clavel, revue Le Jardin des arts no 90, mai 1962
Les croix des mariniers du musée de Serrières par Bernard Clavel, revue Le Jardin des arts nos 97-98, déc. 1962 - janv. 1963
L'école lyonnaise de peinture par Bernard Clavel, revue Le Jardin des arts no 100, mars 1963
Cœur vivant de la maison par Bernard Clavel, revue Le Jardin des arts no 109, décembre 1963
Le grand art de la soierie, revue Le Jardin des arts no 112, Jules Tallandier, mars 1964
Castres par Bernard Clavel, revue Le Jardin des arts no 115, juin 1964
Lyon à la pointe du progrès, par Bernard Clavel, revue Plaisirs de France, avril 1963
Un musée tibétain dans le Vieux-Lyon, par Bernard Clavel, revue Plaisirs de France, février 1965
Le talon de fer, de Jack London, Club Diderot, Paris, 1967
L'Affaire Deveaux, article de Bernard Clavel, Édition Publication Première, collection Édition Spéciale, 265 pages, 1969
Jacquou le croquant, Eugène Le Roy, préface de Bernard Clavel, Calmann-Levy, 360 pages, 1969
Les Cerdan, Passevant Roland, préface de Bernard Clavel, Dargaud, in-8 broché, 170 pages, 1970
La chiropractie, de Jean Gallet, Hachette, Paris, 1970
Mourir pour Dacca, Claude MOSSE, préface de Bernard Clavel, Paris, Robert Laffont, in-8 broché, 220 pages, 1972
Écrits, Louis Lecoin, extraits de 'Liberté' et de 'Défense de l'homme', préfaces de Bernard Clavel et de Robert Proix, Union pacifiste de France UPF, Boulogne, 255 pages, 1974
Revue Liberté de Louis Lecoin, articles de Bernard Clavel sur le pacifisme et l’objection de conscience
Aux confins de la médecine, Gaston Baissette, Préface de Bernard Clavel, In 218 pages, Julliard, 1977
La gerbe d'or, Henry Béraud, préface de Bernard Clavel, Édition Horvath, Roanne, 207 pages, l'histoire de la boulangerie Lyonnaise 'la gerbe d'or' au début du siècle, 1979
Autour de Marcel Aymé, article de Bernard Clavel, Cahiers Dolois, 1980
Le Lycée de mon père, Maurice Toesca avec une préface de Bernard Clavel, Mémoires de ma mémoire - Éditions Clancier -Guénaud - collection Mémoire pour Demain, 209 pages, 1981
Magazine littéraire no 298, Entretien avec Bernard Clavel
Ils ont semé nos libertés, Michel Ragon, avant-propos de Bernard Clavel, Éditions Syros, 1984
Truphémus et les cafés de Lyon par Bernard Clavel et René Déroudille, revue L'œil 360-361, juillet-août 1985
La table au pays d 'Henri Maire, M R Bazin, préface de Bernard Clavel
Fleur de sel, les marais salais de Guérande, texte de Bernard Clavel, photos de Paul Morin, Éditions Le Chêne, 1985
Morges sept siècles d'histoire vivante 1286-1986, Robert Curtat, préface de Bernard Clavel, Au Verseau, 193 pages, 1986
La littérature au risque de la psychanalyse, article de Bernard Clavel, Le Croquant, Saint-Étienne du Bois, 1989
Les Travailleurs Face à L'armée, Jean Authier, postface de Bernard Clavel, Moisan Union pacifiste de France, 80 paqges
L'Irlande, Pat Coogan, Jean-Pierre Duval, Préface de Bernard Clavel et Josette Pratte, Romain Pages Éditions, 1993, 96 pages
Franche-Comté Champagne Ardenne, La France et ses Trésors, préface de Bernard Clavel, Larousse-sélection Du Reader Digest, 1994, 138 pages
Brassens, le mécréant de Dieu, Jean Claude Lamy, témoignage de Bernard Clavel, Albin Michel 2004, 310 Pages
Il y a 100 ans La France d'autrefois, présenté par Bernard Clavel, Reader's Digest, 2005, 287 pages
Œuvres pour la jeunesse
L’Arbre qui chante, 1967, illustrations de Christian Heinrich, La Farandole, Album, réédité en 2005 chez Hatier et en 1997 avec La maison des canards bleus et Le chien des Laurentides
La Maison du canard bleu, Casterman, 1972, Le Chien des Laurentides, Casterman, 1979,
Ces trois titres sont regroupés désormais sous le titre L’Arbre qui chante, 1997, Albin Michel Jeunesse,
Victoire au Mans, Robert Laffont, 1968
Légendes des lacs et des rivières, illustrations Jacques Poirier, notes de Nicole Sinaud, Hachette Jeunesse, 1974 et 1986, réédition chez Hachette Jeunesse, 2002,
Légendes de la mer, Hachette Jeunesse, 1975, LGF en 1981 et Le Livre de poche jeunesse, 10/2008, illustrations Rosiers-Gaudriault, commentaires Nicole Sinaud, 189 pages,
Légendes des montagnes et des forêts, illustrations Mette Ivers, commentaires Nicole Sinaud, Hachette Jeunesse, 1975, LGF en 1983 et Le Livre de poche jeunesse, 08/2008, 184 pages,
Le voyage de la boule de neige, Robert Laffont, 1975
Félicien le fantôme, de Bernard Clavel et Josette Pratte, illustrations Jean Garonnaire, Éditions Jean-Pierre Delarge, 1980
Poèmes et comptines, L'École des Loisirs, 1981
Le hibou qui avait avalé la lune, Clancier-Guénaud, 1981
Odile et le vent du large, G. P. Rouge et Or, 1981
Rouge pomme, L'École des Loisirs, 1982
Le roi des poissons, illustrations Christophe Durual et de François Crozat, Albin Michel Jeunesse, 1994, réédition en 2000
Les trois titres suivants sont regroupés désormais sous le titre Le mouton noir et le loup blanc, 1998, Flammarion :
Le Mouton noir et le loup blanc, Flammarion, 1984, L’Oie qui avait perdu le nord, illustrations Véronique Arendt, Flammarion, 1985, Au cochon qui danse, Flammarion, 1986,
Le grand voyage de Quick Beaver, Nathan, 1988
À kénogami, poèmes, images de Gilles Tibo, Messidor/La Farandole, 1989
Les portraits de Guillaume, illustrations Dominique Ehrhard, Nathan, 1991
Ces deux titres, ainsi que La Maison en bois de lune sont regroupés désormais sous le titre Achille le singe, Albin Michel :
L’autobus des écoliers, illustrations de Christophe Besse, La Farandole, 1991, Le rallye du désert, illustrations Christophe Besse, La Farandole, 1993
Rondes et comptines, disque, textes de bernard Clavel, musique de Thierry Fervant, Éditions Frémeaux, 1991
La cane de barbarie, dessins de Anne Romby, Le Seuil, 1992
Liens
http://youtu.be/KOQDPfOiJjw Goncourt 1968 Clavel
http://youtu.be/g-B3iaXhEGA Bernard Clavel
http://youtu.be/9rQVRbFUm7o PPDA Hommage à Clavel
http://youtu.be/v0qzOtI_B7A Bernard Clavel l'anti grand canal
http://youtu.be/tTgN3t7ZcOg Le carcajou de Clavel     [img width=600]http://1.1.1.1/bmi/ktang28.free.fr/Bernard%20Clavel/Maudits%20sauvages%20(1619)/Maudits%20sauvages%20-%20Bernard%20Clavel_resizedcover.jpg[/img]   [img width=600]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRifb8NLrZRYC_T8oyHtD1BQNBvirsm9pV8mjpZEMGQAE6Unorwuy9YQZf1[/img]   
Posté le : 04/10/2014 12:27
|
|
|
|
|
Le chevalier d'Eon |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 5 octobre 1728 à l'hôtel d'Uzès à Tonnerre naît " le chevalier d'Eon,
de son vrai nom, Charles-Geneviève Louis-Auguste-André-Thimothée d'Éon de Beaumont, dit le chevalier d'Éon ou Mademoiselle d'Eon, mort, à 8I ans, le 21 mai 1810 à Londres, auteur, diplomate et espion français. Il est resté célèbre pour son habillement qui le faisait passer pour une femme. À sa mort cependant, il fut reconnu par un concile de médecins comme de sexe masculin et parfaitement constitué.
Il est le fils de Louis d'Éon de Beaumont, avocat au Parlement de Paris ayant fait fortune dans le commerce du vin en étant directeur des domaines du roi, et de Françoise de Charanton, fille d'un Commissaire Général des Guerres aux armées d'Espagne et d'Italie. D'Éon raconte dans son autobiographie Les Loisirs du chevalier d'Éon de Beaumont qu'il est né coiffé, c'est-à-dire couvert de membranes fœtales, tête et sexe cachés et que le médecin de la ville a été incapable de déterminer son sexe.
En bref
Le Chevalier d'Éon, dont le premier tome est paru en janvier 2014 chez l'éditeur Ankama et dont un second tome est en préparation, est une bande dessinée scénarisée et mise en images par Agnès Maupré. Il s'agit d'une biographie romancée, mais soutenue par une documentation important.
Agent secret de Louis XV, il accomplit avec succès – selon la tradition, sous un déguisement féminin – une mission secrète en Russie 1755, où il fut secrétaire d'ambassade 1757-1759. Ministre plénipotentiaire à Londres 1763, il entretint avec le roi une correspondance politique confidentielle. Il a laissé des Mémoires Loisirs du chevalier d'Éon, 1774
Né à Tonnerre d'une famille de juristes, avocat au Parlement, Charles de Beaumont, chevalier d'Éon, reçoit du prince de Conti une mission à la cour de Russie en 1755 ; agent secret du roi, il est lectrice de la tsarine Élisabeth sous un déguisement féminin ; une seconde mission le voit secrétaire d'ambassade en Russie. Entré dans la carrière des armes en 1761, courageux capitaine de dragons sous les ordres du maréchal de Broglie, il devient ensuite secrétaire d'ambassade en 1762, puis ministre plénipotentiaire, avant de recevoir de Louis XV la croix de Saint Louis. Grâce à son action vigilante et utile, Éon révèle que le ministre protestant Gibert trafique par Rouen et Dieppe l'envoi de protestants dans les colonies anglaises... Mais des menées hostiles et des médisances, ainsi que les discussions auxquelles on se livre sur son sexe, le contraignent à revenir en France. Vergennes et Maurepas l'obligent à paraître dans le monde sous l'aspect de la chevalière d'Éon. Puis il retourne à Londres où il meurt dans l'oubli. Sa collaboration à L'Année littéraire de Fréron, ses œuvres rassemblées et publiées en treize volumes à Londres, en 1775, sous le titre Loisirs du chevalier d'Éon, ses travaux d'économie et de politique témoignent d'un esprit observateur et intelligent. On s'est beaucoup interrogé sur les raisons qui ont déterminé cet homme à accepter ou à créer une telle ambiguïté autour de sa personnalité.
Sa vie
Il naît à Tonnerre où son père de petite noblesse est élu maire et y commence ses études, puis, en 1743, les poursuit à Paris chez son oncle, au collège Mazarin et obtient un diplôme en droit civil et en droit canon en 1749 à 21 ans. Dans la lignée de sa famille de noblesse de robe, il s'inscrit comme avocat au Parlement de Paris le 22 août 1748. Il montre également des talents en équitation et en escrime. Il se met à écrire, publie en 1753 plusieurs Considérations historiques et politiques. L’ouvrage étant remarqué, le jeune homme se crée un réseau de relations, dont le prince de Conti, cousin du roi Louis XV qui le nomme censeur royal pour l'Histoire et les Belles-Lettres.
Carrière
Sollicité, selon la légende il aurait été remarqué par le roi lors d'un bal dans lequel le chevalier était costumé en femme, il est recruté dans le Secret du Roi, cabinet noir de Louis XV qui mène une politique en parallèle des conseils officiels, le prince de Conti, le maréchal de Noailles, Beaumarchais, M. de Tercier en font également partie. Il est aussitôt dépêché à la Cour de Russie comme secrétaire d'ambassade en juin 1756, alors que débute la guerre de Sept Ans, pour obtenir de la tsarine Élisabeth une alliance avec la France. Il racontera plus tard, dans la publication romancée de ses Mémoires en 1836, y avoir été lectrice de la tsarine sous le nom de Lia de Beaumont. Celle-ci aurait percé à jour le déguisement et aurait tenté de consommer, mais il serait resté mou et aurait été traité de fou. En fait, le poste n'existait pas à la cour de Russie, et l'histoire n'apparaît qu'à l'époque où il est en Angleterre. À la cour russe, la tsarine donnant des bals costumés où l'on inversait les rôles les hommes devaient être vêtus en femme et les femmes en homme, il prend sans doute plaisir à se travestir, sa faible corpulence lui permettant de mystifier tout le monde.
Il est de nouveau à Saint-Pétersbourg comme secrétaire d'ambassade de 1758 à 1760. Il porte le texte du traité d'alliance au roi à Versailles où il arrive deux jours avant le courrier dépêché par la tsarine. Le roi le récompense en lui donnant un brevet de capitaine de dragons en 1760. Il participe aux dernières campagnes de la guerre de Sept Ans où il est blessé et quitte l'armée en 1762 pour redevenir agent secret.
Il est envoyé à Londres en 1762, où il collabore, en tant que Secrétaire de l'Ambassade de France pour la conclusion de la paix générale auprès de l’ambassadeur le duc de Nivernais, à la rédaction du traité de paix de Paris qui sera signé le 10 février 1763. Sa grande habileté diplomatique et la subtilisation des documents préparatoires au traité, alors que la France est vaincue par l'Angleterre qui veut s'emparer de tout l'empire colonial français, lui vaut de recevoir une des plus rares distinctions du temps : l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Parallèlement, il est chargé par le Secret du Roi de la composition d’un plan d’invasion sur la Grande-Bretagne, plus précisément d'un projet de descente sur l'Angleterre et le Pays de Galles dont il a reconnu les côtes avec le marquis Carlet de la Rozière. Il est nommé alors ambassadeur par intérim lorsque le duc de Nivernais malade retourne à Paris. Dans l'attente d'un nouvel ambassadeur, il mène grand train et le ministre des Affaires étrangères Étienne François, duc de Choiseul ne veut plus régler les dettes dues à ce train de vie fastueux. À l’arrivée du nouvel ambassadeur, Claude Louis François Régnier, comte de Guerchy, il en devient le secrétaire en tant que ministre plénipotentiaire. Les deux hommes n’arrivent pas à s’entendre. Imbu de l’estime du Roi et redescendu secrétaire après avoir été ministre plénipotentiaire, d'Éon accepte difficilement les remarques de son supérieur qu'il juge incompétent. Une guerre ouverte s’installe alors à l’ambassade de France, deux camps se forment et une guerre de libelle voit le jour. Le 4 novembre 1763, Louis XV demande l’extradition du chevalier mais la législation anglaise l’interdit. Redevenu simple particulier, il continue par provocation d’aller à l’ambassade de France et divulgue en 1764 des secrets d’État et une partie de sa correspondance personnelle, étant prêt à saborder sa carrière afin de discréditer Guerchy et de faire chanter le roi en révélant notamment l'ordre de mission du roi pour le débarquement. Le conflit est marqué par plusieurs procès devant la Cour de sa Majesté britannique.
Lors d'un autre procès, un témoin surprise accuse l’ambassadeur de France d'avoir tenté d’empoisonner son ex-secrétaire lors d'un repas. Le dernier procès, en septembre 1767, donne raison au chevalier d’Éon qui poursuit alors son métier d'espion et reçoit à nouveau sa pension. Devant comparaître à l'un de ses nombreux procès mais n'ayant ni avocat, ni témoins, il préfère se dérober et se déguiser alors en femme et se réfugie chez un ami. En fait, disgracié et tombant dans l'oubli depuis qu'il a abandonné le chantage, il éprouve le besoin de provoquer en se travestissant en femme et de répandre la rumeur qu'il a toujours été une femme.
Sexe
Satire du duel d'escrime entre Monsieur de Saint-George et Mademoiselle la chevalière d'Éon de Beaumont à Carlton House le 9 avril 1787. Gravure de Victor Marie Picot basée sur l'œuvre originale de Charles Jean Robineau
Sa prétendue folie alimente les arguments de Treyssac de Vergy et d’Ange Goudar, deux hommes de plume aux ordres de l’ambassadeur. La rumeur se fait persistante, alimentée par l’attitude équivoque, non-conformiste du chevalier. Son changement de sexe n’y est pas non plus étranger. De fou, on le prétend hermaphrodite, puis femme. Les Britanniques réalisent de nombreuses caricatures du chevalier qu'ils baptisent Épicène8 d'Éon. Ils vont même jusqu'à ouvrir des paris sur son sexe : un parieur traînant en justice un autre parieur, le tribunal, avec de faux-témoins et en l'absence d'Éon, le reconnaît comme femme. Ce changement de sexe et ce travestissement supportent plusieurs interprétations, interprétations freudiennes, névrose, délire narcissique, schizophrénie, etc, comme des lectures purement politiques ou stratégiques.
À cette même époque, d'Éon est en liaison avec le libelliste français Charles Théveneau de Morande. En 1775, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais est envoyé à Londres par le roi de France Louis XVI pour récupérer auprès du chevalier d'Éon la correspondance échangée avec le feu roi Louis XV, notamment ses projets de débarquement et les Mémoires de Mme du Barry écrites par Théveneau de Morande. Après maintes péripéties, une transaction de plus de vingt pages est conclue entre eux deux qui stipule notamment la remise intégrale des documents et que la chevalière ne quittera plus jamais ses vêtements féminins, se faisant désormais appeler Mlle Éon. En échange de quoi la rente viagère lui était accordée. Les négociations ont duré quatorze mois.
D'Éon quitte Londres le 13 août 1777 et se présente à la Cour en capitaine de dragons. Une ordonnance est prise le 27 août 1777 par le roi Louis XVI qui, par vengeance ou parce qu'il croyait que c'était vraiment une femme, lui donne ordre de quitter l'uniforme de dragons qu'elle continue à porter et de reprendre les habits de son sexe avec défense de paraître dans le royaume sous d'autres habillements que ceux convenables aux femmes : habillé par Rose Bertin aux frais de Marie-Antoinette, il est présenté à la Cour en robe à panier et corset le 23 novembre 1777. Il devient la coqueluche de la capitale mais voulant participer à la guerre d'indépendance des États-Unis, il se rhabille en dragon. Arrêté le 20 mars 1779, il est exilé à Tonnerre où il se résout à s'occuper de son domaine familial.
Fin de vie
En 1783, le roi le laisse revenir à Paris. En novembre 1785 muni d'un passeport, il regagne la Grande-Bretagne où le propriétaire londonien de son appartement lui réclame ses loyers alors qu'il ne bénéficie plus de sa rente. Bien qu'ayant accueilli favorablement la Révolution française et proposé à l'Assemblée nationale de conduire une unité d'Amazones, il perd en effet sa pension. La déclaration de guerre du 1er février 1793 et de lourdes dettes le contraignent à demeurer sur le sol britannique6. Il se retrouve dans une demi-misère, doit survivre par des duels en escrime et vendre sa bibliothèque en mai 1791. Il est finalement recueilli par une dame britannique de son âge, la veuve Mrs Mary Cole. Il continue de se battre en escrime, toujours en habits de femmes, gardant une agilité malgré une forte corpulence, jusqu'à l'âge de 68 ans. Il est gravement blessé lors d'un dernier duel en août 1796 : il est blessé par un fleuret qui casse et qui lui transperce le poumon.
En 1804, il est emprisonné pour dettes ; libéré, il signe un contrat pour publier une autobiographie mais est paralysé à la suite d'une chute due à une attaque vasculaire. Grabataire, il vivra encore quatre ans dans la misère, avant de mourir, à Londres, le 21 mai 1810 à l'âge de 82 ans.
En effectuant la dernière toilette de la défunte, on découvre avec stupéfaction que cette vieille dame… est un homme.
Le chirurgien M. Copeland accompagné de dix-sept témoins, membres de la Faculté médicale de la Grande-Bretagne déclare dans un rapport médico-légal10, le 23 mai 1810 : " Par la présente, je certifie que j'ai examiné et disséqué le corps du chevalier d'Éon en présence de M. Adair, de M. Wilson, du père Élysée et que j'ai trouvé sur ce corps les organes mâles de la génération parfaitement formés sous tous les rapports" .
Le chevalier d'Éon, habillé quarante-neuf ans en homme et trente-trois en femme, est enterré au cimetière de la paroisse Saint-Pancrace, dans le comté de Middlesex.
Postérité Éonisme
L'éonisme désigne l'inversion esthético-sexuelle correspondant au besoin qu'éprouvent certains hommes d'adopter des comportements vestimentaires ou sociaux socialement considérés comme féminins. Deux approches de l'éonisme prévalent : le psychologue Havelock Ellis considère que l'éonisme serait la première étape de l'inversion sexuelle, celle-ci s'exprimant symboliquement sur un plan vestimentaire. Le psychiatre Angelo Hesnard pense que l'éonisme est un moyen d'appropriation de l'image de la femme par le travestisme et peut conduire à une forme de perversion sexuelle. Dans certaines pratiques sexuelles, notamment le fétichisme, l'éonisme est un stimulant puissant. À ce titre, le chevalier d'Éon est considéré par la communauté LGBT comme le saint patron des travestis.
Pour expliquer son ambiguïté sexuelle sont évoqués également les syndromes de Kallmann, d'insensibilité aux androgènes, de Klinefelter ou de transvestisme.
Toile, peinture.
En 2012, un portrait du chevalier d'Éon réalisé en 1792 par le peintre Thomas Stewart, perdu depuis 1926, est retrouvé dans une salle des ventes new-yorkaise par le vendeur et historien d'art Philip Mould.
Ouvrages
Éloge du comte d'Ons-en-Bray publié in L'Année littéraire, 1753
Essai historique sur les différentes situations financières de la France sous le règne de Louis XIV, Ballard, 1753
Mémoire sur l'utilité de la culture des mûriers et de l'éducation des vers à soie en France, Paris, 1758
Les Loisirs du chevalier d'Éon de Beaumont, ancien ministre plénipotentiaire de France, ses divers sujets importants d'administration, etc. pendant son séjour en Angleterre, 13 volumes, Amsterdam, 1774
Lettres, Mémoires & Négociations particulières du Chevalier d'Eon, Ministre Plénipotentiaire de France, Londres, 1764
Frédéric Gaillardet, Mémoires du chevalier d’Éon collection de documents commentés, Paris, 1836. 2 vol.
Il a inspiré la série Chevalier d'Eon, agent secret du roi, d'Anne-Sophie Silvestre
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Dans la culture populaire
Théâtre
La Chevalière d'Éon : comédie historique en deux actes, mêlée de couplets, de Charles Dupeuty et Charles-Auguste Clever, baron de Maldigny, 183715
Le Chevalier d'Éon : comédie en trois actes, mêlée de chants, de Jean-François Bayard et Dumanoir, 1837
Eonnagata, pièce mêlant théâtre et danse, de Robert Lepage, 2010
Éon/Beaumarchais ou la Transaction, de Christian Bédard, 1991
Cinéma
1959 : Le Secret du chevalier d'Éon, un film de Jacqueline Audry, avec Andrée Debar, Bernard Blier et Isa Miranda
1996 : Beaumarchais, l'insolent, un film de Édouard Molinaro, avec Fabrice Luchini, Claire Nebout et Sandrine Kiberlain
Télévision
Le Chevalier d'Éon シュヴァリエ, Shuvarie, série d'animation de 2006 en 24 épisodes de Kazuhiro Furuhashi racontant la vie romancée du célèbre espion de Louis XV.
Qui se cachait derrière le chevalier d’Éon ?, documentaire, Secrets d'histoire, France 2, 22 juin 2008.
Chanson
Dans la chanson Sans contrefaçon, la chanteuse Mylène Farmer se dit être le Chevalier d'Éon en faisant allusion à son déguisement.
Dans la chanson Mon Chevalier d'Éon, la chanteuse du groupe Perox raconte son histoire d'amour avec un certain Chevalier d'Éon.
Bande dessinée et dessin animé
Il a inspiré le manga La Rose de Versailles de Riyoko Ikeda paru au Japon en 1972, puis adapté au cinéma par Jacques Demy Lady Oscar, 1978 et en série animée Lady Oscar, 1979.
Le manga Le Chevalier D'Eon traite des personnages de Lia de Beaumont et d'Éon de Beaumont comme étant frère et sœur et retrace leurs aventures à la cour comme dans l'Europe entière; manga de Kazuhiro Furuhashi, paru en 2006. Une adaptation en anime a été réalisée. L'anime est diffusé par Kazé en streaming légal et gratuit.
Lien
http://youtu.be/7EXOJc6qDpo Chevalier d'Eon
[img width=600]http://1.1.1.4/bmi/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Le_chevalier_d%E2%80%99%C3%89on_(1728-1810).jpg[/img]          
Posté le : 04/10/2014 12:25
Edité par Loriane sur 06-10-2014 22:54:07
Edité par Loriane sur 06-10-2014 22:54:50
|
|
|
|
|
Diderot 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 5 octobre 1713 à Langres naît Denis Diderot
mort, à 70 ans le 31 juillet 1784 à Paris écrivain, philosophe, encyclopédiste, Écrivain, Romancier, Dramaturge, Conteur, Essayiste, Dialoguiste, Critique d'art, Critique littéraire, Traducteur français des Lumières
Avec d'Alembert, Diderot fut fondateur et rédacteur de l'Encyclopédie, 1751-1772. Grand amateur de musique, il se donna la tâche de traiter des instruments et des questions d'ordre esthétique concernant cet art. D'autres ouvrages de Diderot réservent une place à la musique, comme ses Mémoires sur différents sujets de mathématiques Paris, 1748, en quatre parties, où il traite des problèmes d'acoustique et d'un projet pour la construction d'un orgue mécanique. Dans le Neveu de Rameau inédit à sa mort, le philosophe attaque le célèbre compositeur en affirmant : Il n'est pas décidé que ce soit un génie …, qu'il soit question de ses ouvrages dans dix ans. En 1771, Diderot fit paraître un livre intitulé Leçons de clavecin et principes d'harmonie par M. Bemetzrieden, sous forme de dialogue, dans lequel l'auteur donne des leçons à un élève, son fils. Comme J.-J. Rousseau, Diderot se prononça en faveur de la musique italienne lors de la Querelle des bouffons en 1752, et contre les partisans de l'ancien opéra à la manière de Rameau.
Diderot est reconnu pour son érudition, son esprit critique et un certain génie. Il laisse son empreinte dans l'histoire de tous les genres littéraires auxquels il s'est essayé : il pose les bases du drame bourgeois au théâtre, révolutionne le roman avec Jacques le Fataliste, invente la critique à travers ses Salons et supervise la rédaction d'un des ouvrages les plus marquants de son siècle, la célèbre Encyclopédie. En philosophie également, Diderot se démarque en proposant plus de matière à un raisonnement autonome du lecteur plutôt qu'un système complet, fermé et rigide. Rien en fait ne représente mieux le sens de son travail et son originalité que les premiers mots de ses Pensées sur l'interprétation de la nature 2e éd., 1754:
"Jeune homme, prends et lis. Si tu peux aller jusqu'à la fin de cet ouvrage, tu ne seras pas incapable d'en entendre un meilleur. Comme je me suis moins proposé de t'instruire que de t'exercer, il m'importe peu que tu adoptes mes idées ou que tu les rejettes, pourvu qu'elles emploient toute ton attention. Un plus habile t'apprendra à connaître les forces de la nature ; il me suffira de t'avoir fait essayer les tiennes."
Mal connu de ses contemporains, tenu éloigné des polémiques de son temps, peu enclin à la vie des salons et mal reçu par la Révolution, Diderot devra attendre la fin du XIXe siècle pour recevoir enfin tout l'intérêt et la reconnaissance de la postérité dans laquelle il avait placé une partie de ses espoirs.
En Bref
Il est vrai que toute grande œuvre se suffit : mais plus l'auteur a été engagé dans l'action, plus il a procédé par allusions, avouées ou secrètes, à son expérience, plus il s'est exprimé et trahi par son style, plus, alors, sa vie nous éclaire. Or, toutes ces raisons valent pour Diderot : il faut tenter de le connaître. Pour commencer par les dehors, on lira des biographies. On ira plus avant en ouvrant la Correspondance, où, comme a dit Paul Vernière, on a déjà le véritable Diderot, naïf mais madré, enthousiaste mais rationnel, simple et pontifiant, jovial et mélancolique, généreux et intéressé, indiscret et fidèle, impudique et secret. Un troisième visage – sans parler de ceux que procurerait l'enquête psychanalytique – apparaîtrait en décryptant, ce travail est loin d'être fait les souvenirs et allusions parfois énigmatiques que l'auteur, surtout vieillissant, a multipliés dans ses œuvres. Parmi d'autres énigmes, pourquoi, dans Jacques le Fataliste, avoir situé rue Traversière, où il a habité, une maison de passe ? Pourquoi mettre dans la bouche de d'Alembert et de Julie de Lespinasse une doctrine qui ne pouvait être la leur ?
On s'en tiendra ici au cadre biographique. Dans ce cadre, en arrière-fond, on aurait à peindre le siècle de Louis XV tel qu'il pouvait apparaître à un Parisien averti, avec ses guerres, ses voyages, ses colonisations, ses théories économiques, avec, plus proches du modèle, les luttes qui opposent le Parlement janséniste à la Cour acquise aux jésuites, avec, enfin, en avant-plan, dans l'éclairage des Lumières, tous les événements philosophiques qui alimentaient journaux, pamphlets, traités, essais. Quant au modèle même, Diderot, il faudrait, par un système de miroirs, en montrer les divers visages simultanés ou successifs : ici, le philosophe qui médite sur la nature de la matière, du mouvement, de la vie ou de l' âme ; là, le critique d'art ; ailleurs, le directeur de l'Encyclopédie, qui improvise, qui compile, s'instruit de toutes sortes de métiers ; dans un autre miroir, le dramaturge qui théorise ou qui sermonne ; à moins que ce ne soit le conteur ou le satiriste ; ou encore l'épistolier. Auteur innombrable, l'un des plus représentatifs de son temps, et l'un de ceux qui lui survivent.
Sa vie Naissance d'un philosophe
Denis Diderot naît à Langres, dans une famille bourgeoise le 5 octobre 1713 et est baptisé le lendemain en l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Langres, la cathédrale étant réservée aux baptêmes de nobles.
Ses parents mariés en 1712 eurent six enfants dont seulement quatre atteignirent l'âge adulte. Son père Didier Diderot, maître coutelier, était réputé pour ses instruments chirurgicaux, scalpels et lancettes notamment. Son grand-père Denis Diderot, coutelier et fils de coutelier, s'était marié en 1679 à Nicole Beligné, de la célèbre maison de coutellerie Beligné. Sa mère Angélique Vigneron était la fille d'un maître tanneur.
Diderot était l'aîné de cette fratrie dont chaque membre tint un rôle important dans la vie de l'écrivain. Angélique, ursuline, mourut jeune au couvent et inspira La Religieuse; Didier-Pierre embrassera la carrière ecclésiastique et sera chanoine de la cathédrale de Langres. Les relations entre les deux frères seront toujours conflictuelles, au-delà même du décès de Denis. Denise, enfin, également restée au pays, sera le lien permanent et discret entre Diderot et sa région natale.
De 1723 à 1728, Denis suit les cours du collège jésuite, proche de sa maison natale. À douze ans 725, ses parents envisagent pour lui la prêtrise et, le 22 août 1726, il reçoit la tonsure de l'évêque de Langres et prend le titre d'abbé dont il a la tenue. Il doit succéder à son oncle chanoine à Langres, mais sa mort prématurée sans testament ne peut faire bénéficier son neveu de sa prébende.
De sa mère, il ne parlera que par occasions. En revanche, son père, un petit industriel coutelier, garde sur lui une influence décisive : Un des moments les plus doux de ma vie, ce fut ... lorsque mon père me vit arriver du collège les bras chargés de prix. Du plus loin qu'il m'aperçut, il laissa son ouvrage, il s'avança sur sa porte et se mit à pleurer. C'est une belle chose qu'un homme de bien et sévère qui pleure. Voilà le ton. Sans cette image paternelle on ne comprendrait ni que le fils ait tenu à écrire dans l'Encyclopédie l'article Coutelier, ni, d'une façon générale, le moralisme dont les Entretiens d'un père avec ses enfants, pris sur le vif, à Langres, proposent le modèle, que l'on retrouve sous la plume du dramaturge, Le Père de famille, 1758 ; Le Fils naturel, 1757, du critique d'art, sur Greuze ou littéraire, sur Richardson, etc. Ce moralisme, souvent trop bavard – rien de tel chez un La Mettrie ou un Helvétius – n'en apparaît pas moins, dans l'œuvre, en permanent conflit avec l'amoralisme, comme si la nature et la société ne cessaient de se quereller en un dialogue semblable à celui du Philosophe et du neveu de Rameau. Denis va avoir quatre sœurs. L'aînée l'étonnera : Socrate femme. La plus jeune, Angélique, finira folle dans un couvent d'ursulines ; il s'en souviendra en composant La Religieuse. Un frère enfin 1722, qui, devenu prêtre, sera le prototype de l'intolérance butée. Diderot reprendra dans l'Encyclopédie, Intolérance une lettre qu'il lui avait adressée en 1760.
Après d'excellentes études au collège des jésuites, en vue de la prêtrise – on le tonsure abbé le 22 août 1726 –, cet adolescens multiplici nomine commendatus vient à Paris en 1728 ou 1729, et l'on dispute encore pour savoir s'il entre au collège d'Harcourt, chez les jansénistes, ou à Louis-le-Grand, chez les jésuites, à moins qu'il ne soit passé de l'un à l'autre établissement. Puis sa trace se perd à peu près jusqu'en 1742. Quelques détails : maître ès arts en septembre 1732, on le devine tour à tour gratte-papier chez un avoué, précepteur chez un banquier ; il s'instruit, il mathématise, il apprend de l'anglais, il hésite entre la Sorbonne et la comédie ; en 1741 il rencontre Antoinette Champion : en bref, il mène une vie de bohème, et c'est là qu'il importerait de dépister, dans l'œuvre, toutes les allusions à ces années d'apprentissage, entre seize et vingt-neuf ans, sans la connaissance desquelles Diderot gardera toujours pour nous un secret.
Premières années
Peu intéressé par la carrière ecclésiastique, ni davantage par l'entreprise familiale et les perspectives de la province, il part étudier à Paris en 1728. Il ne reviendra plus guère à Langres que quatre fois, en 1742, à l'automne 1754, en 1759 et en 1770 et essentiellement pour régler des affaires familiales.
Ses premières années parisiennes sont mal connues. De 1728 à 1732, il suit sans doute des cours au collège d'Harcourt puis étudie la théologie à la Sorbonne. En tous cas, le 6 août 1735, il reçoit une attestation de l'université de Paris qui confirme qu'il a étudié avec succès la philosophie pendant deux ans et la théologie durant trois ans.
Les années 1737-1740 sont difficiles. Diderot donne des cours, compose des sermons, se fait clerc auprès d'un procureur d'origine langroise, invente des stratagèmes pour obtenir de l'argent de ses parents, au désespoir de son père.
Ses préoccupations prennent progressivement une tournure plus littéraire. Il fréquente les théâtres, apprend l'anglais dans un dictionnaire latin-anglais, et donne quelques articles au Mercure de France — le premier serait une épître à M. Basset, en janvier 1739. À la fin des années 1730, il annote une traduction d'Étienne de Silhouette de l'Essay on man d'Alexander Pope et se tourne vers la traduction.
Diderot rencontre Jean-Jacques Rousseau à la fin de 1742. Une forte amitié naît entre les deux hommes. C'est sur la route du Château de Vincennes, où est enfermé Diderot, que Rousseau a la fameuse illumination qui lui inspirera le Discours sur les sciences et les arts. Diderot lui-même n'est d'ailleurs pas étranger à certaines idées du texte. Par l'intermédiaire de Rousseau, Diderot rencontre Condillac en 1745. Ils forment à trois une petite compagnie qui se réunira souvent.
En 1742, il a traduit l'Histoire de la Grèce par Temple Stanyan – et il se lie avec Rousseau : le voici engagé dans la carrière, assez nouvelle au XVIIIe siècle, d'écrivain non pensionné et sans mécène, qui ne devra rien qu'à sa plume. Contre le vœu de son père, auquel il n'avouera son mariage qu'en 1749, il épouse, le 6 novembre 1743, Antoinette Champion ; trois enfants mourront en bas âge avant Marie-Angélique 1753, la future Mme de Vandeul, qui écrira la vie de son père. En 1744, Rousseau lui présente Condillac. L'année suivante, son adaptation annotée de l'Essai sur le mérite et la vertu, de Shaftesbury, laisse admettre qu'il croit encore à un Dieu providentiel. Mais, avec les Pensées philosophiques 1746, il a déjà évolué vers le déisme et la religion naturelle. Il n'ose produire la Promenade du sceptique 1747, qui ne verra le jour qu'en 1830. En 1748, quelques mois avant les Mémoires sur différents sujets de mathématique, il publie, pour satisfaire dit-on aux dépenses de sa maîtresse, Mme de Puisieux, les fameux Bijoux indiscrets. Sa mère meurt. L'Esprit des lois paraît : Diderot sera le seul homme de lettres à suivre le convoi funèbre de Montesquieu.
L'Encyclopédie
Ces années 1748-1749 inaugurent, avec L'Esprit des lois et les œuvres de La Mettrie, de Maillet, Condillac, Buffon, la nouvelle vogue des Lumières qui durera jusque vers 1765. Depuis octobre 1747, d'Alembert et Diderot sont chargés de mener à bien le projet de l'Encyclopédie, dont le Prospectus, probablement de notre auteur, sera lancé dans le public en 1750. La grande aventure commence : J'arrive à Paris. J'allais prendre la fourrure et m'installer parmi les docteurs en Sorbonne. Je rencontre sur mon chemin une femme belle comme un ange ; je veux coucher avec elle, j'y couche, j'en ai quatre enfants ; et me voilà forcé d'abandonner les mathématiques que j'aimais, Homère et Virgile que je portais toujours dans ma poche, le théâtre pour lequel j'avais du goût ; trop heureux d'entreprendre l'Encyclopédie, à laquelle j'aurai sacrifié vingt-cinq ans de ma vie. Une existence ne se faisant pas avec des si , comment apprécier ce que, dans cette aventure, Diderot aura gagné une information de style moderne, journalistique et perdu l'abandon ou la remise à plus tard – à trop tard ? – de l'œuvre personnelle ?
En avril ou juin 1749, il commet d'ailleurs l'imprudence de publier sa Lettre sur les aveugles où, du déisme, un pas de plus l'a conduit à l'athéisme et au matérialisme. Le 24 juillet, il est jeté en prison à Vincennes, où Rousseau lui fait la visite qui prête encore à polémiques : la thèse du Discours sur les sciences et les arts a-t-elle été suggérée en boutade par le prisonnier, ou est-elle apparue, en une illumination, à Rousseau dans le bois de Vincennes ? En tout cas, Diderot résiste mal à la prison : il flanche, il trahit ; quand il en sort, le 3 novembre, peut-être est-il voué comme le veut Michel Butor ou André Billy – contre l'opinion de Dieckmann – à n'écrire et surtout à ne publier qu'avec les ruses d'un Jacques fataliste devant ses maîtres. Tout en travaillant pour l'Encyclopédie, dont le tome premier sera distribué aux souscripteurs le 28 juin 1751, il se lie avec Grimm, avec d'Holbach, il donne la Lettre sur les sourds et muets 18 févr. 1751, polémique en faveur de l'abbé de Prades dont la thèse nov. 1751 pouvait passer pour une défense de la religion naturelle, prend parti pour les Italiens dans la querelle des Bouffons d'août 1752 à mars 1754, fait imprimer ses Pensées sur l'interprétation de la nature en novembre 1753 et – peut-être parce qu'au même mois sort le tome III de l'Encyclopédie déjà condamnée par un Conseil du roi – les diffuse si peu qu'il en procurera en 1754 une nouvelle édition que l'on croira longtemps être la première. Il rencontre Sophie Volland. En 1756 commence la guerre de Sept Ans. Les défaites, l'attentat de Damiens 5 janv. 1757 vont accroître les résistances contre l'Encyclopédie dont le tome VII mi-nov. contient l'article « Genève » de d'Alembert auquel Rousseau répliquera l'année suivante fin sept.. Désormais, le citoyen de Genève va s'éloigner de ses anciens amis. D'Alembert lui-même prend peur et déserte – alors que se déclenche la guerre des cacouacs contre les « philosophes » –, Diderot reste seul à la tête de la grande et périlleuse entreprise. Il tient bon pour ne pas ruiner les libraires.
Mieux, il trouve le temps de poursuivre son œuvre propre : au Fils naturel de 1757 qui ne sera joué à Paris qu'en 1771, il adjoindra en novembre 1758 le Discours sur la poésie dramatique, un mois après Le Père de famille, la première parisienne n'aura lieu qu'en 1761. Pour comble, le scandale provoqué l'été 1758 par le livre d'Helvétius, De l'esprit, alourdit l'atmosphère et brise, pour sept ans, l'essor de l'Encyclopédie, interdite dès mars 1759. En juin, à Langres, mort du père, dans son fauteuil, sans souffrance apparente. En septembre, Diderot rédige son premier Salon pour la Correspondance littéraire de Grimm, mais, en 1753, il avait déjà réfléchi, pour l'Encyclopédie, à la « Composition en peinture » : les Salons, on le sait, feront de notre philosophe un des créateurs de la critique d'art ; on sait beaucoup moins qu'ils ont servi à transformer, dans sa technique, le portrait romanesque. L'année suivante, au départ pour mystifier un marquis crédule, il ébauche La Religieuse. Il se consacre aux dix derniers tomes de l'Encyclopédie – ils ne seront distribués qu'en janvier 1766 – et, en grande partie pour répliquer à l'infamie de Palissot, burine 1762 les premiers traits du Neveu de Rameau. Les Salons se succèdent : 1761, 1763, 1765, 1767... En 1765, Catherine II lui achète sa bibliothèque, dont elle lui laisse à vie la jouissance. Enfin, le voici libéré de l'Encyclopédie, après avoir découvert en 1764 que son libraire, Le Breton, avait osé le censurer : Vous m'avez lâchement trompé deux ans de suite. Vous avez massacré ou fait massacrer par une bête brute le travail de vingt honnêtes gens.
L'œuvre individuelle
Désormais, Diderot peut reprendre ses œuvres inachevées ou en entreprendre de nouvelles : Le Rêve de d'Alembert août 1769, le Supplément au voyage de Bougainville 1772, en même temps qu'il collabore à l'Histoire des deux Indes de l'abbé Raynal. De juin 1773 à avril 1775, il voyage : il séjourne deux fois à La Haye où il annote la Lettre sur l'homme de François Hemsterhuis, et, pour le réfuter, le livre De l'homme d'Helvétius ; surtout, il passe cinq mois auprès de Catherine II, qu'il est venu remercier, et pour laquelle il dresse des plans de gouvernement et d'université. Rentré à Paris, il écrit l'Entretien avec la maréchale ** en 1776, l'Essai sur les règnes de Claude et de Néron en 1778. Il vieillit. Il ne publie pas. Il a renoncé, en 1774 puis en 1777, au projet d'une édition complète de ses œuvres. Ses grands chefs-d'œuvre sont d'abord connus en Allemagne et en allemand : les Essais sur la peinture, Le Neveu de Rameau, traduits par Goethe ; le plus long épisode de Jacques le Fataliste, traduit par Schiller ; Les Deux Amis de Bourbonne dont Schiller s'inspirera pour écrire Les Brigands et l'Entretien d'un père avec ses enfants, traduits par Gessner – est-il besoin de rappeler combien, après Lessing, Diderot retiendra, par ces traductions, l'attention de Hegel ? En 1784, Sophie Volland s'éteint en février ; et, le 30 juillet, comme s'il répétait la mort de son père, Diderot s'éteint à son tour, sans souffrance, dans son fauteuil.
La philosophie
Le monde
On l'appelait le Philosophe. On traduirait mal par « honnête homme » un encyclopédiste se piquant de tout. Mais il garde de l'honnête homme le dédain de la scolastique, l'amour des idées claires, le goût des lettres, la méfiance à l'égard de toute proposition que ne garantit pas l'expérience. Pas de systèmes, donc. Et, du même coup, le modèle mathématique dont se réclamaient ces systèmes more geometrico perd son privilège. Autres modèles : la philosophie de Newton, la psychologie de Locke, l'Histoire naturelle de Buffon, l'économie des physiocrates, la chimie de Rouelle. L'expérience ! toujours l'expérience ! et son corrélatif : la nature. À l'esprit de système du XVIIe siècle succède l'esprit de l'Encyclopédie, qui cherche à dresser l'inventaire de nos connaissances, à réaliser notre avoir afin de le mieux exploiter.
À l'évidence cartésienne, jugée trop subjective, on préférera la certitude expérimentale. Il en résulte que le philosophe doit s'inspirer de la science ou, mieux, des sciences. Or les sciences ne s'éclairent que par des théories qui dépassent les sens. Ces théories ne sont pas celles qu'imaginent les savants pour faire progresser leurs disciplines. Elles sont pour le philosophe une recherche de principes. C'est revenir à la métaphysique. Cependant, l'observable témoignant, assure-t-on, contre le dualisme, il n'y a plus ni Dieu ni âme – donc, non plus, de pourquoi –, toute transcendance est chassée, et cette métaphysique ne peut plus se reconnaître dans la métaphysique traditionnelle : elle est recherche – précritique, menée à partir de l'objet et non pas du sujet – des principes constitutifs du monde et de la nature et, par là, de l'expérience.
Le monde est un tout matériel : le tout. Dans l'espace absolu, la matière se distribue, sans vide, en molécules. Elle ne se réduit pas à l'étendue homogène et uniforme de Descartes : ses molécules sont hétérogènes et il n'en est pas deux d'identiques. Le mouvement lui est essentiel, et non pas inhérent comme le voudrait le déisme. Cela veut dire qu'elle se meut d'elle-même, sans avoir besoin d'impulsion ou de chiquenaude divine, et qu'il n'y a de repos nulle part ni jamais. La seule force d'impulsion n'explique pas ce mouvement : le mécanisme cartésien n'exprime que le plus superficiel des phénomènes. La force d'attraction ne suffit pas non plus, bien que son dynamisme pénètre à l'intérieur des masses homogènes que considère le système du monde. Sans doute, pour passer du monde à la nature, faut-il invoquer la force des chimistes capable, elle, de combiner des substances hétérogènes. Du reste, la chimie prélavoisienne fonctionne comme médium entre la dynamique du physicien et le dynamisme vital.
De la pierre à l'homme, du ver à l'étoile, l'univers reste un parce qu'il est un tout. Comment s'y engendre la vie ? Elle ne saurait naître d'une substance qui l'exclurait par hypothèse : mieux vaut, par conséquent, supposer vivantes les molécules hétérogènes de la matière, c'est-à-dire douées, chacune selon son proprium, d'une irritabilité ou réactivité sensible comparable à un toucher obtus. Ensuite, pourquoi ne pas admettre que ces molécules s'organisent selon les combinaisons de leurs affinités chimiques et selon la combinatoire lucrétienne de leur brassement au hasard, durant l'infinité des siècles ? Ainsi se formeraient les organismes où chaque organe se construirait par la fonction que lui imposerait le monde extérieur et s'organiserait intérieurement par les affinités qui combineraient sa sensibilité particulière.
Voilà des organismes. L'espèce de toucher obtus ou sensibilité morte impliquée dans les molécules s'y éploie, par les connexions qui lèvent l'obstacle de la limitation de l'individualité, en sensibilité vive. Sur fond d'inconscient, quelque conscience s'éclaire. Elle est corrélative de l'organisation et de ses états : entièrement obscure dans le minéral, moins opaque dans les plantes, elle devient confuse ou claire chez les animaux, parfois distincte chez l'homme, l'animal au cerveau le plus développé ; elle conserve en chacun tout ce qu'il a vécu ; elle varie du normal au pathologique ; spontanée chez la bête, elle est chez nous susceptible de réflexion. Une infinité de petites expériences qui se répètent passent en habitudes, elles aussi soumises aux particularités de l'organisation, qui se fondent dans l'inconscient et s'héritent avec la structure de l'organisme. Alors, on les appelle instincts. Chaque espèce a les siens. La raison est un instinct de l'homme.
Si l'une des sources de la raison est physiologique, l'autre est sociale. La raison ne se développe que dans et par la société qui lui en offre les loisirs. Toujours en quête de sa nourriture, toujours soumis à ses besoins, l'animal, bien que doué de connaissance, ne saurait accéder à une connaissance réfléchie : son langage naturel, d'action, réponse immédiate de l'émotion et du besoin, ne s'élève jamais au langage de convention. Libérée par la société, l'intelligence humaine n'est plus une simple faculté d'adaptation directe à la nature, elle se change en faculté d'adaptation indirecte, réfléchie, plus large, plus prévoyante.
La morale
D'origine biologique et sociale, la raison n'a de stable que la stabilité de l'organisation et de la nature ; elle change selon les progrès du milieu social. De même qu'un tout organique est un consensus de tendances où chaque organe a son intérêt propre – ce qui est la leçon de Bordeu –, de même la société, harmonisant les tendances individuelles qui cherchent leur satisfaction dans le bonheur, devrait subordonner les intérêts privés à l'intérêt général. Il faudrait donc que l'intérêt général commandât le droit civil, politique et pénal. Par malheur, trop de conventions nées de l'ignorance ont perverti les règles naturelles de la société. D'où le fanatisme religieux, l'esclavage de la pensée, l'inégalité par la loi, les injustices de l'impôt, la mauvaise organisation du commerce, l'absurdité d'un enseignement sans rapports avec les exigences techniques du monde moderne. Cependant, comme toutes les Lumières – inspirées par les physiocrates –, Diderot ne croit pas que l'institution de la propriété soit injuste : il la fonde sur le travail, de l'agriculteur, au départ ; il l'étend même du foncier à la possession de nos enfants, des disciples, des œuvres de la pensée. Mais il ne l'étend pas aux femmes : il s'indigne, au contraire, de l'état de sujétion en lequel on les maintient ; et le mariage qui veut unir par un serment indestructible deux êtres toujours changeants lui paraît contre nature ; il faut le compléter par le droit de divorce. Et c'est encore contre les vocations forcées que milite La Religieuse. Ainsi, le droit des parents à disposer de leurs enfants devient illégitime, dès qu'il devient contre nature. Comment remédier à l'injustice sociale ? D'abord, en rappelant que la souveraineté véritable est le consensus omnium, le contrat ; et, ensuite, en instituant le droit positif sur un libéralisme éclairé.
Rien d'absolu dans la morale, de quelque point de vue qu'on l'envisage. Elle dépend de notre organisation spécifique : dans un monde d'aveugles, le vol serait puni plus sévèrement que dans un monde de clairvoyants. Elle se diversifie selon les organisations individuelles, la fameuse molécule du Neveu de Rameau. Et chaque nation, chaque culte se fait la sienne. En définitive, nous vivons entre deux morales : l'une générale et commune à toutes les nations, à tous les cultes, et qu'on suit à peu près... ; c'est la morale spécifique, respectée « à peu près » en fait, mais respectable en droit ; l'autre morale est propre à chaque nation, chaque culte ; on la prêche, mais on ne la suit pas du tout. Et qu'enseigne l'expérience au philosophe ? un naturalisme utilitaire. Égoïsme et cruauté, tel est, semble-t-il, le fond primitif : c'est que le bon et le mauvais se définissent primitivement par l'utile à l'espèce et à l'individu ; l'égoïsme est principe de conservation, la cruauté exprime l'énergie, principe d'expansion. Si les méchants n'avaient pas cette énergie dans le crime, les bons n'auraient pas la même énergie dans la vertu. Si l'homme affaibli ne peut plus se porter aux grands maux, il ne pourra plus se porter aux grands biens. Aussi, les grands génies se couvent dans les temps difficiles ; il faut, pour les produire, une époque d'« actions atroces. Plaisir, douleur règlent nos premières démarches. Par la société le bon et le mauvais sont changés en bien et en mal. Grâce à je ne sais quelle singerie des organes – sous la dépendance du diaphragme –, la sympathie élève l'amour-propre à l'intérêt général et fait de l'énergie vitale un facteur de progrès. Ce n'est pas un Dieu, c'est la société qui donne l'idéal d'une morale universelle. Cette morale, le philosophe sait qu'elle est sans transcendance, sans innéité spirituelle, qu'elle est patiemment conquise et apprise dans le mouvement même de l'évolution sociale, qui n'est pas fatale, mais soumise à un déterminisme que le législateur doit utiliser. Mais le libre arbitre ? Chimère. Ce qui nous trompe est la prodigieuse variété de nos actions, jointe à l'habitude que nous avons prise tout en naissant de confondre le volontaire avec le libre. Diderot se souvient de Locke. Et de poursuivre : Mais quoique l'homme bon ou malfaisant ne soit pas libre, l'homme n'en est pas moins un être qu'on modifie ; c'est pour cette raison qu'il faut détruire le malfaisant sur une place publique. La sanction se justifie moralement, comme l'éducation, par l'emploi du déterminisme en vue de quelque bien social. Supprimer le libre arbitre, c'est couper à sa racine la superstition du péché et de l'intolérance. La liberté consiste donc à découvrir et à utiliser les lois de la nature et de notre nature pour promouvoir, par la science et par la politique, le progrès moral.
L'esthétique
En ce que nous appelons l'esthétique, Diderot développe une théorie, et l'applique à ses œuvres ou à la critique des écrivains et des artistes.
Quoique infléchie vers le matérialisme, la théorie, fidèle aux Anciens, recommande l' imitation des classiques et de la nature, mais annonce, par sa doctrine du génie, le passage du classicisme au romantisme.
L'imitation présuppose un modèle. Un modèle idéal. D'abord au sens où nous disons d'une figure mathématique ou d'une loi de la physique qu'elle est idéale. La nature étant une, nous agissons et nous pouvons créer selon ses lois : un charpentier incline les étais pour soutenir un mur suivant l'angle qu'aurait calculé un d'Alembert ou un Clairaut ; Michel-Ange donne au dôme de Saint-Pierre la courbe de plus grande résistance, telle que la retrouvera le géomètre de La Hire ; bref, l'instinct – résultat d'une infinité d'expériences ancestrales et individuelles – applique dans l'expérience la figure ou la loi que la réflexion découvre dans la pensée. Pourtant l'artiste n'est pas le savant, il imite les apparences, et l'œuvre qui paraît la plus parfaite serait une ébauche grossière au jugement de la nature. En art, le modèle n'est pas le vrai, mais il doit être au vrai semblable. Cette fois, passant de l'idéalité de la loi à l'idée ou image, le modèle idéal devient le modèle en idée avant sa mise en œuvre. Ce n'est pas tout. Nous n'observons que des individus qui, s'il s'agit des hommes, sont modelés par leur milieu : chaque âge, chaque état, chaque système politique a ses fonctions, ses expressions. En comparant, les déformations fonctionnelles nous renseignent sur la fonction pure, comme le pathologique sur le normal. Nous remontons à l'homme idéal, naturel. Par exemple, l'Apollon du Belvédère représente la beauté naturelle ; l'Hercule Farnèse, la beauté de l'homme laborieux. L'homme d'avant l'action, l'homme d'avant la société, naturel, voilà par conséquent l'homme idéal.
En définitive, la notion de modèle idéal s'organise autour de deux thèmes : l'idéalité des lois physiques ou de l'homme naturel, dont tous les membres bien proportionnés conspirent de la façon la plus avantageuse à l'accomplissement des fonctions animales ; et, au niveau de l'apparence, l'imaginé. Selon le premier thème, l'idéal se présente comme un archétype immuable de la nature – dans la mesure, au moins, où la nature ne change pas : ce modèle est un type dans le style de l'Apollon du Belvédère, ce n'est pas un individu pittoresque, un original ainsi que le Neveu de Rameau. Selon le second thème, l'idéal suit les vicissitudes des croyances sociales, surtout, à l'origine, religieuses : à l'utilité fonctionnelle, biologique, qui définit le beau selon le premier thème s'ajoute derechef le critère d'utilité sociale.
Comment réaliser le modèle idéal ? Tantôt Diderot ne réclame de l'écrivain ou de l'artiste que l'habitude de l'observation directe et la familiarité avec les grandes œuvres : cette habitude ou familiarité engendre une sorte d'instinct qui nous fait sentir la liaison des choses ; animez cet instinct, qu'il prenne verve, voici le beau. Tantôt Diderot invoque le génie : c'est un ressort de la nature ; ses calculs sont inconscients ; il est spécialisé ; il se rattache, sans qu'on sache comment, à une certaine conformation physiologique ; il jouit d'un esprit d'observation singulier qui voit sans regarder, s'instruit sans étudier, s'exerce sans contention. Cet instinct, au sens fort, exige de l'enthousiasme. Médium entre les forces naturelles et les hommes, il ne s'élève que dans les temps difficiles, de cruauté, d'actions atroces ; alors, par-delà la beauté, il rejoint le sublime : La poésie veut quelque chose d'énorme, de barbare et de sauvage.
De toute façon, il appartient à la raison de critiquer les produits de l'enthousiasme. Exécuter une œuvre veut une tête froide, la maîtrise. D'où le paradoxe, si mal compris, du comédien. En deux traits : l'émotion vraie est celle que provoque un événement vrai ; elle se caractérise par la surprise, l'immédiateté de la réponse, le désordre, la croyance en la réalité de l'objet émouvant : or, l'émotion du comédien est répétée, perfectionnée, ordonnée, et son objet est imaginaire. Si donc le comédien est un artiste, lorsqu'il monte sur scène, il doit déjà avoir créé son rôle et n'être qu'un exécutant qui conserve la tête froide.
Le Paradoxe fait comprendre que l'effet du beau artistique n'est pas le plaisir spontané que l'on éprouverait dans la vie quotidienne devant ce qu'il imite : il est le plaisir réfléchi de l'imitation. De même que l'objet artistique n'est pas vrai, mais semblable au vrai, de même le plaisir qu'il procure n'est pas vrai, mais semblable au vrai. Son utilité, on l'a vu, est à la fois vitale et sociale. Loin d'accepter la maxime de l'art pour l'art, Diderot estime, au contraire, que l'art doit imiter le vrai et servir. De là, le réalisme et le moralisme, trop souvent admis ou condamné sans en démêler ni les raisons ni les nuances.
La littérature Le critique
S'il faut imiter la nature, ce qui se manifeste par l'écrivain et par l'artiste, ce ne sont pas des faits, ce sont des expressions, et, par conséquent, le moral commande le physique ou, en d'autres termes, dans l'art le sensible n'importe que par ses significations humaines. Le déchiffreur, le connaisseur des significations humaines, donc le critique d'art par excellence, c'est le philosophe. Il y a, en toute œuvre, une idée – un idéal – et une technique. La technique ne peut être pleinement appréciée que par les gens de métier ; mais elle ressemble à la main docile d'un élève, que Diderot se flatterait de diriger. L'idée, valeur essentielle, relève de la compétence du philosophe ; elle l'emporte sur le faire. On ne distingue pas toujours les limites exactes entre l'idée et le faire, le moral et le technique : la couleur et le clair-obscur sont des mixtes où le mélange du moral et du physique rend également compétents le philosophe et le peintre. Mais le choix du sujet, l'ordonnance, les caractères, les passions et les mouvements – tout ce qui servira à définir le tableau de théâtre – appartiennent au philosophe.
Ce droit de seigneurie, Diderot l'exerce dans tous les domaines. Des Bijoux indiscrets au Neveu de Rameau dont la première édition d'après le manuscrit autographe ne sera publiée qu'en 1891, des pamphlets sur la querelle des Bouffons (1753) aux Leçons de clavecin et principes d'harmonie par M. Bemetzrieder 1771, il prend part aux polémiques – Rameau contre Lulli, Pergolèse contre Rameau, Gluck contre Pergolèse – et conseille Grétry. Se rend-il au théâtre ? L'art du comédien le passionne : il l'analyse, en se fermant alternativement les yeux ou les oreilles ; il cherche quel parti tirer de la pantomime et du tableau ; il rêve de spectacles sans paroles ; il se hasarde à la psychologie du comédien dès Les Bijoux indiscrets, puis avec les Entretiens sur le Fils naturel, la Lettre à Mme Riccoboni 1758 et le fameux Paradoxe, qui est aussi un plaidoyer pour accorder au comédien droit de cité et rang d'artiste. On célèbre surtout les Salons et les Essais sur la peinture, admirés par Goethe et par Baudelaire. On leur reproche trop de moralisme. Ils n'en marquent pas moins la naissance d'un genre qui transformera le portrait du personnage romanesque et intéressera de plus en plus l'écrivain à la peinture. Du reste, malgré des erreurs, Diderot s'est assez peu trompé, et on doit l'applaudir d'avoir su mettre à leur vraie place La Tour, Vernet, Chardin surtout.
Musique, jeu du comédien, beaux-arts, le philosophe interroge toujours : cela est-il semblable au vrai ? y éprouve-t-on le plaisir réfléchi de l'imitation ? L'œuvre est bonne chaque fois que l'on peut répondre « oui » aux deux questions. Quand l'art imite la nature, par reflet la nature imite l'art.
Mêmes critères dans les belles-lettres. Nulle part l'invraisemblance ne se montre plus choquante qu'au théâtre. Il faut réformer le spectacle en libérant le plateau, en l'élargissant, en usant de décors et de costumes réalistes, en assouplissant le jeu du comédien auquel on laisserait le soin d'improviser des cris, des mots inarticulés, des voix rompues, quelques monosyllabes..., bref, la voix, le geste, l'action ... ce qui nous frappe surtout dans le spectacle des grandes passions . Il faut réformer le répertoire : plus de tragédies ampoulées ; substituons la prose au vers, les tableaux aux tirades et aux coups de théâtre, les bourgeois aux héros, les conditions aux caractères ; dans le genre sérieux, créons la tragédie domestique.
La même invraisemblance qu'au théâtre ne reparaît-elle pas dans les romans ? Conduites trop intriguées, personnages conventionnels, dialogues à mille lieues de la nature, les voilà bien. Mais le remède ? On le trouve dans Richardson – sans lequel Diderot en serait peut-être resté à tisser des événements chimériques et frivoles, comme dans Les Bijoux, au lieu de nous amener à sentir ce qui se passe dans la vie, comme dans La Religieuse – en parsemant son récit de petites circonstances, en retenant le langage naturel de la pantomime, en rendant au dialogue toute la diversité des caractères et des conditions.
Théâtre, roman, poésie, quand il s'agit des belles-lettres, la compétence du jugeur ne s'en tient plus au seul moral, ainsi que, trop souvent, dans les Salons, mais s'étend au technique, analysant ici l'harmonie d'un vers de Racine, là corrigeant le plan d'un ouvrage. On peut en croire un des ennemis les plus féroces de notre philosophe, Barbey d'Aurevilly : critique d'art ou littéraire, Diderot a le don le plus rare ; il a l'invention, il ne se borne pas à dire : voilà ce qu'il ne faut pas faire, il a la puissance de dire : Tenez, voilà comment il fallait s'y prendre.
L'écrivain
Diderot s'est aventuré dans tous les genres. On ne parlera pas de ses versifications. À défaut d'épopée, il a rêvé de s'élever au second rang de la hiérarchie littéraire avec le théâtre. Mais rien de plus vieilli que Le Fils naturel, Le Père de famille, rien qui semble moins naturel aujourd'hui que cette chasse au naturel à coups de points de suspension, d'exclamation – ô ciel ! hélas ! – et de prêchi-prêcha philosophique. Tout au plus, lorsqu'il accepte de sortir du pseudo-tragique bourgeois, écrit-il une aimable pièce : Est-il bon ? Est-il méchant ? Au total on retient l'instigateur du mélodrame.
C'est pourtant par les moyens du théâtre – le dialogue et le tableau – que Diderot réussit dans les autres genres : le roman, le conte, la satire, et, même, la correspondance. Cette transposition, certes on la retrouve chez la plupart des romanciers du siècle, par exemple chez Marivaux. Prenez une pièce de théâtre : changez le temps verbal des indications scéniques, insérez quelques dit-il ou dit-elle, et vous obtenez un récit. Inversement, prenez un roman ou un conte, indiquez en jeux de scène les mouvements de ses tableaux, supprimez dit-il ou dit-elle, et vous obtenez du théâtre. Si la transposition frappe davantage chez Diderot, c'est que souvent il la souligne par la disposition typographique des répliques ou des répétitions de comédie – « Eh bien ! Jacques, et tes amours ? – et c'est surtout par la vivacité de son imagination réaliste. Le dialogue, il veut le saisir sur le vif, dans le style des personnages, avec leurs gestes, leurs costumes, leurs accessoires, leurs décors : le tableau devient si parlant qu'il donne l'illusion que chacun des protagonistes a son vocabulaire et sa syntaxe.
Autre secret de Diderot : l'art d'aviver le plaisir réfléchi de l'imitation. Il y parvient de deux manières. L'une est l'interruption, dont le but n'est pas de décevoir l'attente du lecteur, mais de l'exciter. L'autre est l'intervention de l'auteur, Diderot lui-même, qui s'adresse soudain au lecteur, le raille, le consulte, bavarde, de sorte que le vrai éclaire le fictif, le fictif démasque le vrai ; la réalité imaginaire ne se projette plus sur le plan classique du récit, elle occupe toutes les dimensions de son espace.
On a parlé de décousu. Si l'on veut. C'est le décousu de la conversation avec ses liaisons rapides et légères, soit dans un groupe, soit dans le seul à seul de la correspondance, soit dans le commentaire que l'on écrit en dialogue dans les marges d'un auteur. C'est encore le décousu d'un homme qui s'enflamme, qui a de la verve, et qui peut même s'élever jusqu'à l'enthousiasme. Mais qu'on n'oublie pas les ratures. Cette conversation imite la conversation ; cet enthousiasme s'écoute. Ce décousu exige une grande maîtrise, et la maîtrise nous renvoie toujours à l'unité de quelque pensée forte. Il suffit de se laisser aller à ces sortes de rêve : un d'Alembert y engendre toujours un monde à partir du chaos.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=6851#forumpost6851
Posté le : 04/10/2014 12:24
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
119 Personne(s) en ligne ( 73 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 119
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages