|
|
Re: Défi du 15-11-2014 |
|
Modérateur  
Inscrit:
21/03/2013 20:08
De Belgique
Niveau : 44; EXP : 15
HP : 215 / 1078
MP : 1072 / 35550
|
Tu as illustré cette phrase avec brio et des paillettes !
Ah que Johnny te remercie !
Bises
Couscous
Posté le : 16/11/2014 19:02
|
|
|
|
|
Charles Maurras 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 16 novembre 1952 meurt Charles Marie Photius Maurras 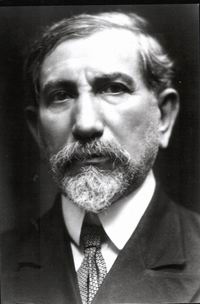
à 84 ans, à Saint-Symphorien-lès-Toursné le 20 avril 1868 à Martigues Bouches-du-Rhône, journaliste, essayiste, homme politique et poète de langue française etprovençale, théoricien du nationalisme intégral, du mouvement néoclassicisme, positivisme et royaliste auteur de poésie, essais et pamphlets il est membre de l'académie Française au fauteuil 16, on parle de style maurassien ou maurassienne. Ses Œuvres principales sont
Enquête sur la monarchie en 1900, Anthinéa en 1901, Kiel et Tanger en 1910, Mes idées politiques en 1937, L'ordre et le désordre en 1948
Écrivain provençal appartenant au Félibrige et agnostique dans sa jeunesse, il se rapproche ensuite des catholiques et dirige le journal L'Action française, fer de lance du mouvement Action française, autour de Léon Daudet, Jacques Bainville, et Maurice Pujo. Nationaliste et contre-révolutionnaire, l'Action française prône alors une monarchie héréditaire, antiparlementaire et décentralisée, mais également un antisémitisme d'État et devient le principal mouvement intellectuel et politique d'extrême droite sous la Troisième République.
En bref
Arrivant à Paris, après de brillantes études au collège religieux d'Aix, le jeune Charles Maurras, d'une famille de petite bourgeoisie provençale, débute obscurément dans le journalisme. Quatre ans plus tard, dans la royaliste Gazette de France, il fera vraiment ses premières armes ; mais de dix-huit à vingt-deux ans, ce qui le préoccupe surtout c'est la foi religieuse perdue et la fascination de la Grèce antique ; c'est, avant la lettre, son Pascal puni et son Voyage d'Athènes 1898.
Esthète, il fréquente bientôt les milieux intellectuels de la capitale, et se mêlent à ses propres réflexions les influences du dilettantisme de Renan, du pessimisme de Schopenhauer, du déterminisme de Taine. Mais d'autres maîtres vont agir sur lui : ce sont, après Anatole France qui endurcit son paganisme, Barrès qui le sensibilise au sens de la patrie, et Mistral qui stimule son amour du terroir et dont le jeune Maurras ne peut oublier l'action politique, tant à propos du régionalisme qu'à propos du choix monarchie-république à la suite de la chute du second Empire.
Le positivisme de Comte permet enfin à l'agnostique de définir un ordre moral et politique en dehors de toutes références religieuses. Enfin Maistre et Bonald apportent des arguments à son traditionalisme, cependant que Le Play et La Tour du Pin précisent ses idées sociales et familiales.
L'année 1895 est décisive pour Maurras. C'est celle de son voyage en Grèce d'où il rapportera Anthinéa, ouvrage que Maurras considérait comme fondamental pour l'expression de sa pensée politique, philosophique, esthétique et où il exprime ce que devrait être pour lui l'ordre du monde ; les premières éditions étant épuisées, Anthinéa fut réédité en 1919 après que l'auteur, pour éviter de compromettre le rapprochement de l'Action française et des catholiques, en eut retiré environ quatre pages, jugées violemment antireligieuses. Plus tard, il en tirera sa critique du romantisme, Barbarie et poésie 1925, Un débat sur le romantisme 1928 ; c'est aussi en 1895 que débute l'affaire Dreyfus qui aura pour Maurras des conséquences marquant l'essentiel de sa pensée politique ; à savoir que l'individu ne doit pas primer l'État, qu'il ne le peut qu'en démocratie et que, pour restaurer l'autorité de l'État, il faut à celui-ci la durée et l'unité de commandement, soit l'hérédité et la monarchie. C'est alors L'Enquête sur la monarchie 1901 qui définit un royalisme à la fois traditionnel et nouveau dans la ligne de la revue L'Action française, fondée par Pujo et Vaugeois en 1899 pour l'institution d'une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée .
Royalisme nouveau parce que Maurras, fidèle à sa pensée philosophique, ne croit pas au droit divin des rois. S'il prône la monarchie héréditaire, c'est que l'éducation lui semble primordiale dans la formation d'un roi comme dans celle d'un artisan ou d'un diplomate et quelle meilleure éducation que celle de la famille et du milieu ? Il s'agit en quelque sorte d'une famille de spécialistes, comme devrait l'être l'ensemble des familles françaises pour un meilleur rendement humain. Les théories monarchistes de Maurras trouvent une large part de leur fondement dans le scientisme, dans le positivisme de son maître à penser, Auguste Comte.
Désormais, la vie de Maurras est toute vouée à son activité de journaliste politique, surtout à partir de 1908, où, devenue un quotidien, L'Action française ne cessera de développer, et généralement sous la forme de violentes polémiques, la philosophie et la doctrine de son chef. Les principales étapes furent les suivantes : en politique extérieure, le journal est résolument germanophobe et mène une campagne pour la revanche de 1870, puis, après 1914, contre les traités de Versailles, jugés trop favorables à l'Allemagne, et contre le briandisme estimé trop européen ; en 1935, il milite pour une entente avec Mussolini, ensuite en faveur de Franco et des accords de Munich, en s'opposant, en 1939, à l'idée d'une guerre dont Maurras affirme l'impréparation. En 1940, quittant Paris pour Lyon, où il poursuit son œuvre de journaliste contre les dissidents de Londres et les collaborateurs de Paris, il s'attache à la politique de Pétain en qui il reconnaît l'homme d'État selon ses vœux. En politique intérieure, les attaques maurrassiennes ont deux cibles qui se confondent : la République d'une part, les juifs et les francs-maçons de l'autre, deux aspects du même dragon que le royaliste doit combattre sans merci et par tous les moyens.
Son talent littéraire donne à ses ouvrages théoriques une grande influence dans les milieux cultivés et conservateurs de France, et ses qualités de polémiste lui assurent une réelle audience dans d'autres, comme l'Académie française à laquelle il est élu le 9 juin 1938. Outre Léon Daudet et Jacques Bainville, Maurras compta parmi ses soutiens des intellectuels comme Georges Bernanos, Jacques Maritain, Thierry Maulnier, Philippe Ariès, Raoul Girardet et la droite littéraire de l'après-guerre Roger Nimier, Jacques Laurent, Michel Déon, Antoine Blondin en fut proche. Avec plus de dix mille articles publiés entre 1886 et 1952, il fut le journaliste politique et littéraire le plus prolifique de son siècle4.
Maurras soutint le régime de Vichy, ce qui lui valut d'être condamné pour intelligence avec l'ennemi à la réclusion criminelle à perpétuité et à la dégradation nationale, le 28 janvier 1945. De cette dernière condamnation découla son exclusion automatique de l'Académie française qui attendit cependant son décès pour procéder à son remplacement. Il meurt en 1952.
Son image de théoricien d'un mouvement politique, due aux traditions savantes et à lui-même, a parfois masqué sa complexité originelle, quand il était un littérateur bohème lié aux avant-gardes, ayant une œuvre et des modes d'action très diversifiés.
Sa vie
En 1868, le 20 avril, naît à Martigues, au 13 quai Saint-Sébastien, Charles Marie Photius Maurras, en Provence. Il est le second fils de Jean Aristide Maurras 1811-1874, un percepteur aux convictions libérales, et de Marie, née Garnier, son épouse, profondément catholique. Ce couple de condition assez modeste se fait apprécier par les aides qu'il prodigue aux plus pauvres. Quelques mois avant la naissance de Charles, ils ont perdu leur premier fils, Romain, âgé de deux ans.
En 1872, la naissance de François Joseph Emile permet d'agrandir la famille. La famille Maurras s'est installée à Martigues au XVIIe siècle ; elle était originaire du pays gavot Haut Var, au sud de Gréoulx, près de Saint-Julien-le-Montagnier.
En 1873, Charles est mis à l'école communale : sa famille est épatée par sa vivacité, ses dons et sa capacité à réciter l'histoire sainte et l'histoire romaine mais il est réprimandé quand il rapporte du provençal à la maison. Charles Maurras écrira que s'il lui était donné de revivre une période de se vie, ce serait sa petite enfance.
Le 3 janvier 1874, il devient orphelin de père10. À six ans, Charles part vivre avec sa mère et son petit frère à Aix-en-Provence.
En octobre 1876, Charles entre en classe de huitième au collège catholique, à Aix-en-Provence, rue Lacépède. À la fin de la septième, il obtient onze prix et pendant quatre ans, il remporte le premier prix de latin.
En 1879, promu élève d'honneur, il reçoit le premier prix d'instruction religieuse mais ce n'est pas un élève sage et il a souvent des sautes d'humeur. Malhabile en mathématiques et en anglais, le latin et le grec le ravissent. Au collège, il se lie avec Xavier de Magallon, auquel le lie une passion pour la poésie et Alfred de Musset, puis il s'enthousiasme pour Frédéric Mistral.
À quatorze ans, il est, soudain, atteint de surdité, cela dégrade aussi ses capacités vocales. Désespéré, le jeune Charles voit s'effondrer tous ses projets, dont celui d'entrer à l'École navale comme le père de sa mère. L'abbé Jean-Baptiste Penon, futur évêque de Moulins et premier latiniste et helléniste du diocèse, propose à Mme Maurras d'aider son fils et celui-ci dira que cette offre spontanée fut la grande bénédiction de sa vie. L'abbé Penon donne des cours particuliers au jeune Charles, ce qui lui permet de revenir parfois au collège pour des cours de rhétorique et philosophie. Alors que Maurras est en révolte contre sa surdité, la lecture de Pascal, qu'il assimile au dolorisme, contribue à lui faire perdre la foi. La perte de la foi et sa surdité le désespèrent et le conduisent à une tentative de suicide qui échouera et n'est connue que par des témoignages indirects.
En 1884, il se raccroche progressivement à la vie et est désigné par ses maîtres, avec quelques-uns de ses amis et condisciples, pour donner des conférences organisées au collège du Sacré-Cœur : Charles Maurras y prononce sa première conférence, qui est aussi son premier texte publié, sur saint Thomas d'Aquin étudiant et lecteur de l'Université à Paris23. La même année, il est reçu – avec mention – à son premier baccalauréat, en 1884, où il excelle en latin et en grec. Il approfondit alors ses lectures philosophiques, s'intéresse à Hippolyte Taine et Ernest Renan qui, pourtant éloignés des milieux cléricaux, remettent en cause l'héritage révolutionnaire et les vagues d'idéalisme qui ont conduit plusieurs fois la France à la défaite et à la Terreur depuis la Révolution.
En 1885, après un échec au second baccalauréat en juillet du fait d'une copie de philosophie jugée trop thomiste, Charles Maurras est admis en novembre de la même année avec la mention Bien : il est reçu en premier en sciences et en philosophie25. L’abbé Penon incite Charles Maurras à monter à Paris car il souhaite l’introduire dans les revues et journaux qu’il connaît, ce qui amène la famille Maurras à quitter Martigues et à s'installer à Paris le 2 décembre 1885.
Période de formation avant l'Action française
Avant la création de l'Action française, Charles Maurras approfondit ses questionnements métaphysiques, s'implique dans la vie littéraire et enrichit sa réflexion politique tout en se lançant dans le journalisme.
Réflexion philosophique
Charles s’inscrit en histoire à la faculté des lettres de Paris, rencontre l’historien orléaniste Paul Thureau-Dangin mais ne peut suivre les cours du fait de son infirmité. En revanche, il se montre un bourreau de travail : lectures innombrables à la bibliothèque Sainte-Geneviève, à l’Arsenal, à la Sorbonne, annotations et rédactions d’articles, perfectionnement de son latin, notamment pour éviter les traductions de Lucrèce en alexandrins qui lui font mal à force de le faire rire.
Maurras écrit dans La Réforme sociale, revue conduite par le sociologue Frédéric Le Play, qui développe une analyse de la société moderne critiquant l’individualisme et prônant des idées corporatistes et familiales dans l’esprit des encycliques papales ; il écrit également pendant cinq ans dans les Annales de philosophie chrétienne, revue dont l’ambition est de combiner la théologie du Docteur Angélique et les idées modernes issues de Lamennais. Entre 1886 et 1888, il collabore au Polybiblion littéraire pour des comptes-rendus d’ouvrages sociologiques ; à partir de l'automne 1886, il rédige aussi le feuilleton bibliographique, Les livres de la semaine de L’Instruction publique, revue de l’enseignement supérieur d’inspiration conservatrice et libérale jusqu’en 1890.
La tournure de sa pensée est encouragée par l’atmosphère intellectuelle du temps qui oscille entre le déterminisme kantien et le pessimisme de Schopenhauer. Il affirme : Le nœud de tous les doutes peut être tranché en un point : en résolvant les problèmes de causalité. ... L’unique mobile de ma vie est l’espoir de rencontrer la vérité.
Entre 1886 et 1889, son questionnement philosophique s'amplifie comme le dialogue épistolaire entre le jeune homme et l’abbé Penon qui tente de le guider vers l’aperception de l’origine divine de la causalité première mais Maurras bute sur la substitution des témoignages de la tradition chrétienne aux preuves rationnelles. Il reconnaît être troublé par la philosophie kantienne de la connaissance ; tout en admirant la méthode géométrique de saint Thomas, il qualifie d’ enfantine la théorie scolastique de la connaissance. Charles Maurras dialogue avec l’abbé Huvelin, vicaire de l’église Saint-Augustin, animal convertisseur selon l’expression de Pierre Boutang, avec des amis séminaristes, avec des philosophes catholiques comme Maurice Blondel et Léon Ollé-Laprune qui ont apprécié ses articles ; mais son exigence de la certitude scientifique empêche Maurras de rencontrer la foi : tiraillé entre le travail de la raison et le désir de certitude religieuse, son agnosticisme se renforce. Ne trouvant pas la foi, Charles Maurras trouve la paix intellectuelle dans la distraction de la littérature car la poésie l’éblouit et dans la méthode positiviste car l’histoire et la philosophie le passionnent.
Activité littéraire
En 1886, Maurras découvre Mistral dans le texte ; il rêve de constituer une anthologie de poésie et de prose provençales et commence un travail de documentation dans ce but33.
En 1887, se définissant comme un pur contemplatif et un solitaire dans le goût sinon de l'école de Spinoza et s'investit dans La Réforme sociale avec pas moins de cent soixante-dix articles jusqu'en juin 1891. Le 23 décembre 1887, il entre au quotidien catholique L’Observateur français dont il deviendra secrétaire de rédaction en octobre 1888 et auquel donnera cent-soixante quatorze articles mais cette grande activité ne fait refluer son amour et sa nostalgie de la Provence. Très vite, le jeune homme rencontre des félibres comme Paul Arène et Albert Tournier.
En 1888, il obtient le prix du Félibrige pour un éloge du poète provençal Théodore Aubanel, il devient membre de cette académie qui s’est fixée comme objectif la restauration de la langue et de la culture d’oc. Durant l’été de la même année, il fait la connaissance de son compatriote Frédéric Mistral, puis, en décembre, du Lorrain Maurice Barrès. À l'âge de vingt ans, il est un des membres les plus influents du Félibrige. Pétri de culture classique Virgile, Lucrèce, Racine et moderne Musset, Lamartine, Mistral, le jeune Maurras éprouve aussi un amour infini pour sa Provence natale.
En 1889, il rencontre Frédéric Amouretti lors des Fêtes félibréennes de Sceaux et devient le secrétaire du Félibrige de Paris. Il publie son premier ouvrage, consacré à Aubanel et devient journaliste littéraire.
En 1890, il rencontre Jean Moréas et devient le théoricien de l'École romane, fondée par le poète du Pèlerin passionné, prônant un néo-classicisme peu enclin à l'académisme. Maurras cherchera à rapprocher félibres et poètes romans. La même année, il ébauche un vaste chant épique de trois mille alexandrins, rassemblés sous le titre de Théocléa et inspiré par la figure de Pythagore en qui il voit le plus grand moraliste de l'Antiquité. Il se lie d'amitié à Anatole France, ce qui contribue au renforcement de son agnosticisme. Il travaille avec ses amis à faire connaître les poètes provençaux au public parisien et à établir des ponts entre symbolisme et provençalisme, notamment en travaillant à un numéro spécial de La Plume.
En 1891, il consacre son deuxième essai critique au poète Jean Moréas, le chef de file de l’École romane, qui lui a été présenté l’année précédente. Il prépare également un court traité visant à établir une doctrine de vivre et de mourir, La Merveille du monde, qui ramasse la recherche philosophique du jeune Maurras mais ne l'achève pas.
Au début de 1892, il rédige la déclaration des Jeunes Félibres fédéralistes qui, soutenue par Mistral, est lue par Frédéric Amouretti. Il ne s’agit plus seulement de défendre culturellement la Provence, mais d’engager une politique de haute lutte qui vise à donner un destin à cette terre et à son peuple.
En 1894, Maurras publie Le Chemin de paradis, mythes et fabliaux.
Jusqu'en 1898, c'est dans la Revue encyclopédique que Maurras livre la plupart de ses articles littéraires : il chronique ainsi les œuvres de Paul Bourget, Jules Lemaitre, Jean Psichari, Willy, Jules Tellier, Gabriele D'Annunzio, Paul Adam, Tristan Bernard, Marcel Schwob, Frédéric Plessis, Jean de Tinan, Remy de Gourmont, Stuart Merrill, Jean Moréas, Hugues Rebell, Pierre Louÿs, Marcel Proust, Henri de Régnier, Pierre Quillard… Dans un article du 1er janvier 1895 de la Revue encyclopédique, le jeune Martégal, qui a lu et analysé l'œuvre de Verlaine, décèle dans les écrits de l’ancien décadent un retour vers le classicisme qu’il salue et contextualise
Évolution politique
Avant sa conversion au monarchisme en 1896, la réflexion politique de Charles Maurras se développe progressivement. De 1885 à 1889, Charles Maurras ne s'intéresse qu'à la philosophie mais le centenaire de la Révolution et le boulangisme qu'il soutient du bout des lèvres ainsi que des recherches historiques en Provence le conduisent à centrer sa réflexion sur la politique.
En 1889, lors du centenaire de la Révolution française, une ébullition historique et philosophique contraste avec la célébration officielle ; des penseurs de différentes tendances, monarchistes, libéraux, conservateurs, catholiques, positivistes mènent une réflexion critique sur les principes revendiquées par la République et qui selon eux menacent le destin français : Ernest Renan affirme que le jour où la France a coupé la tête de son roi, elle a commis un suicide, Edmond Scherer analyse les limites de la démocratie, Émile Montégut parle de la banqueroute de la Révolution. Colloques, publications, débats dans la presse marquent l'anticentenaire intellectuel auquel Maurras participe en suggérant aux hommes les plus intelligents après les cris de triomphe officiels, de douloureux examens de conscience. Charles Maurras, ancien rédacteur de La Réforme sociale fonde sa critique de la Révolution en suivant les développements de l'école de Frédéric Le Play : elle dresse un bilan négatif de la révolution en défendant un programme fondé sur la famille, la hiérarchie sociale, la commune, la participation des citoyens à leur administration, l'indépendance du gouvernement par rapport aux divisions de l'opinion.
De fait, s'il est hostile à la Révolution, il est encore républicain et concède que la République est le meilleur gouvernement pour la France. Il fonde alors sa critique de la philosophie politique de Jean-Jacques Rousseau sur les analyses de Pierre Laffitte qui en soulignent les contradictions plus que sur les théories de Louis de Bonald et de Joseph de Maistre.
Cependant, il est fondamentalement attaché à la décentralisation : en août 1889, se rendant aux archives de Martigues pour une analyse des documents remontant à cent ans en arrière, il découvre les systèmes coutumiers et empiriques, des mécanismes de protection sociale et de solidarité, servant de relais et de protection entre l'individu et l'État central, certains obsolètes mais d'autres utiles et vivaces. Pour Maurras, avec la centralisation, la République n'a pas fait des Français des citoyens mais des administrés. Il développe à l'opposé de l'image de l'historiographie révolutionnaire d'un roi au pouvoir illimité, une image paternelle nourrie de bienveillance et de savoir-faire au sommet d'un État fort mais limité.
En 1894, se rapproche du nationalisme en collaborant à la La Cocarde de Maurice Barrès.
En 1895, Maurras amorce sa conversion au principe monarchique, suivant une démarche intellectuelle se combinant avec le respect pour la personne du comte de Paris. Jusque là il s'est accommodé d'un sentiment politique conservateur, acceptant volontiers de travailler avec des démocrates et des socialistes. Son patriotisme est viscéral, mais cela ne constitue pas une originalité, la gauche de l'époque articulant généralement le discours sur la justice sociale avec l'impératif patriotique et les austères valeurs républicaines50. L'échec de la décentralisation dans le cadre républicain, l'inefficacité du régime parlementaire dans le domaine primordial de la politique étrangère face au danger allemand, l'admiration qu'il porte comme homme d'ordre et de tradition pour le système britannique qui a établi l'équilibre politique et social du peuple de Grande-Bretagne, la lecture de Démosthène et du rôle de la démocratie dans l'effondrement de la Grèce, constituent autant de thèmes de réflexion qui l'inclinent au royalisme en 1895. Il accepte alors de collaborer au journal royaliste Le Soleil.
Du 8 avril au 3 mai 1896, La Gazette de France le charge de couvrir comme reporter les premiers jeux Olympiques modernes, à Athènes. Se basant sur les exemples allemands et anglais, il en revient convaincu que le régime monarchique rend plus fortes les nations qui l'adoptent.
Naissance de l'Action française
En avril 1898, Henri Vaugeois et Maurice Pujo fondent un « Comité d'Action française », qui ne compte aucun royaliste et vise en prévision des élections à ranimer l'esprit de 1875 en instaurant une République patriote conforme au nationalisme originel de la révolution ; républicains, ils avaient participé à l'union pour l'Action morale de Paul Desjardins, groupement d'inspiration kantienne, attaché à faire triompher la morale et la vertu dans les affaires publiques ; Vaugeois se veut l'héritier consciencieux du républicanisme révolutionnaire, auquel le relie la mémoire de son grand-oncle conventionnel ; Maurras rejoint ce groupe même s'il aurait préféré le nom d'intérêt commun à celui d'Action française, moins poignant mais plus précis.
En septembre 1898, Maurras se range dans le camp des antidreyfusards, participant à la campagne contre le capitaine Alfred Dreyfus. Il fait l'éloge d'Hubert Henry, qui avait fabriqué plusieurs faux pour faire croire à la culpabilité du capitaine Dreyfus. Revenant sur l'Affaire Dreyfus en 1930, Maurras dira : Je ne veux pas rentrer dans le vieux débat, innocent ou coupable. Mon premier avis là-dessus avait été que, si Dreyfus était innocent, il fallait le nommer maréchal de France, mais fusiller une douzaine de ses principaux défenseurs pour le triple tort qu'ils faisaient à la France, à la paix et à la raison. Il avait écrit en décembre 1898 à Maurice Barrès : Le parti de Dreyfus mériterait qu'on le fusillât tout entier comme insurgé. Léon de Montesquiou rappellera le rôle crucial de l'Affaire Dreyfus dans la naissance de l'Action française qui s'était fixé comme objectif de lutter contre la trahison, non pas tant la trahison de Dreyfus que celle des Dreyfusards. Il s'agit pour l'Action française de défendre l'armée comme première condition de vie du pays et des hommes qui le composent contre une justice qui lui porterait tort. Pour Maurras, l'Affaire et la mise en cause de l'armée nuisent à la préparation d'une guerre inévitable, où il s'agit de retrouver des provinces perdues ; cette polémique ferait perdre de vue au pays le réalisme politique dans un contexte international menaçant. Maurras prétend ainsi défendre la raison d'État en soutenant l'armée coûte que coûte pour éviter le désastre d'une nouvelle guerre perdue contre l'Allemagne. Il affirme les lois d'un réalisme politique fondé sur un mélange de machiavélisme raisonné et de froide prudence car, selon lui, la confusion entre morale et politique peut engendrer des tragédies pires que les injustices qu'elle prétend corriger. Maurras combat moins le capitaine Dreyfus comme personne que le dreyfusisme comme courant d'opinion qui fragiliserait un pays entouré de grands carnassiers.
En janvier 1899, Maurras rencontre ce groupe puis rejoint la revue l’Action française, fondée par Maurice Pujo et Henri Vaugeois ; en novembre 1899, sa stratégie et son ambition prennent corps : convertir au royalisme tous les nationalistes français à l'heure où le nationalisme est associé au nom de Déroulède et Barrès ; il devient l'inspirateur de la mouvance gravitant autour de la revue qu'il convertit du nationalisme républicain au nationalisme royaliste et au milieu de 1901, la revue est en passe de devenir monarchiste. En revanche, le débat tourne court avec les antisémites de La Libre Parole qui refusent la royauté et préfèrent rester républicains.
En 1905, il fonde la Ligue d'Action française – dont Henri Vaugeois est le président et Léon de Montesquiou le secrétaire général – pour lever des fonds en faveur de L'Action française, devenue l'organe de presse du mouvement. Maurras publie L’Avenir de l’intelligence, qui met en garde contre le règne de l’argent et son emprise sur les intellectuels. Jules Monnerot, François Huguenin, Élisabeth Lévy ont placé haut ce livre, préparé par quinze ans de fréquentation des milieux littéraires et politiques, manifeste pour la liberté de l'esprit, précurseur d'Orwell et Bernanos, voire de la critique situationniste.
En 1906, l’Institut d’action française voit le jour et, en mars 1908, paraît le premier numéro du quotidien L’Action Française, né de la transformation de la revue mensuelle du même nom créée neuf ans plus tôt.
En 1909, Maurras publie, ensuite, une deuxième édition de sa célèbre Enquête sur la monarchie, dans laquelle il se prononce en faveur d’une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée.
En 1911, il préside le Cercle Proudhon, lancé par de jeunes monarchistes hostiles au capitalisme libéral et appelant à l’union avec le courant syndicaliste révolutionnaire inspiré par Georges Sorel. Il reste, cependant, davantage influencé par les conceptions corporatistes et associationnistes du catholique social René de la Tour du Pin.
La campagne de l'Action française contre l'Allemagne commence tôt, dès avant la guerre : en 1911, à l'occasion de la crise d'Agadir, Léon Daudet lance des accusations contre les firmes traitant avec l'Allemagne les laiteries Maggi-Kub par exemple et mène des campagnes de boycottage. L'Action française ne souhaite pas la guerre, mais elle veut, si elle intervient, contribuer à l'unité des Français dans la lutte ; elle dénonce les antimilitaristes dont l'action concrète se traduit selon elle par un affaiblissement de la France, au risque d'une hécatombe de la jeunesse française en cas probable de guerre.
La Première Guerre mondiale
Dans l'immédiat avant-guerre, Maurras pointe avec angoisse les effets de la politique de ses adversaires ; selon lui, les campagnes dreyfusardes ont occasionné l'affaiblissement de l'armée, notamment par le démembrement du Deuxième bureau, ce qui participera à l'impréparation de la France et fait que l'Allemagne sait qu'elle combattra un ennemi borgne. Dans Kiel et Tanger, il vitupère un régime qui ne sait contrer ni les aléas de l'opinion et qui vit de ses divisions, forcément néfaste pour tout pays cerné d'ennemis : au bas mot, en termes concerts, la faiblesse du régime doit nous représenter 500 000 jeunes Français couchés froids et sanglants, sur leur terre mal défendue. En 1913, il écrit : La République nous a mis en retard sur l'Europe entière : nous en sommes à percevoir l'utilité d'une armée forte et d'une marine puissante … à l'heure où les organisations ennemies sont prêtes.
Maurras note au contraire la rapidité des directions impériales allemandes où l'aristocratie et l'institution monarchique jouent comme des forces génératrices de compétence et de production ; il souligne la supériorité institutionnelle de l'Allemagne : Nous avons perdu quarante ans à entrechoquer les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers dans la fumée d'une lutte des classes singulièrement favorable au concurrent et à l'ennemi germanique ; pendant ce temps, Guillaume II négociait entre ses socialistes, ses armateurs et ses financiers, dont les forces uniques, se faisant notre parasite, fructifiaient à nos dépens.
Il soutient alors toutes les initiatives permettant le renforcement de la France et Louis Barthou dira à Pujo à propos de la loi des trois ans de service militaire : sans vos Camelots du roi, je n'aurais jamais pu la faire passer. Inversement, Maurras dénonce les campagnes antimilitaristes des socialistes contre la folie des armements qui n'auront selon lui pour conséquence que de conduire au massacre de la jeunesse française : comme Tardieu et Poincaré, il s'oppose aux conséquences concrètes de l'utopisme pacifiste et de l'irréalisme des internationalistes et dénonce la faiblesse des budgets militaires.
En 1914, il s'insurge contre l'idée répandue par ses adversaires que Raoul Villain est d'Action Française alors qu'il fut membre du Sillon et avant-tout un déséquilibré69. Il constate l'impuissance des théories niant le fait national et le manque de réalisme des socialistes qui avaient conçu l'avenir suivant un développement unilinéaire …, les faits nationaux devant se décomposer.
Dès la déclaration de guerre, il appelle ses partisans à l'union nationale et renonce à la lutte systématique contre le régime républicain comme y invite le duc d'Orléans dans un appel solennel dans L'écho de Paris du 23 avril 1914. Comme preuve de sa bonne volonté, Maurras supprime le chiffre 444 en une du journal, qui renvoyait au décret qui avait innocenté71. Il soutient le gouvernement radical de Viviani et même Aristide Briand, bête noire de l'Action française ou Albert Thomas ancien rédacteur de L'Humanité et ministre des armements.
L'Action française dénonce les industriels traitant avec l'Allemagne. Il en résulte de nombreux procès en diffamation, dont un conduit à la confiscation du quotidien pendant une semaine. Des descentes de police dans les locaux du journal ont lieu de même que des perquisitions chez Charles Maurras, Marius Plateau ou encore Maxime Real del Sarte. En octobre 1917, au cours de l'une de ces perquisitions, diverses armes sont saisies. Le journal de l'Action française tourne alors en dérision ce complot des panoplies, le gouvernement recule et, en novembre 1917, Clemenceau remplacera Painlevé mis en minorité avec l'appui de l'Action française.
En avril 1917, L'Action française lance une campagne en faveur des soldats et de leurs familles ; Maurras défend la création d'une caisse de primes militaires qui associera le combattant aux produits de la Victoire ; ce projet reçoit le soutien de Poincaré et l'État autorisera en juin 1918 la souscription lancée par l'action française. De même, Maurras se met à la disposition de Poincaré pour combattre l'influence germanique en Espagne, en particulier dans les milieux catalans.
C'est avec l'appui de l'Action française qu'en novembre 1917 Georges Clemenceau est nommé à la tête du gouvernement en dépit de la réticence de Maurras pour ce jacobin anticlérical et qui refusé l'offre de paix séparée proposé par l'impératrice Zita ; néanmoins, Clemenceau cherche l'appui moral de l'Action française via l'entremise du député royaliste Jules Delahaye.
L'entre-deux-guerres Le renforcement du prestige de Maurras
La Grande guerre est pour Charles Maurras une période de développement de l'audience de son journal et de sa pensée. En 1917, le journal voit son nombre d'abonnés augmenter de 7500. Le journal comptait 1500 lecteurs en 1908, 22 000 en 1912, 30 000 en 1913, et tire à 156 000 exemplaires en 1918. Les souscriptions augmentent également, ce qui permet en 1917 à L'Action française de quitter son local de la Chaussée d'Antin dans lequel elle avait emménagé en 1908 pour la rue de Rome. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Charles Maurras et son mouvement bénéficient d'un grand prestige dans l'opinion publique, bien au-delà de son courant politique y compris dans l'établissement politique républicain.
D'après Bainville, dans les milieux républicains et radicaux, on dit alors que Maurras, en restaurant la grande discussion politique en France a rendu un immense service à la République elle-même en l'obligeant à faire son examen de conscience76. Poincaré se justifie de sa politique auprès en écrivant à Maurras et le félicite de délicieuse préface de Trois aspects du président Wilson, elle aussi chargée de pensée et illuminée de raison française. Le 1er mars 1925, élu Prince ces écrivains » par les membres de La plume », succédant ainsi à Anatole France.
Cette popularité de l'Action française au lendemain de la Grande guerre se traduit par l'élection de Léon Daudet comme député de Paris à la Chambre bleue horizon ou par la publication par Henri Massis dans Le Figaro du 19 juillet 1919 d'un manifeste Pour un parti de l'intelligence signé par cinquante-quatre personnalités dont Daniel Halévy, Francis Jammes, Jacques Maritain.
Cependant, un grand nombre des espoirs militants et dirigeants de l'Action française sont tombés et Maurras leur rendra hommage dans Tombeaux en 1921 : Henry Cellerier, André du Fresnois, Pierre Gilbert, Léon de Montesquiou, Lionel des Rieux, Jean-Marc Bernard, Albert Bertrand-Mistral, vingt-et-un rédacteurs de la Revue critique comme Joachim Gasquet, Octave de Barral, Henry Lagrange, Augustin Cochin.
L'assassinat de Marius Plateau en 1923, celui d'Ernest Berger en 1925 et d'autres attentats commis contre l'Action française contribuent aussi à créer un élan de solidarité autour de Charles Maurras, dont témoignent les paroles de Jacques Maritain : L'idée des dangers que vous courez, rend encore plus cher au cœur de tous ceux qui aiment la France et l'intelligence.
Critique de la paix de Versailles
Pour Maurras, la république répare mal la guerre, ne peut la gagner qu'en renonçant à elle-même et assure mal la paix ; reprenant la formule de l'historien socialiste Alphonse Aulard, la guerre a été gagnée par des procédés de dictature monarchique qui ont permis de rattraper les erreurs de l'avant-guerre mais au prix de la mort d'un million cinq cent mille Français, trois fois plus qu'annoncé dans Kiel et Tanger.
En 1918, Maurras réclame donc une paix française qui serve le mieux les intérêts de la nation : la division de l'Allemagne, l'annexion du Landau et de la Sarre, un protectorat français sur la Rhénanie.
L'Action française se prononce contre l'application sans discernement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. S'il salue la visite de Wilson au Pape, ses Quatorze points le scandalisent par leur naïveté utopique car nulle revanche du droit n'est sérieuse sans un équilibre du fait. Là où les politiques parlent de droit, de morale, de générosité, l'école de l'Action française réaffirme la nécessité du réalisme pour parvenir aux équilibres internationaux.
Maurras affirme que si on ne démembre pas l'Allemagne, celle-ci réclamera le couloir de Danzig ; il prétend que la crainte du bolchevisme n'est pas une raison suffisante pour permettre à l'Allemagne de se réorganiser. Maurras est favorable aux indemnités de guerre qui permettent de remettre la France à flot tout en affaiblissant l'Allemagne. En effet, selon l'analyse de Jacques Bainville, l'Allemagne et la Russie soviétique sont les ennemis de la France, et son seul allié possible est l'Italie. La paix doit affaiblir l'Allemagne au point de permettre à la France de s'appuyer sur des troupes régulières accomplissant un temps de service long et de ne plus recourir à la conscription. L'immédiat après-guerre est marqué par des appels renouvelés à la vigilance face à l'Allemagne.
Le 6 février 1934 et ses conséquences
Lors de la crise du 6 février 1934, Maurras se trouve rue du Boccador avec Marie de Roux : pour lui la manifestation contre la corruption du régime, dont deux morts sur trois seront royalistes, ne peut déboucher sur le coup de force car les nationalistes non royalistes ne suivraient pas l'Action française et le préalable au renversement du régime est absent : l’armée, la police, l’administration n’ont pas été infiltrées, ce qui aurait nécessité des mois de préparation et un personnel spécifique dont l’Action française était dépourvue ; de plus, la perspective d'une guerre civile lui répugne.
Après le 6 février 1934, si L'Action française gagne dix mille abonnés de plus, Maurras perd le magistère de la rébellion contre le régime auprès de certains des militants qui la quittent alors comme Pierre de Bénouville, Jacques Renouvin, Michel de Camaret. Le comte de Paris est également déçu et le 6 février le déterminera à s'émanciper.
De plus, si les années 1930 voient éclore une nouvelle génération de nouveaux jeunes penseurs maurrassiens comme Thierry Maulnier, Jean-Pierre Maxence, Jean de Fabrègues, ceux-ci n’hésiteront pas à prendre du recul par rapport au vieux maître, critiquant notamment son nationalisme — vu par eux comme étroit — et son évolution conservatrice – qu’ils estiment inadaptée aux nouveaux enjeux sociaux. L'échec du 6 février les confortera dans cette prise de distance.
Emprisonnement
Le 13 février 1936, passant en automobile à proximité du cortège des funérailles de l’historien Jacques Bainville, boulevard Saint-Germain, à Paris, Léon Blum est pris à partie par d’anciens camelots du roi : la Ligue d’action française, les camelots et la Fédération nationale des étudiants d’action française sont dissous par le gouvernement intérimaire, dirigé par le radical Albert Sarraut. Fulminant dans ses articles contre ces mesures et les députés favorables aux sanctions contre l’Italie risquant de pousser celle-ci à une alliance avec l'Allemagne aux conséquences qu'il prévoit désastreuses pour la France, Maurras est condamné à quatre mois de prison ferme. Il réagit en menaçant Léon Blum pour le jour où sa politique nous aura amené la guerre impie qu’il rêve contre nos compagnons d’armes italiens. Ce jour-là, il ne faudra pas le manquer. Déjà, dans L'Action française du 9 avril 1935, Maurras écrivait à propos de Léon Blum : C’est un monstre de la République démocratique. C’est un hircocerf de la dialectique heimatlos. Détritus humain à traiter comme tel… … C’est un homme à fusiller, mais dans le dos.Le 21 juillet 1936, il est condamné à huit mois de prison ferme et effectue sa peine à la prison de la Santé.
Les maurrassiens s'indignent d'une condamnation qu'ils jugent politique, en rappelant que dans Le Populaire, on avait écrit un an plus tôt que si la guerre était déclarée, les mobilisés abattront MM. Béraud et Maurras comme des chiens.De fait, Maurras reçoit de très nombreuses marques de soutien dont celui du pape Pie XI et de mère Agnès, sœur aînée de sainte Thérèse de Lisieux et supérieure du Carmel ; de cent députés et sénateurs alsaciens signeront une protestation. Le 8 juillet 1937, entre quarante à soixante mille personnes, viennent rendre hommage à Maurras à l’occasion de sa libération au Vélodrome d’Hiver en présence de la maréchale Joffre.
Pendant sa captivité, Charles Maurras écrit chaque jour son article politique pour L’Action Française ainsi que plusieurs ouvrages : Les Vergers sur la mer, Dans Arles aux temps des fées, Devant l’Allemagne éternelle, la Dentelle du rempart et Mes idées politiques.
Entrée à l'Académie française
Entretemps, Maurras a été élu à l’Académie française au fauteuil de l’avocat Henri-Robert. Après un premier échec en 1923 contre Charles Jonnart, il est élu à l’Académie française le 9 juin 1938 au fauteuil 16, succédant à Henri-Robert, par 20 voix contre 12 à Fernand Gregh ; il fut reçu le 8 juin de l’année suivante par Henry Bordeaux.
Mise en garde contre l'hitlérisme
Dès 1922, Maurras a des informations précises sur Hitler en provenance d'un agent secret à Munich par le président Raymond Poincaré91. Dès lors, s'il dénonce le pangermanisme de la classe politique allemande de la République de Weimar, comme celui de Stresemann favorable à l'Anschluss, il attire régulièrement l'attention de ses lecteurs sur les dangers propres du national-socialisme : ainsi, en 1924, il dénonce la déroute des Wittelsbach au profit du racisme antisémite du NSDAP et le rapide accroissement du bloc dit raciste sorti de terre en quelques mois et fondé ou échafaudé sur de vieilles imaginations périmées avec sa philosophie abracadabrante de la Race et du Sang.
En 1930, Maurras dénonce l’abandon de Mayence par l’armée française et titre Le crime contre la Patrie là où Léon Blum écrit la paix est faite. La même année, L’Action française publie une série d'articles sur le parti national-socialiste allemand, présentée comme « un des plus grand dangers pour la France, alors que le 1er janvier 1933, Le Populaire annonce sa prochaine disparition.
L'obsession de la menace hitlérienne se traduit par l'ouverture du journal à des officiers d’État-major signant parfois sous pseudonyme : comme chroniqueurs militaires, ils suivront l’évolution du budget militaire allemand avec une inquiétude croissante jusqu’au désastre. En 1932, le général Weygand, proche de l'Action française, dénonce dans ses rapports secrets la politique de désarmement menée par la gauche : L’armée française est descendue au plus bas niveau que permette la sécurité de la France mais son légalisme l'empêche d'exprimer publiquement sa proximité avec Maurras.
En 1933, Maurras écrit : Quoi que fassent ces barbares, il suffit d’appartenir au monde officiel, au monde de la gauche française, pour incliner à leur offrir de l’encens, le pain, le sel et la génuflexion. Maurras voit dans l’arrivée d’Hitler au pouvoir la confirmation de ses pronostics et dénonce le prohitlérisme : Le halo du prohitlérisme joue autour de ces brigandages, les défend et les auréole, ce qui permet aux forces de Hitler un rapide, puissant et formidable accroissement continu. Nous aurons laissé dépouiller et envahir nos amis.
En 1934, après la nuit des longs couteaux, il dénonce l’abattoir hitlérien et félicite la presse britannique énergique dans sa condamnation et annonce le pacte germano-soviétique : Je le répète : il n’y a pas de plus grand danger que l’hitlérisme et le soviétisme. À égalité ! Et ces égaux-là sont faits pour s’entendre. La carte le confirme. L’avenir le vérifiera. Pour Maurras, il n’y a pas de ménagement possible avec Hitler : l’invasion progressive du centre et de l’est européen entraînera celui de la Belgique et donc la soumission de la France à un géant écrasant le continent de sa puissance. Maurras, Bainville et Daudet rivalisent de démonstrations et d’accents polémiques pour que la France s'arme suffisamment pour se défendre et éventuellement attaquer préventivement. La menace allemande constitue le fil rouge de ses préoccupations : dans ses écrits, les débats intérieurs lui sont subordonnés : la politique étrangère qu’il défend consiste à ménager les puissances secondaires d’Europe, celles que menacent l’URSS et le Reich allemand : Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie. Il exalte l’union des pays latins France, Italie, Espagne, Roumanie avec la Grande-Bretagne, la Hongrie, la Pologne.
En 1936, Maurras écrit la préface de l'ouvrage contre le nazisme de la comtesse Joachim de Dreux-Brézé qui sera sa maîtresse106 ; il y déplore l'assassinat de Dollfuss par les nationaux-socialistes. Le 7 mars 1936, le Reich occupe la Rhénanie et alors que la plupart des journaux appellent au calme et que le gouvernement à six semaines des élections refuse de réagir, L’Action française réclame une riposte militaire immédiate.
En 1937, il publie Devant l’Allemagne éternelle, sous-titré « Chronique d’une résistance; il rassemble quarante ans d’écrits sur l’Allemagne, le pangermanisme et l’influence allemande en France.
Maurras essaie de détourner Mussolini de l'alliance avec Hitler : la supériorité générique qu’invoque l’hitlérisme se formule par rapport à ce que l’on appelle les races latines et, comme il n’y a pas de race latine sur ce qu’il faut appeler l’esprit latin. Mussolini doit savoir cela aussi bien que nous, il l’oublie, il veut l’oublier. Mais l’oubli se paie cher L’erreur. Pour Maurras, le tort italien est déterminé par la conduite de Londres et Paris, qui par leurs sanctions contre l’Italie ont poussé cette dernière à fauter ; pour Maurras, le Front populaire, en plaçant l’antifascisme avant la politique équilibre, contribue à renforcer l’Allemagne et à préparer des lendemains douloureux au pays : il attaque violemment Léon Blum et ceux qui ont mené des campagnes de désarmement lorsque la France était plus puissante que l’Allemagne et veulent désormais engager une guerre incertaine pour des raisons idéologiques alors que la France n’a plus les moyens de la victoire.
En 1938, il défend les accords de Munich, non qu’il soit devenu favorable à un rapprochement avec l’Allemagne, mais car il estime que la France n’est pas prête militairement et court à la défaite ; il accepte les accords comme une défaite sanctionnant les erreurs de la politique étrangère de la République, tout en appelant au réarmement. Il s'agit d'éviter de déclencher prématurément une guerre pour des raisons de doctrine et de préparer la France à l'affronter avec de vraies chances de succès : cette position se veut le contraire d'une position germanophile, il s'agit d'appliquer le si vis pacem, para bellum, de ne pas lâcher la Pologne mais de sauver d'abord la France pour sauver l'avenir polonais.
En 1939, Maurras titre La mort d’un peuple » quand les Allemands envahissent la Tchécoslovaquie dont il a admiré la renaissance littéraire et se lamente que l'on n'ait pas écouté vingt ans de mises en garde. Il ne veut pas la guerre car il croit que la France a toutes les chances de la perdre, comme l'écrit le colonel Gauché du Deuxième Bureau : « Jamais, à aucune période de son histoire, la France ne s'est engagée dans une guerre dans des conditions aussi défavorables. Mais il affirme que si elle advient, elle devra être menée avec détermination. Inquiet, il prend diverses initiatives pour renforcer les chances de la France.
Il lance une campagne de souscription en faveur de l’aviation militaire : vingt quotidiens parisiens, cinquante journaux de province le rejoignent mais Daladier s’y oppose.
Il écrit à Franco afin de le convaincre de détourner l’Italie de l’alliance avec l’Allemagne. Maurras a salué la victoire de Franco, gage de sécurité contre le communisme et les persécutions contre les catholiques et dont il pense qu’elle ne peut être que l’ennemie de l’Allemagne. L'obsession allemande a d'ailleurs influé sur la position de Maurras quant à la guerre civile espagnole : il a soutenu les insurgés mais, à l'arrivée du Front populaire, il défend une neutralité de principe pour éviter une entrée en guerre officielle de l'Allemagne aux côté de Franco qui le satelliserait et ruinerait la politique méditerranéenne de la France. La victoire acquise et ce danger écarté, le pari stratégique de Maurras sera confirmé dans les faits : Franco refusera la possibilité à Hitler de traverser le territoire espagnol pour envahir l'Afrique du Nord, ce qui aura un impact important sur l'issue de la guerre.
En liaison avec des intellectuels britanniques, il prône l’alliance avec l’Angleterre jusqu’à l’extrême limite du possible.
Il soutient le gouvernement républicain d'Édouard Daladier dans sa volonté d'interdire le parti communiste dont des militants ont participé à des opérations de sabotage au profit de l'Allemagne nationale-socialiste.
En 1940, un message en caractères énormes ouvre le journal : Le chien enragé de l’Europe, les hordes allemandes envahissent la Hollande, la Belgique, le Luxembourg. Maurras écrit : Nous avons devant nous une horde bestiale et, menant cette horde, l’individu qui en est la plus complète expression. Nous avons affaire à ce que l’Allemagne a de plus sauvagement barbare, c’est-à-dire une cupidité sans mesure et des ambitions que rien ne peut modérer. … Nul avenir ne nous est permis que dans le bonheur des armes.
La Seconde Guerre mondiale
Dès que la guerre est déclarée, le 3 septembre 1939, Charles Maurras reprend les accents bellicistes de l’Union sacrée. Apportant, jusqu’aux derniers combats de juin 1940, un soutien sans faille à l’effort de guerre, il approuve, comme la quasi-totalité des Français, l’armistice. Maurras est regardé comme un adversaire par les autorités d'occupation qui font piller par la Gestapo les bureaux de l'Action française et placent certains livres de Maurras sur la liste Otto des livres interdits ; en 1943, le haut responsable des forces d'occupation en France, le conseiller Schleier, place Maurras parmi les personnes à arrêter en cas de débarquement.
Nature et formes du soutien au Maréchal Pétain
Maurras décide d'apporter son soutien au Maréchal Pétain. La victoire allemande sur la France le désespère et il dira au moment de l'arrivée de soldats allemands en Provence voir réalisé le « cauchemar de son existence. La raison principale de ce soutien est la recherche de l'unité française comme condition du redressement et donc de la revanche contre l'Allemagne, indépendamment de toute considération idéologique.
Maurras affirme lui-même que le soutien au gouvernement Pétain est de même nature que celui apporté aux gouvernements républicains de la Première guerre mondiale ; à Pierre Gaxotte, il déclare : Je soutiens Pétain comme j’ai soutenu tous les gouvernements pendant la guerre de 1914-1918; ce soutien procède de la volonté de sauver l'unité française coûte que coûte car elle est la condition de l'Espérance. À Pierre Boutang, il affirme que l'unité française est un outil de revanche. Pour Maurras, le vainqueur de Verdun ne peut que défendre les intérêts du peuple français et toute dissidence affaiblit la France et compromet son rétablissement. Le soutien à Pétain est alors général : il est notamment estimé de Léon Blum à cause de sa réputation de soldat républicain, contrairement à Weygand ou Lyautey, jugés monarchistes. Dans cette optique, le soutien à Vichy n'est donc pas originellement un choix idéologique, ni tactique, c'est une donnée, posée au-dessus de toute référence, par l'exigence de l'unité du pays. Ce soutien se veut de même nature que celui que Maurras a apporté à la Troisième république pendant la Première Guerre mondiale contre les monarchies traditionnelles allemande et autrichienne, il s'agit de faire le choix de l'union sacrée qui passe par le soutien à l'État. Dans les deux cas, c'est le souci de l'unité française qui prime mais, autant après 1918, ce soutien au gouvernement français aura été profitable au prestige et l'influence de l'Action française, autant après 1945, il aura des conséquences désastreuses sur l'aura de Maurras, en ruinant le crédit d'un demi-siècle d'aventure intellectuelle, en occultant tout un mouvement varié de pensée que l'on ne peut réduire par amalgame au régime de Vichy.
Pour Maurras, la France demeure et n'a besoin ni de l'Angleterre, ni de l'Allemagne pour être ; ceux qui le croient et rejoignent ce qu'il appelle le clan des yes et le clan de ja, deviennent des agents de l'étranger : ce thème est celui de la France seule. À l'été 1940, malgré les conseils de Pierre Gaxotte, Maurras fait reparaître L'Action française à Lyon, avec en tête le slogan La France seule.
Maurras apprécie également l'idée d'une remise en cause des idées démocratiques et la défaite a eu le bon résultat de nous débarrasser de nos démocrates. En effet, pour Maurras, l'invasion et l'occupation du territoire français sont le résultat de l'application de la politique révolutionnaire et de la rupture avec la sagesse de la politique étrangère de l'Ancien Régime, en 1940 comme en 1814, 1815, 1870. Maurras a d'ailleurs déclaré au préfet de la Vienne : Que voulez-vous, monsieur le Préfet, soixante-dix ans de démocratie, ça se paie ! La divine surprise n'est pas la victoire de l'Allemagne comme certains ont cherché à le faire croire à la Libération mais l'accession au pouvoir du Maréchal Pétain. En effet, sur certains plans, des convergences peuvent être détectées entre les thèmes de la Révolution nationale et ceux de l'Action française. En septembre 1940, lorsque le maréchal Pétain lui demande sa conception de la Révolution nationale, il répond un bon corps d'officiers et un bon clergé, une position qu'il appelle : défendre l'héritage en l'absence d'héritier. Il parle d'une divine surprise à propos de l'accession au pouvoir du Maréchal Pétain. Il soutient le régime de Vichy, non la politique de collaboration car il est un nationaliste profondément germanophobe mais certains aspects du discours de la Révolution nationale. Il se félicita par exemple de l'abolition par Vichy du décret Crémieux très mal vu des populations musulmanes.
Mais ce soutien va surtout à la personne du Maréchal Pétain et non à tous les dirigeants ou toute la politique de Vichy : Maurras fêta le renvoi de Laval dans les locaux de L'Action française. Maurras chercha à user de son influence auprès des dirigeants de Vichy comme il le fit auprès de Raymond Poincaré pour contrer les mesures qui lui semblaient mauvaises. Au cours des mois de juillet et août 1940, il joue de ses relations auprès du maréchal Pétain qu’il rencontre le 27 juillet pour faire échec au projet de parti unique lancé par Marcel Déat. Il écrit que de toute évidence, Marcel Déat est égaré par l’exemple de l’Allemagne et de l’Italie 141. À un journaliste japonais, Marcel Déat confiera qu’il s’est heurté par-dessus tout dans son projet d'État totalitaire et de nouvel ordre européen à la résistance de l’Action française. Maurras s'oppose à toute orientation germanophile ; il voit dans les partisans de la collaboration les continuateurs de Jaurès et Briand et note comme l’un des hauts responsables nazis en France, Schleier, que la grande majorité des partisans de la politique de collaboration vient de la gauche française : Déat, Doriot, Pucheu, Marion, Laval, une grande partie de l’ancien personnel briandiste.
La question de l'influence de la pensée de Maurras sur l'idéologie et la politique de Vichy est débattue par l'historiographie : pour Loubet del Bayle, Vichy se situe à l'intersection des idées du technocratisme planiste, d'Action française, du catholicisme social, du personnalisme. L'influence propre de l'Action française est difficile à identifier et isoler ; certains nient l'influence de la pensée de Maurras comme Limore Yagil ; d'autres, comme François Huguenin, voient dans Vichy l'héritière de l'esprit des années 1930 et d'abord de ses rejets, rejets dont certains se retrouvent aussi dans la Résistance : antiparlementarisme, anticapitalisme, anti-individualisme, anticommunisme. Simon Epstein rappelle que Vichy n'attend pas longtemps pour se délester d'une bonne partie de ses maurrassiens : dès 1941, Raphaël Alibert, ministre de la Justice, Paul Baudouin ministre des affaires étrangères en 1941, Georges Groussard, ancien cagoulard qui commande les groupes de protection de Vichy et qui procéda à l'arrestation de Laval trop favorable à l'Allemagne et s'orienta vers la Résistance quittent Vichy. Ceux qui ne sont pas partis quitteront le gouvernement lors du retour de Laval en 1942 : Pierre Caziot, Serge Huard, Yves Bouthillier, René Gillouin, Henry du Moulin de Labarthète, Xavier Vallat, c'est-à-dire avant l'entrée des partisans d'une franche collaboration avec l'Allemagne nationale-socialiste. Ces Maurassiens étaient mal vus des amis de Pierre Laval qui les accusent d'avoir favorisé son renvoi, des Allemands qui n'apprécient pas leur hostilité à la collaboration, des collaborationnistes qui les accusent d'être réactionnaires à l'intérieur et germanophobes à l'extérieur. Les Dreyfusards collaborateurs tels Armand Charpentier et René de la Marmande attaquèrent régulièrement ses positions. Les pacifistes des années 1920 reprochaient à Maurras d'être hostile au rapprochement franco-allemand. Devenus collaborateurs, ces pacifistes témoigneront de ténacité idéologique et constance argumentaire, puisqu'ils lui feront le même reproche sous l'Occupation. Néanmoins, certains opposants à Pétain et à ses soutiens voudront faire de Maurras l'apologiste inconditionnel du gouvernement du maréchal Pétain.
Après la Seconde Guerre mondiale, Charles Maurras fera le point sur ses rapports avec Philippe Pétain et démentira avoir exercé une influence sur lui : après avoir rappelé qu'ils se voyaient à peine avant 1939, il protesta contre la fable intéressée qui fait de moi une espèce d'inspirateur ou d'Éminence grise du Maréchal. Sa doctrine est sa doctrine. Elle reste républicaine. La mienne est restée royaliste. Elles ont des contacts parce qu'elles tendent à réformer les mêmes situations vicieuses et à remédier aux mêmes faiblesses de l'État. … L'identité des problèmes ainsi posée rend compte de la parenté des solutions. L'épouvantable détresse des temps ne pouvait étouffer l'espérance que me donnait le remplacement du pouvoir civil impersonnel et irresponsable, par un pouvoir personnel, nominatif, unitaire et militaire.
Division des partisans de Maurras
Pendant l'occupation, les membres et anciens proches de l'Action française se divisèrent en trois groupes opposés : celui des maurrassiens orthodoxes soutenant le régime de Vichy conduit par le maréchal Pétain, celui des collaborationnistes et ouvertement pro-allemands tels Robert Brasillach, Charles Lesca, Louis Darquier de Pellepoix ou Joseph Darnand, celui des résistants contre les nazis tels Honoré d'Estienne d'Orves, Michel de Camaret, Henri d'Astier de la Vigerie, Gilbert Renault, Pierre Bénouville, Daniel Cordier ou Jacques Renouvin.
Il n'y a pas de statistiques sur la répartition de ces trois groupes mais, à l'époque, l'idée que les dirigeants suivent Maurras dans son soutien à Pétain mais qu'une majorité des sympathisants maurrassiens soutient la Résistance contre l'avis de Maurras est répandue. Pierre Mendès France soutiendra cette position155 : L’Action française, sous l’influence directe de Maurras, suit Vichy, mais là encore, la principale partie des troupes a abandonné les chefs. Comme la plupart des anciens Croix-de-feu, les militants de l’Action française, surtout les éléments jeunes, sont aujourd’hui antiallemands et absolument hostiles à la soumission à l’occupant. Le colonel Rémy dira que sa décision de résister résulta de son imprégnation de la pensée de Maurras : Le réflexe qui m'a fait partir pour l'Angleterre le 18 juin 1940 trouvait son origine dans l'enseignement que, depuis vingt ans, je recevais quotidiennement sous sa signature. Si les maurrassiens résistants affirment parfois comme le colonel Rémy que leur engagement dans la résistance résulte d'une application de la pensée de Maurras, ceux qui ont rejoint le collaborationnisme reconnaissent qu'ils ont rompu avec l'essence de sa pensée comme Lucien Rebatet qui se déchaînera contre Maurras dans de nombreux écrits ou comme Robert Brasillach que Maurras refusera de revoir.
La diversité des parcours posés entre 1940 et 1945 relève parfois du tempérament, voire du hasard des événements : la grille idéologique ne permet souvent pas d'expliquer seule tant de prises de positions différentes, ni d'analyser des choix.
Hostilité aux collaborationnistes
L'écrivain Jean Grenier note au sujet de l'agence de presse Inter-France que Charles Maurras est tout à fait opposé au groupe de journalistes "qui a fondé l'agence de presse Inter-France germanophile."
L'anglophobie de Maurras ne compensait pas aux yeux des Allemands sa germanophobie virulente, ce qui lui valut en 1942 d'être mis au rang des incorrigibles ennemis de l'Allemagne aux côtés de Massis, Claudel et Mauriac par le docteur Payr, dirigeant de l'Amt Schrifttum, dépendant de l'Office Rosenbeg, quand il rend compte de la littérature française. Le conseiller Schleier dénonce dans une note au ministre Ribbentrop son comportement fondamental d'antiallemand. Maurras rompt avec Brasillach, en 1941, quand celui-ci envisage de refaire paraître Je suis partout à Paris :Je ne reverrai jamais les gens qui admettent de faire des tractations avec les Allemands.
Les collaborationnistes Marcel Déat, Robert Brasillach, Lucien Rebatet se déchaîneront en attaques contre Maurras ; Rebatet écrit que Maurras est de tous les Français celui qui détestait le plus profondément l'Allemagne, s'insurge contre les propos de Maurras qui qualifie le Führer de possédé, condamne la germanophobie aveugle et maniaquede L'Action française.
Le collaborationniste Pierre-Antoine Cousteau dira après la guerre : " Maurras m’inspirait une horreur sacrée, uniquement parce qu’il faisait de la pérennité des guerres franco-allemandes la base de son système et que j’étais déjà convaincu c’est le seul point sur lequel je n’ai jamais varié que l’Europe ne serait jamais viable sans entente franco-allemande, que c’était le premier de tous les problèmes, le seul vraiment important, celui dont dépendait la guerre et la paix, la vie et la mort. "
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=7228#forumpost7228
.
Posté le : 16/11/2014 18:06
Edité par Loriane sur 17-11-2014 11:32:31
|
|
|
|
|
Charles Maurras 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Hostilité aux résistants
Par hantise de la guerre civile, Maurras se proclame antigaulliste et qualifie les résistants de terroristes, appelant à la répression la plus violente contre eux : Il exigeait des otages et des exécutions, il recommandait la mise à mort des gaullistes faits prisonniers, sans autre forme de procès, il déclarait que si la peine de mort n'était pas suffisante pour mettre un terme aux activités des gaullistes, il fallait se saisir des membres de leur famille comme otages et exécuter ceux-ci .
Maurras écrit en 1944 que si les Anglo-Américains devaient gagner, cela signifierait le retour des francs-maçons, des Juifs et de tout le personnel politique éliminé en 1940, et que soutenir les Alliés serait prendre parti du mauvais côté. Dans une lettre à Jean Arfel en 1948, Maurras affirme qu'il y avait une part de feinte destinée à tromper les Allemands dans son hostilité aux gaullistes et aux maquisards et le souci d'éviter une guerre civile en France : Mon escrime quotidienne contre les collaborationnistes et philoboches était toujours accompagnée, comme sa feinte protectrice, d'une pointe contre le Gaullisme et les maquisards, feinte qui a toujours trompé les Allemands à leur grand détriment …. Je voulais tout tenter, à tout prix, pour épargner à la France le malheur de redevenir un champ de bataille et pour obtenir qu'elle fût libérée autrement que par la guerre sur le territoire national.
Yves Chiron et François Huguenin affirment que le jeu de la censure allemande fait qu'il est imprudent d'interpréter la pensée de Maurras et d'avoir une idée juste de ses réactions en se référant à ses écrits pendant la guerre
La Libération
En 1944, Charles Maurras maintient sa méfiance pour la France Libre qu'il pense manipulée par Moscou. Le débarquement de Normandie le déconcerte à cause de la destruction des villes françaises par des bombardements massifs ; en revanche, celui d’Italie le réjouit car il obéit à une progression inoffensive pour les populations.
Après le débarquement, il préconise de ne rien faire pour aggraver les maux publics car il craint plus que tout la guerre civile : cette position attentiste est scandaleuse selon les collaborationnistes mais elle ne satisfait pas non plus les résistants ; Maurras ne veut rien faire pour empêcher que la libération puisse se faire et laisser au Maréchal Pétain la possibilité de négocier avec les libérateurs, illusion qu’il partage avec l’amiral Auphan en tractation secrète avec les Américains. Maurras exulte lorsqu’il apprend la libération de Paris et le 3 septembre 1944, il arrose l’événement chez son ami Henri Rambaud, ivre de joie et de vin ; mais les communistes saccagent ses bureaux le 6 septembre et le 9 septembre, il est arrêté à l'instigation d'Yves Farge, lui-même proche du parti : il faudra deux mois pour que Maurras prenne connaissance de son inculpation et son procès commencera le 24 janvier 1945.
Pendant son procès, au cours duquel sera mise en avant sa critique de la résistance gaulliste et communiste, Charles Maurras rappellera quelques-unes de ses positions d'ennemi de toujours de l'Allemagne et de l'hitlérisme et des résistants comme Georges Gaudy ou le capitaine Darcel témoigneront en sa faveur :
Dans une conférence au café Neuf de Lyon, le 3 février 1943, Maurras proclama publiquement que l’Allemagne restait pour la France l’ennemi no 1, la censure empêchant que ses prises de position soient publiées.
S’il a approuvé dans un premier temps la création de la Milice comme une police qui protégerait les gens contre les attentats communistes qui visaient indifféremment de vrais collaborationnistes et des pétainistes antiallemands, il la désapprouva énergiquement dès qu’il appris que son commandement était soumis à l’autorité allemande et interdit à ses partisans de s’y engager, ; de fait, les miliciens réquisitionnèrent ses bureaux et lui firent une figure féroce.
À un correspondant qui lui proposait d'annoncer une exposition antisoviétique dans L'Action française, il répondit que ce n'étaient pas les Russes qui occupaient la France et que si on organisait une exposition antiallemande, il en rendrait compte dans ses articles.
Il met en avant que ses articles visaient à tromper la censure pour mieux faire passer un message antiallemand ; ainsi, le 12 février 1943, il montre l’impossibilité d’intégrer la France dans un ensemble européen et pour son partisan Pierre Boutang, il ne pouvait y avoir alors de tract clandestin plus utile contre l’occupant.
Concernant l'antisémitisme, il dira qu'il ignorait qu'en février 1944, désigner un Juif à l'attention publique, c'était le désigner lui ou sa famille aux représailles de l'occupant, à la spoliation et aux camps de concentration, peut-être à la torture ou à la mort. Il dira également que ses invectives étaient des menaces et ne résultaient pas d'une volonté de nuire physiquement, affirmation dont François Huguenin juge qu'elle peut paraître intolérable mais qui demeure plausible compte tenu du milieu confiné dans lequel vivait Maurras à Lyon et de la vieille habitude pratiquée par Maurras de l'invective violente jamais suivie d'effet. C’est en 1945 que Maurras apprendra l’horreur des camps et qu’il prononcera des paroles de compassion. Il a été cependant ému par la mort de Georges Mandel assassiné par des miliciens : il lui consacre dans L'Action française du 21 juillet 1944 un article fleuve à la fois critique et élogieux, rappelant ses divergences tout en déplorant la mort d’un homme qu’il a rencontré plusieurs fois depuis 1918, qui a rendu par son entremise un service aux Orléans.
Le 28 janvier 1945, la cour de justice de Lyon déclare Charles Maurras coupable de haute trahison et d'intelligence avec l'ennemi et le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité et à la dégradation nationale.
Maurras commenta sa condamnation par une exclamation célèbre :" C'est la revanche de Dreyfus !". Selon Eugen Weber, le procès qui dura seulement trois jours fut un procès politique : les jurés ont été choisis sur une liste établie par des ennemis politiques de Maurras, les vices de forme et les trucages ont été nombreux, le motif choisi est le plus infamant et le plus contradictoire avec le sens de sa vie et pour ses partisans le régime condamne celui qui n'a cessé de le mettre en face de ses responsabilités et lui fait payer le prix de ses propres erreurs
De sa condamnation, article 21 de l'ordonnance du 26 décembre 1944, découle son exclusion automatique de l'Académie française, l'ordonnance prévoit l'exclusion de l'Institut. Conformément à la loi, l'Académie déclare vacant le siège de Maurras lors de la séance du 1er février 1945 mais, selon la décision du secrétaire perpétuel Georges Duhamel, ne procède pas au vote de radiation. L’Académie décida de ne procéder à l'élection du remplaçant de Maurras qu'après son décès, ce qui ne sera pas le cas pour les académiciens collaborationnistes comme Abel Bonnard et Abel Hermant, remplacés de leur vivant.
L'après Seconde Guerre mondiale
Entre 1945 et 1952, Charles Maurras publia quelques-uns de ses textes les plus importants. Bien qu'affaibli, il collabore sous le pseudonyme d'Octave Martin à Aspects de la France, journal fondé par des maurrassiens en 1947, à la suite de l'interdiction de l'Action française. Il dénonce l'épuration et s'en prend particulièrement à François de Menthon, pour avoir été le ministre de la Justice du Gouvernement provisoire de la République française. Ses dernières années, passées en grande partie à la prison de Clairvaux, furent aussi l'occasion d'une introspection sur la question de la Résistance ou du traitement infligé aux Juifs pendant la guerre.
Ainsi, en 1948, il fait part de son admiration pour l'épopée Leclerc et pour les « belles pages du maquis et reconnaît une erreur dont il a conscience et tente d'excuser : il n'a pas su distinguer dans l'ensemble de la Résistance et son incapacité à voir clair découlerait alors de l'obsession de la mort de la France, crispation défensive qui lui fit ignorer les perspectives — minces au début, puis plus larges — d'une victoire possible.
Tout en continuant d'affirmer la nécessité d'un antisémitisme d'État du fait que les Juifs posséderaient une nationalité propre qu'il reconnaît glorieuse mais différente de la française, il s'oppose à Maurice Bardèche sur le drame de la déportation : « Français ou non, bons ou mauvais habitants de la France, les Juifs déportés par l'Allemagne étaient pourtant sujets ou hôtes de l'État français, et l'Allemagne ne pouvait pas toucher à eux sans nous toucher ; la fierté, la justice, la souveraineté de la France devaient étendre sur eux une main protectrice.
Le 10 août 1951, Charles Maurras est transféré à l’hôtel-Dieu de Troyes. Il publie peu après plusieurs ouvrages : Jarres de Biot – où il redit sa fidélité au fédéralisme, revendiquant même la qualité de plus ancien fédéraliste de France –, À mes vieux oliviers et Tragi-comédie de ma surdité.
Le 21 mars 1952, bénéficiant d'une grâce médicale accordée par le président de la République Vincent Auriol, grâce réclamée maintes fois par l'écrivain Henry Bordeaux, auprès du président, par divers courriers, Charles Maurras est transféré à la clinique Saint-Grégoire de Saint-Symphorien-lès-Tours. Quelques mois avant sa mort, Maurras écrivait qu’il n’avait pas fait un pas dans la direction des choses éternelles ; les théologiens qui l’entouraient ne cessaient d’espérer un signe de conversion, mais Maurras était las de cet empressement et souhaitait qu’on mît fin à cette volonté obstinée de donner à boire à un âne qui n’a plus soif. Cependant, il meurt le 16 novembre 1952, après avoir reçu les derniers sacrements et plusieurs témoins ont attesté de la profondeur de sa conversion à l'article de la mort.
Idées politique Maurrassisme.
La principale originalité de Maurras réside dans le fait qu’il a réalisé avec toutes les apparences de la rigueur la plus absolue, l’amalgame de deux tendances jusqu’alors bien distinctes : le traditionalisme contre-révolutionnaire et le nationalisme. Ses travaux ont particulièrement marqué la droite française, incluant l'extrême droite, succès dû au fait qu'il parvint à théoriser un très grand nombre des idées politiques défendues par les différentes familles politiques de droite en une seule et unique doctrine cohérente en apparence. Trois autres raisons sont mises en avant pour expliquer le rayonnement du nationalisme intégral :
Le nationalisme intégral se présente comme un ensemble parfaitement cohérent ; c'est avec le marxisme la seule doctrine s’offrant aux esprits soucieux de rigueur et ennemis de l’opportunisme ; d'après l'historien Alain-Gérard Slama, l'efficacité de Maurras tient justement dans le rassemblement intellectuellement ordonné d'idées provenant de divers courants de droite alors que les familles politiques de droite étaient jusqu'alors caractérisées par leur seule opposition à la gauche ;
Le nationalisme intégral est une doctrine d’opposition radicale qui peut séduire ceux qui éprouvent un profond dégoût pour le monde dans lequel ils sont condamnés à vivre ;
Le nationalisme intégral est défendu par des revues de grande qualité sur le plan intellectuel ; l'incontestable qualité littéraire de L'Action française, son intérêt apporté au cinéma, la densité, la liberté de ton et de goût de ses pages critiques, la confiance faite à de très jeunes gens comme Boutang, Maulnier, Brasillach contribuent au succès d'un quotidien dont Marcel Proust disait en 1920 qu’il lui était impossible d’en lire un autre.
La politique naturelle
Charles Maurras est le fondateur du nationalisme positiviste. Au sentimentalisme barrésien s'oppose le positivisme maurrassien. Le martéga considère la politique comme une science. Sa politique naturelle se veut une politique scientifique, fondée sur le réel, objectivement observable et descriptible, c'est-à-dire une politique fondée sur la biologie et sur l'histoire. Pour Maurras comme pour tous les théoriciens de la contre-Révolution, Burke, Maistre, Ernest Taine, la nature se confond avec l'histoire. Lorsqu'il écrit que les sociétés sont des faits de nature et de nécessité, il veut dire qu'il faut se conformer aux leçons de l'histoire : Notre maîtresse en politique c'est l'expérience.
De telles affirmations ne sont pas neuves mais ce qui distingue Maurras de Maistre et des théocrates sur ce plan, c'est le recours à la biologie ; ici se manifeste l'influence du comtisme et du darwinisme. Un des développements de Mes idées politiques est intitulé De la biologie à la politique. Si Maurras préconise le recours à la monarchie, ce n'est nullement parce qu'il croit au droit divin des rois. Il ne prend pas en compte cet argument théologique et prétend ne recourir qu'à des arguments scientifiques : la biologie moderne a découvert la sélection naturelle, c'est donc que la démocratie égalitaire est condamnée par la science ; les théories transformistes mettent au premier plan le principe de continuité : quel régime mieux que la monarchie peut incarner la continuité nationale ?
Pour Maurras, l'État est menacé de perdre l'indépendance de son pouvoir de décision et de son arbitrage ; il lui manque d'être ab-solutus, sans lien de dépendance avec des partis qui tendent à compromettre le service qu'il doit rendre à l'ensemble de la nation et non à l'une ou l'autre de ses composantes. Sa conception du bien commun et de la raison d'État doit aussi à une certaine lecture de saint Thomas d'Aquin et de l'encyclique diuturnum que ses maîtres d'Aix avaient publié dans La Semaine religieuse et ainsi commentée : une société ne peut exister ni être conçue sans qu'il y ait quelqu'un pour modérer les volontés de chacun de façon à ramener la pluralité à une sorte d'unité, et pour leur donner l'impulsion, selon le droit et l'ordre, vers le bien commun.
D'où la position centrale du nationalisme intégral dans ses idées politiques. Celles-ci sont les bases de son soutien tant au royalisme français qu'à l'Église catholique et au Vatican. Cependant, il n'avait aucune loyauté personnelle envers la maison d'Orléans, et était un agnostique convaincu, jusqu'au retour au catholicisme à la fin de sa vie.
Inégalité, justice et démocratie
Dans l'avant-propos de son ouvrage Mes idées politiques, Charles Maurras entend définir le domaine au sein duquel la notion de justice a un sens car pour lui de nombreuses erreurs politiques procèdent d'une extension abusive de ce domaine : L'erreur est de parler justice qui est vertu ou discipline des volontés, à propos de ces arrangements qui sont supérieurs ou inférieurs à toute convention volontaire des hommes. Quand le portefaix de la chanson marseillaise se plaint de n'être pas sorti des braies d'un négociant ou d'un baron, sur qui va peser son reproche ? À qui peut aller son grief ? Dieu est trop haut, et la Nature indifférente. Le même garçon aurait raison de se plaindre de n'avoir pas reçu le dû de son travail ou de subir quelque loi qui l'en dépouille ou qui l'empêche de le gagner. Telle est la zone où ce grand nom de justice a un sens.
Pour Maurras, l'inégalité peut être bienfaisante en ce qu'elle permet une répartition protectrice des rôles et il doit s'agir pour l'État non soumis à la démagogie de les organiser au bénéfice de tous ; il est vain de vouloir supprimer les inégalités, cela est même dangereux du fait des effets secondaires pires que le mal que l'on prétend résoudre : Les iniquités à poursuivre, à châtier, à réprimer, sont fabriquées par la main de l'homme, et c'est sur elles que s'exerce le rôle normal d'un État politique dans une société qu'il veut juste. Et, bien qu'il ait, certes, lui, État, à observer les devoirs de la justice dans l'exercice de chacune de ses fonctions, ce n'est point par justice, mais en raison d'autres obligations qu'il doit viser, dans la faible mesure de ses pouvoirs, à modérer et à régler le jeu des forces individuelles ou collectives qui lui sont confiées. Mais il ne peut gérer l'intérêt public qu'à la condition d'utiliser avec une passion lucide les ressorts variés de la nature sociale, tels qu'ils sont, tels qu'ils jouent, tels qu'ils rendent service. L'État doit se garder de prétendre à la tâche impossible de les réviser et de les changer ; c'est un mauvais prétexte que la justice sociale : elle est le petit nom de l'égalité. L'État politique doit éviter de s'attaquer aux infrastructures de l'état social qu'il ne peut pas atteindre et qu'il n'atteindra pas, mais contre lesquelles ses entreprises imbéciles peuvent causer de généreuses blessures à ses sujets et à lui-même. Les griefs imaginaires élevés, au nom de l'égalité, contre une Nature des choses parfaitement irresponsable ont l'effet régulier de faire perdre de vue les torts, réels ceux-là, de responsables criminels : pillards, escrocs et flibustiers, qui sont les profiteurs de toutes les révolutions.… Quant aux biens imaginaires attendus de l'Égalité, ils feront souffrir tout le monde. La démocratie, en les promettant, ne parvient qu'à priver injustement le corps social des biens réels qui sortiraient, je ne dis pas du libre jeu, mais du bon usage des inégalités naturelles pour le profit et pour le progrès de chacun.
Maurras voit dans la république démocratique un régime démesuré où la démagogie égalitaire inspirée par une fausse conception de la justice fragilise les murailles de la cité et finit par emporter les degrés de la civilisation. Dans la démocratie, Maurras discerne un régime entropique d’élimination de la polis à laquelle se substitue une société amorphe d'individus égaux et épars, point sur lequel il rejoint Tocqueville.Prise en fait la démocratie c'est le mal, la démocratie c'est la mort. Le gouvernement du nombre tend à la désorganisation du pays. Il détruit par nécessité tout ce qui le tempère, tout ce qui diffère de soir : religion, famille, tradition, classes, organisation de tout genre. Toute démocratie isole et étiole l'individu, développe l’État au-delà de la sphère qui est propre à l’État. Mais dans la Sphère où l’État devrait être roi, elle lui enlève le ressort, l'énergie, même l’existence. … Nous n'avons plus d’État, nous n'avons que des administrations.
Maurras ne rejette pas le suffrage universel, il invite ses lecteurs à ne pas être des émigrés de l'intérieur et à jouer le rôle des institutions et du suffrage universel qu’il s’agit non de supprimer mais de le rendre exact et utile en en changeant la compétence : ne pas diriger la nation mais la représenter. Abolir la République au sommet de l’État et l’établir où elle n’est pas, dans les états professionnels, municipaux et régionaux. Maurras demande à ses lecteurs de jouer au maximum le jeu des institutions, il faut voter à toutes les élections : le mot d'ordre est celui du moindre mal.
Le nationalisme maurrassien
Le nationalisme maurrassien se veut contre-révolutionnaire, rationnel, réaliste, germanophobe, non ethniciste et conforme à la conception française de la nation.
Le nationalisme de Charles Maurras contrairement à celui de Péguy qui assume l'ensemble de la tradition française, ou à celui de Barrès qui ne récuse pas l'héritage de la Révolution, rejette l'héritage de 1789. Son nationalisme intégral rejetait tout principe démocratique qu'il jugeait contraire à l’inégalité protectrice, et critiquait les conséquences de la Révolution française : il prônait le retour à une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée. Le nationalisme de Maurras se veut intégral en ce que la monarchie fait partie selon lui de l'essence de la nation et de la tradition françaises. Maurras rejette le nationalisme de Paul Déroulède et son égalitarisme mystique, ancré sur les images de l'An II et 1848. Le royalisme est le nationalisme intégral car sans roi, tout ce que veulent conserver les nationalistes s'affaiblira d'abord et périra ensuite.
En contraste également avec Maurice Barrès, théoricien d'une sorte de nationalisme romantique basé sur l'ego, Maurras prétendait baser sa conception du nationalisme sur la raison plus que sur les sentiments, sur la loyauté et sur la foi. Mais Maurras exaltera la pensée de Maurice Barrès en ce que celle-ci est le fruit d'une évolution profonde ; partant des doutes et des confusions du moi, elle prit peu à peu conscience de la nation, de la tradition et de la sociabilité, qui la déterminent et l'élèvent : le culte du moi aboutit à une piété du nous.
La nation est pour Maurras une réalité avant d'être une idée ; il s'agit de dissocier le mot nation de son acception révolutionnaire : L'idée de nation n'est pas une nuée ; elle est la représentation en termes abstrait d'une forte réalité. La nation est le plus vaste des cercles communautaires qui soient au temporel solides et complets. Brisez-le et vous dénudez l'individu. Il perdra toute sa défense, tous ses appuis tous ses concours.
Le nationalisme de Charles Maurras est fondamentalement germanophobe ; Maurras, comme Fustel de Coulanges, était très hostile à l'idée de l'origine franque de la noblesse française et à la tendance à écrire l'histoire de France selon la méthode allemande. La méfiance à l'égard de l'Allemagne se traduit par une vigilance sur la politique de ce pays ; Walter Benjamin note à cet égard que l’orientation de l’Action française lui semble finalement la seule qui permette sans s’abêtir, de scruter les détails de la politique allemande.
Cette hostilité à l'Allemagne induit une méfiance à l'égard de tout ce qui peut détourner la France de la Revanche ; en particulier, Maurras est opposé aux conquêtes coloniales de la Troisième république ; le nationalisme maurrassien n'est pas impérialiste et Maurras se décrira à Barrès, comme un vieil adversaire de la politique coloniale.
Par ailleurs, le nationalisme maurrassien n'est pas antibritannique ; Maurras s'inquiète ainsi de l'antibritannisme qui pourrait détourner de la Revanche. Maurras admire l'élan vital de l'Angleterre qui concilie sagement le cosmopolitisme et le mieux défendu des nationalismes. Il rappelle son goût ancien et très vif pour Shakespeare qu'en 1890, il avait nommé un grand Italien, tant son œuvre est selon lui mue par la tradition latine et par Machiavel. Le peuple anglais lui apporte une image de ce que les Français ne sont plus, fiers dans leur roi d'être ce qu'ils sont :C'est qu'en Angleterre les choses sont à leur place.
La théorie nationale de Maurras rejette le messianisme et l'ethnicisme que l'on retrouve chez les nationalistes allemands héritiers de Fichte. La nation qu'il décrit correspond à l'acception politique et historique de Renan dans Qu'est-ce qu'une nation ?, aux hiérarchies vivantes que Taine décrit dans Les Origines de la France contemporaine, aux amitiés décrites par Bossuet.
Le nationalisme maurrassien se veut un réalisme opposé aux idéalismes naïfs et utopies internationalistes qui par leur irréalisme sont des pourvoyeurs de cimetières.
Le nationalisme d'Action française est à la fois militariste, c'est-à-dire pour le renforcement permanent de l'armée afin que dans l'éventualité d'une guerre, la nation soit victorieuse et souffre le moins possible, mais pacifiste, c'est-à-dire qu'économe du sang français, elle ne prône la guerre que si la France est en position de l'emporter et pour éviter un péril grave pour elle. L'Action française ne sera pas favorable au déclenchement des hostilités, ni en 1914, ni en 1939, la France n'étant pas prête pour gagner selon elle ; en revanche, elle prônera une intervention militaire en 1936 contre l'Allemagne afin d'empêcher qu'elle ne devienne dangereuse et conquérante. Pour l'Action française, ce ne sont pas les nationalisme qui sont fauteurs de guerre mais les impérialismes.
Le royalisme maurrassien
Maurras entend dépasser le nationalisme, doctrine rendue nécessaire par les temps, en l'ouvrant à ce qui théoriquement ne procède pas d'un parti, à ce qui seul peut décrire l'unité politique d'une nation, au-dessus des opinions : le principe royal. On ne restaure la monarchie non pour elle-même mais pour ce qu'elle peut apporter à la nation. La conclusion de Maurras est le nationalisme intégral, c’est-à-dire la monarchie : sans la monarchie, la nation périra. Le fameux « politique d’abord » ne signifie pas que l’économie a moins d’importance que la politique, mais qu’il faut commencer par réformer les institutions : « Ne pas se tromper sur le sens de politique d’abord. L’économie est plus importante que la politique. Elle doit donc venir après la politique, comme la fin vient après le moyen. » La monarchie selon Maurras est traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée.
Les deux caractères, traditionnelle et héréditaire, résultent immédiatement de la politique naturelle. Tradition veut dire transmission, transmission d’un héritage. Maurras parle du devoir d’héritier ainsi que du devoir de léguer et de tester. Il souligne les bienfaits de l’institution parentale : Les seuls gouvernements qui vivent longuement, écrit-il dans la préface de Mes idées politiques, les seuls qui soient prospères, sont, toujours et partout, publiquement fondés sur la forte prépondérance déférée à l’institution parentale. Il est partisan d’une noblesse héréditaire, il conseille aux fils de diplomates d’être diplomate, aux fils de commerçants d’être commerçant, etc. La mobilité sociale lui paraît provoquer une déperdition du rendement humain, expression dont il se sert dans L’Enquête sur la Monarchie. Pour Maurras, le gouvernement légitime, le bon gouvernement c’est celui qui fait ce qu’il a à faire, celui qui fait le bien, celui qui réussit l’œuvre du bien public. Sa légitimité se vérifie à son utilité. Or, le souci vigilant de l’intérêt public est selon lui cruellement dispersé dans la démocratie alors qu'en monarchie il est rassemblé dans la personne du souverain : Ce que le prince aura de cœur et d’âme, ce qu’aura d’esprit, grand, petit ou moyen, offrira un point de concentration à la conscience publique : le mélange d’égoïsme innocent et d’altruisme spontané inhérent aux réactions d’une conscience de roi, ce que Bossuet nomme son patriotisme inné, se confondra psychologiquement avec l’exercice moral de des devoirs d’État : le possesseur de la couronne héréditaire en est aussi le serf, il y est attaché comme à une glèbe sublime qu’il lui faut labourer pour vivre et pour durer. La nation a intérêt à être dirigé par un dirigeant dont les intérêts coïncident avec les siens et dont l'égoïsme privé devient une vertu publique. L'égoïsme des politiciens tend à s'identifier avec celui des partis, celui du Roi tend à s'identifier avec celui de la Patrie.
La doctrine de Maurras est antidémocratique et antiparlementaire. Sur ce thème, il affirme que l'histoire prouve qu’une république fondée sur les aléas de la démocratie parlementaire est incapable d’avoir une politique étrangère cohérente dans la durée ou du moins d’avoir les moyens de sa politique : les intérêts à court terme des partis passent avant les intérêts à long terme de la patrie. Il s’en prend au respect du nombre et au mythe de l’égalité devant la loi l’inégalité est pour lui naturelle et bienfaisante, au principe de l’élection contrairement à ce que croient les démocrates, le suffrage universel est conservateur, au culte de l’individualisme. Il dénonce le panjurisme démocratique, qui ne tient aucun compte des réalités. Il attaque avec une particulière violence les instituteurs, les Juifs, les démocrates chrétiens. Il affirme qu’il n’y a pas un Progrès mais des progrès, pas une Liberté mais des libertés : Qu’est-ce donc qu’une liberté ? - Un pouvoir. D’autre part Maurras déteste le règne de l’argent, non pas les financiers et les capitalistes en tant que tels, mais l'influence illégitime qu'ils peuvent chercher à exercer sur l'État. Il souligne les liens entre démocratie et capitalisme ; son traditionalisme est opposé au pouvoir exclusif de la bourgeoisie ; sur ce point, il est d’accord avec Péguy et sa doctrine est en harmonie avec les sentiments des hobereaux plus ou moins ruinés qui constituaient souvent les cadres locaux de L’Action française.
Maurras est un adversaire de la centralisation napoléonienne. Il estime en effet que cette centralisation, qui a pour conséquence l’étatisme et la bureaucratie rejoignant ainsi les idées de Proudhon, est inhérente au régime démocratique. Il affirme que les républiques ne durent que par la centralisation, seules les monarchies étant assez fortes pour décentraliser. Maurras dénonce l'utilisation insidieuse du mot décentralisation par l'État, qui lui permet de déconcentrer son pouvoir tout en se donnant un prestige de liberté : à quoi bon créer des universités en province si l'État central les commande entièrement. Comme Maurice Barrès, Charles Maurras exalte la vie locale comme la condition même du fait politique et du civisme, annihilée ou atrophiée par la centralisation : c'est par le biais décentralisateur et fédéraliste, par la défense des traditions locales que doit s'effectuer le passage d'un nationalisme jacobin, égalitaire et étatiste, à un nationalisme historique et patrimonial appuyé sur les diversités de la nation française, hostile à l'emprise de l'État central : Il n'est guère enviable d'être mené comme un troupeau, à coup de règlements généraux, de circulaires contradictoires, ni d'être une organisation toute militaire. Pour Maurras, il faut refonder l'État, un État véritable : l'État redevenu la Fédération des régions autonomes, la région, la province redevenues une Fédération de communes ; et le commune, enfin, premier centre et berceau de la vie sociale. Pour Maurras, il ne s'agit pas de faire revivre les anciennes provinces de l'Ancien Régime car leur découpage a varié d'un siècle par l'effet des traités, des donations, des mariages, des coutumes du droit féodal à l'autre mais de réfléchir au projet de création régions épousant les désirs de la nature, ses vœux, ses tendances. Décentralisation territoriale sans doute, mais aussi et surtout décentralisation professionnelle, c’est-à-dire corporatisme : il faut redonner une vie nouvelle aux corps de métier, à toutes ces communautés naturelles dont l’ensemble forme une nation.
Charles Maurras est hostile à l'influence politique sur le royalisme du romantisme dans lequel il voit une manifestation d'un esprit incompatible au génie gréco-latin, à l'esprit d'ordre et de clarté qui soit selon lui animer l'esprit français. Il s'en prend en particulier à Chateaubriand dont la pensée ne constitue pas pour les royalistes français un appui solide ; il ne méconnaît pas le génie littéraire de l'homme mais il perçoit que Chateaubriand n'aime la monarchie qu'au passé : Chateaubriand n'a jamais cherché dans la mort et dans le passé, le transmissible, le fécond, le traditionnel, l'éternel : mais le passé, comme passé, et la mort, comme mort, furent ses uniques plaisirs. Il a habitué ses lecteurs à l'idée que la monarchie aussi belle qu'elle soit, n'était au fond qu'un beau souvenir, sans voir ce qu'elle pourrait apporter dans le futur.
Critique de la Révolution française et de ses sources
Charles Maurras était hanté par l'idée de décadence, partiellement inspirée par ses lectures d'Hippolyte Taine et d'Ernest Renan. Comme ses derniers, il pensait ainsi que la décadence de la France trouvait son origine dans la Révolution de 1789 ; la Révolution française, écrivait-il dans L’Observateur, était objectivement négative et destructive par les massacres, les guerres, la terreur, l'instabilité politique, le désordre international, la destruction du patrimoine artistique et culturel dont elle fut la cause.
L'origine de la Révolution se trouve selon lui dans les Lumières et à la Réforme ; il décrivait la source du mal comme étant des idées suisses, une référence à la nation adoptive de Calvin et la patrie de Jean-Jacques Rousseau. Ce dernier incarnait la rupture avec le classicisme que Maurras considérait comme l'expression du génie grec et latin, ce qui se ressent nettement dans ses recueils de poèmes, notamment La Musique intérieure et La Balance intérieure. La critique du protestantisme est thème récurrents de ses écrits : ainsi quand il définit la notion de Civilisation et son principe dans ses Œuvres Capitales, il affirme que la Réforme a eu pour effet le recul de la Civilisation. Il ajoutait que la Révolution n'était que l'œuvre de la Réforme en ce que l'esprit protestant symbolise selon lui l'individualisme exacerbé, destructeur du lien social et politique, tel qu'Auguste Comte le décrit et le condamne. Il y aura toutefois une composante protestante à l'Action française dont Jacques Delebecque et Henri Boegner sont les plus connus. Maurras tempèrera son antiprotestantisme par la suite et se livrera à la mort du géographe protestant Onésime Reclus à son panégyrique, regrettant sa rencontre manquée avec lui.
Pour Maurras, la Révolution française avait contribué à instaurer le règne de l'étranger et de l' Anti-France, qu'il définissait comme les quatre États confédérés des Protestants, Juifs, Francs-maçons, et métèques. En effet, pour lui, Protestants, Juifs et Francs-maçons étaient comme des étrangers internes dont les intérêts en tant que communautés influentes ne coïncidaient pas avec ceux de la France.
La pensée de Maurras est également caractérisée par un militantisme antimaçonnique. À propos de la franc-maçonnerie, il écrit dans son Dictionnaire politique et critique : Si la franc-maçonnerie était jadis un esprit, d’ailleurs absurde, une pensée, d’ailleurs erronée, une propagande, d’ailleurs funeste, pour un corps d’idées désintéressées ; n’est aujourd'hui plus animé ni soutenu que par la communauté des ambitions grégaires et des appétits individuels.
Maurras pensait ainsi que la Réforme, les Lumières, et la Révolution française ont eu pour effet l'invasion de la philosophie individualiste dans la cité française. Les citoyens la composant se préoccupant, d'après Maurras, avant tout de leur sort personnel avant de s'émouvoir de l'intérêt commun, celui de la nation. Il croyait alors que cette préoccupation individualiste et antinationale était la cause d'effets indésirables sur la France ; la démocratie et le libéralisme ne faisant qu'empirer les choses.
Différences avec les traditions orléaniste et légitimiste
Même si Maurras prônait un retour à la monarchie, par bien des aspects son royalisme ne correspondait pas à la tradition monarchiste française orléaniste, ou à la critique de la Révolution de type légitimiste. Son antiparlementarisme l'éloignait de l'orléanisme et son soutien à la monarchie et au catholicisme étaient explicitement pragmatiques et non fondés sur une conception providentialiste ou religieuse caractéristique du légitimisme.
L'hostilité de Maurras à la Révolution se combinait avec une admiration pour le philosophe positiviste Auguste Comte dans laquelle il trouvait une contre-balance à l'idéalisme allemand et qui l'éloignait de la tradition légitimiste. Du comtisme, Maurras ne retient ni la théorie des trois âges, ni la religion du Grand Être, ni la filiation avec l'athéisme philosophique mais l'idée que l’Église catholique a joué un rôle bénéfique pour la civilisation, la société et l'homme indépendamment de l'affirmation personnelle de foi226. Contrairement au royalisme légitimiste qui met en avant la providence divine, Maurras se borne à vouloir chercher les lois de l'évolution des sociétés et non ses causes premières qu'il ne prétend pas identifier.
Certaines intuitions de Maurras à propos du langage annoncent le structuralisme et se détachent de toute recherche métaphysique : Ce qui pense en nous, avant nous, c'est le langage humain, qui est, non notre œuvre personnelle, mais l'œuvre de l'humanité, c'est aussi la raison humaine, qui nous a précédés, qui nous entoure et nous devance.
D'autres influences incluant Frédéric Le Play lui permirent d'associer rationalisme et empirisme, pour aboutir au concept d' empirisme organisateur, principe politique monarchique permettant de sauvegarder ce qu'il y a de meilleur dans le passé.
Alors que les légitimistes rechignaient à s'engager vraiment dans l'action politique, se retranchant dans un conservatisme catholique intransigeant et une indifférence à l'égard du monde moderne considéré comme mauvais du fait de sa contamination par l'esprit révolutionnaire, Maurras était préparé à s'engager entièrement dans l'action politique, par des manières autant orthodoxes que non orthodoxes les Camelots du roi de l'Action française étaient fréquemment impliqués dans des bagarres de rue contre des opposants de gauche, tout comme les membres du Sillon de Marc Sangnier. Sa devise était politique d'abord .
Politique sociale
En dépit de l'appui mesuré et prudent qu'il donna au Cercle Proudhon, cercle d'intellectuels divers et indépendants, Charles Maurras défendit une politique sociale plus proche de celle de René de La Tour du Pin ; Maurras ne fait pas comme Georges Sorel et Édouard Berth le procès systématique de la bourgeoisie où il voit un appui possible. À la lutte des classes, Maurras préfère opposer comme en Angleterre, une forme de solidarité nationale dont le roi peut constituer la clef de voûte.
À l'opposé d'une politique de masse, il aspire à l'épanouissement de corps intermédiaires librement organisés et non étatiques, l'égoïsme de chacun tournant au bénéfice de tous. Les thèmes sociaux que traite Charles Maurras sont en concordance avec le catholicisme social et avec le magistère de l’Église tout en relevant également d'une stratégie politique pour arracher à la gauche son emprise sur la classe ouvrière.
Comme l'Action française, le cercle Proudhon est décentralisateur et fédéraliste, et insiste sur le rôle de la raison et de l'empirisme ; il se trouve loin de l'irrationalisme, du jeunisme du populisme, de l'intégration des masses dans la vie nationale qui caractériseront par exemple les ambitions du fascisme italien, gonflé par les conséquences sociales de la guerre. Charles Maurras veilla cependant à ce que le cercle Proudhon ne soit pas intégré à l'Action française : il rejetait en effet le juridisme contractualiste de Proudhon, qui représente pour lui un point de départ plutôt qu'une conclusion : Je ne dirai jamais : lisez Proudhon à qui a débuté par la doctrine réaliste et traditionnelle, mais je n'hésiterai pas à donner ce conseil à quiconque ayant connu les nuées de l'économie libérale ou collectiviste, ayant posé en termes juridiques ou métaphysiques le problème de la structure sociale, a besoin de retrouver les choses vivantes sous les signes sophistiqués ou sophistiqueurs ! Il y a dans Proudhon un fort goût des réalités qui peut éclairer bien des hommes.
Antisémitisme d'État
Charles Maurras hérite de la pensée de La Tour du Pin le principe de la lutte contre les États dans l'État et il l'applique à ce qu'il appelle les « quatre États confédérés » juif, protestant, franc-maçon et métèque étranger, expression qu'il reprend cependant à Henri Vaugeois qui l'utilise en juin 1899 ; Maurras souhaite que l'État ne soit plus soumis à l'influence de ces quatre États confédérés qui défendent leur intérêt et non celui de la nation. Contre l’hérédité de sang juif, il faut l’hérédité de naissance française, et ramassée, concentrée, signifiée dans une race, la plus vieille, la plus glorieuse et la plus active possible. … Décentralisée contre le métèque, antiparlementaire contre le maçon, traditionnelle contre les influences protestantes, héréditaire enfin contre la race juive, la monarchie se définit, on le voit bien, par les besoins du pays. Nous nous sommes formés en carré parce qu’on attaquait la patrie de quatre côtés.
Le problème juif est pour Maurras que l'intérêt juif rentre fatalement en concurrence avec l'intérêt français et que si la France dans un régime fédéraliste peut être une fédération de peuples autonomes dans le cadre des provinces, il ne peut en être autrement des Juifs qui n'ont pas de sol à eux en France et qui en possèdent de droit un hors de France en Palestine. Chaque ligueur de l'Action française devait prêter un serment disant notamment : Seule, la Monarchie assure le salut public et, répondant de l’ordre, prévient les maux publics que l’antisémitisme et le nationalisme dénoncent. Selon Laurent Joly, la lutte antijuive est au cœur du combat contre la République. Jusque-là, l’AF était une association d’intellectuels qui se réunissaient au café de Flore et lançaient leurs mots d'ordre dans une revue paraissant tous les quinze jours. Dorénavant, le mouvement dispose de troupes préparées à l'agitation et au coup de poing. La doctrine est fixée, la stratégie également : ces combats prendront pour cible privilégiée les Juifs.
De fait, le discours antisémite n'est au moment de la naissance de l'Action française pas l'apanage des courants de pensée réactionnaires ou nationalistes ; François Huguenin, analysant l’antisémitisme de Maurras, rappelle que Voltaire évoqua Le plus abominable peuple de la Terre, que Marx développa dans La Question juive et Le Capital un antisémitisme farouche ; il affirme que Jaurès et Clemenceau auront contre les Juifs des formules que jamais Maurras n'osera.
Maurras n'écrira pas de livre spécifique sur la question juive mais dénoncera régulièrement l'influence juive en recourant à la violence verbale qui caractérise son style polémique, courante à son époque et qui touchait autant les non-Juifs. Ainsi, il déploya, avec ses principaux collaborateurs, une grande virulence, allant régulièrement jusqu'à la menace de mort explicite. Maurras publia ainsi une lettre ouverte à Abraham Schrameck, ministre de l'Intérieur, en 1925, après l'assassinat de plusieurs dirigeants de l'Action française comme Marius Plateau : Ce serait sans haine et sans crainte que je donnerais l'ordre de répandre votre sang de chien si vous abusiez du pouvoir public pour répandre du sang français répandu sous les balles et les couteaux des bandits de Moscou que vous aimez, ce qui lui valut d'être condamné pour menace de mort. Il récivide en 1935 et 1936 contre Léon Blum, avant comme après la nomination de celui-ci à la présidence du Conseil :
Ce Juif allemand naturalisé, ou fils de naturalisé, la famille Blum était française de plein droit depuis 1791, qui disait aux Français en pleine Chambre qu’il les haïssait Blum n'a jamais dit cela, n’est pas à traiter comme une personne naturelle. C’est un monstre de la République démocratique. Et c’est un hircocerf de la dialectique heimatlos. Détritus humain à traiter comme tel… L’heure est assez tragique pour comporter la réunion d’une cour martiale qui ne saurait fléchir. M. Reibel demande la peine de mort pour les espions. Est-elle imméritée pour les traîtres ? Vous me direz qu’un traître doit être de notre pays : M. Blum en est-il ? Il suffit qu’il ait usurpé notre nationalité pour la décomposer et la démembrer. Cet acte de volonté, pire qu’un acte de naissance, aggrave son cas. C’est un homme à fusiller, mais dans le dos.
C'est en tant que Juif qu'il faut voir, concevoir, entendre, combattre et abattre le Blum. Ce dernier verbe paraîtra un peu fort de café : je me hâte d'ajouter qu'il ne faudra abattre physiquement Blum que le jour où sa politique nous aura amené la guerre impie qu'il rêve contre nos compagnons d'armes italiens. Ce jour-là, il est vrai, il ne faudra pas le manquer.
Certes, Maurras ne réservait pas, dans le deuxième cas, sa menace au seul Léon Blum mais contre l'ensemble des parlementaires partisans de sanction contre l'Italie fasciste, qui avait envahi l'Éthiopie, en violation de la charte de la Société des Nations ; mais, outre que seul Léon Blum fut victime d'une agression physique par des maurrassiens, en février 1936, du 6 au 21 juin 1936, au moins sept manchettes de L'Action française sont des attaques antisémites visant le gouvernement de Front populaire. De même, après l'attaque verbale de Xavier Vallat contre Léon Blum, ce fut essentiellement la presse d'Action française, Maurras en tête, qui fit de la surenchère antisémite. Déjà, en 1911, la plupart des articles publiés par Maurras cette année-là contenaient des attaques antisémites et une vingtaine étaient spécifiquement consacrés à la question juive. En 1938 que l'antisémitisme de Maurras franchit un palier lorsqu'il écrit : Le Juif veut votre peau. Vous ne la lui donnerez pas ! Mais nous l’engageons à prendre garde à la sienne, s’il lui arrive de nous faire accéder au massacre universel.
L'antisémitisme d'État de Maurras occupe cependant une place modeste dans son œuvre selon Léon Poliakov qui évoque les bons Juifs qu'avait distingués Maurras par leur engagement dans la Grande Guerre, comme Pierre David et René Groos, Juif d'Action française, pour qui la Monarchie, par le recours au Roi justicier et conciliateur, peut seule résoudre le problème juif.Pour François Huguenin, il n'y a pas chez Maurras, ni dans l'ensemble de la rédaction de L'Action française, une plus grande hostilité à la communauté juive qu'aux protestants, et qui sous-tendrait un racisme fondamental. Inversement, pour Laurent Joly, Chez Charles Maurras, la haine du Juif occupe une place prépondérante tant dans son univers mental que dans la construction politique qu’il a élaborée. Et il est exagéré de mettre, comme on le fait souvent, son antisémitisme sur le même plan que ses sentiments à l’égard des protestants et des francs-maçons, et de ne le considérer que comme une conséquence de son idéologie antilibérale et monarchiste. Habituellement virulent contre ses adversaires politiques, Maurras peut modérer son point de vue vis-à-vis des protestants, comme les Monod par exemple. Il ne manifestera jamais la même clémence à l’égard d’un Juif. Ce dernier peut rendre des services à la nation, il ne sera jamais un vrai Français. Laurent Joly s'appuie en particulier sur deux citations de Maurras. L'une à propos des protestants : Nous n’attaquons pas les protestants ; nous nous défendons contre eux, ce qui n’est pas la même chose. Nous n’avons jamais demandé d’exclure les protestants de l’unité française, nous ne leur avons jamais promis le statut des Juifs. L'autre à propos des francs-maçons et des protestants à la fois : Nous en avons à leur gouvernement et à leur tyrannie, non à leur existence contrairement aux Juifs. S. Giocanti argue que Charles Maurras eut des propos positifs sur des politiciens juifs comme Benjamin Disraeli, mais Disraeli s'était converti au christianisme.
Charles Maurras est conscient du problème éthique posé par l'antisémitisme biologique : en 1937, il affirme : L'antisémitisme est un mal, si l'on entend par là cet antisémitisme de peau qui aboutit au pogrom et qui refuse de considérer dans le Juif une créature humaine pétrie de bien et de mal, dans laquelle le bien peut dominer. On ne me fera pas démordre d'une amitié naturelle pour les Juifs bien nés. Lors de la promulgation du statut des Juifs, Charles Maurras insistera sur cette distinction entre l'antisémitisme de peau et l’antisémitisme d'État ; Maurras condamne l'antisémitisme racial et biologique et affirme que l'État ne doit en vouloir ni à la foi religieuse des Israélites, ni à leur sang, ni à leur bien. En 1941, il réaffirme la spécificité de son antisémitisme d'État : On pose bien mal la question. Il ne s'agit pas de flétrir une race. Il s'agit de garder un peuple, le peuple français, du voisinage d'une peuple, qui, d'ensemble, vit en lui comme un corps distinct de lui …. Le sang juif alors ? Non. Ce n'est pas quelque chose d'essentiellement physique. C'est l'état historique d'un membre du peuple juif, le fait d'avoir vécu et de vivre lié à cette communauté, tantôt grandie, tantôt abaissée, toujours vivace. Dans sa Philosophie de l'antisémitisme, Michel Herszlikowicz affirme que Maurras avait compris les dangers du racisme et des mouvements de masse mais que son erreur consiste dans l'idée que l'antisémitisme peut devenir une conception dépouillée de toute sentimentalité et de toute brutalité. Inversement, pour Ralph Schor, dans la pratique, le maître à penser de l'Action française ne différait guère des autres antisémites ; la différence était théorique. De fait, Maurras prône pour les Juifs un statut personnel, la protection et la justice mais leur refuse l'accès aux fonctions publiques. Selon Stéphane Giocanti, cet antisémitisme se veut moins grossier que d'autres, en condamnant les théories pseudo-scientifiques, et en rejetant la haine ordurière que l'on trouve chez Édouard Drumont et il se présente comme une construction plus rationnelle et apte à séduire un public bourgeois, sensible à la bonne conscience. Toutefois, encore en 1911, Maurras qualifiait Drumont de maître génial et de grand Français qui a posé la difficile question de l’antisémitisme d’État.Maurras ajoutait : Le Juif d’Algérie, le Juif d’Alsace, le Juif de Roumanie sont des microbes sociaux. Le Juif de France est microbe d’État : ce n’est pas le crasseux individu à houppelande prêtant à la petite semaine, portant ses exactions sur les pauvres gens du village ; le Juif d’ici opère en grand et en secret.Et en 1907, l'Action française avait tenté de racheter La Libre Parole, journal de Drumont, car l'AF, à ce moment-là, ambitionne de se poser en successeur légitime du père de La France juive Drumont Selon Jean Touchard et Louis Bodin, l'antisémitisme de Charles Maurras, de L'Action française en général, et de quelques autres auteurs d'extrême droite atteignit en 1936 un degré de violence qui fait paraître modérés les écrits d'Édouard Drumont.
Refusant le racisme et l'antisémitisme biologique, Charles Maurras reçut des témoignages de fidélité de juifs français, comme celui du sergent Pierre David que Maurras nommera le héros juif d'Action française. D'autres juifs deviendront des ligueurs d'Action française comme Marc Boasson, Georges et Pierre-Marius Zadoc, Raoul-Charles Lehman, le professeur René Riquier, les écrivains Louis Latzarus et René Groos. En 1914 le journal publie l'éloge funèbre d'Abraham Bloch, grand rabbin de Lyon, tué au cours de la bataille de la Marne.
Pour Maurras, l'antisémitisme est un instrument, un ressort dialectique et insurrectionnel, une idée à la fois contre-révolutionnaire et naturaliste, un levier qui permet de mobiliser les énergies contre l'installation de la démocratie libérale, vision qu'il partage avec des syndicalistes révolutionnaires de l'extrême gauche engagés dans la lutte insurrectionnelle.
Certains maurrassiens théorisent l'antisémitisme ; ainsi, Octave Tauxier, pour qui l'antisémitisme, en manifestant que les communautés d'intérêt existent, agissent et vivent pour leur compte, ruine par les faits la théorie révolutionnaire jacobine refusant l'homme de chair mais concevant un homme abstrait comme une unité raisonnable forçant sa nature rebelle aux groupements que seule la tradition rend stable. Léon de Montesquiou déclare : Le Juif est l’agent destructeur de notre foi et de la patrie. Nous sommes prêts à sacrifier nos existences pour débarrasser la France des Juifs.Léon Daudet ajoute : La guerre est déclarée comme en 1870.… C’est une guerre franco-juive. Une première bataille a été livrée, elle a été gagnée ; il s’agit de continuer.Daudet écrit aussi, dans le contexte du Front populaire :
Du fait de la République, régime de l’étranger, nous subissons actuellement trois invasions : la russe, l’allemande, et notamment la juive allemande, l’espagnole. La crapule de ces trois nations s’infiltre et s’installe chez nous. Elle y pille, elle y corrompt et elle y assassine. Ce mouvement immonde, et qui va en accélérant, annonce la guerre. Il date de loin, de l’affaire du traître Dreyfus. La domination d’un Juif rabbinique, Léon Blum, totalement étranger à nos mœurs, coutumes et façons de comprendre et de ressentir, multiplie actuellement le danger par dix.
D’autres maurrassiens sont indifférents à ce thème et ne sont pas antisémites, comme Jacques Bainville sous la plume desquels on ne trouve aucun texte antijuif.
Maurras et les dictatures européennes non communistes, le fascisme
Pour François Huguenin, comprendre la position de Maurras face au fascisme nécessite de prendre en compte trois ordres de préoccupation autonomes parfois confondus : celui de la politique extérieure, celui de l'idéologie, celui de la réussite révolutionnaire.
Sur le plan de la technique de la prise de pouvoir, les maurrassiens seront impressionnés par la capacité du fascisme à mettre fin au désordre démocratique libéral.
Sur le plan de la politique extérieure, Maurras ne cessera de prôner face au péril allemand une union latine englobant la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. En 1935, Maurras s'opposera aux sanctions contre le régime fasciste pour empêcher de pousser Mussolini à s'allier avec Hitler, alors que Mussolini souhaitait initialement contrer l'expansion du national-socialisme en liaison avec les alliés de l'Italie pendant la Première Guerre mondiale comme la France. L'idéologie ne dicte par cette volonté d'alliance orientée contre l'Allemagne qui explique la discrétion des critiques de Maurras contre le fascisme italien, critiques pourtant contenues dans l'anti-étatisme de Maurras.
Sur le plan idéologique, Maurras met en garde contre une trop grande admiration de Mussolini et sa position évolue avec l'évolution du fascisme ; au tout début du fascisme, avant le développement de l'étatisme et la théorisation par le fascisme du totalitarisme, Maurras souligne la parenté entre certaines de ses idées et celles du mouvement de Mussolini ; mais dès 1928, il écrit : C'est la naïveté courante. Ceux qui la formulent et la propagent innocemment ne se rendent pas compte qu'une action d'ordre et de progrès comme celle du fascisme italien suppose une base solide et stable, que la Monarchie fournit et qu'un certain degré d'aristocratie, ou, si l'on veut, d'antidémocratie doit encore la soutenir. Comme Massis, Maurras s'inquiétera des lois scolaires du fascisme. Quand en 1932, Mussolini déclare qu'en dehors de l'État, rien de ce qui est humain ou spirituel n'a une valeur quelconque, Maurras dénonce une conception aux antipodes de sa pensée : rappelant le double impératif de fortifier l'État et d'assurer la liberté des groupes sociaux intermédiaires, il réaffirme combien les partisans du nationalisme intégral ne sont pas étatistes.
Le souci de ménager l'Italie pour éviter qu'elle ne s'engage militairement avec l'Allemagne et l'admiration de la réussite d'un coup de force tranchant avec l'impuissance des nationalistes français expliquent la faible insistance à souligner les divergences importantes avec le fascisme italien.
Charles Maurras, dans sa réflexion centrée sur la France, n'a jamais pris la peine de réfuter les expériences politiques étrangères, ce qui vaut pour le marxisme comme pour le fascisme et l'Action française s’accommodera pour l'étranger de régimes dont elle ne voudrait pas pour la France. C'est à un de ses disciples, Thierry Maulnier, que reviendra de dénoncer le fascisme, comme si l'attraction fasciste était plus sensible pour un homme de sa génération que pour un homme comme Maurras ; Thierry Maulnier multipliera dans le quotidien de Maurras ou dans d'autres publications les écrits contre le fascisme, ce collectivisme autoritaire, religieux, total et désolant et la civilisation française. De façon générale, nombre de maurrassiens ont affirmé que la pensée de Maurras les avaient prémunis de l'attraction du fascisme ; dans les années 1990, Raoul Girardet dira : Même ébréchée, la doctrine maurrassienne constituait à cet égard une barrière solide : la conception totalitaire de l'État et de la société lui était complètement étrangère.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=7227#forumpost7227
Posté le : 16/11/2014 18:05
|
|
|
|
|
Charles Maurras 3 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Son oeuvre
Les activités politiques ne diminuent en rien l'œuvre littéraire où s'ajoutent, aux analyses politiques, les ouvrages du félibre toujours présent en Maurras, comme Musique intérieure 1925, recueil de poèmes. Et quand il connaît la prison, en 1935, à la suite des menaces de mort qu'il avait adressées aux parlementaires coupables d'avoir voté les sanctions contre Mussolini à l'occasion de la guerre d'Éthiopie, non seulement il continue à rédiger son article quotidien, mais il élabore largement des ouvrages qui deviendront Mes Idées politiques 1937, bilan synthétique de sa doctrine, Arles au temps des fées 1937, Les Vergers sur la mer 1937, Devant l'Allemagne éternelle 1937, Jeanne d'Arc, Louis XIV, Napoléon 1937.
Son art de la polémique, son talent littéraire et la participation constante de l'Action française en tête de l'agitation des ligues donnèrent à Maurras, surtout dans le milieu étudiant, une large audience. Des hommes aussi différents que Daudet et Massis, Brasillach et Bernanos, sans oublier Pierre Gaxotte, Jacques Maritain, Thierry Maulnier, Kléber Haedens et, au début de l'Action française, Barrès, Henri Bordeaux, Jacques Bainville, Paul Bourget se trouvèrent un moment rassemblés sous l'étendard maurrassien. Mais comme Maritain en 1926, Bernanos en 1932, Brasillach en 1941, beaucoup le quittèrent, soit en raison de sa doctrine sur le christianisme judaïsant, Le Venin juif de l'Évangile, soit en raison de son antisémitisme qui prenait trop souvent les apparences du racisme, soit en raison de ses atermoiements devant toute entreprise de conquête du pouvoir, soit encore à la suite de la condamnation de Rome. Dès avant 1914, l'Église s'inquiétait en effet de l'influence sur les esprits chrétiens de ce maître qui, tout en proclamant son respect et son admiration pour elle, demeurait un agnostique, alors qu'il dirigeait un journal et un mouvement surtout composés de catholiques. Pour Maurras, l'Église n'était qu'une autorité utile pour l'ordre, un temple des définitions du savoir. Déjà ses principaux ouvrages avaient été mis à l'Index quand, en 1926, le Vatican condamna son mouvement : lecture du journal et appartenance au mouvement d'Action française étaient interdites sous peine d'être exclu des sacrements. Le coup fut durement ressenti, et il était trop tard pour que le journal retrouvât vraiment toute son influence ; la rupture avec le prétendant, Henri, comte de Paris, qui « pour ne pas compromettre les chances de la monarchie se désolidarisait de ses supporters nov. 1937 lui portait un nouveau coup. En 1939, à la suite des articles de Maurras sur la guerre d'Espagne, Pie XII abrogea la condamnation prononcée par Pie XI.
Arrêté en septembre 1944, Maurras est jugé et condamné à la dégradation civique et à la détention perpétuelle. À Riom puis à Clairvaux, il poursuit son œuvre tant politique que littéraire en écrivant L'Ordre et le désordre 1948, Le Parapluie de Marianne 1948, Pour un jeune Français 1949, Mon jardin qui s'est souvenu 1949, Le Beau Jeu des reviviscences 1952. Ayant obtenu une grâce en raison de sa santé, il achève, avant de mourir à la clinique de Tours et ayant retrouvé la foi de son enfance, un livre sur Pie X et un recueil de poèmes.
Maurras et le national-socialisme
La condamnation du national-socialisme se fonde sur une série d'arguments se situant à différents niveaux d'analyse.
Maurras dénonce le racisme depuis le début de son activité politique : Nous ne pouvions manquer, ici d’être particulièrement sensibles : le racisme est notre vieil ennemi intellectuel ; dès 1900, ses maîtres français et anglais, Gobineau, Vacher de Lapouge, Houston Chamberlain, avaient été fortement signalés par nous à la défiance des esprits sérieux et des nationalistes sincères. Charles Maurras écrit en 1933 : Nous ne croyons pas aux nigauderies du racisme. Maurras traite de basses sottises les idées de Joseph de Gobineau et de Georges Vacher de Lapouge et rappelle : J'ai, pour mon compte, toujours pris garde de séparer les réflexions sur l'hérédité politique et économique d'avec les généralisations vagues, aventureuses et captieuses sur la stricte hérédité physiologique. Pour Maurras : Nous sommes des nationalistes. Nous ne sommes pas des nationalistes allemands. Nous n'avons aucune doctrine qui nous soit commune avec eux. Toutes les falsifications, tous les abus de textes peuvent être tentés : on ne fera pas de nous des racistes ou des gobinistes. Maurras écrit à propos du nazisme : l’entreprise raciste est certainement une folie pure et sans issue.
Maurras précise sa critique métaphysique du nazisme en soulignant fondements fichtéens : il dénonce l’image de l’homme allemand défini par Fichte, initiateur du narcissisme originel et fondamental où Hitler se retrouve ; Maurras insiste sur l'horreur fichtéenne d'Hitler pour le fédéralisme, sa démagogie métaphysique, son déisme à la Robespierre. Maurras est un des rares à souligner la dimension et l’inversion théologique du nazisme, son imitation caricaturale et perverse d’Israël et comme Alain Besançon, il voit le national-socialisme procéder à une contrefaçon fichtéenne de la notion de peuple élu. Dès le début des années 1930, Maurras et l'Action française mettent en garde contre le messianisme du nationalisme allemand dont le national-socialisme est l'expression accomplira jusqu'à la folie la logique dominatrice.
Le nationalisme de Maurras est héritier de Fustel de Coulanges et de Renan, historique et politique, on n'y trouve ni linguisticisme, ni racisme : politique d’abord ! … Entre tous, l’élément biologique est le plus faiblement considéré et le moins sérieusement déterminé. Dès lors, ces déterminations vagues d’une part, ces faibles déterminations d’autre part, ne peuvent porter qu’un effet : l’exaltation des fanatismes d’où sortent les exagérations que le Vatican dénonçait l’autre jour, et l’encouragement aux méprises et aux malentendus.
Sa critique du national-socialisme est aussi fondée sur le fait que celui-ci est selon lui un aboutissement logique du rousseauisme et de la démagogie démocratique : dans De Demos à César, il analyse l’évolution des régimes contemporains et discerne les liens de continuité entre la société démocratique et les tyrannies bolcheviques ou nazies, le prolongement que le despote moderne fournit au moi rousseauiste, en absorbant l’individu dans la collectivité
Bien qu'agnostique Maurras défend la civilisation catholique et il perçoit dans le nazisme un ennemi du catholicisme et de ses valeurs : lorsque le pape Pie XI promulgue Mit Brennender Sorge, le 25 mars 1937, Maurras approuve avec enthousiasme et précise sa position : Tous les esprits impartiaux qui ont étudié le nationalisme français, même intégral, surtout intégral, savent combien il est profondément hostile à ce que l'Encyclique d'hier appelle la théorie du sol et du sang, théorie métaphysique, bien entendu, qui substitue aux relations normales et objectives des hommes, au jeu naturel des apports collectifs nationaux et professionnels, une distribution toute subjective fondée sur les races et sur les climats, dérivée du principe que l'Homme allemand all-man est l'Homme par excellence, le tout de l'Homme, et de ce que Luther incarna cet Homme dans l'histoire politique et dans l'histoire des religions. Les maurrassiens dénonceront le national-socialisme à la lumière d'une critique plus générale de l'esprit allemand.
Sa critique du national-socialisme est aussi une critique implicite du totalitarisme. C’est la nation que Maurras défend et pas l’idolâtrie de son État : un nationalisme n’est pas un nationalisme exagéré ni mal compris quand il exclut naturellement l’étatisme. Il discerne dans le totalitarisme une usurpation de l’État sur la société : Quand l’autorité de l’État est substituée à celle du foyer, à l’autorité domestique, quand elle usurpe les autorités qui président naturellement à la vie locale, quand elle envahit les régulateurs autonomes de la vie des métiers et des professions, quand l’État tue ou blesse, ou paralyse les fonctions provinciales indispensables à la vie et au bon ordre du pays, quand il se mêle des affaires de la conscience religieuse et qu’il empiète sur l’Église, alors ce débordement d’un État centralisé et centralisateur nous inspire une horreur véritable : nous ne concevons pas de pire ennemi.
Maurras s’inquiète de ce que certains pourraient voir dans l’Allemagne un rempart contre le communisme, il y voit un piège politique : Les cornichons conservateurs … qui prendraient Hitler pour un sauveur de l’ordre – de l’ordre français - sont certainement coupables d’un crime devant l’esprit au moins égal à celui de nos moscoutaires. Il note même que l’intrigue hitlérienne est plus dangereuse que celle des Soviets. En avril 1936, Maurras dénonce le péril national-socialiste et le déclare même pire pour la France que le péril communiste : Hitler est encore notre ennemi numéro 1. Moscou est bien moins dangereux.
Maurras dénonce Hitler qu'il appelait le chien enragé de l'Europe car son idéologie est porteuse de barbarie ; il s’en prend à la presse qui travaille à créer pour cette gloire de primate, un cercle de respect béant et d’inhibition ahurie à l’égard du dictateur walkyrien.Face à la barbarie nazie, Maurras écrit : Ce ne peut être en vain que la France a été pendant des siècles la civilisatrice et l’institutrice du monde. Elle a le devoir de ne pas renoncer à ce rôle. Hitler prépare la barbarisation méthodique de l'Europe.
Il alerte les Français sur l'eugénisme : Le 1er janvier 1934, une certaine loi sur la stérilisation est entrée en vigueur ; si elle joue contre l’indigène du Reich, croit-on que l’étranger s’en défendra facilement ? Afin de mettre en garde les Français sur ce qui les attend, il réclame une traduction non expurgée de Mein Kampf, dont certains passages laissant prévoir les ambitions hitlériennes avaient été censurés dans la version française.
Toutefois, il écrit dans L'Action française du 28 août 1942 : Avec toute la France, les prisonniers heureusement libérés remercient M. Hitler.
Maurras et la colonisation
Maurras est hostile à l'expansion coloniale impulsée par les gouvernements républicains qui détourne de la Revanche contre l'Allemagne et disperses ses forces ; de plus, il est hostile à la politique jacobine et républicaine d'assimilation qui vise à imposer la culture française à des peuples ayant leur propre culture. Comme Lyautey, il pense qu'il faut faire aimer la France et non imposer la culture française au nom d'un universalisme abstrait.
Cette dernière conception attire à lui des faveurs dans les élites des peuples colonisés ; ainsi, Ferhat Abbas, est d’abord un algérien maurrassien : il est le fondateur de L’Action algérienne, organe se réclamant du nationalisme intégral et se battant pour l’adoption de propositions concrètes : toutes vont dans le sens de la démocratie locale et organisée, la seule forme de démocratie pour laquelle Maurras militait, parce que d’après lui, elle est la seule vraiment réelle : autonomie des corporations indigènes locales et régionales, autonomie en matière de réglementation sociale et économique, suffrage universel dans les élections municipales, large représentation de corporations, des communes, des notables et chefs indigènes, constituant une assemblée auprès du gouvernement français : En 1920, écrit Abbas, les hommes de ma génération avaient vingt ans, personnellement je me mis à penser que l’Algérie ressemblait à la France d’ancien régime à la veille de 1789. Il n’y a rien dans le Livre saint qui puisse empêcher un Algérien musulman d’être nationalement un Français … au cœur loyal conscient de sa solidarité nationale. Parmi l’élite musulmane d’Algérie, Ferhat Abbas n'est pas le seul soutien de l’Action française : on compte parmi eux Hachemi Cherief, qui sera plus tard le conseiller juridique de Mohammed V et l’avocat de Ben Bella, ainsi que des Kabyles, gênés par la prépondérance arabe et attirés par la vision décentralisatrice de Charles Maurras.
S'il fut hostile à l'expansion coloniale, Maurras fut ensuite hostile à la liquidation brutale de l'empire colonial français après la Seconde Guerre mondiale, préjudiciable selon lui autant aux intérêts de la France qu'à ceux des peuples colonisés.
Maurras et le catholicisme
Les rapports de Charles Maurras avec le catholicisme et avec l'Église catholique ont évolué avec le temps
Dans son enfance et jusqu'à son adolescence, il reçoit une éducation religieuse marquée par la foi de sa mère qu'il partage.
Lors de son adolescence, sa surdité et la révolte qu'elle génère puis la difficulté à consolider sa foi par des arguments rationnels en plus de témoignages de la tradition chrétienne contribuent à la lui faire perdre.
Lors de ses premières années à Paris, désireux de préciser sa position sur le plan religieux, il noue un dialogue avec des théologiens, des philosophes, des prêtres, des séminaristes qui cherchent à le convertir mais n'y parviennent pas.
Dans la dernière décennie du XIXe siècle, la déception qui en découle conjugué à une hostilité croissante à l'esprit et l'influence hébraïques conduisent siècle à publier des textes empreints d'hostilité au christianisme au sein duquel il prétend distinguer ce qui relève de l'esprit juif et ce qui relève de l'esprit gréco-latin. Il ne croit pas aux dogmes de l'Église, ni aux Évangiles, écrits, selon son expression, par quatre obscurs juifs. Cependant, il persiste à admirer et aimer l'Église catholique pour être parvenue à concilier bien des dangereux apprentissages de la Bible dont il soupçonnait qu'ils avaient conduit à l'émergence des erreurs révolutionnaires en France et en Europe. L'interprétation de Maurras à propos de la Bible fut alors critiquée fermement par bien des membres du clergé. Dans Le chemin de Paradis, il guerroie contre la version la plus révolutionnaire du christianisme. Maurras s'avouant alors impuissant à croire affirmait néanmoins respecter la croyance religieuse : Je n'ai pas été dédaigneux de la foi ! On ne dédaigne pas ce qu'on a tant cherché. On ne traite pas sans respect la faculté de croire quand on l'estime aussi naturelle à l'homme et plus nécessaire que la raison.
Naissance de l'Action française
Dans les années 1900, sans retrouver la foi, Maurras se rapproche du catholicisme et renforce son soutien à l'Église catholique.
Il subit tout d'abord sous l'influence de Léon de Montesquiou, de Louis Dimier, de prêtres comme le bénédictin Dom Besse et de l'abbé de Pascal, tous désireux de le rapprocher du catholicisme voire de faire renaître en lui la foi.
Il s'appuie sur Auguste Comte qui lui permet d'étudier la réalité sociale, de penser la politique en l'absence de foi, tout en admirant le catholicisme. Il n'y a alors plus sous sa plume d'attaques indirectes contre le christianisme, d'autant que sa mère très croyante lit tout ce qu'il écrit ; il perçoit dans la morphologie historique du catholicisme un principe de paix et de civilisation. Maurras voit dans l'Église le grand principe d'ordre qui arrache l'homme à l'individualisme, qui discipline les intelligences et les sensibilités. Maurras, amenant des Français de toutes origines à raisonner ainsi, en a conduit plusieurs à considérer le catholicisme comme le bien pour la France, voire à retrouver la foi.
Il s'appuie sur le lien historique entre le catholicisme et la tradition et l'identité françaises ; n'ayant jamais cessé de soutenir l'influence et le prestige de l'Église catholique comme composante politique, parce qu'elle était intimement liée à l'Histoire de France et que sa structure hiérarchique et son élite cléricale reflétaient l'image qu'il se faisait de la société idéale. Il considérait que l'Église devait être le mortier chargé d'unir la France, et la chaîne chargée de lier tous les Français. L'Action française se veut ouverte à tous : croyants, positivistes, sceptiques ; mais elle affirmait clairement que tout Français patriote se devait de défendre le catholicisme comme religion historique du peuple français.
Il s'engage fougueusement et sincèrement aux côtés de l'Église chaque fois que celle-ci se sent persécutée : affaire des Fiches, interdiction aux religieux d'enseigner, Inventaires, interventions de l'armée dans les monastères, exil de milliers de moines et de religieux, prescription aux instituteurs de dénigrer le christianisme renvoyé avec la monarchie dans les ténèbres de l'histoire de France.
Il s'en prend au laïcisme n'était pas une pure neutralité mais procédait d'une métaphysique d'État intolérante, véritable théologie d'autant plus ardente, fanatique, féroce, qu'elle évite de prononcer le nom de Dieu.
Il laisse voir dans ses écrits que son silence sur la foi et le surnaturel est suspensif et qu'il respecte la foi en autrui : La libre pensée ne consiste qu'à délier l'individu, elle dit : de ses chaînes ; nous disons : des ses points d'appui, de ses aides et des ses contreforts.
Ces prises de position firent que Maurras fut suivi par bien des monarchistes : à la suite des inventaires, deux officiers chassés de l'armée, Bernard de Vesins et Robert de Boisfleury rejoignent l'Action française comme le jeune Bernanos qui assimile les Camelots du roi à une nouvelle chevalerie chrétienne. Beaucoup d'ecclésiastiques sont déduits par le mouvement dont des assomptionnistes. En dépit de différences essentielles, il y a une coïncidence entre la métaphysique de l'Ordre chez Maurras et celle de saint Thomas. Ce soutien de milieux catholiques joua un rôle important dans le rayonnement de l'Action française et attira vers Maurras des théologiens comme Jacques Maritain. Dès sa naissance, l'Action française est apparue comme l'alliée du catholicisme antimoderne et du renouveau thomiste et comme un recours face à l'anticléricalisme croissant des républicains. L'Action française est nourrie par le catholicisme social d'Albert de Mun et de René La Tour du Pin et Charles Maurras loua le Syllabus, catalogue des erreurs modernes établi en1864 par le pape Pie IX.
Rapport avec le Sillon
En 1904, Maurras regarda avec sympathie la création par trois anciens du collège Stanislas à Paris, dont Marc Sangnier, du mouvement du Sillon afin de former des groupes pour faire rayonner les forces morales et sociales du catholicisme. Un rapprochement entre le Sillon et l'Action française eut alors lieu : pour Firmin Braconnier, les deux organisations ont le même but : le perfectionnement moral, intellectuel et social de la personnalité humaine rejetées ensemble par la gauche. Mais en dépit d'échanges de haut niveau et au début fort aimables, les deux hommes ne s'entendirent pas, Marc Sangnier voulant opposer le positivisme et le christianisme social, ce que Maurras percevait comme un faux dilemme car :
retrouver les lois naturelles par l'observation des faits et par l'expérience historique ne saurait contredire les justifications métaphysiques qui en constituent pour les chrétiens le vrai fondement ; car le positivisme, pour l'Action française, n'était nullement une doctrine d'explication mais seulement une méthode de constatation ; c'est en constatant que la monarchie héréditaire était le régime le plus conforme aux conditions naturelles, historiques, géographiques, psychologiques de la France que Maurras était devenu monarchiste : Les lois naturelles existent, écrivait-il ; un croyant doit donc considérer l'oubli de ces lois comme une négligence impie. Il les respecte d'autant plus qu'il les nomme l'ouvrage d'une Providence et d'une bonté éternelles.
le christianisme social se retrouve davantage dans l'Action française que dans le Sillon : s'il y a de nombreux chrétiens sociaux dans les rangs de l'Action française, c'est précisément car les chrétiens sociaux ont toujours préconisé l'organisation d'institutions permanentes, capables de secourir la faiblesse des hommes ; or, pour Maurras, Marc Sangnier croyait qu'il fallait d'abord donner à l'individu une âme de saint avant de vouloir modifier les institutions. Dans cette optique Marc Sangnier est le continuateur du préjugé individualiste qui avait engendré la question sociale et contre lequel les catholiques sociaux, de Villeneuve-Bargemont à Albert de Mun et au marquis de La Tour du Pin avaient toujours réagi.
Le fondateur du Sillon s'expliqua sur sa conception de la démocratie, régime qui doit « porter au maximum la conscience et la responsabilité de chacun. Il se défendait d'avoir voulu se fonder sur une unanimité de saints, une minorité lui suffisait : Les forces sociales sont en général orientées vers des intérêts particuliers, dès lors, nécessairement contradictoires et tendant à se neutraliser … Il suffit donc que quelques forces affranchies du déterminisme brutal de l'intérêt particulier soient orientées vers l'intérêt général pour que la résultante de ces forces, bien que numériquement inférieure à la somme de toutes les autres forces, soit pourtant supérieure à leur résultat mécanique. Et quel sera le centre d'attraction ? Le Christ est pour nous cette force, la seule que nous sachions victorieusement capable d'identifier l'intérêt général et l'intérêt particulier. Et d'expliquer : plus il y aura de citoyens conscients et responsables, mieux sera réalisé l'idéal démocratique. Cet optimisme suscita les objections renouvelées de Maurras, pour qui :
Rêver, en oubliant le péché originel, d'un État dont le fondement serait la vertu est irréaliste. Si la vertu est nécessaire et si la chrétienté a suscité de grands élans d'héroïsme et de sainteté, ce fut dans le respect de la vénérable sagesse de l'Église, laquelle, sachant que la seule prédication du bien ne saurait suffire à transformer une société, a toujours voulu multiplier, pour encadrer l'individu, les habitudes, les institutions, les communautés qui le portaient à surmonter ses penchants égoïstes ; pour Maurras, s'il faut des élites morales, il faut aussi des chefs capables, eux, par la place qu'ils occupent, de savoir exactement en quoi consiste l'intérêt général car sinon les efforts de l'élite de saints risquent d'être vains.
Être sublime à jet continu, héroïque à perpétuité, tendre et bander son cœur sans repos et dans la multitude des ouvrages inférieurs qui, tout en exigeant de la conscience et du désintéressement veulent surtout la clairvoyance, l'habileté, la compétence, la grande habitude technique, s'interdire tous les mobiles naturels et s'imposer d'être toujours surnaturel, nous savons que cela n'est pas au pouvoir des meilleurs. Maurras voit dans la démocratie de Sangnier une autre forme de celle de Rousseau, qui pensaient que le perfectionnement moral par l'accroissement de la liberté individuelle rendrait les hommes de plus en plus aptes au seul régime démocratique : Si la république réclame beaucoup de vertu de la part des républicains, cela tient à ce qu'elle est un gouvernement faible et grossier … et que sa pauvreté naturelle ne saurait être compensée que par la bonté des individus.
Ainsi, si Charles Maurras et Marc Sangnier cherchèrent à surmonter leurs différends, la tentative échoua. Les partisans du Sillon verront dans la condamnation de leur mouvement par le Pape Pie X, qui l'accusait de convoyer la Révolution l'œil fixé sur une chimère, le résultat de l'influence de théologiens proches de l'Action française. À leur tour les maurrassiens prétendront que les hommes du Sillon se vengèrent en cherchant à faire condamner l'Action française. L'essentiel de ses échanges entre les deux hommes fut publié dans Le Dilemme de Marc Sangnier.
Rapport avec la papauté : la condamnation de l'Action française et sa levée
Sous Léon XIII, et en dépit du ralliement de 1893, essentiellement tactique, l'Église catholique continuait de se méfier de la République française, régime né de la Terreur, dont les soutiens travaillaient à l'extirpation de la religion de la sphère sociale et politique. La doctrine politique de Léon XIII n'excluait pas la monarchie comme forme possible de régime, conformément à la théologie de saint Thomas d'Aquin qui la recommande et sur laquelle s'appuie largement le magistère de l'Église. En 1901, Maurras fut frappé par une encyclique de ce pape suggérant qu'une monarchie pouvait sous certaines conditions correspondre aux exigences de la démocratie chrétienne au sens où ce texte l'entend : une société organisée mais tournée vers Dieu.
Sous Pie X, les relations avec la papauté se développèrent. Louis Dimier fut reçu par le Pape Pie X et ce voyage fut reçu par Maurras et ses amis comme un encouragement exaltant. Pie X s'opposa à ceux qui voulait condamner globalement Maurras à cause de certains écrits témoignant de son agnosticisme et d'une métaphysique non chrétienne.
Sous Pie XI, son agnosticisme suscita l'inquiétude d'une part de la hiérarchie catholique et en 1926, le pape Pie XI classa certains écrits de Maurras dans la catégorie des Livres Interdits et condamna la lecture du journal L'Action française. Cette condamnation du pape fut un grand choc pour bon nombre de ses partisans, qui comprenaient un nombre considérable de membres du clergé français, et causa un grand préjudice à l'Action française. Elle fut levée cependant par Pie XII en 1939, un an après que Maurras fut élu à l'Académie française.
Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer la condamnation de l'Action française par Pie XI puis sa réhabiliation par Pie XII. La pensée de Maurras ayant peu évolué pendant le quart de siècle pendant lequel l'Action française ne fit l'objet d'aucun blâme, des raisons liées au contexte politique et géopolitique ont été mises en avant. En 1921, la République a rétabli les relations diplomatiques avec le Saint-Siège et Pie XI préconise une politique d’apaisement systématique avec l’Allemagne : il approuve les accords de Locarno et l’entrée de l’Allemagne à la SDN, contrairement à Maurras qui les dénonce avec virulence car pouvant contribuer au renforcement et donc aux possibilités de revanche de l'Allemagne. L'Action française entre en opposition avec les objectifs de la diplomatie papale. En plus du contexte, un élément déclencheur provoque l'inquiétude de certains ecclésiastiques face à une influence jugée grandissante : dans une enquête de Louvain, les jeunes catholiques disent être fidèles à la Bible et à Maurras comme s’il était possible de les mettre sur le même plan ; mais une part du haut clergé français, des associations, des ordres religieux quelques-uns des principaux théologiens soutiennent Maurras en dépit des réserves qu’ils témoignent vis-à-vos de certains aspects de sa pensée. Pie XI entend néanmoins balancer l’influence prépondérante détenue au sein de l’Église par l’épiscopat nomme du temps de Pie X et de la réaction antimoderniste et son désir d’avoir les mains libres pour développer des mouvements d’action catholique du type de la JOC et de la JAC est fort.
Le Pape chargea alors le cardinal Andrieu de mettre en garde les fidèles contre l'Action française : celui-ci, qui avait chaleureusement remercié Maurras en 1915 pour l'envoi de L'Étang de Berre, qualifié de monument de piété tendre, lui disant qu'il défendait l'Église avec autant de courage que de talent, prétendait désormais percevoir chez lui l'athéisme, l'agnosticisme, l'antichristianisme, un antimoralisme individuel et social ; ces accusations publiées dans La Semaine religieuse d'août 1926 furent perçue comme excessives et Maurras et les siens furent rassurés par les soutiens dont ils bénéficièrent ; cependant, loin d'adopter une attitude soumise et humble, Maurras fit bruyamment savoir que si la soumission à l’autorité romaine doit être totale sur le plan spirituel, si celle-ci intervient dans le domaine politique de manière critiquable, alors la résistance s’impose sur le terrain. Réagissant à une allocution papale mettant indirectement en garde contre l'influence de l'Action française en décembre 1926, conseillés par plusieurs théologiens, les dirigeants catholiques de l’Action française publièrent une déclaration maladroite intitulée Non possumus » qui fit d’eux des rebelles alors qu'ils s'y identifiaient aux premiers martyrs chrétiens. La condamnation fut publiée par décret de la Congrégation du Saint-Office tombe le 29 décembre 1926 : elle touchait Le Chemin de Paradis, Anthinéa, Les Amants de Venise, Trois idées politiques, L'Avenir de l'Intelligence, ouvrages présentant un caractère naturaliste au sens métaphysique et dont certains aspects peuvent être qualifiés de philo-païens, ainsi que le quotidien.
Appliquée par les évêques et les prêtres, la condamnation fut ressentie comme une blessure, une injustice et un drame par de nombreux croyants y compris au plus haut niveau de l'Église : pour le cardinal Billot, la condamnation fut une heure de la puissance des ténèbres Le 19 décembre 1927, il remit au pape sa pourpre cardinalice et se retire dans un monastère. Paradoxalement, elle ramena à l'Action française plusieurs catholiques comme Georges Bernanos qui dans Comœdia et La Vie catholique en prit la défense Maurras. La condamnation ne condamnait ni le royalisme ni le nationalisme. Bien que de nombreux catholiques firent le choix de rester à l'Action française, la condamnation affaiblit le mouvement.
Charles Maurras contesta avoir fait de l'adhésion à tous ses écrits une condition adhésion à l’Action française : jamais son positivisme et son naturalisme, d'ailleurs partiels, n’ont constitué des articles de foi pour les militants. Il ne fondait pas sa doctrine politique sur des conceptions philosophiques morales ou religieuses. On pouvait critiquer tel ou tel point de sa pensée mais non la rejeter en bloc. En 1919, dans la nouvelle version d’Anthinéa, il n’avait pas hésité à supprimer un chapitre entier pour ne pas heurter les catholiques. Il rappela que l'Action française avait contribué à ramener à la foi de nombreux français : dès 1913, Bernard de Vesins avait établi une liste de militants et abonnés entrés dans les ordres, tel André Sortais qui devint abbé général des Cisterciens réformés, afin d'illustrer le fait que le mouvement maurrassien fut une pépinière pour l’église.
Sous Pie XII, la condamnation sera levée ; il fut sans doute pris en compte que si Maurras avait été véritablement pleinement païen, sa rébellion eût été plus totale et sa vindicte antichrétienne eût trouvé de quoi se nourrir. Les tractations avaient commencé sous Pie XI qui ne rejeta pas Maurras et qui lui écrira même lorsqu'il fut emprisonné.
Liens avec le carmel de Lisieux
La pensée de Maurras quant à la religion et sa philosophie ne fut jamais une chose figée et homogène ; ses doutes n'ont pas éteint en lui l'espérance de la foi ; c'est ce que qu'il explique dans une lettre non envoyée au père Doncœur, il expliquera avoir volontairement tu les doutes et tourments liés à la question de la foi et pourquoi il a gardé dans le tête-à-tête solitaire de sa conscience et de sa pensée ses doutes, rechutes et angoisses philosophiques et religieuses. Maurras eût eu tout intérêt à se convertir et donc à feindre la conversion ; les gains pour lui ou son mouvement eussent été énormes mais il ne le fit pas et en cela il est l'homme intègre décrit par ses opposants catholiques comme Marc Sangnier. Comme Maritain le lui prédit, la condamnation fit renaître en lui le désir de retrouver la foi.
De fait, nombreux furent ceux qui prièrent pour sa conversion. En 1926, à l’heure de la condamnation, une jeune fille dont Maurras avait connu la mère entra au Carmel de Lisieux en offrant sa vie pour la conversion de Maurras. En 1936, lorsque cette carmélite mourut, en 1936, mère Agnès, sœur aînée de sainte Thérèse de Lisieux et supérieure du Carmel, écrivit une lettre à Maurras pour lui révéler le sens de cette mort et pour lui promettre d’intervenir auprès de Pie XI au sujet de la condamnation ; il s'ensuivra une correspondance suivie. De fait, Pie XI écrivit à Maurras pour lui apporter son soutien quand il fut emprisonné en 1937. Et Maurras lui répondit qu'à sa libération il irait se recueillir à Lisieux sur le tombeau de Celle dont les Sœurs et les Filles m’ont entrouvert un monde de beauté et de charité toujours en fleur, comme le mystique rosier de la petite et grande sainte Thérèse de l’Enfant Jésus Après la seconde guerre mondiale, les liens avec le Carmel de Lisieux se poursuivirent : il correspondit avec sœur Marie-Madelaine de Saint-Jospeh. En 1948, le carmel lui envoie une image de sainte Thérèse avec une prière de Mère Agnès : Ô Thérèse, Illuminez votre pèlerin et sanctifiez le dans la vérité. Le carmel lui envoie également les dix volumes de L’Année liturgique de Dom Guéranger.
Mort
Dans ses dernières années, Maurras confia à des prêtres comme l’abbé Van Den Hout, fondateur de La Revue catholique des idées et des faits en Belgique, la souffrance qu’il ressent dans la perte de la foi. Son agnosticisme est un agnosticisme insatisfait. Ceci transparaît dans ses dernières œuvres poétiques où il exprime l'idée que rétiens : la miséricorde de Dieu dépasse sa justice, autrement dit le symbole de la justice divine n’est pas la balance mais le don infini : Chère Âme, croyez-vous aux célestes balances ? Cet instrument d’airain n’est rêvé que d’en bas ; Du très Haut, du très Bon, du Très Beau ne s’élance Que l’or du bien parfait qu’il ne mesure pas.
Tous les témoignages attestent que les derniers mois de Maurras ont été marqués par le désir de croire et le 13 novembre 1952, il fait demander l’extrême onction. La question du retour de Maurras a la foi a longtemps constitué le fil directeur de la critique maurrassienne. Ivan Barko, en 1961, trouva plus intéressant d’imaginer un Maurras agnostique que jusqu’à la fin et ne conservant de l'extrême onction que la ritualité. Selon Stéphane Giocanti, une telle interprétation ne tient pas compte de l’extrême probité de l’homme à l’égard d’une foi qu’il mit toute sa vie à vouloir retrouver intacte, ayant la défiance de la moindre simulation.
Certains démocrates-chrétiens ont cherché à accréditer la thèse de la conversion inventée rétrospectivement, mais le témoignage et les commentaires de Gustave Thibon, penseur chrétien rigoureux et épris d’absolu atteste la réalité de l'expérience mystique finale de Maurras. Thibon n'a pu faire entrer la moindre complaisance dans le mouvement spirituel qu’il a discerné chez Maurras : Je n'en finirais pas d'évoquer ce que fut pour moi le contact avec Maurras : je l'ai vu deux fois à Tours et je l'entends encore me parler de Dieu et de la vie éternelle avec cette plénitude irréfutable qui jaillit de l'expérience intérieure. J'ai rencontré beaucoup de théologiens dans ma vie : aucun d'eux ne m'a donné, en fait de nourriture spirituelle, le quart de ce que j'ai reçu de cet "athée" ! Toute la différence entre le géographe et l'explorateur Luiqui préfère l’athée qui cherche Dieu au croyant installé dans les apparences de la foi.
Maurras parvint à suivre la cérémonie de l'extrême-onction avec attention et il récite le confiteor. Vers 23h30, le 15 novembre, il demanda son chapelet et selon ses proches, ses dernières paroles furent un alexandrin : Pour la première fois, j’entends quelqu’un venir. Il meurt le matin du 16 novembre 1952.
L’abbé Giraud confiera au poète ardéchois Charles Forot sa réaction devant la mort de Maurras : Je revois, très souvent, mon inoubliable entretien avec le grand protégé de la Petite Thérèse. Sa fin chrétienne si édifiante ne m’a point surpris… Je l’attendais avec la plus totale confiance. … Lisieux ne l’oublie pas non plus, et son souvenir est souvent évoqué dans mon courrier par sœur Madeleine de Saint-Joseph, qui fut pour lui, l’ange gardien visible.
L’influence de Charles Maurras En France sur les intellectuels français
En tant que penseur, Charles Maurras exerça une très grande influence sur la vie intellectuelle de la France : il fut à l'origine de nombreuses aventures intellectuelles et littéraires. De nombreux auteurs ou hommes politiques ont subi l'influence de Maurras sans nécessairement se réclamer de lui.
En 1908, année de la fondation du quotidien L'Action française, les jeunes intellectuels maurrassiens se regroupaient autour de la Revue critique des idées et des livres, qui fut jusqu'en 1914 la grande rivale de la NRF d'André Gide. La revue défendait l'idée d'un classicisme moderne , s'ouvrait aux théories nouvelles Henri Bergson, Georges Sorel… et formait une nouvelle génération de critiques et d'historiens. Pendant l'entre-deux-guerres, l'expérience de la Revue Critique se poursuivit dans un grand nombre de revues : Revue universelle, Latinité, Réaction pour l'ordre, La Revue du siècle…
Le démocrate-chrétien Jacques Maritain était aussi proche de Maurras avant la condamnation du pape, et critiqua la démocratie dans l'un de ses premiers écrits, Une opinion sur Charles Maurras ou Le Devoir des Catholiques.
Chez les psychanalystes, Élisabeth Roudinesco a montré que Maurras a constitué une étape dans la genèse de la pensée de Jacques Lacan : ce dernier rencontra personnellement Maurras et participa à des réunions d’action française ; Lacan trouva chez son aîné un certain héritage positiviste, l’idée que la société se composait plus de familles que d’individus, l’insistance sur la longue durée au détriment de l’événementiel, l’inanité des convulsions révolutionnaires et l’importance primordiale du langage : Partant de Maurras, il arrivait ainsi à Freud, pour rappeler … combien la tradition, malgré les apparences, pouvait favoriser le progrès. Il faut également citer Édouard Pichon, le maître de Françoise Dolto, qui dans les années 1930 fera de la pensée maurrassienne l’axe de son combat pour la constitution d’un freudisme français.
Chez les libéraux, Daniel Halévy ou Pierre Lasserre ont subi le pouvoir d'attraction politique et philosophique du Maurrassisme alors qu'a priori leur héritage politique ne les prédisposait pas à être séduit par un penseur contre-révolutionnaire.
Dans les milieux littéraires, le climat patriotique de la première guerre mondiale, le prestige de Maurras et la qualité de son quotidien font que Henri Ghéon, Alfred Drouin, Marcel Proust, André Gide, Augustin Cochin, Auguste Rodin, Guillaume Apollinaire lisent tous L'Action française. Anna de Noailles prie Maurras de croire à ses sentiments de profonde admiration. Les années 1920 correspondent à l'apogée littéraire de Maurras avec une force d'attraction dont Jean Paulhan témoigne : Maurras ne nous laisse pas le droit en politique d'être médiocres ou simplement moyens. L'apogée littéraire se traduit par le portrait que publie Albert Thibaudet dan la série Trente ans de vie française à la NRF, où Les Idées de Charles Maurras précèdent La Vie de Maurice Barrès et Le bergsonisme. Cette monographie est un livre important puisqu'en formulant objections et réserves, il éclaire la partie supérieure de la pensée et de l'œuvre de Maurras, celle qui sort du poids du quotidien et échappe au discours partisan et polémique.
Après la première guerre mondiale, il reçoit en abondance des lettres pleines de respect et d'admiration d'Arnold Van Gennep, Gabriel Marcel, René Grousset, Colette, Marguerite Yourcenar, Montherlant, Charles Ferdinand Ramuz, Paul Valéry ; le jeune Malraux à écrire une notice pour la réédition de Mademoiselle Monck et exprime son envie de rencontrer Maurras.
Charles Maurras eut une forte influence parmi les étudiants et la jeunesse intellectuelle de l'entre-deux-guerres : quand Jean-Baptiste Biaggi, futur compagnon de De Gaulle accueille Maurras au nom des étudiants en droit de Paris, il a autour de lui Pierre Messmer, Edgar Faure, Edmond Michelet et parmi les Camelots du Roi, on compte François Périer et Michel Déon ; Maurras reçoit Des témoignages d'admiration de Pierre Fresnay et Elvire Popesco et est entouré par les jeunes Raoul Girardet, François Léger, François Sentein, Roland Laudenbach, Philippe Ariès ; Maurras aime s'entourer de jeunes dont il pressent le talent et il prend pour secrétaires particuliers Pierre Gaxotte et Georges Dumézil, l'un le jour l’autre la nuit.
Maurras et De Gaulle
Avant la Seconde Guerre mondiale, il semble que Charles de Gaulle, dont le père lisait L'Action française et se qualifiait de monarchiste de regret et qui discuta avec le comte de Paris de la possibilité d'une restauration de la royauté, ait été influencé par l'Action française et que cette dernière l'ait considéré avant la France libre avec sympathie.
En 1924, Charles de Gaulle dédicaça La Discorde chez l'Ennemi à Maurras en lui témoignant ses respectueux hommages.
Au printemps 1934, sous l'égide du cercle Fustel de Coulanges, une vitrine de l’Action française, Charles de Gaulle prononça une série de conférences à la Sorbonne. De Gaulle savait qu’il avait dans l’Action française un allié attentif ; le 1er juin 1934, l'Action française consacra un article élogieux à Vers l’armée de métier qui défendait le principe d’une armée professionnelle très compétente et mobile se superposant à l’armée conscrite ; Le Populaire et Léon Blum suspectèrent le danger d’un coup d’État et c’est dans L’Action française que l’ouvrage fit l’objet du seul encadré publicitaire auquel il eut droit. De Gaulle écrira à Hubert de Lagarde, chroniqueur militaire de L'Action française : Monsieur Charles Maurras apporte son puissant concours à l'Armée de métier. Au vrai, il y a longtemps qu'il le fait par le corps de ses doctrines. Voulez-vous me dire s'il a lu mon livre que j'ai eu l'honneur de lui adresser au mois de mai ? Maurras avait découvert de Gaulle en lisant un article de La Revue hebdomadaire et s'était exclamé : Quelle confirmation de nos idées les plus générales sur l'armée !
Après la guerre Maurras ignorait si De Gaulle avait écrit sous pseudonyme dans l'Action française.
En 1940, la nomination au grade de général de Charles de Gaulle provoqua la jubilation de Charles Maurras dans L'Action française des 1er et 3 juin 1940 ; Maurras y qualifia de Gaulle de pénétrant philosophe militaire et affirmait avoir voulu rester discret à son endroit pour ne pas le gêner notamment : Sa thèse nous paraissait suffisamment contraire à la bêtise démocratique pour ne pas ajouter à ces tares intrinsèques, la tare intrinsèque de notre appui. Mieux valait ne pas compromettre quelqu'un que, déjà, ses idées compromettaient toutes seules.
Paul Reynaud, qui rencontra en captivité en Allemagne la sœur du général de Gaulle, Marie-Agnès Caillau, affirme que selon elle le chef de la France libre serait resté maurrassien jusqu'aux accords de Munich, soit seulement un an avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale : Très franche, intelligente et bonne, elle nous raconte que Charles était monarchiste, qu'il défendait Maurras contre son frère Pierre jusqu'à en avoir les larmes aux yeux dans une discussion. Mais au moment de Munich, il a désapprouvé entièrement l'attitude de Maurras.
Christian Pineau dira à André Gillois que le général avait reconnu devant lui qu’il avait été inscrit à l’Action française et qu’il s’était rallié à la République pour ne pas aller contre le sentiment des Français.
De Gaulle dit à Claude Guy qu'il n'aimait pas la révolution française : À entendre les républicains, la France a commencé à retentir en 1789 ! Incroyable dérision : c'est au contraire depuis 1789 que nous n'avons cessé de décliner. Il confia également à Alain Peyrefitte son peu d'enthousiasme pour la république : Je n'aime pas la république pour la république. Mais comme les Français y sont attachés, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il lui confia également en 1962, alors qu'il annonçait une initiative pour assurer la continuité de l'État, qu'un roi pourrait être utile à la France : Ce qu'il faudrait à la France, c'est un roi.
Charles de Gaulle dira à plusieurs témoins à propos de Charles Maurras : Maurras est un homme qui est devenu fou à force d'avoir raison. De fait, selon Claude Mauriac, chef du secrétariat particulier du général de Gaulle à la Libération, ce dernier porta une très grande attention au sort du théoricien du nationalisme intégral ; il interviendra ainsi pour que Maurras ne passe pas devant la cour de justice de Lyon en septembre 1944, mais devant la Haute Cour, réputée plus indulgente. Le 13 mai 1958, Jean-Baptiste Biaggi fit remarquer à de Gaulle que d’autres et lui-même devaient leur nationalisme à Charles Maurras, ce dont le général convint, regrettant que Maurras l'ait critiqué : Aussi bien, je n’ai jamais rien dit contre lui. Que ne m’a-t-il imité ! Charles Maurras en voudra toujours à de Gaulle d'avoir rompu avec Pétain.
À l'étranger
Maurras et l'Action française ont exercé une influence sur différents penseurs se réclamant d'un nationalisme se voulant contre-révolutionnaire et chrétien dans le monde.
En Grande-Bretagne, Charles Maurras fut suivi et admiré par des écrivains et philosophes et a plusieurs correspondants britanniques, universitaires ou directeurs de revue ; en 1917, il a été sollicité par Huntley Carter du New Age et de The Egoist. Plusieurs de ses poèmes furent traduits et publiés en Grande-Bretagne où Maurras a de nombreux lecteurs parmi les High Church de l'anglicanisme et les milieux conservateurs. On compte parmi ses lecteurs T.S. Eliot ou T.E. Hulme. Eliot trouva les raisons de son antifascisme chez Maurras : son antilibéralisme est traditionaliste, au bénéfice d’une certaine idée de la monarchie et de la hiérarchie. Music within me, qui reprend en traduction les pièces principales de La Musique intérieure paraîtra en 1946, sous la houlette du comte G.W.V. Potcoki de Montalk, directeur et fondateur de la The Right Review. La condamnation de 1926 eut ainsi des effets jusqu'en Grande-Bretagne où elle détourna du catholicisme des partisans de la High Church, déçus par le juridisme romain : la conversion de T.S. Eliot à l’anglicanisme, l’éloignement du catholicisme de personnalité comme Ambrose Bebb sont liés à cet événement. Eliot inséra une citation en Français de L’Avenir de l’intelligence dans son poème Coriolan qu’il tenait pour un maître livre pour sa satyre des honneurs officiels.
Au Mexique, Jesús Guiza y Acevedo, surnommé le petit Maurras, et l'historien Carlos Pereyra.
En Espagne, il existe un mouvement proche de l'Action française Cultura Española et sa revue Acción Española.
Au Pérou, le marquis de Montealegre de Aulestia a été influencé par Maurras. Ce grand penseur réactionnaire péruvien, admiratif de sa doctrine monarchique, le rencontre en 1913.
En Argentine, le militaire argentin Juan Carlos Onganía, tout comme Alejandro Agustín Lanusse, avaient participé aux Cursillos de la Cristiandad, ainsi que les Dominicains Antonio Imbert Barrera et Elias Wessin y Wessin, opposants militaires à la restauration de la Constitution de 1963.
Au Portugal, António de Oliveira Salazar qui gouverna le pays de 1932 à 1968 admirait Maurras même s'il n'était pas monarchiste et il fit par de ses condoléances à sa mort.
Vie personnelle Caractère
Pour Stéphane Giocanti, l’image d’un Maurras froid et austère est un contre-sens ; il a au contraire un caractère sanguin et contrasté : à la fois tendre et violent, contemplatif et actif, patient et impatient, tantôt inflexible et obstiné, tantôt bon et généreux ; sachant à l'occasion reconnaître ses torts, pardonner et s’effacer devant les autres, il est tour à tour exaspérant et charmant : Il peut s’entêter, se raidir, entrer dans des colères, devenir une teigne, quitte à le regretter ensuite comme Bossuet Il a la frénésie de la discussion et de la dialectique car il a la passion de la vérité, de l’ordre, de l’unité. Il a l’intransigeance et la fierté d’un homme de la fin du dix-neuvième siècle qui ne revient pas sur sa parole et réserve ses doutes pour lui-même. Il s’engage radicalement et est prêt à mourir pour la Cause d’autant qu’il engage les autres dans son périple. Généreux vis-à-vis de ses amis d’une fidélité en amitié, il peut être un amant passionné, un charmeur blaguant, diseur de vers et buveur de bon vin. Très sensible aux femmes, il s’affirme bon causeur caustique, pétillant et aimant la complicité des dames élégantes.
Il suscita des attachement très forts et reçut d’innombrables marques de fidélité et d’admiration : ainsi, avant de gagner l’horizon polaire avec l’explorateur Roald Amundsen, deux pilotes survolant la maison de leur maître lâchèrent sur le jardin une pluie de pétales de roses, message de fidélité placé sous le signe de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Pierre Gaxotte écrivit à son propos : Maurras était en pleine force, insensible à la fatigue, aux incommodités, aux menaces, aux dangers. On était pris d'abord par son regard, où rayonnaient l'intelligence, l'autorité, l'énergie le courage, la bienveillance, une attention extrême et parfois la gaieté. Mais on était conquis aussi par sa jeunesse, son ardeur, son alacrité
Charles Maurras qui aimait la simplicité et avait le sens de la pauvreté, gagnait volontairement moins que le plus petit ouvrier qualifié de son journal ; après 1940, il versa ses droits d'auteur à une œuvre de prisonniers.
Famille
Le 22 novembre 1925, lors d’une réunion organisée par l'Action française en réaction à la victoire du Cartel des Gauches à Luna Park où trente mille personne se rendent, Charles Maurras a la préscience de la mort de son frère. Il apprend le lendemain la mort au Tonkin du médecin et chirurgien Joseph Maurras, qui donnait une chronique médicale à L'Action française très suivie par la profession. Il télégraphie à sa belle sœur Henriette qu’il adopte son neveu Jaques et ses nièces Hélène et Jeanne ; il logera son neveu avec sa mère avenue Mozart et leur trouvera un précepteur, l’abbé Rupert ; Jacques sera bachelier au lycée Janson-de-Sailly, diplômé de l’École libre des sciences politiques, licencié en droit. Maurras était également le parrain de François Daudet, un des fils de Léon Daudet.
Relations avec les femmes
Charles Maurras eut une vie sentimentale riche et intense. Il eut de nombreuses relations féminines qui se terminèrent par des ruptures en douceur : son air parfois triste conjugué à l’ardeur de son regard pouvaient plaire.
Dans les années 1890, Maurras a dû affronter la séparation de la belle Valentine de Saint-Pons, puis il a été l'amant de la bouillonnante Mme Paul Souday qu'il continua de fréquenter amicalement après leur séparation.
Il tomba ensuite amoureux de la comtesse de la Salle-Beaufort, la nièce de Gustave Janicot, qui travaillait avec lui à La Gazette de France et qu'il connaissait depuis 1892 : la jeune femme, mariée et mère de plusieurs enfants, cultivée et touchée par cet amour ardent, ne voulut pas tout abandonner pour lui, ce qui lui donnera des envies de suicide. Maurras ne rompait jamais avec les femmes : il correspondit avec la comtesse jusqu'en 1930.
En 1910 et jusqu'à son mariage, Pierre Chardon alias Mme Jules Stefani, née Rachel Legras fut l'amante de Maurras qui lui confia la publication de son Dictionnaire politique et critique, encyclopédie touchant tous les domaines auxquels Maurras toucha : politique littérature, histoire, sociologie philosophie.
En 1925, l’objet de ses sentiments amoureux fut Alice Gannat, intendant au collège des jeunes filles de la Légion d’honneur mais celle-ci ne consentit qu'à une relation amicale.
En 1928, il se lia avec la princesse Yvonne Rospigliosi, baronne de Villenfagne de Sorinnes 1887-1946 marié au prince Ferdandino Carlo Rospiglios ; celle-ci habita chez Maurras rue de Verneuil et ils connurent des amours tempétueuses.
Sa dernière amie fut Mme de Dreux-Brézé, qui s'installa dans un logement tout près de sa prison et avec laquelle il eut une correspondance suivie après la Seconde Guerre mondiale. Il eut également une liaison avec Mme Espinasse-Mongenet.
De façon générale, Charles Maurras aimait les femmes et cela se traduisit par des prises de position politiques : en 1910, il salua l'entrée des femmes dans le cycle des études supérieures : Représentez-vous ce que les 2 500 étudiantes de Paris nous annoncent d'artistes, de lettrées, d'avocats, de doctoresses et tout ce qu'elles vont faire d'imitatrices, étudiantes de demain, parmi les fillettes qui sautent à la corde ou préparent leur première communion363 ? Favorable au droit de vote des femmes, il rappelait que les femmes avaient voté sous Louis XVI dans les paroisses. Touchée par les pages que lui consacra Maurras, la poétesse saphique Renée Vivien compara Maurras à un Archange .
Œuvres
1889 : Théodore Aubanel
1891 : Jean Moréas
1894 : Le Chemin du Paradis, mythes et fabliaux [lire en ligne sur archive.org le texte de l'édition remaniée
1896-1899 : Le Voyage d'Athènes (Lettres des Jeux olympiques, GF-Flammarion, prés. Axel Tisserand, 2004
1898 : L'Idée de la décentralisation
1899 : Dictateur et Roi
1899 : Trois idées politiques – Chateaubriand, Michelet, Sainte-Beuve
1900 : Enquête sur la monarchie
1901 : Anthinéa – d'Athènes à Florence
1902 : Les Amants de Venise, George Sand et Musset (éd. Flammarion, 1992)
1905 : L'Avenir de l'intelligence
1906 : Le Dilemme de Marc Sangnier
1910 : Kiel et Tanger
1910 : Les idées royalistes
1910 : * (et Henri Dutrait-Crozon), Si le coup de force est possible, Paris, Nouvelle librairie nationale, 1910. Repris dans Charles Maurras, Enquête sur la monarchie, Paris, Nouvelle librairie nationale, 1924; 1928 et 1937, Paris, Fayard; édition Kontre Kulture 2012.
1912 : La Politique religieuse (repris dans La démocratie religieuse, Nouvelles Éditions Latines, prés. Jean Madiran, 2008, contient aussi Le Dilemme de Marc Sangnier et L'Action française et la religion catholique
1914 : L'Action française et la religion catholique
1915 : L'Étang de Berre [lire en ligne sur archive.org]
1916 : Quand les Français ne s'aimaient pas
1916-1918 : Les Conditions de la victoire, 4 volumes [lire en ligne sur archive.org, vol. 1], vol. 2, vol. 3
1917 : Le Pape, la guerre et la paix
1920 : Le Conseil de Dante
1921 : Tombeaux
1922 : Inscriptions
1923 : Les Nuits d'épreuve tiré à 1 200 exemplaires, particulièrement rare
1923 : Poètes
1924 : L'Allée des philosophes
1925 : La Musique intérieure
1925 : Barbarie et poésie
1926 : La Bonne mort, conte, ill. par Paul Devaux tiré à 715 exemplaires
1926 : La Sagesse de Mistral (tiré à 530 exemplaires)
1927 : Lorsque Hugo eut les cent ans
1927 : La République de Martigues(tiré à 1 000 exemplaires)
1928 : Le Prince des nuées
1928 : Un débat sur le romantisme
1928 : Vers un art intellectuel
1928 : L'Anglais qui a connu la France
1929 : Corps glorieux ou Vertu de la perfection
1929 : Promenade italienne
1929 : Napoléon pour ou contre la France
1930 : De Démos à César
1930 : Corse et Provence
1930 : Quatre nuits de Provence
1931 : Triptyque de Paul Bourget
1931 : Le Quadrilatère
1931 : Au signe de Flore
1932 : Heures immortelles
1932-1933 : Dictionnaire politique et critique, 5 volumes
1935 : Prologue d'un essai sur la critique
1937 : Quatre poèmes d'Eurydice
1937 : L'Amitié de Platon
1937 : Jacques Bainville et Paul Bourget
1937 : Les vergers sur la mer
1937 : Jeanne d'Arc, Louis XIV, Napoléon
1937 : Devant l'Allemagne éternelle
1937 : Mes idées politiques
1937 : La Dentelle du Rempart
1940 : Pages africaines
1941 : Sans la muraille des cyprès
1941 : Mistral
1941 : La Seule France
1942 : De la colère à la justice
1943 : Pour un réveil français
1943 : Vers l'Espagne de Franco
1944 : Poésie et vérité
1944 : Paysages mistraliens
1944 : Le Pain et le Vin
1945 : Au-devant de la nuit
1945 : L'Allemagne et nous
1947 : Les Deux Justices ou Notre J'accuse
1948 : L'ordre et le désordre (L'Herne, Carnets, 2007, précédé de L'Avenir du nationalisme français
1948 : Réflexions sur la Révolution de 1789
1948 : Maurice Barrès
1948 : Une promotion de Judas
1948 : Réponse à André Gide
1949 : Au Grand Juge de France
1949 : Le Cintre de Riom
1950 : Mon jardin qui s'est souvenu
1951 : Tragi-comédie de ma surdité
1951 : Vérité, justice, patrie (avec Maurice Pujo)
1952 : À mes vieux oliviers
1952 : La Balance intérieure
1952 : Le Beau Jeu des reviviscences
1952 : Le Bienheureux Pie X, sauveur de la France
1953 : Pascal puni
1958 : Lettres de prison (1944-1952)
1966 : Lettres passe-murailles, correspondance échangée avec Xavier Vallat
2007 : Dieu et le Roi – Correspondance entre Charles Maurras et l'abbé Penon (1883-1928), présentée par Axel Tisserand, Privat, coll. « Histoire », Paris, novembre 2007, 750 p. (ISBN 978-2-7089-6881-3)
2008 : L’ordre et le désordre, préface de François L'Yvonnet, coll. Carnets, L’Herne, Paris.
2010 : Soliloque du prisonnier, préface de François L'Yvonnet, coll. Carnets, L’Herne, Paris.
2011 : La bonne mort, préface de Boris Cyrulnik et présentation de Nicole Maurras, coll. Carnets, L’Herne, Paris.
Charles Maurras, majoral du Félibrige, a publié une grande partie de son œuvre en provençal utilisant la graphie mistralienne.
Liens
http://youtu.be/_ne4PGTtlCg Conférence de Hilaire de Crémiers
http://youtu.be/FbUak_IiUP4 Entretein avec Charles maurras
http://youtu.be/zc-gJ-R1HDA 2000 ans d'histoire Maurras 1
http://youtu.be/1dzOy0tHd7c 2000 ans d'Histoire Maurras 2
http://youtu.be/kKPgD9pSvL8 Histoire de l'action française
http://youtu.be/9uvxXgm2TWs Duel de Maurras et Paul de Cassagnac
http://youtu.be/kJgAaj2IyY4 L'action française et la culture
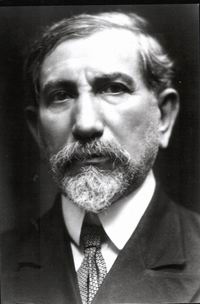 [img width=600]http://www.valeursactuelles.com/sites/default/files/styles/va-article/public/charles_maurras_redim.png?itok=dFwP8PqI[/img] 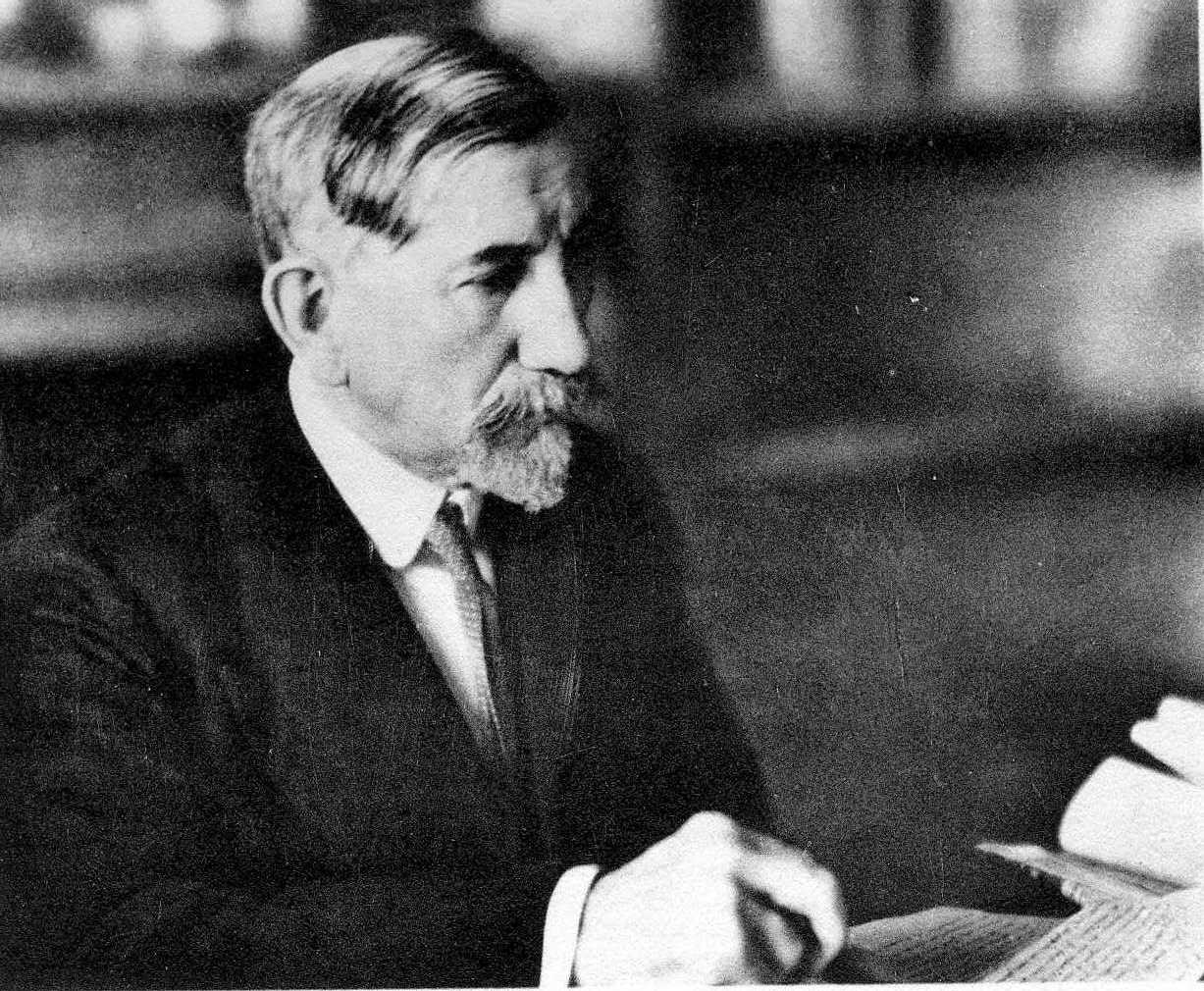 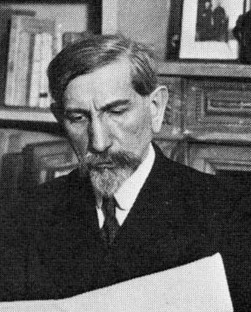 [img width=600]http://www.cairn.info/loadimg.php?FILE=GEN/GEN_047/GEN_047_0062/fullGEN_idPAS_D_ISBN_pu2002-02s_sa05_art05_img005.jpg[/img]  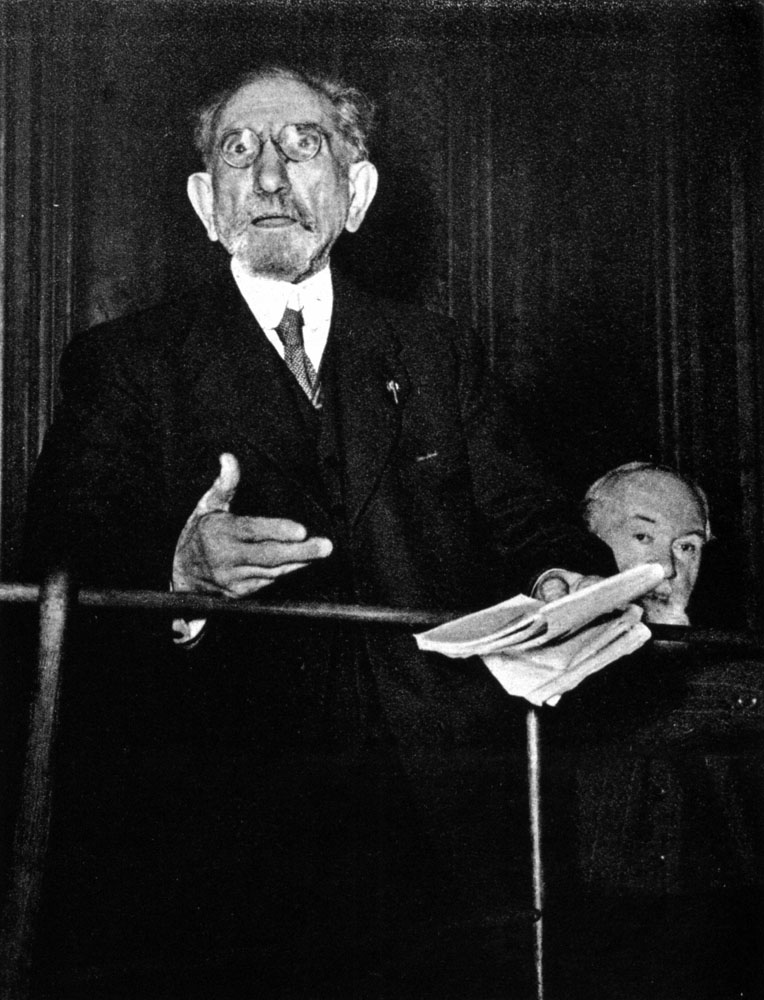   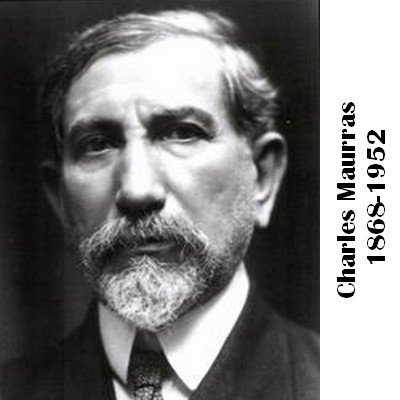 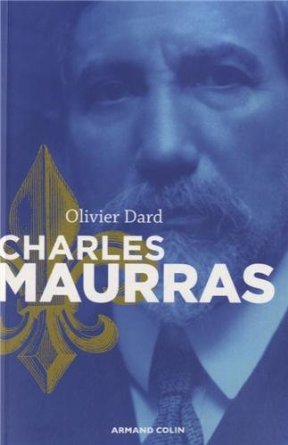
Posté le : 16/11/2014 18:00
Edité par Loriane sur 17-11-2014 11:25:50
Edité par Loriane sur 17-11-2014 11:30:59
Edité par Loriane sur 19-11-2014 18:55:22
|
|
|
|
|
Re: Défi du 15-11-2014 |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
06/08/2013 20:30
De Le Havre
Niveau : 25; EXP : 53
HP : 0 / 613
MP : 268 / 19535
|
Johnny Be Good Johnny est grand, costaud, et très en colère contre sa femme. - Regarde-toi ! Toujours en train de lire ! Est-ce que je lis moi ? Je rentre du gratin, et t’es toujours là assise sur le canapé ou à ton bureau. Parce que madame a un bureau maintenant ! Sa femme le regarde à peine. Tous les jours c’est la même sérénade, Johnny ne supporte pas qu’elle étudie pour avoir une meilleure situation. Ils se sont mariés jeunes, très jeunes, il était beau Jojo, c’était le plus baraqué de la bande, mais il est resté un peu brut. Angélique, elle, a évolué, elle ne voulait pas rester standardiste toute sa vie, elle a passé des diplômes, et, maintenant elle va suivre des cours à l’université. - Qu’est-ce qu’on en a à foutre des diplômes, tu peux m’le dire ? Est-ce que j’en ai moi ? Et j’gagne plus de maille que toi, pauvre pomme ! C’est toujours le même refrain, Johnny ne voit pas plus loin que le bout de son nez. C’est sûr qu’il gagne plus qu’elle, mais c’est surtout grâce à son job de sosie du chanteur. Tous les soirs il s’habille avec des paillettes, il prend sa fausse guitare et il va chanter « Que je t’aime » en play-back au « Pirate », la boîte de nuit à la mode. Ses parents l’ont appelé Johnny comme Hallyday, il a écouté ses chansons pendant toute son enfance, et maintenant il se prend pour lui, c’est pathétique… Heureusement que sa femme n’a pas suivi le même chemin, ses parents étaient fans d’ « Angélique Marquise des anges ». Angie prend bien soin de l’appartement, elle fait la cuisine, les courses, le ménage, tout ça en plus de son travail. Elle ne veut pas que son mari lui reproche de négliger leur foyer, mais ça ne suffit pas, il veut qu’elle arrête d’étudier. - J’arrive même pas à lire les titres de tes bouquins ! Comment qu’tu peux t’intéresser à des conneries pareilles ! Y’a même pas d’images ! Mais la jeune femme a trouvé un article intéressant : - Tiens regarde, il y a des mines d’or au Sénégal. Il paraît qu’on peut gagner plein d’argent en allant là-bas. - Des mines d’or ! Ma pauv’ fille tu délires ! - Non, je t’assure, regarde, tu peux acheter des concessions, les gens du coin travaillent pour toi et tu les payes trois fois rien, après tu empoches les bénéfices. Chercheur d’or ! Voilà un métier qui a toujours fait rêver Jojo. Il se voit déjà avec une grande écuelle, au bord d’une rivière, avec son chapeau de cowboy et ses santiags, le visage buriné par le soleil. - Ce sont des mines, rien à voir avec l’or qu’on trouve dans les cours d’eau. C’est beaucoup mieux, quand tu trouves un filon, ta fortune est faite ! - Oui mais c’est dégueulasse, tu veux qu’j’aille exploiter des pauv’z’ Africains ? - Mais non, mon Johnny, tu les payes assez pour qu’ils aient une bonne vie dans leur pays, mais par rapport à nos salaires c’est peanuts ! - Ouais, ben j’ai du taf moi ici, j’ai même deux boulots, alors quand est-ce qu’c’est-y que j’vais aller dans les mines ? - Pendant tes vacances mon amour ! Angélique pousse ses livres et fait une place à Johnny. Elle le prend par le cou. - Tu sais qu’il faut que je travaille pour mes examens. Tu pars te dorer la pilule au soleil pendant cinq semaines, et tu reviens plein aux as. - Tes examens ! On croirait qu’tu vas à l’hosto. L’image d’Indiana Jones se superpose à celle du cowboy près de la rivière. - Remarque, pourquoi pas, après tout. J’aime l’aventure. Il se met à fredonner « l’Aventure c’est l’aventure » - Elle est pareille à l’amur, elle est à moi pur tujurs… T’as raison mon Ange, j’vais partir, tu restes dans tes bouquins, et je reviendrai te couvrir d’or, comme ça, tu m’foutras la paix avec tes conneries d’études. https://www.youtube.com/watch?v=ct0j44qZs4sAngélique a acheté le billet d’avion de son mari, elle a trouvé un contact au Sénégal, par un biais pas vraiment légal, et bye bye Johnny ! Quelques temps plus tard, l’ambassade de France l’appelle pour lui annoncer le décès de son mari. Il a été attaqué par des voleurs qui avaient appris qu’il avait trouvé un super filon. La jeune femme repose le combiné, elle se rassoit sur le canapé au milieu de ses lectures, et soupire en pensant à ce qu’elle va bien pouvoir faire de tout cet or que Johnny a eu le temps de lui faire parvenir avant de mourir. Elle se rappelle du film un taxi pour Tobrouk où l’un des personnages dit : « un intellectuel assis va moins loin qu’un con qui marche », et elle marmonne avec un petit sourire : - C’est pas faux…
Posté le : 16/11/2014 17:51
|
|
|
|
|
Georges Clémenceau 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 16 novembre 1917 est élu Georges Benjamin Clémenceau,
76ème président du conseil des ministres français, 88ème chef du gouvernement, il restera à ce poste jusqu'au 18 Janvier 1920, sous la présidence de Raymond Poincaré. Sa carrière politique commence au poste de ministre de l'Intérieur du 14 mars 1906 au 20 juillet 1909, sous le président Armand Fallières. Dans le gouvernement Clemenceau I, Législature IXe, son prédécesseur est Ferdinand Sarrien son successeur Aristide Briand. Du 25 Octobre 1906 au 20 Juillet 1909, il est 63e président du Conseil des ministres français il est le 75e chef du gouvernement, président Armand Fallières. Sous le président Raymond Poincaré, il préside le gouvernement Clemenceau II, son prédécesseur est Paul Painlevé, son successeur André Lefèvre. Vint ensuite le gouvernement Clemenceau II, Législature XIIe, son prédécesseur est Paul Painlevé, son successeur Alexandre Millerand. Du 16 novembre 1917 au 18 janvier 1920, ministre de la guerre.
Son surnom est "Le tigre" et "Le père la Victoire". Il adhère au parti politique des indépendants proche des Radicaux.
Georges Benjamin Clemenceau, né le 28 septembre 1841 à Mouilleron-en-Pareds Vendée et mort, à 88 ans le 24 novembre 1929 à Paris, homme d'État français, radical-socialiste, président du Conseil de 1906 à 1909, puis de 1917 à 1920.
Issu d'une famille de notables républicaine, il est maire du 18e arrondissement de Paris puis président du conseil municipal de Paris au début de la Troisième République, ainsi que député en 1871, puis de 1876 à 1893, siégeant en tant que républicain radical. Défenseur de l'amnistie pour les Communards et anticlérical, il prône inlassablement la séparation des Églises et de l'État et s'oppose à la colonisation, faisant tomber le gouvernement Jules Ferry sur cette question. Fondateur du journal La Justice et de la Société des droits de l'homme et du citoyen, il travaille ensuite à L'Aurore et prend une part active dans la défense du capitaine Dreyfus.
Élu sénateur du département du Var en 1902, bien qu'il ait critiqué dans sa jeunesse l'institution du Sénat et de la présidence de la République, il est nommé ministre de l'Intérieur en 1906, se désignant lui-même comme le premier flic de France. Surnommé le Tigre, il réprime alors les grèves et met fin à la querelle des inventaires, puis devient président du Conseil à la fin de l'année 1906, fonction qu'il occupe pendant près de trois ans. Retournant ensuite au Sénat, il fonde le journal L'Homme libre, rebaptisé L'Homme enchaîné après avoir essuyé la censure au début de la Première Guerre mondiale.
Le 16 novembre 1917, il est de nouveau nommé président du Conseil et forme un gouvernement consacré à la poursuite de la guerre. Négociateur lors de la Conférence de Versailles, le Père la Victoire, après avoir promulgué la loi des huit heures, échoue à l'élection présidentielle de janvier 1920, étant critiqué à gauche et à droite, et se retire de la vie politique.
En bref
Issu d'une famille de la bourgeoisie vendéenne de tradition républicaine, Georges Clemenceau fait des études de médecine, séjourne de 1865 à 1869 aux États-Unis avant d'entrer véritablement dans la carrière politique. Maire de Montmartre en septembre 1870, puis du XVIIIe arrondissement, il est élu le 8 février 1871 député à l'Assemblée nationale, y siège à l'extrême gauche et en démissionne pendant la Commune. La même année, il devient conseiller municipal, puis président du conseil municipal de Paris en 1875. Il est élu député dans le XVIIIe arrondissement en 1876 sur un programme comportant : suppression de l'état de siège, instruction primaire obligatoire et laïque, séparation des Églises et de l'État. Après 1877, il se sépare des opportunistes et dirige le petit groupe d'extrême gauche d'où sortira le Parti radical. La violence de ses discours et l'adresse de son intelligence font de lui un tombeur de ministères : celui de Gambetta, puis celui de Ferry, au nom du patriotisme intégral contre la politique coloniale. Il fonde un journal : La Justice. À partir de 1885, il représente le Var à l'Assemblée. Il soutient la carrière politique du général Boulanger à ses débuts. À la fois autocrate et libertaire, il multiplie les mots et les duels. En 1893, il est battu aux élections après avoir été impliqué dans le scandale de Panamá. Éditorialiste à L'Aurore, le 13 janvier 1898 il y publie la lettre de Zola J'accuse, à propos de l'affaire Dreyfus. En 1902, le Var l'envoie au Sénat, qu'il a violemment combattu : Le Sénat ... c'est la résistance au mouvement, l'immobilité, la réaction. Dans le cabinet Sarrien 1906, il est ministre de l'Intérieur.
La même année, le Jacobin Clemenceau accède à la présidence du Conseil et appelle à son gouvernement le socialiste indépendant Viviani pour qui il crée le ministère du Travail chargé d'appliquer une série de réformes dans le sens de la justice sociale, limitation du temps de travail, assurance vieillesse. Le nouveau président a un vaste plan de réformes pour tous les secteurs de la vie nationale, et il est appuyé par une écrasante majorité du Bloc des gauches à la Chambre. Mais la C.G.T., où les révolutionnaires viennent de triompher des réformistes, suscite contre lui une vague de grèves. Celui qui s'est proclamé le premier des flics ne supporte pas cette agitation et la réprime durement. Vignerons du Midi, instituteurs, fonctionnaires, armée protestent à leur tour, et les socialistes se désolidarisent des radicaux qui rendent leur chef responsable de cette cassure. Ne voulant ni se rapprocher de la droite, ni pratiquer la politique demandée par la gauche, et brouillé avec Jaurès qui est devenu le porte-parole de celle-ci, Clemenceau, muré dans son intransigeance, est renversé en juillet 1909 par ceux qu'il appelait avec mépris les muets du sérail radicaux.
Il entre en 1909 dans l'opposition, aux côtés de Caillaux et de Briand. Il fonde un nouveau journal, L'Homme libre, qui devient bientôt L'Homme enchaîné, et dans lequel il combat tous les gouvernements qui se succèdent jusqu'en 1917. Mais, le 16 novembre 1917, il prend la direction du gouvernement et fait la guerre. Sa popularité est immense et, pour une génération d'hommes, il incarne l'histoire même de notre pays. À la chute du cabinet Painlevé, Poincaré fait le choix inévitable de celui dont le programme se résume en une phrase : Je fais la guerre. Churchill, qui était présent le jour de la présentation de son gouvernement à la Chambre, écrira : Tout autour de lui était une assemblée qui eût tout fait pour éviter de l'avoir là, mais qui, l'ayant mis là, sentait qu'elle devait obéir.
L'Action française soutient celui qui est maintenant, pour elle, le vieux chouan. La S.F.I.O. le redoute depuis qu'elle l'a connu ministre de l'Intérieur et briseur de grèves. Monarque pour les uns, comité de salut public pour les autres, Clemenceau entreprend la lutte sur le front de l'intérieur comme de l'extérieur. Malvy qui, comme ministre de l'Intérieur dans les précédents cabinets, s'était solidarisé avec les manifestations défaitistes, est banni sous l'accusation de forfaiture ; Caillaux est lui aussi emprisonné pour avoir parlé avec les Allemands. Clemenceau visite le front, soutient le moral des troupes, se bat avec les Alliés pour imposer aux armées le commandement unique de Foch, défend encore celui-ci devant la Chambre lors de la dernière contre-offensive en été 1918. La suprématie du civil sur le militaire, c'est lui et lui tout seul et, s'il a des comptes à régler avec ses généraux, il le fait loin des oreilles parlementaires. Le Tigre est devenu le Père la Victoire .
Le 11 novembre 1918, il donne lecture à la Chambre de la convention d'armistice. Il y est acclamé, et les députés proclament qu'il a bien mérité de la patrie. Président de la Conférence de la paix, il s'oppose souvent à Wilson et à Lloyd George. Pour Clemenceau, l'Allemagne doit payer, réparer, restituer. Il faut démanteler cet ennemi héréditaire. Mais, si Clemenceau obtient la restitution de l'Alsace-Lorraine, il échoue pour la rive gauche du Rhin, ne reçoit pour la Sarre qu'une concession provisoire. Et si le principe des réparations est retenu, le montant n'en est pas fixé.
Clemenceau semble avoir compté sur la garantie américaine pour maintenir le nouvel équilibre européen imposé par le traité de Versailles. Sa renommée est alors universelle. En 1920, la coalition des habiles et des inquiets, autour de Briand, l'écarte de la présidence de la République. Clemenceau présente la démission de son gouvernement le 18 janvier 1920. Il quitte la scène politique et se retire dans son village de Vendée, après une présence politique qui a marqué un demi-siècle.
Sa vie
Né le 28 septembre 1841 au 19 rue de la Chapelle, rebaptisée depuis rue Georges Clemenceau, dans la maison de ses grands-parents maternels à Mouilleron-en-Pareds, petite bourgade vendéenne, Clemenceau affirmera plus tard C'est au caractère vendéen que je dois le meilleur de mes qualités. Le courage, l'obstination têtue, la combativité. Il est le deuxième des six enfants de Sophie Gautereau et de Benjamin Clemenceau, établi comme médecin à Nantes, mais vivant surtout de ses fermages.
Sa famille paternelle qui appartient à la bourgeoisie vendéenne, habite le manoir du Colombier, près de Mouchamps. Au début du XIXe siècle, elle hérite par mariage du domaine de "l'Aubraie" de Féole6, dans la commune de La Réorthe, en Vendée, région de tradition royaliste et catholique.
Son arrière-grand-père, Pierre-Paul Clemenceau 1749-1825, est médecin des Armées de l'Ouest pendant la guerre de Vendée, puis sous-préfet de Montaigu et député du Corps législatif en 1805, au début du Premier Empire.
Son père, Benjamin 1810-1897 est médecin ; c'est un républicain engagé, progressiste, farouchement athée, qui aura une grande influence sur Georges, le second de ses six enfants, en lui transmettant les idéaux révolutionnaires et la haine de toute monarchie.
Il a participé aux Trois Glorieuses de 1830 et, lors de la Révolution de 1848, il a créé une Commission démocratique nantaise. Détenu une brève période à Nantes au lendemain du coup d'État du 2 décembre 1851, il est arrêté après l'attentat d'Orsini de 1858 et soumis, sans procès, à la transportation vers l'Algérie en vertu de la loi de sûreté générale. Il est toutefois libéré avant d'embarquer à Marseille, grâce à l'indignation de Nantes et à l'intervention d'un groupe de notables, notamment de son collègue Pierre Honoré Aubinais, médecin nantais et bonapartiste de gauche, proche de Jérôme Bonaparte, et mis quelque temps en résidence forcée à Nantes. Outre ce fond républicain, marqué par le buste de Robespierre sur la cheminée, son père lui enseigne la chasse, l'équitation et l'escrime : en 1890, Clemenceau sera le nègre de son ami James Fillis pour ses Principes de dressage et d'équitation.
Benjamin Clemenceau, qui, comme tous les hommes qui ne faisaient rien, était très occupé selon son fils, fut à ses heures peintre : portrait en buste de son fils enfant, et sculpteur : profil de son fils et double profil de lui et de sa sœur Emma, l'un et l'autre en plâtre, en 1848, année où il planta dans la propriété familiale du Colombier à Mouchamps 85, avec son jeune fils un cèdre de l'Atlas, son "arbre de la Liberté", qui surplombe sa tombe, et depuis novembre 1929, celle de son fils.
Sa mère, Sophie Gautereau, 1817 - † Hyères, 20 avril 1903 qui lui enseigne le latin, il connaît également le grec, est issue d'une famille de cultivateurs devenus de petits bourgeois, de religion protestante.
Jeunesse : du lycée de Nantes au séjour américain
Clemenceau par Nadar, avec ses cheveux ras, son front dégarni, ses pommettes saillantes, ses sourcils épais et broussailleux, sa moustache tombante.
Georges Clemenceau est élève du lycée de Nantes à partir de la classe de 5e en 1852-53. Son professeur de lettres de 5e est Louis Vallez, le père de Jules Vallès. Il effectue une scolarité convenable, obtenant chaque année sauf en 4e quelques accessits, et seulement trois prix, récitation classique en 5e, histoire naturelle en rhétorique, version latine en logique. Lors de la remise de ce dernier prix, en 1858, l'année de l'arrestation de son père, il est ovationné par les assistants. À partir de 1883, Clemenceau est un membre-fondateur actif de l'Association des anciens élèves du lycée de Nantes, section parisienne où il rencontre Boulanger, son condisciple en 1852-53, mais beaucoup plus âgé, élève de classe préparatoire à Saint-Cyr. Son nom sera donné au lycée dès 1919.
Il obtient le baccalauréat ès-lettres en 1858. Il s'inscrit ensuite à l'école de médecine de Nantes. Après trois années pendant lesquelles il se révèle un étudiant médiocre et dissipé, passant notamment en conseil de discipline, il part en 1861 poursuivre ses études à Paris, où il s'inscrit également en droit.
Il fréquente des cercles artistiques et républicains dans le Quartier latin où il fait connaissance avec Claude Monet en 1863. Avec plusieurs camarades, Germain Casse, Jules Méline, Ferdinand Taule, Pierre Denis, Louis Andrieux, il fonde un hebdomadaire, Le Travail, dont le premier numéro paraît le 22 décembre 1861. Zola se joint au groupe afin de soutenir le journal contre la censure. Clemenceau y publie des piques à l'encontre de l'écrivain Edmond About, rallié au régime.
La publication prend fin au bout de huit numéros : la plupart des membres ont en effet été arrêtés après un appel à manifester place de la Bastille afin de commémorer la Révolution du 24 février 1848. Le 23 février 1862, Clemenceau est envoyé pour 73 jours à la prison de Mazas. Quand on a l'honneur d'être vivant, on s'exprime ! Quand ?.
Libéré, il rend visite à son ami Ferdinand Taule, détenu à Sainte-Pélagie, où il rencontre Auguste Blanqui, alias l'Enfermé, avec qui il se lie d'amitié et de complicité, ainsi qu'Auguste Scheurer-Kestner, personnage central de la défense de Dreyfus. En 1896, il honorera Blanqui en parlant de cette vie de désintéressement total … Qui ne découragera que les lâches du grand combat pour la justice et pour la vérité.
Durant ses années d’études, Clemenceau participe à la création de plusieurs autres revues et écrit de nombreux articles avec son ami Albert Regnard. Après avoir effectué des stages à l'hôpital psychiatrique de Bicêtre, puis à La Pitié, il obtient le doctorat en médecine le 13 mai 1865 avec une thèse intitulée De la génération des éléments anatomiques, sous la direction de Charles Robin, un matérialiste ami d'Auguste Comte. Sa thèse reprend les idées de Robin, qui est un adversaire du catholique bonapartiste Pasteur. Elle est ensuite publiée chez Germen-Baillère en échange de la traduction par Clemenceau d’Auguste Comte and Positivism de J.S. Mill. Plus tard, lorsque Pasteur sera devenu célèbre, Clemenceau reconnaîtra de bonne grâce son erreur.
À la suite d'un dépit amoureux avec Hortense Kestner, la belle-sœur de son ami Auguste Scheurer-Kestner, le 25 juillet 1865, il s’embarque, d'abord pour l'Angleterre, où son père le présente à Mill et Spencer7, puis pour les États-Unis, qui sortent à peine de la guerre de Sécession. Il trouve un poste d’enseignant dans un collège pour jeunes filles à Stamford Connecticut où il donne des cours de français et d’équitation. Il devient également correspondant du journal Le Temps7.
Clemenceau s’éprend alors d’une de ses élèves, Mary Plummer 1848-1922, qu’il épouse civilement le 20 juin 18697, avec qui il aura trois enfants, dont Michel, né en 1873 et deux filles, Madeleine et Thérèse-Juliette.
Sa femme ayant une liaison avec son jeune secrétaire précepteur des enfants, il fait constater l'adultère et l'envoyer brutalement quinze jours dans la prison Saint-Lazare pour adultère, alors qu'il a eu lui-même de nombreuses liaisons féminines, on lui en attribue environ 800 et pendant cette incarcération demande le divorce qu'il obtient en 1891 avant de la renvoyer brutalement aux États-Unis avec un billet de troisième classe et obtenu qu'elle perde la garde de ses enfants et la nationalité française. Revenue vivre en France, mais restée perturbée psychologiquement par ces évènements conjugaux, l'ex-Madame Georges Clemenceau mourra seule, le 13 septembre 1922, dans son appartement parisien du 208, rue de la Convention. Clemenceau l'annoncera ainsi à son frère Albert: Ton ex-belle-sœur a fini de souffrir. Aucun de ses enfants n'était là. Un rideau à tirer. lettre du 27 septembre 1922 dans sa Correspondance 1858-1929, p. 639.
De ce séjour américain, il tire un bilinguisme franco-anglais rare à l'époque et une familiarité avec les cercles anglo-saxons.
L'effondrement de l'Empire
Le 26 juin 1869, il est de retour en France avec sa femme. Son voyage aux États-Unis lui aura fait découvrir la démocratie américaine - il admire la procédure d'impeachment- et lui laisse un goût durable pour la philosophie et la littérature anglo-saxonne.
Dès que la guerre franco-prussienne éclate, il quitte sa femme et son nouveau-né, Madeleine, pour se rendre à Paris, où il arrive début août 1870. À la suite de la défaite de Sedan, le 2 septembre 1870, il prend une part active, avec ses amis Arthur Ranc et Edmond Adam, à la journée du Quatre Septembre au cours de laquelle est proclamée la République.
Formé le jour même, le gouvernement de la Défense nationale nomme Étienne Arago maire de Paris, qui lui-même nomme des maires provisoires dans les différents arrondissements. Arago cherchant des républicains sûrs23 nomme Clemenceau, - introduit auprès d'Arago par son père - à la tête de la mairie de Montmartre, alors commune indépendante. Il rencontre alors l'anarchiste Louise Michel, institutrice du quartier, et permet à Blanqui de devenir commandant du 169e bataillon, alors que le siège de Paris commence le 19 septembre 1870.
Fin octobre, les Parisiens se révoltent en apprenant la reddition du maréchal Bazaine à Metz et l'envoi par le gouvernement provisoire conservateur d'Adolphe Thiers à Versailles, pour négocier l'armistice avec Bismarck. Pour le républicain farouchement antimonarchiste qu'est Clemenceau, c'est une provocation : il fait placarder des affiches annonçant son refus d'une telle trahison. Le jour même, la Garde nationale des quartiers populaires organise un soulèvement afin de prendre l'Hôtel de Ville. La Garde nationale des quartiers bourgeois, emmenée par Jules Ferry, s'y oppose et empêche le coup de force. L'épisode fait de Clemenceau et Ferry des rivaux acharnés.
Désavoués pour leur complicité avec les révolutionnaires, Arago démissionne, suivi de Clemenceau. Le gouvernement obtient la confiance des Parisiens par le plébiscite du 3 novembre, et organise des élections municipales le 5 novembre. Clemenceau est élu dans le XVIIIe arrondissement. Il est cependant destitué le 22 janvier 1871, jour d'une manifestation à l'Hôtel de Ville, pour avoir demandé, avec d'autres maires d'arrondissement réunis par Jules Favre, la démission du général Trochu. L'armistice, refusé par Clemenceau et le peuple parisien, est signé six jours plus tard.
Le 8 février, ayant refusé l'offre de Gambetta de devenir préfet du Rhône, il est élu député de la Seine, en 27e position au sein de la nouvelle Assemblée nationale. Il figure alors sur les listes électorales de l'Union républicaine, s'opposant à la paix léonine avec Bismarck, aux côtés de Victor Hugo, Garibaldi, Gambetta, Courbet, Louis Blanc, etc.
De la Commune au conseil municipal. Commune de Paris 1871.
Début mars 1871, Clemenceau est à Paris. Le 1er mars 1871, il appelle ses concitoyens à s'abstenir de toute violence lors de l'entrée des Prussiens dans la ville. Lors du soulèvement du 18 mars 1871, accompagné du capitaine Mayer et Sabourdy, il tente de sauver de la foule les généraux Thomas et Lecomte. Le soir, le Comité central de la garde nationale a pris le pouvoir à Paris, et décide l'organisation d'élections municipales.
Deux jours plus tard, à l'Assemblée réunie à Versailles, Clemenceau dépose, avec 18 députés républicains, un projet de loi afin d'organiser l'élection d'un conseil municipal de 80 membres à Paris, qui aura le titre et exercera les fonctions de maire de Paris. Il navigue ainsi entre le gouvernement de Thiers et la Commune de Paris, tentant de concilier les camps ennemis, ce qui lui attire l'inimitié des deux parties. Les communards à qui il reproche d'être sortis de la légalité, le font ainsi démissionner de sa fonction de maire le 22 mars, le remplaçant par un délégué du Comité central. Ce dernier organise des élections municipales le 26 mars 1871, au cours desquelles Clemenceau n'obtient que 752 voix.
Minoritaire, il démissionne de son poste de conseiller municipal et de député la veille de la proclamation de la Commune, et fonde avec d'anciens maires la Ligue républicaine des droits de Paris, qui tente de négocier avec les deux camps. Il quitte Paris le 10 mai 1871 afin de rejoindre le congrès des municipalités à Bordeaux, interdit par le gouvernement Thiers. Devant cet échec, il tente de revenir à Paris, mais ne peut entrer dans la ville, soumise à l'attaque sanglante du gouvernement Thiers.
Soupçonné de connivence avec la Commune, il se rend clandestinement en Vendée, puis à Belfort et Strasbourg annexé, avant de retourner à Paris le 15 juin 1871. Battu aux élections complémentaires du 2 juillet 1871, il se fait élire conseiller municipal de Paris le 30 juillet 1871, à Clignancourt. En 1872, il se bat en duel avec Poussargues, ce qui lui vaut 15 jours avec sursis et 25 francs d'amende. Il est réélu lors des élections municipales de novembre 1874. Le 29 novembre 1875, il est élu président du conseil municipal de Paris par 39 voix sur 54 suffrages :
" Le caractère dominant de notre politique municipale, déclare-t-il alors, … c'est d'être profondément imbue de l'esprit laïque, c'est-à-dire que, conformément aux traditions de la Révolution française, nous voudrions séparer le domaine de la Loi, à qui tous doivent obéissance, du domaine du Dogme, qui n'est accepté que par une fraction seulement des citoyens ".
Le député radical 1876-1896
Son élection, le 20 février 1876, comme député de Paris à la Chambre des députés marque son émergence sur la scène nationale. Il est élu dans le 18e arrondissement dès le premier tour avec 15 000 voix contre 3 700 pour son rival. Refusant alors aussi bien les institutions de la présidence de la République et du Sénat que le cumul des mandats, il démissionne de son poste de président du conseil municipal le 24 avril 1876.
Clemenceau s'impose par son verbe comme le chef incontesté des républicains radicaux qui ne sont pas encore constitués en parti et de l’opposition d’extrême gauche aux Opportunistes, emmenés par Gambetta. L'écrivain Julien Gracq parlera a posteriori de son agressivité pure, gratuite, incongrue, de cette personnalité aux arêtes tranchantes comme un rasoir. Il lutte alors pour l'amnistie des Communards, la révision des lois constitutionnelles de 1875 rédigées par les républicains opportunistes et les orléanistes, la laïcité et, 30 ans avant la loi de 1905, la séparation de l’Église et de l’État.
La lutte pour l'amnistie
Dès son discours du 16 mai 1876 à la Chambre, il se fait remarquer par son éloquence, qu'il met au service de l'amnistie30. Raspail, Lockroy et lui, ainsi que Victor Hugo au Sénat, s'unissent dans ce combat, mais ils sont minoritaires face aux opportunistes, qui, derrière Gambetta et Jules Méline, soutiennent une amnistie partielle.
Ils relancent le combat pour l'amnistie trois ans plus tard. Au gouvernement Waddington qui veut exclure de celle-ci ceux qui se déclarent les ennemis de la société, Clemenceau rétorque, suscitant les rires de la Chambre :
À quel signe, à quel critérium, on reconnaît un ennemi de la société : M. le duc de Broglie est un ennemi de la société aux yeux de M. Baudry d'Asson, et moi je tiens M. Baudry d'Asson pour un ennemi de la société. Nous sommes ainsi 36 millions d'ennemis de la société qui sommes condamnés à vivre dans la même société, Nouveaux rires.
Le projet est cependant rejeté. Il soutient alors, avec quelques amis, et incognito, la candidature à la députation de Blanqui, détenu à la maison centrale de Clairvaux. Celui-ci est élu le 20 avril 1879 ; sa situation d'inéligibilité permet à Clemenceau de relancer la bataille pour l'amnistie. En 1880, la démission du maréchal Mac-Mahon, ultime épisode de la crise du 16 mai 1877, son remplacement par Jules Grévy, et le résultat des élections sénatoriales permettent finalement à Clemenceau d'arriver à ses fins : l'amnistie pleine et entière est votée, sur un projet de loi du gouvernement Freycinet.
La rupture avec Gambetta et le discours de Marseille
Après que les républicains se sont scindés entre radicaux et opportunistes, Clemenceau attaque férocement ces derniers pour leur timidité et leur pragmatisme. Il contribue ainsi à la démission du ministre de l'Intérieur Marcère en mars 1879, provoquée par un scandale de police : à cette occasion, qui signe la rupture avec Gambetta, Clemenceau réclame l'épuration des cadres de police hérités du Second Empire.
Son discours de Marseille du 28 octobre 1880, qui reprend le programme de Belleville de Gambetta 1869, blâme ainsi l'opportunisme qui vise à ajourner les réformes dans le cadre de la République victorieuse des monarchistes. Il y réclame la séparation de l'Église et de l'État, la confiscation des biens des congrégations, la suppression du Sénat, l'élection des magistrats, l'autonomie municipale, l'impôt sur le revenu, la limitation de la durée légale de la journée de travail, la retraite des vieux travailleurs, la responsabilité des patrons en cas d'accident, le rétablissement du divorce et la reconnaissance du droit syndical, ainsi que l'interdiction du travail pour les enfants en dessous de 14 ans, la liquidation des grandes compagnies de chemin de fer, des canaux et des mines.
À l'occasion d'une interpellation du jeune socialiste Alexandre Avez, il critique cependant le collectivisme et la socialisation des moyens de production. Lors de ce discours, prononcé le 11 avril 1880 au cirque Fernando à Paris, il rétorque à Avez : il y a aussi des jésuites rouges. Le quotidien centriste Le Temps remarque : Quelque avancé que l'on soit, on se trouve toujours être le réactionnaire de quelqu'un.
Bien que siégeant toujours à l'Extrême-Gauche, il incarne ainsi une voie médiane entre le socialisme émergeant et l'opportunisme. Lors des débats sur la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, il tente de s'opposer à l'institution d'un délit d'outrage au président de la République, qu'il considère comme une forme de censure. De même, il se moque en février 1881 du délit de diffamation :
M. le rapporteur nous présente une loi qui donne paraît-il la liberté de la presse, mais il ne permet pas la diffamation ni envers les cours d'appel, ni envers les tribunaux, ni envers les armées de terre ou de mer, ni envers les corps constitués, ni envers les administrations publiques, ni envers un ou plusieurs membres du ministère, ni envers un ou plusieurs membres de l'autre Chambre, ni envers un fonctionnaire public, ni envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique, ni envers un ministre de l'un des cultes salariés par l'État, ni envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, ni envers un juré ou un témoin à raison de sa déposition. Moyennant qu'on ne parle jamais des personnes que je viens d'indiquer, on aura le droit de tout dire.
Il tente également d'autoriser les assemblées non permanentes lors des débats sur la liberté de réunion, alors que le projet de loi maintient l'interdiction sur les clubs politiques. Concernant les lois Jules Ferry, il s'oppose radicalement à une loi sur l'éducation obligatoire qui n'inclurait pas le caractère laïque de l'éducation publique, considérant l'éducation obligatoire dans des écoles religieuses comme contraire à la liberté de conscience.
Durant ce mandat, il a ainsi voté pour les poursuites judiciaires contre les responsables du 16 mai, Mac Mahon, etc. ; pour la révision des lois constitutionnelles de 1875 proposée par la commission Barodet ; pour l'élection des magistrats ; pour la séparation de l'Église et de l'État ; pour l'amnistie des Communards ; pour l'instruction laïque ; pour le service militaire réduit à 3 ans ; pour la fin de l'exemption du service militaire pour les séminaristes ; pour la diminution du traitement des cardinaux, archevêques et évêques ; pour la suppression de l'ambassade au Vatican ; pour le rétablissement du divorce ; pour la liberté d'association et la liberté de réunion ; contre l'interdiction des clubs ; pour la liberté de la presse ; pour la loi visant à protéger les employés des chemins de fer contre les grandes compagnies ; pour la journée de 10 heures maximum ; pour la reconnaissance des syndicats ; pour le scrutin de liste ; pour les poursuites contre le préfet de police Andrieux.
Pour asseoir davantage son influence, il fonde avec le jeune Stephen Pichon un journal, La Justice, qui paraît pour la première fois le 13 janvier 1880. Le rédacteur en chef en est Camille Pelletan. Malgré un tirage relativement faible et un échec économique durable, le quotidien bénéficie d'une certaine audience dans les milieux politiques.
Jules Ferry et le colonialisme
Réélu aux législatives de 1881, à la fois dans les deux circonscriptions du XVIIIe arrondissement où il s'est présenté et à Arles, où les républicains locaux lui ont demandé de se présenter, Clemenceau acquiert pour sa férocité le surnom de Tigre, un animal qu'il disait ne pas aimer, Tout en mâchoire et peu de cervelle. Cela ne me ressemble pas, et une réputation de tombeur de ministères grâce notamment à ses talents d'orateur redouté pour son ironie et sa férocité verbale. Intransigeant face aux opportunistes, il fait en effet tomber plusieurs ministères successifs, avec l'appoint de voix de droite. Je n'ai pourtant jamais démoli qu'un seul ministère, dit-il pour sa défense, puisque c'était toujours le même.Lors du discours de Salerne en 1893, il déclarera :
Ce qu’on ne dit pas. c’est que les modérés ont, à travers tout, sous des noms divers, maintenu les mêmes hommes et la même politique d’atermoiement. Ce qu’on ne dit pas, c’est que rencontrant un cabinet radical, les modérés ne se sont pas fait faute de s’unir à la droite pour le renverser. Ainsi se retourne contre eux un de leurs principaux griefs contre nous.
Dès novembre 1881, il attaque le cabinet Ferry à propos de l'expédition tunisienne qui a abouti à l'instauration d'un protectorat traité du Bardo, considérant qu'elle ne résulte que de l'action d'hommes qui veulent faire des affaires et gagner de l'argent à la Bourse !. Il dépose une motion proposant une enquête sur les causes de l'expédition, la droite déposant une motion rivale accusant le gouvernement d'avoir trompé les Chambres et le pays. Incapable de faire voter l'ordre du jour, Ferry démissionne et laisse la place au gouvernement Gambetta.
Deux mois plus tard, en janvier 1882, l'action de Clemenceau en faveur de la révision intégrale de la Constitution contribue à la démission du ministère Gambetta, remplacé par le cabinet Freycinet. En incitant les députés à refuser le vote d’un budget pour une intervention militaire sur le canal de Suez, ce qui est fait le 29 juillet 1882, il pousse également Freycinet à la démission.
En février 1883, Jules Ferry forme son deuxième cabinet, appuyé sur une coalition centriste, Union républicaine et Gauche républicaine, groupe de centre-droit en réalité. Clemenceau et les radicaux se sont déjà opposés à Ferry lorsqu'il était au ministère de l'Instruction publique 1879-80 et 1882, l'accusant de timidité dans la mise en œuvre des réformes républicaines. Pour autant, le mouvement ouvrier et socialiste commence à s'organiser, contestant le radicalisme vieille école de Clemenceau. En 1882, Jules Guesde fonde en effet le Parti ouvrier français, tandis que les anarchistes se manifestent : pas seulement par la propagande par le fait, dénoncée dès 1887 par Kropotkine, mais surtout avec la mise en place des Bourses du travail.
Lors des débats sur l'autorisation des syndicats loi Waldeck-Rousseau votée en mars 1884, Clemenceau rétorque à Ferry, en janvier 1884 :
" C'est l'État qui doit intervenir directement pour résoudre le problème de la misère, sous peine de voir la guerre sociale éclater au premier jour."
Durant l'été 1884, alors qu'on débat de la révision constitutionnelle, Clemenceau prône l'abolition du Sénat et la suppression de la présidence de la République. Il échoue, la loi du 9 décembre 1884 se limitant à une simple réforme du Sénat. La même année, il se rend avec une délégation radicale à Marseille lors de l'épidémie de choléra, faisant la connaissance de l'équipe du journal Le Petit Var.
Paul Cambon, résident général de France en Tunisie. Nommé en Tunisie, le général Boulanger ne lui plaira guère, et sera rappelé à Paris en 1885. Clemenceau rencontrera Cambon à Londres lors de la Première Guerre mondiale, et le choisira comme membre de son équipe de négociateurs lors de la conférence de paix.
Son combat contre Jules Ferry aboutit le 30 mars 1885 à la démission de ce dernier sur l'affaire du Tonkin. La Chambre, en particulier la droite et l'extrême gauche, refuse de voter une rallonge de 200 millions de francs pour les troupes françaises au Tonkin attaquées par l’armée chinoise. Le 9 juin 1885, le second traité de Tien-Tsin confirme cependant l'occupation française. Le succès initial de la colonisation française dans les décennies suivantes poussera nombre d'historiens et membres du parti colonial à critiquer Clemenceau pour son aveuglement: la décolonisation ne sera à l'ordre du jour que 70 ans plus tard.
Le débat avec Ferry rebondit le mois qui suit sous le cabinet Brisson, alors que Ferry défend l'expédition de Madagascar. De nouveau, Clemenceau s'oppose farouchement à la colonisation, refusant tout impérialisme au nom du respect envers les autres peuples et civilisations ; il s'oppose par ailleurs à une politique aventuriste et du fait accompli, faite au profit d'une camarilla d'hommes d'affaires, le célèbre parti colonial ; il défend enfin la nécessité de préparer la France face à l'Allemagne. Le 28 juillet 1885, Ferry invoque à la Chambre le devoir qu'ont les races supérieures de civiliser les races inférieures, s'appuyant sur un type de discours alors à la mode, ainsi que la nécessité de trouver des débouchés commerciaux et de ne pas laisser le champ libre aux autres puissances européennes. Clemenceau lui répond vigoureusement.
Plus tard, s'appuyant sur l'exemple de la Cochinchine, Clemenceau contestera, rejoignant en cela la position de Thiers et de la droite de cette époque le profit économique qu'apporterait la colonisation, pour refaire la France vaincue, ne pas gaspiller son sang et son or dans des expéditions sans profit, proclamera-t-il lors du discours de Salerne de 1893. Plutôt que de diffuser la civilisation française dans le monde, il préconise de lutter contre la misère en France et de faire avancer les droits sociaux. Concernant les présupposés racistes de l'idéologie colonialiste, il rétorque le 31 juillet :
" Les races supérieures ont sur les races inférieures un droit qu'elles exercent et ce droit, par une transformation particulière, est en même temps un devoir de civilisation. Voilà, en propres termes, la thèse de M. Ferry et l'on voit le gouvernement français exerçant son droit sur les races inférieures en allant guerroyer contre elles et les convertissant de force aux bienfaits de la civilisation. Races supérieures ! Races inférieures ! C'est bientôt dit. Pour ma part, j'en rabats singulièrement depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande, parce que le Français est d'une race inférieure à l'Allemand. Depuis ce temps, je l'avoue, j'y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation et de prononcer : homme ou civilisation inférieure ! Race inférieure, les Hindous ! Avec cette grande civilisation raffinée qui se perd dans la nuit des temps ! Avec cette grande religion bouddhiste qui a quitté l'Inde pour la Chine, avec cette grande efflorescence d'art dont nous voyons encore aujourd'hui les magnifiques vestiges ! Race inférieure, les Chinois ! Avec cette civilisation dont les origines sont inconnues et qui paraît avoir été poussée tout d'abord jusqu'à ses extrêmes limites. Inférieur Confucius ! … Je ne veux pas juger au fond la thèse qui a été apportée ici et qui n'est autre chose que la proclamation de la puissance de la force sur le Droit … "
La vague boulangiste
Les élections d'octobre 1885 marquent un progrès important des monarchistes alors que la Grande dépression s'abat sur la France. Clemenceau, mis en ballotage, est élu à la fois à Paris et dans le Var où le modéré Jules Roche s'est désisté par discipline républicaine, permettant à la liste radicale de l'emporter. Clemenceau opte pour le Var, circonscription de Draguignan, département dont la population vote de plus en plus à gauche. Majoritaire, la gauche est cependant divisée entre les modérés de l'Union républicaine et de l'Union démocratique et l'extrême-gauche, incluant la Gauche radicale dont fait partie Clemenceau.
En 1886, le général Boulanger, ancien condisciple de Clemenceau au lycée de Nantes56, est nommé Ministre de la Guerre dans le cabinet Freycinet, ce qui est considéré comme un geste des modérés vis-à-vis de Clemenceau. Effectivement, Boulanger, républicain et patriote, applique de manière étendue la loi du 22 juin 1886 interdisant aux membres des familles ayant régné sur la France de servir dans l'armée. Opposé au colonialisme, qu'il considère comme un détournement de l'effort militaire vis-à-vis de Bismarck, et préparant la professionnalisation de l'armée, il plaît alors à Clemenceau, qui reste cependant circonspect.
Lors de l'affaire Schnæbelé 1887, Boulanger consulte Clemenceau, qui lui conseille d'agir avec fermeté sans tomber dans la provocation lancée par Bismarck. C'est le début de la vague boulangiste qui manque d'emporter la République. Appuyé par une coalition hétéroclite de radicaux d'extrême-gauche, L'Intransigeant de Rochefort et La Lanterne de Mayer et de monarchistes, Boulanger, démis de ses fonctions en tant que ministre à la suite de la chute du cabinet Goblet provoquée par Ferry, puis démis de ses fonctions militaires en mars 1888, se présente successivement à plusieurs élections partielles, se faisant élire puis démissionnant pour se faire élire ailleurs, afin de faire la preuve de sa popularité. Il critique le parlementarisme et appelle à une réforme institutionnelle qui donnerait une grande place au référendum et à ce qu'il appelle la démocratie directe, proposition de loi du 4 juin 1888. Les sceptiques, au contraire, dénoncent un risque d'autoritarisme. Fin 1887, le scandale des décorations est utilisé par les boulangistes pour discréditer le régime parlementaire : le président Jules Grévy est contraint de démissionner en décembre 1887.
Les républicains, Jules Ferry en tête, s'inquiètent de cette vague antiparlementaire. Ferry fait l'objet de la colère populaire lors d'une manifestation des 1er et 2 décembre 1887, à laquelle participent des membres de la Ligue des patriotes de Déroulède, des proches de Rochefort, des anarchistes, dont Louise Michel, des blanquistes du Comité central révolutionnaire, etc., qui s'opposent à l'élection à la présidence de Ferry. C'est finalement Sadi Carnot qui est élu.
De son côté, Clemenceau semble s'appuyer au début sur la vague boulangiste pour pousser ses propres projets de réforme institutionnelle, abolition du Sénat et de la présidence, avec prudence puisque dès juillet 1887, il critique la manifestation en faveur de Boulanger qui a eu lieu le 1456. En mars 1888, tout en s'opposant aux boulangistes, il refuse de voter l'ordre du jour demandé par le cabinet Tirard, composé d'Opportunistes. Il exige en effet des réformes sociales, et pas seulement politiques : selon lui, c'est leur absence qui explique le succès du général. Il vote donc comme les députés boulangistes, Laguerre, ancien collègue de La Justice, ou Michelin. L'ordre du jour est néanmoins voté par 339 voix, contre 82. Selon l'historien Michel Winock :
" Au fond, Clemenceau, à la mi-mars 1888, utilise la fièvre boulangiste, sans être boulangiste lui-même, pour aiguillonner le parti républicain, ses hommes au pouvoir et les parlementaires. "
En avril, il s'oppose frontalement à Boulanger, l'accusant de césarisme et de bonapartisme, bref, de représenter un danger pour la République. Le 25 mai 1888, avec Joffrin, Ranc et Lissagaray, il fonde la Société des droits de l'homme et du citoyen, unissant contre la vague boulangiste diverses tendances républicaines, à l'exception des partisans inconditionnels de Ferry, ainsi que certains possibilistes Joffrin .
Lorsque le 4 juin 1888, Boulanger présente à la Chambre son projet de réforme institutionnelle, Clemenceau s'y oppose, déclarant :
" Je le dis très haut : je suis pour la politique de parti … Il Boulanger ignore apparemment, lui qui essaie de faire un parti, que c'est d'abord un groupement d'idées, que c'est là ce qui, dans tous les pays du monde, constitue un parti …
Lisez l'histoire de la France depuis la Révolution française, et vous verrez que le parti royaliste, que le bonapartisme lui-même, et en tout cas le parti républicain, ont chacun leurs traditions et leurs titres dont ils peuvent se réclamer. Vous croyez qu'ils peuvent disparaître à votre voix … Le voulussent-ils, ils ne le pourraient pas, et il me sera permis qu'il faut que le parti royaliste ne se sente guère de fierté au cœur pour adhérer à la déclaration que nous avons entendue tout à l'heure … ces cinq cents hommes qui sont ici, en vertu d'un mandat égal au vôtre, ne s'accordent pas sans discussion. Eh bien, puisqu'il faut le dire, ces discussions qui vous étonnent, c'est notre honneur à tous. Elles prouvent surtout notre ardeur à défendre les idées que nous croyons justes et fécondes. Ces discussions ont leurs inconvénients, le silence en a davantage. …
" Si c'est le régime de discussion que vous croyez flétrir sous le nom de parlementarisme, sachez-le, c'est le régime représentatif lui-même, c'est la République sur qui vous osez porter la main. "
" La Révolution est un bloc"
La Révolution est un bloc, discours du 29 janvier 1891 à la Chambre.
… il a été joué à la Comédie-Française une pièce évidemment dirigée contre la Révolution française. Il est temps d'écarter toutes les tartuferies auxquelles on a eu recours pour dissimuler la réalité. Assurément, on n'a pas osé faire ouvertement l'apologie de la monarchie contre la République. On ne pouvait pas le faire à la Comédie Française. On a pris un détour, on s'est caché derrière Danton. Depuis trois jours, tous nos monarchistes revendiquent à l'envi la succession de Danton. … Mais voici venir M. Joseph Reinach qui monte à cette tribune entreprendre le grand œuvre d'éplucher, à sa façon, la Révolution française. Il épluche en conscience et, sa besogne faite, nous dit sérieusement : J'accepte ceci, et je rejette cela ! J'admire tant d'ingénuité. Messieurs, que nous le voulions ou non, que cela nous plaise ou que cela nous choque, la Révolution française est un bloc… un bloc dont on ne peut rien distraire, parce que la vérité historique ne le permet pas.
Je ne pouvais m'empêcher, en entendant M. Reinach, de faire un rapprochement bizarre. Ah ! vous n'êtes pas pour le tribunal révolutionnaire, monsieur Reinach ! mais vous avez la mémoire courte. Il n'y a pas longtemps, nous en avons fait un ensemble, un tribunal révolutionnaire… Nous en avons fait un ensemble, un tribunal révolutionnaire, et le pire de tous. Nous avons livré des hommes politiques à des hommes politiques, leurs ennemis, et la condamnation était assurée d'avance, Clemenceau fait ici allusion à la condamnation par la Haute Cour de justice, le 14 août 1889, de Boulanger, Rochefort et Dillon à la déportation dans une enceinte fortifiée..
Voilà ce que nous avons fait. Dans cet acte réfléchi, voulu, je revendique ma part de responsabilité et je ne regrette rien de ce que j'ai fait.
Vous souvenez-vous de l'état d'esprit de beaucoup de nos collègues à cette époque ? Oui, un jour néfaste est venu où nous avons eu peur pour la République et pour la patrie — nous pouvons le dire, c'est notre excuse.
… et, suivant le mot de Michelet, à l'heure où la France était aux frontières faisant face à l'ennemi, ils lui plantaient un poignard dans le dos. … c'est une besogne facile que de venir dire aujourd'hui à ces hommes qui ont fait la patrie, qui l'ont défendue, sauvée, agrandie : Sur tel point, à telle heure, vous avez été trop loin ! ». Oui ! il y a eu des victimes, des victimes innocentes de la Révolution, et je les pleure avec vous.
… Vous avez tort de rire, quand vos ancêtres massacraient les prisonniers républicains à Machecoul, quand Joubert, le président du district, avait les poings sciés, est-ce que ce n'étaient pas là des victimes innocentes ? Est-ce que vous n'avez pas du sang sur vous ?
Vous savez bien que la Terreur blanche a fait plus de victimes que l'autre.
… si vous voulez savoir pourquoi, à la suite de cet événement sans importance d'un mauvais drame à la Comédie Française, il y a eu tant d'émotion dans Paris, et pourquoi il y a à l'heure présente tant d'émotion dans la Chambre, je vais vous le dire.
C'est que cette admirable Révolution par qui nous sommes n'est pas finie, c'est qu'elle dure encore, c'est que nous en sommes encore les acteurs, c'est que ce sont toujours les mêmes hommes qui se trouvent aux prises avec les mêmes ennemis."
"Oui, ce que nos aïeux ont voulu, nous le voulons encore.
Aux élections générales de septembre-octobre 1889, le camp républicain s'unit contre la menace boulangiste et la droite. Clemenceau se présente de nouveau à Draguignan. Au premier tour, il obtient 7 500 voix sur 15 400 suffrages exprimés, face au boulangiste Achille Ballière, ex-déporté de Nouvelle-Calédonie, et au radical Louis Martin 3 500 voix. Par discipline républicaine, Martin se désiste et Ballière, bon perdant, se retire, permettant la réélection de Clemenceau le 6 octobre 1889, 9 500 voix sur 10 200 suffrages exprimés, l'abstention ayant augmenté au deuxième tour.
Le 29 janvier 1891, à l'occasion d'une interpellation du gouvernement au sujet de l'interdiction de la pièce de Victorien Sardou, Thermidor, Clemenceau fait son célèbre discours dans lequel il affirme : «la Révolution est un bloc.
Lors de la fusillade de Fourmies du 1er mai 1891, Clemenceau évoque un Quatrième État à propos des ouvriers et réussit à faire voter l'amnistie des manifestants arrêtés. Avec Millerand et Pelletan, il proposera, sans succès, une mesure similaire, à la suite de la grève des mineurs de Carmaux de 1892.
Le scandale de Panama
En 1892, Clemenceau est mis en cause dans l'affaire de Panama.
La première attaque vient de Gaston Calmette qui, le 12 décembre 1892, écrit sous pseudonyme un article dans Le Figaro, dans lequel il monte en épingle une rencontre, la veille de la mort de Jacques de Reinach, avec Clemenceau, Maurice Rouvier et Cornelius Herz. Rouvier avait en fait demandé à Clemenceau d'être son témoin pour cette réunion.
Ensuite, il est accusé par les boulangistes, Maurice Barrès, les antisémites, notamment La Libre Parole, Ernest Judet, propriétaire de l'influent Petit Journal, dont les attaques sont douteuses, du 19 août 1893, d'avoir frayé avec Cornelius Herz, d'origine juive, qui achetait les votes de certains députés et avait naguère investi dans La Justice. On intente un procès contre Clemenceau, de fausses preuves sont produites mais il est blanchi.
Néanmoins, le mal est fait, sa réputation est entachée, la revanche de ses nombreux adversaires est en marche. Le nationaliste Paul Déroulède l'accuse de corruption à la Chambre le 20 décembre 1892 et le provoque publiquement en duel. Le 22 décembre 1892, aucune des six balles tirées par chacun des adversaires ne fait mouche. Les témoins sont Barrès et Léon Dumonteil pour Déroulède, Gaston Thomson et Paul Ménard-Dorian pour Clemenceau.
Le journaliste Édouard Ducret va jusqu'à utiliser un faux pour faire accuser Clemenceau d'intelligence avec l'ennemi, en l'occurrence le Royaume-Uni, avec le relais de Lucien Millevoye. Ce dernier, qui accuse non seulement le député radical mais également Rochefort, est ridiculisé à la Chambre. Ducret et son complice, l'escroc Louis-Alfred Véron alias Norton, sont condamnés pour faux et usage de faux.
La campagne haineuse de 1893
Lors de la campagne électorale pour les législatives d'août-septembre 1893, l’opposition utilise abondamment la rhétorique de l’homme vendu aux puissances étrangères, de l’escroc, du parvenu… Il est soumis à une campagne particulièrement haineuse, dépassant de loin le département du Var. Ses ennemis, de gauche et de droite, forment même une Ligue anti-clemenciste, et Engelfred crée le 5 août un nouveau journal, L'Anti-Clemenciste. La presse, nationale et régionale, n'est pas en reste : le Petit Dracénois de Fortuné Rouvier se retourne contre lui, le Petit Journal, une puissance qui tire à un million d'exemplaires, continue sa campagne contre lui, de même que La Cocarde, Le Figaro, Le Petit Marseillais, La Croix, etc. Le marquis de Morès, fondateur avec Drumont de la Ligue antisémitique, se présente contre lui et l'accuse d'être un « agent de l'Angleterre.
En face, Clemenceau est moralement soutenu par Rochefort, Jaurès ou les mineurs de Carmaux. Le 8 août 1893, dans son discours de Salerne, il dénonce la meute lancée contre lui et demande : Où sont les millions ?
Le 20 août 1893, au premier tour, il obtient 6 634 voix : il est le mieux placé des dix candidats, mais en ballottage ; le 3 septembre, il est battu, n'obtenant que 8 610 voix contre 9 503 à l'avocat Joseph Jourdan, soutenu par une coalition hétéroclite de gauche et de droite
Affaire Dreyfus au Sénat 1893-1909 Clemenceau, l'écriture, question sociale
Cet échec électoral force Clemenceau à se mettre en retrait. Il s'appuie sur ses talents d'écriture ainsi que sur sa notoriété pour faire face à ses difficultés financières ; il a en effet des dettes pour La Justice, où il remplace Pelletan à la rédaction en chef à partir d'octobre 1893. Un nouveau duel - il en a eu 12 au total, considérant ceux-ci comme la marque de l’accomplissement de la liberté individuelle garantie par la République- l'oppose à Paul Deschanel, qui l'a de nouveau impliqué, sans preuves, dans l'affaire de Panama, le 27 juillet 1894. Deschanel est légèrement blessé.
Clemenceau profite de ce répit pour écrire dans La Justice une série d'articles, rassemblés en 1895 dans La Mêlée sociale, avec une préface qui décrit un processus de civilisation rigoureusement inverse à celui prôné par le darwinisme social ; le jeune Maurras, pas encore devenu royaliste, la dit d'une tumultueuse beauté. Il y dénonce les tarifs Méline de 1892 qui protègent les cultivateurs de blé, mais pas, selon lui, les petits propriétaires terriens ni les populations urbaines, assujetties à une hausse des prix. Il ne cesse d'appeler à la réforme sociale, mettant l'accent sur la misère à travers des faits divers ; il reprend, à propos du chômage, la phrase de Marx sur l'armée de réserve du travail. Il critique la répression des grèves, fait l'éloge de Louise Michel, critique l'évolution du christianisme, qui, d' insurrection des pauvres, est devenu un syndicat des riches.
Il s'indigne de l'appel à la foi[précision nécessaire], relayé par Jules Simon ou Zola, s'élève contre la propagande par le fait des anarchistes, rappelant une effroyable histoire de sang, de tortures et de bûchers, auprès desquels la bombe de Vaillant est une plaisanterie d'enfants !. Il compare la psychologie de ce dernier à celle de Robespierre qui voulait amener le règne de la vertu sur terre. Comme Jaurès, il s'oppose aussi à la peine de mort, décrivant par le détail l'exécution d'Émile Henry :
" Je sens en moi l'inexprimable dégoût de cette tuerie administrative, faite sans conviction par des fonctionnaires corrects. … Le forfait d'Henry est d'un sauvage. L'acte de la société m'apparaît comme une basse vengeance. "
Il s'oppose aux lois scélérates 1894, prenant la défense de l'ouvrage censuré de l'anarchiste Jean Grave, La Société mourante et l'anarchie.
Il s'attaque au libéralisme économique défendu par Léon Say, Yves Guyot et Leroy-Beaulieu :
" Qu'est-ce que votre laissez-faire, votre loi de l'offre et de la demande, sinon l'expression pure et simple de la force ? Le droit prime la force : voilà le principe de la civilisation. Dès que nous avons constaté votre loi, à l'œuvre contre sa barbarie!"
Contre l'individualisme libéral et la non-intervention de l'État d'un côté, contre le collectivisme de l'autre, il préconise les réformes sociales et l'impôt sur le revenu et sur la propriété67. Il ébauche néanmoins une possibilité d'entente avec Jaurès, affirmant que son programme n'est, en fait, que la reprise du programme radical-socialiste défendu par La Justice depuis quatorze ans.
Par ailleurs, d'août 1894 à 1902, il écrit dans La Dépêche de Toulouse, contrôlée par Maurice Sarraut, d'abord des chroniques littéraires, puis des articles politiques. Il collabore également au Journal de 1895 à 1897, à L'Écho de Paris 1897, devient éditorialiste à L’Aurore et à l'hebdomadaire Le Bloc. Il publie des recueils d'articles : Le Grand Pan 1896, dans lequel il fait l'apologie du paganisme précédant le judéo-christianisme ; Au fil des jours 1900 et Les Embuscades de la vie 1903. Il s'essaie même au roman, avec Les Plus Forts 1898. Ses essais littéraires, qui ne remportent guère de succès populaire, sont raillés par Barrès, Maurras étant plus indulgent. En revanche, Léon Blum est élogieux pour Le Grand Pan ainsi que pour son roman68. Il écrit aussi une pièce de théâtre, Le Voile du Bonheur, jouée au théâtre Récamier en 1901, mais sans grand succès.
L'affaire Dreyfus
C'est l’affaire Dreyfus qui permet à Clemenceau de revenir au premier plan. Entré comme rédacteur à L’Aurore en octobre 189769, il n’est au départ pas convaincu de l’innocence du capitaine Dreyfus, condamné au bagne en 1894. Approché par Mathieu Dreyfus, par Lucien Herr, le bibliothécaire de l'École normale supérieure, et par son ami Arthur Ranc, il va progressivement entrer dans l'Affaire.
Ranc l'envoie chez son vieil ami, dont il s'était éloigné, Auguste Scheurer-Kestner, vice-président du Sénat, qui a eu connaissance par Me Leblois du témoignage du lieutenant-colonel Picquart innocentant Dreyfus et accusant Esterhazy. Sans se prononcer sur l'innocence de Dreyfus, Clemenceau s'indigne contre le refus de transmettre les pièces du dossier à l'avocat de la défense, et va réclamer la révision du procès sur cette base. Loin de considérer que cela déshonore l'armée, il s'étonne au contraire que l'armée puisse ne pas être soumise à la justice ; il commence aussi à prendre conscience du rôle de l'antisémitisme.
C’est l’acquittement d'Esterházy, le 11 janvier 1898, qui déclenche la crise. Le 13 janvier, Zola publie « J'accuse…!, dont le titre a été trouvé par Clemenceau. Il lui dédicacera ainsi l'Iniquité : À Zola, pour l'avoir suivi dans la bataille ». La même année, il publie un ouvrage sur les mœurs de la communauté juive de Galicie, Au pied du Sinaï, qui, malgré les poncifs nez crochus,maîtres du monde, s'achève sur une note conciliante.
Il plaide ensuite dans le procès intenté à Zola et au journal, aux côtés de son frère, avocat. Le 23 janvier 1898, il lance le néologisme d'intellectuel :
" N'est-ce pas un signe, tous ces intellectuels, venus de tous les coins de l'horizon, qui se groupent sur une idée et s'y tiennent inébranlables ? "
Provoqué par Édouard Drumont, il défie celui-ci en duel le 26 février 1898, aucune des trois balles tirée par chacun ne touchant l'adversaire. Absorbé par l'Affaire, il décline la proposition qui lui est faite de se présenter dans le Var pour les législatives de mai 1898.
Depuis décembre 1897, il publie sans relâche : près de 700 articles dreyfusards publiés entre 1899 et 1903 sont réunis en sept volumes, L'Iniquité, La Honte, etc., articles qui seront des succès populaires, permettant au Tigre de rembourser la plupart de ses dettes. Malgré la réticence de son directeur Arthur Huc, il écrit également dans La Dépêche. C'est après la lecture publique des preuves alléguées contre Dreyfus, par le ministre de la Guerre Godefroy Cavaignac, le 7 juillet 1898, qu'il acquiert l'intime conviction de l'innocence du capitaine, sans toutefois changer sa ligne de défense.
Cloué au lit par une bronchite contractée à la station thermale de Carlsbad, il ne peut assister au procès de révision en août-septembre 1899 à Rennes, ouvert peu après la formation du gouvernement de Défense républicaine de Waldeck-Rousseau. Il recommande alors d'attaquer frontalement les militaires, ce qui n'est pas suivi par Me Demange. En septembre 1899, alors que Dreyfus a été de nouveau condamné pour trahison, mais avec circonstances atténuantes - jugement dont Clemenceau moque l'incohérence -, Waldeck-Rousseau envoie le ministre Millerand proposer à l'équipe dreyfusarde d'accepter de demander une grâce présidentielle. Contrairement à Jaurès, Clemenceau y est opposé, préférant la justice et la reconnaissance de droit de l'innocence de Dreyfus plutôt qu'un acte de clémence : dans une lettre à Me Labori, il avait souligné : Dreyfus n'est ici qu'un protagoniste symbolique. Il faut sauver tout ce que représente l'innocence aux abois.Cependant, interrogé par Mathieu Dreyfus, qui refuse de demander la grâce sans l'unanimité de l'équipe dreyfusarde, il lui laisse le champ libre. Le président Loubet signe le décret de grâce le 19 septembre 1899. Cinq jours plus tard, Clemenceau réitère ses convictions :
" Oh! je n'ignore pas qu'on va poursuivre la réhabilitation de Dreyfus devant la Cour de cassation. … Mais au-dessus de Dreyfus - je l'ai dit dès le premier jour - il y a la France, dans l'intérêt de qui nous avons d'abord poursuivi la réparation du crime judiciaire. La France à qui les condamnations de 1894 et de 1899 ont fait plus de mal qu'à Dreyfus lui-même."
Dreyfus est réhabilité le 12 juillet 1906 par un pourvoi en cassation ; ainsi, comme le préconisait l'avocat à la défense Maître Henri Mornard, le conseil de guerre de Rennes a été annulé sans renvoi : attendu en dernière analyse que de l'accusation portée contre Dreyfus rien ne reste debout ; il est décoré le même jour par le général Gillain.
Clemenceau s'oppose à la loi d'amnistie du 14 décembre 1900, qui concerne aussi bien le général Mercier que Picquart et Zola.
En décembre 1899, Clemenceau quitte L’Aurore, indigné par un article d'Urbain Gohier qui se vantait d'avoir à lui seul défendu Dreyfus. Il crée alors un nouvel hebdomadaire : Le Bloc, qu'il rédige quasiment en entier. Il s'attaque à nouveau au colonialisme, s'intéressant en particulier au cas de l'Indochine, et critiquant au passage les missionnaires. Ce journal paraît jusqu’au 15 mars 1902.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=7224#forumpost7224
Liens
http://youtu.be/pENOrVi7ByM Secrets d'Histoire
http://youtu.be/u-K99_0J5h8 Clémenceau contre la paix 4
http://youtu.be/JU7QuvHzU2E Clémenceau visite Oostkerke et Forthem
http://youtu.be/nNrm8q_0OlE Clémenceau courte biographie
http://youtu.be/3E3ewmUJUDc Clémenceau 3
http://youtu.be/zMWSAr59DZQ Clémenceau briseur de grève
http://youtu.be/_TcVHoq7Iv4 Georges Clémenceau aux états-unis
Posté le : 16/11/2014 17:51
Edité par Loriane sur 17-11-2014 11:36:11
Edité par Loriane sur 19-11-2014 17:49:50
|
|
|
|
|
Georges Clémenceau 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le sénateur : anticléricalisme et anticolonialisme 1902-1906
Après dix ans d'absence, son retour à la vie parlementaire s'appuie sur ses nombreuses amitiés, mais aussi sur les résultats de ses campagnes d'agitation en faveur d'Alfred Dreyfus. Lorsqu'une place de sénateur inamovible se libère, ce qui provoque une élection partielle dans le Var, nombreux sont ceux qui l’incitent à poser sa candidature et se déclarent prêts à la soutenir. Réticent au départ, Clemenceau se laisse finalement convaincre par son éditeur, Stock, et surtout la délégation varoise menée par le maire de Draguignan. Une autre raison est que le général Mercier, ennemi acharné lors de l'Affaire Dreyfus, s'est fait élire sénateur. La décision du Tigre est saluée par Jaurès.
Bien que Clemenceau ait affirmé antérieurement son radicalisme et son socialisme, il reste à l'écart du nouveau Parti radical-socialiste, créé en 1901, ce qui ne l'empêche pas d'être soutenu dans le Var par les radicaux d'une part, des républicains indépendants d'autre part.
Le 6 avril 1902, le radical hostile au bicamérisme, qui dénonçait le Sénat comme une institution antirépublicaine vingt ans plus tôt est triomphalement élu avec 344 voix sur 474 votants, contre 122 pour son rival, un conseiller général radical-socialiste. Les législatives d'avril-mai 1902 voient la victoire du Bloc des gauches et la formation du cabinet Emile Combes.
Après la réaction cléricale et militariste provoquée par l'Affaire Dreyfus, l'ordre du jour républicain n'est autre que la séparation des Églises et de l'État revendiquée par le Tigre depuis des décennies. Cependant, dès la rentrée, son discours du 30 octobre 1902 étonne l'assemblée. Constituant selon l'historien Michel Winock une des bases de la philosophie républicaine en matière de laïcité et d'éducation, ce discours critique férocement la « politique romaine et le gouvernement romain, distingué de la religion catholique romaine, ces deux composantes formant l'Église romaine. Alors que la loi 1901 sur les associations visait uniquement les congrégations religieuses non autorisées, il pourfend la théocratie catholique et réclame la suppression pure et simple au nom de la liberté des congrégations religieuses, législativement » supprimées depuis 1790 :
Retirés du monde, les moines sont partout répandus dans le monde. La congrégation plonge ses racines dans tous les compartiments de l'État, dans toutes les familles. Et de toute sa puissance, elle enserre pour notre malheur cette société moderne, ce progrès, ce libéralisme que le Syllabus a condamné.
Il défend cependant la liberté d'enseignement, contestant, à l'encontre de Ferdinand Buisson qu'il cite et de la gauche républicaine, l'intérêt pour l'État du monopole de l'éducation :
l'État, au lieu de s'immobiliser dans le monopole, recevra de ses concurrents l'impulsion nécessaire à son propre développement d'éducateur.
Le Temps s'alarme de ce regain de jacobinisme tandis que Péguy, pas encore converti, publie ce discours dans les Cahiers de la quinzaine, avec le titre : Discours pour la liberté.
Il participe finalement à la chute du cabinet Combes, à la fois en raison de l'affaire des fiches et de la non-dénonciation du Concordat qui aurait dû, selon lui, être l'aboutissement de la crise provoquée par le voyage du président Loubet à Rome.
En avril 1905, lors des débats sur la loi de séparation des Églises et de l'État, Clemenceau passe à nouveau à l'attaque, cette fois-ci contre Aristide Briand et Jean Jaurès ; il s'oppose à leur frilosité à propos de l'article 4, qui concerne la dévolution de la propriété ecclésiastique aux associations cultuelles. Alors que le catholique Albert de Mun se félicite de ce grand coup donné à la loi, Clemenceau traite Briand de socialiste papalin et accuse la nouvelle formulation de l'article de mettre la société cultuelle dans les mains de l'évêque, dans les mains du pape ; voulant rompre le Concordat, la Chambre des députés est demeurée dans l'esprit du Concordat … au lieu de comprendre qu'elle aurait pour premier devoir d'assurer la liberté de tous les fidèles, sans exception. Malgré cela, il vote la loi. Le 30 septembre 1906, la séparation de l'Église et de l'État constitue le deuxième thème de son discours à la Roche-sur-Yon.
Pas plus que sur l'anticléricalisme, revigoré par l'Affaire, Clemenceau ne cède quoi que ce soit sur le colonialisme. Dans L'Aurore du 13 juin 1904, il critique la domination française sur le Maroc, et se moque, le 2 avril 1905, au moment de la crise de Tanger, de la politique de l'inamovible ministre des Affaires étrangères, Théophile Delcassé :
" Les politiques républicains, trouvant plus aisé de remporter des victoires sur les populations désarmées de l'Afrique et de l'Asie que de s'adonner à l'immense labeur de la réformation française, envoyaient nos armées à des gloires lointaines, pour effacer Metz et Sedan, trop prochains. Une effroyable dépense d'hommes et d'argent, chez une nation saignée à blanc, où la natalité baissait. … Partis de France dans l'illusion qu'à la condition de tourner le dos aux Vosges, le monde s'ouvrait à nous, nous rencontrons l'homme de l'autre côté des Vosges devant nous à Tanger."
La volonté de protéger le pays n'est jamais loin : Être ou ne pas être, voilà le problème, qui nous est posé pour la première fois depuis la guerre de Cent Ans, par une implacable volonté de suprématie.L'Aurore, 18 juin 1905. Il s'éloigne de Jaurès, entré aux côtés de Jules Guesde à la SFIO, et critique l'internationalisme de Gustave Hervé dans Pour la patrie 12 mai 1905 :
ils comprendraient peut-être que la nature humaine est à la racine de tous les faits sociaux, bons ou mauvais, et que la suppression de la patrie ne détruirait point le fondement universel de l'égoïsme humain, ne changeant que la forme des manifestations de violence inhérentes à l'homme, seul ou associé.
Clemenceau au pouvoir Le premier flic de France 1906
En mars 1906, après la victoire des radicaux aux législatives, Ferdinand Sarrien est appelé à former le cabinet. Clemenceau ironise : Ça, rien ? Tout un programme!. Mais Briand, qui doit encore négocier les inventaires de l'Église, préfère l'avoir avec lui plutôt que contre lui, et subordonne sa participation à celle de Clemenceau89 : ce dernier obtient ainsi l'Intérieur, alors que la France connaît une vague de grèves importantes, parfois quasi-insurrectionnelles, la CGT a entériné son orientation syndicaliste révolutionnaire avec la Charte d'Amiens, tandis que la SFIO est sur une position révolutionnaire et anti-réformiste bourgeoise, malgré les hésitations de Jaurès. Je suis le premier des flics, dit-il alors.
Place Beauvau, Clemenceau calme le jeu sur la question des inventaires : le 20 mars 1906, alors qu'il ne reste plus à inventorier que 5 000 sanctuaires sur 68 000, il déclare à la Chambre : Nous trouvons que la question de savoir si l'on comptera ou ne comptera pas des chandeliers dans une église ne vaut pas une vie humaine.
Confronté à la grève qui fait suite à la catastrophe de Courrières, plus de 1 000 morts, il refuse d'envoyer, comme c'est l'usage, la troupe de façon préventive, c'est-à-dire dès que la grève se déclare, mais se rend à Lens dès le 17 mars, et affirme aux grévistes que leur droit à faire grève sera respecté, sans envoi de la troupe, tant qu'aucune personne ni propriété ne sera menacée. Les grévistes s'échauffant, il se résout à envoyer une troupe de 20 000 soldats le 20 mars ; le Temps, 22 mars est rassuré89. Cette décision marque le début du divorce entre Clemenceau et la gauche socialiste, révolutionnaire et syndicaliste.
La grève fait tache d'huile, atteignant Paris : L'Écho de Paris titre Vers la révolution. À l'approche du 1er mai 1906, Clemenceau avertit Victor Griffuelhes, secrétaire général de la CGT, qu'il sera tenu responsable pour tout débordement, et fait arrêter préventivement plusieurs militants d'extrême-droite, laissant entendre la préparation d'un complot. Il fait aussi venir 45 000 soldats à Paris : la fête du Travail, sous haute surveillance policière, se déroule dans le respect de l'ordre et de la propriété. En juin 1906, une joute l'oppose à Jaurès à la Chambre pendant six jours.
Le 18 octobre 1906, Sarrien, malade, recommande Clemenceau au président Fallières pour lui succéder.
Le gouvernement Clemenceau 1906-1909
Il accède à la présidence du Conseil le 25 octobre 1906, à 65 ans, et restera au pouvoir presqu'aussi longtemps que Waldeck-Rousseau. Son cabinet comprend le socialiste indépendant René Viviani, à la tête d'un Ministère du Travail inédit, le général Picquart, qui avait dévoilé la supercherie accusant Dreyfus, comme ministre de la Guerre, et son ami journaliste et diplomate Stephen Pichon à la tête du quai d'Orsay. Conformément à l'habitude de cumuler la présidence du Conseil avec un portefeuille ministériel, Clemenceau demeure à l'Intérieur. Enfin, il maintient Briand à l'Instruction publique et aux Cultes.
Son programme ministériel, dévoilé le 5 novembre 1906 à la Chambre, vise à maintenir la paix avec l'Allemagne, tout en réformant l'armée afin de préparer la France à un éventuel conflit. Sur le plan social, il déclare vouloir accomplir la réalisation de la loi sur les retraites ouvrières, la loi sur les 10 heures, améliorer la loi Waldeck-Rousseau sur les syndicats, racheter la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest en quasi-faillite, intervenir dans le contrôle de la sécurité dans les mines avec possibilité de rachat des compagnies houillères, préparer un projet de loi sur l'impôt sur le revenu… 17 chantiers sont ainsi lancés.
La séparation de l’Église et de l’État
Le sujet prioritaire, c'est toutefois l'application de la loi de séparation des Églises et de l'État, fermement condamnée par Pie X dans l'encyclique Vehementer nos. Cela soulève de nouveaux débats, le Vatican faisant tout pour empêcher la formation des associations cultuelles, auxquelles sont censées être dévolues les biens de l'Église. Attaqué par Maurice Allard, Briand rétorque le 9 novembre 1906 en rappelant que la loi de séparation est une loi d'apaisement, que l'État laïc n'est pas antireligieux mais areligieux. Si la loi n'est pas appliquée d'ici décembre 1907, Briand déclare qu'il s'appuiera sur la loi de 1881 sur les réunions publiques afin de maintenir la possibilité d'un exercice légal des cultes. Par circulaire du 1er décembre 1906, il précise qu'une déclaration annuelle doit suffire à cet exercice. Le 11 décembre, le Conseil des ministres rappelle qu'en cas de non-déclaration annuelle, les infractions seront constatées : l’intransigeance pontificale menace de créer un délit de messe. Mgr Carlo Montagnini, à la tête de la Nonciature apostolique de la rue de l’Élysée, est expulsé sous l'accusation d’inciter au conflit.
Le 21 décembre 1906, un nouveau débat, durant lequel Briand accuse le Vatican de préconiser l’intransigeance afin de réveiller la foi endormie dans l’indifférence , aboutit à la loi du 2 janvier 1907 qui vise à rendre impossible la sortie de la légalité des catholiques quoi que fasse Rome. Le pape la dénonce à nouveau, le gouvernement parle d'ultimatum… et finalement, par la loi du 28 mars 1907, autorise les réunions publiques, sans distinction d'objet, et sans déclaration préalable. La position d'apaisement du gouvernement est confirmée par la loi du 13 avril 1908, qui considère les églises comme des propriétés communales et prévoit des mutualités ecclésiastiques,pour les retraites, etc.. Ces mesures ne seront cependant acceptées par le Vatican qu'après la Première Guerre mondiale avec le compromis, élaboré par Pie XI et le gouvernement français, des associations diocésaines.
Clemenceau, briseur de grèves
L'article a aussi été publié dans la Neue Freie Presse. Il était nécessaire que Clemenceau devînt chef du gouvernement puisqu'il était chef du parti radical, qui forme la majorité de la Chambre. … J'ai souhaité son avènement aux affaires …Je suis plus socialiste que jamais. … Ce sera l'éternel honneur de Clemenceau d'avoir secoué l'égoïsme bourgeois des opportunistes. … Et quand Jules Ferry, abandonnant jusqu'aux apparences de l'anticléricalisme, s'allia avec le clergé dans des entreprises coloniales, fructueuses seulement pour quelques capitalistes privilégiés …, Clemenceau, au risque de perdre sa popularité, s'éleva contre un système de conquêtes lointaines … Si l'on regarde aux dangers que courra bientôt le ministère … Les dangers qui viennent de lui-même ne sont pas les moindres. D'esprit, il est souple et divers ; de caractère, il est vif et cassant. Je ne le fâcherai pas en disant qu'il y a des choses qu'il préfère au pouvoir. Il a le sens de l'action … il est philosophe … ministre de l'Intérieur, il était déjà tout le ministère avant d'en être le chef. Alors il a opposé aux socialistes les doctrines d'un agnosticisme social sans doute grave et mélancolique Bien qu'il n'ait jamais varié dans ses doctrines … et qu'il soit, aujourd'hui comme en 1870, républicain libéral et patriote, il surprend par l'imprévu de ses idées. …]Libéral de naissance … il est, de caractère et d'esprit, homme d'autorité. Il est révolutionnaire et il exècre la démagogie … Le journal Le Temps chaque jour vante sa sagesse, le loue de sa modération … le compromet ainsi chaque jour, le rend suspect aux yeux des républicains radicaux. Le côté faible de Clemenceau, c'est son indépendance … Il est libéral, mais il ne l'est pas comme eux. … Il faudra bien que Clemenceau, bon gré mal gré, réforme le bloc des gauches, sans quoi, pris entre l'extrême gauche et la droite, il est perdu.
Une journée sanglante, Le Matin du 31 juillet 1908.
Président du Conseil le plus à gauche qu'ait connu jusqu'alors la IIIe République, mais « premier flic de France, Clemenceau est confronté à d'importantes grèves 1906 bat des records. Il s'illustre par sa férocité, à la fois contre les mouvements sociaux et contre le personnel politique qu'il estime peu quand il ne l'accable d'un profond mépris - ainsi quand il décide de retirer le portefeuille des Finances au vieux président Ribot : Il est voûté, mais ce n'est pas un abri sûr.
C'est d'abord, en mars 1907, une grève des électriciens à Paris. Le génie militaire rétablit le courant. En avril, une grève de l'alimentation, lancée par la CGT, touche Paris. La fonction publique réclame le droit de grève,la Poste le 12 mars 1909, inimaginable pour Clemenceau. Des dizaines de postiers, ainsi que Marius Nègre, fondateur du Syndicat national des instituteurs, et le syndicaliste révolutionnaire Émile Janvion sont ainsi révoqués. La Ligue des droits de l'homme apporte son soutien aux révoqués.
Au printemps 1907, la révolte des vignerons du Languedoc s'étend à l'ensemble de la population de la région et prend une tournure insurrectionnelle. Le 10 juin 1907, le maire socialiste de Narbonne, Ernest Ferroul, démissionne, avec l'appui des maires locaux. Les viticulteurs réclament des aides équivalentes à celles accordées aux betteraviers du nord. Cinq ou six manifestants sont tués le 20 juin97, la préfecture de Perpignan est incendiée, et le lendemain, le 17e régiment se mutine.
Le 21 juin, la Chambre confirme son appui à Clemenceau. Le 23, il reçoit le leader gréviste et non-violent, Marcelin Albert. Et, comme celui-ci, venu en train, lui dit candidement n'avoir pas de quoi payer son billet de retour, il lui fait remettre 100 francs, après avoir placé un journaliste dans la pièce voisine de son bureau. La Presse, faisant ensuite passer Albert comme "acheté" par le ministre, le discrédite auprès des vignerons... La grève s'essouffle, et le 29 juin 1907, la Chambre vote la loi revendiquée, qui fixe une surtaxe sur les sucres utilisés pour la chaptalisation.
En juillet 1907, deux grévistes sont tués à Raon-l'Étape.
L'année suivante, il est confronté à la grève de Draveil-Villeneuve-Saint-Georges : deux grévistes tués le 28 mai 1908. Le socialiste Édouard Vaillant accuse la politique du gouvernement d'être responsable du meurtre. Clemenceau rétorque : la Chambre …dira si elle veut faire avec nous l'ordre légal pour les réformes contre la révolution. Hormis les socialistes, la majorité le soutient. Le conflit redémarre le 2 juin 1908 à Vigneux, où deux grévistes sont tués et plusieurs blessés : il s'agit de la violence policière la plus grave depuis le début de la IIIe République, dans la mesure où les gendarmes ont tiré à bout portant dans une salle, sur des ouvriers désarmés et accompagnés de femmes et d'enfants. Le 30 juillet, toujours à Vigneux, quatre grévistes sont tués et il y a plusieurs blessés du côté des forces de l'ordre.
Clemenceau décide alors des arrestations massives dans les rangs de la CGT, Griffuelhes, Pouget, etc., malgré l'attitude conciliante du secrétaire général. Des rumeurs insistantes feront état d'un agent provocateur qui aurait été utilisé par Clemenceau pour dissoudre la CGT anarcho-syndicaliste qu'il abhorrait. Bien que l'existence d'un tel agent soit avérée, elle sera l'objet d'une interpellation de Caillaux en 1911, l'enquête historique de Jacques Julliard, Clemenceau, briseur de grèves, relativise son importance dans les événements : comme le disait Péricat, le secrétaire de la Fédération du bâtiment, surestimer son rôle serait faire bien peu de cas de la Fédération du bâtiment, de son Comité fédéral et de ses militants.
En fin de compte, Clemenceau, tout comme Viviani, préfèrerait plutôt favoriser une tendance moins dure à la CGT, poussant à ce que celle-ci abandonne le vote par membres un membre = une voix au profit d'un vote par syndicat, une fédération = une voix.
Il est également confronté à des grèves d'employés voulant faire appliquer la loi sur le repos hebdomadaire votée sous Sarrien, notamment dans le secteur de la boulangerie.
Il devient rapidement ami avec le préfet de police Lépine — alors qu'ils ne s'aimaient guère au départ — et conduit d'importantes réformes de la police. Alors que la presse s'effraie des Apaches, il soutient la création de la Police scientifique par Alphonse Bertillon, un des experts de l'Affaire Dreyfus, et des Brigades du Tigre officiellement : brigades régionales mobiles par Célestin Hennion, nommé à la tête de la nouvelle Sûreté générale104. Hennion met en place un fichier des récidivistes et crée un service d'archives, tandis que les Brigades régionales fichent les nomades. Le projet de loi du 25 novembre 1908 relatif à la réglementation de la circulation des nomades aboutira à la loi du 16 juillet 1912 sur le port du carnet anthropométrique d’identité : recensant les empreintes digitales ; ce carnet, qui ne s'applique qu'aux Tsiganes, préfigure la carte d'identité105 et le livret de circulation.
Le cabinet Clemenceau ne se résume cependant pas à la répression. L'abolition de la peine de mort est mise à l'ordre du jour de la Chambre le 3 juillet 1908, à la suite d'une intervention de Joseph Reinach. Le gouvernement est pour, ainsi que Jaurès, Briand et l'abbé Lemire ; mais la commission parlementaire est contre et son rapport est approuvé le 8 décembre 1908 par une majorité rassemblant le centre et la droite catholique. Le projet de loi sur l'impôt sur le revenu, présenté en février 1907 par le ministre des Finances Joseph Caillaux, est bloqué par le Sénat. En revanche, la loi Ribot sur les Habitation à bon marché HBM est votée en avril 1908, puis, en juillet 1909, la loi sur le bien de famille insaisissable, qui vise à protéger les paysans. Zola est transféré au Panthéon.
La posture de premier flic de France l'amène à se brouiller durablement avec Jaurès, qui n'écartait pas, au début de son cabinet, une possibilité d'alliance avec le leader radical. La SFIO et la CGT ne sont clairement pas sur la même ligne que le radical-socialisme de Clemenceau. D'où cet échange savoureux au Parlement :
" Monsieur Jaurès, vous promettez tout à l'ouvrier, mais vous n'êtes tout de même pas le bon Dieu !
- Et vous, vous n'êtes pas le Diable !
- Qu'en savez-vous ? "
Politique étrangère et coloniale
En politique extérieure, Clemenceau et Pichon se soumettent aux résultats de la Conférence d'Algésiras et probablement aussi à l'influence du parti colonial. En effet, lorsqu'en mars 1907 un médecin est assassiné au Maroc, il ordonne un débarquement et autorise le général Lyautey à occuper Oujda. Le 30 juillet 1907, plusieurs Français sont tués lors d'une émeute consécutive à la décision de faire passer un chemin de fer à travers un cimetière musulman. Cela finit par un bombardement de Casablanca en août puis par l'occupation de Settat. Ces incidents, comme ils sont qualifiés en France… suscitent aussi quelques remous avec l'Allemagne. En 1908, une querelle franco-allemande au sujet de la désertion de soldats de la Légion étrangère finit par un arbitrage de la Cour de La Haye, qui donne raison à la France le 22 mai 1909. Le 9 février 1909, par un accord franco-allemand, Paris s'engage à accorder l'égalité de traitement aux ressortissants allemands au Maroc, tandis que Berlin reconnait la légitimité de la France à s'octroyer le maintien de l'ordre dans le pays.
En revanche, un décret du 24 septembre 1908 propose une timide réforme en Algérie, avec l'élection des conseillers généraux indigènes, jusque là nommés par le gouverneur. En octobre 1908, une délégation des Jeunes Algériens vient réclamer la reconnaissance de l'ensemble des droits civils et politiques pour les Algériens évolués ». Clemenceau se heurte à ce sujet aux Européens d'Algérie ; il se rattrapera avec la loi du 4 février 1919, louée par Messali Hadj.
Delcassé fait tomber Clemenceau
Clemenceau est renversé au bout de presque trois ans, alors que la session parlementaire touche à sa fin et qu'un grand nombre de députés de la majorité sont rentrés dans leurs circonscriptions. Le 20 juillet 1909, Clemenceau se refuse à répondre à des questions d'ordre technique sur la Marine posées par son rival Delcassé, qui a fait tomber le ministre Gaston Thomson l'année précédente ; il fait voter un ordre du jour. Celui-ci est repoussé par 212 voix contre 176, avec 176 absents dont 76 radicaux-socialistes et 23 républicains de gauche et Clemenceau démissionne. En effet, furieux, il a révélé à la Chambre que les ministères de la Guerre et de la Marine considéraient, lors de la crise de Tanger, que la France n'était pas prête à la guerre, ce qui équivalait à révéler des informations confidentielles presque de l'ordre du secret défense. Dans sa biographie, Jean-Baptiste Duroselle écrit : la chute du gouvernement Clemenceau présenta un caractère accidentel et fut liée à une incontestable maladresse tactique de sa part. Le 21 juillet 1909, L'Humanité titre : La fin d'une dictature .
Le journalisme et l'Amérique latine
Le docteur Domingo Cabrel, qui a installé une clinique psychiatrique à ciel ouvert, dans la localité d'Open Door, Buenos Aires, visitée et louée par Clemenceau. Cabred fut l'un des premiers à plaider pour l'irresponsabilité pénale en matière psychiatrique lors du Congrès national d'anthropologie criminelle de Genève de 1898.
Les années 1909-1912 constituent dans sa carrière une période d'accalmie. Le 10 avril 1910 paraît le premier numéro du Journal du Var dont il est le créateur. Il se détache peu à peu de cette publication pendant les deux années qui suivent.
Le 30 juin 1910, il embarque sur le Regina Elina pour effectuer en Amérique latine Argentine, Uruguay, Brésil une tournée de conférences destinées à renflouer son portefeuille ; il y fait l'apologie du régime parlementaire. L'Illustration, ainsi que le New York Times, rend compte de la tournée et publie ses Notes de voyage. En Argentine, qui fête un siècle d'indépendance et s'apprête à voter la loi Sáenz Peña établissant le scrutin universel secret, le Tigre rencontre Villanueva, président du Sénat argentin, et fait l'éloge des indigènes locaux, du moins des survivants…. Il y assiste avec intérêt à une conférence sur la justice social du criminologue Enrico Ferri. Il fait l'éloge des systèmes scolaires, il remarque que la séparation entre l'Église et l'État existe presque entièrement de fait et pénitentiaire ainsi que des hospices ; il les juge bien meilleurs que leurs équivalents français, tout en soulignant certaines limites matérielles de l'Instruction publique. De même, il est étonné par la modernité du système de santé ; il critique l'enfermement psychiatrique, tel qu'il l'a connu à l'asile de Sainte-Anne, en comparaison avec le traitement en extérieur, accompagné d'essais de réinsertion, pratiqué par le docteur Cabred.
Revenu en Europe à bord du Principe Umberto, il doit passer devant une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Rochette une sorte de chaîne de Ponzi qui avait suscité de nouvelles piques anti-parlementaires de Barrès, mais est blanchi de tout soupçon, ainsi que le préfet Lépine.
En 1912, il subit aussi une opération risquée de la prostate, dont il sort en meilleure forme. Après la crise d'Agadir, il vote, avec une quarantaine d'autres sénateurs, contre la ratification de la convention franco-allemande : nous voulons la paix … Mais … si on nous impose la guerre, on nous trouvera. Clemenceau, sans être devenu revanchard, est désormais convaincu de la réalité de la Weltpolitik allemande.
À la suite de l'élection présidentielle de janvier 1913, il se brouille de nouveau avec Raymond Poincaré, président du Conseil depuis 1912, qui ne s'étant pas retiré devant le candidat choisi par le camp républicain, Jules Pams, a été élu en s'appuyant sur la droite.
En mars 1913, il fait tomber le cabinet Briand en tant que président de la Commission sénatoriale chargée d'examiner le projet de loi, complexe, sur le scrutin proportionnel, destiné à remplacer le scrutin d'arrondissement, voté par la Chambre le 10 juillet 1912. Clemenceau, bien que critique à l'égard de ce dernier, considère celui-là comme propice au césarisme et s'oppose au changement. Le Sénat le suit 161 contre 128 et Briand démissionne : c'est le second cabinet de la IIIe République, depuis celui de Léon Bourgeois 1896, à être renversé par le Sénat.
L'Homme, libre ou enchaîné ? La guerre Première Guerre mondiale.
Le 6 mai 1913 paraît le premier numéro de L’Homme libre, journal édité à Paris. Il y publie quotidiennement son éditorial, et ne cesse d'avertir la France du danger que constitue l'Allemagne, Pour la défense nationale, 21 mai 1913 ; Vouloir ou mourir, 24 mai ; Ni défendus ni gouvernés, 15 juillet, etc.. Il défend avec ardeur la loi des trois ans, qui accroît la durée du service militaire, et qui est votée le 19 juillet 1913 avec l'appui de la droite contre les deux-tiers des députés radicaux-socialistes.
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en juillet 1914, Clemenceau défend dans son journal l'Union sacrée et la prééminence des civils sur l'état-major. Déterminé à se battre, il est loin de l'optique de la fleur au fusil : La parole est au canon … Et maintenant, aux armes ! Tous. J'en ai vu pleurer, qui ne seront pas des premières rencontres. Le tour viendra de tous.… Mourir n'est rien. Il faut vaincre.L'Homme libre, 5 août 1914. Le 26 août 1914, il refuse la proposition de Briand d'entrer dans le cabinet Viviani : il ne veut rien d'autre que la présidence du Conseil !
Il va jusqu'à reprocher au ministre Malvy de n'avoir pas arrêté les militants fichés au carnet B, alors que la quasi-totalité de la gauche socialiste s'est ralliée à l'Union sacrée. Après qu'il a dénoncé les insuffisances du service sanitaire aux armées, qui fait voyager les blessés dans les mêmes wagons que des chevaux atteints du tétanos, son journal est suspendu par Malvy du 29 septembre au 7 octobre 1914, en application de la loi du 4 août qui réprime les indiscrétions de la presse en temps de guerre. Le journal reparaît le 30 septembre sous le titre L'Homme enchaîné ; immédiatement saisi, il reparaîtra sous ce nouveau nom le 8 octobre à Paris. Son quotidien sera à nouveau suspendu en août 1915. Clemenceau enverra alors les articles aux parlementaires.
Pendant les années qui suivent, Clemenceau s’emploie à critiquer l’inefficacité du gouvernement, l'insuffisance des informations qu’il transmet, le défaitisme, l'antimilitarisme et le pacifisme, et défend sans cesse le patriotisme et l'Union sacrée face aux Allemands. Siégeant à la Commission des Affaires étrangères du Sénat et à la Commission de l'Armée, il en devient rapidement président, distribuant rapports et blâmes au ministère, effectuant de multiples visites au front en sa qualité de président de la Commission de l'Armée. Il affirme la légitimité du contrôle du Parlement sur les actes du gouvernement et la conduite de la guerre : Il n'est bon pour personne de n'être pas contrôlé, critiqué ; cela n'est que trop vrai, même et surtout du haut commandement militaire.
En juillet 1915, son secrétaire Léon Martin ayant été envoyé au front, il est remplacé par le poète Jean Martet.
Il siège au sein des comités secrets du Sénat réunis à partir de juin 1916, alors que la bataille de Verdun fait rage. Trois jours après la première réunion du comité secret, il fait partie avec son ami Stephen Pichon des 16 sénateurs qui refusent de voter la confiance au gouvernement Briand. Au lendemain d'une nouvelle réunion, il présente au Sénat, le 24 décembre 1916, un ordre du jour refusant la confiance à Briand, mais celle-ci est votée 194 voix contre 60.
Malgré son patriotisme, Clemenceau reste attaqué par certains royalistes. Ainsi, le 30 août 1916, Léon Daudet, fils de l'écrivain Alphonse, lui adresse cette lettre ouverte : Oh ! Comme je vous connais ! Votre élément, c'est le désastre national à condition de pouvoir y faire des mots. Vous appartenez à la génération absurde et aveugle qui, en 1870-71, guettait une ascension politique sur les malheurs de la patrie. Il est toutefois soutenu par Barrès.
À l'entrée en guerre des États-Unis, avril 1917, il déclare sans prévoir l'évolution des événements en Russie ni le traité de Brest-Litovsk d'avril 1918 :
" Le suprême intérêt des pensées générales par lesquelles le président Wilson a voulu justifier l'action de son pays, c'est que la révolution russe et la révolution américaine se complètent à miracle pour fixer définitivement toute la portée idéaliste du conflit. Tous les grands peuples de la démocratie, c'est-à-dire du juste droit pour tous, ont désormais pris, dans la lutte, la place qui leur était destinée.
Le 22 juillet 1917, lors d'une interpellation concernant l'offensive Nivelle, il fait pendant deux heures et demie une critique acharnée de Malvy ; ce discours, applaudi au Sénat, est reproduit en plusieurs éditions par L'Homme enchaîné du 23 juillet puis diffusé en brochure sous le titre L'Antipatriotisme au Sénat. Malvy démissionne un peu plus tard, ce qui entraîne la chute du cabinet Ribot septembre 1917, remplacé par Painlevé.
Le président du Conseil, le Père la Victoire 1917-1920 1ère Guerre mondiale.
L’homme enchaîné garde son nom jusqu’à l’accession de Clemenceau à la Présidence du Conseil, le 16 novembre 1917. Le 13 novembre en effet, le gouvernement Painlevé tombe et le président Poincaré doit rapidement lui trouver un successeur. Il aurait eu alors à choisir entre Joseph Caillaux et Clemenceau. Bien qu'il n'aime guère Clemenceau, il préfère celui-ci, favorable à une victoire militaire et dont la force morale l'impressionne, plutôt que Caillaux, partisan d’une paix de compromis mais accusé d'intriguer contre la France en faveur de l'Allemagne. Dès janvier 1917, Charles Ier d'Autriche avait entamé des pourparlers de paix secrets avec Poincaré qui se montre enthousiaste et prêt à faire des concessions, colonies et avantages commerciaux à l'Allemagne. Clemenceau, belliciste souhaitant la guerre jusqu'au bout, refuse cette paix négociée, prétextant que c'est un piège tendu par l'Allemagne.
À 76 ans Clemenceau devient ainsi à nouveau président du Conseil, malgré l'opposition de Briand et des socialistes (Marcel Sembat affirme à Poincaré que sa nomination susciterait un soulèvement immédiat. Hormis la presse socialiste, les journaux acclament sa nomination, jusqu'au New York Times, dithyrambique.
Son gouvernement est essentiellement composé de proches et de figures qui s'effacent derrière lui : Stephen Pichon aux Affaires étrangères, Jules Pams à l'Intérieur, Georges Leygues à la Marine, Louis Loucheur à l'Armement. Son ami Georges Mandel devient chef de cabinet et Jules Jeanneney sous-secrétaire d'État à la présidence ; dans son cabinet se trouve aussi Georges Wormser, son futur biographe. En novembre 1919, il fera entrer André Tardieu au gouvernement ; celui-ci restera un ami proche jusqu'à son entrée dans le Gouvernement Poincaré dans les années 1920. Lui-même se réserve le portefeuille de la Guerre, La Guerre ! C'est une chose trop grave pour la confier à des militaires !", avait-il dit en 1887 lors de l'affaire Schnæbelé. Il s'y adjoint les services du général Henri Mordacq, qui devient son chef de cabinet militaire et véritable bras droit pour les questions militaires.
Le 20 novembre 1917, il annonce à la Chambre son programme de gouvernement : Vaincre pour être juste, voilà le mot d'ordre de tous nos gouvernements depuis le début de la guerre. Ce programme à ciel ouvert, nous le maintiendrons. Il rend hommage aux poilus comme au courage de l'arrière : ces silencieux soldats de l'usine, sourds aux suggestions mauvaises, ces vieux paysans courbés sur leurs terres, les robustes femmes de l'arrière et ces enfants qui leur apportent l'aide d'une faiblesse grave. Mais il affirme également la fin des campagnes pacifistes : Ni trahison, ni demi-trahison : la guerre !. Il précise toutefois : Nous sommes sous votre contrôle. La question de confiance sera toujours posée. Il est acclamé. Seuls les socialistes lui refusent la confiance ; le lendemain, La Lanterne de Marcel Sembat écrit : Depuis le début de la guerre, on n'a rien entendu d'aussi vide !
Il restaure la confiance, mettant tout en œuvre pour que la République soutienne le choc de cette guerre Guillaume II prédisait justement le contraire, assurant que les démocraties – France et Royaume-Uni – s'effondreraient d'elles-mêmes si la guerre devait durer. Il s'attache d'abord à épurer l'administration, révoquant le préfet de police et le préfet de la Seine, ainsi que nombre de fonctionnaires jugés incompétents.
Dans sa politique intérieure, Georges Clemenceau s’emploie à mater énergiquement toute tentative de révolte, de mutinerie ou de grève dans les usines. Il mène également une lutte énergique pour le soutien du moral des troupes. Pour ce faire, il pourchasse les pacifistes, les défaitistes, les embusqués pour soutenir le moral des troupes et fait également pression sur la presse favorable à ces mouvements sans pour autant utiliser la censure.
Il généralise l'appel aux troupes coloniales la force noire du général Mangin, qu'il nomme à la tête du 9e corps d'armée malgré l'hostilité de Pétain, nommant le député sénégalais Blaise Diagne, qui vient d'adhérer à la SFIO, Commissaire Général chargé du recrutement indigène. Malgré les révoltes, 65 000 hommes sont ainsi recrutés dans les colonies en 1918. Il fait également appel à l'immigration italienne, négociant avec le président du Conseil Orlando pour obtenir cette main-d'œuvre d'appoint. 70 000 immigrants italiens sont ainsi en France en mars 1918. Par la loi du 10 février 1918, il obtient le droit de réglementer par décret la production, la circulation et la vente des produits servant à la consommation humaine ou animale, point sur lequel le cabinet Briand avait échoué en 1916. Ceci lui permet de renforcer l'économie de guerre.
Les défaitistes sont réprimés, soit à la demande de Clemenceau, soit par la justice. Ainsi, l'ex-ministre de l'Intérieur Malvy, lourdement attaqué par Clemenceau journaliste, demande à ce qu'une Commission de la Chambre examine son cas pour le disculper ; celle-ci le renvoie devant la Haute Cour de justice, et il sera condamné pour forfaiture à l'été 1918.
Le 11 décembre 1917, Clemenceau s'attaque directement à Joseph Caillaux, accusé de chercher une paix blanche sans annexions ; il demande la levée de son immunité parlementaire conjointement à celle du député Louis Loustalot128. 397 députés votent pour la levée ; Caillaux est incarcéré en janvier 1918, Clemenceau refusant toute intervention judiciaire. Caillaux sera condamné par la Haute Cour en février 1920.
Clemenceau frappe aussi la rédaction du Bonnet rouge, journal défaitiste subventionné par l'Allemagne, ainsi que Paul Bolo dit Bolo Pacha, payé par l'Allemagne pour racheter Le Journal, ce qui lui vaudra d'être condamné à mort.
La censure est cependant allégée, étant restreinte aux faits militaires et diplomatiques : Le droit d'injurier les membres du gouvernement doit être mis hors de toute atteinte, déclare-t-il à la suite de la publication d'un article qui le visait férocement. Il pose également régulièrement la question de confiance, se soumettant ainsi au contrôle parlementaire. À de nombreuses reprises, les chambres du Parlement doivent ainsi choisir entre soutenir ses décisions et le renverser.
Mettant la pression sur les États-Unis pour faire venir des troupes, il participe au Conseil supérieur de guerre interallié, dont la première réunion a lieu le 1er décembre 1917 avec Lloyd Georges, Orlando et le conseiller présidentiel de Wilson, Edward House, et à la Conférence interalliée pour tenter de mettre en place une direction intégrée des troupes.
Plus résolu et plus intransigeant que jamais, il conduit ainsi une politique de salut public qui porte ses fruits l'année suivante, consacrant un tiers de son temps à la visite des tranchées, suscitant l'admiration des poilus pour son courage; il se couvre la tête d'un simple chapeau. Le 8 mars 1918, il présente ainsi son programme de gouvernement à la tribune alors qu'il veut faire voter les crédits de guerre :
Vous voulez la paix ? Moi aussi. Il serait criminel d'avoir une autre pensée. Mais ce n'est pas en bêlant la paix qu'on fait taire le militarisme prussien.
Ma politique étrangère et ma politique intérieure, c'est tout un. Politique intérieure ? Je fais la guerre. Politique étrangère ? Je fais la guerre. Je fais toujours la guerre.
Il ajoute alors : Celui qui peut moralement tenir le plus longtemps est le vainqueur.Churchill a ainsi dit de lui : Dans la mesure où un simple mortel peut incarner un grand pays, Georges Clemenceau a été la France
Le 24 mars 1918, trois jours après le déclenchement d'une nouvelle offensive du général Ludendorff, Clemenceau envisage sérieusement d'opérer un retrait du gouvernement sur la Loire, mais Poincaré l'en dissuade. Le Tigre se rend alors à Compiègne voir Pétain, qu'il juge à nouveau trop pessimiste. Le 26 mars, il se rend avec Poincaré à Doullens, au nord d'Amiens. Il préfère alors Foch à Pétain comme généralissime des troupes interalliées, choix entériné le 14 mai après une rencontre à Beauvais, le 3 avril, avec Lloyd George et le général Pershing. Poincaré et Clemenceau se méfient en effet de Pétain, malgré cela nommé maréchal en novembre 1918. Poincaré raconte ainsi que le Tigre lui aurait dit :
" Imaginez-vous qu'il m'a dit une chose que je ne voudrais confier à aucun autre que vous. C'est cette phrase : " Les Allemands battront les Anglais en rase campagne ; après quoi, ils nous battront aussi." Un général devrait-il parler et même penser ainsi ? "
À son surnom de Tigre vient s'ajouter celui de Père la Victoire, qui résume à lui seul la part prise par lui au redressement de 1918, notamment pour son rôle dans la création du commandement unique. Après une nouvelle offensive lancée à partir du Chemin des Dames, qui permet à l'armée allemande de se trouver à 60 km de Paris, Pétain conseille alors à Clemenceau de quitter la capitale, le gouvernement est critiqué par les présidents des Chambres, Dubost et Paul Deschanel. Le 4 juin 1918, il obtient la confiance de la Chambre par 377 voix contre 110. Deux jours plus tard, un Comité de défense du camp retranché de Paris est institué, pour préparer les mesures en cas d'évacuation du gouvernement.
À partir de la bataille de Château-Thierry, en juillet 1918, le vent commence à tourner. En octobre, alors que l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie ont fait savoir qu'elles demandaient l'armistice sur la base des Quatorze points de Wilson, Clemenceau manque de démissionner à la suite d'une lettre de Poincaré, dans laquelle celui-ci refuse tout armistice tant que les troupes ennemies n'auront pas évacué tout le territoire français, voire l'Alsace-Lorraine. Alors que la droite, L'Action française, L'Écho de Paris, Le Matin… fait preuve de jusqu'au boutisme, réclamant d'aller jusqu'à Berlin imposer l'armistice, Clemenceau s'y refuse, préférant mettre fin au carnage et signer l'armistice du 11 novembre 1918. Ceci lui vaut l'ironique Perd-la-Victoire au sein de la droite nationaliste.
Viscéralement antibolchevique, il lance, dans les dernières semaines de 1918, une importante opération en mer Noire pour soutenir les armées blanches en lutte contre la Révolution d'Octobre. Mais les moyens engagés fondent avec la démobilisation, et les soldats, épuisés, ne comprennent pas cette nouvelle guerre lointaine. L'échec de l'expédition sera consommé au printemps 1919 avec la vague de mutineries qui secoue l'escadre de la mer Noire.
Le Conseil des Quatre à la conférence de paix : Lloyd George, Vittorio Orlando, Georges Clemenceau, et Woodrow Wilson.
En compagnie du Président de la République, il entreprend un voyage triomphal dans l’Alsace et la Lorraine libérées. Le 21 novembre 1918, l'Académie française l'élit à l'unanimité, aux côtés du maréchal Foch ; Clemenceau ne siégera jamais. L'Humanité ironise :
M. Clemenceau a contribué à la Commune. Il est devenu conservateur. M. Clemenceau a été dreyfusard. Il a étouffé la justice. M. Clemenceau a assailli, criblé de sarcasmes et ruiné le Sénat. Il est sénateur. M. Clemenceau a mésestimé l'Académie française. Il en a été élu hier membre.
L'empereur déposé Guillaume II écrira au contraire, dans ses Mémoires :
La cause principale de la défaite allemande ? Clemenceau. … Non, ce ne fut pas l'entrée en guerre de l'Amérique, avec ses immenses renforts … Aucun de ces éléments ne compta auprès de l'indomptable petit vieillard qui était à la tête du gouvernement français. … Si nous avions eu un Clemenceau, nous n'aurions pas perdu la guerre.
La Conférence de paix 1919 Conférence de paix de Paris 1919.
Où l'on voit les quatre chefs d'État de la conférence de Versailles, sous le titre Paix et future chair à canon. En bas, la légende : Le Tigre : C'est curieux ! J'ai l'impression d'entendre un enfant pleurer. L'image montre Clemenceau regardant un enfant, avec marqué au-dessus Classe militaire de 1940. Ce dessin prémonitoire de l'Australien Will Dyson est paru dans le Daily Herald en mai 1919.
La gauche lui est alors hostile, invoquant les Quatorze points de Wilson et sa vision idéaliste contre Clemenceau, opposition exprimée tant dans Le Rappel ou La République française que dans Le Matin, proche de Briand et dans L'Œuvre radicale de Gustave Téry. La droite, au contraire, soutient Clemenceau, espérant arracher le plus possible à l'Allemagne, Le Figaro, Le Gaulois, L'Écho de Paris, L'Action française et une partie de la presse radicale, Le Pays, Le Radical ainsi que le centriste Le Temps. Le 29 décembre 1918, la Chambre lui renouvelle sa confiance par 398 voix contre 93.
Représentant de la France à la conférence de paix de Paris janvier-juin 1919, il y défend trois priorités : la ratification de la réintégration de l'Alsace-Lorraine, les réparations et l'assurance de la sécurité de la frontière franco-allemande. Il fixe seul la composition de la délégation française, faisant venir Tardieu comme négociateur, accompagné du ministre des Affaires étrangères Stephen Pichon, du ministre des Finances Klotz et de l'ambassadeur Jules Cambon. Il est élu président du Conseil des Dix, devenu, après le départ du Japon, Conseil des Quatre, avec Wilson, Lloyd George et Orlando.
Pour cela, il exige l'annexion de la rive gauche du Rhin et de lourdes indemnités matérielles et financières. En mars, il obtient la réduction de l'armée allemande à 100 000 hommes, avec un service militaire sur la base du volontariat. Le 14 avril 1919, le Conseil des Quatre lui accorde l'occupation du Rhin pendant 15 ans avec évacuation partielle de 5 ans en 5 ans, celle-ci pouvant être retardée en cas d'absence de garanties suffisantes contre des projets d'agression allemande, art. 429 du Traité. Il s'oppose sur ce sujet au maréchal Foch, qui, soutenu par Barrès, prône l'annexion de la Rhénanie. Il revendique également l'annexion de la Sarre, bassin minier qui remplacerait les pertes du Nord de la France, et obtient finalement, en avril 1919, un consensus avec la création d'un statut autonome, sous administration de la Société des Nations, de celle-ci.
Le 19 février 1919 à 8h30 du matin, après avoir attendu que le président du Conseil sorte de son domicile rue Franklin, l'anarchiste Émile Cottin qui reproche à Clemenceau d'être un briseur de grève et un tortionnaire de la classe ouvrière, tire à neuf reprises sur sa Rolls. Il le touche trois fois, sans le blesser grièvement. Une balle, jamais extraite, se loge dans l’omoplate à quelques millimètres de l’aorte. L’attentat déclenche dans la population et dans la presse une ferveur extraordinaire. L’enthousiasme populaire est exacerbé, on idolâtre Clemenceau. Il s’en sort finalement sans trop de dommages et intervient pour commuer la condamnation à mort de Cottin en dix ans de réclusion. Six jours plus tard, il reprend ses activités, faisant preuve d'une santé vigoureuse pour son âge, et conserve son poste de président du Conseil jusqu'en 1920.
S'il défend les promesses faites à l'Italie lors du pacte de Londres, il refuse de soutenir Orlando sur la question de Fiume, qui n'avait pas été évoquée en 1915. Le Premier ministre italien part, furieux. En juin 1919, les Allemands montrant des réticences à l'égard du traité de paix, Clemenceau consulte Foch pour organiser une éventuelle offensive. Finalement, le traité de Versailles est signé le 28 juin 1919, dans la Galerie des Glaces de Versailles, une idée de Clemenceau qui voulait marquer le coup par rapport au lieu de la proclamation du Reich allemand. La ratification par la Chambre a lieu le 23 octobre 1919, Clemenceau déclarant au Sénat :
" Poussé par une opinion publique traumatisée par les destructions de la guerre, le boche doit payer, Clemenceau a eu envers l'Allemagne et l'Autriche une attitude très intransigeante. Concernant l'Allemagne, concessions territoriales et versement de réparations importantes sont les deux pans de son programme. La République d'Autriche allemande, en allemand Deutschösterreich doit être renommée en Autriche, en allemand Österreich, et la revendication d'une partie de sa population, de bénéficier du 9e point de Wilson en rejoignant la nouvelle république d'Allemagne, est formellement rejetée, le Traité de Saint-Germain, signé en septembre 1919, interdisant ce rattachement. Clemenceau se heurte aux réticences du Royaume-Uni et des États-Unis, soucieux de préserver la stabilité de la toute nouvelle République de Weimar et l'équilibre de l'Europe centrale, et le texte du traité de Versailles sera finalement un compromis, où la position de Clemenceau est cependant dominante.
Clemenceau lui-même devait, sur le plan intérieur, tenir compte des positions antagonistes des partis français : la SFIO se montre très critique, accusant Clemenceau d'avoir surchargé l'Allemagne au risque de compromettre la paix ; en revanche, la droite nationaliste, Jacques Bainville, de l'Action française, est particulièrement virulent, l'accuse d'avoir fait preuve de faiblesse face à l'ennemi héréditaire .
Politique intérieure 1919
Avant de partir, Clemenceau, qui se montre particulièrement dur envers la Russie soviétique, fait tout de même voter la loi des huit heures avril 1919, afin de couper l'herbe sous le pied de la SFIO, quelques jours avant le 1er mai 1919. Le ministre de l'Intérieur Jules Pams interdit toute manifestation. Celle-ci a tout de même lieu : 300 manifestants blessés, deux morts, et 400 blessés du côté des forces de l'ordre. Le gouvernement est interpellé à la Chambre le 6 mai, mais celle-ci lui vote la confiance par une large majorité.
Une loi sur les conventions collectives est également adoptée le 25 mars 1919. Cela n'empêche pas qu'il continue à être attaqué par les socialistes : le 4 avril 1919, à la suite de l'acquittement de Raoul Villain, l'assassin de Jaurès, un article d'Anatole France, publié dans L'Humanité, déclare : Ce verdict vous met hors la loi, vous et tous ceux qui défendent votre cause. En juin, les métallurgistes parisiens entament une grève d'envergure, revendiquant l'application de la loi des 8 heures. Le 18 juillet 1919, le radical et ex-ministre Augagneur fait voter un ordre du jour défavorable au ministre de l'Agriculture Victor Boret. Au lieu de démissionner, Clemenceau remplace ce dernier par Joseph Noulens, ex-ambassadeur en Russie et anti-bolchévique notoire. Il convoque le dirigeant de la CGT Léon Jouhaux, un modéré, et lui promet l'amnistie et l'accélération de la démobilisation tout en affirmant qu'il n'hésitera pas à réquisitionner la fonction publique en cas de grève générale. Le 22 juillet 1919, il est à nouveau mis en difficulté à la Chambre par la gauche, mais parvient à se maintenir.
Aux législatives de novembre 1919, que Clemenceau a refusé de repousser, la droite, réunie au sein du Bloc national, l'emporte largement : c'est la chambre Bleu horizon. Cette victoire est en partie due à la nouvelle loi électorale du 22 juillet 1919, qui a instauré le scrutin proportionnel avec une dose de majorité, mais aussi aux divisions de la gauche.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=7223#forumpost7223
Posté le : 16/11/2014 17:47
|
|
|
|
|
Georges Clémenceau3 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Candidature avortée Élection présidentielle française de janvier 1920.
En janvier 1920, Clemenceau, qui aspire désormais à une retraite paisible, accepte que des amis soumettent sa candidature à la présidence de la République, mais ses nombreux ennemis, à gauche comme à droite, s’unissent dans le dessein de soutenir la candidature de son adversaire, le président de la Chambre des députés, Paul Deschanel. Aristide Briand, en particulier, convainc la droite catholique du danger que cet anticlérical impénitent représente Léon Daudet l'appelle le Vendéen rouge, tandis que la SFIO garde en tête l'image du premier flic de France .
Deschanel, qu’il avait battu en duel en 1894, l’emporte d’une courte majorité lors du vote préparatoire au sein du groupe républicain, le 16 janvier 1920, à l’Assemblée nationale. Clemenceau retire alors à ses amis l’autorisation de poser sa candidature à l'Élysée. Le lendemain, le 17 janvier, Paul Deschanel est largement élu président de la République et Clemenceau présente la démission de son gouvernement au chef de l'État sortant, Raymond Poincaré.
Vie sociale L'homme
Être caustique doté d'un humour souvent décapant, Clemenceau s'est régulièrement illustré par des propos sarcastiques concernant la France, sa société et ses voisins.
Clemenceau était athée ou vaguement déiste - car il évoquait Dieu de temps en temps - anticlérical, ardent défenseur de la laïcité. Pourtant, il se disait être bouddhiste : Que voulez-vous, je suis bouddhiste !, a-t-il répondu un jour à des journalistes à la sortie d'une cérémonie bouddhiste organisée au Musée Guimet149.
Il pratiquait le sport gymnastique tous les matins, équitation et aimait les plaisirs de la campagne, la chasse, les animaux il avait un bouledogue, notamment les oiseaux… il installe des paons et des cigognes au ministère place Beauvau ; dans Le Cinquième État, il s'émeut des inutiles travaux infligés aux animaux domestiques150.
Grand amateur d'art asiatique, collectionneur d'estampes japonaises, de bouddhas du Gandhara, de laques, masques et céramiques, et autres objets d'art asiatique.
Il assista en 1890 à l'exposition d'art nippon, organisée par Samuel Bing à la galerie des Beaux-Arts à Paris parmi, entre autres personnalités, Henri Vever et Antonin Proust ; il fait acheter pour le Louvre, en 1891, les deux premières oeuvres japonaises du musée ; il intervint pour faciliter le legs à l'État de la collection de 1 700 objets d'art chinois et japonais de Clémence d'Ennery 1894 - dont il fut exécuteur testamentaire - devenue musée en 1908.
Sa propre collection, qui comptait entre autres peintures et objets 3000 boîtes à encens en porcelaine ou kogos, musée des Beaux-Arts de Montréal, a fait l'objet de l'exposition le Tigre et l'Asie au musée national des arts asiatiques - Guimet à Paris en 2014.
Ami de Monet et défenseur des impressionnistes
Il rencontra Monet dans les cafés du Quartier latin, foyer de l'agitation républicaine face au Second Empire : les deux étudiants républicains s'y croisaient régulièrement. Leur amitié profonde se développa lorsque Clemenceau publia un grand article élogieux, intitulé Révolution de cathédrales dans son journal La Justice, le 20 mai 1895, à propos de l'exposition chez Durand-Ruel. Il écrivit le livret d'un opéra, Le Voile du bonheur.
L'Olympia de Manet déclenche ce 15 juin 1865 au Palais de l'Industrie et des Beaux-Arts de Paris l'indignation ; Une tempête de fureur, soufflait et on vomissait les injures les plus grossières, raconte Clemenceau venu soutenir en compagnie de Zola, son ami Manet. Lorsqu'un rustre à la mine fleurie, vient cracher sur le tableau. Clemenceau se jette sur lui en le souffletant. Un duel s'ensuivit au petit matin dans les faubourgs de Paris. Clemenceau écorcha le bonhomme, qui s'en tirait à bon compte. Cette histoire fit le tour des ateliers parisiens et ses nouveaux amis avaient pour nom: Pissaro, Degas, Toulouse-Lautrec, Sisley, mais il resta très proche de Claude Monet qu'il appelle mon vieux coeur.
Durant sa longue carrière politique, malgré son activité infatigable, il a trouvé le temps de s'intéresser à l'art et fut le protecteur de Claude Monet, il obtiendra que ses Nymphéas soient exposées à l'Orangerie des Tuileries, à Paris et d'autres peintres, tels que Jean Peské.
Fréquentations et salons
N'aimant guère cependant la paysannerie réactionnaire de Vendée, il fréquentait assidûment les salons littéraires et musicaux de la Belle Époque et, ayant divorcé, était connu comme coureur de jupons, nombreuses petites danseuses repérées dans le foyer de l'opéra, Léonide Leblanc, ex-maîtresse du duc d'Aumale, et de Gambetta; en son souvenir il donna son prénom à une ânesse qui, comme elle, avait "de grands yeux humides, la langue chaude et le poil luisant"…, l'actrice Suzanne Reichenberg, la comtesse d'Aunay, et, pendant plus longtemps, la cantatrice Rose Caron.
Il fut également un ami de la féministe Marguerite Durand, de la femme de lettres Anna de Noailles, de l'actrice Sarah Bernhardt ou de Cécile Sorel, autre actrice également amie de Barrès, à qui il déclarera : Toute ma vie j'ai été amoureux.
Il fréquente ainsi le salon de la comtesse de Loynes avant qu'elle ne choisisse, avec son amant Jules Lemaître, le camp des anti-dreyfusards. Celui, surtout, d'Aline Ménard-Dorian, fille du ministre du gouvernement de la Défense nationale Pierre-Frédéric Dorian et épouse de Paul Ménard-Dorian, riche maître des forges député radical, mère de Pauline Ménard-Dorian qui se maria avec le petit-fils de Victor Hugo.
Dans le salon républicain d'Aline, rue de la Faisanderie, on rencontrait Émile Zola, Alphonse Daudet, les frères Goncourt, Rodin, Carrière, Béthune, RenouardLequel ?, Victor Considerant, et nombre d'hommes politiques républicains de l'époque, tels que Georges Périn, Allain-Targé, Challemel-Lacour, Henri Rochefort, etc.
À la fin du siècle, il fréquentait également beaucoup, avenue Hoche, le salon de Mme Arman de Caillavet, l'égérie d'Anatole France, le plus célèbre des salons dreyfusistes, et où l'on rencontrait la fine fleur des arts et des lettres, en même temps que le gratin politique.
Il se rendit à Vienne en 1886, lors de la crise boulangiste, au mariage de son frère Paul avec Sophie Szeps, fille du journaliste Moritz, propriétaire de la gazette libérale Wiener Tagblatt, célébrations au cours desquelles il rencontra l'archiduc Rodolphe d'Autriche 1859-1889, ami des Szeps et favorable à un rapprochement avec la France. Jusqu'à l'annexion de la Bosnie-Herzgovine par l'Autriche-Hongrie en 1908, il put espérer une alliance avec l'Autriche. Par ailleurs, il demeurera proche de sa belle-sœur, Berta Zuckerkandl.
Souvenez-vous du vieux Rembrandt du Louvre, creusé, ravagé qui s'accroche à sa palette, résolu à tenir bon jusqu'au bout à travers de terribles épreuves. Voilà l'exemple. lettre du 12 juillet 1911, puis, Vous l'avez plus cruellement ressentie sa cataracte double parce que vous êtes un artiste hors pair et que vous avez entrepris, quand votre vue défaille, de faire plus beau qu'avec vos deux yeux, et à poursuivre les recherches picturales qui aboutirent aux célèbres Décorations des Nymphéas; c'est à son instigation que le peintre les offrit à son pays le 12 avril 1922.
Nous sommes fous tous les deux mais pas de la même folie. C'est pourquoi nous nous comprendrons bien jusqu'au bout.
Clemenceau fréquenta aussi les peintres et graveurs Jean-François Raffaëlli 1850-1924 et Eugène Carrière 1846-1906, habitué du salon d'Armand de Caillavet.
Fin de vie "Au soir de la Pensée "
À 79 ans Clemenceau va désormais consacrer son temps à de longs voyages. Il part ainsi, en avril 1920, pour l'Égypte à bord du Lotus, puis au Soudan où il rencontre le nationaliste Osman Digma.
De retour à Paris, il paie ses dernières dettes et s'achète une Citroën - André Citroën ne voulant pas la lui faire payer, Clemenceau exige en retour qu'il accepte 10 000 francs pour la caisse de solidarité des ouvriers.
Il fréquente Basil Zaharoff, marchand d'armes millionnaire, vieux Grec d'Odessa qui gagne cent mille francs par jour, fume les cigares les plus chers du monde, très beau, l'air d'un Tintoret, très généreux, splendide aventurier, roi secret de l'Europe, Paul Morand, qui contrôlait la firme d'armement anglaise Vickers, employeur - grâce à son ami Nicolas Pietri - de son fils Michel.
Zaharoff lui procure chauffeur et Rolls-Royce afin de remplacer celle que lui avait offerte en 1917 le roi d'Angleterre en qualité de Président du Conseil, et qu'en conséquence le gouvernement français lui a demandé de laisser à l'État en 1920. Le seul geste du Pouvoir envers lui - il ne reçut aucune pension ou indemnité - a été l'offre de la Médaille Militaire, qu'il a déclinée avec ironie habituelle, lui, simple civil qui n'est même pas un ancien gendarme.
Le 22 septembre 1920, le lendemain de la démission de Deschanel, il part pour Ceylan sur la Cordillère. Il est invité en Inde par Ganga Singh, le maharajah de Bîkâner, rencontré lors de la Conférence de paix. Il visite aussi Colombo, Singapour, Jakarta, Bandung, Rangoun, Bénarès, Bombay, Mysore, où le maharajah local l'a également invité…
De retour à Toulon le 21 avril 1921, il se rend ensuite en Angleterre, où l'université d'Oxford le fait docteur honoris causa 22 juin 1921. Il y rencontre ses amis Churchill, Kipling, le rédacteur en chef du Times Steed, l'ex-Premier ministre Asquith et, à sa demande, fait une visite à Lloyd Georges.
De retour en France, séjournant en Vendée, il inaugure le 9 octobre 1921 le Monument aux Morts de Mouilleron-en-Pareds, son village natal, et le 20 son propre monument, au centre du bourg de Sainte-Hermine Vendée, le célèbre groupe sculpté sur place en deux ans par son ami le sculpteur François Sicard, qui le représente debout sur un rocher surmontant plusieurs poilus : la statue, décapitée pendant l'Occupation par les troupes allemandes, a été restaurée — la tête originale est conservée au musée national maison de Georges Clemenceau de Saint-Vincent-sur-Jard.
Au proche village de Féole se trouve le logis médiéval de L'Aubraie de son grand-père propriété privée, où, enfant, il séjourna et qui fut attribuée à son frère Paul en compensation des secours financiers apportés par leur père à Georges pour apurer ses dettes journalistiques, partage qui brouilla les deux hommes.
En février 1922 il relance un journal, L'Écho national, qui a comme fondateur Clemenceau, et comme directeur politique Tardieu. Édouard Ignace, Georges Bonnefous, Georges Suarez, Gaston Bénac y collaborent.
Le 27 mai 1922 il prononça un discours émouvant lors de l'inauguration du Monument aux Morts de La Grande Guerre du lycée nantais qui portait déjà son nom; le futur Julien Gracq, qui y assistait l'évoqua plus tard.
À l'automne 1922 il part aux États-Unis pour une tournée de conférences, plaidant la cause de la France. De retour le 20 décembre 1922, Clemenceau s’attelle à la rédaction de plusieurs ouvrages : Démosthène, où il peint à la fois l'orateur grec et lui-même ; Grandeur et Misères d’une victoire, où il défend, contre Poincaré et Foch, son action politique de 1917-1919 et évoque le risque du réarmement allemand en raison de l'abandon des garanties du traité de Versailles et de la politique d'apaisement de Briand; et surtout Au soir de la Pensée, un gros ouvrage de réflexion et de philosophie qui va être le but principal de ses vieux jours : il y réfléchit sur l'humanité, les différentes religions et cultures, le progrès, etc.
Fin 1923, à 82 ans, il rencontre Marguerite Baldensperger, de 40 ans sa cadette, et qui venait de perdre une fille, Je vous aiderai à vivre et vous m'aiderez à mourir, voilà notre pacte lui dit-il, directrice de collection et épouse d'un professeur de littérature à la Sorbonne. Il la fait venir chez lui pour écrire une biographie sur Démosthène et lui écrit régulièrement jusqu'à ses derniers jours 668 lettres qui lui tiennent lieu de journal, publiées en 1970 par son fils Pierre sous le titre Lettres à une Amie ; elles révèlent l'amour platonique d'un Clemenceau inconnu, attentif, courtois, plein de tendresse et d'égards … soudain ombrageux, irrité, tel qu'en lui-même l'amour ne l'a pas entièrement changé.
Il lui dédicaça entre autres La France devant l'Allemagne 1918 et un exemplaire des Embuscades de la vie, 1919 - archives pers., en juin 1924, en inscrivant un "Aimons la France", trois mots qui peuvent résumer sa vie politique.
Au vu de la situation internationale, il se décide à écrire au président Coolidge le 9 août 1926 :
" Nous sommes débiteurs et vous êtes créanciers. Il semble que ce soit pure affaire de caisse. N'y a-t-il point d'autres considérations à envisager ? …
Si les nations n'étaient que des maisons de commerce, ce sont des comptes de banques qui règleraient le sort du monde. … Or, c'est le secret de la comédie qu'il ne s'agit ici que d'échéances fictives pour aboutir à l'emprunt, avec de bonnes hypothèques sur nos biens territoriaux, comme en Turquie …
La France n'est pas à vendre, même à ses amis !
Coolidge ne se donna pas la peine de répondre, se contentant d'un communiqué laconique. Ce fut la dernière intervention politique de Clemenceau.
Mort
Frappé d'une crise d'urémie à 88 ans Clemenceau meurt après trois jours de maladie, à l'aube du 24 novembre 1929, à son domicile de la rue Benjamin Franklin à Paris — ancienne garçonnière de Robert de Montesquiou — qu'il habitait depuis 34 ans et qui, mis en vente en 1926 par les héritiers de sa propriétaire Mme Morand, qui, connaissant les ressources modestes de son auguste locataire, avait eu l'élégance de ne pas augmenter le loyer, et, elle-même très âgée, avait même demandé à ses héritiers d'en faire autant jusqu'à la mort de Clemenceau fut alors été acheté en secret le 18 mai 1926 par l'émissaire d'un de ses fervents admirateurs, le milliardaire américain James Stuart Douglas 1867-1949 pour 950 000 francs sur une mise à prix de 500 000 du fait de la concurrence des voisins, les jésuites de Saint-Louis de Gonzague, désireux de s'agrandir.
Pour mes obsèques, je ne veux que le strict minimum, c'est-à-dire moi
Une terrasse plantée d'acacias qui domine le lit d'un ruisseau. Des arbres, beaucoup d'arbres. Quelque chose dans tout cela de simple et en même temps d'orgueilleux. Une sorte de paix des premiers âges … M. Clemenceau me montrant sa tombe : voilà la conclusion de votre livre : un trou et beaucoup de bruit pour rien.
Sur son lit de mort Clemenceau, voyant arriver un prêtre aurait dit : Enlevez-moi ça ! mais l'anecdote est peu sûre ; René Godart le représenta — les méplats asiatiques de son visage le font ressembler à Gengis Khan — et François Sicard réalisa son masque mortuaire dessin et masque sont reproduits dans le numéro-hommage de L'Illustration de novembre 1929.
Son exécuteur testamentaire fut son vieil ami corse Nicolas Pietri. Le lendemain du décès, conformément au testament du 28 mars précédent qui excluait tout cortège ni cérémonie d'aucune sorte, son corps, auprès duquel avait été placé, selon ses instructions, un petit coffret recouvert de peau de chèvre, le livre, Le Mariage de Figaro selon le numéro-hommage de l'Illustration de novembre 1929 qu'y avait déposé sa mère, sa canne à pomme de fer qui est de ma jeunesse , offerte par son père lorsqu'il était enfant, et deux bouquets de fleurs desséchées, dont celui que lui offrirent en Champagne le 6 juillet 1918 deux soldats d'avant-poste promis à la mort, fut transporté dans sa voiture et arriva à 12 heures 30 à Mouchamps Vendée, au bois sacré où reposait depuis 1897 son père, en présence de 200 gendarmes et de nombreux paysans accourus malgré les barrages routiers et la fermeture du chemin menant au manoir-ferme du Colombier, où ses ancêtres avaient vécu du début du XVBIIIe siècle à 1801. Il fut porté en terre par son chauffeur Brabant, son valet de chambre Albert Boulin, deux fossoyeurs et deux paysans, sur le bord d'un ravin boisé dominant une boucle du Petit Lay, terrain qui avait été donné à la commune en avril 1922 par Clemenceau et ses cinq frères et sœurs dans la simplicité des funérailles protestantes traditionnelles.
Une légende tenace veut qu'il ait été enterré debout afin d'être tourné vers la ligne bleue des Vosges voire pour défier l'Église catholique; en réalité, du fait d'une des grosses racines du cèdre impossible à réduire, le cercueil ne put être posé à plat, mais fut légèrement incliné.
Un de ses familiers, le commandant Jean de Lattre de Tassigny, futur maréchal de France — dont la pieuse mère disait chaque jour son chapelet depuis 1918 pour la conversion de Clemenceau — fut avec son épouse parmi ses rares amis vendéens à assister à ses obsèques, et protesta ensuite envers l'évêque qui n'avait cru devoir annuler une réjouissance publique prévue le soir même.
Une copie — sans le livre sur lequel s'appuie la lance de l'original, à la demande de Clemenceau — de la Minerve casquée dite de Samos sculptée par Sicard en pierre blonde d'Égypte surplombe les sépultures jumelles, dépourvue de dalles et de toute inscription, entourées de grilles ombragées par un grand cèdre de l'Atlas, arbre de La Liberté planté en 1848 par Benjamin Clemenceau et son jeune fils pour célébrer la Deuxième République.
Pendant de longues années, la commune de Montmartre fit fleurir la sépulture, de même que celle de Mouchamps, le jour anniversaire de l'Armistice de 1918, et l'État, pour celui de sa mort 24 novembre; c'est probablement lors de l'une de ces deux circonstances, en 1954, que le peintre amateur C. Gauducheau-Merlot brossa un tableautin du lieu coll. privée.
Par décision ministérielle du 15 juillet 1998 les deux tombes, la stèle et l'allée d'accès ont été inscrites à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments historiques.
Postérité
Quinze jours après l’Armistice est créée l’Union nationale des combattants, citée dans le Journal officiel du 11 décembre 1918. Elle est reconnue d’utilité publique par décret du 20 mai 1920. Georges Clemenceau et le Révérend Père Daniel Brottier en sont les fondateurs. Clemenceau remet au premier trésorier de l’U.N.C. la somme de 100 000 francs or, provenant d’un don d’une mère, dont le fils est tombé au combat.
Hommages de personnalités
Vinrent s'incliner sur la tombe :
en mai 1943 Erwin Rommel
le 12 mai 1946, Charles de Gaulle, entouré d'une foule estimée à 3000 personnes, honorant sa promesse de venir lui annoncer la victoire, à la suite du message qu'il adressait symboliquement de Londres le 11 novembre 1941 :
Au fond de votre tombe vendéenne, Clemenceau, vous ne dormez pas. Certainement la vieille terre de France qui vous enterre pour toujours a tressailli avec colère tandis que le pas insolent de l'ennemi et la marche feutrée des traîtres foulaient le sol de la patrie…
deux présidents de la République, lors de visites officielles : le 9 novembre 1951 Vincent Auriol et le 11 novembre 1987 François Mitterrand, entouré de 300 personnes, et un ancien président du Conseil et président du parti radical-socialiste, Édouard Herriot en 1955.
Hommages de Nantes
Nantes est une des villes qui a le plus rendu hommage à Clemenceau, de son vivant même.
En effet, c'est dès le 12 novembre 1918 que la municipalité exprime le souhait de donner son nom au lycée où il a fait ses études secondaires, ce qui est entériné par un décret du 4 février 1919.
Peu après est décidée la construction d'un monument aux morts du lycée ; lors de la séance du Conseil Municipal de Nantes du 26 mars 1919, un débat s'élève pour savoir si on doit y représenter Clemenceau : les socialistes, par la voix d'Eugène Le Roux, futur député, estiment que ce n'est pas nécessaire et rappellent qu'il est aussi le président du Conseil de 1906-1907. Le monument sans Clemenceau de Siméon Foucault est inauguré en sa présence, le 27 mai 1922 ; il y prononce un discours dont la dernière phrase, adressée au lycéens, est restée depuis lors gravée sur une plaque dans la cour d'honneur : pour connaître par vous-mêmes, sans attendre l'avenir, la fortune de vos efforts, retroussez résolument vos manches et faites votre destinée, paroles qui marquèrent, entre autres lycéens, le futur écrivain Julien Gracq. Cette cérémonie fit la couverture de L'Illustration du 3 juin.
D'autres hommages sont rendus après sa mort.
Dès le 24 novembre 1929, la municipalité donne son nom à la rue du Lycée et peu après, décide d'ériger un monument en son honneur dans la cour du lycée, en pendant au Monument aux Morts. Ce monument, qui comporte en médaillon un buste de Clemenceau par Sicard, fut inauguré le 26 avril 1931 en présence d'André Tardieu, L'Illustration du 2 mai, de nouveau en couverture.
Enfin, en 1966, un des ponts de la deuxième ligne de ponts reçoit le nom de Clemenceau le second, celui de Briand.
Honneurs anthumes
Le Monument à Georges Clemenceau à Sainte-Hermine Vendée, de Sicard, date de 1920.
Une photo le montrant regardant la statue est reproduite dans le numéro-hommage de L'Illustration novembre 1929.
Honneurs posthumes
Onomastique
Son nom a été donné à un porte-avions français, en service de 1961 à 1997. Lors de son dernier voyage le commandant du Clem' , comme l'appellent encore de vieux marins, vint mouiller entre l'île de Ré et la côte vendéenne et fit tirer une salve d'honneur afin de saluer symboliquement Bel-Ebat à Saint-Vincent-sur-Jard, la maison de vacances de Clemenceau.
Il a aussi été donné à de nombreux établissements scolaires : lycées Nantes, Reims, Montpellier, Chantonnay…, collèges Tulle… ainsi qu'à un hôpital, Hôpital Georges-Clemenceau, à des ponts Pont Georges-Clemenceau, avenues ou rues en France comme à l'étranger : par exemple, rue Georges-Clemenceau à Nantes, rue Clemenceau à Beyrouth .
En Amérique du Nord, on trouve un quartier neighborhood de la ville de Cottonwood Arizona, nommé Clemenceau à la demande de son ami James Douglas, Jr, fondateur du Clemenceau Heritage Museum consacré à l'histoire de la ville, ainsi qu'une montagne dans les Rocheuses canadiennes, le Mont Clemenceau.
Plaque Georges Clemenceau dans la station portant son nom sur la ligne 1 du Métro
En 1931, la station Champs-Élysées sur la ligne 1 du Métro prend le nom de Champs-Élysées - Clemenceau. Une station de la ligne du métro de Rennes porte aussi non nom.
Sa statue du rond-point des Champs-Élysées à Paris 1932. Photo coul. plus haut est due au sculpteur officiel François Cogné 1876-1952 ; des réductions en terre cuite ont été produites.
À Saint-Vincent-sur-Jard Vendée, la longue et basse maison de pêcheur louée à partir de 1920 au commandant Luce de Trémont, châtelain à Avrillé Vendée, un hobereau voisin, afin d'y passer la moitié de l'année, ce qu'il appelait sa bicoque ou son château horizontal, où il réunit meubles familiaux, provenant de sa demeure de Bernouville Eure, vendue entre-temps, voire achetés, le buffet rustique de la cuisine objets personnels et livres, fut achetée par l'État et transformée en une sorte de maison du souvenir, qui est gérée par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.
La mer ici m'enchante …. Il y a des bleus et des verts sur la palette du ciel. On en ferait des tableaux lettre à Monet, automne 1921.
À Paris, son appartement, devenu propriété américaine, fut transformé en musée en 1931 et géré par une fondation qui reçut des trois héritiers de Clemenceau les meubles et objets s'y trouvant à sa mort; demeuré ouvert pendant la Seconde Guerre mondiale, il reçut la visite de militaires allemands, dont le Feldmarschal von Stülpnagel, commandant en chef des troupes d'occupation en France.
Son fils, Michel Clemenceau 1873-1964, résistant, déporté et interné en 1940-1945, homme politique de la Quatrième République, à qui son père avait dédicacé ainsi un de ses ouvrages : À mon fils, qui aura des devoirs après ma mort, meubla et décora avec des meubles, objets d'art et souvenirs personnels de son père, la maison qu'il avait fait bâtir de 1927 à 1929 à Moret-sur-Loing Seine-et-Marne, nommée La Grange-Batelière , qu'il légua à sa quatrième épouse, Madeleine. Celle-ci conserva sa vie durant le musée Clemenceau ainsi constitué, qui fut dispersé en 250 lots le 13 février 2005 à Fontainebleau, dont plusieurs épaves de la collection d'art asiatique de Clemenceau cf. catalogue à qui, en 1922, en remerciement de sa réception en Vendée, le prince héritier du Japon Hirohito, âgé de 11 ans, envoya deux bannières en soie peintes de carpes, qui devinrent le signal de sa présence pour les pêcheurs - et un ivoire millénaire figurant la déesse des eaux , dons personnels du couple impérial.
Dans le cadre de cette vente publique l'État préempta certains souvenirs et documents historiques pour le musée Clemenceau de la rue Benjamin-Franklin et un fonds muséal vendéen ; par ailleurs, l'État acquit cette même année la maison natale de Clemenceau à Mouilleron-en-Pareds, située à deux rues de celle de Jean de Lattre de Tassigny, qui sont réunies dans le projet global du musée national des Deux Victoires, ou musée Georges Clemenceau et Jean de Lattre, créé en 1959 dans la mairie à l'initiative de la maréchale de Lattre et d'André Malraux.
À l'occasion du cinquantenaire de sa mort, une exposition iconographique Clemenceau, du portrait à la caricature s'est tenue du 4 juillet au 29 septembre 1980 au Musée national des Deux Victoires de Mouilleron-en-Pareds Vendée. En novembre 1997, l'Association des maires de Vendée a organisé l'exposition itinérante du riche fonds documentaire et iconographique du collectionneur vendéen Octave Fort, qui fut maire d'Avrillé - comprenant les archives du général Mordacq, chef du cabinet militaire de Clemenceau de 1917 à 1920 - sous le titre Clemenceau, cet inconnu.
Numismatique: "Le Tigre" est l'effigie d'une pièce de 10 € en argent éditée en 2012 par la Monnaie de Paris, pour la collection Les euros des régions afin de représenter les Pays de la Loire, sa région natale.
Expositions:
2013-2014 - Clemenceau et les artistes modernes, Manet, Monet et Rodin' à l'Historial de la Vendée, aux Les Lucs-sur-Boulogne, du 8 décembre 2013 au 2 mars 2014, catalogue par les éditions d'art Somogy et Conseil général de la Vendée ;
Le Tigre et l'Asie, Musée national des arts asiatiques - Guimet, Paris, du 12 mars au 6 juin 2014 ; catalogue et hors-série exposition no 74 de L'Objet d'Art.
Carrière
Maire du 18e arrondissement de Paris, composé pour l'essentiel de l'ancienne commune de Montmartre, de 1870 à 1871
Conseiller municipal de Paris 1871-1876
, président du conseil municipal de Paris 1875
Député à l'Assemblée nationale 1871 puis 1876-1893
Sénateur 1902-1920
Ministre de l'Intérieur 1906, surnommé le Tigre
Président du Conseil 1906-1909 et 1917-1920, surnommé le Père la Victoire
Membre de l'Académie française, élu en 1918, il n'y siègera jamais.
Honneurs
Docteur honoris causa de l'Université jagellonne de Cracovie en 1918
La place Clemenceau, sur l'avenue des Champs-Élysées prend son nom en hommage en 1930.
Iconographie
Georges Clemenceau vu par Aristide Delannoy, Les Hommes du jour, n°1, janvier 1908
1917 ca - Clemenceau visitant une tranchée gouache de Mathurin Méheut Péronne historial de la Grande Guerre, et une version à l'huile réalisée en 1955 pour décorer le navire Le Vendée offerte au Musée Mathurin Méheut de Lamballe
1919 - Clemenceau par Jean-Louis Forain dessin
1920 - Clemenceau par Cecilia Beaux, reproduite supra ;
1932 - Clemenceau , statue du rond-point des Champs-Élysées à Paris. Par le sculpteurFrançois Cogné 1876-1952 ; des réductions en terre cuite ont été produites;
s. d. - Clemenceau par Edmond Heuzé;
par Manet, dont il avait fait entrer L'Olympia au musée du Louvre, et pour lequel il s'était battu en duel;
par René Godart, dessin à la sanguine ? reproduit par L'Illustration ;
par Nadar photographie reproduite supra;
par le caricaturiste Léandre, qui le représente pourfendant symboliquement un rond-de-cuir,
par Manet179 reprod. supra ;
par Rodin180 ; il décrit lui-même ainsi une séance de pose : « montant sur un escabeau pour faire des croquis du sommet de son crâne puis, s'accroupissant, pour mieux voir le bas de sa mâchoire, tout cela pour lui faire une tête de général mongol;
par Albert Besnard dans une gravure à l'eau-forte en 1917.;
un buste en terre cuite fait face à celui de son grand ami et presque exact contemporain Claude Monet dans son l'atelier-salon du peintre à Giverny Eure, qu'il encouragea à se faire opérer de sa cataracte;
un grand buste en grès de Carrière est exposé au musée Sainte-Croix de Poitiers;
une photographie anonyme et non datée de lui assis à son bureau parisien illustre l'article de Jean Silvain cité en bibliographie - arch. pers.;
Filmographie
En 1910, son roman Le voile du bonheur est adapté par Albert Capellani;
En 2012, Didier Bezace interprète Georges Clemenceau dans le téléfilm Clemenceau de Olivier Guignard.
Télévision
Michel Ragon : Georges & Louise, Radio-télévision belge de la Communauté française, Sonuma, 27 janvier 2000,
       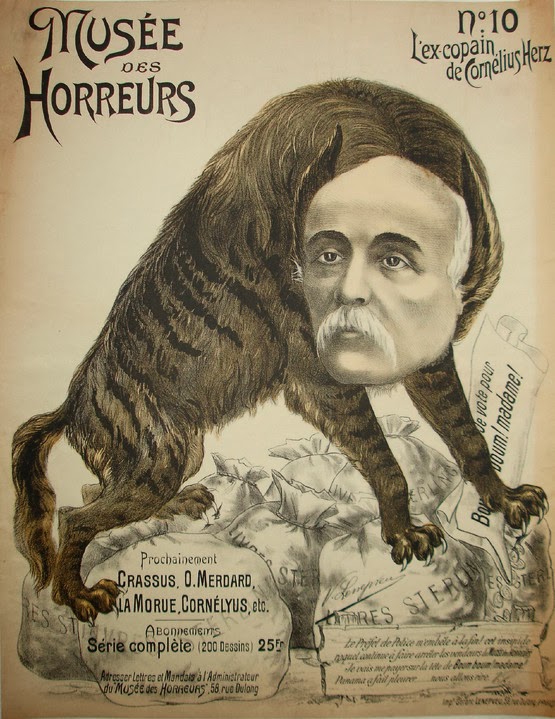 [img width=600]http://centenaire.org/sites/default/files/styles/full_16_9/public/atom-source-images/clemenceauok.jpg?itok=p9Wsps_T[/img]  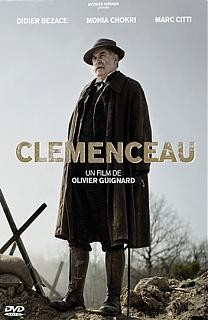 [img width=-00]http://juliendaget.perso.sfr.fr/Clem/Clemenceau_4.jpg[/img]
Posté le : 16/11/2014 17:44
Edité par Loriane sur 17-11-2014 11:44:27
|
|
|
|
|
Atahualpa dernier Inca |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 16 Novembre 1532 est fait prisonnier Atahualpa dernier empereur Inca.
Après une guerre civile menée contre son frère aîné, Huáscar, il fut capturé par surprise, et exécuté par Pizarro, qui affirma ainsi la domination espagnole sur le Pérou.
Atahualpa né entre 1497 et 1502 à Cuzco ou Quito, mort à Cajamarca en 1533, il est le cinquième et dernier empereur de l'empire inca indépendant. D'abord implanté dans la partie nord du royaume, une région dont les principales villes sont à l'époque Quito et Tomebamba, il s'empare du trône impérial de Cuzco après sa victoire lors de la guerre fratricide qui l'oppose à son demi-frère Huascar pour le pouvoir après la mort de leur père Huayna Capac. Sa victoire coïncide toutefois avec l'arrivée au Pérou des conquistadors espagnols menés par Francisco Pizarro, par lesquels il est capturé en 1532 lors de la bataille de Cajamarca, puis exécuté en 1533.
En Bref
À la mort de Huayna Cápac, l'Empire inca est en proie à une guerre qui oppose le fils légitime du défunt, Huáscar, officiellement couronné dans la capitale du Cuzco, à son fils bâtard, Atahualpa, qui, avec l'appui des généraux de son père, s'empare du nord du pays. En 1531, au moment où l'Espagnol Pizarro guerroie dans le golfe du Guayaquil, Atahualpa triomphe de son demi-frère Huáscar après une bataille décisive devant le Cuzco. Pizarro n'ignore pas ces événements et, après avoir voulu soutenir Huáscar, reconnaît Atahualpa comme souverain légitime ; sa stratégie conquérante commence par la décision hardie de se rendre à Cajamarca auprès d'Atahualpa. L'empereur ne lui fait pas obstacle et même, en réponse à l'ambassadeur Fernando, il promet de venir rendre visite aux Espagnols.
Les sources rapportent l'épisode tragique de la rencontre entre l'Inca et les conquistadores du Nouveau Monde. Le souverain arrive avec dignité dans une litière toute garnie de fin or, accompagné d'une escorte qui chante et danse autour de lui.
Les Espagnols l'exhortent à se convertir au christianisme et lui présentent les Évangiles. Atahualpa répond fièrement qu'il n'a d'autre dieu à adorer que le Soleil ; il feuillette le livre et essaye d'écouter ce qu'il dit, mais comme il n'entend rien, il le jette à terre. Ce refus est suivi d'un massacre. Pour échapper à la mort, Atahualpa promet ses richesses. Sa promesse excite la cupidité de ses adversaires et Pizarro, après avoir tiré tout le parti possible de l'Inca, le fait tuer ; la désintégration de l'Empire inca est immédiate.
L'attitude d'Atahualpa reste assez énigmatique pour les historiens : pourquoi a-t-il laissé traverser son pays par des étrangers ? Contrairement à une hypothèse qui a été avancée, il n'a pas cru à la surhumanité des Espagnols. Certes, les chevaux, les arquebuses et l'écriture l'avaient impressionné, mais il savait que ces barbus étaient des mortels auxquels on pouvait se mesurer. Juste avant qu'il ne rencontre les hommes de Pizarro, le bruit courait dans son camp que les fusils ne tiraient que deux coups et que les chevaux perdaient tout pouvoir pendant la nuit. C'est pour cela que l'empereur, après avoir convenu de l'entrevue avec Pizarro à midi, n'arriva qu'à la tombée de la nuit ; mais le piège qu'il avait pensé tendre se retourna contre lui.
Un avènement difficile
Fils d'une princesse de l'ancien du Royaume de Quito et du Sapa Inca Huayna Capac, Atahualpa naît dans le royaume de Quito vers 1500. Lorsque son père décède, la succession au trône reste incertaine, le fils désigné par Huayna Capac ayant été emporté par une épidémie de variole. Dans l'incertitude, Huascar dont la mère est une princesse de Cuzco est couronné. La noblesse du nord de l'empire étant hostile à cette décision décide de couronner Atahualpa comme Sapa Inca. Le prince régnera ainsi deux années sur les provinces du nord de l'empire où il est honoré et respecté comme souverain unique. Un statu quo se maintient jusqu'à ce que les généraux quiténiens arrivent à persuader le prince de monter sur le trône de Cuzco : l'empire ne doit pas rester divisé. Les généraux Quizquiz, Chalcuchimac et Rumiñahui sont à la tête des armées de Quito, les hostilités s'ouvrent ainsi. Après des mois de guerre civile, les armées de Huascar sont presque défaites. Atahualpa semble pouvoir devenir le 13e empereur inca du Tahuantinsuyu l'empire inca, il est en route pour Cuzco lorsqu'il reçoit la nouvelle du débarquement des hommes blancs et barbus dans la baie de Tumbes. Le prince fait surveiller les étrangers et on rapporte déjà de nombreux abus de leur part.
L'arrivée des conquistadore
Le 16 novembre 1532, après quelques pourparlers, Atahualpa est invité par le conquistador espagnol Francisco Pizarro, dans le village de Cajamarca au nord de l'actuel Pérou.
L'empereur Atahualpa se rend à proximité de Cajamarca entouré de sa cour et escorté de ses armées triomphantes, celles-ci sont suffisamment nombreuses pour encercler toute la ville et camper sur tous les flancs de la vallée. Pour convaincre Atahualpa de le rencontrer, Pizarro lui propose de l'aider dans la lutte qui l'oppose à son frère Huascar. Méfiant, Atahualpa accepte néanmoins et convient d'une entrevue à laquelle Indiens et Espagnols doivent se rendre sans armes.
N'ayant pas décelé le piège, l'Inca se rend en très grande pompe dans la ville de Cajamarca : il souhaite impressionner les étrangers. Dans sa litière d'or, portée par les plus nobles princes de l'empire, le « Fils du Soleil » est escorté par pas moins de 30 000 hommes et femmes de sa cour et de son armée. Un prêtre espagnol présente une bible au prince en lui demandant s'il accepte de suivre la « parole du Dieu unique ». Atahualpa se saisit du livre et le porte à son oreille. Celui-ci s'exclame qu'il n'entend aucune parole et jette le livre à terre. Erreur fatale : pour les Espagnols, le sacrilège sera le prétexte qu'ils attendaient pour capturer le prince, et ils donnent alors le signal de l'attaque.
Cachés dans les maisons de la ville, les Espagnols en armes se ruent sur les Indiens venus désarmés. Ayant attaché des grelots aux jambes de leurs chevaux et tirant en tout sens avec leurs fusils, ils créent une véritable panique chez les Indiens, ceux-ci tentent de s'enfuir de la place dont les issues sont trop petites, beaucoup sont déjà piétinés. Les Espagnols finissent par se saisir de lui et le souverain inca est fait prisonnier. Mais cela ne semble pas suffire aux Espagnols qui, jusqu'à la nuit tombée, pourchassent les Indiens dans toute la vallée, laissant derrière eux plus de vingt mille cadavres dont une grande partie de la noblesse et de l'élite impériale venue en paix.
Voyant que les Espagnols portaient un intérêt spécial aux métaux précieux, le prince propose pour sa libération une fabuleuse rançon en or et en argent. Les Espagnols acceptent. Sur ordre du souverain, les sujets apportent de tout l'empire une quantité extraordinaire d'or et d'argent, les temples sont vidés on parle alors de 12 tonnes d'or et d'argent.
Pendant sa détention, Atahualpa reçoit des nouvelles de ses armées : le prince de Cuzco, Huascar est fait prisonnier et est enfermé au Sacsahuaman, Atahualpa qui semble croire que les Espagnols vont le libérer, ordonne de faire exécuter son rival. On peut considérer qu'Atahualpa fait la même chose à son rival étant donné qu'Huascar avait demandé auparavant l’exécution de son demi-frère.
Exécution d'Atahualpa par le feu.
Funérailles d'Atahualpa.
Après versement de la rançon, les Espagnols, ayant pris la mesure de la puissance du prince en son royaume, commencent à penser que cet homme qui a tant de prestige et d'autorité sur son peuple finira tôt ou tard par reprendre le dessus sur eux. Les Espagnols les plus radicaux proposent d'exécuter le prince et de placer un empereur fantoche à sa place, lequel sera plus manipulable. Pizarro, à contre cœur, doit condamner Atahualpa qu'il a appris à estimer. Le prince est donc condamné à être brûlé sur un bûcher. Les Espagnols l'estimant le supplient de se convertir, auquel cas il sera garrotté et non brûlé ; Atahualpa accepte. L'exécution a lieu dans sa cellule le 29 août 1533.
L'empire inca est anéanti. Les Espagnols poursuivront leur plan en plaçant sur le trône Manco Inca aussi appelé Manco Capac II, qui par la suite mènera une grande rébellion.
Conséquences de l’exécution
Après l’exécution de l’empereur Atahualpa, l’empire Inca est anéanti. Les espagnols le remplacent par Manco Capac II (ou Manco Inca); demi-frère de Atahualpa et d’Huascar. Au départ, le plan des espagnols était de renverser l’empereur Atahualpa afin d’instaurer un monarque plutôt fantoche et plus facilement manipulable. Malgré cela, le nouvel empereur Manco Capac II s’est rebellé contre les conquistadors et réussit à renverser pendant quelque temps la puissance des espagnols. Après la guerre de résistance, les conquistadors amplifient leur puissance militaire au Pérou et Manco Capac II sera finalement assassiné par le fils de Diego de Almagro.
Le tombeau
L'historienne Tamara Estupiñán Viteri, chercheuse à l’Institut français des études andines, est convaincue que la dépouille d'Atahualpa se trouve sur un site archéologique qui a été découvert dans la région de Sigchos, dans l’actuelle province de Cotopaxi en Équateur3. Entre 2004 et 2010, Tamara Estupiñán Viteri y découvre les premiers vestiges, et à proximité, un lieu-dit appelé Machay qui signifie l’endroit où repose le malqui l'empereur en quechua. Les ruines apparentes sont constituées d’un bassin, alimenté par des canaux, surmonté d’une plateforme ou d’un ushnu, une sorte d’oratoire solaire où pouvait s’asseoir l’Inca, et d’une place en forme de trapèze. Une campagne de fouilles devrait débuter en avril 2012
Représentations
Aux yeux de nombreux habitants des pays andins, le prince Atahualpa reste une figure historique très estimée en raison de l'aspect tragique de sa capture par les Espagnols.
Il est également souvent considéré comme le XIIIe et dernier empereur inca annoncé par la prophétie faite à l'époque de Tupac Yupanqui.
Par ailleurs la capture de l'empereur Atahualpa à Cajamarca fut l'objet d'un poème de Pablo Neruda : Las Agonías.
liens
http://youtu.be/bSR2U56Qsp0 Atahualpa bande annonce film en espagnol
http://youtu.be/tfxa4SQz3X8 Loss Sigchos
http://youtu.be/7wQJ6yjdLM8 Atahualpa
http://youtu.be/f-jDOqyeedM L4EMPIRE iNCA
http://youtu.be/gAzGhF3iF_s Tombe des restes présumés d'atahualpa
http://www.ina.fr/video/CPB75055760/p ... erant-du-perou-video.html Pizarre
          
Posté le : 16/11/2014 17:36
Edité par Loriane sur 17-11-2014 12:01:17
Edité par Loriane sur 17-11-2014 12:09:32
Edité par Loriane sur 17-11-2014 12:18:00
Edité par Loriane sur 19-11-2014 17:40:25
|
|
|
|
|
Re: Les expressions |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
« Les carottes sont cuites »
Tout est perdu.
Il n'y a plus aucun espoir.
Pourquoi ces carottes sont-elles cuites lorsqu'il n'y a plus rien à faire pour sauver la situation ?
Remontons d'abord au XVIIe siècle.
A cette époque et encore longtemps après, la carotte est considérée comme un aliment pauvre. Mais, du fait d'une forme similaire et d'une prononciation très proche paronymie, elle est aussi associée à la 'crotte'. On disait d'ailleurs de quelqu'un de constipé qu'il "chiait des carottes".
Un peu plus tard, "ne vivre que de carottes", c'était "vivre très chichement".
Cette valeur péjorative liée à la carotte est restée et, à la fin du XIXe siècle, "avoir ses carottes cuites", c'était "être mourant", mais sans qu'on sache exactement le pourquoi de cette association du bientôt mort avec ces légumes cuits peut-être était-ce par allusion au fait que, dans les familles pauvres, les plats de viande -donc d'animal mort- étaient souvent accompagnés de carottes également cuites ?.
Toujours est-il que c'est cette notion de carottes qui marquent un état sans espoir, où on ne peut plus rien, qui est arrivée jusqu'à nous.
La phrase "les carottes sont cuites", je répète "les carottes sont cuites", a fait partie de celles, nombreuses, qui ont servi de code à la radio de Londres pour déclencher des actions ou opérations dans les territoires occupés par l'Allemagne pendant la seconde guerre mondiale. Pourtant, pour qu'elles opposent de la résistance, les carottes doivent rester crues.
Et puis une question existentielle majeure nous vient obligatoirement à l'esprit à la lecture de cette expression : pourquoi, lorsque les carottes sont cuites, est-ce "la fin des haricots" ?
Posté le : 16/11/2014 12:03
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
85 Personne(s) en ligne ( 48 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 85
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages