|
|
Re: Défi du 15-11-2014 |
|
Administrateur  
Inscrit:
30/05/2013 12:47
Niveau : 34; EXP : 7
HP : 0 / 826
MP : 540 / 26786
|
merci couscous pour ce récit, qui tend à prouver que l'abus de boisson, ne diminue en rien les facultés d''entreprendre!!
OUF, je suis rassuré , et vais de ce pas m'enfiler un godet de riesling, qui me reste de la poule faisane d'hier, cuisinée au choux et vin d’Alsace.....!!!!!
Belle rigolade, que cette délicieuse lecture
Amitiés de Touraine
Posté le : 17/11/2014 11:52
|
|
_________________
Le bonheur est une chose qui se double,..…..si on le partage …
Titi
|
|
|
Re: Défi du 15-11-2014 |
|
Administrateur  
Inscrit:
30/05/2013 12:47
Niveau : 34; EXP : 7
HP : 0 / 826
MP : 540 / 26786
|
Il était un bonhomme, fatigué par les ans
Qui de sa vie voyait le tout dernier tournant
Il avait amassé, à force de travail
Des quantités d’argent, qu’il offrait à es ouailles
Mais le vieux, fort conscient, que ses pauvres douleurs
Il les devait sans doute à un trop dur labeur
Énonçât à ses fils, ce propos fort bizarre
Je lègue ma fortune au meilleur combinard
Les 3 enfants, dés lors, de montrer au vieillard
Combien chacun d’entre eux, était fort débrouillard
Ainsi, ce fut l’ainé diplômé de l’ENA
Qui sans perdre un instant à la tache s’attela
Décrivant à son père, sa ‘’pénible’’ journée,
Ou, le plus gros effort était de détourner
De leur but avoué, les réformes votées
Par tous les députés, qui d’ailleurs s’en foutaient….
Le second des fistons, qui travaillait en Suisse
Conseillait les nantis, et tous ceux blanchissent,
Un peu de leur fortune, de provenance honteuse.
L’argent n’a pas d’odeur, dans la gente douteuse
Le troisième larron, pas futé, pas malin
Mais étant terrassier, et sachant où l’ancien
Avait dans le jardin, enterré le trésor
A l’aide d’une bêche, eut le magot dans l’heure.
Entre temps le bonhomme avait rejoint St Pierre
En étant, de l’issue obtenue, pas peu fier
Lui qui, toute sa vie, avait comme démarche :
L’intello assis va, moins loin qu’un con qui marche.
Posté le : 17/11/2014 11:29
|
|
_________________
Le bonheur est une chose qui se double,..…..si on le partage …
Titi
|
|
|
Re: Les expressions |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
« Avoir voix au chapitre »
Être consulté, avoir le droit d'exprimer une opinion, de participer à une délibération.
Par extension : avoir de l'influence, avoir autorité pour se mêler d'une affaire.
Ce chapitre-là n'a strictement rien à voir avec celui d'un livre.
Le nôtre remonte au Moyen Âge. Il concerne le clergé dans lequel le chapitre désigne à la fois le corps des chanoines d'une cathédrale ou d'une église importante, l'assemblée des moines et chanoines qui traite des affaires de leur communauté et le lieu dans lequel se tient cette assemblée.
Celui qui avait voix au chapitre était celui qui pouvait participer aux prises de décisions, celui qui avait une voix lors des délibérations aux cours des assemblées, droit qui était ouvert aux chanoines et à leurs supérieurs comme les évêques, mais pas aux serviteurs et moinillons également présents.
L'expression, qui a gardé le sens d'origine, ne semble apparaître qu'au XVIe siècle, malgré l'ancienneté des chapitres.
Posté le : 17/11/2014 09:28
|
|
|
|
|
Jean Le rond d''Alembert |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 16 novembre 1717 à Paris naît Jean le Rond D’Alembert
mort, à 65 ans le 29 octobre 1783 dans la même ville, mathématicien, philosophe et encyclopédiste français de l'académie française et de l'académie des sciences
Il est célèbre pour avoir dirigé l’Encyclopédie avec Denis Diderot jusqu’en 1757 et pour ses recherches en mathématiques sur les équations différentielles et les dérivées partielles.
En bref
L'un des mathématiciens et physiciens les plus importants du XVIIIe siècle, d'Alembert fut aussi un philosophe marquant des Lumières. Dans les sciences aussi bien qu'en philosophie, il incorpora la tradition du rationalisme cartésien aux conceptions newtoniennes, ouvrant la voie du rationalisme scientifique moderne, du moins dans sa direction physico-mathématique. Il développa le calcul différentiel et intégral calcul aux dérivées partielles, généralisa et étendit la mécanique newtonienne et ses applications principe de d'Alembert, hydrodynamique, problème des trois corps : son œuvre représente une étape décisive avant celles de Lagrange et de Laplace. Ses analyses épistémologiques originales constituent une véritable philosophie des sciences liée à une théorie de la connaissance tributaire de Locke et Condillac et annoncent, par leur modernité, bien des développements ultérieurs. Codirecteur avec Diderot de l'Encyclopédie, dont il rédigea beaucoup d'articles, ami de Voltaire, membre de nombreuses académies, il fut un des protagonistes les plus éminents de la lutte des Lumières contre l'absolutisme religieux et politique.
Ses contributions à l'Encyclopédie débordèrent rapidement ses attributions initiales, puisque c'est à lui qu'échut la rédaction du Discours préliminaire publié en tête du premier volume en 1751, discours qui apparaît comme un véritable manifeste des Lumières et qui fut immédiatement salué comme un chef-d'œuvre. En même temps qu'il développait ses vues philosophiques dans des articles de l'ouvrage, par exemple Élémens des sciences aussi bien qu'en marge de ce dernier, Essai sur les élémens de philosophie, 1759 ; Éclaircissements à cet Essai, 1765 ; volumes de Mélanges, il participait à l'orientation idéologique de l'Encyclopédie par des préfaces très polémiques et des articles tels Dictionnaire, ou Genève, où il prenait nettement des positions antimétaphysiques et antiabsolutistes. Des divergences tactiques aussi bien que philosophiques l'opposèrent bientôt à Diderot, et il démissionna de l'Encyclopédie en mars 1759, mais revint quelques mois plus tard pour se consacrer uniquement à la partie mathématique et physique. Sa brouille avec Diderot dura jusqu'en 1765.
Cible privilégiée des adversaires de l'Encyclopédie, d'Alembert entretint par ailleurs des rapports étroits – surtout épistolaires – avec les « souverains éclairés Frédéric de Prusse et Catherine de Russie. Il refusa toutefois d'entrer à leur service, et déclina la présidence de l'Académie de Berlin que lui offrait Frédéric, la fonction de précepteur de son fils que lui proposait Catherine.
Méfiant à l'égard du pouvoir de l'aristocratie, mal vu par la Cour – son Essai sur les gens de lettres et sur les Grands paru en 1759 n'était pas fait pour améliorer ces relations –,il opposait à l'idéologie de la noblesse et du sang celle des talents et de l'égalité, les valeurs sur lesquelles la société devait s'appuyer étant la science et le commerce. Affirmant dès le Discours préliminaire l'existence d'un lien direct entre le progrès des connaissances et le progrès social, d'Alembert représente, comme la plupart des autres philosophes et encyclopédistes, l'intellectuel organique au sens de Gramsci qui exprime l'idéologie de la nouvelle classe montante, la bourgeoisie. Ce combat, il l'a mené par ses écrits de l'Encyclopédie, quelques rares pamphlets, dont La Destruction des Jésuites en France, publié anonymement en 1764, et surtout par son action au sein des académies, où son influence devint peu à peu prépondérante et où il assura la suprématie du parti philosophique.
Membre de l'Académie française depuis 1754, il en devint secrétaire perpétuel en 1772. Il y donna de nombreux éloges historiques, qui constituent une véritable histoire de l'Académie française de 1679 à 1687. Traducteur de Tacite, il donna aussi d'autres contributions littéraires de moindre importance.
Il mourut le 29 octobre 1783, au faîte de sa gloire, d'une maladie de la vessie.
Sa vie
Le 16 novembre 1717, on recueille sur les marches de l'église Saint-Jean-le-Rond, dans le cloître Notre-Dame, un nouveau-né abandonné dans une boîte de sapin. Porté à l'hospice des Enfants-Trouvés et baptisé sous un nom qui rappelle le lieu de sa découverte, il est ensuite confié à la femme d'un pauvre vitrier.
Fruit d’un amour illégitime entre la célèbre femme de lettres et salonnière Claudine Guérin de Tencin et le chevalier Louis-Camus Destouches, commissaire d’artillerie, D’Alembert naît le 16 novembre 1717 à Paris. Le lendemain, il est abandonné par sa mère qui le fait porter par un serviteur sur les escaliers de la chapelle Saint-Jean-le-Rond attenant à la tour nord de Notre-Dame de Paris. Comme le veut la coutume, il est nommé du nom du saint protecteur de la chapelle et devient Jean Le Rond. Il est d’abord placé à l’hospice des Enfants-Trouvés, mais son père le retrouve rapidement et le place dans une famille d’adoption. Bien qu’il ne reconnaisse pas officiellement sa paternité, le chevalier Destouches veille secrètement à son éducation en lui accordant une pension et le visite quelquefois chez sa nourrice, madame Rousseau, née Étiennette Gabrielle Ponthieux ca 1683 - 1775 la fameuse vitrière chez qui d’Alembert vivra jusqu’à ses cinquante ans.
Études Doué pour les mathématiques
Entré à douze ans au collège des Quatre-Nations, le jeune garçon étonne ses professeurs par ses dons pour les langues anciennes et la spéculation philosophique. Maître ès arts en 1735, auteur d'un commentaire de l'Épître de saint Paul aux Romains qui enthousiasme ses professeurs jansénistes, il refuse cependant de se consacrer à la théologie et suit les cours de l'École de droit.
Avocat en 1738, il s'essaie à la médecine, mais découvre assez vite sa véritable vocation : les mathématiques, qu'il a plutôt réinventées qu'apprises à l'aide de quelques leçons d'un unique professeur.
Premiers travaux scientifiques
À 21 ans, en 1739, il présente à l’Académie des Sciences, son premier travail en mathématiques à la suite d'une erreur qu’il avait décelée dans l’Analyse démontrée, ouvrage publié en 1708 par Charles-René Reynaud avec lequel D’Alembert avait lui-même étudié les bases des mathématiques. En 1741, il est admis à l'Académie royale des sciences de Paris et un an plus tard, il est nommé adjoint de la section d’Astronomie de l’Académie des sciences où son grand rival en mathématiques et en physique fut Alexis Clairaut. En 1743, il publie son célèbre Traité de Dynamique, qui dans l’histoire de la mécanique représente l’étape qu’il fallait franchir entre l’œuvre de Newton et celle de Lagrange. En 1746, il est élu associé géomètre.
Des travaux scientifiques à la pointe de son temps
Dès 1739, il adresse à l'Académie des sciences des observations sur l'Analyse démontrée du P. Reyneau, puis l'année suivante un mémoire sur la réfraction des corps solides. Le 29 mai 1741, il est nommé adjoint dans la section d'astronomie. Associé géomètre en 1746, pensionnaire surnuméraire en 1756, il ne sera titulaire qu'en 1765, mais il lui a fallu moins de dix ans pour donner l'essentiel de son œuvre scientifique, toute centrée sur la mécanique.
Son Traité de dynamique 1743 est fondé sur le « principe de d'Alembert », qui ramène la dynamique à la statique.
En 1752, il établit les équations rigoureuses et générales du mouvement des fluides.
Ses recherches de mécanique, d'acoustique et d'astronomie le conduisent à approfondir et à perfectionner l'outil analytique de son siècle. Il montre que le corps ℂ des nombres complexes suffit à tous les besoins de l'analyse et donne une démonstration, la première, du théorème fondamental de l'algèbre 1746. Premier à utiliser un développement de Taylor avec reste explicité sous forme d'intégrale 1754, il trouve la solution générale d'une équation aux dérivées partielles (Recherches sur les cordes vibrantes, 1747 et propose une méthode de résolution des systèmes d'équations différentielles. En 1768, il utilise, dans un cas particulier, le critère de convergence des séries qui porte son nom.
Il entre à l’Académie de Berlin à 28 ans. La suite de sa carrière à l’Académie des Sciences sera moins brillante. Nommé pensionnaire surnuméraire en 1756, ce n’est qu’en 1765, à 47 ans, qu’il devient pensionnaire.
L’homme de lettres
Ami de Voltaire et constamment mêlé aux controverses passionnées de ce temps, D’Alembert est un habitué des salons parisiens, notamment ceux de Marie-Thérèse Geoffrin, de Marie du Deffand et de Julie de Lespinasse, de la duchesse du Maine au Château de Sceaux, faisant partie des Chevaliers de la Mouche à Miel, invité des Grandes Nuits de Sceaux.
C’est là qu’il rencontre Denis Diderot, en 1746. L’année suivante, ils prennent conjointement la tête de L’Encyclopédie. En 1751, après cinq ans de travail de plus de deux cents contributeurs, paraît le premier tome de l’Encyclopédie dont D’Alembert rédige le Discours préliminaire.
En 1754, D’Alembert est élu membre de l’Académie française, dont il deviendra le secrétaire perpétuel le 9 avril 1772. L'année 1757 voit la parution de l’article Genève dans l’Encyclopédie, provoquant la vive réaction de Jean-Jacques Rousseau Lettre sur les spectacles, 1758. Après plusieurs crises, la publication de l’Encyclopédie est suspendue de 1757 à 1759. D’Alembert se retire de l’entreprise, en 1757, après s’être fâché avec Diderot.
Un homme fidèle
Célébré par les académies, d'Alembert est alors découvert par les salons : lancé par Mme Geoffrin, il devient, dès la fin de l'année 1748, l'un des hôtes les plus assidus de Mme du Deffand. Désireux de plaire et jaloux de son repos, irritable mais généreux, défenseur du goût et ne dédaignant pas le calembour, d'Alembert apparaît comme un personnage ondoyant, inégal : Je change à mon gré de visage …, lui fait dire Chamfort, je contrefais même le sage. Il possède, il est vrai, un véritable talent d'imitation il parodie les acteurs de l'Opéra ou ses savants confrères, qu'il n'hésite pas à faire applaudir jusque dans les séances publiques de l'Académie française.
Mais d'Alembert témoigne de qualités plus réelles, quoique plus discrètes. Ainsi la fidélité. À l'égard, d'abord, de la seule passion de sa vie, Julie de Lespinasse. Enfant naturelle comme lui, entrée chez Mme du Deffand comme demoiselle de compagnie, elle doit à d'Alembert de conserver la société des encyclopédistes lorsque la marquise la chasse en 1764. C'est lui qui la soigne lorsqu'elle est atteinte de la petite vérole. Il n'y a entre nous ni mariage ni amour, écrit-il à Voltaire, mais de l'estime réciproque et toute la douceur de l'amitié.
Fidélité aussi à sa nourrice : jusqu'à l'âge de quarante-sept ans, d'Alembert rentre chaque soir dans sa petite chambre de la rue Michel-le-Comte, qu'il ne quittera, atteint d'une fièvre en 1765, que sur les instances de son médecin.
Fidélité encore à ses amis : c'est pour eux qu'il mène une vie casanière, entrecoupée seulement d'un séjour aux Délices, chez Voltaire 1756, de deux voyages auprès du roi de Prusse Frédéric II, en 1755 à Wesel, en 1763 à Potsdam, d'une excursion en Provence en 1770. Il refuse de succéder à Maupertuis à la présidence de l'Académie de Berlin, il décline, en 1762, l'offre de Catherine II de Russie de diriger l'éducation de son fils, le grand-duc héritier.
Fidélité enfin à l'esprit philosophique, moins par l'exposé d'un système de pensée rigoureux que par son attachement à une certaine attitude mentale.
Un esprit sceptique
Sceptique et doutant même de la valeur du scepticisme, il pense qu'il n'y a point de science qui n'ait sa métaphysique ; et en métaphysique non ne lui paraît guère plus sage que oui.
Cherchant à fonder la morale aussi bien que la logique sur des principes simples, il accorde cependant une place à l'intuition en mathématiques et finit par croire que tout ce que nous voyons n'est qu'un phénomène qui n'a rien hors de nous de semblable à ce que nous imaginons ».
On prétend qu'il confesse la vérité avec plus d'héroïsme dans sa correspondance que dans ses publications officielles. Mais il fait l'apologie du christianisme dans une lettre à Catherine II et regrette l'athéisme de Lucrèce dans la préface à ses Éloges de plusieurs savants 1779. Protagoras, le surnomme Voltaire. S'il a du sophiste grec le dédain du dogmatisme, il en a aussi la souplesse, l'art de persuader .
Le rôle de d'Alembert a été essentiel dans la diffusion des idées nouvelles, qu'il savait présenter sans agressivité, les colorant habilement de sa bonhomie et de son prestige. C'est ce talent qu'il sut si bien utiliser dans la présentation de l'Encyclopédie.
Après
Il quitte la maison familiale en 1765 pour vivre un amour platonique et difficile avec l’écrivain Julie de Lespinasse, qui disparaît en 1776.
Jusqu’à sa mort, il continue ses travaux scientifiques et disparaît au faîte de sa célébrité, prenant ainsi une revanche éclatante sur sa naissance. Il est enterré sans cérémonie religieuse.
Postérité
Nicolas de Condorcet en a fait l’éloge funèbre en 1783, soulignant ses apports scientifiques.
Son œuvre complète a été republiée en 1805 et en 1821-1822, toutefois sans les écrits scientifiques. La sortie en cours de ses Œuvres complètes aux Éditions du CNRS réparera cette omission.
Son œuvre L’Encyclopédie
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.
En 1745, D’Alembert, qui était alors membre de l’Académie des sciences, est chargé par André Le Breton, d’abord sous la direction de Gua de Malves, de traduire de l’anglais en français le Cyclopaedia d’Ephraïm Chambers. D’une simple traduction, le projet se transforme en la rédaction d’une œuvre originale et unique en son genre, l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. D’Alembert écrira le fameux Discours préliminaire ainsi que la plupart des articles sur les mathématiques, l’astronomie et la physique. Il rédige(sous la signature O ainsi près de 1700 articles, la plupart concernant les mathématiques au sens large mais baisse très sensiblement son niveau de participation à partir de 1762.
D'Alembert est l'un des quatre rédacteurs des articles d'astronomie, avec Jean-Baptiste Le Roy, Jean Henri Samuel de Formey, et Louis de Jaucourt. Il apporte des preuves de l'héliocentrisme avec les arguments nouveaux de la mécanique newtonienne. Adoptant un ton militant, il ne manque aucune occasion de se moquer des ecclésiastiques et critique sévèrement l'Inquisition, jugeant dans le Discours préliminaire que « l'abus de l'autorité spirituelle réunie à la temporelle forçait la raison au silence ; et peu s'en fallut qu'on ne défendit au genre humain de penser.
Penser d’après soi et penser par soi-même, formules devenues célèbres, sont dues à D’Alembert ; on les trouve dans le Discours préliminaire, Encyclopédie, tome 1, 1751. Ces formulations sont une reprise d’injonctions anciennes Hésiode, Horace.
Mathématiques Le théorème de D’Alembert
Dans le Traité de dynamique, il énonce le théorème de d'Alembert aussi connu sous théorème de Gauss-d’Alembert qui dit que tout polynôme de degré n à coefficients complexes possède exactement n racines dans, non nécessairement distinctes, il faut tenir compte du nombre de fois qu’une racine est répétée. Ce théorème ne sera démontré qu’au XIXe siècle par Carl Friedrich Gauss, qui localise plusieurs failles dans une démonstration proposée par d'Alembert. Louis de Broglie présente ce théorème ainsi : On lui doit le théorème fondamental qui porte son nom et qui nous apprend que toute équation algébrique admet au moins une solution réelle ou imaginaire Réf. en bibliographie.
Règle de D’Alembert pour la convergence des séries numériques
Soit une série à termes strictement positifs pour laquelle le rapport tend vers une limite . Alors :
si L<1 : la série de terme général converge ;
si L>1 : la série de terme général diverge car ;
si L=1 : on ne peut conclure.
Martingale de D’Alembert :
À un jeu où l’on gagne le double de la mise avec une probabilité de 50 % (par exemple à la roulette, en jouant pair / impair, passe / manque), il propose la stratégie suivante :
Miser une unité
Si l’on gagne, se retirer
Si l’on perd, miser le double (de quoi couvrir la perte antérieure et laisser un gain
continuer jusqu’à un gain… ou épuisement
Avec ce procédé, le jeu n’est pas forcément gagnant, mais on augmente ses chances de gagner un peu au prix d’une augmentation de la perte possible (mais plus rare). Par exemple, si par malchance on ne gagne qu’à la dixième fois après avoir perdu 9 fois, il aura fallu miser et perdre 1+2+4+8+16+32+64+128+256+512 = 210-1 unités, pour en gagner 1024, avec un solde final de seulement 1 ! Et il aura fallu être prêt à éventuellement supporter une perte de 1023, avec une probabilité faible (1/1024), mais non nulle. Même avec une richesse de départ infinie ? et une durée de jeu sans limite, il faut encore faire face à l’éventualité que le jeu ne s’arrête jamais.
Enfin, il faut s’abstenir de jouer à nouveau après un gain, puisque cela a l’effet inverse à celui de la martingale (augmenter la probabilité de la perte).
Il existe d’autres types de martingales célèbres, qui toutes nourrissent le faux espoir d’un gain certain.
L’attribution de cette martingale à D’Alembert est néanmoins sujette à caution.
Dans la réalité, la possibilité d'utiliser cette martingale est limitée par le plafonnement des mises par les casinos.
On peut d'ailleurs remarquer que dans un épisode de Futurama, série télévisée, le docteur Zoidberg applique cette loi en misant l'ensemble de ce qu'il a gagné à chaque fois.
Astronomie
Il étudia le problème des trois corps et les équinoxes, dans le mémoire publié en 1749 sur la précession des équinoxes. Ce phénomène, dont la période est de 26 000 ans, avait été constaté par Hipparque dans l’Antiquité. Newton avait compris que la cause de ce phénomène résidait dans l’action des forces de gravitation sur le corps non rigoureusement sphérique qu’est le globe terrestre. Mais c’est à D’Alembert qu’il revint de pousser les calculs et d’obtenir des résultats numériques en accord avec l’observation. D’Alembert fit également progresser le difficile problème que constituait pour les astronomes l’explication du mouvement lunaire. En ce sens, il est le précurseur de la Mécanique céleste de Laplace.
D’Alembert travailla également sur le problème de l’aberration chromatique qui limitait la précision des lunettes astronomiques, en concurrence avec Alexis Claude Clairaut et avec Leonhard Euler. Il proposa de superposer plusieurs lentilles de forme et d’indice différent. Il fit également des avancées sur le problème des aberrations hors-axe.
En 1970, l'Union astronomique internationale a attribué le nom de D'Alembert à un cratère lunaire en son honneur.
Physique
En 1743 dans le Traité de dynamique dans lequel il énonce le principe de la quantité de mouvement, qui est parfois appelé principe de D'Alembert.
Si l’on considère un système de points matériels liés entre eux de manière que leurs masses acquièrent des vitesses respectives différentes selon qu’elles se meuvent librement ou solidairement, les quantités de mouvements gagnées ou perdues dans le système sont égales.
Ce principe a servi de base au développement de la mécanique analytique. D’Alembert considère le cas général d’un système mécanique qui évolue en restant soumis à des liaisons ; il montre que les forces de liaison s’équilibrant, il doit y avoir équivalence entre les forces réelles qui impriment son mouvement au système et les forces qu’il faudrait mettre en œuvre si les liaisons n’existaient pas. Ce faisant, il éliminait les forces de liaison, dont les formes sont généralement inconnues, et, ramenait, d’une certaine manière, le problème de la dynamique envisagé à une question d’équilibre, c’est-à-dire de statique. Cela permettait de ramener tout problème de statique à l’application d’un principe général, qu’on nommait alors le principe des vitesses virtuelles. Ce faisant, D’Alembert jetait les bases sur lesquelles Lagrange allait bâtir l’édifice grandiose de la Mécanique céleste.
Il étudia aussi les équations différentielles et les équations à dérivées partielles.
En hydrodynamique, on lui doit d’avoir démontré le paradoxe qui porte son nom : il montra que, d’après les solutions les plus simples des équations hydrodynamiques, un corps devrait pouvoir progresser dans un fluide sans éprouver aucune résistance ou, ce qui revient au même, qu’une pile de pont plongée dans le cours d’un fleuve ne devait subir de sa part aucune poussée. C’était obtenir un résultat contraire à l’intuition et à l’expérience. Il fallut attendre la théorie des sillages, qui substitue aux solutions continues simples de l’hydrodynamique, des solutions de surfaces de discontinuités et mouvements tourbillonnaires, pour venir à bout de cette difficulté qu’avait soulevée D’Alembert.
Il est également à l’origine de l’équation de d'Alembert.
Philosophie
D’Alembert découvre la philosophie au collège janséniste des Quatre-Nations. Il s’intéresse également aux langues anciennes et à la théologie (il commente entre autres l’Épître de saint Paul aux Romains). À la sortie du collège, il laisse définitivement de côté la théologie et se lance dans des études de droit, de médecine et de mathématiques. De ses premières années d’études, il conservera une tradition cartésienne qui, intégrée aux conceptions newtoniennes, ouvrira la voie au rationalisme scientifique moderne.
C’est l’Encyclopédie, à laquelle il collaborera avec Diderot et d’autres penseurs de son temps, qui lui donnera l’occasion de formaliser sa pensée philosophique. Le Discours préliminaire de l’Encyclopédie, inspiré de la philosophie empiriste de John Locke et publié en tête du premier volume 1751, est souvent considéré, et avec raison, comme un véritable manifeste de la philosophie des Lumières. Il y affirme l’existence d’un lien direct entre le progrès des connaissances et le progrès social.
Contemporain du siècle des Lumières, déterministe et déiste, D’Alembert fut l’un des protagonistes, ainsi que son ami Voltaire, de la lutte contre l’absolutisme religieux et politique qu’il dénonce dans les nombreux articles philosophiques qu’il écrivit pour l’Encyclopédie. La compilation de ses analyses spirituelles de chaque domaine de la connaissance humaine traité par l’Encyclopédie, constitue une véritable philosophie des sciences.
Dans Philosophie expérimentale, D’Alembert définit ainsi la philosophie : La philosophie n’est autre chose que l’application de la raison aux différents objets sur lesquels elle peut s’exercer.
D’Alembert est représenté dans l’Entretien entre d’Alembert et Diderot, le Rêve de d’Alembert et la Suite de l’entretien été 1769 par Diderot.
La philosophie des sciences
En contrepoint à son œuvre scientifique et en relation avec elle, d'Alembert a développé une théorie de la connaissance influencée par Locke et le sensualisme de Condillac, mais centrée avant tout sur une épistémologie de la physique newtonienne. C'est à nos sensations que nous devons nos connaissances ; la première est la conscience d'exister, qui légitime l'exercice de la pensée, la deuxième est l'existence des objets extérieurs, qui assure le fondement de la validité des sciences. Mais la connaissance nécessite la médiation de la raison entre le réel et la pensée. Il y a une physique de l'âme – celle de Locke – et une physique des corps qui, bien que distinctes, entretiennent des relations. Les faits de la première sont de plain-pied avec l'attention de la raison, et l'esprit est une nature simple : de cette simplicité découle l'illumination de la connaissance mathématique. La physique des corps suppose l'attention au monde extérieur ; elle vise à l'unification des faits par la pensée rationnelle s'appuyant sur l'expérience. D'Alembert distingue les sciences empiriques, éloignées de cette unification, et les sciences physico-mathématiques, dont le statut est mixte, relatives à des objets concrets mais descriptibles par abstraction, au moyen des mathématiques : leurs propriétés peuvent être retrouvées par un raisonnement déductif, à partir des principes fondamentaux auxquels ils ont été ramenés. La mécanique est rationnelle en raison du degré de certitude auquel elle est parvenue, dû à son caractère mathématisé. Réaliste, prônant le recours à l'expérience, il fut en même temps profondément rationaliste dans la lignée de Descartes. Mais, bien que la raison ait été sa référence fondamentale, à tel point qu'il désirait fonder sur ses principes les plus évidents la science physico-mathématique – il essaya de « démontrer » les trois lois fondamentales de la mécanique, qu'il considérait comme des « principes » –, son programme ne peut être dit cartésien. Il rejette en effet les idées innées et accepte la critique d'une rationalité apparente requise par la considération de faits irréductibles. Le concept d'attraction revêt dans son épistémologie une importance considérable. L'attraction n'est pas réductible aux principes rationnels de la mécanique : ce sont les faits qui l'imposent, et ce concept nous oblige à réviser ce qu'il faut entendre par naturel, évident, rationnel. Il en résulte une modification, une critique en quelque sorte, de notre conception de la rationalité : une fois accepté le concept d'attraction, l'astronomie est rationnelle. La critique de l'évidence effectuée dans le cas de l'attraction est ensuite étendue à d'autres concepts qui paraissaient correspondre à une clarté immédiate, celui d'impénétrabilité par exemple. Sa critique des concepts physiques ou mathématiques vise à assurer les fondements d'une connaissance certaine, et se situe dans le courant d'une lutte contre la métaphysique scolastique. Son rejet du concept de force comme de la considération d'une texture intime des corps bien qu'il accepte l'atomisme semblent faire de lui, par le refus de ce qui ne serait pas directement mesurable, l'annonciateur du positivisme de Laplace et de Comte : mais d'Alembert considère que la pensée peut parvenir à la connaissance du réel, et il faut plutôt voir dans sa position un effet de sa conception sur la connaissance mathématique qui est seule vraiment illuminatrice de la raison.
Son épistémologie est en définitive un réalisme rationnel référé à l'être même de la nature – la raison et la nature se rejoignent en profondeur. Elle présente cette originalité d'intervenir à partir de et après la connaissance scientifique, ce qui lui permet de garantir une autonomie des sciences par rapport aux constructions à priori, au sein d'une théorie de la connaissance détachée des anciens systèmes métaphysiques, et de prétendre ainsi renouveler la métaphysique, en tant que recherche et énoncé des conditions de la connaissance. Pour cette raison, son épistémologie, qui s'attache à la considération de problèmes et de concepts précis, est indiscutablement moderne.
Sceptique en philosophie, il se rapprocha peu à peu d'un matérialisme dynamique proche de celui de Diderot. Son épistémologie précise et sa philosophie rationnelle mais informée de l'importance de l'expérience le situent à la croisée-amont des principaux courants philosophiques qui se fondent sur l'acquis des sciences : criticisme, positivisme, matérialisme.
Musique
D’Alembert est considéré comme un théoricien de la musique, en particulier dans Éléments de musique. Une controverse l’opposa à ce sujet à Jean-Philippe Rameau.
Étudiant la vibration des cordes, il parvint à montrer que le mouvement d’une corde vibrante est représenté par une équation aux dérivées partielles, et a indiqué la solution générale de cette équation. Cette équation des cordes vibrantes a été le premier exemple de l’équation des ondes. Cela fait de D’Alembert, l’un des fondateurs de la physique mathématique. Ses travaux ont été à l’origine de polémiques fécondes, lorsque Euler, à la suite de Bernoulli, eut donné sous la forme d’une série trigonométrique, une solution de l’équation des cordes vibrantes qui semblait totalement différer de celle de D’Alembert. Il a résulté de la discussion que la solution trigonométrique pouvait s’adapter à la représentation d’une forme initiale arbitraire de la corde.
Œuvres
Mémoire sur le calcul intégral 1739, première œuvre publiée
Traité de dynamique 1743 puis 1758
Traité de l’équilibre et du mouvement des fluides : pour servir de suite au Traité de dynamique
Réflexions sur la cause générale des vents 1747, Paris, David l'aîné
Recherches sur les cordes vibrantes 1747
Recherches sur la précession des équinoxes et sur la nutation de l’axe de la terre 1749
Discours préliminaire de l'Encyclopédie' 1751
Éléments de musique 1752
Mélanges de littérature et de philosophie 2 tomes 1753, 5 tomes 1759-1767
Essai sur les éléments de philosophie 1759
Éloges lus dans les séances publiques de l’Académie française 1779
Opuscules mathématiques 8 tomes, 1761
Œuvres complètes, Éditions CNRS, 2002
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Flammarion, 1993
Trois Mois à la cour de Frédéric lettres inédites de d’Alembert publ. et annotées par Gaston Maugras, Paris, C. Lévy, 1886
Correspondance avec Frédéric le Grand, éd. Preuss, Berlin, Duncker 1854, et al.
Inventaire analytique de la correspondance 1741-1783, éd. de Irène Passeron, CNRS éditions, 2009
Bibliographie
Joseph Bertrand, d’Alembert, texte disponible en ligne sur le projet Gutenberg.
Louis de Broglie, Un mathématicien, homme de lettres : d’Alembert, L’Encyclopédie et le progrès des sciences et des techniques, Centre International de synthèse, Paris,
La formation de D’Alembert , Recherche sur Diderot et sur l’Encyclopédie, no 38, 2008 résumé
D'Alembert : mathématicien des Lumières. Revue Pour la science
L'Encyclopédie de Denis Diderot et de Jean Le Rond d'Alembert
L'Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Denis Diderot (1713-1784) et de Jean Le Rond d'Alembert (1717-1783) a pris très tôt valeur de symbole. En elle se trouvent concentrés l'appétit de savoir qui habite le XVIIIe siècle, son goût des bilans et des sommes, l'intérêt porté aux sciences et techniques, l'extraordinaire développement que connaît alors l'imprimé, la présence militante de la philosophie, alliée à une nouvelle façon de concevoir le travail intellectuel. Enfin l'optimisme conquérant des Lumières apparaîtrait ici à son zénith. Sans nier toutes ces valeurs que la tradition lui attache, on s'interroge aujourd'hui, pour tenter de mieux le comprendre, sur la nature même du discours encyclopédique, sur sa diffusion réelle, ses lectures possibles et sa postérité.
Une archéologie, une histoire, une postérité
Le XVIIIe siècle n'a pas inventé l'Encyclopédie. Il y a dans son projet une pensée de l'homme et de la connaissance déjà présente dans la philosophie de la Renaissance, par exemple chez un Pic de la Mirandole. Et bien des tentatives l'ont précédée : en 1694, Thomas Corneille publie un Dictionnaire des arts et des sciences. En débattant de la notion d'antiquité, la querelle des Anciens et des Modernes a imposé l'idée d'un progrès des sciences et des arts. Le discours philosophique de Pierre Bayle prend la forme du Dictionnaire historique et critique 1697. En Angleterre se publient des dictionnaires techniques et la Cyclopaedia, or an Universal Dictionary of Arts and Sciences de Chambers 1728, que les libraires parisiens, en quête d'entreprises rentables, se proposent de traduire. En 1745, une équipe est constituée, des traducteurs désignés, un maître d'œuvre choisi : l'abbé Jean-Paul Gua de Malvés, qui s'attache les services de Diderot et de d'Alembert. Gua de Malvés est évincé en 1747 : la responsabilité de l'ouvrage est confiée à ses deux collaborateurs. Ces derniers recrutent un homme à tout écrire, Jaucourt, des plumes brillantes : Voltaire, Buffon, Rousseau, d'Holbach, Montesquieu, Marmontel, et toute une piétaille, essentielle à la bonne marche de l'entreprise.
Si le premier tome de l'Encyclopédie paraît en 1751, après la présentation générale du projet par Diderot dans son fameux Prospectus 1750, tout n'ira pas sans incidents de parcours, malgré la protection que lui accorda Malesherbes, directeur de la Librairie. Une première interdiction a lieu en 1752 : l'abbé de Prades, auteur de l'article Certitude voit sa thèse en Sorbonne condamnée par l'archevêque de Paris et le Parlement. Cette condamnation rejaillit sur les encyclopédistes, dénoncés comme une secte dangereuse. Le 7 février, le Conseil du roi condamne l'Encyclopédie au pilon. Un partie de la cour rassemblée défend l'ouvrage. L'attentat de Damiens contre le roi relance les attaques. D'Alembert abandonne la partie en 1758. La condamnation de De l'esprit d'Helvétius entraîne en 1759 celle de l'Encyclopédie, qui est interdite et mise à l'index. Les libraires font valoir les risques de ruine de l'édition parisienne et obtiennent un nouveau privilège. En 1759, on accuse les gravures de l'Encyclopédie de plagiat. C'est ainsi que les attaques les plus diverses accompagnèrent la publication des dix-sept tomes de l'Encyclopédie et de leurs onze volumes de planches, jusqu'en 1772. Mais de 1751 à 1782, on estime qu'il s'en vendit 25 000 exemplaires. À peine achevée, on la réédita ; on publia des suppléments, des abrégés. En 1782, le libraire Panckoucke entreprit la publication de l'Encyclopédie méthodique, qui compte plus de 200 volumes et fut achevée en 1832.
Le projet et les problèmes
L'ouvrage que nous commençons et que nous désirons de finir a deux objets : comme Encyclopédie, il doit exposer, autant qu'il est possible, l'ordre et l'enchaînement des connaissances humaines ; comme Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, il doit contenir sur chaque science et sur chaque art, soit libéral, soit mécanique, des principes généraux qui en sont la base, et les détails les plus essentiels qui en font le corps et la substance. Discours préliminaire de d'Alembert. Faire un bilan des connaissances, relier les sciences entre elles. Le projet est clairement défini dès l'origine. Diderot y ajoute la part faite aux techniques et aux métiers. Mais ce panorama vise aussi à dresser les efforts de l'esprit humain . Il n'est pas de savoir sans référence à la philosophie, qui exalte ici l'esprit des Lumières et se veut l'illustration d'une histoire des progrès de l'esprit humain en lutte contre l'ignorance. L'ouvrage est de consultation d'où son didactisme, son ordre alphabétique, le rôle donné au planches et, discrètement, de militantisme philosophique par le jeu des renvois ou, plus brutalement, par des articles qui dénoncent et prennent parti, comme l'article Prêtres que rédige d'Holbach.
Le temps et les poursuites dont elle fut victime aidant, on a interprété l'Encyclopédie comme un ouvrage éminemment subversif, incrédule et parfois athée. On a pris pour argent comptant les dénonciations de ses adversaires, et oublié les contraintes de lecture qu'il imposait. Son format in-folio et la durée de sa publication étalée sur plus de vingt ans, sa lecture de consultation, souvent strictement technique, rendaient peu efficace le système de renvois qui tourne court : il arrive qu'un renvoi annoncé n'existe pas. Il faut admettre que l'Encyclopédie est justiciable de diverses lectures : philosophiques, de consultation, de recours technique, de braconnage. Et toutes fondamentalement discontinues. On imagine mal aujourd'hui sa lecture de A à Z. Politiquement aussi, comme le prouvent les articles Peuple ou Autorité, l'Encyclopédie demeure prudente.
On a vu en elle, à la lumière d'une interprétation marxiste du XVIIIe siècle, une prise de possession triomphale du monde par une bourgeoisie en pleine ascension. Une telle vision n'est plus guère acceptée. L'Encyclopédie apparaît comme partagée entre l'orgueil intellectuel de classer, nommer, unifier et décrire, et la volonté de préserver les savoirs acquis d'une éventuelle destruction du monde civilisé, ainsi que l'affirme l'article Encyclopédie lui-même.
Lien
http://youtu.be/ZJBpRIIvzus Biographie courte
http://youtu.be/-vr6e0K85_E D'Alembert mathématicien
http://youtu.be/Su-B7859zTo?list=PL7x ... nXi7leEyXd6MmNOSJfNjrumzz
              [img width=-00]http://1.1.1.4/bmi/www.bkneuroland.fr/img/synesthesies/dossiersynesthesiemai2006/synesthesiemai2006.082.jpg[/img]  
Posté le : 16/11/2014 23:49
Edité par Loriane sur 19-11-2014 18:08:57
|
|
|
|
|
Nicolas Gilbert |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 16 novembre 1780 à Paris à 30 ans meurt Nicolas Joseph Florent Gilbert
né le 15 décembre 1750 dans le sud du Duché de Lorraine à Fontenoy-le-Château, poète lorrain francophone.
Après avoir vainement cherché à faire reconnaître son talent le Génie aux prises avec la fortune ou le Poète malheureux, 1772, il finit par trouver sa voie dans la satire antiphilosophique
En bref
Poète lorrain, Nicolas Gilbert doit une certaine réputation à la légende ou, plutôt, au mythe romantique du poète incompris, victime d'une société égoïste, tel que le représente Vigny dans Stello : on a fait de lui une sorte de Chatterton français. S'il est vrai qu'il est mort jeune, à vingt-neuf ans, il ne faut plus pour autant s'abuser aujourd'hui.
Gilbert naît à Fontenoy-le-Château Vosges, où son père agriculteur, marchand de grains, possède deux petites fermes, tout en exerçant les fonctions de maire 1742. Il fait une partie de ses études au fameux collège de l'Arc, à Dôle, puis il monte à Paris, à la conquête d'une gloire qu'il ne trouvera, de manière posthume, qu'au XIXe siècle. Bien reçu par d'Alembert, auquel il est recommandé par Mme de la Verpillière, femme du prévôt des marchands de Lyon, il aurait sans doute été gagné au parti philosophique, comme son compatriote Saint-Lambert. Il en fut autrement ; Gilbert entra dans le clan des réactionnaires, au côté de Fréron, l'illustre directeur de L'Année littéraire. Il publie, alors qu'il n'a pas vingt ans, un roman passé justement inaperçu, puis son Début poétique 1771. Il participe au concours annuel de l'Académie française, en proposant Le Poète malheureux ou le Génie aux prises avec la fortune 1772, aux épanchements plus ou moins autobiographiques, et une ode consacrée au Jugement dernier 1773, qui se termine par ces vers : L'Éternel a brisé son tonnerre inutile ; -Et, d'ailes et de faux dépouillé désormais, Sur les mondes détruits le temps dort immobile.
Ce sont deux échecs consécutifs le prix étant remporté deux fois par Jean-François La Harpe, fade poète, mais dévoué à la cabale philosophique dans les feuilles du Mercure de France qui sont ressentis par Gilbert comme deux humiliations. Après un séjour à Nancy, il se lance courageusement dans la satire, se montrant digne successeur de Juvénal, Régnier et Boileau, s'en prenant à Voltaire, Diderot, d'Alembert, La Harpe, et dénonçant avec violence, d'abord dans Le Dix-Huitième Siècle 1776 dédié à Fréron, ensuite dans Mon Apologie,1778, la licence de l'athéisme, la corruption des mœurs et la décadence littéraire de son temps : Parlerai-je d'Iris ? chacun la prône et l'aime ; -C'est un cœur, mais un cœur, -c'est l'humanité même. -Si d'un pied étourdi quelque jeune éventé -Frappe, en courant, -son chien qui jappe épouvanté, -La voilà qui se meurt de tendresse et d'alarmes ; -Un papillon souffrant lui fait verser des larmes : -Il est vrai ; mais aussi qu'à la mort condamné, Lalli soit en spectacle à l'échafaud traîné, -Elle ira la première à cette horrible fête -Acheter le plaisir de voir tomber sa tête.
Sa vie
Nicolas Joseph Florent Gilbert naît le 15 décembre 1750 à Fontenoy-le-Château actuellement dans les Vosges. Baptisé le lendemain il a pour marraine Marie Iroy et pour parrain, son grand-père, Nicolas Joseph Florent Blancheville dont il prend les prénoms. Son père, maire de Fontenoy-la-Côte, propriétaire de deux fermes, y exerce le métier de marchand de grains. Son éducation est confiée au curé du village, un jésuite qui, voyant en lui "un esprit apte à être éduqué", lui apprend le latin. Puis le jeune Nicolas part faire ses humanités au collège de l’Arc à Dole.
En 1768, à la mort de son père, il monte à Nancy, ancienne capitale du duché de Lorraine devenu Français en 1766, où il côtoie quelque temps les cercles littéraires. Il fréquente les salons de Darbès et ceux de du comte de Lupcourt et est reçu chez l'avocat Mandel. Il y fait ses débuts, avec un roman persan, les Familles de Darius et d’Éridame ou Statira et Amestris 1770 et quelques pièces poétiques, dont son début poétique, composé de trois héroïdes et, entre plusieurs odes, le Jugement dernier 1773.
Après 1770, il part pour Paris, avec en poche ses premiers vers, ainsi qu’une lettre, signée de Mme de La Verpillière, femme du prévôt des marchands de Lyon et mécène. Cette lettre recommande le jeune poète à D’Alembert. Il semble que D’Alembert, lui ayant promis une place de précepteur, n’honore pas cette espérance, et le reçoit d’ailleurs assez froidement :
Et ce froid d'Alembert, chancelier du Parnasse,
Qui se croit un grand homme et fit une préface
Nicolas Gilbert, Le Dix-huitième siècle
Gilbert se retrouve donc comme tant d’autres, reclus dans une mansarde, à tâcher de vivre de sa plume, misérablement en somme. Il fait publier ses premières pièces en vers en 1771 ; le volume est en butte à l’indifférence générale. Melchior Grimm écrit dans sa Correspondance littéraire : "M. Gilbert a donné, il y a quelque temps, un Début poétique qui n’a été lu de personne."
Il présente successivement en 1772, puis en 1773, deux pièces au concours de l’Académie française. Son œuvre Le Poète malheureux, emplie d’accents élégiaques, non dénuée d’un certain talent ou en tout cas, d’une certaine sensibilité, n’obtient pas même une mention ; c’est Jean-François de La Harpe, directeur du Mercure de France, qui reçoit le prix.
Sa deuxième pièce, L’Ode du Jugement Dernier, subit le même sort. Gilbert en concevra alors une haine certaine pour La Harpe en particulier, ainsi que pour les encyclopédistes, voire les philosophes en général, qui tiennent tout le Parnasse littéraire français : ainsi nomme-t-on à ce moment l’élite des écrivains. De son côté, La Harpe n’aura de cesse de tenir en mépris tout ce que produira Gilbert.
Probablement en 1774, par l’entremise de Baculard d’Arnaud, Gilbert rencontre Élie Fréron, qui dirige l'Année littéraire, pendant du Mercure de France. Gilbert assiste probablement à des dîners organisés par Fréron et s’engage à ses côtés, sans doute par rancœur envers le milieu littéraire parisien dans un premier temps. Grâce à la recommandation de Fréron, Gilbert obtint les faveurs de l’archevêché et plusieurs pensions, dont une du roi.
François de Neufchateau dans son poème Les Vosges, consacre une strophe à son compatriote :
Au rang des bons esprits dont j'exhume la gloire,
Dois-je placer Gilbert ? Parmi nous étant né
Du Dernier Jugement ce chantre infortuné,
L'indigence altéra son cerveau pindarique;
Il vendit au clergé sa plume satirique
Du talent le plus rare, ô malheureux emploi !
Sa muse, fléchissant sous cette affreuse loi,
Contre la raison même abuse de ses armes;
Mais ses derniers adieux nous font verser des larmes.
François de Neufchateau, 'Les Vosges'
En 1775 paraît sa première pièce majeure, qui marque son temps. C’est une satire en vers, Le Dix-huitième siècle, qui donne la caricature féroce de son temps ; la philosophie y est le principe de la chute des arts, de la perte des mœurs. Tout y est matière à charge — nous sommes bien dans une satire — : la bourgeoisie, la noblesse, le clergé libertin ; la littérature du moment y est passée au peigne fin. À la fin de la satire, le nom honni paraît enfin : Voltaire. Le Dix-huitième siècle est véritablement à sa parution, et pour reprendre une expression de Huysmans, un météore dans le champ littéraire de l’époque ; il n’est en effet pas vraiment de bon ton de se moquer de ceux qui sont à l’origine du Progrès, et pensionnés par les plus grandes têtes couronnées d’Europe. La critique se déchaîne, mais Grimm verra tout de même la marque d’un certain talent chez Gilbert. Vivement critiqué ou applaudi, il est indéniable qu’à partir de 1775, le jeune poète est une figure reconnue de la littérature en cette fin d’Ancien Régime.
C’est dans le genre satirique que Gilbert fera au reste fortune, durant le peu d’années qu’il lui reste à vivre. En 1776 — année de la mort de Fréron et de la reprise de l'Année littéraire par son fils —, paraît une Diatribe sur les prix académiques. Le poète n’a en effet pas oublié ses cuisants échecs aux prix de l’Académie quelques années auparavant, et fustige dans cette pièce en prose la teneur fade des œuvres primées au concours. Puis il fait publier en 1778 une défense de la satire, Mon apologie, dialogue en vers entre un philosophe nommé Psaphon, et Gilbert lui-même mis en scène ; c’est son deuxième succès du genre.
Peu avant sa mort, il écrit une Ode inspirée de plusieurs psaumes, plus généralement connue sous le nom d'Adieux à la vie, un poème dont la thématique pré-romantique sera reprise par Alfred de Vigny dans Stello et Chatterton.
Le 24 octobre 1780, après une chute de cheval qui occasionne une blessure à la tête Gilbert est conduit à l'Hôtel-Dieu de Paris. Suite de l’opération du trépan, l'ayant rendu fou, il avale la clef d'une cassette qui reste accrochée à l'œsophage Journal de médecine, janv. 1781, p. 82. il meurt le 16 novembre à seulement 29 ans, après, comme nous venons de le voir, avoir avalé une clé dans une crise de délire, anecdote qui, chargée pour beaucoup d’une très riche symbolique, vaudra par exemple à Toulet ce vers : Mourir comme Gilbert en avalant sa clé. Par une ironie du sort, cette mort insolite l'emporte alors qu'il vient d'attirer sur lui la protection de M. de Beaumont, archevêque de Paris, et celle du roi. On dit, sans jamais l'avoir prouvé, que trois pensions lui étaient échues : une de l'archevêché, une prélevée sur la cassette royale, une enfin, du Mercure. Ce fait peut être exact ; mais il se trouve fâcheusement mentionné dans les apocryphes Souvenirs de la marquise de Créquy édition de 1855, pp. 182-184, où tout ce qu'il y a d'indubitablement faux laisse planer de grands doutes sur ce qui pourrait bien être vrai.
Il fut inhumé le 17 novembre dans la grande cave de l'église Saint-Pierre-aux-Bœufs sur l'Île de la Cité avant d'être transféré au cimetière de Clamart à Paris.
Gilbert est mort à l'Hôtel-Dieu, trop tôt sans doute pour se faire un grand nom. Une trépanation, à la suite d'une chute de cheval, l'ayant rendu fou, il avale la clef d'une cassette qui reste accrochée à l'œsophage Journal de médecine, janv. 1781, p. 82. Par une ironie du sort, cette mort insolite l'emporte alors qu'il vient d'attirer sur lui la protection de M. de Beaumont, archevêque de Paris, et celle du roi. On dit, sans jamais l'avoir prouvé, que trois pensions lui étaient échues : une de l'archevêché, une prélevée sur la cassette royale, une enfin, du Mercure. Ce fait peut être exact ; mais il se trouve fâcheusement mentionné dans les apocryphes Souvenirs de la marquise de Créquy, où tout ce qu'il y a d'indubitablement faux laisse planer de grands doutes sur ce qui pourrait bien être vrai.
Il est certain toutefois qu'après plusieurs années de bohème, Gilbert meurt dans une relative aisance. Il loue un appartement, des meubles, et pratique l'équitation, fait peu commun pour l'époque. Quant à son Ode tirée des Psaumes XL, 1780, elle a été composée à Conflans-les-Carrières, dans la résidence de campagne de son protecteur ecclésiastique (elle est publiée dans le Journal de Paris, le 17 octobre), et non huit jours avant sa mort sur son lit d'hôpital, survenue le 16 novembre. Elle n'en demeure pas moins remarquable par des accents élégiaques fort rares dans ce siècle, et qui annoncent Chénier ou Lamartine : Au banquet de la vie, infortuné convive, / J'apparus un jour, et je meurs : / Je meurs, et sur ma tombe, où lentement j'arrive, / Nul ne viendra verser des pleurs.
Il laisse, selon Van Bever, le souvenir d’un esprit chagrin et d’un génie malheureux
L’émergence d’un mythe
Toutefois, la mort de Gilbert ne signe pas l’oubli définitif de son nom. Il y a plusieurs seuils à passer pour assurer la postérité d’une œuvre ; la mort est un de ces seuils, et c’est bien malgré lui La Harpe qui va d’une manière ou d’une autre, permettre au nom de Gilbert de survivre, et de connaître une certaine fortune littéraire durant tout le siècle qui va suivre. La Harpe, tâchant une fois de plus de ridiculiser le poète, va effectivement rédiger une notice nécrologique qui paraîtra dans le Mercure de France en 1780, puis qu’il intégrera plus tard dans sa Correspondance littéraire, notice dans laquelle il relate dans ses moindres détails, la mort supposée du poète :
"Gilbert s’était logé à Charenton, dans le voisinage de la maison de campagne de M. de Beaumont, archevêque de Paris, car, en sa qualité d’apôtre de la religion, il se croyait obligé de faire sa cour au prélat, qui l’avait, en effet, recommandé à M. de Vergennes, et avait obtenu pour lui une des pensions que le ministre des Affaires étrangères peut prendre sur le privilège qu’il accorde aux papiers politiques. Il était allé chez l’archevêque, qui ne le reçut pas avec toute la distinction qu’il en attendait, et qui le fit manger avec ses secrétaires et ses valets de chambre. Gilbert, déjà mal disposé, fut tellement aigri de cette réception, qu’il rentra chez lui la tête absolument tournée. La fièvre le prit pendant la nuit, et le matin il alla, en chemise et en redingote, demander les sacrements au curé de Charenton, qui l’exhorta vainement à rentrer chez lui. Il courut de là chez l’archevêque, et la plupart des gens de la maison n’étant pas encore levés, il parvint jusqu’à la chambre de ce prélat, se roula par terre comme un possédé, en criant qu’on lui donnât les sacrements, qu’il allait mourir, et que les philosophes avaient gagné le curé de Charenton pour lui refuser les sacrements. L’archevêque, effrayé de ses cris et de ses convulsions, le fit porter à l’Hôtel-Dieu, dans la salle où l’on traite les fous. Là, sa folie ne fit qu’augmenter ; il faisait sa confession à haute voix ; et, comme un autre fou avait la manie de crier les arrêts du parlement, Gilbert criait de son côté que c’était lui qu’on allait pendre. Dans un de ces accès, il avala la clef de sa cassette, qui lui resta dans l’œsophage. Il mourut vingt-quatre heures après, ne pouvant pas être secouru, et s’accusant toujours lui-même, sans qu’il en faille pourtant rien conclure contre lui, car le cri de la folie n’est pas toujours celui de la conscience."
Ce texte, on le voit, nous présente Gilbert agonisant dans les affres de la folie. Ce n’est pas tout ; les détracteurs du poète accuseront le parti anti-philosophe d’avoir laissé mourir de faim leur supposé protégé. Ces légendes qui courent sur la mort de Gilbert sont toutefois fausses. Loin d’avoir agonisé sur un grabat d’hôpital, malheureux, pauvre et affamé comme on tente alors de la faire accroire, le poète, dans les dernières années de sa vie, reçoit plusieurs pensions : 800 livres du roi, 600 livres de Mesdames, 100 écus sur le Mercure de France, 500 livres de l’archevêché. Les dix louis qu'il aurait laissés par testament à un jeune soldat qui n’est autre que Bernadotte sont une légende.
Cette série de fables courant sur la mort du poète, loin de le desservir, lui permettent de passer à la postérité sous le signe du poète maudit, à l’exemple de Chatterton ou de Malfilâtre.
Postérité
De ce fait, Gilbert passe l’épreuve de la mort avec un certain succès, sous l’image du poète malheureux, maudit, rejeté par son siècle. Quoique le poète ait connu une gloire littéraire certaine durant sa vie, grâce à son œuvre satirique, ce sont ses œuvres plus personnelles qui lui assureront de quoi vivre dans les mémoires des siècles suivants, à savoir, Le Poète malheureux, et Les Adieux à la vie. Dès 1819, en effet, le Romantisme, en quête de figure tutélaire, reprend à son compte la part élégiaque de Gilbert, au même titre que la dimension de révolte présente dans l’œuvre de Chénier : les deux noms sont bien souvent associés dans la pensée des Romantiques. De Musset à Flaubert - qui est indéniablement Romantique par ses origines, cf. sa Correspondance, en passant par Vigny il est l’une des trois figures emblématiques du Stello, avec Chatterton et Chénier, ou encore Charles Nodier, Nodier édite les Œuvres complètes de Gilbert en 1826, tous reconnaissent l’influence certes mineure, mais bien présente, du poète dans leur inspiration, et l’âme du mouvement.
Le nom de Gilbert ne tombe définitivement dans l’oubli qu’à l’aube du XXe siècle, où le romantisme lui-même achève de tomber en désuétude.
Hommage
La ville de Fontenoy-le-Château lui a fait ériger une statue. La première statue érigée en 1898 était l'œuvre de la Duchesse d'Uzès. Elle fut retirée, pour être fondue, pendant la seconde guerre mondiale. Une nouvelle statue, l'actuelle, fut érigée en 1953.
Les villes de Nancy et d'Épinal ont donné le nom de Gilbert à une rue et Fontenoy à une place.
Dans les catacombes de Paris, le Sarcophage du Lacrymatoire dit Tombeau de Gilbert porte sur son socle les vers célèbres du poète: Au banquet de la vie, infortuné convive, j' apparus un jour et je meurs...
Œuvres
Les Familles de Darius et d'Hidarne La Haye et Paris, 2 vol., 1770
Début poétique Paris, 1771
Le Poète malheureux, ou Le Génie aux prises avec la fortune Paris, 1772
Le Jugement dernier Paris, 1773
Le Carnaval des auteurs ou les masques reconnus et punis Paris, 1773
Le Siècle (Paris, 1774
Éloge de Léopold, duc de Lorraine 1774
Le Dix-Huitième siècle Paris, 1775
Le Jubilé Paris, 1775
Mon Apologie Amsterdam, 1778
Ode sur la guerre présente, ou Le Combat d'Ouessant Paris, 1778
Ode imitée de plusieurs psaumes, dite Adieux à la vie 1780
b] Le 16 novembre 1780 à Paris à 30 ans meurt Nicolas Joseph Florent Gilbert
né le 15 décembre 1750 dans le sud du Duché de Lorraine à Fontenoy-le-Château, poète lorrain francophone.
Après avoir vainement cherché à faire reconnaître son talent le Génie aux prises avec la fortune ou le Poète malheureux, 1772, il finit par trouver sa voie dans la satire antiphilosophique En brefPoète lorrain, Nicolas Gilbert doit une certaine réputation à la légende ou, plutôt, au mythe romantique du poète incompris, victime d'une société égoïste, tel que le représente Vigny dans Stello : on a fait de lui une sorte de Chatterton français. S'il est vrai qu'il est mort jeune, à vingt-neuf ans, il ne faut plus pour autant s'abuser aujourd'hui. Gilbert naît à Fontenoy-le-Château Vosges, où son père agriculteur, marchand de grains, possède deux petites fermes, tout en exerçant les fonctions de maire 1742. Il fait une partie de ses études au fameux collège de l'Arc, à Dôle, puis il monte à Paris, à la conquête d'une gloire qu'il ne trouvera, de manière posthume, qu'au XIXe siècle. Bien reçu par d'Alembert, auquel il est recommandé par Mme de la Verpillière, femme du prévôt des marchands de Lyon, il aurait sans doute été gagné au parti philosophique, comme son compatriote Saint-Lambert. Il en fut autrement ; Gilbert entra dans le clan des réactionnaires, au côté de Fréron, l'illustre directeur de L'Année littéraire. Il publie, alors qu'il n'a pas vingt ans, un roman passé justement inaperçu, puis son Début poétique 1771. Il participe au concours annuel de l'Académie française, en proposant Le Poète malheureux ou le Génie aux prises avec la fortune 1772, aux épanchements plus ou moins autobiographiques, et une ode consacrée au Jugement dernier 1773, qui se termine par ces vers : L'Éternel a brisé son tonnerre inutile ; -Et, d'ailes et de faux dépouillé désormais, Sur les mondes détruits le temps dort immobile. Ce sont deux échecs consécutifs le prix étant remporté deux fois par Jean-François La Harpe, fade poète, mais dévoué à la cabale philosophique dans les feuilles du Mercure de France qui sont ressentis par Gilbert comme deux humiliations. Après un séjour à Nancy, il se lance courageusement dans la satire, se montrant digne successeur de Juvénal, Régnier et Boileau, s'en prenant à Voltaire, Diderot, d'Alembert, La Harpe, et dénonçant avec violence, d'abord dans Le Dix-Huitième Siècle 1776 dédié à Fréron, ensuite dans Mon Apologie,1778, la licence de l'athéisme, la corruption des mœurs et la décadence littéraire de son temps : Parlerai-je d'Iris ? chacun la prône et l'aime ; -C'est un cœur, mais un cœur, -c'est l'humanité même. -Si d'un pied étourdi quelque jeune éventé -Frappe, en courant, -son chien qui jappe épouvanté, -La voilà qui se meurt de tendresse et d'alarmes ; -Un papillon souffrant lui fait verser des larmes : -Il est vrai ; mais aussi qu'à la mort condamné, Lalli soit en spectacle à l'échafaud traîné, -Elle ira la première à cette horrible fête -Acheter le plaisir de voir tomber sa tête. Sa vieNicolas Joseph Florent Gilbert naît le 15 décembre 1750 à Fontenoy-le-Château actuellement dans les Vosges. Baptisé le lendemain il a pour marraine Marie Iroy et pour parrain, son grand-père, Nicolas Joseph Florent Blancheville dont il prend les prénoms. Son père, maire de Fontenoy-la-Côte, propriétaire de deux fermes, y exerce le métier de marchand de grains. Son éducation est confiée au curé du village, un jésuite qui, voyant en lui "un esprit apte à être éduqué", lui apprend le latin. Puis le jeune Nicolas part faire ses humanités au collège de l’Arc à Dole. En 1768, à la mort de son père, il monte à Nancy, ancienne capitale du duché de Lorraine devenu Français en 1766, où il côtoie quelque temps les cercles littéraires. Il fréquente les salons de Darbès et ceux de du comte de Lupcourt et est reçu chez l'avocat Mandel. Il y fait ses débuts, avec un roman persan, les Familles de Darius et d’Éridame ou Statira et Amestris 1770 et quelques pièces poétiques, dont son début poétique, composé de trois héroïdes et, entre plusieurs odes, le Jugement dernier 1773. Après 1770, il part pour Paris, avec en poche ses premiers vers, ainsi qu’une lettre, signée de Mme de La Verpillière, femme du prévôt des marchands de Lyon et mécène. Cette lettre recommande le jeune poète à D’Alembert. Il semble que D’Alembert, lui ayant promis une place de précepteur, n’honore pas cette espérance, et le reçoit d’ailleurs assez froidement : Et ce froid d'Alembert, chancelier du Parnasse, Qui se croit un grand homme et fit une préface Nicolas Gilbert, Le Dix-huitième siècle
Gilbert se retrouve donc comme tant d’autres, reclus dans une mansarde, à tâcher de vivre de sa plume, misérablement en somme. Il fait publier ses premières pièces en vers en 1771 ; le volume est en butte à l’indifférence générale. Melchior Grimm écrit dans sa Correspondance littéraire : "M. Gilbert a donné, il y a quelque temps, un Début poétique qui n’a été lu de personne." Il présente successivement en 1772, puis en 1773, deux pièces au concours de l’Académie française. Son œuvre Le Poète malheureux, emplie d’accents élégiaques, non dénuée d’un certain talent ou en tout cas, d’une certaine sensibilité, n’obtient pas même une mention ; c’est Jean-François de La Harpe, directeur du Mercure de France, qui reçoit le prix. Sa deuxième pièce, L’Ode du Jugement Dernier, subit le même sort. Gilbert en concevra alors une haine certaine pour La Harpe en particulier, ainsi que pour les encyclopédistes, voire les philosophes en général, qui tiennent tout le Parnasse littéraire français : ainsi nomme-t-on à ce moment l’élite des écrivains. De son côté, La Harpe n’aura de cesse de tenir en mépris tout ce que produira Gilbert. Probablement en 1774, par l’entremise de Baculard d’Arnaud, Gilbert rencontre Élie Fréron, qui dirige l'Année littéraire, pendant du Mercure de France. Gilbert assiste probablement à des dîners organisés par Fréron et s’engage à ses côtés, sans doute par rancœur envers le milieu littéraire parisien dans un premier temps. Grâce à la recommandation de Fréron, Gilbert obtint les faveurs de l’archevêché et plusieurs pensions, dont une du roi. François de Neufchateau dans son poème Les Vosges, consacre une strophe à son compatriote : Au rang des bons esprits dont j'exhume la gloire, Dois-je placer Gilbert ? Parmi nous étant né Du Dernier Jugement ce chantre infortuné, L'indigence altéra son cerveau pindarique; Il vendit au clergé sa plume satirique Du talent le plus rare, ô malheureux emploi ! Sa muse, fléchissant sous cette affreuse loi, Contre la raison même abuse de ses armes; Mais ses derniers adieux nous font verser des larmes. François de Neufchateau, 'Les Vosges'
En 1775 paraît sa première pièce majeure, qui marque son temps. C’est une satire en vers, Le Dix-huitième siècle, qui donne la caricature féroce de son temps ; la philosophie y est le principe de la chute des arts, de la perte des mœurs. Tout y est matière à charge — nous sommes bien dans une satire — : la bourgeoisie, la noblesse, le clergé libertin ; la littérature du moment y est passée au peigne fin. À la fin de la satire, le nom honni paraît enfin : Voltaire. Le Dix-huitième siècle est véritablement à sa parution, et pour reprendre une expression de Huysmans, un météore dans le champ littéraire de l’époque ; il n’est en effet pas vraiment de bon ton de se moquer de ceux qui sont à l’origine du Progrès, et pensionnés par les plus grandes têtes couronnées d’Europe. La critique se déchaîne, mais Grimm verra tout de même la marque d’un certain talent chez Gilbert. Vivement critiqué ou applaudi, il est indéniable qu’à partir de 1775, le jeune poète est une figure reconnue de la littérature en cette fin d’Ancien Régime. C’est dans le genre satirique que Gilbert fera au reste fortune, durant le peu d’années qu’il lui reste à vivre. En 1776 — année de la mort de Fréron et de la reprise de l'Année littéraire par son fils —, paraît une Diatribe sur les prix académiques. Le poète n’a en effet pas oublié ses cuisants échecs aux prix de l’Académie quelques années auparavant, et fustige dans cette pièce en prose la teneur fade des œuvres primées au concours. Puis il fait publier en 1778 une défense de la satire, Mon apologie, dialogue en vers entre un philosophe nommé Psaphon, et Gilbert lui-même mis en scène ; c’est son deuxième succès du genre. Peu avant sa mort, il écrit une Ode inspirée de plusieurs psaumes, plus généralement connue sous le nom d'Adieux à la vie, un poème dont la thématique pré-romantique sera reprise par Alfred de Vigny dans Stello et Chatterton. Le 24 octobre 1780, après une chute de cheval qui occasionne une blessure à la tête Gilbert est conduit à l'Hôtel-Dieu de Paris. Suite de l’opération du trépan, l'ayant rendu fou, il avale la clef d'une cassette qui reste accrochée à l'œsophage Journal de médecine, janv. 1781, p. 82. il meurt le 16 novembre à seulement 29 ans, après, comme nous venons de le voir, avoir avalé une clé dans une crise de délire, anecdote qui, chargée pour beaucoup d’une très riche symbolique, vaudra par exemple à Toulet ce vers : Mourir comme Gilbert en avalant sa clé. Par une ironie du sort, cette mort insolite l'emporte alors qu'il vient d'attirer sur lui la protection de M. de Beaumont, archevêque de Paris, et celle du roi. On dit, sans jamais l'avoir prouvé, que trois pensions lui étaient échues : une de l'archevêché, une prélevée sur la cassette royale, une enfin, du Mercure. Ce fait peut être exact ; mais il se trouve fâcheusement mentionné dans les apocryphes Souvenirs de la marquise de Créquy édition de 1855, pp. 182-184, où tout ce qu'il y a d'indubitablement faux laisse planer de grands doutes sur ce qui pourrait bien être vrai. Il fut inhumé le 17 novembre dans la grande cave de l'église Saint-Pierre-aux-Bœufs sur l'Île de la Cité avant d'être transféré au cimetière de Clamart à Paris. Gilbert est mort à l'Hôtel-Dieu, trop tôt sans doute pour se faire un grand nom. Une trépanation, à la suite d'une chute de cheval, l'ayant rendu fou, il avale la clef d'une cassette qui reste accrochée à l'œsophage Journal de médecine, janv. 1781, p. 82. Par une ironie du sort, cette mort insolite l'emporte alors qu'il vient d'attirer sur lui la protection de M. de Beaumont, archevêque de Paris, et celle du roi. On dit, sans jamais l'avoir prouvé, que trois pensions lui étaient échues : une de l'archevêché, une prélevée sur la cassette royale, une enfin, du Mercure. Ce fait peut être exact ; mais il se trouve fâcheusement mentionné dans les apocryphes Souvenirs de la marquise de Créquy, où tout ce qu'il y a d'indubitablement faux laisse planer de grands doutes sur ce qui pourrait bien être vrai. Il est certain toutefois qu'après plusieurs années de bohème, Gilbert meurt dans une relative aisance. Il loue un appartement, des meubles, et pratique l'équitation, fait peu commun pour l'époque. Quant à son Ode tirée des Psaumes XL, 1780, elle a été composée à Conflans-les-Carrières, dans la résidence de campagne de son protecteur ecclésiastique (elle est publiée dans le Journal de Paris, le 17 octobre), et non huit jours avant sa mort sur son lit d'hôpital, survenue le 16 novembre. Elle n'en demeure pas moins remarquable par des accents élégiaques fort rares dans ce siècle, et qui annoncent Chénier ou Lamartine : Au banquet de la vie, infortuné convive, / J'apparus un jour, et je meurs : / Je meurs, et sur ma tombe, où lentement j'arrive, / Nul ne viendra verser des pleurs. Il laisse, selon Van Bever, le souvenir d’un esprit chagrin et d’un génie malheureux L’émergence d’un mythe
Toutefois, la mort de Gilbert ne signe pas l’oubli définitif de son nom. Il y a plusieurs seuils à passer pour assurer la postérité d’une œuvre ; la mort est un de ces seuils, et c’est bien malgré lui La Harpe qui va d’une manière ou d’une autre, permettre au nom de Gilbert de survivre, et de connaître une certaine fortune littéraire durant tout le siècle qui va suivre. La Harpe, tâchant une fois de plus de ridiculiser le poète, va effectivement rédiger une notice nécrologique qui paraîtra dans le Mercure de France en 1780, puis qu’il intégrera plus tard dans sa Correspondance littéraire, notice dans laquelle il relate dans ses moindres détails, la mort supposée du poète : "Gilbert s’était logé à Charenton, dans le voisinage de la maison de campagne de M. de Beaumont, archevêque de Paris, car, en sa qualité d’apôtre de la religion, il se croyait obligé de faire sa cour au prélat, qui l’avait, en effet, recommandé à M. de Vergennes, et avait obtenu pour lui une des pensions que le ministre des Affaires étrangères peut prendre sur le privilège qu’il accorde aux papiers politiques. Il était allé chez l’archevêque, qui ne le reçut pas avec toute la distinction qu’il en attendait, et qui le fit manger avec ses secrétaires et ses valets de chambre. Gilbert, déjà mal disposé, fut tellement aigri de cette réception, qu’il rentra chez lui la tête absolument tournée. La fièvre le prit pendant la nuit, et le matin il alla, en chemise et en redingote, demander les sacrements au curé de Charenton, qui l’exhorta vainement à rentrer chez lui. Il courut de là chez l’archevêque, et la plupart des gens de la maison n’étant pas encore levés, il parvint jusqu’à la chambre de ce prélat, se roula par terre comme un possédé, en criant qu’on lui donnât les sacrements, qu’il allait mourir, et que les philosophes avaient gagné le curé de Charenton pour lui refuser les sacrements. L’archevêque, effrayé de ses cris et de ses convulsions, le fit porter à l’Hôtel-Dieu, dans la salle où l’on traite les fous. Là, sa folie ne fit qu’augmenter ; il faisait sa confession à haute voix ; et, comme un autre fou avait la manie de crier les arrêts du parlement, Gilbert criait de son côté que c’était lui qu’on allait pendre. Dans un de ces accès, il avala la clef de sa cassette, qui lui resta dans l’œsophage. Il mourut vingt-quatre heures après, ne pouvant pas être secouru, et s’accusant toujours lui-même, sans qu’il en faille pourtant rien conclure contre lui, car le cri de la folie n’est pas toujours celui de la conscience." Ce texte, on le voit, nous présente Gilbert agonisant dans les affres de la folie. Ce n’est pas tout ; les détracteurs du poète accuseront le parti anti-philosophe d’avoir laissé mourir de faim leur supposé protégé. Ces légendes qui courent sur la mort de Gilbert sont toutefois fausses. Loin d’avoir agonisé sur un grabat d’hôpital, malheureux, pauvre et affamé comme on tente alors de la faire accroire, le poète, dans les dernières années de sa vie, reçoit plusieurs pensions : 800 livres du roi, 600 livres de Mesdames, 100 écus sur le Mercure de France, 500 livres de l’archevêché. Les dix louis qu'il aurait laissés par testament à un jeune soldat qui n’est autre que Bernadotte sont une légende. Cette série de fables courant sur la mort du poète, loin de le desservir, lui permettent de passer à la postérité sous le signe du poète maudit, à l’exemple de Chatterton ou de Malfilâtre. Postérité
De ce fait, Gilbert passe l’épreuve de la mort avec un certain succès, sous l’image du poète malheureux, maudit, rejeté par son siècle. Quoique le poète ait connu une gloire littéraire certaine durant sa vie, grâce à son œuvre satirique, ce sont ses œuvres plus personnelles qui lui assureront de quoi vivre dans les mémoires des siècles suivants, à savoir, Le Poète malheureux, et Les Adieux à la vie. Dès 1819, en effet, le Romantisme, en quête de figure tutélaire, reprend à son compte la part élégiaque de Gilbert, au même titre que la dimension de révolte présente dans l’œuvre de Chénier : les deux noms sont bien souvent associés dans la pensée des Romantiques. De Musset à Flaubert - qui est indéniablement Romantique par ses origines, cf. sa Correspondance, en passant par Vigny il est l’une des trois figures emblématiques du Stello, avec Chatterton et Chénier, ou encore Charles Nodier, Nodier édite les Œuvres complètes de Gilbert en 1826, tous reconnaissent l’influence certes mineure, mais bien présente, du poète dans leur inspiration, et l’âme du mouvement. Le nom de Gilbert ne tombe définitivement dans l’oubli qu’à l’aube du XXe siècle, où le romantisme lui-même achève de tomber en désuétude. HommageLa ville de Fontenoy-le-Château lui a fait ériger une statue. La première statue érigée en 1898 était l'œuvre de la Duchesse d'Uzès. Elle fut retirée, pour être fondue, pendant la seconde guerre mondiale. Une nouvelle statue, l'actuelle, fut érigée en 1953. Les villes de Nancy et d'Épinal ont donné le nom de Gilbert à une rue et Fontenoy à une place. Dans les catacombes de Paris, le Sarcophage du Lacrymatoire dit Tombeau de Gilbert porte sur son socle les vers célèbres du poète: Au banquet de la vie, infortuné convive, j' apparus un jour et je meurs... Œuvres
Les Familles de Darius et d'Hidarne La Haye et Paris, 2 vol., 1770 Début poétique Paris, 1771 Le Poète malheureux, ou Le Génie aux prises avec la fortune Paris, 1772 Le Jugement dernier Paris, 1773 Le Carnaval des auteurs ou les masques reconnus et punis Paris, 1773 Le Siècle (Paris, 1774 Éloge de Léopold, duc de Lorraine 1774 Le Dix-Huitième siècle Paris, 1775 Le Jubilé Paris, 1775 Mon Apologie Amsterdam, 1778 Ode sur la guerre présente, ou Le Combat d'Ouessant Paris, 1778 Ode imitée de plusieurs psaumes, dite Adieux à la vie 1780 [/b]   [img width=600]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfrkGHA0tEg7uTf8hfw0Bvloiz6KNJ4hqvM0i686xtyfKLgdF53q9Kpd6mGg[/img]       
Posté le : 16/11/2014 23:40
Edité par Loriane sur 17-11-2014 10:54:14
Edité par Loriane sur 17-11-2014 10:57:06
Edité par Loriane sur 17-11-2014 11:12:31
Edité par Loriane sur 17-11-2014 11:16:32
|
|
|
|
|
L'Oklahoma |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 16 novembre 1907 l'Oklahoma adhère à l"union et devient le 46e État
d'Amérique du nord . 
Sa devise est "Labor omnia vincitse" qui signifit Le travail conquiert tout L'Oklahoma, en anglais Écouter est un État du Centre Sud des États-Unis. Il est bordé au nord par le Colorado et le Kansas, à l'est par le Missouri et l'Arkansas, à l'ouest par le Nouveau-Mexique et au sud par le Texas dont il est séparé par la rivière Rouge du Sud.
Exploré par les Espagnols au XVIe s, le pays fut annexé, avec la Louisiane, par Cavelier de La Salle 1682. Cédé aux États-Unis 1803, il devint une réserve pour les Indiens des cinq nations en 1834. Progressivement ouvert à la colonisation blanche 1889 à 1904, l'Oklahoma devint État de l'Union en 1907.
Avec une population estimée à 3 642 361 habitants en 2008 et une superficie de 177 847 km, l'Oklahoma est le 28e État le plus peuplé et le 20e plus grand de la Fédération. Le nom de l'État vient des mots choctaw okla et humma, signifiant peuple rouge ; l'Oklahoma est aussi connu par son surnom The Sooner State. Formé par l'unification du Territoire de l'Oklahoma et du Territoire indien. Ses habitants sont appelés Oklahomans et Oklahoma City est sa capitale ainsi que la ville la plus peuplée.
L'économie de l'Oklahoma est diversifiée : le secteur primaire repose sur l'agriculture, la production de gaz naturel et de pétrole. Les autres activités sont l'aéronautique, les télécommunications et les biotechnologies. Avant la crise économique de 2008-2009, l'État connaissait l'une des plus fortes croissances économiques du pays. Oklahoma City et Tulsa sont les deux principaux centres urbains : en effet, près de 60 % des habitants vivent dans ces deux régions métropolitaines. L'Oklahoma est particulièrement dynamique dans les domaines de l'éducation et de la santé. Ses plus grandes universités participent aux principales associations sportives.
La majeure partie de l'Oklahoma appartient aux Grandes Plaines avec des paysages variés de prairie, de montagnes moyennes et de forêts à l'est. Le climat est marqué par des phénomènes violents tels que les tornades. D'après le Bureau du recensement des États-Unis, de nombreux habitants déclarent descendre d'ancêtres allemands, irlandais, britanniques et amérindiens. Plus de 25 langues amérindiennes sont parlées, le record de tous les États américains. L'Oklahoma se trouve au carrefour de plusieurs aires culturelles. Il appartient à la Bible Belt où le succès du christianisme évangélique en fait l'un des États les plus conservateurs. Cependant, les adhérents au Parti démocrate sont très nombreux. L'identité de l'État repose sur un folklore vivant rodéo, western, country, cultures amérindiennes.
Origine du nom
Le nom de l'État vient des mots choctaw okla et humma, signifiant peuple rouge. Le chef choctaw Allen Wright suggéra ce nom en 1866 pendant les négociations entre les Amérindiens et le gouvernement fédéral des États-Unis sur le Territoire indien. L'expression peuple rouge désigne les Amérindiens comme un peuple unique. Oklahoma devint plus tard le nom de facto du Territoire de l'Oklahoma et fut approuvé officiellement en 1890, deux ans après que la région fut ouverte à la colonisation blanche. Le mot Okies a été popularisé par le roman de John Steinbeck les Raisins de la colère ; le terme est utilisé de manière positive par les habitants de l'Oklahoma. Enfin, l'expression Oklahoma is OK joue sur l'abréviation de l'État OK.
Les montagnes Ouachita au Sud-Est de l'Oklahoma
L'Oklahoma est le 20e État des États-Unis pour la superficie avec 181 035 km2, dont 177 847 km2 de terres et 3 188 km2 sous l'ea. Il se trouve dans les Grandes Plaines non loin du centre géographique des États-Unis contigus. Il est bordé au nord par le Colorado et le Kansas, à l'est par le Missouri et l'Arkansas, à l'ouest par le Nouveau-Mexique et au sud par le Texas. L'Oklahoma se trouve entre le 33e et le 37e parallèle nord, entre le 94e et le 103e méridien ouest.
L'Oklahoma est situé entre les Grandes Plaines et les monts Ozark à l'est. L'organisation du relief est simple : plus on se dirige vers l'ouest, plus les altitudes augmentent. L'Ouest de l'État est occupé par de hautes plaines alors que des plaines humides caractérisent le Sud-Ouest. Le point culminant, Black Mesa, 1 516 mètres d'altitude se trouve au nord-ouest, dans le Panhandle. Le point le plus bas 88 mètres d'altitude se situe sur la Little River près de la frontière sud-est et de la ville d'Idabel.
Il existe quatre ensemble de montagnes ou de collines : les Ouachita au sud-est, les Arbuckle au sud, les Wichita au sud-ouest et les Ozark au nord-est. Les Monts Ozark et les Montagnes Ouachita représentent les seules montagnes entre les Appalaches et les Rocheuses. Une partie des Flint Hills s'étire à travers le centre-nord de l'Oklahoma ; Cavanal Hill, au sud-est de l'État est considérée par le Département du Tourisme et des Loisirs comme la plus haute colline du monde 609 mètres d'altitude. Le centre est occupé par les Red Bed Plains,région autour d'Oklahoma City. Entre les Red Bed Plains et la frontière avec l'Arkansas se trouvent les Sandstone Hills particulièrement riches en pétrole et en charbon. À l'ouest, les Gypsum Hills sont aussi appelées Glass Mountains en raison de leur aspect minéral.
Le paysage du nord-ouest est constitué de mesas, de hautes plaines semi-arides et de plateaux disséqués par des gorges comme dans les Glass Mountains. Le Sud-Ouest est dominé par des plaines coupées par de petites chaînes de montagnes comme les Antelope Hills et les montagnes Wichita. Une zone de transition, située au centre de l'État, offre des étendues de prairies et de bois. Les monts Ozark et les montagnes Ouachita s'élèvent d'ouest en est.
Le risque sismique est faible en Oklahoma. Le tiers oriental de l'État est affecté par des glissements de terrains. Les rives des cours d'eau vivent sous la menace des inondations.
Le climat
On recense quelque 500 cours d'eau de diverses tailles et 200 lacs formés par les barrages : l'Oklahoma possède le plus grand nombre de réservoirs artificiels du pays. La plus grande partie de l'État appartient à deux bassins hydrographiques : celui de la Rivière Rouge et celui de l'Arkansas, deux affluents du fleuve Mississippi qui se jette dans le golfe du Mexique. La Cimarron et la Canadian prennent leurs sources dans les Montagnes Rocheuses et se jettent dans l'Arkansas River. La Washita est un affluent de la Red River qui forme la frontière avec le Texas au sud. Les cours d'eau venant de l'ouest sont alimentés par la fonte des neiges au printemps mais subissent une forte évaporation dans les Grandes Plaines. Ils sont fortement chargés en alluvions et en sable, en sel à l'ouest.
Le lac Eufaula 41 278 hectares et le lac Texoma 36 017 hectares sont les plus grands lacs artificiels de l'État. C'est à l'est que se concentrent les lacs formés sur un bras mort d'un cours d'eau. À l'ouest, de nombreux lacs sont temporaires et se remplissent lorsqu'il y a une grosse averse.
L'Oklahoma possède d'importantes réserves d'eau dans son sous-sol : les aquifères permettent de courvir 60 % des besoins en eau de l'État. Les aquifères de l'ouest, comme celui de Rush Springs, servent à irriguer les terres agricoles..
L'Oklahoma se trouve dans la zone tempérée. Son climat est de type continental et la région connaît une forte amplitude thermique annuelle. L'hiver, le blizzard paralyse les réseaux de transport. En janvier et février, les vagues de froid cold waves peuvent faire chuter brutalement les températures. Les tornades sont des phénomènes violents et ponctuels qui concernent cette partie de la Tornado Alley. Elles naissent de la rencontre de l'air tropical avec l'air plus froid venant du nord, particulièrement entre avril et juin. L'État est frappé par 54 tornades par an en moyenne, l'une des fréquences les plus élevées du monde. La tornade de Woodward du 9 avril 1947 fait 107 morts. Celles de 1999 font une quarantaine de morts et plus d'un milliard de dollars de dégâts. La même année, on recense 145 tornades de différentes intensités. Dans le panhandle, les averses soudaines et brutales provoquent la crue des fleuves. En été, les vents brûlants provoquent des sécheresses et favorisent l'érosion des sols comme lors du Dust Bowl des années 1930. Les orages peuvent par ailleurs provoquer des incendies. Le 20 mai 2013, une importante tornade fait 24 morts dans la ville de Moore près de Oklahoma City.
Les températures annuelles évoluent selon un gradient nord/sud, du plus froid au plus chaud. Les précipitations, quant à elles, varient suivant un gradient est/ouest, du plus humide au plus sec. L'est de l'Oklahoma connaît un climat subtropical humide, Cfa selon la classification de Köppen : cette région subit l'influence des vents du sud qui font remonter des masses d'air chaudes et humides en été depuis le golfe du Mexique. Les hautes plaines de l'ouest ont un climat semi-aride, Bsk selon la classification de Köppen. Au sud-est, la température annuelle moyenne est de 17 °C et la hauteur annuelle moyenne de précipitations est de 1 420 mm, alors que le panhandle connaît des températures moyennes de 14 °C et 430 mm de précipitations. L'ensoleillement dans l'ensemble de l'état est très élevé et varie entre 2700 à plus de 3100 heures en moyennes par an en fonction des zones. Lors de la saison estivale les températures peuvent atteindre ou dépasser les 40°C dans l'ensemble de l'état, l'hiver les température peuvent approcher les -18°C dans les zones les plus froides de l'état. La plus haute température record connu dans l'Etat fut de 49°C. Cette température fut observé la première fois lors du très chaud été de 1936: à Alva le 18 juillet, à Altus le 19 Juillet et le 12 Août, et à Poteau le 10 Août. On peut aussi noter que la barre des 49°C fut atteint à Tishomingo 26 Juillet 1943 et plus récemment à Tipton le 27 Juin 1994. La plus basse température fut enregistrer à Nowata avec -35.0°C le 10 Février 2011.
En hiver, les chutes de neige varient de moins de 10 cm dans le sud à 51 cm dans le panhandle. Le centre de prévision des tempêtes, National Storm Prediction Center du Centre national météorologique se trouve à Norman.
Flore et faune
Des troupeaux de bisons vivent dans les prairies de l'Oklahoma. La Tallgrass Prairie Nature Preserve dans le comté d'Osage
L'environnement de l'Oklahoma est l'un des plus divers des États-Unis : les spécialistes distinguent onze régions écologiques : huit sont dans la moitié orientale de l'État, trois dans la moitié occidentale. Les symboles de l'État reflètent la richesse de la flore Gaillardia pulchella, Cercis canadensis, Sorghastrum nutans et de la faune Tyran à longue queue, Crotaphytus collaris, Bar blanc, Dindon sauvage, Raton laveur, Bison, Papilio polyxenes, Ouaouaron, Molosse du Brésil.
Les forêts occupent 24 % de la superficie de l'Oklahoma et se concentrent à l'est ; la prairie reste le milieu naturel dominant au centre, même si elle s'est considérablement réduite avec la mise en valeur agricole des terres. Dans les régions semi-arides de l'ouest, la couverture végétale devient moins haute et s'adapte à la sécheresse : c'est le domaine de la prairie basse, des buissons et des arbrisseaux qui forment la steppe. Les rives des cours d'eau sont propices à la croissance du Pin pignon, du genévrier et du Pin ponderosa. Le Sud-Est Kiamichi Country plus chaud et plus humide en été, est le domaine des marais et des forêts de cyprès, de pins et de feuillus ; au nord-est, on trouve des forêts de feuillus Chêne étoilé, orme, caryer et de conifères cèdre, pin. Le centre est constitué d'une flore particulière de forêts de chênes et de hautes herbes appelées Cross Timbers. Le Sud-Est est dominé par les pinèdes.
L'Oklahoma abrite une importante diversité de mammifères Cerf hémione, Cerf de Virginie, coyote, lynx, etc. et d'oiseaux caille, Columbidae, Pygargue à tête blanche, Buse à queue rousse, Cardinalidae, faisan, dindon sauvage que l'on trouve ailleurs aux États-Unis.
Dans la prairie, le bison d'Amérique du Nord, le tétras des prairies, le blaireau et le tatou sont fréquents. Le Panhandle possède l'une des plus grandes concentrations de chiens de prairie du pays. Les Cross Timbers, une zone de transition entre les prairies de l'est et les forêts de l'est abrite 351 espèces de vertébrés. Les montagnes Ouachita servent d'habitat à l'Ours noir, à la Loutre de rivière, au Renard roux et au Renard gris. Le Sud-Est compte quelque 328 espèces de vertébrés, parmi lesquelles l'Alligator d'Amérique.
Au temps de la Louisiane française et espagnole, le castor fut intensément chassé pour sa fourrure et sa viande. Des tentatives de réintroduction de cet animal ont été entreprises à partir des années 1950. L'Ours noir avait complètement disparu en 1915 ; il est aujourd'hui réintroduit dans les monts Ozark et les montagnes Ouachitas.
Aires protégées
Aujourd'hui, l'environnement de l'Oklahoma est fragilisé par les activités humaines : l'agriculture et l'élevage ont réduit les milieux naturels. Les industries et les grandes agglomérations polluent l'air et les cours d'eau. Les régions minières longtemps exploitées, doivent aujourd'hui être dépolluées.
Oklahoma possède 50 parcs d'État, six parcs nationaux ou aires protégées, deux forêts nationales et un important réseau de réserves naturelles. Six pourcents des 40 000 km2 de forêts sont des terres publiques comme la Forêt nationale d'Ouachita, la plus grande et la plus ancienne forêt du Sud des États-Unis. Avec une superficie de 158 km2, la Tallgrass Prairie Preserve au centre-nord de l'Oklahoma est la plus grande prairie naturelle préservée du monde où vivent 2500 bisons en liberté. La Black Kettle National Grassland s'étend sur 127 km2 de prairie au sud-ouest de l'Oklahoma. Le Wichita Mountains Wildlife Refuge est la plus ancienne 1901 et la plus vaste 238,8 km2 aire sauvage protégée de l'état. La Chickasaw National Recreation Area 18 km2 est la plus grande zone récréative de l'état. Parmi les sites historiques protégés par l'État fédéral, on peut citer le piste de Santa Fe, la piste des Larmes, le fort Smith, le Washita Battlefield National Historic Site et l'Oklahoma City National Memorial.
Histoire
Période précolombienne
Les premières traces de la présence humaine en Oklahoma datent de la dernière ère glaciaire lorsque des groupes nomades de Paléoaméricains parcouraient la région en quête de nourriture. Les cultures Folsom et Clovis ont été identifiées en plusieurs endroits. Vers 500 après Jésus-Christ apparurent les premières céréales cultivées dans la partie orientale, puis des innovations techniques, arc et flèche, céramique, architecture. La population connut alors une importante croissance. Le plus ancien site occupé de façon permanente par l'Homme est celui de Spiro Mounds, dans l'est de l'Oklahoma, qui fut habité entre 850 et 1450 après Jésus-Christ. La civilisation du Mississippi dominait alors le centre de l'Amérique du Nord et laissa de nombreux tertres funéraires ou cultuels. Après la disparition des Mound Builders, la région fut occupée par les Caddos, les Osages et les Wichitas qui chassaient le bison ou pratiquaient l'agriculture maïs, haricot, courge.
Exploration et colonisation
Le conquistador espagnol Francisco Vásquez de Coronado traversa l'Oklahoma en 1541. Puis les explorateurs français sillonnèrent la région pour la traite des fourrures et revendiquèrent la région au XVIIIe siècle qui fit partie de la Louisiane française jusqu'en 1803, lorsque cette dernière fut achetée par les États-Unis. Les années 1800-1820 furent marquées par l'exploration américaine des cours d'eau.
Le Territoire indien
Tout au long du XIXe siècle, plusieurs milliers d'Amérindiens furent contraints de quitter leurs terres pour s'installer en Oklahoma et dans les régions proches. Les Cinq tribus civilisées furent les plus touchées par la déportation comme celle dite de la Piste des Larmes 1831-1838. La région, qui était déjà habitée par les tribus osages et Quapaws, fut attribuée par le gouvernement américain aux Choctaws puis à d'autres peuples déplacés, les Cherokees de Géorgie, les Séminoles de Floride, les Chickasaws de Louisiane. Vers 1890, plus de 30 nations et tribus amérindiennes vivaient sur le Territoire indien .
Durant la guerre de Sécession, le Territoire indien fut envahi par l'armée confédérée et par celle de l'Union. Dès 1866, de nouveaux traités furent passés entre les Indiens et le gouvernement qui amputèrent de moitié le territoire originel des Amérindiens. L'autre moitié servit à parquer des tribus telles que les Ottawas ou les Wichitas. Finalement, le 22 avril 1889, les terres furent ouvertes aux colons qui s'y installèrent en masse près de 50 000. Le 2 mai 1889, le Territoire de l'Oklahoma fut organisé sur la partie occidentale du Territoire indien, auquel fut adjoint l'Oklahoma Panhandle.
Entre 1866 et 1899, la croissance démographique des États-Unis entraîna une augmentation de la consommation de viande. Pour faire face à cette demande, l'élevage se développa au Texas et dans l'Oklahoma. Ce fut la grande époque des cow-boys qui menaient les troupeaux vers les gares du Kansas. En 1881, quatre des cinq chemins de transhumance passaient par le Territoire indien.
Avec l'installation de colons blancs dans la région, le gouvernement fédéral établit le Dawes Act en 1887, approfondi par le Curtis Act en 1898. Cette loi distribuait les terres tribales aux familles amérindiennes et encourageait leur mise en valeur agricole. La moitié des terres amérindiennes fut en réalité ouverte à la colonisation ou achetée par les compagnies de chemin de fer. La course à la terre Land Run en anglais, en particulier en 1889, commençait selon le principe du premier arrivé, premier servi. Ceux qui ne respectaient pas les règles en entrant dans le Territoire avant le départ officiel étaient appelés les sooners, terme qui devint le surnom de l'Oklahoma. Entre 1889 et 1895, six courses à la terre furent organisées. Le 16 novembre 1907, le Territoire de Oklahoma et le Territoire indien furent regroupés au sein de l État de l'Oklahoma qui devint le 46e État de l'Union.
La tentative de créer un état amérindien nommé Oklahoma ou Sequoyah échoua ; mais la Sequoyah Statehood Convention de 1905 posa les fondations de l'Oklahoma Statehood Convention, qui se réunit deux ans plus tard. La découverte du pétrole provoqua l'essor de plusieurs villes à partir de 1896 : au début du XXe siècle, Tulsa fut surnommée la capitale mondiale du pétrole Oil Capital of the World. En 1927, l'État atteignait sa production maximale de pétrole. La même année, l'homme d'affaires Cyrus Avery s'engagea en faveur de la création de la Route 66. Il souhaitait que sa région d'adoption, l'Oklahoma, soit au carrefour de plusieurs routes traversant les États-Unis.
Passé afro-américain
Oklahoma possède également une riche histoire afro-américaine. Plusieurs communautés noires se sont formées au début du XXe siècle pour échapper au racisme qui prévalait notamment dans les États du Sud. Leur installation dans ce qui était alors le Territoire indien a été encouragée par le politicien Edward P. McCabe. Ce dernier essaya même de convaincre le président Theodore Roosevelt que l'Oklahoma deviendrait un État majoritairement noir. Pourtant, de nombreuses communautés afro-américaines sont devenues des villes fantômes, à quelques exceptions près comme Boley et Langston, siège de l'université afro-américaine de Langston.
Malgré les lois Jim Crow et la présence du Ku Klux Klan, le quartier noir de Greenwood, connut son heure de prospérité jusqu'aux émeutes raciales de 1921. Ces dernières firent entre 50 et 500 morts, des milliers de blessés et des destructions importantes. À la fin des années 1920, l'influence du Ku Klux Klan diminua fortement en Oklahoma.
XXe siècle
Pendant les années 1930, le Nord-Ouest de l'État fit partie du Dust Bowl, la région des États-Unis touchée par la sécheresse et l'érosion des sols. De nombreux agriculteurs furent contraints de quitter l'Oklahoma pour s'installer à l'ouest du pays : ce sont les Okies. La catastrophe fit également de nombreux morts victimes de maladies respiratoires ou de malnutrition. La population diminua jusque dans les années 1950. Le président américain Franklin Roosevelt ordonna au Civilian Conservation Corps de planter des arbres entre la frontière canadienne et le Texas afin de couper le vent et de maintenir les sols. Les fermiers furent formés aux techniques de préservation du sol et de l'eau. Plusieurs barrages furent aménagés pour les besoins de l'irrigation et pour contrôler les crues. Ainsi, dans les années 1960, on comptait déjà près de 200 lacs artificiels, le record aux États-Unis._
La prohibition n'y a été abolie que tardivement en 1959.
L'économie de l'Oklahoma reprit sa croissance avec la Seconde Guerre mondiale. Les besoins de l'armée américaine stimulèrent la production de pétrole et de biens manufacturés. L'État connut de nouveau la crise dans les années 1980 avec la multiplication des faillites bancaires et la diminution de la production de pétrole. L'attentat d'Oklahoma City eut lieu le 19 avril 1995 contre le bâtiment fédéral Alfred P. Murrah ; il fit 168 morts dont 19 enfants et plus de 800 blessés. Perpétré par Timothy McVeigh et Terry Nichols, attentat le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis après ceux du 11 septembre 2001.
Économie
La BOK Tower à Tulsa, est le plus haut gratte-ciel de l'Oklahoma. Elle abrite le siège social de Williams Companies.
L'économie de l'Oklahoma repose sur les secteurs de l'aérospatiale, de l'énergie, du matériel de transport, de l'agroalimentaire, de l'électronique et des télécommunications. Au début de l'année 2007, l'Oklahoma comptait 1,7 million d'emplois civils. Le gouvernement est le premier employeur avec 326 000 postes, suivi par le transport 285 000, l'éducation 191 000, les affaires 178 000 et l'industrie 151 000.
L'État se classe au deuxième rang national pour la production de gaz naturel et au cinquième pour le blé. En 2007, quatre entreprises du classement Fortune 500 et trois du Fortune 1000 ont leur siège en Oklahoma. L'Oklahoma est attractif pour les entreprises car il se classe au 7e rang pour le faible degré d'imposition.
Entre 2000 et 2006, le PIB augmente de 50 %, ce qui représente la 5e croissance économique du pays. Entre 2005 et 2006, le PIB passe de 122,5 milliards de dollars à 134,6 milliards de dollars, soit une croissance de 10,8 %10 ; le PIB/hab. progresse de 5,9 % 36 364 dollars/hab. en 2006 ; 38 516 $/hab. en 2007, c'est-à-dire la troisième meilleure performance aux États-Unis. En 2007, l'Oklahoma se classe 41e sur 50 États américains pour le PIB/hab. Bien que le pétrole domine l'économie pendant la majeure partie du XXe siècle, près de 90 000 emplois liés au secteur énergétique disparaissent entre 1980 et 2000. En décembre 2009, le taux de chômage est de 6,6 %, un taux très inférieur à la moyenne nationale.
En 2008, les exportations de l'Oklahoma dépassent les 5 milliards de dollars. Les principaux pays importateurs sont le Canada, le Mexique, le Japon, la Chine et Singapour. Les machines, les composants d'avion, les instruments optiques et médicaux représentent la moitié des exportations.
Agriculture
L'Oklahoma est le 27e État américain pour la production agricole, le cinquième pour le bétail et pour la production de blé. Environ 5,5 % du bœuf américain provient de l'Oklahoma, 6,1 % du blé, 4,2 % de la viande de porc et 2,2 % des produits laitiers. Les autres productions sont le fourrage, le maïs, le soja, le coton, les poulets d'élevage 44,3 millions, les poules pondeuses 3,3 millions.
Les rives de la Red River constitue une importante région céréalière alors que la région de l'Arkansas River est vouée à l'élevage. L'État compte 86 600 exploitations 2008 sur 14 millions d'hectares et qui génèrent 5,8 milliards de dollars de recettes. La taille moyenne des exploitations est de 163,9 hectares, mais les plus grandes se trouvent à l'ouest
Énergie et minerais
L'Oklahoma est le cinquième État producteur de pétrole brut du pays
Comme pour le Texas voisin, le secteur pétrolier représente un part importante de l'économie de l'Oklahoma. L'industrie pétrolière représente 23 milliards de dollars du PIB de l'État et les salariés de ce secteur ont un revenu deux fois supérieur aux autres employés. En 2004, 83 750 puits de pétrole à usage commercial étaient recensés sur un total de 750 000 pour une production de 178 000 barils de brut par jour. L'Oklahoma se classe au cinquième rang de la production américaine de pétrole. Il existe cinq raffineries, dont deux se trouvent dans l'aire métropolitaine de Tulsa. Enfin, l'État possède la deuxième concentration de foreuses actives du pays et la cinquième réserve de pétrole brut.
L'Oklahoma est le cinquième État américain pour la capacité de production d'énergie éolienne, qui se concentre à l'ouest ; cependant, 96 % de l'énergie est produite par des sources non renouvelables : 64 % par le charbon et 32 % par des centrales à gaz. Il existe actuellement neuf grands barrages hydroélectriques, essentiellement situés à l'est, dont le plus grand est celui de Pensacola construit pendant la Grande Dépression. Enfin, l'Oklahoma ne possède aucune centrale nucléaire.
En 2004, la production de gaz représentait 8 % de la production nationale, faisant de l'Oklahoma le troisième producteur des États-Unis. 10 % des besoins américains en gaz naturel sont assurés par l'Oklahoma avec une production de 47 1 km3.
Selon Forbes, Devon Energy Corporation, Chesapeake Energy Corporation et SandRidge Energy Corporation, dont les sièges sociaux sont à Oklahoma city, sont les plus grands groupes pétroliers privés du pays. Toutes les compagnies classées dans le Fortune 500 appartiennent au secteur de l'énergie. En 2006, Semgroup, une entreprise de transport des hydrocarbures basées à Tulsa, se classait cinquième dans le classement des plus grandes compagnies privées de Forbe de 2008, QuikTrip 46e et Love's Travel Stops & Country Stores 25e.
L'Oklahoma se classe 11e pour la consommation d'énergie par habitant en 2006.
L'Oklahoma produit également des pierres, du ciment Portland, du sable, des graviers, du charbon dans l'Est et du gypse. Il est le premier producteur américain d'iode, le troisième d'hélium, le cinquième de feldspath. Le gypse et le sel dans l'Ouest alimentent l'industrie chimique.
Industrie
Le secteur de l'aérospatiale emploie 7,6 % de la population active et 10 % de la production industrielle de l'Oklahoma qui figure parmi les dix premiers États pour ce secteur. Il génère quelque 11 milliards de dollars par an. Tulsa abrite la plus grande base aérienne de maintenance du monde ainsi que le siège social de la compagnie American Airlines.
Bénéficiant d'une situation géographique centrale aux États-Unis, l'Oklahoma abrite de très nombreux centres de logistique. Il est le premier producteur de pneus d'Amérique du Nord et connaît une rapide croissance des activités de biotechnologies. Les exportations de produits manufacturés représentaient 4,3 milliards de dollars en 2005. L'agroalimentaire, notamment le conditionnement de la viande, et la production d'après-shampooing sont d'autres productions industrielles majeures.
En 2005, 14,5 % des habitants déclarent avoir des ancêtres allemands, 13,1 % américains, 11,8 % irlandais, 9,6 % anglais, 8,1 % afro-américains et 11,4 % amérindiens dont 7,9 % cherokee. L'Oklahoma possède la plus grande proportion et le plus grand nombre d'Amérindiens du pays 395 219 en 2002. Les Amérindiens forment la première minorité ethnique juste devant les Afro-américains.
La structure par âge de la population est sensiblement la même que celle des autres Américains : 24,9 % ont moins de 18 ans et 13,5 % ont plus de 65 ans. 20,3 % des habitants ont un diplôme de l'enseignement supérieur. Le revenu moyen par habitant est de 17 646 $ soit 3 941 dollars de moins que la moyenne nationale. Le taux de personnes vivant sous le seuil de pauvreté est de 15,8 % contre 13 % pour les États-Unis. L'Oklahoma se classe parmi les États américains où la vie est la moins chère.
Santé
En 2005, l'Oklahoma est le 21e État américain pour les subventions fédérales en faveur de la santé pour une dépense totale de 7 580 364 dollars. Les principaux investissements concernent la vaccination, la prévention contre le bioterrorisme et l'éducation à la santé. L'Oklahoma se situe dans la moyenne nationale pour le proportion de personnes souffrant d'asthme, de diabète, du cancer et d'hypertension.
En 2000, l'Oklahoma se classe 45e pour le nombre de médecins par habitant ; en revanche, il se trouve au-dessus de la moyenne nationale pour le nombre moyen de places à l'hôpital. En 2005, un quart des habitants entre 18 et 64 ans n'ont pas d'assurance maladie, l'un des plus forts taux des États-Unis. 30,3 % des habitants sont obèses, soit le cinquième plus fort taux du pays.
Le principal centre hospitalier est l'Oklahoma Health Center à Oklahoma City, qui regroupe de nombreuses structures de recherche comme l'University of Oklahoma Health Sciences Center
Le centre médical régional pour le traitement du cancer à Tulsa est l'une des quatre institutions de ce genre aux États-Unis, et l'une des plus importantes du pays. Dans la même ville, l'Oklahoma State University Medical Center possède la plus grande école d'ostéopathie des États-Unis et l'un des meilleurs établissements spécialisés dans les neurosciences.
Religion
La Boston Avenue Methodist Church à Tulsa est classée National Historic Landmark.
Oklahoma fait partie de la Bible Belt, littéralement la ceinture de la Bible, une région du Sud des États-Unis dans laquelle vivent un pourcentage élevé de personnes se réclamant d'un protestantisme rigoriste. L'université Oral Roberts de Tulsa est considérée comme l'épicentre du renouveau charismatique et du fondamentalisme protestant dans l'État. La population de Bible Belt se caractérise par son conservatisme sur les questions de société et de politique : condamnation de l'homosexualité, de l'avortement, de la théorie de l'évolution, etc.
D'après le Pew Research Center, plus de 80 % des habitants de l'Oklahoma sont chrétiens. La proportion de catholiques est moitié moins élevée que la moyenne nationale, alors que le pourcentage de personnes pratiquant l'évangélisme est deux fois plus élevée que dans le pays. Les croyants se répartissent dans 73 affiliations religieuses principales et quelque 5 854 congrégations. La Convention baptiste du Sud domine avec 1 578 églises et 967 223 membres ; la Holy Orthodox Church in North America ne compte qu'une église et six membres. L'Église méthodiste unie revendique 322 794 fidèles, l'Église catholique romaine 168 625, les Assemblées de Dieu 88 301 et les Églises du Christ 83 047. En 2000, il y avait environ 5 000 juifs et 6 000 musulmans, avec dix congrégations pour chaque groupe.
Répartition des habitants par confession :
Évangélisme – 53 %
Protestantisme – 16 %
Catholicisme – 13 %
Autres – 6 %
Sans affiliation
Villes de l'Oklahoma.
Oklahoma city est la plus grande ville de l'état.
Tulsa est la deuxième plus grande ville de l'Oklahoma
Les principales aires urbaines de l'Oklahoma sont Oklahoma City 1 206 142 habitants et Tulsa 916 079 habitants qui regroupent à elles deux 58 % des habitants de l'Oklahoma.
Les métropoles de l'Oklahoma ressemblent aux autres grandes villes américaines : elles comportent un centre des affaires avec des gratte-ciel, entouré par des ghettos, des entrepôts et des zones industrielles. Les banlieues, dans lesquelles résident les classes moyennes blanches, sont reliées au centre par des autoroutes et quelques voies ferrées. Des opérations de rénovations des centres-villes programme Main Street depuis 1985 ont pour objectif de revitaliser ces quartiers et attirer les touristes.
Selon la législation en vigueur, les municipalités se rangent en deux groupes : les cities ont plus de 1 000 habitants alors que les towns ont moins de 1 000 habitants. Les deux types de villes possèdent des pouvoirs législatifs et judiciaires propres. Les cities peuvent choisir leur organisation parmi deux modèles : le Mayor–council government ou le Council–manager government Gouvernement à gérance municipale.
Politique
Le Capitole de l’État d'Oklahoma se situe à Oklahoma City.
Le gouvernement de l'Oklahoma est une république constitutionnelle qui suit le modèle du Gouvernement fédéral des États-Unis et qui est séparé en trois branches pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. L'État est divisé en 77 comtés et six districts congressionnels.
Institutions de l'État
La législature de l'Oklahoma est constituée d'un Sénat et d'une Chambre des Représentants. Elle détient le pouvoir législatif et vote le budget de l'État. Les 48 sénateurs sont élus pour quatre ans ; la Chambre des représentants compte 101 membres avec un mandat de deux ans. Les élus de la législature ne peuvent rester en charge plus de douze années consécutives pour les deux fonctions.
Lors de la session 2011–2013, la législature de l'État est largement dominée par les Républicains. Au Sénat, 32 Républicains font face à 16 Démocrates tandis que la Chambre des Représentants est dominée par une majorité de 70 élus républicains contre 31 démocrates.
Le pouvoir judiciaire est assuré par deux cours d'appel : la Cour suprême de l'Oklahoma pour les affaires civiles et l'Oklahoma Court of Criminal Appeals pour les crimes. Cette dernière se prononce sur l'application de la peine de mort. L'État est subdivisé en 77 districts District Courts, qui correspondent aux 77 comtés. Le système judiciaire comprend également deux cours indépendantes : la Court of Impeachment et l'Oklahoma Court on the Judiciary. Les juges de ces deux cours, ainsi que ceux de la Court of Civil Appeals sont désignés par le gouverneur sur recommandation d'une commission judiciaire Judicial Nominating Commission pour six années. Depuis 1976, l'Oklahoma a exécuté 88 personnes, ce qui place cet État au troisième rang derrière le Texas et la Virginie.
La branche exécutive se compose d'un gouverneur et de son équipe ainsi que d'autres personnels élus. Elle élabore le budget, applique les lois, assure la sécurité et l'ordre dans l'État. Le gouverneur, élu pour quatre ans, est le chef du gouvernement : il est le commandant en chef de la garde nationale de l'Oklahoma et possède un droit de veto sur les lois votées par la Législature.
Il existe en outre 39 gouvernements tribaux amérindiens qui exercent des pouvoirs limités sur certains secteurs de l'Oklahoma, des terres attribuées à l'époque du Territoire indien. En revanche, il n'y a pas de réserves indiennes comme dans le reste des États-Unis. Les gouvernements tribaux détiennent une quasi souveraineté sur les membres et les fonctions de la tribu. Ils sont sous l'autorité du Congrès américain dans certains domaines, notamment en matière constitutionnelle.
Depuis l'élection présidentielle de 1952 54,59 % pour Dwight Eisenhower, et à l'exception d'une seule fois, les électeurs de l'Oklahoma ont eu tendance à plébisciter les candidats républicains aux élections présidentielles. De fait, les électeurs d'Oklahoma n'ont pas voté pour un candidat démocrate depuis Lyndon Johnson en 1964. Ainsi, lors de l'élection présidentielle de 2008, le candidat républicain John McCain remporte tous les comtés de l'Oklahoma et obtient son meilleur score national 66 % alors qu'il est battu par le démocrate Barack Obama au niveau national. Bien que l'Oklahoma soit considéré lors des élections présidentielles comme l'un des états les plus républicains du pays, une majorité des électeurs continuent d'être enregistrés sur les listes électorales du parti démocrate.
Culture
Du fait de sa position centrale aux États-Unis, de l'impact de son histoire et de son brassage ethnique, l'Oklahoma possède une culture riche mais qui lui est propre. Le Bureau de recensement américain place l'Oklahoma parmi les États du Sud ; mais l'Oklahoma se trouve à la charnière de plusieurs ensembles culturels comme le Middle West et le Sud-Ouest. Certaines régions de l'Oklahoma appartiennent au Sud supérieur et aux Grandes Plaines.
La culture de l'Oklahoma est marquée par la diversité des influences. Les habitants se réclament de différentes origines, essentiellement allemandes, irlandaises et amérindiennes. 25 langues amérindiennes sont parlées, plus que dans n'importe quel autre État américain. Dans le passé, six gouvernements différents ont revendiqué leur souveraineté sur le territoire de l'Oklahoma. 67 tribus amérindiennes sont présentes et 39 nations reconnues par le pouvoir fédéral. L'afflux de populations amérindiennes dans les siècles précédents, a beaucoup joué sur la personnalité de l'État de l'Oklahoma. Les symboles améindiens y sont d'ailleurs nombreux, jusque dans le drapeau de l'État sur lequel figure un bouclier traditionnel des plaines sur lequel se croisent une branche d'olivier et un calumet de la paix. Les différents gouvernements qui se sont succédé à la tête de l'Oklahoma ont d'ailleurs joué un rôle très important dans ce devoir de mémoire, et dans cette fierté d'appartenir à l'État des Native Americans, c'est-à-dire des Indiens d'Amérique. Cette volonté de conservation s'exprime au travers de la conservation de l'art, de la culture et des croyances amérindiennes dans différents musées et sites spécifiques tels que le musée Tsa-La-Gi de Tahlequah, Musée de la civilisation Cherokee.
La cuisine reflète particulièrement l'appartenance de l'Oklahoma au Sud du pays et sa diversité culturelle. Les plats traditionnels sont ceux de la cuisine du Sud des États-Unis et utilisent des produits comme la cornille, la courge et le maïs. Le barbecue et la tarte aux pacanes figurent parmi les mets incontournables de l'Oklahoma.
Festivals et évènements culturels
Les évènements culturels amérindiens, comme les pow wows, sont fréquents en Oklahoma.
En 2007, le centenaire de l'Oklahoma fut élu meilleur événement de l'année par l'American Bus Association1. De nombreux festivals ethniques se tiennent tout au long de l'année au cours desquels les visiteurs peuvent assister à des pow wows. La foire d'Oklahoma, Oklahoma State Fair et celle de Tulsa Tulsa State Fair se déroulent pendant dix jours et reçoivent chacune près d'un million de visiteurs. En 2006, l'Oktoberfest, une fête de la bière qui se tient à Tulsa, a été reconnue comme l'une des plus importantes dans le monde par le quotidien USA Today.
Tulsa compte également un grand nombre d'événements culturels : en 2007, le Mayfest festival a attiré quelque 375 000 visiteurs sur quatre jours. Le Dfest est un festival de musique renommé. Rocklahoma est un festival annuel de hard rock se déroulant à Pryor, qui a réuni quelque 100 000 spectateurs en 2007. À Norman se déroule le Norman Music Festival.
Architecture et arts plastiques
Les premières habitations des colons sont en bois. Les demeures du Sud ressemblent à celles des grands plantations. L'architecture du début du XXe siècle est marquée par l'éclectisme. Les magnats du pétrole se font construire des résidences à la mesure de leur fortune. Les bâtiments publics sont relativement récents. Certains ont été construits par de grands noms de l'architecture comme Frank Lloyd Wright Price Tower, à Bartlesville. Les campus universitaires et les églises adoptent souvent le style néogothique. Les centres d'affaires sont constitués de gratte-ciel témoignant de la puissance des entreprises.
Les premiers peintres blancs qui visitent le territoire de l'Oklahoma représentent les Amérindiens : George Catlin 1796-1872 qui séjourne dans les Montagnes Wichita dans les années 1830, John Mix Stanley 1814-1872, Frederic Remington 1861-1918, Elbridge Ayer Burbank 1848-1959. Au début du XXe siècle, les magnats de l'industrie et du pétrole investissent leur fortune dans l'art. L'école d'art de l'université de l'Oklahoma commence à rayonner sur la culture de l'état. L'Association of Oklahoma Artists voit le jour en 1916. Pendant l'Entre-Deux-Guerres, des fresques qont réalisées par des artistes amérindiens sur les murs des bâtiments publics. D'une manière générale, la WPA encourage le développement de la culture durant la Grande Dépression.
Arts du spectacle et musique
Le festival Mozart Oklahoma Mozart Festival de Bartlesville est l'un des plus importants du Sud des États-Unis. Le Festival of the Arts d'Oklahoma City est également l'un des meilleurs du pays. Cinq ballerines amérindiennes sont originaires de l'État et ont des tournées mondiales : Yvonne Chouteau, les sœurs Marjorie et Maria Tallchief, Rosella Hightower et Moscelyne Larkin, connues sous le nom de Five Moons. Le Tulsa Ballet est considéré par le journal New York Times comme l'une des meilleures compagnies des États-Unis. Yvonne Chouteau et son époux Miguel Terekhov sont à l'origine de l'Oklhoma City Ballet et de l'University of Oklahoma's dance program en 1962. À Sand Springs, un amphithéâtre en plein air appelé Discoveryland! accueille la comédie musicale Oklahoma !.
Le XIXe siècle fut marqué par la coexistence de traditions musicales différentes : rythmes amérindiens, ballades des cow-boys et des pionniers, Negro spiritual. Le jazz s'est développé dans les grandes villes de l'Oklahoma au début du XXe siècle. L'Oklahoma est le berceau de styles musicaux tels que The Tulsa Sound et Western Swing, qui fut popularisé par le Cain's Ballroom de Tulsa. Le bâtiment appelé Carnegie Hall of Western Swing servit de salle de spectacle pour Bob Wills et les Texas Playboys pendant les années 1930. Stillwater est connue comme le foyer de la musique Red Dirt, dont le principal représentant est le groupe Bob Childers.
Musées et institutions culturelles
Oklahoma possède plus de 300 musées. Le Philbrook Museum de Tulsa est considéré comme l'un des 50 meilleurs musées des États-Unis et le Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History à Norman est l'un des plus grands musées universitaires. Les collections de Thomas Gilcrease sont exposées au Gilcrease Museum de Tulsa, qui abrite également la plus grande collection d'art de l'Ouest américain. L'Oklahoma City Museum of Art est célèbre pour ses collections de Dale Chihuly, les plus importantes du monde ; le National Cowboy and Western Heritage Museum à Oklahoma City expose des objets sur la conquête de l'Ouest. Le Sherwin Miller Museum of Jewish Art de Tulsa possède la plus grande collection judaïque du Sud-Ouest des États-Unis.
Cinéma
De nombreux films ont été tournés ou se déroulent en Oklahoma. La La Ruée vers l'Ouest 1960 puis Horizons lointains 1992 évoquent la course à la terre au xixe siècle. Oklahoma ! 1955 est l'adaptation en film musical par Fred Zinnemann de la comédie musicale du même titre. Tulsa 1949 se déroule pendant le boom pétrolier. Outsiders de Francis Ford Coppola 1983 fut tourné à Tulsa. Twister a été filmé en Oklahoma et met en scène des chasseurs de tornades. L'Oklahoma est un lieu de passage pour les héros des road movies Macadam à deux voies 1971 et Rain Man 1989. Meurtre à Tulsa 1997 est une adaptation du roman de Bryan Fair Berkey. Le Mystère Silkwood 1983 raconte l'histoire réelle de Karen Silkwood morte dans des circonstances douteuses alors qu'elle enquêtait sur des actes délictueux dans l'usine de plutonium où elle travaillait à Cimarron Oklahoma. Bien que dans le film Thelma et Louise 1991, l'action se situe en partie en Oklahoma, ce film a en réalité été tourné en Utah et surtout en Californie qui offre certains paysages similaires ceux de l'Oklahoma.
Littérature
Les premiers écrits sur l'Oklahoma datent du xvie siècle. Il s'agit du récit de l'expédition du conquistador Francisco Vásquez de Coronado raconté par Castañeda. Au xixe siècle, le naturaliste anglais Thomas Nuttall 1786-1859 et l'écrivain américain Washington Irving 1782-1859 décrivent la région. En 1835, le missionnaire Samuel Worcester traduit la Bible pour les Cherokees et installe la première presse de l'Oklahoma. Il publie de nombreux textes amérindiens. Entre la Guerre de Sécession et le début du XXe siècle, la littérature de l'Oklahoma s'enrichit des témoignages des pionniers et des officiers comme ceux de Thompson Benton Ferguson 1857-1921, futur gouverneur de l'État. La poésie se développa après la Première Guerre mondiale sous l'impulsion de professeurs de l'université de l'Oklahoma tels que Rollie Lynn Riggs 1899-1954 ou Stanley Vestal 1877-1957. Les poètes Donald Benson Blanding 1894-1957 et John Berryman 1914-1972 eurent des carrières nationales. Benjamin A. Botkin 1901-1975 édite entre 1929 et 1932 la revue Folk-Say sur le folklore américain. En 1945, Marquis James 1891-1955 publie Cherokee Strip: A Tale of an Oklahoma Boyhood ainsi que plusieurs biographies. Plusieurs écrivains de la deuxième moitié du XXe siècle sont originaires de l'Oklahoma : Angie Debo 1890-1988 a écrit de nombreux livres sur l'histoire de l'Oklahoma et sur les Amérindiens. John Joseph Mathews vers 1894-1979 est l'auteur de romans à succès sur les Osages. L'histoire de l'Oklahoma a donné de nombreuses sources d'inspiration aux écrivains nés dans l'état : par exemple, Matt Braun s'est spécialisé dans le western et a reçu plusieurs récompenses littéraires. Cimarron est un roman d'Edna Ferber publié en 1929 qui évoque la course à la terre. L'Oklahoma est aussi le décor choisi par John Steinbeck pour le début de son roman Les raisins de la colère dépeignant la grande misère qui a frappé les petits exploitants lors de la Grande Dépression. Enfin cet État, et plus précisément la période de la course à la terre, a inspiré le dessinateur de Bandes dessinées Morris dans un album de Lucky Luke intitulé 'Ruée sur l'Oklahoma'.
Éducation
Le système éducatif se compose d'écoles publiques financées par l'État de l'Oklahoma et d'écoles privées indépendantes. En 2006, il comptait 631 337 élèves répartis dans 1 846 établissements primaires et secondaires et 540 school districts. L'Oklahoma compte le plus grand nombre d'élèves amérindiens du pays, 120 122 pour l'année scolaire 2005-2006. L'État se classe parmi les derniers pour les dépenses d'éducation 6 614 dollars par élève en 2005 même si celles-ci ont augmenté. En 2004, il était à la 36e place pour le pourcentage d'adultes ayant un diplôme du secondaire 85,2 %, soit l'un des plus forts taux du Sud des États-Unis .
Il existe au total 43 établissements d'enseignement supérieur dans l'État. Les deux plus grandes universités publiques sont l'Université d'Oklahoma 30 000 étudiants et l'Oklahoma State University–Stillwater 32 760 étudiants pour l'année universitaire 2006-2007. Chacune possède un campus principal et des antennes régionales. L'Université d'Oklahoma City 3 800 étudiants, l'Université Oral Roberts et l'Université de Tulsa 4 187 étudiants sont les principaux établissements privés.
L'Oklahoma possède 11 universités publiques régionales. La Northeastern State University est la deuxième institution d'enseignement supérieur fondée à l'ouest du Mississippi 1851 et possède la seule école d'optométrie de l'Oklahoma et le plus important effectif d'étudiants amérindiens du pays.
Sports
L'Oklahoma possède de nombreuses équipes sportives en basket-ball, football américain, baseball, soccer et hockey sur glace, dans les villes d'Oklahoma City, Tulsa, Enid, Norman et Lawton. Le Thunder d'Oklahoma City évolue en NBA et est la seule équipe qui joue dans une ligue professionnelle nationale. Les autres équipes appartiennent à des divisions inférieures : ligue mineure de baseball, les RedHawks d'Oklahoma City, les Drillers de Tulsa, arenafootball, les Yard Dawgz d'Oklahoma City, les Talons de Tulsa, National Women's Football Association, équipe féminine du Lightning d'Oklahoma City, NBA Development League 66ers de Tulsa. Les villes d'Enid et de Lawton possèdent des équipes professionnelles de basket-ball : USBL et CBA. Après le passage du cyclone Katrina sur la Louisiane en 2005, le club de basket-ball des Hornets de La Nouvelle-Orléans fut contraint de s'installer au Ford Center d'Oklahoma City où ils jouèrent pendant deux saisons. En juillet 2008, les SuperSonics de Seattle, propriété d'un groupe d'hommes d'affaires d'Oklahoma City dirigé par Clayton Bennett, furent relocalisés au Ford Center sous le nom du Thunder d'Oklahoma City.
Le sport universitaire est très populaire dans l'État. Les Sooners de l'Oklahoma, Université de l'Oklahoma et les Cowboys d'Oklahoma State qui évoluent dans la division sud de la Big 12 Conference. Les derbys entre les deux équipes sont appelés Bedlam Series et sont particulièrement suivis. Le programme de football américain de l'université de l'Oklahoma réunit en moyenne 84 561 spectateurs lorsque l'équipe joue à domicile.
11 universités ou colleges sont inscrits à la NCAA, dont quatre appartiennent à la première division : l'université de l'Oklahoma, l'université d'État de l'Oklahoma, l'université de Tulsa et l'université Oral Roberts. Le magazine Sports Illustrated place les équipes de l'Université de l'Oklahoma et l'Université d'État d'Oklahoma parmi les meilleures du pays.
Douze autres établissements d'enseignement supérieur participent à la National Association of Intercollegiate Athletics, la plupart dans la Sooner Athletic Conference. La finale de l'US Open féminin de golf a été jouée à Muskogee en 1970 et au Cedar Ridge Country Club à Tulsa en 1983. Le championnat de golf masculin s'est déroulé dans plusieurs lieux de l'État : Southern Hills Country Club Tulsa, Oak Tree Country Club Oklahoma City et Cedar Ridge Country Club Tulsa. Southern Hills a accueilli quatre championnats de la PGA et trois US Open de golf, le plus récent en 2001. Le rodéo est également un sport populaire en Oklahoma et la ville de Guymon organise le plus important des États-Unis.
Presse écrite
En 2006, l'Oklahoma compte plus de 220 périodiques, dont 177 hebdomadaires et 48 quotidiens. The Oklahoman Oklahoma City est le quotidien le plus important de l'État et le 48e du pays. Il est diffusé à 215 102 exemplaires en semaine et 287 505 le dimanche. Le Tulsa World est le deuxième en Oklahoma et le 77e aux États-Unis 189 789 le dimanche et 138 262 en semaine. Le Cherokee Advocate, premier journal de l'Oklahoma, est paru en 1844 ; les articles étaient publiés en langue Cherokee et en anglais.
Radios
WKY est la première station à Oklahoma City en 1920, suivie par KRFU à Bristow, qui est transférée par la suite à Tulsa et devint KVOO en 1927. En 2006, il existe plus de 500 stations de radio en Oklahoma.
Les deux principales radios sont Oklahoma Public Radio et Public Radio International. Lancée en 1955, Oklahoma Public Radio a reçu 271 récompenses pour la qualité de ses programmes. Public Radio International diffuse ses émissions sur dix stations à travers l'État.
Télévision
Les débuts de la télévision hertzienne en Oklahoma remontent à 1949 avec la naissance des chaînes KFOR-TV à Oklahoma City et KOTV-TV à Tulsa. Actuellement, tous les réseaux nationaux sont disponibles.
L'Oklahoma possède quelques chaînes de télévision communautaires à destination des Amérindiens, des Hispaniques et des Asiatiques. Trinity Broadcasting Network est un réseau de télévision chrétienne dont les studios se trouvent à Tulsa.
Transports
Par sa position centrale aux États-Unis, à équidistance entre New York et Los Angeles, l'Oklahoma est un carrefour de voies de communications et possède un réseau de transport diversifié. L'État est traversé par quatre autoroutes inter-États Interstate Highway. À Oklahoma City se croisent l'Interstate 35, l'Interstate 44 et l'Interstate, ce qui constitue le plus important carrefour du système autoroutier américain. Le réseau routier a une longueur cumulée de 19 000 km et se compose notamment d'autoroutes gérées par l'État de l'Oklahoma et de dix autoroutes à péage. La célèbre Route 66 qui relie Chicago à Los Angeles traverse l'État du nord-est à l'ouest en passant par Tulsa. En 2005, l'Interstate 44 à Oklahoma City était l'autoroute la plus fréquentée de l'Oklahoma avec une moyenne de 131 800 voitures par jour.
L'aéroport Will Rogers World à Oklahoma City est le plus important aéroport de l'Oklahoma avec environ 3,5 millions de passagers par an. Le deuxième est l'aéroport international de Tulsa, avec trois millions de passagers par an. En termes de trafic, l'aéroport de Riverside-Jones à Tulsa est le plus actif avec 235 039 décollages et atterrissages en 2006. Au total, l'Oklahoma possède plus de 150 aéroports publics.
L'Oklahoma ne possède qu'une ligne de chemin de fer pour les passagers : depuis 1999, la Heartland Flyer mesure 332 km entre Fort Worth au Texas et Oklahoma City. Un projet d'extension vers Tulsa est à l'étude depuis 2007. Le port de Muskogee et le Tulsa Port of Catoosa sont situés sur le McClellan-Kerr Arkansas River Navigation System qui est relié au Mississippi et qui constitue l'une des voies navigables les plus actives du monde. Le Tulsa Port of Catoosa a un trafic annuel de plus de deux millions de tonnes.
Liens
http://youtu.be/5sWi_IE-nAs La tornade du siècle dans l'Oklahoma
http://youtu.be/Cbix-qdv6c4 Oklahoma
http://youtu.be/B1B7UOKFNvI Tornade en Oklahoma
http://www.ina.fr/video/VDD11021024/tulsa-oklahoma-video.html Tulsa en Oklahoma
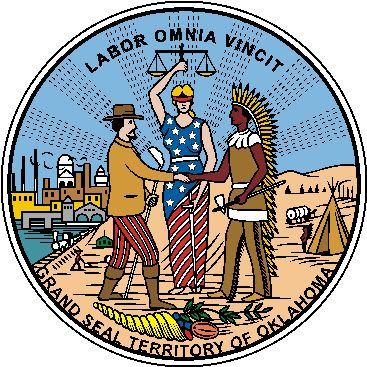 [img width=600]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAd00jMEq6fB_PM51zlGclz67O5bACdkYM6n9LwPUHRMKFmHcsEg[/img]  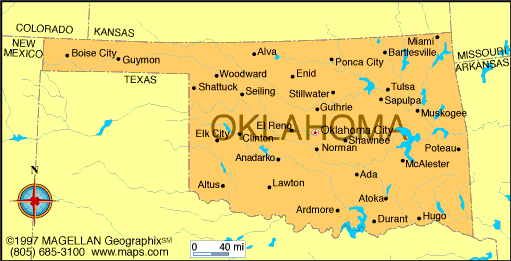        [img width=600]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROxeeH7ydSChwPFHsiz0UCyZUtplqk2rp4Dx9FlrBxqXemDsHd3J0yP60y[/img]    
Posté le : 16/11/2014 23:11
Edité par Loriane sur 17-11-2014 13:00:57
Edité par Loriane sur 17-11-2014 13:09:32
Edité par Loriane sur 17-11-2014 13:14:21
Edité par Loriane sur 17-11-2014 13:20:43
Edité par Loriane sur 17-11-2014 13:24:12
Edité par Loriane sur 17-11-2014 13:27:10
Edité par Loriane sur 19-11-2014 18:00:21
|
|
|
|
|
l'Unesco |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 16 novembre 1945 est crée l'UNESCO 
L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture en anglais United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Unesco ou UNESCO institution spécialisée de l'Organisation des Nations unies.
sigle de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, en français Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
Institution spécialisée de l'O.N.U., créée le 16 novembre 1945 à la suite de la réunion à Londres des représentants de 44 pays, en vue de la rédaction de son acte constitutif ratifié le 4 novembre 1946.
L'Unesco a pour but, notamment, de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales en resserrant par l'éducation, la science, la culture et la communication la collaboration entre nations afin d'assurer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
Singapour s'est retiré de l'Unesco en 1985. Les États-Unis ont délaissé l'organisation de 1984 à 2003, la Grande-Bretagne de 1985 à 1997.
Le siège de l'Unesco, à Paris, est un ensemble de cinq bâtiments construits entre 1955 et 1970 par B. Zehrfuss (en collaborationavec M. Breuer et P. L. Nervi pour les deux premiers. À leur décoration ont participé Picasso, Miró et Artigas, Arp, Moore, Calder, Bazaine, Tamavo, Soto, etc., ainsi que Noguchi jardin japonais et Burle Marx patios-jardins..
Rôle
Elle a pour objectif selon son acte constitutif de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations unies reconnaît à tous les peuples.
Le siège de l'Unesco est situé à Paris France, au 7/9 place de Fontenoy, dans le 7e arrondissement. Sont rattachés au siège plus de cinquante bureaux, plusieurs instituts et centres dans le monde entier, comme l’Institut de statistique à Montréal ou le Bureau international d'éducation à Genève.
L'Organisation compte 195 États membres en 2014.
L'Unesco poursuit son action à travers cinq grands programmes : l’éducation, les sciences exactes, naturelles, sociales et humaines, la culture, la communication et l’information.
Des périodiques spécialisés sont publiés comme le Bulletin du droit d’auteur, Perspectives pédagogie, la Revue internationale des sciences sociales, Museum muséographie.
L'Unesco anime la Décennie internationale pour la promotion d’une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde 2001-2010 proclamée par l’ONU en 1999.
Éducation
Les missions pour l’éducation de l’Unesco sont :
conduire au niveau international l’édification de structures permettant à toutes les populations d’accéder à l’éducation ;
offrir une expertise et encourager les partenariats afin de renforcer le leadership de l’éducation au niveau national ainsi que la capacité des pays à offrir une éducation de qualité à tous ;
l’Unesco pousse les États et la communauté internationale à accélérer la marche du progrès vers la réalisation de ces objectifs ;
l’organisation facilite la mise en place de partenariats et mesure les progrès accomplis.
Sciences naturelles
L'Unesco abrite la Commission océanographique intergouvernementale, organe de coordination scientifique.
Dans le cadre du programme MAB Man and Biosphere a établi un réseau de réserves de biosphères qui se propose de protéger la nature, tout en préservant l’activité humaine sur toute la planète.
Sciences humaines et sociales
En agissant dans l’un des cinq secteurs spécialisés de l’Unesco : éducation, sciences naturelles, sciences sociales et humaines, culture ainsi que communication et information , la mission est de faire avancer les connaissances, les normes et la coopération intellectuelle afin de faciliter les transformations sociales porteuses des valeurs universelles de justice, de liberté et de dignité humaine.
Culture
Logo du Patrimoine mondial de l'Unesco.
La collection Unesco d'œuvres représentatives est un projet de traduction de l'Unesco qui a été actif de 1948 à 2005.
L'Unesco est connue depuis 1972 pour sa liste du patrimoine mondial pour le patrimoine matériel, culturel et naturel. Une liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité existe également depuis 2001.
L'Unesco a aussi adopté la Déclaration universelle de l'Unesco sur la diversité culturelle en 2001 pour promouvoir la diversité culturelle.
La Bibliothèque numérique mondiale est une bibliothèque numérique lancée par l'Unesco et la Bibliothèque du Congrès des États-Unis opérationnelle depuis le 21 avril 2009.
Communication et information
L'Unesco a également créé en 1992 le programme Mémoire du monde, visant à sensibiliser la communauté internationale à la richesse du patrimoine documentaire, à la nécessité d’assurer sa conservation pour les générations futures et à le rendre accessible à un large public. Il s’est doté pour cela d’un Registre mondial, liste des éléments du patrimoine documentaire identifiés par le Comité consultatif international CCI et approuvés par le directeur général de l'Unesco.
L'Unesco est par ailleurs, à l’origine de la création, en mai 1994, conjointement avec l’Université du Québec à Montréal, du réseau Orbicom, réseau mondial associant des universitaires et des professionnels de la communication et des médias, ayant pour objet de stimuler l’échange d’informations et le développement de projets conjoints, afin d’examiner comment ce domaine en constante évolution peut contribuer à promouvoir la démocratie et un développement durable. Situé au carrefour de l’enseignement, de la recherche et des pratiques professionnelles, il s’est fixé pour mission première de développer et promouvoir le partage de savoir et d’expertise en communication par l’éducation, la recherche et l’action concrète. Reliant les spécialistes à travers le monde qui travaillent dans différents secteurs des communications, et soutenu par des institutions internationales, des médias, des gouvernements et des entreprises, il s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de la communication de l'Unesco, adoptée à l’unanimité lors de la Conférence générale de 1989.
Historique
L'Unesco et son mandat pour la coopération intellectuelle sur le plan international ont leurs racines dans la décision de la Société des Nations du 21 septembre 1921 d'élire une commission chargée d'étudier la question. Cette Commission internationale de coopération intellectuelle CICI, située à Genève, a été créée le 4 janvier 1922 comme un organe consultatif composé de personnalités élues pour leurs compétences personnelles. L'Institut international de coopération intellectuelle IICI a été établi à Paris le 9 août 1925 comme l'agence exécutive de la CICI. Le 18 décembre 1925, le Bureau International d'Éducation BIE a commencé son action comme organisation non-gouvernementale au service du développement international dans le domaine éducatif. Néanmoins, le travail de ces prédécesseurs de l'Unesco, a été interrompu par la Seconde Guerre mondiale.
À la suite des signatures de la Charte de l'Atlantique et de la Déclaration des Nations unies, la Conférence des Ministres alliés de l'éducation CAME a commencé à se réunir à Londres, du 16 novembre 1942 au 5 décembre 1945. Le 30 octobre 1943, la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’URSS ont exprimé la nécessité d'une organisation internationale dans la Déclaration de Moscou. Cela a été suivi par les propositions du 9 octobre 1944 lors de la Conférence de Dumbarton Oaks. À partir de la proposition de la CAME et conformément aux recommandations de la Conférence de San-Francisco, tenu entre avril-juin 1945, la Conférence des Nations unies pour l'établissement d'une organisation éducative et culturelle ECO/CONF a été convoquée à Londres du 1er au 16 novembre 1945. Elle a rassemblé les représentants de 44 états. Pendant l'ECO/CONF, l'Acte constitutif de l'Unesco a été introduit et signé par 37 états, et une Commission préparatoire a été également établie. La Commission préparatoire a effectué son travail du 16 novembre 1945 au 4 novembre 1945 - jour où l'Acte constitutif entra en vigueur avec le dépôt de la vingtième ratification d'un état membre.
Tenue entre le 19 novembre et le 10 décembre 1946, la première Conférence générale a élu le docteur Julian Huxley au poste de Directeur général de l'Organisation. En novembre 1954, la Conférence générale a amendé l'Acte constitutif de l'Organisation en décidant que les membres du Conseil devraient désormais représenter des gouvernements de leur état. Ce changement de gouvernance a distingué l'Unesco de son précurseur, la CICI compte tenu de la collaboration des États dans les domaines de compétence de l’Unesco. À mesure que les États membres coopéraient pour réaliser le mandat de l'Unesco, des évènements historique et politique ont influencé les activités de l'Organisation, notamment lors les périodes de la guerre froide, de la décolonisation, et de la dissolution de l’URSS.
Parmi les réalisations notables de l'Organisation, on peut citer son travail de lutte contre le racisme. Ainsi, les déclarations autour de la question raciale, notamment celle des anthropologues datant de 1950, parmi lesquels figure Claude Lévi-Strauss et la Déclaration sur la race et les préjugés raciaux de 1978. Estimant quelques publications de l'Unesco comme une ingérence dans les problèmes raciaux du pays, la République d'Afrique du Sud a quitté l'Organisation en 1956, avant de revenir, sous la direction de Nelson Mandela, en 1994.
Le projet de l'éducation de base dans la vallée de Marbial en Haïti est un exemple du travail que l'Unesco mène à ses débuts dans le secteur de l'éducation. Amorcé en 1947, ce projet a été suivi par les missions d'experts dans d'autres pays, comme l'Afghanistan en 1949. En 1948, l'Unesco a proposé aux États membres d'instituer un enseignement primaire obligatoire, gratuit et universel. En 1990, la Conférence mondiale sur l'éducation pour tous, à Jomtien en Thaïlande, a lancé un mouvement global afin de fournir une éducation de base pour tous, enfants, jeunes et adultes. Dix ans plus tard, lors du Forum mondial sur l'éducation à Dakar, les gouvernements se fixent jusqu'à 2015 pour s'engager à l'éducation de base pour tous.
Dans le domaine de la culture, l'Unesco à ses débuts a lancé la Campagne de Nubie en 1960. Le but de cette Campagne était de déplacer le Temple Abou Simbel pour le sauver des eaux montantes du Nil après la construction du barrage d'Aswan. Pendant cette Campagne de 20 ans, 22 monuments et complexes architecturaux ont été déplacés. Elle était la première campagne, et la plus importante, d’une longue série, parmi lesquelles celles de Moenjodaro Pakistan, Fès Maroc, Katmandou Népal, Borobudur Indonésie et l’Acropole d’Athènes Grèce. Le travail de l'Unesco dans le domaine du patrimoine a abouti à l'adoption en 1972 de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. Le Comité du patrimoine mondial est créé en 1976 et les premiers sites sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 1978. Depuis lors, quelque instruments juridiques internationaux ont été adoptés par les États membres de l'Unesco en 2003 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, et en 200, Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
En décembre 1951, une réunion intergouvernementale qui s'est tenue à l'Unesco, a mené à la création du Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire CERN. Le CERN a notamment permis la création en 1989 du World Wide Web.
Dans le domaine des sciences naturelles, l'Unesco a initié très tôt un projet majeur concernant la zone aride. En 1968, l'Unesco organisa la première conférence intergouvernementale visant à la réconciliation de l'environnement et du développement, questions toujours d'actualité dans le domaine du développement durable. Le principal résultat de la conférence a été la création du Programme sur l'homme et la biosphère.
Dans le domaine de la communication, la libre circulation de l'information reste une priorité de l'Unesco depuis ses débuts. Lors de l’immédiat après-guerre, les activités de l'Unesco ont été concentrées sur la reconstitution et les besoins des moyens de communication de masse partout dans le monde. L'Unesco a commencé à organiser la formation et l'éducation pour les journalistes à partir des années 1950. Afin de répondre aux exigences d'un Nouvel ordre mondial de l’information et de la communication à la fin des années 1970, Unesco a établi la Commission internationale d'étude des problèmes de la communication qui a abouti au rapport MacBride, du nom du Président de la Commission et lauréat du Prix Nobel de la paix Seán MacBride. Après ce rapport, l’Unesco a introduit les programmes La Société de l'information pour tous et Vers les sociétés du savoi, en anticipant les questions des Sommets mondiaux sur la société de l'information, Genève, 2003 et Tunis, 2005.
En 2011, la Palestine est devenue un membre de l’Unesco faisant suite au vote avec 107 États Membres pour et 14 contre. Des lois passées aux États-Unis en 1990 et 1994 stipulent qu'ils ne peuvent contribuer financièrement à des organisations des Nations-Unies qui reconnaissent la Palestine comme État membre. En conséquence, il retire son financement, qui représente environ 22 % du budget de l'Unesco. Israël a également réagi à l'admission de la Palestine à l'Unesco par le gel des paiements d'Israël à l'Unesco et en imposant des sanctions à l'Autorité palestinienne, affirmant que l'admission de la Palestine pourrait être préjudiciable "aux pourparlers potentiels de paix ". Le budget est donc passé de 653 à 507 millions de dollars américains.
Sièges
1946-1958 : hôtel Majestic 16e arrondissement de Paris.
Depuis 1958 : maison de l'Unesco 7e arrondissement de Paris.
États fondateurs
L'Unesco a été fondé par vingt-et-un États, signataires de l'Acte constitutif en 1946 :
Afrique du Sud
Arabie saoudite
Australie
Brésil
Canada
Chine
Danemark
Égypte
États-Unis
Arménie
France
Grèce
Inde
Liban
Mexique
Norvège
Nouvelle-Zélande
République dominicaine
Royaume-Uni
Tchécoslovaquie
Turquie
Crise d'identité et de vocation
Depuis l’élection de son directeur général en 1999, et surtout depuis le retour des États-Unis au sein de l’organisation en 2003, l'Unesco s’est engagée dans un plan sévère de réduction des dépenses, assorti d’une réforme de sa stratégie : furent ainsi décidés le non-renouvellement de nombreux postes subalternes, la suppression du magazine généraliste Le Courrier de l'Unesco, l’abandon des activités en faveur des logiciels open source, la réduction nette du budget général au profit de programmes désormais financés, et donc aussi pilotés ou gérés, par des États membres ou des entreprises commerciales, dont Microsoft et L'Oréal.
Pour tenir un budget en baisse depuis l'arrêt de la contribution américaine en 2011, quelque 300 personnes risquent de perdre leur emploi en 2013. L'agence onusienne employait en 2012 1 200 personnes au siège installé à Paris et 900 à travers le monde.
Liste des directeurs généraux
Julian Huxley, 1946–1948
Jaime Torres Bodet, 1948–1952
John Wilkinson Taylor, 1952–1953
Luther Evans, 1953–1958
Vittorino Veronese, 1958–1961
René Maheu, 1961–1974
Amadou-Mahtar M'Bow, 1974–1987
Federico Mayor Zaragoza, 1987–1999
Kōichirō Matsuura, 1999–2009
Irina Bokova, depuis le 15 novembre 2009
Composition
Au 23 novembre 2011, l’Unesco compte 195 États membres, ainsi que huit membres associés :
Membres :
Afghanistan (04/05/1948)
Afrique du Sud (12/12/1994)
Albanie (16/10/1958)
Algérie (15/10/1962)
Allemagne (11/07/1951)
Andorre (20/10/1993)
Angola (11/03/1977)
Antigua-et-Barbuda (15/07/1982)
Arabie saoudite (04/11/1946)
Argentine (15/09/1948)
Arménie (09/06/1992)
Australie (04/11/1946)
Autriche (13/08/1948)
Azerbaïdjan (03/06/1992)
Bahamas (23/04/1981)
Bahreïn (18/01/1972)
Bangladesh (27/10/1972)
Barbade (24/10/1968)
Belgique (29/11/1946)
Belize (10/05/1982)
Bénin (18/10/1960)
Bhoutan (13/04/1982)
Biélorussie (12/05/1954)
Birmanie (27/06/1949)
Bolivie (13/11/1946)
Bosnie-Herzégovine (02/06/1993)
Botswana (16/01/1980)
Brésil (04/11/1946)
Brunei (17/03/2005)
Bulgarie (17/05/1956)
Burkina Faso (14/11/1960)
Burundi (16/11/1962)
Cambodge (03/07/1951)
Cameroun (11/11/1960)
Canada (04/11/1946)
Cap-Vert (15/02/1978)
Chili (07/07/1953)
Chine (04/11/1946)
Chypre (06/02/1961)
Colombie (31/07/1947)
Comores (22/03/1977)
Corée du Nord (18/10/1974)
Corée du Sud (14/06/1950)
Costa Rica (19/05/1950)
Côte d'Ivoire (27/10/1960)
Croatie (01/06/1992)
Cuba (29/08/1947)
Danemark (04/11/1946)
Djibouti (31/08/1989)
Dominique (09/01/1979)
Égypte (04/11/1946)
Émirats arabes unis (20/04/1972)
Équateur (22/01/1947)
Érythrée (02/09/1993)
Espagne (30/01/1953)
Estonie (14/10/1991)
États-Unis (01/10/2003)
Éthiopie (01/07/1955)
Fidji (17/07/1983)
Finlande (10/10/1956)
France (04/11/1946)
Gabon (16/11/1960)
Gambie (01/08/1973)
Géorgie (07/10/1992)
Ghana (11/04/1958)
Grèce (04/11/1946)
Grenade (17/02/1975)
Guatemala (02/01/1950)
Guinée (02/02/1960)
Guinée équatoriale (29/11/1979)
Guinée-Bissau (01/11/1974)
Guyana (21/03/1967)
Haïti (18/11/1946)
Honduras (16/12/1947)
Hongrie (14/09/1948)
Îles Cook (25/10/1989)
Inde (04/11/1946)
Indonésie (27/05/1950)
Iran (06/09/1948)
Irak (21/10/1948)
Irlande (03/10/1961)
Islande (08/06/1964)
Israël (16/09/1949)
Italie (27/01/1948)
Jamaïque (07/11/1962)
Japon (02/07/1951)
Jordanie (14/06/1950)
Kazakhstan (22/05/1992)
Kenya (07/04/1964)
Kirghizistan (02/06/1992)
Kiribati (24/10/1989)
Koweït (18/11/1960)
Laos (09/07/1951)
Lesotho (29/09/1967)
Lettonie (14/10/1991)
Liban (04/11/1946)
Liberia (06/03/1947)
Libye (27/06/1953)
Lituanie (07/10/1991)
Luxembourg (27/10/1947)
Macédoine (28/06/1993)
Madagascar (10/11/1960)
Malaisie (16/06/1958)
Malawi (27/10/1964)
Maldives (18/07/1980)
Mali (07/11/1960)
Malte (10/02/1965)
Maroc (07/11/1956)
Îles Marshall (30/06/1995)
Maurice (25/10/1968)
Mauritanie (10/01/1962)
Mexique (04/11/1946)
Micronésie (19/10/1999)
Moldavie (27/05/1992)
Monaco (06/07/1949)
Mongolie (01/11/1962)
Monténégro (01/03/2007)
Mozambique (11/10/1976)
Namibie (02/11/1978)
Nauru (17/10/1996)
Népal (01/05/1953)
Nicaragua (22/02/1952)
Niger (10/11/1960)
Nigeria (14/11/1960)
Niue (26/10/1993)
Norvège (04/11/1946)
Nouvelle-Zélande (04/11/1946)
Oman (10/02/1972)
Ouganda (09/11/1962)
Ouzbékistan (26/10/1993)
Pakistan (14/09/1949)
Palaos (20/09/1999)
Palestine (23/11/2011)
Panama (10/01/1950)
Papouasie-Nouvelle-Guinée (04/10/1976)
Paraguay (20/06/1955)
Pays-Bas (01/01/1947)
Pérou (21/11/1946)
Philippines (21/11/1946)
Pologne 06/11/1946)
Portugal (11/09/1974)
Qatar (27/01/1972)
République centrafricaine (11/11/1960)
République démocratique du Congo (25/11/1960)
République du Congo (24/10/1960)
République dominicaine (04/11/1946)
République tchèque (22/02/1993)
Roumanie (27/07/1956)
Royaume-Uni (01/07/1997)
Russie (21/04/1954)
Rwanda (07/11/1962)
Saint-Christophe-et-Niévès (26/10/1983)
Sainte-Lucie (06/03/1980)
Saint-Marin (12/11/1974)
Saint-Vincent-et-les Grenadines (14/01/1983)
Salomon (07/09/1993)
Salvador (28/04/1948)
Samoa (03/04/1981)
Sao Tomé-et-Principe (22/01/1980)
Sénégal (10/11/1960)
Serbie (20/12/2000)
Seychelles (18/10/1976)
Sierra Leone (28/03/1962)
Singapour (08/10/2007)
Slovaquie (09/02/1993)
Slovénie (27/05/1992)
Somalie (15/11/1960)
Soudan (26/11/1956)
Soudan du Sud (27/10/2011)
Sri Lanka (14/11/1949)
Suède (23/01/1950)
Suisse (28/01/1949)
Suriname (16/07/1976)
Swaziland 25/01/1978)
Syrie (16/11/1946)
Tadjikistan 06/04/1993)
Tanzanie (06/03/1962)
Tchad (19/12/1960)
Thaïlande (01/01/1949)
Timor oriental (05/06/2003)
Togo (17/11/1960)
Tonga (29/09/1980)
Trinité-et-Tobago (02/11/1962)
Tunisie (08/11/1956)
Turkménistan (17/08/1993)
Turquie (04/11/1946)
Tuvalu (21/10/1991)
Ukraine (05/12/1954)
Uruguay (08/11/1947)
Vanuatu (10/02/1994)
Venezuela (25/11/1946)
Viêt Nam (06/07/1951)
Yémen (02/04/1962)
Zambie (09/11/1964)
Zimbabwe (22/09/1980)
Membres associés :
Aruba
Îles Caïmans
Curaçao
Îles Féroé
Îles Vierges britanniques
Macao
Saint-Martin
Tokelau
Le Saint-Siège possède un observateur permanent à la conférence générale et au Conseil exécutif en la personne de Mgr Francesco Follo.
Résultant du vote concernant l'adhésion de la Palestine à l'Unesco :
Pour
Contre
Abstention
Absent
Non-membres, ne pouvant voter
Le dernier membre à avoir rejoint l'organisation est la Palestine, acceptée au sein de l'Unesco en tant que membre titulaire le 23 novembre 2011. En réaction, les États-Unis décident de suspendre leur contribution financière, soit 1/5e du budget de l'organisation.
Fonctionnement
La Conférence générale, qui réunit les représentants de l’ensemble des États membres, siège tous les 2 ans les années impaires. Le directeur général est élu par la conférence générale pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois depuis 2005. Le Conseil exécutif siège au moins 2 fois par an dans l’intervalle des sessions de la Conférence générale. Ses membres sont au nombre de 58, et sont élus par la Conférence générale pour un mandat de 4 ans. Ses effectifs sont d’environ 2 400 fonctionnaires internationaux dont un millier d’administrateurs.
Siège à Paris
Enseigne de l'Unesco.
Le siège de l'Unesco à Paris, construit par les architectes Bernard Zehrfuss, Marcel Breuer et Pier Luigi Nervi, est représentatif du style architectural des années 1950. Il renferme des compositions murales de Picasso et de Miró en collaboration avec Artigas, Rufino Tamayo, Afro Basaldella et Roberto Matta ainsi qu’un stabile de Calder dans les jardins. Le jardin de la Paix d’Isamu Noguchi se visite lors de la journée parisienne portes ouvertes des jardins.
Le site possède des œuvres d’art d'artistes renommés, comme Bazaine, Giacometti ?, Le Corbusier, Henry Moore, Takis, ou Tsereteli. Il y a aussi des points remarquables comme l’ange de Nagasaki, l’Espace de méditation de Tadao Ando, le Square de la Tolérance de Dani Karavan et le Globe symbolique d’Erik Reitzel, Totes les coses de Tapies, Guinovart, La Liberté : la paix le jour d'après d'Abelardo Espejo Tramblin.
L'Unesco organise et parraine de nombreuses manifestations culturelles et scientifiques. En 1998, le Palais de l'Unesco à Paris a ainsi accueilli le 24e Congrès international des sciences administratives organisé par l'Institut français des sciences administratives sur le thème Le citoyen et l'administration.
Élections
Les élections 2009 pour le poste de directeur général ont eu lieu à Paris du 7 au 23 septembre. Huit candidats étaient en lice pour recueillir les votes de 58 pays votants.
L'élection peut comporter jusqu'à cinq tours, selon que les candidats parviennent, ou non, à obtenir une majorité rapidement.
L'élection 2009 est particulièrement controversée en raison des diatribes antisémites du candidat favori, le ministre égyptien de la Culture Farouk Hosni. En 2001, il avait déclaré que la culture israélienne était inhumaine et raciste, puis dénoncé l'infiltration des juifs dans les médias internationaux. En 2008, il avait répondu à un député islamiste au Parlement vouloir brûler les livres en hébreu dans les bibliothèques d'Égypte, s'il en trouvait. Des intellectuels, dont le prix Nobel de la paix et survivant d'Auschwitz Elie Wiesel, avaient alors condamné une candidature dangereuse, termes repris depuis par de nombreux journaux, comme le New York Times, la BBC et France. L'élection 2009 a finalement été remportée par la Bulgare Irina Bokova, par 31 voix contre 27 à Farouk Hosni. Élection confirmée le 15 octobre suivant par le vote de la Conférence générale.
ONG officielles de l’Unesco
L’Unesco entretient des relations avec 319 Organisations non gouvernementales ONG internationales. La plupart sont opérationnelles et une partie d’entre elles sont formelles.
Les relations opérationnelles sont réservées aux ONG très actives dans leur domaine, capables de mener des expertises et de canaliser les intérêts de leurs clients. Les demandes d’admission à l’Unesco pour des relations opérationnelles peuvent être adressées à tout moment au Directeur Général.
Les relations formelles sont réservées aux ONG qui exercent un rôle soutenu de coopération en direction, et à partir de l’Unesco. L’admission pour une reconnaissance formelle n’est accordée qu’aux ONG internationales représentatives et qui agissent en tant qu’experts et représentent le plus largement leur domaine d’activité, grâce à une structure internationale étendue. Les relations formelles sont elles-mêmes sous-divisées en deux groupes, consultatif ou associatif, selon le rôle et la structure de l’ONG. Les instances du bureau exécutif de l’Unesco décident de l’admission à l’un ou l’autre groupe sur la base des recommandations du Directeur Général. Ces relations formelles sont établies pour des périodes de six ans renouvelables.
La forme d’affiliation la plus étroite à l’Unesco est l’ association formelle et dix ONG entrant dans cette catégorie ont leur bureau au siège même de l’Unesco55. Ce sont :
l'Association internationale des universités AIU ;
le Conseil international du cinéma, de la télévision et de la communication audiovisuelle CICT;
le Conseil international des musées ICOM ;
le Conseil international de la musique IMC ;
le Conseil international de la philosophie et des sciences humaines CIPSH ;
le Conseil international des sciences sociales (ISSC)60 ;
la Fédération mondiale des associations, centres et clubs Unesco WFUCA ;
l'Institut international du théâtre ITI ;
le Conseil international des sciences de l'ingénieur et de la technologie ICET ;
le Comité de coordination du service volontaire international CCSVI.
L'ONU
sigle de Organisation des Nations unies
Cet article fait partie du dossier consacré à la guerre froide.
Organisation internationale constituée par les États qui ont accepté de remplir les obligations prévues par la Charte des Nations unies en vue de sauvegarder la paix et la sécurité mondiales et d'instituer entre les nations une coopération économique, sociale et culturelle.
La création de l'ONU
L'organisation des Nations unies ONU est née officiellement le 24 octobre 1945, date officielle d'entrée en vigueur de la Charte des Nations unies, signée le 25 avril de la même année, à San Francisco, par la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et 45 autres pays. À ces membres originaires s'ajoutait la Pologne, qui, absente à la conférence, signa le texte peu après. L'idée maîtresse qui présida à la création de l'Organisation des Nations unies était la préservation de la paix. Les nations fondatrices étaient alors engagées solidairement dans la lutte contre les forces de l'Axe Allemagne, Italie et Japon.
Pour en savoir plus, voir l'article Charte des Nations unies.
Avant l'ONU, la SDN
Une autre institution intergouvernementale ayant les mêmes buts existait avant l'ONU : la Société des nations SDN, créée en 1919 par le traité de Versailles, et qui avait pour mission, après la Première Guerre mondiale, d'asseoir définitivement la paix entre les nations et de fournir des garanties réciproques d'indépendance politique et territoriale aux États, petits ou grands. Mais la SDN ne parvint à rassembler que les démocraties européennes et se limita rapidement à une simple association de ces dernières. Les États-Unis n'en firent jamais partie, en raison du refus du Sénat de ratifier le traité. L'entrée décisive, en 1933, de l'Union soviétique – qui fut exclue en 1939 après qu'elle eut attaqué la Finlande, campagnes de Finlande – coïncida avec le départ du Japon et de l'Allemagne.
La SDN, dont on ne retient le plus souvent que la faiblesse ou l'inefficacité, réussit pourtant à introduire au sein de la communauté internationale l'idée d'une grande organisation intergouvernementale à vocation mondiale et à caractère égalitaire ; cette idée prit définitivement corps pendant la Seconde Guerre mondiale.
Pour en savoir plus, voir les articles Seconde Guerre mondiale, Société des nations SDN.
Les étapes de la création de l"ONU
– 12 juin 1941 : Franklin Roosevelt et Winston Churchill, réunis à Londres au Saint James Palace, font la première déclaration interalliée, réclamant que fût fondée une organisation pour assurer la paix partout dans le monde.
– 14 août 1941 : Roosevelt et Churchill se retrouvent en tête à tête, avant de faire une déclaration connue sous le nom de charte de l'Atlantique, dans laquelle ils s'engagent à appliquer des principes communs dans les politiques nationales des pays où leurs pays respectifs jouissent d'une influence : c'est le prélude à la décolonisation. Intégrée à la conférence de Washington de 1942, la charte de l'Atlantique devient ipso facto le programme de paix des Nations unies.
– 1er janvier 1942 : Roosevelt utilise pour la première fois l'expression nations unies. Ce jour-là, ces nations unies au nombre de 26 s'engagent à poursuivre la lutte contre les forces de l'Axe, ensemble, jusqu'à leur défaite.
– 20 octobre 1943 : alors que la guerre est à son paroxysme, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine affirment, dans leur Déclaration des quatre nations clôturant la conférence de Moscou, la nécessité d'établir, aussi tôt que possible, une organisation internationale fondée sur le principe de l'égalité souveraine entre tous les États pacifiques.
– 28 novembre-1erdécembre 1943 : dans une déclaration signée à Moscou le 30 octobre 1943, l'URSS, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine préconisent la création d'une organisation internationale chargée du maintien de la paix et de la sécurité. Cet objectif est réaffirmé à la conférence de Téhéran, le 1er décembre 1943.
– 21 août-7 octobre 1944 : réunis à Dumbarton Oaks, près de Washington, les délégués de l'URSS, du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Chine s'entendent pour établir la paix et la sécurité internationales. Cette conférence élabore le plan de l'Organisation des Nations unies et fixe les dispositions qui devaient assurer, du point de vue économique et social, les libertés essentielles de l'être humain.
– 4-11 février 1945 : conférence de Yalta. Roosevelt, Staline et Churchill achèvent l'examen de ce projet et décident de convoquer une conférence internationale en vue de la création de l'Organisation.
– 25 avril-26 juin 1945 : conférence de San Francisco. La conférence des Nations unies sur l'organisation internationale convoquée par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'URSS et la Chine, regroupe 50 États. Elle adopte un traité multilatéral signé le 26 juin 1945 : la Charte de l'Organisation des Nations unies. La Pologne, non représentée à la conférence, signera la Charte plus tard, mais est néanmoins devenue l'un des 51 membres originels.
• Winston Churchill
• conférence de San Francisco
• conférence de Téhéran
• conférence de Yalta
• Franklin Roosevelt
• plan de Dumbarton Oaks
• Joseph Staline
– 24 octobre 1945 : l'entrée en vigueur de la Charte de l'ONU, ratifiée par la Chine, les États-Unis , la France, le Royaume-Uni, l'URSS et la majorité des autres pays signataires, marque l'existence officielle de l'Organisation des Nations unies.
États membres de l'Organisation des Nations Unies
La Charte de l'ONU
La Charte est l'instrument constitutif de l'Organisation des Nations unies. Elle fixe les droits et les obligations des États membres et établit les organes et les procédures.
Elle comprend 111 articles regroupés en 19 chapitres auxquels se rajoute le statut de la Cour internationale de justice (CIJ).
Le principe de base qui y est affirmé est l'égalité souveraine de tous les membres. Néanmoins, un droit de veto est reconnu de fait à chacun des cinq membres du Conseil de sécurité.
Les buts et les principes de l'ONU, définis dans les premiers chapitres, sont les suivants :
– le maintien de la paix et de la sécurité internationale ;
– le développement des relations amicales entre les nations ;
– la coopération internationale et le développement des droits fondamentaux de l'homme.
À cet égard, la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale réunie à Paris le 10 décembre 1948, demeure le texte de référence. L'attachement aux libertés fondamentales, aussi bien de l'homme respect universel et effectif des droits de l'homme, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion que des peuples égalité des droits et droit à disposer d'eux-mêmes, est explicitement proclamé.
Pour en savoir plus, voir les articles Charte des Nations unies, Déclaration universelle des droits de l'homme.
Siège de l'ONU
Créée par la Charte des Nations unies en 1945, l'Assemblée générale est le principal organe délibérant, directeur et représentatif de l'ONU.
Elle est composée des représentants de tous les États membres, chacun d'entre eux disposant d'une voix. Diverses questions y sont débattues. Pour celles afférentes aux sujets de première importance – sécurité internationale, admission d'un État, budget – les décisions sont prises à la majorité des deux tiers. Sur les autres sujets, la majorité simple suffit.
L'Assemblée tient chaque année une session ordinaire de septembre à décembre. Elle peut se réunir en session extraordinaire, convoquée par le Conseil de sécurité, par la majorité des États membres, ou par un seul État appuyé par une majorité des autres.
Les décisions votées par l'Assemblée ne constituent aucune obligation juridique pour les gouvernements nationaux. Toutefois, l'interdépendance croissante des États et des continents, la médiatisation des événements de toute nature donnent aux résolutions adoptées un poids moral qui n'échappe pas à l'opinion publique mondiale. De plus, l'œuvre entreprise durant l'année par l'Organisation découle, en grande partie, des décisions prises par l'Assemblée générale.
Le Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité, à la fois organe exécutif et organe d'initiative, assume la responsabilité principale du maintien de la paix. Il est appelé à œuvrer « par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux. Une singularité le distingue des autres institutions, puisqu'il est le seul organe à prendre des décisions que les membres de l'Organisation sont tenus d'appliquer.
Quinze membres siègent au Conseil de sécurité, dont cinq membres permanents : il s'agit de la Chine, des États-Unis, de la Fédération de Russie qui a succédé à l'Union soviétique, de la France et du Royaume-Uni. Les dix autres membres sont élus tous les deux ans par l'Assemblée générale, qui les choisit en fonction d'une répartition géographique et d'un dosage politique.
La nécessité d'un élargissement du nombre de membres permanents pour une meilleure représentativité au Conseil de sécurité fait l'objet, depuis les années 1990, de longues et difficiles négociations.
Pour en savoir plus, voir l'article Conseil de sécurité.
Le Conseil économique et social
Composé de 54 membres élus pour trois ans par l'Assemblée générale selon un critère de répartition géographique et disposant chacun d'une voix, le Conseil économique et social est l'instance où sont examinées les questions économiques et sociales internationales, et où sont réalisées les études et les rapports sur ces questions. Il convoque les conférences internationales sur les sujets de sa compétence. Il consulte 900 organisations non gouvernementales ONG, qui travaillent sur le terrain. Le Conseil s'emploie à faire respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il agit par recommandations, les décisions sont prises à la majorité simple.
Le Conseil de tutelle
Le Conseil de tutelle se compose de représentants de 7 États membres et des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Il a pour tâche de surveiller l'administration des territoires placés sous le régime de la tutelle (chapitre XIII, articles 86 et suivants de la Charte de l'ONU. Ce régime a pour but de confier l'administration de territoires non autonomes à une autorité chargée de tutelle, et de faire en sorte que les gouvernements chargés de cette administration prennent les mesures qui conviennent pour préparer ces territoires à la réalisation des objectifs énoncés dans la Charte.
Au cours des premières années d'existence de l'ONU, 11 territoires furent placés sous régime de tutelle. Ces territoires ont tous aujourd'hui accédé à l'indépendance ou se sont volontairement unis à un État pour constituer un pays indépendant. En 1994, le Conseil de sécurité a mis un terme à l'accord de tutelle régissant le dernier territoire – celui des îles du Pacifique (Palau), administré par les États-Unis – après que la population de ce territoire se fut prononcée pour son autonomie. Palau devint indépendant en 1994 et adhéra à l'ONU en tant que 185e État membre. Avec l'indépendance de Palau, dernier territoire sous tutelle des Nations unies, le régime de tutelle avait ainsi achevé sa mission historique, et le Conseil décida officiellement de suspendre ses activités à partir du 1er novembre 1994. Il demeure toutefois un organe de l'ONU à part entière.
La Cour internationale de justice CIJ
Créée en 1945, la Cour internationale de justice est l'organe juridictionnel des Nations unies. Elle applique, conformément à l'article 38 de son statut, partie intégrante de la Charte des Nations unies, les conventions internationales qui établissent les règles reconnues par les États nationaux en litige, mais aussi la coutume internationale acceptée comme le droit et les principes généraux de droit reconnus par les nations. Chaque membre de l'ONU est partie au statut de la Cour. Siégeant à La Haye, la Cour se compose de 15 magistrats élus indépendamment par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, pour une durée de 9 ans. La Cour siège en séance plénière, mais peut constituer des organes plus restreints, appelés chambres, à la demande des parties. Les délibérations sont secrètes et les arrêts sont pris à la majorité des juges présents.
Pour en savoir plus, voir l'article Cour internationale de justice CIJ.
Le Secrétariat des Nations unies
Environ 7 500 personnes, appartenant à 170 pays, composent le Secrétariat, dont le siège est à New York. Ces fonctionnaires internationaux sont en principe indépendants de leur pays d'origine : au terme de l'article 100 de la Charte, les États membres s'engagent à reconnaître le caractère exclusivement international de l'activité du secrétaire général et du personnel du Secrétariat et à ne pas chercher à les influencer. Ces fonctionnaires sont choisis en fonction de leur compétence et selon un subtil dosage géographique. Ils sont nommés par le secrétaire général.
Considéré comme la machine administrative de l'ONU, le Secrétariat se voue à des tâches multiples, touchant à l'administration des opérations du maintien de la paix, à la traduction de documents dans les langues officielles, à l'analyse des problèmes économiques et sociaux, enfin, à l'organisation des conférences internationales.
Le secrétaire général
Il est nommé par l'Assemblée, sur recommandation du Conseil de sécurité. La Charte ne précise pas la durée de ses fonctions, mais elle est habituellement de cinq ans. Le secrétaire général est rééligible. Décrit par la Charte comme « le plus haut fonctionnaire de l'Organisation », il en est de fait l'emblème. Il a pour mission d'attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, selon lui, pourrait mettre en danger la paix et la sécurité partout dans le monde. Mais la Charte lui demande également de remplir « toute autre fonction » dont il serait chargé par le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale et les organes principaux de l'ONU.
Dans les faits, il est le porte-parole de la communauté internationale, tout en étant au service des États membres. Il propose ses bons offices dans l'intérêt général, donc, par définition, en toute impartialité. Pour cela, il est amené tout naturellement à rencontrer les chefs d'État et dirigeants mondiaux. Chaque secrétaire général a défini sa mission dans le contexte des événements mondiaux de l'époque. Il est notable qu'aucun d'entre eux n'ait appartenu à une grande puissance. C'est que le choix du titulaire doit véritablement reposer sur un consensus. D'une part, une entente entre les deux organes souverains s'impose, car le secrétaire général étant nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité, il doit recueillir non seulement l'aval des grandes puissances mais aussi l'assentiment des pays du Sud.
Le plus haut fonctionnaire de l'Organisation ne s'est pas cantonné à la place que lui avaient assignée les fondateurs de l'ONU. Il a été amené à jouer un rôle de plus en plus important dans la politique internationale, en multipliant missions de bons offices et initiatives diversement appréciées par exemple pour empêcher in extremis, en 1998, une nouvelle intervention armée, souhaitée par les États-Unis, contre l'Iraq.
Les secrétaires généraux de l'ONU
– Trygve Lie 1946-1952 : ce Norvégien a accompli son mandat durant la guerre de Corée, à l'occasion de laquelle les soldats furent dépêchés pour s'interposer entre les belligérants. L'hostilité de l'URSS envers lui était telle qu'il décida de démissionner un an avant l'expiration de son mandat.
– Dag Hammarskjöld 1953-1961 : le mandat de ce Suédois s'est déroulé dans le contexte de la crise de Suez et de celle du Congo. Il est mort en Afrique, à la suite d'un accident d'avion aux causes non élucidées. Il a obtenu le prix Nobel de la paix à titre posthume.
– Sithu U Thant 1961-1971 : représentant permanent auprès de l'ONU, ce diplomate birman a été le premier secrétaire général issu d'un pays du tiers-monde. Du fait du décès de son prédécesseur, il a occupé le poste par intérim, avant d'être élu. Son mandat s'est déroulé alors que la guerre du Viêt Nam s'intensifiait. Ses incessants efforts pour que s'ouvrent des négociations ne furent guère récompensés.
– Kurt Waldheim 1972-1981 : cet Autrichien a effectué deux mandats pleins. Désireux de se présenter pour un troisième, il dut retirer sa candidature. L'opinion publique, en effet, s'était penchée – fort tardivement – sur son attitude durant la Seconde Guerre mondiale, à laquelle il participa comme officier de l'armée allemande, et avait estimé que son passé ne pouvait s'accorder avec des fonctions conférant une haute autorité morale.
– Javier Pérez de Cuéllar 1982-1991 : représentant permanent auprès de l'ONU, ce diplomate péruvien a accompli deux mandats successifs, alors que s'écroulait le mur de Berlin, annonciateur de la fin de la guerre froide. Javier Pérez de Cuéllar était encore en poste lors de la guerre du Golfe.
Cinquantième anniversaire de l'ONU
– Boutros Boutros-Ghali 1992-1996 : Ce diplomate égyptien a accompli son mandat alors que sévissaient des crises majeures : Somalie, Rwanda, ex-Yougoslavie. Énergique et autoritaire, il a voulu s'atteler à réformer l'Organisation. Les États-Unis n'ont guère apprécié ses prises de position et se sont opposés à ce qu'il se présente pour un second mandat. La France le soutint d'abord, à la satisfaction de nombre d'États arabes et africains, mais, quand un successeur africain sachant s'exprimer en français fut pressenti, elle renonça à maintenir le candidat sortant jusqu'au bout. Boutros-Ghali a été nommé secrétaire général à la francophonie peu après.
Accord sur l'inspection des installations militaires iraquiennes par l'ONU, 1998
– Kofi Annan 1997-2006 : la carrière de ce diplomate ghanéen s'est déroulée essentiellement à l'ONU. S'étant donné comme tâche prioritaire de rénover les Nations unies, il cherche, par ailleurs, à maintenir l'engagement de la communauté internationale en faveur de l'Afrique, le plus désavantagé des continents, et doit gérer maintes situations politiques essentielles telles que la réintégration de l'Iraq dans le concert international ou le conflit israélo-palestinien. Réélu à l'unanimité pour un second mandat, K. Annan se voit décerner, conjointement à l'Organisation, le prix Nobel de la paix en septembre 2001.
Ban Ki-moon
– Ban Ki-moon depuis 2007 : diplomate sud-coréen, il intègre les Nations unies dès 1975 et défend inlassablement la vision d'une péninsule coréenne pacifique.
EN SAVOIR PLUS
• Kofi Annan
• Ban Ki-moon
• Boutros Boutros-Ghali
• Dag Hammarskjöld
• Javier Pérez de Cuéllar
• Trygve Lie
• Sithu U Thant
• Kurt Waldheim
Les moyens de l'Organisation Les moyens financiers
Le budget ordinaire de l'ONU tourne autour de 3 milliards d'euros. Les États membres sont soumis au paiement de leur contribution en fonction de leur capacité financière. Les plus riches, tels les États-Unis, contribuent à hauteur de 22 % de ce budget, le Japon 12,5 %, l'Allemagne 8,01 %, le Royaume-Uni 6,6 %, la France 6,1 %, l'Italie 4,9 %, alors que le Burkina, la Bolivie ou le Cambodge ne doivent couvrir chacun que 0,01 % de ce budget.
Les États membres sont également appelés à financer les opérations de maintien de la paix. De plus, toutes sortes d'activités de l'ONU sont assurées par des contributions volontaires, en dehors du budget ordinaire, tels que les programmes du Programme des Nations unies pour le développement PNUD, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés HCR, du Programme alimentaire mondial PAM.
Les moyens juridiques
L'article premier de la Charte ne laisse planer aucun doute sur la mission des Nations unies, appelées à régler les différends internationaux par des moyens pacifiques, conformément au principe de la justice et du droit international. Hormis le Conseil de sécurité, qui élabore des recommandations, mais qui prend aussi des décisions. l'Assemblée générale, elles ne constituent pas un moyen d'action. Tout au plus servent-elles de bases aux recommandations et autres décisions. La Charte ignore le mot sanction . Mais les articles 5 et 6 prévoient la suspension et l'exclusion d'un État membre, la suspension du droit de vote à l'Assemblée générale article 19 ou encore article 41 la rupture, ou la réduction, des relations diplomatiques, économiques, sportives et culturelles avec l'État membre incriminé.
Les moyens humains
Aux fonctionnaires rattachés aux sièges de New York, de Genève et de Vienne s'ajoute le personnel des institutions et programmes rattachés environ 50 000 personnes. Les délégués des pays ne sont pas comptabilisés, car ils travaillent pour leurs gouvernements respectifs.
L'ONU utilise aussi du personnel pour les opérations de maintien de la paix : ce sont des soldats appartenant aux contingents militaires des pays membres – l'Organisation n'a pas d'armée propre –, auxquels se joignent aussi des civils. Ces volontaires civils, selon leur appellation officielle, sont des professionnels qualifiés et expérimentés, spécialistes dans quelque 115 domaines. Ils participent aux opérations humanitaires et aux programmes de développement. On en dénombre 4 000 environ qui travaillent dans 130 pays.
Les programmes d'action Le maintien de la paix
L'objectif majeur de l'ONU est de maintenir partout la paix et la sécurité. Depuis sa fondation, elle a été souvent sollicitée pour empêcher qu'une situation dangereuse ne dégénère en conflit armé. Les méthodes et les moyens utilisés à cette fin varient. Force militaire et diplomatie peuvent être utilisées alternativement ou simultanément.
Des Casques bleus sur le terrain
Si la Charte prévoit que les États membres doivent régler leurs différends par la voie pacifique, elle stipule aussi que c'est au Conseil de sécurité qu'incombe la responsabilité de la paix et de la sécurité dans le monde. Ce dernier met donc en place un dispositif de maintien de la paix que dirige le secrétaire général. Ces opérations revêtent diverses formes. La plus spectaculaire consiste en l'envoi des fameux Casques bleus, soldats de la paix issus des contingents des pays membres. Les Casques bleus agissent dans le cadre d'un mandat qu'ils se doivent de respecter scrupuleusement. Ces forces militaires ont obtenu en 1988 le prix Nobel de la paix.
Le dispositif de maintien de la paix consiste aussi à envoyer des missions d'observation militaire composées d'officiers non armés. Dans tous les cas, les forces onusiennes gardent le contact avec les deux parties, qui sont traitées sur un pied de stricte égalité.
Arrivée des Casques bleus à Pale, 1994
L'envoi de forces armées pose un problème politico-diplomatique majeur aux États du monde. L'expédition, sous mandat onusien, de forces coalisées pour forcer l'Iraq à évacuer le Koweït, qu'il avait envahi le 2 août 1990, l'a démontré, guerre du Golfe. Les coalisés, épaulant le gendarme américain, se muaient en bras armé de l'Amérique. De même, en juillet 1995, l'ONU a-t-elle confié à trois pays, États-Unis, Royaume-Uni et France, le soin d'opérer, mandatés par elle certes, mais sous leurs propres couleurs, les engagements militaires rendus nécessaires par la situation en Bosnie-Herzégovine. La FORPRONU s'était montrée incapable de les assumer.
L'assistance électorale
Dans le cadre des efforts onusiens pour garantir les conditions de paix, la surveillance des élections est une intervention qui a fait ses preuves. Inaugurée en 1989 en Namibie, cette mission s'est généralisée, au Nicaragua et en Haïti 1990, en Angola 1992, au Cambodge 1993, et ainsi chaque année en divers points du globe.
Plusieurs fois honorée, l'Organisation est pour la première fois en tant que telle lauréate du prix Nobel de la paix en septembre 2001.
La réglementation de l'armement et le désarmement
En 1959, la notion de désarmement général et complet fut mise à l'ordre du jour de l'Assemblée générale en tant que sujet distinct. Au début des années 1960, les États-Unis et l'URSS soumirent bien des plans à cet effet, mais on se rendit vite compte que l'objectif d'un désarmement complet s'éloignait chaque jour davantage. Depuis, une autre approche a vu le jour. Elle s'appuie sur des organes subsidiaires : le Département des affaires de désarmement créé en 1982, supprimé en 1992 et rétabli en 1998, et la Conférence du désarmement, autonome de l'Assemblée générale.
• arme nucléaire
• armes chimiques
• désarmement
• prolifération
• sécurité collective
En 1993 est conclue la Convention sur les armes chimiques. En matière nucléaire, plusieurs traités, allant de la non prolifération nucléaire à l'interdiction complète des essais nucléaires, ont vu le jour depuis 1963. Certains d'entre eux interdisent la mise en place d'armes nucléaires dans l'espace extra-atmosphérique (1967) ou sur le fonds des mers et des océans 1971.
Le développement économique et social
La philosophie onusienne privilégie les actions de développement économique, social et culturel, gage de stabilité. C'est là le second rôle majeur de l'Organisation. Consciente de leur importance, l'ONU entend faire progresser le consensus mondial en la matière. Elle agit au moyen de programmes et d'institutions spécialisées.
Les programmes
Avec les programmes et les stratégies de développement approuvés par l'Assemblée générale, l'ONU met en œuvre des projets globaux, mais aussi des actions ponctuelles concernant tous les domaines économiques et sociaux. Ces programmes revêtent diverses formes : coopération technique, enquêtes et études, organisations de conférences internationales, etc. En outre, certains de ces programmes sont liés à des catégories de populations spécifiques, tels les enfants, les femmes, les vieillards, les réfugiés, les migrants, les handicapés, et d'autres encore.
Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), constitue, pour les 177 pays où il est présent, la principale source de financement gratuit pour le développement humain.
Les institutions spécialisées
L'ONU s'est donnée des institutions spécialisées qui sont des organisations internationales disposant d'une autonomie budgétaire et d'une indépendance de fait. Elles sont rattachées au Conseil économique et social par accords latéraux approuvés par l'Assemblée générale article 63 de la Charte. L'article 57 en précise la création par accords intergouvernementaux, la définition de leurs compétences dans leur domaine spécifique, et leur rattachement à l'ONU. Ces institutions, sous leur appellation propre, ont en commun d'être dotées, classiquement, de trois organes : une Assemblée plénière ou Conférence, un organe exécutif restreint le Conseil, ou Conseil exécutif, voire Conseil d'administration, un Secrétariat ou Bureau international.
On distingue les organisations à vocation globale :
– l'Organisation internationale du travail OIT,
– l'Organisation mondiale de la santé OMS,
– l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO,
– l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture Unesco.
Parmi les organisations à vocation économique et financière figurent notamment le groupe de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international FMI.
Les organisations fonctionnelles à vocation technique regroupent par exemple :
– l'Union internationale des télécommunications UIT,
– l'Organisation maritime internationale OMI,
– l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI,
– l'Union postale universelle UPU
Les débats d'idées et les droits de l'homme Débats d'idées
Plusieurs fois par an, par le biais de ses institutions, programmes ou conférences, l'ONU mobilise l'opinion publique mondiale, sur des sujets variés et d'intérêt commun.
Ainsi la protection de l'environnement fut-elle à l'honneur à Rio de Janeiro en 1992. Le développement des micro-États insulaires Bridgeton, 1994, la prévention des catastrophes naturelles Yokohama, 1994, l'égalité des femmes 4e conférence mondiale sur ce thème à Pékin, en 1995 ou encore le racisme Durban, 2001 ont aussi capté l'attention mondiale.
Droits de l'homme
Le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale adopte la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations . Plus tard, deux pactes sont élaborés et entrent en vigueur en 1976 :
– le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui concerne le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la libre circulation, la présomption d'innocence, la liberté de pensée, de conscience et religieuse, etc.
– Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui concerne le droit de travailler dans des conditions justes et favorables, la protection sociale, le droit à l'éducation, etc.
En outre, il existait une Commission des droits de l'homme, principal organe chargé de la promotion des droits de l'homme du monde. Créée en 1946, avec pour objectif l'élaboration de normes relatives aux droits de l'homme, elle consacrait une grande part de son activité aux problèmes de leur mise en œuvre et se réunissait en session annuelle à Genève. Dans le cadre de la réforme de l'ONU, la Commission, discréditée par la présence dans ses rangs de régimes jugés répressifs, a été remplacée, en juin 2006, par le Conseil des droits de l'homme CDH, qui regroupe 47 pays membres, élus par l'Assemblée générale pour trois ans maximum.
Parmi les mécanismes créés par la Commission des droits de l’homme et repris par le Conseil des droits de l’homme figurent les rapporteurs spéciaux ou groupes de travail mandatés pour examiner la situation particulière d’un pays ou des thèmes spécifiques alimentation, logement, racisme, discrimination raciale, xénophobie, etc.. Lors de sa création, le CDH s'est doté d'un nouveau mécanisme, l'examen périodique universel EPU, qui contraint les 192 États membres de l'ONU à se soumettre tous les quatre ans à une évaluation par les autres États membres du respect des droits de l'homme.
Liens
http://youtu.be/rsKHpJXpAJE Histoire de l'unesco
http://youtu.be/A1R2Qlg-YJwLa France au patrimoine mondial
http://youtu.be/jd-WK4YYxhU?list=PLDFE920B7E333672DPatrimoine mondial
http://youtu.be/j5mUF1ZeApc Patrimoine de l'UNESCO 2
http://youtu.be/oWDHO4z9JXY Patrimoine mondial marin de l'Unesco
         [img width=600]http://fr.unesco.org/sites/default/files/styles/media_featured_327x200/public/headquarters_flags.jpg?itok=RSxli8Mp[/img] 
Posté le : 16/11/2014 21:04
Edité par Loriane sur 17-11-2014 13:48:41
Edité par Loriane sur 17-11-2014 13:49:42
Edité par Loriane sur 19-11-2014 20:17:52
|
|
|
|
|
Alain Colas |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 16 septembre 1943 naît Alain Colas
à Clamecy Nièvre, navigateur français disparu en mer, à l'âge de 35 ans sur le trimaran Manureva, le 16 novembre 1978 au large des Açores au Portugal lors de la première Route du Rhum. Il est le premier marin à réaliser un tour du monde à la voile en solitaire et en multicoque.
La jeunesse
Alain Colas naît à Clamecy dans la Nièvre, où son père, Roger Colas 1907-1993, dirige la faïencerie de la ville. Dès son enfance, il veut réaliser ses rêves. Écolier à Clamecy, il étudie en sixième au lycée Michelet de Vanves, puis au lycée Jacques Amyot d'Auxerre de la cinquième à la première. Il passe la classe de philosophie au lycée Paul Bert d'Auxerre, obtient le baccalauréat en 1961, et fréquente un an la faculté de lettres de Dijon. Il étudie ensuite l'anglais en Sorbonne. En juillet 1963, à dix-neuf ans, il crée le club de canoë-kayak de Clamecy.
Chargé de cours en Australie
En 1965, son père lui communique une annonce parue dans Le Monde, par laquelle l'université de Sydney recherche un lecturer, c'est-à-dire un chargé de cours, et non un lecteur comme Alain le croit. Il postule aussitôt et prépare son départ. Malgré une réponse négative, il s'embarque en janvier 1966 sur un cargo pour l'Australie. À la faculté des lettres de Sydney, ce jeune homme dynamique et persuasif est recruté ; il devient chargé de cours, à vingt-deux ans, au St John’s College, où il enseigne la littérature française.
En Australie, il découvre la voile et la course au large dans la baie de Sydney.
Équipier d'Éric Tabarly
En 1967, Alain Colas rencontre Éric Tabarly, qui dispute la course Sydney-Hobart. Ce dernier lui propose d’embarquer à son bord, sur Pen Duick III, pour un périple jusqu’en Nouvelle-Calédonie.
Pour Alain, l’appel du large est plus fort qu’un avenir universitaire tout tracé. En mai 1968, il rejoint à Lorient Éric Tabarly qui prépare, pour la transatlantique en solitaire de 1968, un multicoque expérimental géant : Pen Duick IV, conçu par l'architecte français André Allègre. Alain fait toute la saison de course 1968-1969 avec Tabarly. Il apprend le métier de marin de course au large et devient journaliste de ses aventures maritimes. En 1970, il rachète à Tabarly le trimaran Pen Duick IV, avec l'aide de sa famille. Pour payer les premières échéances, il raconte ses voyages dans la presse française et anglo-américaine et vend des photographies.
Afin de s'entraîner et de mieux connaître son bateau, il participe en franc-tireur à la course Sydney-Hobart. Puis il regagne Tahiti pour écrire des reportages sur la Polynésie et préparer Pen Duick IV à son retour en métropole. Il rencontre au début de 1971 une tahitienne, Teura Krause, qui devient sa compagne, et avec laquelle il aura trois enfants.
Les victoires
Le 17 juin 1972, sur Pen Duick IV, il prend le départ à Plymouth, en Angleterre, de la quatrième Transat anglaise, une course transatlantique en solitaire. Le 8 juillet 1972, il arrive vainqueur à Newport aux États-Unis, pulvérisant le record de l’épreuve en vingt jours, treize heures et quinze minutes. La France se découvre un héros sympathique au parcours original.
Son prochain objectif est de réaliser le premier tour du monde en solitaire en multicoque avec Pen Duick IV rebaptisé Manureva, l’oiseau du voyage en tahitien. À bord de ce bateau, légèrement modifié pour affronter les mers difficiles de l'hémisphère sud, Alain Colas part de Saint-Malo le 8 septembre 1973. Après une escale à Sydney, il franchit le cap Horn le 3 février 1974. Arrivé à Saint-Malo le 28 mars 1974, il bat de trente-deux jours le record du tour du monde en solitaire détenu par Sir Francis Chichester, en monocoque. Il est le premier marin à réussir ce pari.
Ce périple a été accompli en parallèle à la première édition de la Whitbread, une course autour du monde en équipage en monocoques. Il lui a été reproché de vouloir ainsi bénéficier de sa couverture médiatique, alors que son bateau n'entrait pas dans la même catégorie et disposait d'un potentiel de vitesse supérieur. Par ailleurs, cette course s'est avérée désastreuse pour Tabarly et son Pen Duick VI, contraint à l'abandon. Une polémique discutable avait lieu en même temps à propos du lest en uranium appauvri de ce bateau. Tout cela contribua à écorner l'image de Tabarly et à détourner l'intérêt du public au profit de Colas ; il faut sans doute voir dans ces circonstances la naissance d'une rancune tenace de Tabarly envers son ancien équipier, qui mit fin à l'amitié qui les liait.
Le quatre-mâts Club Méditerranée
Le monocoque quatre-mâts de course en solitaire avant-gardiste : Club Méditerranée de 1976.
En 1975, Alain Colas conçoit et met en œuvre la construction d’un quatre-mâts, voilier de soixante-douze mètres de long, à la pointe de la technologie, pour la Transat anglaise en solitaire de juin 1976. C’est le gigantesque Club Méditerranée.
Le 19 mai 1975, dans le port de La Trinité-sur-Mer, Alain Colas est victime d'un accident : sa cheville droite est sectionnée par le cordage d'une ancre de Manureva. Il subit vingt-deux opérations qui lui permettent de conserver son pied, et continue à superviser la réalisation du Club Méditerranée depuis son lit de l'hôpital de Nantes. Le 15 février 1976, le navire est lancé à l'arsenal du Mourillon à Toulon. Une équipe de volontaires réalise ensuite les équipements très sophistiqués du navire, qui fait sa première sortie en mer le 21 mars 1976.
Le 5 juin 1976, Alain Colas est au départ, sur le Club Méditerranée, de la cinquième Transat anglaise en solitaire, à Plymouth. Les jours suivants, cinq tempêtes se succèdent dans l'Atlantique nord, coulant plusieurs bateaux. Sur Club Méditerranée, elles provoquent la rupture des drisses, câbles tenant les voiles. Tabarly étant alors faussement localisé en tête, la course paraît jouée. Alain Colas décide d'une escale technique à Terre-Neuve, qui dure trente-six heures. Le 29 juin, il arrive second à Newport, sept heures et vingt-huit minutes après Éric Tabarly. Mais le comité de course le pénalise de 58 heures, le rétrogradant à la cinquième place, parce qu'il a été aidé par des équipiers à hisser ses voiles lors de son départ de Terre-Neuve. Les scellés de son moteur n'étaient plus en place, mais rien ne lui fut reproché sur ce point : Alain Colas avait dû s'en servir pour entrer à Terre-Neuve, comme la loi l'y obligeait ; lors de son départ, les douaniers refusèrent de plomber à nouveau le moteur.
Après la course, il représente la France sur Club Méditerranée, lors du défilé des navires organisé sur l'Hudson, pour le bicentenaire des États-Unis. Puis il regagne la France et organise, en août et en septembre 1976, l'opération Bienvenue à bord. Accostant son voilier géant dans les grands ports de la Manche et de l'Atlantique, il accueille gratuitement les visiteurs le matin ; l'après-midi, il propose des sorties en mer avec participation aux frais, suivies de projections et de conférences. Ces manifestations, qui rencontrent le succès, sont l'occasion de vendre les livres d'Alain Colas et les objets ornés de son logo. Au printemps et en été 1977, Bienvenue à bord se déroule dans les ports français de la Méditerranée.
Disparition
Le trimaran Manureva quelques jours avant le départ
En 1978, Alain Colas participe à sa dernière course : le 5 novembre 1978, il prend le départ de la première Route du Rhum à bord de Manureva.
Le 16 novembre 1978, alors qu'il a passé les Açores dans les îles Portugaises, il envoie son dernier message radio, dans lequel il signale qu'il fait bonne route. Il navigue alors parmi les premiers mais, dans la tempête qui se déchaîne peu après, Manureva disparaît corps et biens. Alain Colas avait trente-cinq ans.
Contrairement aux multicoques actuels qui sont insubmersibles et flottent donc entre deux eaux en cas d'accident sérieux structure nid d'abeille, composites, Manureva était construit en AGaluminium, plus lourd que l'eau, ce qui ne permit pas de retrouver le moindre élément du navire.
Alain Colas a su faire évoluer sa carrière grâce à son intelligence et son caractère entreprenant. Il s'est beaucoup appuyé sur les médias. Il a obtenu l'aide de mécènes pour financer ses courses et son quatre-mâts. Il a conçu le Club Méditerranée comme une vitrine de la technologie : le bateau utilisait les énergies éolienne, hydraulique et solaire, possédait un système de positionnement par satellite, un ordinateur, un fax.
Dans les années 1980, Bernard Tapie racheta Club Méditerranée à l'abandon, le fit rénover en le transformant et le rebaptisa Phocéa.
Hommages
La disparition d'Alain Colas inspira Serge Gainsbourg qui écrivit en 1979 les paroles de la chanson Manureva, composée et chantée par Alain Chamfort.
Une plaque en sa mémoire a été posée sur un des murs de l'intra-muros à Saint-Malo.
Le lycée de la communication à Nevers a reçu le nom d'Alain Colas. À Clamecy, une statue du navigateur, en bronze, a été inaugurée en 2006.
Plusieurs villes de France ont donné le nom d'Alain Colas à une rue, un quai ou un bâtiment.
Distinctions
Prix Guy Wildenstein de l'Académie des sports : 1972
Prix André de Saint-Sauveur de l'Académie des sports : 1975
Bibliographie
Alain Colas, Un tour du monde pour une victoire, Arthaud, 1972, 312 p.
Alain Colas, Cap Horn pour un homme seul, Flammarion, 1977, 269 p.
Jean-Paul Aymon, Patrick Chapuis, Gilles Pernet, Colas Terlain Vidal Tiercé de la mer, Paris, Solar, 1972, 254 p.
Jean-Paul Aymon, Alain Colas la mer est son défi, Fernand Nathan, 1977, 96 p.
Alain Colas Manureva ne répond plus..., Paris, Sipe, 1978, 96 p.
Jean-François Colas, "Alain Colas et ses navigations", Bulletin de la société scientifique et artistique de Clamecy, 2011, p. 9-34.
Liens
http://youtu.be/9bMMsEJuLfE Alain Colas
http://youtu.be/ZEl3ZDAVOm4 La recherche d'Alain Colas
http://youtu.be/XZ-CmHKBBXw Manureva de Alain Chamfort
http://youtu.be/z3kaVMp_0uU Colas et Tabarly
http://youtu.be/TiGWcuYToro Interview du père d'Alain Colas
http://youtu.be/WUQ5ZoT66X8 Alain Colas archives
http://youtu.be/A0fVJhlEPjk Interview
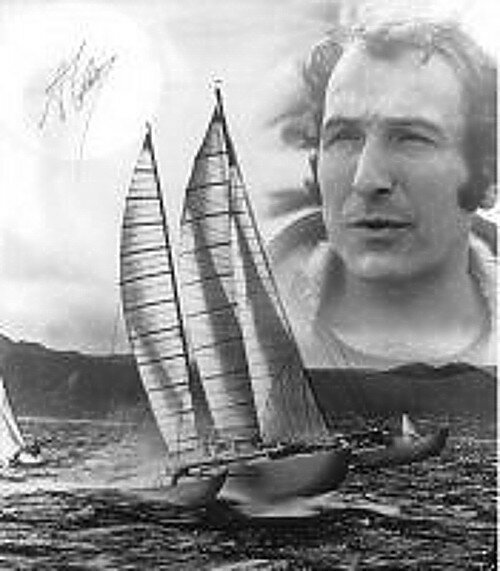      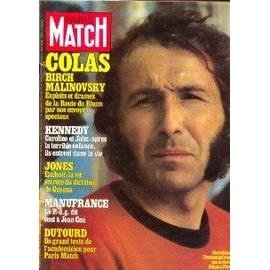 [img width=-00]http://idata.over-blog.com/0/05/97/56/tout-et-n--importe-quoi/colasec.jpeg[/img]  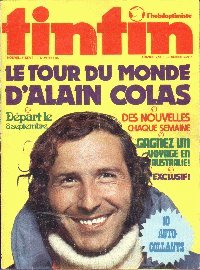  
Posté le : 16/11/2014 21:02
Edité par Loriane sur 17-11-2014 15:21:36
Edité par Loriane sur 19-11-2014 20:33:32
|
|
|
|
|
Re: Défi du 15-11-2014 |
|
Modérateur  
Inscrit:
21/03/2013 20:08
De Belgique
Niveau : 44; EXP : 15
HP : 215 / 1078
MP : 1072 / 35550
|
Ça c'est vache !
Posté le : 16/11/2014 20:10
|
|
|
|
|
Re: Défi du 15-11-2014 |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
06/08/2013 20:30
De Le Havre
Niveau : 25; EXP : 53
HP : 0 / 613
MP : 268 / 19535
|
Toute la musique que j'aimeu
Posté le : 16/11/2014 19:16
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
130 Personne(s) en ligne ( 79 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 130
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages