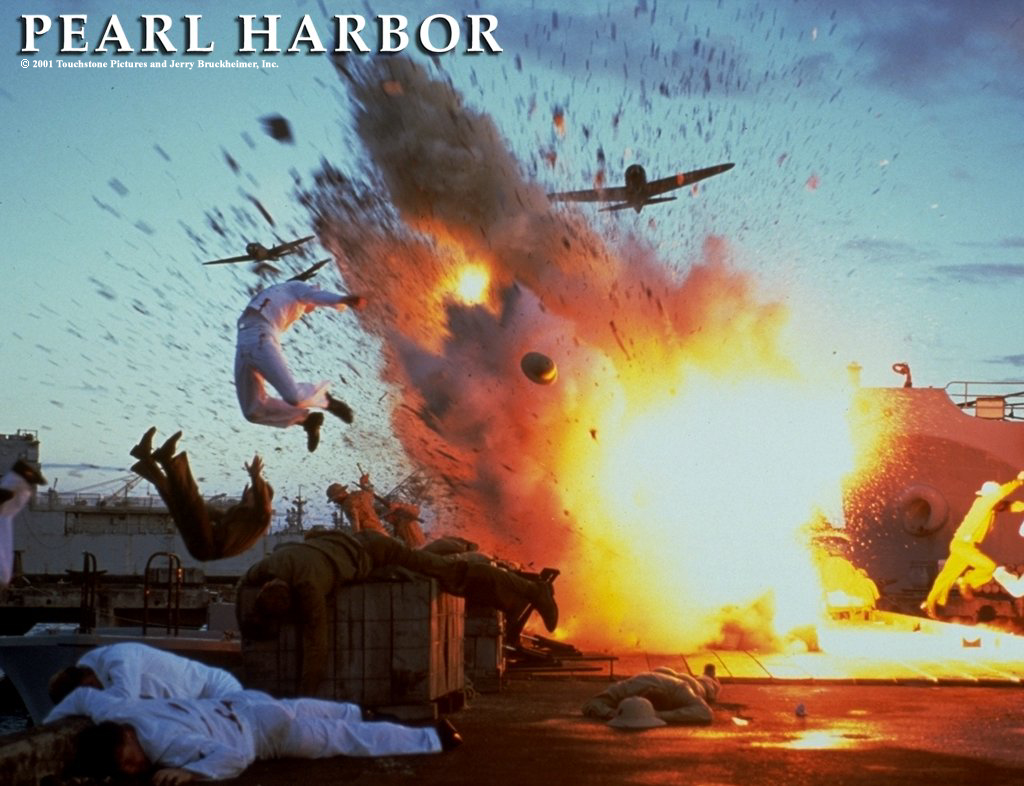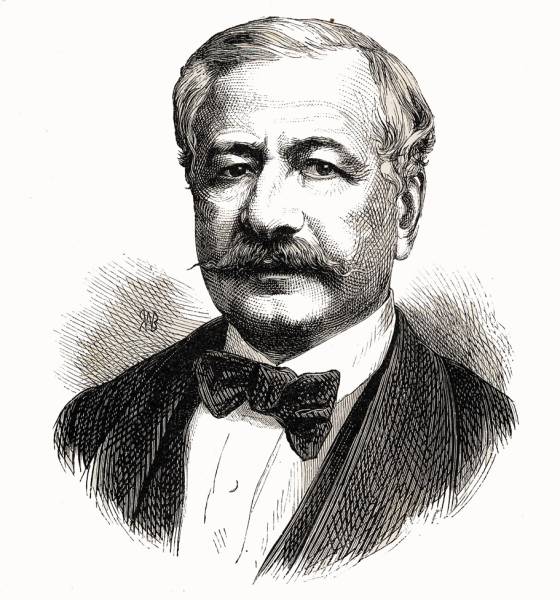Tous les messages Tous les messages
#4141
Le Bernin (Gian LorenzoBerminiolo)
Loriane
Posté le : 06/12/2014 18:26
Le 7 décembre 1598 naît Gian Lorenzo Berminiolo ou Gian Lorenzo
Bernini dit Le Bernin ou Cavaliere Bernini à Naples, mort, à 81 ans, le 28 novembre 1680 à Rome, sculpteur, architecte et peintre du mouvement baroque, il avait pour mécènes le cardinal Scipione Borghese, il fut influencé par Michel-Ange et influença Francesco Borromini . Il fut surnommé le second Michel-Ange. Son art, typiquement baroque, est caractérisé par la recherche du mouvement, la torsion des formes, le spectaculaire et les effets d'illusion. Il peut être qualifié d'artiste total, dans la mesure où, non seulement il maîtrisait les différents Beaux Arts, Architecture, Peinture et Sculpture, mais aussi parce qu'il était capable de les faire concourir au sein d'une même œuvre. Par son abondante production artistique, il se place comme la figure de proue de l'art baroque à Rome. En bref Giantimo Lorenzo naît, à Naples, le 7 décembre 1598 d'Angelica Galante et de Pietro Bernini, sculpteur maniériste d'origine florentine. Il est le dernier d'une fratrie de dix enfants, et l'unique garçon[réf. nécessaire]. Le couple se rend à Rome en 1605 où Pietro travaille pour le compte du cardinal Scipione Borghese ce qui est l'occasion de faire montre du talent précoce du fils qui travaille auprès de son père. Pietromo Bernini travaille sur les chantiers de Paul V Borghèse, achevant en particulier ce qui est reconnu comme son chef-d'œuvre, l’Assomption de la Vierge du baptistère de Sainte-Marie-Majeure et la chapelle Paolina destinée à accueillir la tombe de Paul V et Clément VII pour laquelle Pietro Bernini réalise un couronnement de Clément VII 1611. Le jeune Gian Lorenzo bénéficie très jeune de l'expérience de son père, en particulier en ce qui concerne l'organisation du travail collectif sur un chantier et la fusion des œuvres architectoniques, picturales, sculpturales dans un ensemble de marbres polychromes. La Rome des débuts du xviie siècle est une ville qui vit un renouveau artistique phénoménal avec en particulier l'introduction de la révolution naturaliste en peinture introduite par Le Caravage et l'influence baroque initiée dans les Flandres par Rubens, et où le talent ne demande qu'à être reconnu. Bernin aurait certainement décliné le qualificatif de maître du baroque, dont on croit l'honorer. Il est en effet aux antipodes du style baroque – au sens étymologique du terme, c'est-à-dire irrégulier et bizarre, libéré des règles – de son contemporain et rival Borromini, qu'il considère comme un hérétique. Comme Rubens ou Le Brun, comme Jules Hardouin Mansart ou Wren dans leurs domaines, il est en fait le maître de ce qu'on peut appeler le grand style moderne. Formé à l'admiration des chefs-d'œuvre de la statuaire hellénistique et des maîtres de la haute Renaissance, notamment Raphaël et Michel-Ange, revenant à la discipline du dessin d'après nature selon la leçon de Caravage et des Carrache, il conçoit ses œuvres comme des tableaux et plus encore comme des mises en scène théâtrales, dont il était friand ; il joue avec virtuosité du contraste entre les chairs nues, polies, et les larges drapés qu'il anime dramatiquement pour susciter l'émotion. L'échec de son séjour à Paris en 1665 ne résulte pas d'une opposition entre baroque et classicisme, mais seulement d'une méconnaissance des usages français de construction et de distribution. Il se concilia par son talent précoce la faveur du pape Paul V. Favori des papes, il devient l'architecte de la basilique Saint-Pierre. Il fut employé sans interruption par les pontifes : Grégoire XV le nomma chevalier ; Urbain VIII le combla de richesses ; plutôt en disgrâce sous le pontificat d'Innocent X il n'en conçut pas moins la fontaine des quatre fleuves de la place Navone. On lui doit le baldaquin aux colonnes torsadées du maître-autel et le dessin de la majestueuse colonnade et des statues qui encerclent la place devant la basilique Saint-Pierre. Ses fontaines monumentales, dont celle des Quatre Fleuves, offrant à la vue de tous le déchaînement des forces vives du baroque, exerceront une grande influence sur l'urbanisme romain et sur l'organisation des places publiques dans les autres capitales européennes. Charles Ier d'Angleterre lui fit faire sa statue. Sa vie Gian Lorenzo Bernini est né en 1598 à Naples où son père Pietro, sculpteur florentin de second ordre, était venu travailler, mais il se forme entièrement à Rome où sa famille s'installe en 1605 ou 1606. Gian Lorenzo reçoit ses premières leçons de sculpture de son père et se révèle enfant prodige. Bernin raconta plus tard que, lorsqu'il avait huit ans, le cardinal Barberini avait dit à son père : Prenez garde, cet enfant vous surpassera et sera plus habile que son maître, à quoi Pietro répliqua : Je ne m'en soucie pas. À ce jeu-là, qui perd gagne. L'amour paternel qui transparaît dans cette réplique est certainement l'une des clés de la personnalité de Bernin, qui n'a rien d'un artiste saturnien comme Michel-Ange. Constamment stimulé par son père, le jeune Bernini se forme en dessinant les marbres antiques du Vatican, notamment le Laocoon, l'Apollon du Belvédère et surtout l'Antinoüs dans lequel nous reconnaissons aujourd'hui un Hermès qu'il va consulter comme son oracle pour composer sa première figure, raconte-t-il en 1665 devant l'Académie de peinture et de sculpture de Paris, et dont il s'inspire encore pour sculpter les figures d'ange du pont Saint-Ange, 1668-1669, deux originaux aujourd'hui à Sant'Andrea delle Fratte. Il apprend aussi à grouper harmonieusement les figures en dessinant d'après les Stanze de Raphaël et Le Jugement dernier de Michel-Ange, se montre sensible au coloris et à l'atmosphère de Titien et de Corrège, et revient également à une étude directe de la nature, cherchant à saisir dans le miroir ou par de rapides esquisses la vérité de l'expression et du mouvement. Il y est encouragé par l'exemple de Caravage, dont les œuvres, petits tableaux de chevalet ou grandes toiles d'autel, ont ouvert la voie d'un retour à la leçon de la nature en réaction contre les virtuoses déformations de la maniera, et plus encore par les compositions d'Annibal Carrache qui le premier proposa dans ses fresques de la galerie Farnèse cette nouvelle synthèse entre idéal antique et vérité d'expression, qui fit la gloire de l'école bolonaise. Ce faisant, Bernin inverse en quelque sorte la démarche des artistes de la haute Renaissance : ceux-ci avaient renouvelé la peinture en étudiant la statuaire antique ; Bernin renouvelle la sculpture en s'inspirant de leurs œuvres. Plus précoce encore que Michel-Ange, Gian Lorenzo aurait sculpté à treize ans un groupe qui put passer pour un antique, Zeus allaité par la chèvre Amalthée 1609 ? , galerie Borghèse, Rome, et à dix-sept ans un Saint Laurent, son saint patron martyrisé sur le gril vers 1614-1615, coll. Bonacossi, Florence, où il affirme sa maîtrise. Introduit par son père dans le cercle du pape Paul V Borghèse 1605-1621, puis auprès des cardinaux amateurs d'art, le jeune Bernin sculpte pour le cardinal Maffeo Barberini, le futur Urbain VIII, un Martyre de saint Sébastien 1615-1616 coll. Thyssen, Lugano et pour le cardinal Montalto, neveu de Sixte V, un Neptune et Triton, destiné à une fontaine vers 1620, Victoria and Albert Museum, Londres. Pour la villa du cardinal Scipion Borghèse, neveu de Paul V, où ils se trouvent toujours, il sculpte les groupes d'Énée, Anchise et Ascagne fuyant Troie 1619-1620, Pluton et Proserpine 1621-1622, Apollon et Daphné 1622-1625, qu'il saisit en pleine course et en pleine métamorphose. Il réalise également un David 1623-1624, pour lequel il prend le contre-pied du David serein et méditatif de Michel-Ange, en donnant à sa figure bandant sa fronde la torsion du Polyphème de Carrache à la galerie Farnèse. Comme les sculptures de Jean de Bologne, ces groupes, qui veulent rivaliser avec les groupes hellénistiques, font oublier qu'ils sont taillés dans un bloc de marbre. Bernin abandonne cependant les points de vue multiples chers aux maniéristes : faites pour être vues de face comme des tableaux, ses sculptures étaient présentées adossées aux murs de la galerie Borghèse. S'intéressant aux expressions changeantes des visages sous l'effet de la souffrance Saint Laurent, déjà cité, et L'Âme damnée, vers 1619, de la peur Daphné ou de la détermination David, il taille aussi à cette époque ses premiers bustes, Paul V vers 1618, galerie Borghèse, Monsignor Pedro de Foix Montoya 1622, couvent de Sainte-Marie de Monserrato. Il réalise également plusieurs bustes en bronze et en marbre du pape Grégoire XV Ludovisi 1621-1623, qui le nomme cavaliere dès 1621, année où il est élu principe de l'académie de Saint-Lucie Les œuvres de jeunesse 1609 - 1617 Sous le patronage du cardinal Scipion Borghèse, alors membre de la famille papale régnante, le jeune Bernini commence à être reconnu comme sculpteur de talent. Ses premières œuvres sont des pièces décoratives destinées à orner le jardin de la villa Borghèse, Priape et Flore, 1615 - 1616 aujourd'hui au Metropolitan Museum of Art. Un groupe décoratif des Quatre Saisons commandé par Leone Strozzi pour le jardin de sa villa romaine dont les traits sensuels et réalistes des festons de fruits dénotent l'influence des œuvres caravagiennes présentes dans la collection du cardinal et auxquelles Le Bernin n'a pas pu échapper. Dans sa première phase stylistique, on dénote une influence nette de la sculpture hellénistique dans des œuvres qui imitent à la perfection le style antique comme le révèlent le Saint-Sébastien de la collection Thyssen Bornemisza à Madrid et un Saint-Laurent sur le gril dans la collection Contini Bonacossi à Florence. De cette période datent aussi un Putti avec dragon et un Faune émoustillé par des Amours, circa 1617, coll. Metropolitan Museum of Art qui sont sans doute encore des œuvres collectives, les premières créations indubitablement de la main du Bernin sont la Chèvre Amalthée avec Zeus enfant et un faune 1615, coll. Galerie Borghèse de facture naturaliste, le buste de Giovanni Battista Santoni conservé en l'église Santa Prassede de Rome et les allégories de l’Âme damnée et l’Âme sauvée 1619, conservées au Palazzo di Spagna. Les groupes Borghèse Avec les quatre groupes Borghèse qui l'occupent pendant cinq ans, Le Bernin atteint une gloire immédiate. Il s'agit de trois sujets mythologiques et un biblique correspondant aux centres d'intérêt antiquisants de leur commanditaire, le cardinal Scipion Borghèse : Énée, Anchise et Ascagne 1619 Rapt de Proserpine 1622 David 1624 Apollon et Daphné 1622-1625 L’Énée et Anchise ne se démarque pas encore totalement de l'influence paternelle maniériste et est sans doute forcément influencé par une fresque de Raphaël dans la Stanza dell’Incendio di Borgo au Vatican où, fuyant l'incendie de Rome, un homme mûr porte son père sur ses épaules, suivi de son fils. D'un point de vue allégorique, l'œuvre représente les trois âges de la vie, où Anchise porte sur ses épaules une statue des dieux Lares, il est lui-même porté par son fils Énée alors qu'Ascagne les suit en soutenant le feu sacré, les trois, et la statue des ancêtres portée par Anchise fondant une représentation spatiale d'un arbre généalogique. D'un point de vue psychologique, il n'est pas innocent que Le Bernin choisisse ce thème un fils dans la force de l'âge portant son père affaibli sur ses épaules alors qu'il atteint la majorité. Le Rapt de Proserpine est un sujet tiré des Métamorphoses d'Ovide quand Pluton enlève Proserpine. Il est offert au cardinal Ludovico Ludovisi neveu du pape Grégoire XV et secrétaire d’État, il reviendra par la suite dans les collections de la galerie Borghèse. Sa composition en spirale est faite pour accentuer le dynamisme dramatique et est soulignée par le mouvement des cheveux et des drapés. L'empreinte des doigts du dieu des enfers dans les chairs de Proserpine est virtuosement réaliste et participe aussi de l'effet dramatique du rapt. Avec son David, Le Bernin, âgé d'à peine vingt-cinq ans, se mesure avec l'icône insurpassable de la Renaissance italienne, le David de Michel-Ange, l'un comme l'autre symbolisent à la perfection l'art de leur temps : autant l'œuvre michelangelesque est posée, digne, racée, élégante, autant Le Bernin parvient, en représentant David sur le point de lancer son projectile à l'aide de sa fronde, le torse tourné, le visage grimaçant d'effort, à réunir tous les éléments de l'art baroque : l'énergie, le mouvement, le dynamisme. Et l'on peut dire que celui-ci est le symbole de la Rome de la Contre-Réforme, d'une église prête à affronter ses adversaires alors que celui-là représente à la perfection la Florence de la Renaissance, fière cité jalouse de son indépendance. À moins qu'il ne s'agisse du geste du Bernin lui-même, défiant le Goliath-Michel-Ange. Le sujet d’Apollon et Daphné est une fois de plus tiré des Métamorphoses d'Ovide : la nymphe Daphné, victime des ardeurs du dieu Apollon, supplie son père de lui venir en aide ; Pénée transforme alors sa fille en laurier et Le Bernin capture ce moment précis opérant par-là une mise en abyme puisque dans une scène pleine de vie et de pathos, il immobilise dans le marbre la jeune nymphe qui se fige dans une écorce protectrice et s'enracine dans la terre. Au risque de nous répéter, on ne peut que souligner la tension dramatique, l'impression de mouvement donnée par une construction en spirale typique de l'art baroque en général et marque de fabrique du Bernin en particulier. Avec cette œuvre, Le Bernin atteint un summum esthétique. L'Âme damnée, Bernin L'Âme damnée, marbre, vers 1619. Ambassade d'Espagne à Rome, Italie. Gian Lorenzo Bernini, dit le Cavalier Bernin, Apollon et Daphné, 1622-1625, marbre de Carrare, hauteur 243 cm. Galleria Borghese, Rome. Détail des visages d'Apollon et de Daphné, où se mêlent les expressions de sentiments divers : surprise, puis déception chez le dieu, peur, étonnement, enfin soulagement chez la nymphe, qui, par sa métamorphose, parvient à lui échapper. Le pontificat d'Urbain VIII Barberini, Grand ordonnateur des arts En 1623, succédant à Grégoire XV, le florentin Maffeo Barberini monte sur le trône pontifical sous le nom d'Urbain VIII. Le Bernin trouve en lui le mécène idéal, Urbain mène une politique de grands travaux pour graver dans la pierre la volonté de reconquête de l'église comme force triomphante du paganisme via les missions et du protestantisme via la Contre-Réforme : une architecture spectaculaire, une esthétique communicante, persuasive et festive voire fastueuse en seront les vecteurs. Première commande pontificale, dès 1623, une Santa Bibiana, statue destinée à orner l'église homonyme, déjà représentée en posture d'extase et qui s'intègre en une scénographie toute baroque aux fresques de Pierre de Cortone. Par la suite, il utilisera souvent l'effet théâtral des draperies, des jeux de marbres, de l'intégration de la peinture, de la dramatisation de la scène par un clair-obscur. En 1624, le pape décide de l'édification d'un baldaquin de bronze au-dessus de l'autel de Saint Pierre. La construction s'étend de 1624 à 1633 et, pour ce faire, on utilise le bronze du Panthéon ce qui fera dire : Quod non fecerunt Barbari fecerunt Barberini Ce que les Barbares n'ont pas fait, les Barberini l'ont fait. Le génie théâtral du Bernin s'exprime à plein dans ce dais soutenu par des colonnes torses qui rappellent le trône et le temple du roi Salomon, iconographie jamais innocente liant Rome à Jérusalem, soulignant la continuité sinon la légitimité voire le primat du Vatican avec/sur le judaïsme. La modénature du monument souligne également l'importance des Barberini des abeilles en référence aux armes de la famille papale et la sûreté de leur goût le laurier, symbole d'Apollon et des arts. Bernin dessine ainsi le nouveau portique de l'église Santa Bibiena 1624-1626, pour laquelle il sculpte aussi une statue de Sainte Viviane destinée à être placée dans une niche au-dessus du maître-autel. Mais son grand projet est le chantier de Saint-Pierre, qui l'occupe pratiquement jusqu'à sa mort. Il dessine le Baldaquin de marbre et de bronze qui se trouve sous le dôme à l'emplacement du tombeau de saint Pierre 1624-1633, et la décoration des quatre grands piliers qui supportent le dôme ; il y conçoit le projet de quatre statues colossales destinées à célébrer les reliques les plus précieuses de la basilique, se réservant l'exécution du Saint Longin dont le geste spectaculaire et le large plissé conviennent pour une vision à distance 1629-1638. En 1627, le tombeau du pape est commandé au Bernin. Il sera achevé des années plus tard et placé en face de celui de Paul III, l'initiateur de la Contre-Réforme qu'Urbain VIII pensait avoir achevée. C'est l'occasion pour le Bernin de se mesurer, comme il l'a déjà fait avec son David, avec Michel-Ange qui avait réalisé le tombeau de Paul III. La statuaire représente le pape bénissant de la main, la Justice et la Charité à ses côtés et la Mort, sous forme d'un squelette aux pieds du Saint-Père, écrit son épitaphe ; l'idée iconographique novatrice est que la Mort elle-même est soumise au pouvoir du pape… Le chantier du palais Barberini est confié, vers 1630, au Bernin en collaboration avec Francesco Borromini qui deviendra son grand rival par la suite. La fontaine du Triton Fontana del Tritone qu'il achève en 1643 est la première d'une longue série de réalisations de « mobilier urbain. La fontaine des abeilles Fontana delle Api immortalise peu après les trois abeilles symbole de la famille Barberini. Pour le tombeau d'Urbain VIII à Saint-Pierre 1628-1647, Bernin s'inspire de la composition de Guglielmo della Porta pour le mausolée de Paul III Farnèse 1549-1575, mais il anime ses figures avec une remarquable autorité. Pendant sa disgrâce sous le pontificat d'Innocent X, Bernin conçoit ce qu'il considérera comme son œuvre la plus parfaite : la chapelle funéraire du cardinal vénitien Federico Cornaro, dans la petite église des carmélites de Sainte-Marie-de-la-Victoire 1645-1652. Il dessine un pavement de marbres, orné de médaillons dans lesquels s'animent des squelettes ; sur les côtés, il sculpte, comme accoudés à une tribune, les membres de la famille Cornaro et, au-dessus de l'autel, sainte Thérèse d'Avila en extase : la transverbération est fidèlement représentée d'après le récit de la nouvelle sainte, canonisée en 1622. Les expériences théâtrales de Bernin ne sont sans doute pas étrangères à cette véritable mise en scène de marbres. Ces réalisations donnent à Bernin une renommée internationale. Comme Pierre de Cortone, Carlo Rainaldi et quelques autres, Bernin participe au concours international organisé par Colbert pour l'achèvement du Louvre et il est invité en France au printemps de 1665. Grâce au Journal tenu par Paul Fréart de Chantelou, maître d'hôtel du roi chargé d'assister Bernin, nous sommes parfaitement renseignés sur ce séjour de cinq mois, de juin à octobre, du Cavalier à Paris. Il établit alors un nouveau dessin pour le palais du Louvre, que l'on renonça finalement à exécuter, et sculpta un Buste de Louis XIV, 1665, Versailles. Le portrait est un genre que Bernin pratiqua épisodiquement toute sa vie, Cardinal Scipion Borghèse, 1632, galerie Borghèse, Rome ; Paolo Giordano Orsini, vers 1635, château de Bracciano ; Thomas Baker, vers 1638, Victoria and Albert Museum, Londres ; Urbain VIII, 1638, coll. part. ; François Ier d'Este, duc de Modène, 1650-1651, galerie Estense, Modène ; Gabriele Fonseca, vers 1670, chapelle funéraire de la famille Fonseca à San Lorenzo in Lucina. Son don d'observation du visage en mouvement qui est, comme le raconte fort bien Chantelou, l'élaboration d'un buste s'exprime aussi dans des caricatures, qui sont les premières à représenter des personnages en vue. Le Bernin dessine les clochers qui devaient encadrer la façade de Maderno 1637, mais la tour sud se fissura, fut abattue en 1646, et les clochers ne furent jamais réalisés. En disgrâce au début du pontificat d'Innocent X Pamphili 1644-1655, le Cavalier garde la conduite du chantier de Saint-Pierre, dirigeant la décoration des écoinçons des arcs de la nef par des figures de Vertus, travail quasiment achevé par une armée de sculpteurs pour le jubilé de 1650. Sa maîtrise est telle que le pape, plus proche de Borromini, mais reconnaissant néanmoins qu'il est né pour traiter avec les plus grands princes, lui demande un buste vers 1647 et lui confie la réalisation de la Fontaine des Quatre-Fleuves, place Navone, sous les fenêtres du palais familial Pamphili 1648-1651. Bernin y pousse plus loin encore la virtuosité anthropomorphe de la Fontaine du Triton 1642-1643, place Barberini. Sous le pontificat d'Alexandre VII Chigi 1655-1667, qui veut renouer avec la grande politique d'Urbain VIII et lui rend toute sa confiance, le Cavalier exécute le dessin de la place Saint-Pierre 1656-1667. Ce parvis monumental, destiné à contenir la foule des pèlerins lors des bénédictions urbi et orbi, rappelle la grandeur de la Rome antique et s'inspire peut-être du cortile Baccanario, péristyle qui servait de parvis au prétendu temple de Bacchus, en fait mausolée de Sainte-Constance, gravé par Serlio. Presque en même temps, Bernin conçoit dans l'abside un monument destiné à porter la chaire de saint Pierre, 1657-1666 ; symbole du pouvoir pontifical et exaltation de la cathedra Petri, elle est soutenue par les quatre Pères de l'Église 1657-1666. Pour le palais du Vatican, le Cavalier dessine la Scala regia 1663-1666, qu'il orne d'une statue équestre de Constantin 1654-1670 et qu'il anime d'une colonnade en perspective accélérée comme Borromini l'avait fait au palais Spada 1652. Mais s'il imite ici Borromini, son architecture prend généralement le contre-pied de celle de son rival, dont il condamne le libertinage architectural, déclarant qu'il préfère un mauvais catholique à un bon hérétique. Lorsqu'il s'inspire de Michel-Ange, c'est plus de l'architecte classique de la place du Capitole ou de Saint-Pierre que de l'hérétique à la fantaisie trop libre de la porta Pia. Pour l'église du noviciat des jésuites, Saint-André-au-Quirinal 1658-1670, il dessine une façade qui est une variation sur la travée du palais des Conservateurs de la place du Capitole et délimite un espace ovale beaucoup plus banal que celui de l'église voisine de Borromini, Saint-Charles-aux-Quatre-Fontaines. Borromini à Saint-Charles et à Saint-Yves-de-la-Sapience crée un espace complexe qu'il décore de stuc blanc et or, alors que Bernin transfigure l'espace en utilisant marbres polychromes et en multipliant les statues. Pour Sainte-Marie-de-l'Assomption à Ariccia 1662-1664, il revient à un langage architectural encore plus sage, sobre variation sur le thème du Panthéon. Dans ses dernières œuvres, Daniel et Hababuc et l'ange 1655-1657 et 1655-1661, chapelle Chigi de Sainte-Marie-du-Peuple, la Sainte Madeleine et le Saint Jérôme 1661-1663, chapelle Chigi de la cathédrale de Sienne, les Anges qui devaient couronner la balustrade du pont Saint-Ange, la Statue équestre de Louis XIV 1670, qui déplut au roi et fut transformée en Marcus Curtius Versailles, le Tombeau d'Alexandre VII 1671-1678, Saint-Pierre, les figures, plus libres, s'allongent, se balancent, les drapés sont plus expressifs, le contraposto plus marqué. Dans la chapelle Altieri à San Francesco a Ripa, dessinée en 1674 pour le cardinal Paluzzi degli Albertoni, apparenté au pape Clément X 1670-1676, dont il prit le nom, le Cavalier retrouve les problèmes artistiques qu'il avait résolus à la chapelle Cornaro. L'éclairage indirect des fenêtres illumine le lit où est étendue la bienheureuse Ludovica Albertoni mourante, dont le culte fut institué en 1671. Les toutes dernières œuvres de Bernin furent un buste du Salvator Mundi pour la reine Christine de Suède et des projets de restauration du palais de la Chancellerie pour Innocent XI Odescalchi 1676-1689, le huitième pape qu'il ait servi. Le pontificat En 1644, Gian Battista Pamphili est élu au trône de Saint-Pierre. C'est un pape austère ou aux ambitions artistiques limitées par la crise des finances du Saint-Siège fin de la guerre de Trente Ans et traités de Westphalie. Coup dur à la réputation du Bernin, c'est aussi l'année de la démolition du campanile de la basilique Saint-Pierre pour des raisons de statique. Ses concurrents en profitent pour faire valoir leur place, Borromini obtient le chantier de Saint-Jean de Latran, Carlo Rainaldi construit le Palazzo Pamphilj et commence la construction de l'église Sainte-Agnès en Agone sur la Piazza Navona. Le Bernin n'est pas en disgrâce mais cela y ressemble presque et il faut l'habile médiation du prince Niccolò Ludovisi pour qu'on lui commande la réalisation de la magnifique fontaine des Quatre-Fleuves 1648 - 1651. Entre 1647 et 1652, Le Bernin travaille sur ce qui est son chef-d'œuvre et celui de la sculpture baroque, l’Extase de sainte Thérèse dans la chapelle Cornaro de Santa Maria Della Vittoria à Rome. Commande du cardinal Federico Cornaro pour célébrer sainte Thérèse récemment canonisée 1622 et première carmélite à l'avoir été. La lumière zénithale accentue la position extatique de la sainte, comme terrassée par la flèche mystique de l'ange. Durant cette décennie, il réalise également un Monument à la sœur Maria Raggi à Santa Maria sopra Minerva, une Verità aujourd'hui dans la galerie Borghèse, un buste d'Innocent X coll. Galleria Doria Pamphili et un buste de Francesco I d’Este coll. museo Estense di Modena. Le pontificat d'Alexandre VII Chigi Alexandre VII est un pape humaniste et urbaniste qui monte sur le trône de saint Pierre en 1655. Il commande au Bernin la colonnade de la place Saint-Pierre lequel trouve une solution urbanistique et symbolique élégante en concevant une colonnade qui s'écarte depuis la basilique comme deux bras qui accueilleraient la foule. Dans son projet, l'architecte aurait souhaité fermer entièrement la place par une troisième aile à l'est de celle-ci, mais la mort d'Alexandre VII, interrompit définitivement les travaux1. Le plan elliptique est typique de l'architecture baroque influencée par les découvertes contemporaines en astronomie, l'usage de l'ellipse se généralisera pour devenir un lieu commun de l'architecture baroque et rococo. Cathedra Petri Avant cela, le Bernin a réalisé, pour l'abside de la basilique Saint-Pierre, la Chaire de saint Pierre Cathedra Petri, ajoutant un chef-d'œuvre de plus à la liste déjà longue. L'œuvre est un reliquaire contenant la cathèdre paléochrétienne, portée par les statues monumentales des quatre pères de l'Église, symboles de la sagesse et de la connaissance qui soutiennent l'autorité papale. L'originalité est ici de situer le siège de l'évêque (et le pape, successeur de saint Pierre n'est autre qu'un évêque parmi d'autres dans une longue lignée, en théorie appelé à s'asseoir sur la chaire du premier évêque de Rome) en hauteur, comme inaccessible, inatteignable, affirmant indirectement la suprématie de Rome sur les autres patriarcats. De 1658 à 1678, il travaille à l'édification de l'église Saint-André du Quirinal dont le plan elliptique servira de modèle pour nombre d'églises baroques par la suite. Le Bernin, qui a beaucoup contribué à l'embellissement ou la complétion de bâtiments existants et peu construit d'édifices dans leur totalité considère cette église comme son chef-d'œuvre architectural. Le Bernin est un artiste de réputation internationale et, dès 1664, Colbert l'invite en France pour le compte de Louis XIV qui doit faire pression sur le pape pour qu'il libère son architecte préféré, lequel part pour Paris en avril 1665 pour travailler sur la restructuration du Louvre. Reçu comme un prince, il réalise alors un buste du roi, mais aucun de ses projets de façade pour le Louvre ne sera retenu, marquant le début du déclin de l'influence italienne sur l'art architectural français. On lui préfère le projet de Claude Perrault. La statue équestre du roi, qu'il avait proposée lors de son séjour en France, et qui sera réalisée quelques années plus tard à Rome, sera livrée, mais exilée dans un coin peu prestigieux du parc de Versailles. Il retourna à Rome dès octobre 1665. Comme pour Urbain VIII, il réalise le tombeau d'Alexandre VII avec les allégories de la Charité, de la Vérité devant la Prudence et la Justice avec une porte qui symbolise le passage vers l'au-delà. Les dernières années Extase de la bienheureuse Ludovica Albertoni 1675 Sous Clément IX, Le Bernin réalise une série d'anges pour le pont Saint-Ange de Rome. De cette série, seule une statue est de la seule main du Bernin laquelle est aujourd'hui conservée en la basilique Sant'Andrea delle Fratte. Il s'attaque une ultime fois au thème de l'extase avec celle de la bienheureuse Ludovica Albertoni terminée en 1674. Il meurt à Rome en 1680 et est enterré dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. Deux ans après sa mort, la reine Christine de Suède, alors en exil à Rome commande sa biographie à Philippe Baldinucci La Vie du chevalier de Bernin. Œuvres Sculptures Éléphant par Le Bernin, Piazza Minerva Fontaine de la Barcaccia Fontaine du Triton Fontaine des Quatre-Fleuves Buste de Louis XIV par Le Bernin, salon de Diane, Versailles, 1665. Buste de Giovanni Battista Santoni c. 1612 - Marbre, Basilique Santa Prassede, Rome. Saint Laurent sur le grill 1614-1615 - Marbre, 66 × 108 cm, Contini Bonacossi Collection, Florence. La Chèvre Amalthée avec Jupiter enfant et un faune 1615 - Marbre, Galerie Borghèse, Rome. Saint Sébastien c. 1617 - Marbre, Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid. Faune émoustillé par des Amours 1616-1617 - Marbre, 132 cm, Metropolitan Museum of Art, New York. Énée, Anchise et Ascagne 1618-1619 - Marbre, 220 cm, Galerie Borghèse, Rome Âme damnée 1619 - Palazzo di Spagna, Rome. Âme sauvée 1619 - Palazzo di Spagna, Rome. Buste du Cardinal Escoubleau de Sourdis 1620 - Musée des beaux-arts de Bordeaux, Bordeaux. Annonciation ? - groupe sculpté par Bernini le père pour l'Archange Gabriel et la Vierge par Gian Lorenzo Bernini, Église Saint-Bruno, Bordeaux. Apollon et Daphné 1622-1625 - marbre, 243 cm, Galerie Borghèse, Rome. La Charité avec quatre enfants 1627-1628 - terre cuite, 39 cm, Musées du Vatican, Vatican. David 1623-1624 - marbre, 170 cm, Galerie Borghèse, Rome. Fontana della Barcaccia 1627-1628 - marbre, Piazza di Spagna, Rome Buste de Monsignor Pedro de Foix Montoya c. 1621 - marbre, Santa Maria di Monserrato, Rome Neptune et Triton 1620 - marbre, 182 cm, Victoria and Albert Museum, Londres. Le Rapt de Perséphone 1621-1622 - marbre, 295 cm, galerie Borghèse, Rome. Fontaine du Triton Fontana del Tritone 1624-1643 - travertin, Piazza Barberini, Rome. Tombe d'Urbain VIII 1627-1647 - bronze doré et marbre, basilique Saint-Pierre, Vatican. Buste de Thomas Baker 1638 - marbre, 81,6 cm, Victoria and Albert Museum, Londres. Buste de Costanza Bonarelli c. 1635 - marbre, 70 cm, Bargello, Florence. Charité avec deux enfants 1634 - terre-cuite, 42 cm, musées du Vatican, Vatican. Saint Longinus 1631-1638- marbre, 450 cm, basilique Saint-Pierre, Vatican. Buste de Scipione Borghèse 1632 - marbre, height 78 cm, galerie Borghèse, Rome Buste de Scipione Borghèse 1632 - marbre, basilique Saint-Pierre, Vatican. Buste d'Urbain VIII 1632-1633 - bronze, 100 cm, musées du Vatican, Vatican. Buste du Cardinal Armand de Richelieu 1640-1641 - marbre, Musée du Louvre, Paris. Mémorial à Maria Raggi 1643 - bronze doré et marbres polychromes, Santa Maria sopra Minerva, Rome. Buste d'Innocent X circa 1650- marbre, Galerie Doria-Pamphilj, Rome. La Vérité 1645-1652 - marbre, 280 cm, Galerie Borghèse, Rome. L'Extase de Sainte Thérèse (647-1652 - marbre, Chapelle Cornaro, Santa Maria della Vittoria, Rome. Loggia des fondateurs 1647-1652 - marbre, Chapelle Cornaro, Santa Maria della Vittoria, Rome. Buste d'Urbain - marbre, basilique Saint-Pierre, Vatican. Noli me tangere 1649 marbre, Église Santi Domenico e Sisto, Rome. Fontaine des Quatre-Fleuves 1648-1651 - travertin et marbre, Piazza Navona, Rome. Daniel et le lion 1650 - marbre, Santa Maria del Popolo, Rome. François Ier d'Este 1650-1651 - marbre, 107 cm, Galleria Estense, Modène Fontaine du Maure 1653-1654 - marbre, Piazza Navona, Rome Constantin 1654-1670 - marbre, Palais du Vatican, Vatican. Daniel et le lion 1655 - terre-cuite, 42 cm, Musées du Vatican, Vatican. Habacuc et l'ange 1655 - terre-cuite, 52 cm, Musées du Vatican, Vatican. Buste de Louis XIV 1655- terre-cuite, 52 cm, Musées du Vatican, Vatican. Buste de Louis XIV 1682- terre-cuite, Place Royale, Québec, Canada Croix d'autel 1657-1661 - bronze doré, 185 cm, basilique Saint-Pierre, Vatican. Trône de Saint Pierre 1657-1666 - marbre, bronze, stuc, basilique Saint-Pierre, Vatican. Saint Augustin 1657-1666 - bronze, basilique Saint-Pierre, Vatican. Constantin, Scala Regia 1663-1670 - marbre et stucs polychromes, Palais du Vatican, Vatican. Ange debout avec un parchemin 1667-1668 - terre-cuite, 29 cm, Fogg Art Museum, Cambridge. Ange avec la couronne d'épines 1667-1669 - marbre, Basilique Sant'Andrea delle Fratte, Rome. Ange avec les Écritures 1667-1669 - marbre, over life-size, Sant'Andrea delle Fratte, Rome Éléphant de la Minerve 1667-1669 - marbre, Piazza di Santa Maria sopra Minerva, Rome attribué par certains à Giuseppe Paglia. Buste de Gabriele Fonseca 1668-1675 - marbre, San Lorenzo in Lucina, Rome. Statue équestre de Louis XIV 1669-1670 - terre-cuite, 76 cm, Galerie Borghèse, Rome. Statue équestre de Louis XIV 1671-1677, transformée en Statue équestre de Louis XIV sous les traits de Marcus Curtius par Girardon - marbre, château de Versailles. Buste de Louis XIV 1665 - marbre, 105 × 99 × 46 cm, salon de Diane, Château de Versailles, Versailles. Herm de Saint Étienne de Hongrie - bronze, Cathédrale de Zagreb, Zagreb. Saint Jérôme 1661-1663 - marbre, 180 cm, Chapelle Chigi, Duomo di Siena, Sienne. Tombe d'Alexandre VII 1671-1678- marbre et bronze doré, basilique Saint-Pierre, Vatican. Au sommet le pape est en prière; au-dessous de lui un précieux suaire, au centre, un squelette surgit de la porte de la mort tenant une clepsydre pour avertir le pape de sa fin proche. Bienheureuse Ludovica Albertoni 1671-1674 - marbre, Chapelle Altieri-Albertoni, de l'Église San Francesco a Ripa, Rome. Buste Salvator mundi 1680 - marbre Disparu à la fin du XVIIe siècle, il a été redécouvert à Rome au couvent Saint-Sébastien-hors-les-murs. Ce buste avait été offert par La Bernin à Christine de Suède, grande amie du sculpteur2 Souvenir funèbre d'Ippolito Merenda (ate inconnue - église San Giacomo in Settimiana, via della Lungara, Rome. Monument représentant un squelette ailé qui plane en soutenant, de ses doigts crochus et de ses dents, le cartouche commémoratif du défunt, un juriste. Architecture Façade de l'église Santa Bibiana c. 1623, Rome. Baldaquin de la basilique Saint-Pierre 1624 – 1633, Rome. Baldaquin de la basilique San Crisogono, Rome. Chapelle Cornaro en l'église de Notre-Dame de la Victoire, contenant la célèbre Extase de Sainte Thérèse 1647 – 1652, Rome. Palazzo Montecitorio c. 1650, Rome. Fontaine des Quatre-Fleuves 1651, Rome. Colonnade de la place Saint-Pierre c. 1660, Rome. Restauration de l'église Sainte-Marie-du-Peuple 1655 - 1661, Rome - avec en particulier la décoration de la nef et du transept et réalisation de la chapelle Chigi. Église Saint-André du Quirinal 1658 - 1678, Rome. Palais Chigi c. 1660, Rome. Scala Regia au Vatican 1662 - 1668, Rome - avec en particulier une statue équestre de Constantin. Colonnade du Louvre 1665, Paris. Peintures Pour Le Bernin, la peinture est une activité annexe. Ses toiles révèlent néanmoins une touche sûre dénuée de pédanterie. Saint André et Saint Thomas c. 1627 - huile sur toile, 59 × 76 cm, National Gallery, Londres Portrait de garçon c. 1638 - huile sur toile, Galerie Borghèse, Rome Autoportrait en jeune homme c. 1623 - huile sur toile, Galerie Borghèse, Rome Autoportrait à l'âge mûr 1630-1635 - huile sur toile, Galerie Borghèse, Rome Portrait d'Urbain VIII Liens http://youtu.be/d7CrI5uxEJg le Bernin en musique http://youtu.be/NzjBH9nb-f0 ( Geoffroy Drouin ) http://youtu.be/P0uY8YorFC4 (geoffroy Drouin) http://youtu.be/WNHS3cQrYdo Le Bernin 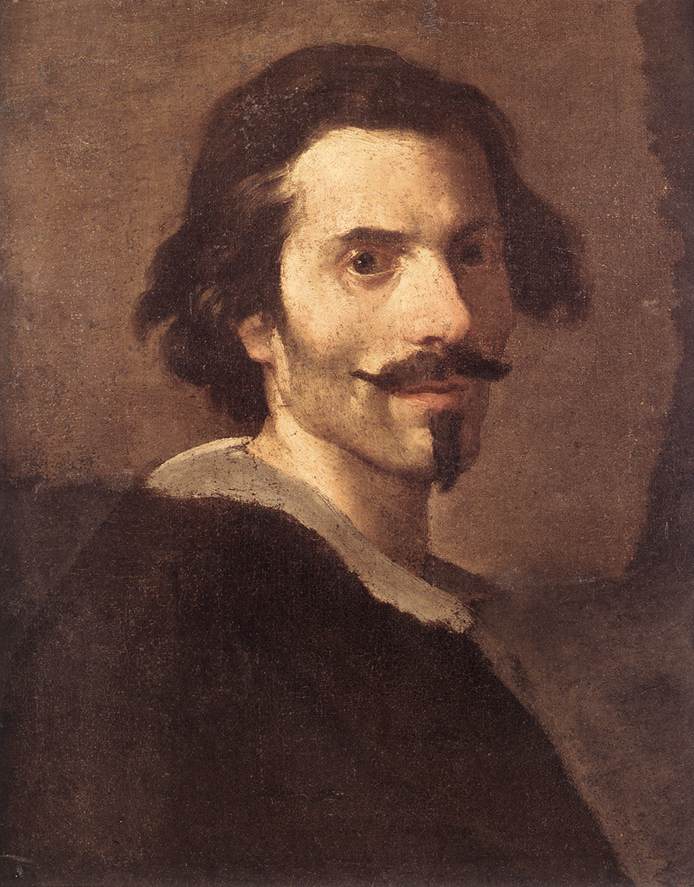 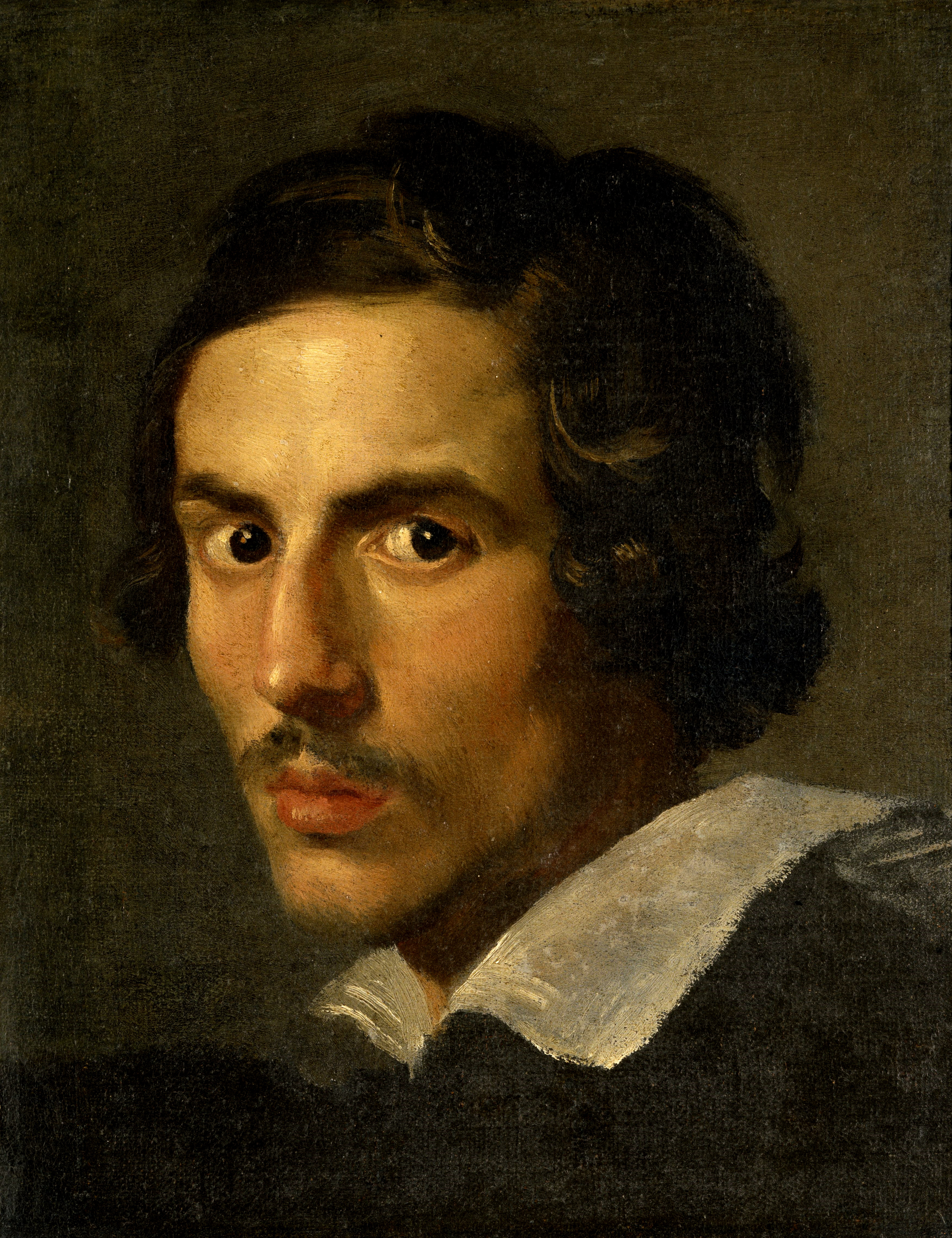     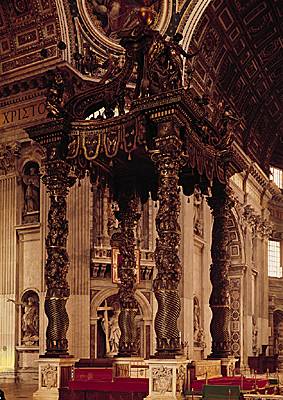  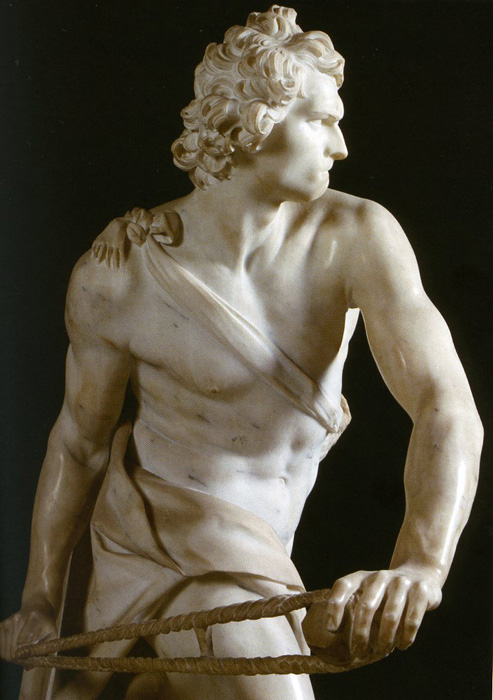   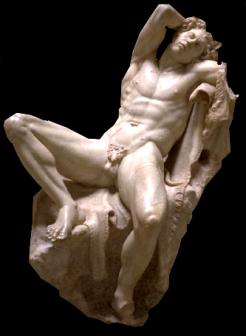 
#4142
Marie Walewska
Loriane
Posté le : 06/12/2014 18:16
Le 7 décembre 1786 naît Marie Walewska ou Waleska
à l'origine Maria Łączyńskà Brodno, à Brodno en Pologne, morte, à 31 ans, à Paris le 11 décembre 1817 à Paris, est connue pour avoir été l'une des maîtresses de Napoléon Ier, épouse de Anastazy Walewski dont elle a un fils Antoine walewski, puis de Philippe Antoine d'Ornano avec qui elle aura un fils Rudolf-August d'Ornano ; elle est également désignée comme la femme polonaise de Napoléon, Napoléon 1 avec qui elle aura Alexandre Florian Joseph Colonna Walewski. La jeune Marie appartient à une famille ancienne de la noblesse polonaise. Très respectée, elle s'est distinguée à travers les âges au service de la Pologne. À la fin du xvie siècle, Jérôme Hieronym Łączyński est connu comme juriste. Au XVIIIe siècle, la branche cadette de la famille s'établit en Pologne orientale et la branche aînée, la plus ancienne, en Pologne centrale. Durant le règne de Stanislas-Auguste, le père de Marie, Mathieu Maciej Łączyński reprend le domaine familial lorsque son frère aîné décide d'entrer dans les ordres. En 1792, la Pologne subit le second partage et perd une bonne part de son territoire. En 1794, Mathieu participe à l'insurrection de Kosciuszko, qui ne parvient pas à éviter le troisième partage 1795 ; cela met fin au royaume de Pologne. Les terres de la famille font partie du territoire incorporé à la Prusse. Mathieu, blessé durant une des batailles, meurt en mai 17953. En bref Marie Laczynska est née le 7 décembre 1789 à Varsovie. En 1804 elle épouse le comte Athénase Walewski, beaucoup plus âgé qu'elle il a 70 ans. Un petit Antoine naît de leur union en 1805. Elle a 18 ans quand elle rencontre Napoléon, le 1r janvier 1807, au relais de Blonie. Elle voudrait le convaincre de donner l'indépendance à la Pologne. Ses amis la poussent à accepter les avances de l'Empereur, geste qu'ils qualifient de "patriotique". Le "sacrifice" se transforme en amour et le 4 mai 1810 ils ont un fils: Alexandre Walewski. Marie est discrète et fidèle. Son désir est de suivre Napoléon et d'être à ses côtés dans les moments difficiles. Elle tente en vain de le voir à Fontainebleau. Début septembre 1814, elle passe 3 jours à l'île d'Elbe. Elle voit l'Empereur pour la dernière fois à Malmaison, après Waterloo. Il refuse qu'elle le suive à Sainte-Hélène. Etant veuve, elle épouse le comte Philippe-Antoine d'Ornano, un cousin éloigné, en septembre 1816. Elle meurt le 11 décembre 1817, à 31 ans, des suites d'un accouchement. Son coeur est placé dans la crypte de la famille d'Ornano au cimetière du Père Lachaise, à Paris, et son corps est ramené en Pologne. Elle était blonde, elle avait les yeux bleus et la peau d'une blancheur éblouissante; elle n'était pas grande, mais parfaitement bien faite et d'une tournure charmante. Une teinte légère de mélancolie, répandue sur toute sa personne, la rendait plus séduisante encore. Sa vie Marie naît le 7 décembre 1786 à Brodno, village proche de Kiernozia en pologne. La première enfance de Marie fut heureuse, bien que souvent solitaire. Après la mort de son père, son enfance est marquée par le précepteur engagé par sa mère, Eva ; c'est un Français venu en Pologne sept ans plus tôt, Nicolas Chopin, le père de Frédéric. De 1795 à 1802, il éduque Théodore et Marie, puis les deux autres filles, Antonine et Honorée, avant d'entrer au service d'une famille amie des Laczynski, la famille Skarbek. À cette époque, de nombreux jeunes gens quittent le pays pour s'engager dans l'armée de Bonaparte, en particulier les Légions polonaises formées à Mantoue sous le commandement du général Jean-Henri Dombrowski. C'est d'ailleurs le cas du frère aîné de Marie, Benoît Benedykt, qui deviendra général en 1804 Théodore, deviendra colonel de l'armée française. Un peu avant son quatorzième anniversaire, Marie part pour le couvent Notre-Dame de l'Assomption à Varsovie, où les jeunes filles de bonne famille étaient envoyées pour y compléter leur éducation. Marie fut heureuse dans cette vie nouvelle. Marie est intelligente et studieuse, avec une douceur de caractère qui l'a fait aimer par tous ici écrivait la supérieure à sa mère, Ewa Laczynska, à la fin de la scolarité de la jeune fille. Marie était aussi devenue d'une grande beauté. Il n'y avait qu'une voie qui pouvait apporter à une fille fortune et honneur : un riche mariage avec un homme bien né. Mariage Elle est mariée en 1804 - à 17 ans - au comte et chambellan Anastazy Walewski, un grand noble polonais presque septuagénaire. La jeune femme rêve d'une Pologne libre, et nourrit une haine virile du Russe qui occupe la Mozavie, ce lambeau de Pologne où elle est née, à quelques lieues de Varsovie, mais aussi du Prussien et de l'Autrichien qui se sont partagés le reste du pays. C'est en Pologne, en 1805, qu'elle donne naissance à son premier fils, Antoine6. Napoléon À l'automne 1806, Napoléon Ier occupe le territoire polonais. Les Polonais l'attendaient comme le Messie. Le champion de la liberté, se devait de libérer la Pologne. Les Walewski Walewscy, eux aussi voient en lui un libérateur, et s'installent à Varsovie pour mieux s'intégrer à l'enthousiasme ambiant. Marie s'abandonna à une fiévreuse agitation, travaillant avec les dames de Varsovie à organiser des hôpitaux, des ambulances, des stations de premier secours. Elle est également introduite dans la haute société, mais la vie mondaine l'intéresse peu. C'est le 1er janvier 1807, lors du passage de l'empereur au relais de Blonie, que Marie Walewska aurait rencontré Napoléon pour la première fois. Un bal fut organisé par Talleyrand, ministre français des relations extérieures, devait marquer à Varsovie l'ouverture du carnaval et la plus brillante réception que la capitale dévastée eût vue depuis Stanislas-Auguste. Un bref paragraphe apparut dans le journal officiel, la gazette de Varsovie : Sa majesté l'Empereur a assisté à un bal chez le ministre des relations extérieures, le Prince de Bénévent, au cours duquel il a invité à une contredanse la femme du chambellan Anastase Walewski. À midi, le lendemain, une voiture s'arrêta devant l'hôtel des Walewski. Duroc, le grand maréchal du palais, en descendit, portant un gigantesque bouquet de fleurs et une lettre sur un épais parchemin, fermée du sceau vert impérial. " Je n'ai vu que vous, je n'ai admiré que vous, je ne désire que vous. … N " Marie fit répondre à Duroc qu'il n'y aurait pas de réponse. D'autres lettres enflammées suivirent… Les allées et venues de Duroc allaient attirer l'attention, et nombre de gens venaient donner des conseils à Marie. Elle avait été distinguée par le destin. Elle avait été choisie pour sauver la Pologne. Le chef de famille Laczynski - soldat modèle de l'empereur - lui donnait sa bénédiction. Elle finit par accepter, avec l'accord de son mari de devenir sa maîtresse. Ils poursuivent leur liaison au château de Finckenstein en Prusse-Occidentale. L'idylle printanière du couple d'avril à juin dans le lointain château de Finckenstein est un moment unique et entièrement inattendu dans la vie de Napoléon, une période qui le vit déployer ce qu'un historien de cette période de sa vie appela une énergie miraculeuse. Pour Marie, la décision de rejoindre l'Empereur à Finckenstein était un acte de suprême courage et le risque couru énorme. Les deux amants sont très épris l'un de l'autre et l'empereur va dès lors organiser sa vie de façon à consacrer du temps à ses amours, chose qu'il n'avait pas faite depuis Joséphine de Beauharnais. Dans l'intimité Marie, avec son doux entêtement polonais, ramène la conversation sur son idée fixe : la résurrection de la Pologne. Patiemment Napoléon discute avec elle sans toutefois s'engager. Ses arguments sont toujours les mêmes : que les Polonais fassent preuve de cohésion, de maturité, qu'ils soutiennent militairement sa lutte contre la Russie, et ils seront récompensés selon leurs mérites. Son obstination finira par aboutir : Napoléon crée le Duché de Varsovie 1807-1815, qui disparaîtra peu après la défaite de la campagne de Russie en 1812-1813. C'était en fait un compromis pour ne pas déplaire au tsar, mais une réponse terriblement faible à l'attente de milliers de soldats polonais morts pour l'empereur. Naissance d'Alexandre Le 4 mai 1810, à 4 heures de l'après-midi, Alexandre, comte Walewski, un bel enfant robuste, ouvrit les yeux sur un monde dans lequel il allait connaître une carrière brillante et tumultueuse. Je suis né au château Walewice en Pologne, écrira 35 années plus tard dans ses mémoires le futur ministre des affaires étrangères de Napoléon III. Mgr Anastazy Walewscy, Anastase de Walewski - âgé de 73 ans - déclara qu'il était issu de son mariage avec Marie née Łączyńska - âgée de 23 ans. Napoléon apprend la naissance de son fils au cours d'un voyage triomphal en Belgique avec sa jeune épouse, Marie-Louise d'Autriche. Il fait parvenir des dentelles de Bruxelles et 20 000 francs en or pour Alexandre. Le 5 mai 1812 , à Saint-Cloud, en présence de Marie, Napoléon signa un long document juridique garantissant l'avenir du jeune Alexandre. La dotation consistait en 60 fermes aux environs de Naples, d'un revenu annuel de 169 516 francs 60 centimes. Les armoiries conférées par les lettres patentes en même temps que le titre de comte de l'Empire étaient un mélange des blasons Walewski et Laczynski. Séparation et divorce D'après les règles de la communauté de biens de son mariage, les revenus de la dotation du jeune Alexandre, pendant sa minorité, couraient le risque d'être engloutis dans l'avalanche de dettes du vieux chambellan. Le 16 juillet 1812 le couple passa un acte dans lequel Marie déclarait son intention de se séparer légalement de son mari et se chargeait d'assumer la responsabilité financière de ses deux fils (Antoine et Alexandre). La Comtesse Walewska bénéficiait des dispositions récemment introduites par le Code Napoléon qui facilitait le divorce. Le 24 août le mariage était dissous — un temps étonnamment court pour qu'un tribunal rendît une décision. Si Marie était légalement libre, son éducation catholique comme la tradition la contraignirent, aussi longtemps que vécut le chambellan (2 ans et demi), à le considérer comme son mari. Vie en France L'année 1813 trouva Marie de retour à Paris, installée rue de la Houssaye avec ses deux fils, son frère Théodore et sa sœur Antonia. Grâce à la généreuse dotation de Napoléon, la comtesse Walewska était maintenant une femme riche. Marie et son fils Alexandre rendirent visite à Napoléon en exil à l'île d'Elbe du 1er au 3 septembre 1814 en compagnie d'Emilia et de Teodor Émilie et Théodore, sœur et frère de Marie. Second mariage Veuve en 1814 de son premier mari, elle consent à épouser le 7 septembre à Sainte-Gudule Bruxelles 1816 le comte Philippe Antoine d'Ornano, cousin éloigné de Napoléon et général d'empire. En janvier 1817, Marie qui attendait un enfant décida de se rendre en Pologne pour consulter son vieil ami, éminent gynécologue, le Dr Ciekierski. Il diagnostiqua une maladie des reins : toxémie aiguë aggravée par la grossesse. La fin de sa vie semble proche. Au cours de l'été, étendue sur une chaise longue dans le jardin de sa maison à Liège, la comtesse d'Ornano dicta à son secrétaire, ce qui est supposé être ses Mémoires. Sa liaison avec l'empereur y est décrite comme un sacrifice fait à son pays. Décès À 7 heures du soir, le 11 décembre 1817, le cœur de Marie Walewska cessa de battre. Elle avait 31 ans et 4 jours. Toute la maison était plongée dans un vrai désespoir, racontera Alexandre Walewski des années plus tard. … Ma mère était l'une des femmes les plus remarquables qui eût existé. Testament Dans son testament, Marie exprima le désir que son cœur reste en France mais que son corps soit transporté en Pologne dans le caveau familial de Kiernozia. Conformément à ce vœu, une urne contenant son cœur repose aujourd'hui au cimetière du Père-Lachaise dans le caveau des d'Ornano 67e division, portant la simple inscription : Marie Laczynska, comtesse d'Ornano … et le corps fut emmené en Pologne 4 mois plus tard. Regards des contemporains Sous la plume de Madame de Kielmannsegge : " J'eus peu de rapports avec Mme Walewska … Elle n'était pas précisément grande, mais elle avait la taille bien prise, les cheveux blonds, le teint clair, la figure pleine, un sourire extrêmement agréable et un timbre de voix qui la rendait sympathique aussitôt qu'elle parlait ; modeste et sans prétention, très réservée dans ses gestes et toujours très simple dans sa toilette, elle avait comme femme tout ce qu'il faut pour plaire et être aimée. Napoléon évoquant Marie Walewska : "Une femme charmante, un ange ! C'est bien d'elle qu'on peut dire que son âme est aussi belle que sa figure !… " Lettre de Napoléon Ier à Marie Colonna Walewska, à Varsovie, le mercredi 28 janvier 1807 : "Madame, vous étiez triste lundi au cercle, cela m'a peiné... Je vous ai écrit deux fois mais tout le monde est parti, et mes lettres ne vous sont pas arrivées... Je désire, Marie, vous voir ce soir à huit heures. Allez chez votre amie, celle dont vous m'avez parlé. Une voiture viendra vous y prendre... J'espère et j'ai besoin de vous dire ce soir tout ce que vous m'inspirez et toutes les contrariétés que j'ai éprouvées ... Mille baisers sur les lèvres de ma Marie. ce mercredi 28 à 11 heures du matin." Marie se montre rétive mais Napoléon n'est pourtant pas un homme qu'on décourage : "Je veux, entends-tu bien ce mot, s'écrie-t-il avec violence, je veux te forcer à m'aimer ! J'ai fait revivre le nom de ta patrie : sa souche existe encore, grâce à moi. Je ferai plus encore. Mais songe que, comme cette montre que je tiens à la main et que je brise à tes yeux, c'est ainsi que son nom périra, et toutes tes espérances, si tu me pousses à bout en repoussant mon coeur et me refusant le tien." Sa forte voix résonne, durcie par l'accent qui revient dans tous ses moments d'émotion. Marie demeure immobile et muette, mais quand il jette sa montre sur le parquet et l'écrase du talon, ses nerfs s'affaissent, elle s'évanouit. Lorsqu'elle retrouve ses sens, au visage anxieux de Napoléon, aux mots qu'il murmure, elle comprend qu'il a abusé de sa défaillance sic. Cette vilenie, il l'a accomplie comme poussé par un instinct sauvage. Maintenant il la regrette et, devant ces yeux désespérés, il a peur. Elle le repousse avec horreur et sanglote longuement. Heure lourde et triste où l'homme reste décontenancé, muet devant sa captive." Hommages En 1937, Greta Garbo interprète le rôle de Marie Walewska dans le film Marie Walewska, Conquest, en anglais qui retrace sa vie. Chanson : Serge Lama, Marie La Polonaise Marie Walewska vient en visite à l'île d'Elbe avec son fils Alexandre. Ils débarquent sur l'île le 1r septembre 1814 et passent les journées des 2 et 3 à la Madona des Monte en compagnie de l'Empereur. Extraits de NAPOLÉON empereur de l'île d'Elbe - Souvenirs & Anecdotes de Pons de l'Hérault, Les Éditeurs Libres 2005 La visite de Marie Walewska Récit 1 En réalité Marie Walewska débarqua à San Giovanni face à la rade de Portoferraio le 01-09-1814 dans la soirée. Elle quitta la Madonna Del Monte à Marciana le 3 septembre dans la soirée, en pleine tempête. L'embarquement prévu initialement à Marciana Marina ne put avoir lieu vu cette tempête et finalement c'est dans l'anse de Mola Porto Longone devenu en 1947 Porto Azzuro qu'elle reprit la mer malgré les craintes de son entourage, mais c'était "un ordre de l'Empereur"! Les avis divergent quant au fait que Napoléon tenta de la rejoindre en chevauchant dans la nuit. Il semble plutôt que ce soit l'officier d'ordonnance Carlo PERES qui fut chargé de cette mission, qu'il ne remplit point... Les Elbois croyaient qu'il s'agissait de l'Impératrice et s'agitaient quelque peu: on leur cachait quelque chose, car ils avaient bien vite repéré ce navire qui état venu mouiller dans l'anse de San Giovanni et les commentaires allaient bon train. Bien que Marie s'offrit même à rester à l'île d'Elbe discrètement, il ne voulut pas. Il semble qu'il craignait les rumeurs: alors qu'il n'omettait jamais de dire dans son entourage que son épouse et son fils lui manquaient, tout le monde allait savoir qu'il s'agissait de sa maîtresse polonaise... ce que les espions n'allaient pas manquer de rapporter à qui de droit. A ce moment là, en septembre 1814, je crois qu'il espère encore l'arrivée de Marie-Louise et de l'Aiglon. Donc, pour le départ rapide, comme je l'ai écrit: c'était un ordre de l'Empereur! On peut découvrir à l'île d'Elbe l'être humain avec ses craintes, ses hésitations, ses remords et ses doutes. Il n'osa pas rentrer directement à Porto Ferraio la peur d'être interpellé. et résida quelques temps à Porto Longone. Il ne revint plus à la Madonna Del Monte, le charme était rompu. Il ne fut jamais aussi Humain que dans cette île. L'endroit de l'arrivée: "A 09.30 heures, comme la nuit tombait, le bateau jeta l'ancre dans le petit port de San Giovanni, une baie écartée de l'autre côté de Portoferraio" Marie Walewska, le Grand Amour de Napoléon. "...à un tournant du chemin, exactement à Proccio, les voyageurs qu'escortaient les palefreniers porteurs de torches, aperçurent une lanterne et derrière elle un cavalier... Le bateau a jeté l'ancre dans la baie, hors du port. Marie admire du pont la blanche ville de Portoferraio..." Marie Walewska l'épouse polonaise de Napoléon, Comte d'Ornano "Tout à coup, la population matinale s’écria : « L’Impératrice et le Roi de Rome sont arrivés » et aussitôt la population entière fut debout. On m’envoya un exprès pour m’instruire de ce grand évènement, j’accourus à Porto-Ferrajo. Les officiers de la Garde avaient la tête à l’envers ; ils voulaient que l’Impératrice et le Roi de Rome restassent à l’île d’Elbe. Le commandant Malet me priait de rédiger une adresse raisonnée pour signifier cela à l’Empereur. Les Porto-Ferrajais voulurent en faire autant ; l’intendant me demanda s’il devait consentir à cette démarche. Le général Drouot évitait de se montrer en public. Le vrai était que Mme la comtesse Walewska et son fils avaient débarqué à Marciana, que Mme la comtesse Walewska avait à peu près l’âge de l’Impératrice, autant de noblesse que l’Impératrice, que l’enfant avait aussi à peu près l’âge du Roi de Rome, qu’il était mis comme le Roi de Rome. l’erreur était facile ; elle fut complète. Mme la comtesse Walewska se plut à la laisser exister, même elle la sanctionna, car elle faisait répéter à son fils les paroles que la renommée attribuait au Roi de Rome. C’était le rapport des marins dans le bâtiment desquels Mme la comtesse Walewska était venue à l’île d’Elbe avec son fils. Aussitôt que Mme la comtesse Walewska fut arrivée à la tente de l’Empereur, l’Empereur ne reçut plus personne, pas même Madame Mère, et l’on peut dire qu’il se mit en grande quarantaine. Son isolement fut complet. … Mme la comtesse Walewska et son fils restèrent environ cinquante heures auprès de l’Empereur." Le 1er septembre 1814, la comtesse Walewska, sa soeur, Émilie Laczinska et Alexandre, fils de l’empereur débarquèrent à l’île d’Elbe. Louis Marchand précise que le frère de la comtesse, le colonel Teodor Laczinski, accompagnait ces dames et l’enfant. Il ajoute que dans l’île, on crut que c’était l’impératrice et le Roi de Rome, les têtes s’en montèrent . «Mme Walewska avait dû être, dans son jeune âge, une fort belle personne. Bien qu’ayant, lors de son voyage à l’île d’Elbe, la trentaine, elle était née en 1786 et s’éteignit en 1817, après avoir épousé en secondes noces le général d’Ornano et peut-être quelque chose de plus, elle était encore fort bien. Ce qui la déparait un peu, c’était quelques petites places sanguines, ou rougeurs, qu’elle avait dans la figure. Du reste elle était très blanche et d’un coloris qui annonçait une belle santé. Elle était de belle taille, avait un embonpoint raisonnable. Elle avait une fort belle bouche, de beaux yeux, les cheveux châtain clair ; elle avait l’air fort douce et paraissait être une excellente personne. … Le jeune Walewski était gentil garçon, déjà grandelet, la figure un peu pâle ; il avait quelque chose des traits de l’empereur. Il en avait le sérieux. Né en 1810, il a alors quatre ans. Il décèdera en 1868, après une carrière publique bien remplie, ambassadeur et ministre des Affaires étrangères sous le Second Empire La visite de Marie Walewski à l'ile d'Elbe Récit 2 ...Une visite inopinée va troubler cette quiétude. exceptionnelle dans l'existence de Napoléon. Au cours de la nuit du 1er septembre, un navire entre en rade de Porto Ferrajo mais, au lieu de gagner le port, mouille dans une crique au fond du golfe. Bertrand prévenu accourt, salue profondément la jeune femme et l'enfant qui débarquent, fait atteler une calèche et seller les chevaux. Les voyageurs disparaissent aussi mystérieusement qu'ils sont venus. En ville le bruit se répand de l'arrivée de l'Impératrice et du Roi de Rome. Quelques heures plus tôt, au crépuscule, Napoléon avait suivi à la lunette l'approche du bâtiment. Dès qu'une estafette de Bertrand lui apprend l'accostage, il la renvoie avec ses ordres et saute lui-même à cheval. Précédé de quatre porteurs de torches, il descend de son nid d'aigle. La rencontre des deux groupes se fera au milieu de la nuit, le long de la mer, près de Marciana Marina. Napoléon prend la place de Bertrand dans la calèche et, tout en jouant avec les boucles blondes de l'enfant, s'enquiert affectueusement du voyage. Avant l'aube, tout le monde atteint enfin l'Ermitage, Napoléon a cédé sa chambre et fait dresser une tente devant la maison. Mais Ali, son valet de chambre, le voit furtivement la quitter aussitôt : Marie Walewska passe avec lui une dernière nuit... Certes, les temps de l'idylle polonaise sont révolus. L'amour de l'Empereur est mort, celui de Marie subsiste-t-il ? Pendant les quatre années du règne de Marie-Louise il l'a rarement revue. A Fontainebleau, après l'abdication, elle a vainement attendu une nuit devant sa porte, il ne l'a pas reçue. A l'île d'Elbe, elle lui a écrit plusieurs fois, gagnant par petites étapes la côte toscane, sollicitant la permission de venir. Il la lui accorde enfin et elle accourt, peut-être avec l'espoir de rester auprès de lui. C'est mal le connaître. Informé quelques heures plus tard de la rumeur publique, il en conçoit un vif mécontentement. Ainsi, malgré les précautions prises, les Elbois sont déjà persuadés que sa femme et son fils l'ont rejoint. Il désire éviter que le Cabinet autrichien ne tire parti de cette visite pour inciter Marie-Louise à ajourner encore sa venue. Il ne veut surtout pas, lui si strict pour les autres, que sa conduite soit un objet de scandale quand la vérité éclatera. Marie Walewska sera donc une fois de plus sacrifiée au devoir conjugal et aux obligations d'Etat. Il ne le lui dit pas tout de suite. Le matin, il l'emmène jusqu'à son rocher ; au déjeuner, il s'esquive pour sa visite quotidienne à Madame Mère - la famille avant tout. Le soir, il dîne sous la tente avec la jeune femme et les officiers polonais de la Garde. On improvise des danses, les chants slaves s'élèvent de la terre latine. Marie espère, Marie est heureuse. Le lendemain, informée par le trésorier Peyrusse de la détresse financière de l'Empereur, elle veut restituer le collier de perles qu'il lui offrit jadis à la naissance d'Alexandre, mais il refuse avec émotion et la prie doucement de partir le soir même. Puis il disparaît toute la journée et ne la reverra que pour les adieux. Rien ne manque à cet épisode, ni le cadre exceptionnel où il se déroula, ni son dénouement romantique. Avec la nuit la tempête s'est levée, la pluie tombe en rafales. Marie, transie, serrant son enfant contre elle, tente de s'embarquer à Marciana. Le risque est trop grand. Son navire ira l'attendre à Porto Longone, à l'autre extrémité de l'île. De longues heures elle peine sur les mauvais chemins transformés en torrents. dans la nuit traversée d'éclairs. Lorsqu'elle atteint son but, on veut encore la dissuader. Trop fière elle s'obstine, saute dans une barque et, courant mille périls. gagne l'échelle de coupée. Le vaisseau s'éloigne, elle ne reverra Napoléon que furtivement à l'Elysée et à Malmaison. quelques mois plus tard. Lui, pendant ce temps, saisi de remords et d'angoisse, dépêche un officier d'ordonnance pour ajourner l'embarquement, puis de plus en plus inquiet, saute à cheval et galope jusqu'à Longone, où il arrivera trop tard. Au matin, accablé, frissonnant, il regagne l'Ermitage, mais le charme est rompu. Deux jours plus tard, il le quittera à son tour pour n'y plus revenir." Le départ de Marie Walewska Une espèce d’ouragan bouleversait le ciel et la terre. On craignait pour les bâtiments qui se trouvaient affalés sur la côte de Toscane. Néanmoins, ce fut en ce moment que Mme la comtesse Walewska quitta l’Empereur pour retourner sur le continent. Une barque attendait Mme la comtesse à Longone. Toutefois, à peine avait-elle quitté Marciana, que l’Empereur, justement effrayé de la fureur toujours croissante du vent, fit monter à cheval l’officier d’ordonnance Pérez, et lui ordonna d’aller l'empêcher de partir sous quelque prétexte que ce pût être. Mais ce Pérez, tout officier d’ordonnance que l’Empereur l’avait fait, était le sot des sots : sans cœur, sans âme, et incapable de s’inquiéter du danger qui menaçait Mme la comtesse Walewska, il ne songea qu’à s’abriter lui-même. Mme la comtesse Walewska était en pleine mer lorsque ce franc malotru arriva à Longone. Les autorités et les marins de Longone avaient fait tout ce qu’il leur était possible de faire pour que Mme la comtesse Walewska ne mît pas à la voile. Mais, résolue, elle repoussa tous les conseils et elle affronta la destinée. L'Empereur eut des heures d’angoisse. Il lui fut impossible d’attendre le retour de son officier d’ordonnance. Il se rendit de sa personne au lieu où Mme la comtesse Walewska devait s’embarquer. Il était trop tard. Ses alarmes durèrent jusqu’au moment où Mme la comtesse Walewska lui eut appris elle-même que le péril était passé. Merci au général Bertrand Lien http://www.ina.fr/video/CPF86618423/marie-walewska-video.html Decaux et castelot         
#4143
Léon Minkus
Loriane
Posté le : 06/12/2014 18:04
Le 7 décembre 1917 meurt Ludwig Aloisius Minkus, dit Léon Minkus
en russe Людвиг Минкус ; il a alors 91 ans, né le 23 mars 1826, compositeur, violoniste, pédagogue autrichien de musique de ballet, un violoniste virtuose et un professeur de violon. Minkus est surtout connu pour les partitions qu'il a composées en tant que compositeur de ballets des Théâtres impériaux de Saint-Pétersbourg, pour lesquels il écrivit des œuvres originales et des reprises à l'intention des maîtres de ballet Marius Petipa et Arthur Saint-Léon. Ses compositions les plus célèbres sont La Source (avec Léo Delibes, 1866, Don Quichotte 1869 et La Bayadère 1877. Il a également écrit des passages destinés à être insérés dans des ballets existants. Parmi ceux-ci le Grand pas classique, le Pas de trois et la Mazurka des enfants, écrits pour la reprise par Petipa, en 1881, du ballet Paquita. De nos jours, la musique de ballet de Minkus est une des plus connues et elle est interprétée par toutes les compagnies de ballet. Elle fait également partie intégrante du répertoire du ballet classique traditionnel. En bref Tout comme les chorégraphies elles-mêmes, les œuvres écrites par Minkus connaissent de nombreuses modifications avec le temps. C'est là tout le paradoxe de sa musique : indissociable du ballet qu'elle supporte, elle n'en est pas pour autant immuable. Certaines pages seront ainsi transformées, voire réécrites selon les besoins des chorégraphes (la Bayadère, 1904, A.Gorski ; 1980,M. Makarova, ce qui conduira R. Noureev à vouloir en retrouver la partition originale en 1992. D'autres seront extraites de leur contexte comme morceau de bravoure pour les danseurs, second pas de deux de Don Quichotte ; acte des "Ombres" de la Bayadère. Ces libertés ne font que prolonger une pratique courante à son époque : Minkus apporte lui-même diverses modifications aux œuvres d'autres compositeurs comme le grand pas de dix qu'il compose pour Paquita en 1881 ou ses ajouts à la partition du Corsaire en 1899 qui subsisteront dans la plupart des versions ultérieures. Plutôt que source d'inspiration, sa musique agit comme un soutien au mouvement, Petipa ayant l'habitude de construire sa chorégraphie avant d'en commander la musique. Compositeur au service de la danse, Minkus est exemplaire d'une époque qui touche à sa fin avec l'arrivée de Tchaïkovski. Moins inspiré que celui-ci, sa musique lui survit toutefois durablement à travers les ballets qui sont restés au répertoire : Don Quichotte, la Bayadère et, incidemment, Paquita et le Corsaire. Sa Vie Léon Minkus, de son patronyme complet Aloysius Bernhard Philipp Minkus, est né le 23 mars 1826 à Innere Stadt à Vienne, un arrondissement de Vienne. Son père, Theodor Johann Minkus, est né en 1795 à Groß Meseritsch en Moravie, actuellement situé en République tchèque sous le nom de Velké Meziříčí. Sa mère, Maria Franziska Heimann, est née à Pest Hongrie en 1807. Minkus était d'origine juive mais ses parents se sont convertis au catholicisme peu avant d'émigrer à Vienne et se sont mariés le jour suivant. Les raisons de cette conversion ne sont pas très claires mais il semble que ce soit le seul moyen de s'établir dans la capitale impériale à cette époque. Le père de Minkus est un grossiste en vins pour la Moravie, l'Autriche et la Hongrie. Il ouvre un restaurant, animé par son propre orchestre, dans l'arrondissement d'Innere Stadt. Ce fait pourrait avoir influencé le jeune Minkus - il est possible qu'il ait composé Tanzkapelle pour l'orchestre de son père, une des nombreuses formations de la capitale impériale. Il s'initie au violon vers l'âge de quatre ans et commence des études musicales à la Gesellschaft der Musikfreunde de Vienne. Le violoniste fait ses débuts devant le public viennois à l'âge de huit ans. Le 18 octobre 1845, une publicité concernant les représentations de la saison précédente et parue dans le journal viennois Der Humorist, définit ainsi le jeu caractéristique de Minkus : un style classique doublé d'une exécution brillante . Le jeune Minkus se produit bientôt dans des salles de concert en soliste. Il est qualifié d'enfant prodige à la fois par le public et par les critiques. Minkus commence à composer pour le violon alors qu'il est toujours étudiant. Cinq pièces pour cet instrument sont publiées en 1846. Minkus s'essaye à la direction d'orchestre dès cette époque. Il est le chef en titre d'un orchestre qu'il complète en lui incorporant celui dirigé par le jeune Johann Strauss II des années plus tard, Strauss fera la connaissance d'Eugen Minkus, directeur d'une banque viennoise et frère de Ludwig. La biographie de Léon Minkus de 1842 à 1852 est peu documentée. Des demandes de visas pour visiter l'Allemagne, la France et l'Angleterre sont retrouvées mais rien ne dit qu'elles aient abouti. En 1852, Minkus accepte le poste de premier violon au sein de l'Opéra de la Cour de Vienne mais, en raison de son peu d'empressement pour remplir les conditions exigées par sa charge, il part, cette même année, pour une importante mission musicale à l'étranger. Mission qui bouleversera le cours de sa vie à tout jamais. En 1853, Minkus épouse Maria Antoinette Schwarz, née à Vienne en 1838, en l'église catholique de Sainte-Catherine à Saint-Pétersbourg. Après trente neuf années passées en Russie, Minkus et sa femme quittent définitivement la Russie dans le courant de l'été 1891 pour leur Vienne natale. Le compositeur, en semi-retraite, vit chichement d'une modeste pension que lui verse le Trésor du Tsar. Il habite pendant quelque temps Karl Léon Strasse, dans un appartement du troisième étage que lui loue son ami Theodor Leschetizky, professeur de piano et pianiste réputé. Après le décès de sa femme survenu en 1895, Minkus déménage dans un appartement situé à Gentzgasse où il passera le reste de sa vie seul et dans une extrême indigence, les rumeurs de la Première Guerre mondiale ayant interrompu le versement de la pension que lui alloue le tsar. Une pneumonie contractée au cours d'un hiver particulièrement froid l'emporte le 7 décembre 1917 à l'âge de quatre-vingt onze ans, sans descendance et assisté par sa nièce Clara von Minkus. Minkus est enterré au cimetière Döblinger de Vienne. Sa sépulture est détruite en 1939 par la police nationale-socialiste à l'époque où toutes les tombes de personnes ethniquement indésirables particulièrement les descendants de Juifs ou pour qui les taxes annuelles du cimetière n'ont pas été acquittées sont nettoyées. Ses ossements, exhumés, ont été transférés dans une fosse commune. Carrière La Russie En 1853, Minkus émigre à Saint-Pétersbourg comme chef de l'orchestre du prince Nikolaï Youssoupoff, poste que Minkus occupe jusqu'en 1855. De 1858 à 1861, Minkus est premier violon au théâtre impérial Bolchoï de Moscou. Il se voit rapidement confier le poste de chef d'orchestre et premier violon de l'Opéra impérial italien de Saint-Pétersbourg. En 1861 Minkus est maître des concerts au théâtre Bolchoï puis Inspecteur des Orchestres des Théâtres impériaux à Moscou. Il enseigne conjointement le violon au tout nouveau Conservatoire de Moscou. Minkus compose L′Union de Thétis et Pélée qui paraît être sa première composition pour un ballet à l'occasion d'une représentation privée au palais Ioussoupov en 1857. Au cours de son contrat avec le théâtre impérial Bolchoï Minkus a composé une autre musique pour le ballet en un Acte intitulé Deux jours à Venise et produit en 1862. Un peu plus tard au cours de la même année, il est convié à composer un Entr'acte pour le ballet Orfa monté par Arthur Saint-Léon et chorégraphié par Jean Coralli sur une musique d'Adolphe Adam. Saint-Léon était un des maîtres de ballet les plus en vue et, depuis 1860, il occupait le poste de premier maître de ballet des Théâtres impériaux à Saint-Pétersbourg, position qui l'obligeait également à monter des œuvres pour le ballet de Moscou. Au mois de mars 1863, Saint-Léon mandate Minkus pour composer entièrement la musique du ballet en trois actes La Flamme d′amour ou la Salamandre que le maître de ballet destine à la prima ballerina Marfa Muravieva. L'avant-première du ballet qui a lieu le 24 novembre/12 novembre 1863 au théâtre Bolchoï de Moscou, est un franc succès. Saint-Léon montera à nouveau le ballet pour Muravieva à Saint-Pétersbourg sous le titre Fiammetta ou l'Amour du diable dont la première est interprétée le 25 février/13 février 1863 au théâtre impérial Bolchoï Kamenny. Minkus accompagnera Saint-Léon à Paris pour présenter une version de l'œuvre réduite à deux actes à l'Opéra impérial de Paris avec, à nouveau, Muravieva dans le rôle principal et la ballerine Eugénie Fiocre dans celui de Cupidon. L'avant-première a lieu le 11 juillet 1864 sous le nouveau titre Néméa ou l'Amour vengé et restera inscrit au répertoire de l'Opéra de Paris jusqu'en 1871, période au cours de laquelle il sera représenté cinquante trois fois. Le 15 mars 1868 a lieu l'avant-première au Teatro communale de Trieste sous le titre, une fois de plus changé, de Nascita della fiamma d'amoure (Naissance de la flamme d'amour. Les changements réitérés du titre ont semé le trouble parmi les historiens. Plusieurs d'entre eux ont décrété qu'il s'agissait d'œuvres totalement différentes. À la fin de l'année 1866, Saint-Léon est pressenti pour produire une nouvelle œuvre à l'Opéra impérial de Paris. Il y monte La Source dont la musique est composée par Minkus en collaboration avec Léo Delibes. Minkus écrit l'acte I et le second tableau de l'acte III, et Delibes la totalité de l'acte II et le premier tableau de l'acte III. Les documents actuellement en notre possession ne permettent pas de connaître la raison de cette division des tâches. L'avant-première de La Source a lieu le 12 novembre 1866. Elle restera inscrite au répertoire de la compagnie jusqu'en 1876 et sera interprétée soixante-treize fois. Saint-Léon travaillera avec Minkus tout au long des années 1860. Le 1er décembre 1866 20 novembre il présente le Le Poisson doré à Peterhof en l'honneur du mariage d'Alexandre Alexandrovich Romanov avec la princesse Maria Feodorovna, Dagmar de Danemark. Saint-Léon choisit un thème russe basé sur un poème intitulé Le Conte du Pêcheur et du Petit Poisson en russe : Skazka o rybake i rybke écrit par Alexandre Pouchkine en 1835. Avec Minkus, Sant-Léon étoffe Le Poisson doré pour en faire un Grand Ballet en trois actes qu'il présente en avant-première le 20 novembre/8 novembre 1867 pour l'ouverture de la saison 1867-1868 des Ballets impériaux. La saison suivante, Minkus et Saint-Léon produisent Le Lys, un ballet tiré d'une légende chinoise intitulée Les Trois Flèches et construit sur une musique proche de celle de La Source. L'avant-première a lieu le 2 novembre/21 octobre 1869 au théâtre Bolchoï Kamenny avec la ballerine Adèle Grantzow dans le rôle principal. En dépit des efforts de Saint-Léon, aussi bien Le Lys que la version étoffée du Poisson doré sont un échec cuisant. De ce fait, le directeur des Théâtres impériaux ne reconduit pas le contrat du maître de ballet qui émigre alors à Paris où il décède en 1870. L'association avec Saint-Léon est bénéfique à Minkus qui est remarqué par le déjà renommé chorégraphe Marius Petipa. Petipa arrive dans la capitale impériale en 1847 comme premier danseur des Théâtres impériaux et comme assistant du maître de ballet Jules Perrot qui sera premier maître de ballet de 1850 à 1859. Petipa est promu second maître de ballet après le succès de son grand ballet La Fille du pharaon qu'il chorégraphie sur la partition du compositeur italien Cesare Pugni. Pugni a le titre de compositeur de ballet des Théâtres impériaux de Saint-Pétersbourg depuis 1850, poste spécialement créé à son intention lorsqu'il accompagne Perrot en Russie cette année-là. Vers le milieu des années 1860, le compositeur touche au terme de sa vie et de sa carrière prolifique. À la fin de la décennie, peu fiable du fait de son alcoolisme sévère, sa musique devient d'une qualité de plus en plus médiocre. Saint-Léon et Petipa se détournent progressivement de lui au profit de Minkus. Petipa monte un Grand Ballet intitulé Don Quichotte, basé sur le Don Quichotte de Cervantes, pour la saison 1869-1870 du théâtre impérial Bolchoï de Moscou. Bien que le projet soit chorégraphié sur une musique de Pugni, Petipa se tourne vers Minkus qui compose une partition truffée d'une grande variété de thèmes hispanisants. L'avant-première du 26 décembre/14 décembre 1869 connaît un succès retentissant. L'œuvre devient célèbre dans le répertoire du ballet classique. Petipa est nommé premier maître de ballet des Théâtres impériaux de Saint-Pétersbourg peu avant le décès de Sant-Léon. Au mois de janvier 1870, le compositeur Cesare Pugni, principal collaborateur de Petipa, décède alors que ce dernier monte une reprise de son Don Quichotte pour les ballets impériaux de Saint-Pétersbourg. À cette occasion, Minkus revoit entièrement l'œuvre qu'il développe. L'avant-première de cette version, interprétée le 21 novembre/9 novembre 1871, devient un classique et vaut maints éloges à Minkus pour son efficace musique. Ces éloges valent à Minkus le poste de Compositeur de ballet des Théâtres impériaux de Saint-Pétersbourg et marquent le début d'une fructueuse collaboration avec Petipa. Après le succès du ballet, Minkus et Petipa montent en 1872, La Camargo ; en 1874, une version développée du Papillon de Jacques Offenbach ; en 1875, Les Aventures de Pélée et Thétis ; en 1876, Le Songe d'une nuit d'été sur la musique de Felix Mendelssohn de 1843 et enfin, en 1877, La Bayadère qui sera leur œuvre la plus durable et la mieux conservée. Tout au long de cette période, Minkus continue à jouer du violon à titre professionnel. C'est ainsi qu'il est second violon lors de l'interprétation, en avant-première, du Quatuor pour cordes n° 1 en do majeur de Tchaïkovski le 28 mars 1871 à Moscou. Les partitions de Minkus comprennent des passages spécialement écrits pour l'illustre Leopold Auer. Minkus écrit la musique du somptueux ballet de Petipa intitulé Nuit et jour et interprété au théâtre impérial Bolchoï de Moscou pour le couronnement de l'empereur Alexandre III de Russie. Ce dernier, balletomane acharné, décore le compositeur de l'Ordre de Saint-Stanislas pour récompenser sa partition musicale. Au cours de la cérémonie, le nouvel empereur s'adresse à Minkus en ces termes : ... Vous avez atteint la perfection en tant que compositeur de ballets. Les Pilules magiques, ballet de Petipa dont l'avant-première a lieu le 21 février/9 février, est monté pour l'inauguration du Théâtre Impérial Mariinsky nouvellement restauré et devenu le lieu principal pour les représentations de ballets et opéras. Les Pilules magiques s'apparentent au vaudeville et occupent une place à part dans l'œuvre de Petipa. Bien entendu, Minkus assure la composition des trois tableaux fantastiques dansés dont Petipa assure la chorégraphie et qui ont fait sensation dans le microcosme saint-pétersbourgeois des balletomanes et des critiques. L'action du premier tableau a pour cadre une grotte souterraine habitée par des sorcières. Le second interprète divers jeux de cartes exprimés par la danse. Le troisième et dernier est connu sous le nom de Royaume des dentelles où se place un Grand divertissement fait de danses nationales espagnoles, napolitaines et hongroises. Minkus écrit ensuite la partition de L'Offrande à l'amour, un ballet en un acte chorégraphié par Petipa pour la ballerine Eugenia Sokolova et monté le 3 août/22 juillet 1886. La musique de Minkus est saluée comme étant le chef-d'œuvre de la musique pour ballet. Néanmoins, Ivan Vsevolojski, directeur des Théâtres impériaux de Saint-Pétersbourg, désireux de diversifier ses sources de musique pour ballets, supprime le poste de Minkus. Ce dernier prend officiellement sa retraite peu de temps après. Il donne son gala d'adieu le 21 novembre/9 novembre 1886. La retraite Nul ne sait si Minkus travailla à nouveau pour les Théâtres impériaux de Saint-Pétersbourg en raison de sa participation à deux importantes productions entre son départ à la retraite en 1886 et son départ de Russie en 1891. La première de ces productions serait une reprise par Petipa de Fiammetta, un ballet de Saint-Léon que le maître de ballet monte spécialement pour la venue de la ballerine invitée italienne Elena Cornalba et dont la musique a été historiquement portée au crédit de Minkus. L'avant-première a lieu le 18 décembre/6 décembre 1887. Il est cependant peu probable que Minkus ait participé à cette reprise pour la raison que Riccardo Drigo, le nouveau directeur des ballets impériaux, a construit pratiquement toutes les partitions supplémentaires nécessaires à la prestation de Cornalba à partir de musiques tirées de différents ballets existants. Kalkabrino, une chorégraphie de Petipa destinée, cette fois, à la ballerine invitée italienne Carlotta Brianza et dont la musique serait exclusivement de Minkus, est interprétée en avant-première le 25 février/13 février 1891. Il n'est pas du tout certain que le compositeur ait eu une quelconque participation dans son écriture. En effet, les historiens russes affirment que cette musique est un pastiche d'autres compositions de Minkus écrites pour les Ballets impériaux au cours de sa longue et brillante carrière à Saint-Pétersbourg. C'est au cours de son séjour à Karl-Ludwig-Straße, dans l'appartement que lui loue son ami Theodor Leschetizky, que Minkus écrit ses dernières compositions connues : Das Maskenfest Le Festival masqué est décrit par le compositeur comme une Tanz und Mythe Danse et Mythe, Il le compose en 1897 pour le ballet du Kaiserliches und Königliches Hof-Operntheater Opéra de la Cour de Vienne, Autriche, devenu l'Opéra d'État de Vienne. Son travail est rejeté par Gustav Mahler, alors directeur de l'Operntheater, sous le prétexte que le livret ne correspond pas au goût du public actuel. Die Dryaden Les Dryades, ballet en un acte composé Minkus, en 1899, pour la scène Viennoise. Rübezahl, composé peu avant sa mort est un pastiche de musiques provenant de La Source, un ballet qu'il a écrit en collaboration avec Delibes, et de partitions de Johann Strauss II. L'écriture musicale de Minkus Le fait que Minkus soit tombé dans l'oubli est très certainement en rapport avec la manière dont la musique de ballet est créée et appréhendée à l'époque où il est compositeur de ballets en Russie. À cette époque, là, comme ailleurs en Europe, le maître de ballet a tout pouvoir sur les partitions que lui fournit le compositeur. Les ballets du XIXe siècle sont un mariage entre la danse et le mime. La musique de ballet doit avant tout être dansante et avoir une mélodie légère, agréable, riche, un phrasé simple, facile à comprendre, rythmé et, enfin, apte à souligner le mouvement des danseurs. La musique accompagnant les mimes et les scènes d'action doit rendre l'atmosphère du drame. Minkus travaille sous contrat pour composer la partition à la demande. Il est contraint de fournir une musique pour ballet à chaque nouvelle saison, en plus de réviser celle qui existe déjà pour les nombreuses reprises de Petipa. Comme beaucoup de « compositeurs spécialistes de ballets avant lui, Minkus esquisse la plupart de ses partitions au cours des répétitions pendant que le maître de ballet chorégraphie ses danses. De même, il annote ses partitions d'instructions détaillées que lui fournit le maître de ballet. Minkus est bien connu pour détenir à son domicile des partitions toutes prêtes classées par genre polkas, valses, adages, etc.. Ces musiques sont réorchestrées pour être incorporées dans une nouvelle œuvre. Minkus écrit fréquemment quatre à cinq mélodies pour une variation ou pas qu'il laisse au choix du chorégraphe. D'autres fois, il compose « sur mesure » la partition pour s'accorder avec n'importe quelle chorégraphie. Beaucoup des partitions de Minkus, anticipant d'éventuelles coupes, contiennent des répétitions en différentes expressions. Par exemple, Minkus compose une partition pour corps de ballet contenant une introduction, quatre ou cinq mélodies et une conclusion que le maître de ballet assemble ensuite selon la quantité de musique désirée. Dans certains cas, il arrive qu'il faille composer une musique s'adaptant à un pas déjà chorégraphié ! Minkus est fréquemment tenu d'inclure dans ses œuvres la musique d'autres compositeurs de ballets en les plagiant. Le plus souvent à la demande d'une ballerine qui souhaite danser son pas ou sa variation favoris issu du travail de quelqu'un d'autre. Ces inclusions exigent de Minkus d'adapter sa musique pour réaliser des transitions habiles. La plupart des partitions de Minkus sont à deux ou trois temps. 2/4, 4/4, 3/4, 3/8, 6/8, 12/8, etc. bien qu'occasionnellement il compose des danses en 5/4 en alternance avec des rythme en 4/4 et 3/4 comme la danse des esclaves de La Bayadère 1877. Cependant, le rythme de 3/4 est privilégié dans la plupart de ses compositions. Les servantes du temple hindou, les Bohémiens, les filles de ferme, les corridas, les contes de fées, les dieux et déesses, les princes et les princesses, les rois et les reines, qu'ils soient vivants ou des fantômes, tous dansent sur un rythme à trois temps. Une des grandes forces de Minkus est son habileté à créer une infinie variété de mélodies élément principal de jugement au XIXe siècle. L'historien du ballet, Konstantin Skalkovsky, raconte dans son étude Dans le monde du Théâtre comment la Marche de Roxana, le ballet dont il a composé la musique en 1878, est devenue l'air favori du tsar Alexandre III qui n'aimait habituellement pas la musique. Plusieurs unités de l'armée de terre russe ont fait le siège de Plevna au son de cette marche. D'autres grandes réussites de Minkus sont les compositions pour violon solo et pour harpe écrites pour le célèbre violoniste Leopold Auer et le harpiste Albert Zabel qui sont respectivement Premier violon et harpiste de l'orchestre des Théâtres Impériaux à la fin du xixe siècle et au début de XXe. Les orchestrations de Minkus font appel à de nombreux instruments. Une de ses partitions utilise les cordes, la flûte, le piccolo, la clarinette, le cornet, le hautbois, le basson, le contrebasson, le trombone, le cor anglais, le cor d'harmonie, la trompette, le tuba auxquels peuvent s'ajouter la harpe, le tambour (tambour à timbre, grosse caisse, le triangle, le tambourin et le glockenspiel. Minkus fait occasionnellement appel au gong, au piano et aux castagnettes. Même avec de tels ensembles, les passages tutti restent exceptionnels. Minkus utilise quasiment toujours la même combinaison d'instrument sauf lorsqu'il faut rendre une ambiance particulière. Il ne fait appel aux cuivres que pour rendre la musique plus consistante si nécessaire. La priorité est donnée au premier violon et au flûtiste dans la plupart de ses compositions et sont souvent doublés par les seconds violons et altos. Les autres instruments favoris de Minkus sont la grosse caisse et les pizzicato pour contrebasse qu'il utilise, le plus souvent, pour marquer le tempo c'est l'orchestration originale qu'il a adoptée pour sa partition du Royaume des Ombres dans La Bayadère de 1877. Cette façon de composer n'est nullement le témoignage d'un manque d'imagination de la part de Minkus. Il écrit ainsi pour aller plus vite étant donné qu'il a très peu de temps pour orchestrer après les décisions du maître de ballet. De plus, une structure musicale plus complexe aurait été rejetée à la fois par le maître de ballet et par les danseurs. L'admiration que la Russie voue à Minkus pour ses capacités à composer la musique de ballet est restée vivace alors que cet engouement est d'apparition plus récente en Occident. Ceci est dû au fait que nombre de musiciens considèrent cette musique du XIXe siècle comme secondaire. Plusieurs troupes de ballet ont choisi d'interpréter la musique du compositeur sur des réorchestrations écrites par différents musiciens dont le plus connu est le compositeur et chef d'orchestre John Lanchbery. Depuis quelques années, de plus en plus de compagnies tentent de se rapprocher autant que possible de la musique originale lorsqu'elles montent des ballets et sont ainsi à l'origine d'un regain d'intérêt pour le vieux « compositeur de musique de ballets . En 2001, le théâtre Mariinski a mis en scène une reconstitution de La Bayadère sur la base des notations chorégraphiques de Vladimir Ivanovich Stepanov tirées de la Collection Sergeyev actuellement propriété de la Librairie de l'université Harvard. Pour cette reconstruction, le Ballet Mariinski a exhumé la partition originale manuscrite de Minkus que l'on croyait perdue depuis plusieurs années. Cette ancienne partition est saluée comme un chef-d'œuvre dans son genre et un magnifique exemple d'une longue disparition dans l'histoire du ballet. Ballets composés par Minkus Fiammetta, ou l'Amour du diable reprise de La Flamme d′amour, ou La Salamandre, chorégraphie d'Arthur Saint-Léon, 25 février/13 février 1863. Le Poisson doré version étoffée, chorégraphie de Saint-Léon, 20 novembre/8 novembre 1867. Le Lys, chorégraphie de Saint-Léon, 2 novembre/21 octobre 1869. Don Quichotte (version étoffée), chorégraphie de Marius Petipa, 21 novembre/9 novembre 1871. La Camargo, chorégraphie de Petipa, 29 décembre/17 décembre 1872. Les Brigands, chorégraphie de Petipa, 6 février/26 janvier 1875. Les Aventures de Pélée, chorégraphie de Petipa, 30 janvier/18 janvier 1876 La Bayadère, chorégraphie de Petipa, 14 février/23 janvier 1877. Roxana, la beauté du Monténégro, chorégraphie de Petipa, 10 février/29 janvier 1878. La Fille des neiges, chorégraphie de Petipa, 19 janvier/7 janvier 1879. Mlada, chorégraphie de Petipa, 14 décembre/2 décembre 1879. Zoraïa, ou la Maure en Espagne, chorégraphie de Petipa, 13 février/1er février 1881. Kalkabrino, 1891, créé après son départ Adaptations Le Papillon. Partition originale d'Offenbach. Chorégraphie de M. Petipa d'après Marie Taglioni. 19 janvier/7 janvier 1874. Le Songe d’une nuit d’été. Partition originale de Felix Mendelssohn. Chorégraphie de M. Petipa. 26 juillet/14 juillet 1876. Frisac ou la Double Noce. Arrangement orchestral à partir de différentes partitions de Giacomo Meyerbeer, Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini et Gioachino Rossini. Chorégraphie de M. Petipa. 23 mars/11 mars 1879. La Fille du Danube. Partition originale d'Adolphe Adam. Chorégraphie de M. Petipa d'après Filippo Taglioni. 8 mars/24 février 1880. Pâquerette. Partition originale de François Benoist dans une version de Cesare Pugni. Chorégraphie de M. Petipa d'après Arthur Saint-Léon. 22 janvier/10 janvier 1882. Le Diable à quatre ou La Femme capricieuse. Partition originale d'Adolphe Adam dans une version de Cesare Pugni. 5 février/23 janvier 1885. Discographie La Source. ballet de 1866 Acte I & Acte III scène 2 en collaboration avec Léo DELIBES Acte II & Acte III scène 1 : Orchestra of the Royal Opera House, Covent Garden, direction : Richard Bonynge 1987 / DECCA. Don Quichotte. ballet de 1871 1°) extraits : Orchestre du Théâtre Bolchoï, direction : Georgi G. Zhemchushin (date non précisée / PILZ). 2°) extraits : Elizabethan Trust Melbourne Orchestra, direction : John Lanchbery (1972 / EMI = bande sonore originale du film de Rudolf Noureïev). 3°) intégrale : Orchestre de l'Opéra National de Sofia, direction : Boris Spassov (1994 / CAPRICCIO). 4°) intégrale : Orchestre de l'Opéra National de Sofia, direction : Nayden Todorov (2002 / NAXOS). La Bayadère. ballet de 1877 : English Chamber Orchestra, direction : Richard Bonynge (1992 / DECCA). Paquita. ballet de 1881 + La Bayadère extraits du ballet de 1877 : Orchestre de l'Opéra National de Sofia, direction : Boris Spassov (1994 / cAPRICCIO). Paquita, pas-de-dix + La Bayadère Scène du Royaume des Ombres : Orchestre Symphonique de Sidney, direction : John Lanchbery 1983 / EMI. La Bayadère, Don Quichotte, Paquita : Pas-de-deux + Paquita : Grand-Pas . Orchestre Symphonique de Londres, direction : Richard Bonynge (1962 / DECCA). Théâtre impérial Bolchoï, Moscou Deux jours à Venise. Chorégraphie de ? 1862. La Flamme d′amour, ou la Salamandre. Chorégraphie d'Arthur Saint-Léon. 24 novembre/12 novembre 1863. Don Quichotte. Chorégraphie de M. Petipa. 26 décembre/14 décembre 1869. Nuit et Jour. Chorégraphie de M. Petipa. 30 mai/18 mai 1883. Autres lieux L'Union de Thétis et Pélée. Chorégraphie de ? 1857. Théâtre privé du Palais Ioussoupov, Saint-Pétersbourg. La Source (composé conjointement avec Léo Delibes). Chorégraphie d'Arthur Saint-Léon. 12 novembre 1866. Théâtre Impérial de l’Opéra, Paris. Le Poisson doré. Chorégraphie d'Arthur Saint-Léon. 1er décembre 1866. Amphithéâtre Olga Island, Peterhof, Saint-Pétersbourg. Les Pilules magiques. Chorégraphie de M. Petipa. 21 février/9 février 1886. Théâtre impérial Mariinsky, Saint-Pétersbourg. L'Offrande à l'amour. Chorégraphie de M. Petipa. 3 août/22 juillet 1886. Théâtre impérial Mariinsky, Saint-Pétersbourg. Bibliographie Il ne semble pas y avoir de documentation complète concernant la vie et l'œuvre de Minkus en français. Cet article est un travail compilatoire construit, majoritairement, à partir des livrets accompagnant les CD cités ci-dessous et d'ouvrages, en anglais, de Roland Wiley Keith Anderson. Livret accompagnant le CD. Léon Minkus. Don Quichotte. Direction Nayden Todorov. Orchestre de l'Opéra national de Sofia. Naxos 8.557065/66. Ivor Guest. Livret accompagnant le CD. Adolphe Adam. Giselle. Direction Richard Bonynge. Orchestre du Royal Opera House, Covent Garden. Decca 417 505-2. Ivor Guest. Livret accompagnant le CD. Léon Minkus & Léo Delibes. La Source. Direction Richard Bonynge. Orchestre du Royal Opera House, Covent Garden. Decca 421 431-2. Ballet du Théâtre Mariinsky. Programme de La Bayadère. Théâtre Mariinsky Theatre, 2001. Marius Petipa. "Agendas de Marius Petipa", traduits et édités en anglais par Lynn Garafola sou le titre Studies in Dance History 3.1 Spring 1992. Royal Ballet. Programme de La Bayadère. Royal Opera House, 1990. Michael Stegemann. Livret accompagnant le CD. Léon Minkus. Don Quijote. Direction Boris Spassov. Orchestre de l'Opéra national de Sofia. . Capriccio 10 540/41. Michael Stegemann. Livret accompagnant le CD. Léon Minkus.Léon Minkus. Paquita & La Bavadere. Direction Boris Spassov. Orchestre de l'Opéra national de Sofia. Capriccio 10 544 (en) John Warrack, C. Scribner's Sons, New York, Tchaikovsky (en) Roland John Wiley. "Dances from Russia: An Introduction to the Sergeyev Collection", The Harvard Library Bulletin, 24.1 January 1976. (en) Roland John Wiley, Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1990., A Century of Russian Ballet: Documents and Accounts, 1810-1910. (en) Roland John Wiley, Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1990., A Century of Russian Ballet: Documents and Accounts, 1810-1910. (en) Roland John Wiley, Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1990., Tchaikovsky's Ballets: Swan Lake, Sleeping Beauty, Nutcracker. Liens http://youtu.be/As9zyB6QXk4?list=PLsw ... zBqw5v8eQoDENGJPsXunGnAHt 200 vidéos         
#4144
Attaque de Pearl Harbour
Loriane
Posté le : 06/12/2014 17:58
Le 7 décembre 1941 les japonais attaquent Pearl Harbor
base américaine aéronavale d'HawaÏ, construite à partir de 1906. La flotte américaine du Pacifique y fut attaquée par surprise, sans déclaration de guerre, par des avions japonais. Les cuirassés de la flotte étaient hors combat, ainsi que 3 croiseurs et des detroyers ; 159 avions furent détruits.Cette attaque détermina l'entrée en guerre des États-Unis. L'attaque de Pearl Harbor est une attaque surprise par l'aéronavale japonaise le 7 décembre 1941 de la base navale américaine de Pearl Harbor située sur l’île d’Oahu, dans l’archipel du territoire américain d’Hawaï, au cœur de l'océan Pacifique. Cette attaque visait à détruire la flotte de l'United States Navy qu'elle abritait et entraîna l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale des États-Unis. ELLe est dirigée et commandée par les commandants Amiral Husband Kimmel, Général Walter Short Amiral Isoroku Yamamoto, Amiral Chuichi Nagumo, il y avait en présence 8 cuirassés, 6 croiseurs, 29 destroyers, 9 sous-marins, ~390 avions sur 6 porte-avions, 2 cuirassés 3 croiseurs, 9 destroyers, 441 avions, et 5 sous-marins de poche. Les pertes furent : 2 cuirassés et un bateau cible coulés, 6 cuirassés endommagés, 5 autres navires diversement endommagés, 188 avions détruits, 155 avions endommagés, 2 403 tués ou disparus, 29 avions détruits, 55 pilotes tués, 4 sous-marins de poche coulés, un pris par l'ennemi, 9 sous-mariniers tués et 1 sous-marinier capturé. Cette attaque eut lieu au cours de la seconde Guerre mondiale dans la Guerre du Pacifique Au cours de cette guerre se déroulèrent les batailles et opérations de : Chine · Indochine française 1940 · Guerre franco‑thaïlandaise · Eaux australiennes · Nauru · Pearl Harbor · Atoll de Wake · Hong Kong · Philippines · Invasion japonaise de la Thaïlande · Attaque du Prince of Wales et du Repulse · Malaisie · Ceylan · Bataan · Singapour · Indes orientales néerlandaises · Bornéo · Birmanie · Nouvelle-Guinée · Timor · Java · Mer de Java · Détroit de la Sonde · Îles Salomon · Australie · Taungû · Île Christmas · Yenangyaung · Mer de Corail · Corregidor · Midway · Îles Aléoutiennes · Komandorski · Attu · Îles Gilbert et Marshall · U-Go · Kohima · Imphal · Peleliu · Angaur · Tinian · Guam · Opération Forager · Saipan · Mer des Philippines · Philippines · Morotai · Leyte · Golfe de Leyte navale · Singapour air · Cabanatuan · Luçon · Manille · Kita · Iwo-Jima · Indochine française 1945 · Okinawa · Opération Ten-Gō · Bornéo · Détroit de Malacca · Bombardements navals sur le Japon · Invasion soviétique de la Mandchourie Kouriles · Bombardements de Hiroshima et Nagasaki · Reddition du Japon Le contexte international Sans déclaration de guerre, l'aviation et la flotte japonaises ont détruit la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor, à 6 000 kilomètres de Yokohama. Les États-Unis sont surpris car ils n'y étaient absolument pas préparés, mais ils entreprennent aussitôt de convertir une grande partie de leur industrie, qui va faire d'eux l'arsenal de la coalition contre l'Axe. L'agression japonaise a comme effet de galvaniser une véritable unanimité nationale derrière le président Roosevelt, qui déclare : "La guerre nazie est une répugnante affaire. Nous ne voulions pas y entrer ; mais nous y sommes et nous allons combattre avec toutes nos ressources ! " "En 1941, le Japon mène depuis déjà dix ans une politique d'expansion impérialiste. Après avoir imposé l'État satellite du Mandchoukouo en 1931, il a entamé la conquête de la Chine en 1937. En 1940, la défaite française lui permet de pénétrer en Indochine et de prendre la Thaïlande sous sa protectio… En attendant, le Japon se rend maître de l'Extrême-Orient. Il prend Hong Kong et entreprend la conquête de la Birmanie, qu'il achève entre janvier et mai 1942. Cependant, l'armée japonaise ne pousse pas son avance en direction de l'Inde. Par l'Indochine et le Siam, elle envahit la Malaisie et s'empare de Singapour (févr. 194 Poursuivant sa progression vers le nord de la Birmanie, la 33e division d'infanterie japonaise atteint les champs pétrolifères de la Burma Oil Company et s'apprête à encercler le corps expéditionnaire allié du général Slim le Burma Corps. Après l'occupation par la marine japonaise des îlots d'importance stratégique dans le Pacifique, l'Indonésie hollandaise est conquise, et la résistance américaine réduite dans les Philippines après le siège de Corregidor en Avril 1942. Ainsi les Occidentaux ont-ils perdu la face en Asie ; les empires coloniaux britannique, français, hollandais et américain sont disloqués. D'un coup, le Japon a conquis les matières premières dont son économie avait besoin. Les Japonais ont débarqué dans l'île néerlandaise de Java, le 28 février 1942; dès le 8 mars, les Néerlandais capitulent. Le drapeau américain est descendu par les soldats japonais après la chute de Corregidor, Philippines, en mai 1942 et la défaite des Américains. Le Japon entreprend d'organiser la Grande Asie sous sa domination. Après avoir encouragé les nationalismes indigènes contre les puissances coloniales, il tend à se substituer à celles-ci et à exploiter à son profit les territoires occupés. D'autre part, toutes ses conquêtes ont été faites sans aucun lien avec la guerre que l'Allemagne mène en U.R.S.S. ; elles se sont arrêtées aux lisières de l'Australie sans avoir pu l'attaquer. Les territoires occupés sont si éloignés les uns des autres que la marine japonaise, disséminée dans le Pacifique, navigue en convois mal protégés, proies faciles pour les sous-marins américains. L'attaque fut ordonnée par le général Hideki Tojo lancée par surprise le matin du dimanche 7 décembre par le service aérien de la marine impériale japonaise contre la flotte américaine du Pacifique dans le port et d’autres forces qui stationnaient aux alentours. Cette attaque s’inscrit dans la politique d’expansion impériale. L’anéantissement de la principale flotte de l'US Navy devait permettre à l’empire du Soleil levant d’établir sa « sphère de coprospérité de la grande Asie orientale ». Le quartier-général impérial souhaitait également répondre aux sanctions économiques prises par Washington en juillet 1941 après l'invasion de la Chine et celle de l'Indochine française par l'armée impériale japonaise. À l'issue de l'attaque, conduite en deux vagues aériennes parties de 6 porte-avions japonais et impliquant plus de 400 avions, les pertes américaines furent importantes : 2 403 morts et 1 178 blessés. Quatre navires de ligne, trois croiseurs, trois destroyers et 188 avions furent détruits. Cependant, beaucoup de navires purent être remis en état dans les mois qui suivirent, et les trois porte-avions américains du Pacifique, alors absents de Pearl Harbor, échappèrent à l'attaque. Les Japonais perdirent 64 hommes, 29 avions et cinq sous-marins de poche ; un marin fut capturé. En moins de vingt-quatre heures, l'Empire du Japon attaqua également les États-Unis aux Philippines et ouvrit les hostilités avec le Royaume-Uni, en envahissant Hong Kong et en débarquant en Malaisie. L'attaque de Pearl Harbor provoqua l’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés des Alliés. Aux États-Unis, cette attaque reste un des évènements les plus marquants de l'histoire du pays — chaque année le drapeau est mis en berne à la date anniversaire de l'attaque — synonyme de désastre national. Les historiens ont mis en évidence l’audace du plan de l’amiral Isoroku Yamamoto, le manque de préparation et les négligences américaines. Le rôle du président Roosevelt reste un sujet de polémique. L’expansionnisme japonais Expansionnisme du Japon Shōwa, Empire du Japon et Seconde Guerre mondiale. Pendant l’ère Meiji 1868-1912, l’Empire du Japon s’engagea dans une période de croissance économique, politique et militaire afin de rattraper les puissances occidentales. Cet objectif s’appuyait également sur une stratégie d’expansion territoriale en Asie orientale qui devait garantir au Japon son approvisionnement en matières premières indispensables à son développement. L’expansionnisme nippon se manifesta dès la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle avec l’annexion de l’île de Formose 1895, du sud de l’île de Sakhaline 1905 et de la Corée (1910). Pendant la Première Guerre mondiale, le Japon s’empara des possessions allemandes d’Extrême-Orient et du Pacifique et gagna des parts de marché au détriment des Européens et des Américains présents dans la région. Après 1920, la croissance économique nipponne ralentit et le chômage augmenta ; l’industrie souffrit du manque de matières premières et de débouchés. Dans l’entre-deux-guerres, l’archipel se dota d’une marine de guerre moderne. La Grande Dépression des années 1930 n’épargna pas l’économie du Japon. Aux effets de la crise économique s’ajouta une montée des nationalistes et des militaires au cours de l'ère Shōwa. L'armée impériale japonaise envahit la Mandchourie en 1931 et ce territoire devint l'État fantoche du Mandchoukouo. Le Japon prit ensuite progressivement le contrôle d'autres régions de la Chine. En 1937, le Japon envahit le reste de la Chine à partir de Shanghai sans toutefois déclarer officiellement la guerre. La dégradation des relations entre Tokyo et Washington L'empereur Showa et Osami Nagano, chef d'état-major de la Marine Les conquêtes nipponnes en Asie orientale menaçaient les intérêts américains et Washington intervint contre le Japon, sans aller jusqu’à la confrontation armée. Ainsi, le Traité de Washington de 1922 limita le tonnage de la flotte de guerre japonaise au troisième rang mondial. En réponse aux pressions diplomatiques internationales à la suite de l'invasion de la Mandchourie, Tokyo décida de quitter la Société des Nations en 1933. Entre 1935 et 1937, les États-Unis choisirent la non-intervention en promulguant une série de lois sur la neutralité. Le Japon signa le pacte anti-Komintern en 1936. En 1937, le président des États-Unis Franklin Roosevelt prononça à Chicago le Discours de la quarantaine dans lequel il condamnait les dictatures, y compris celle du Japon. L'année suivante, son discours sur l'état de l'Union propose d'augmenter les dépenses militaires. En décembre 1937, au moment du massacre de Nankin, les avions japonais coulèrent la canonnière américaine Panay sur le Yang-tse-Kiang. Washington obtint des excuses mais la tension monta rapidement entre les deux pays. En 1939, le gouvernement américain mit fin au traité de commerce signé en 1911, prélude à l’embargo commercial. En 1940, l'Empire rejoignit les forces de l’Axe en signant le Pacte tripartite. La même année, le quartier-général impérial, profitant de la défaite de la France et de l’affaiblissement du Royaume-Uni, autorisa l'implantation de bases militaires en Indochine française. Immédiatement après un accord conclu le 22 septembre avec le gouverneur-général de l'Indochine Française, le Japon déclencha une offensive sur Lang Son et bombarda Haiphong. 1941 fut l'année de l’escalade entre les deux pays : en mai, Washington accorda son soutien à la Chine par l’octroi d’un prêt-bail. À la suite du refus du Japon de se retirer de l'Indochine et de la Chine, à l'exclusion du Mandchoukouo, les États-Unis, le Royaume-Uni et les Pays-Bas décrétèrent à partir du 26 juillet 1941 l’embargo complet sur le pétrole et l’acier ainsi que le gel des avoirs japonais sur le sol américain. La conférence impériale tenue le 6 septembre 1941 décida qu'une guerre serait entreprise contre les États-Unis et le Royaume-Uni, à moins qu'un accord ne soit trouvé à bref délai avec Washington. L'attaque de Pearl Harbor n'est pas un plan préparé conjointement par l'Allemagne et par le Japon mais une initiative japonaise, les Allemands y ayant vu leur intérêt. Le 16 octobre, le Premier ministre du Japon Fumimaro Konoe, jugeant avoir perdu la confiance de l'empereur Showa et des militaires, démissionna de son poste en proposant le prince Naruhiko Higashikuni, un oncle de l'empereur, pour le remplacer. Hirohito refusa cette candidature, proposée également par les militaires, et choisit plutôt le général Tōjō, un ferme partisan de la guerre mais également un homme renommé pour sa fidélité envers l'institution impériale. Le prince Nobuhito Takamatsu Sans même attendre la fin des pourparlers auxquels ils ne croyaient plus, les Japonais commencèrent à préparer l'attaque. Le 3 novembre, l'amiral Osami Nagano expliqua en détail à Hirohito la version finale du plan d'attaque contre Pearl Harbor. Le 5 novembre 1941, l'empereur approuva en conférence impériale le plan d'opération pour une guerre contre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Hollande prévu pour le début décembre6. Le jour même, le quartier-général impérial mit en application la décision adoptée à la conférence et ordonna au commandant en chef de la flotte combinée, l’amiral Isoroku Yamamoto, de mettre en branle la mission sur Pearl Harbor. Les négociations avec les États-Unis demeurant dans une impasse, Hirohito approuva finalement le 1er décembre en conférence impériale la guerre de la Grande Asie orientale, après que Nagano et le ministre de la Marine Shigetaro Shimada, l'eurent rassuré la veille sur les chances de succès de l'entreprise en réfutant l'argument du prince Nobuhito Takamatsu qui jugeait que la Marine impériale ne pourrait tenir plus de deux ans contre les États-Unis. Les forces en présence À partir du XIXe siècle, la puissance militaire japonaise se renforça et se modernisa grandement. Pour pallier la hausse du chômage provoquée par la Grande Dépression, le gouvernement multiplia les commandes d'armement. Les dépenses militaires augmentèrent fortement. Au total, le Japon possédait en 1941 une quinzaine de cuirassés, une dizaine de porte-avions, 50 croiseurs, 1 destroyers, 80 sous-marins et quelque 1 350 avions. Surtout, le pays comptait 73 millions d'habitants animés d'une fierté patriotique et d'un esprit de sacrifice. Les militaires japonais étaient confiants dans la supériorité de leur armée ; en outre, Tokyo était assuré du soutien allemand en cas de contre-attaque des Américains. En 1941, les États-Unis n'étaient pas prêts à entrer en guerre. Certes, le pays était une puissance démographique 132 millions d’habitants et industrielle de premier ordre. En 1941, l'aviation américaine pouvait avancer plusieurs milliers d'avions mais beaucoup étaient obsolètes. En 1940, face aux trois millions de soldats japonais, l'United States Army était en position d'infériorité numérique 250 000 hommes. Surtout, l’opinion américaine n'était pas prête à entrer en guerre. Le souvenir de la Première Guerre mondiale et des soldats américains morts en Europe était encore très présent. Les emprunts contractés par les belligérants auprès des États-Unis n'avaient pas été remboursés et beaucoup d'Américains étaient isolationnistes. Le président Franklin Roosevelt 1933-1945 ne voulait pas s'aliéner les Américains d'origine allemande, italienne et japonaise. Le comité America First, une association pacifiste influente, faisait également pression pour maintenir les États-Unis hors de la guerre. En janvier 1941, Roosevelt promit à Winston Churchill que son pays interviendrait d'abord contre l'Allemagne nazie et non contre le Japon. Pour soulager le Royaume-Uni dans la bataille de l'Atlantique, d'avril à juin 1941, trois cuirassés, un porte-avions, quatre croiseurs et deux flottilles de destroyers sont transférés du Pacifique à l'Atlantique soit 20 % de la flotte du Pacifique ce qui laisse la supériorité numérique dans la zone à la marine japonaise. La base de Pearl Harbor Pearl Harbor constituait la plus grande base navale américaine dans l'océan Pacifique. Elle se trouvait sur la côte sud de l’île d’Oahu, dans l’archipel d’Hawaï, 15 km à l’ouest d’Honolulu. Elle était relativement isolée dans l'océan Pacifique, à 3 500 km de Los Angeles et à 6 500 km de Tokyo. L'île d'Oahu était la plus peuplée de l'archipel hawaïen et se trouvait sur la route des bases américaines de Guam, Wake et Midway. Au début de la Seconde Guerre mondiale, 140 à 180 000 Japonais résidaient à Hawaï. La base de Pearl Harbor s'étendait autour d'une rade peu profonde. L'entrée de cette rade se faisait par un chenal très étroit 400 mètres de large. La plupart des navires de guerre mouillaient à l'intérieur de la rade, à l'est et au nord de l'île de Ford. Trois se trouvaient à l’ouest l’USS Utah, l'USS Raleigh et l'USS Curtiss. Les bâtiments de guerre étaient amarrés deux par deux, par souci d'économie et par manque de place. La flotte de guerre américaine du Pacifique, composée alors de la Battle Force, la Scouting Force, la Base Force et de la Amphibious Force avaient, le dimanche 7 décembre, 86 unités dans la base : 28 destroyers, 9 croiseurs, 8 cuirassés, 4 sous-marins, un cuirassé-cible l’USS Utah et une trentaine de bâtiments auxiliaires. On comptait enfin 25 000 hommes sur la base25 et environ 300 avions et hydravions de l'USAAF et de l'aéronavale dans l’île. Le général Walter Short était le commandant des forces terrestres tandis que la flotte du Pacifique était sous les ordres de l'amiral Husband Kimmel. La défense des installations et des ateliers de réparation était assurée par la DCA et les défenses littorales ainsi que 35 B-. La stratégie et les plans japonais.Marine impériale japonaise. L'objectif de l'attaque était d'anéantir la flotte américaine stationnée à Pearl Harbor afin de conquérir sans difficulté l'Asie du Sud-Est et les îles de l'océan Pacifique. Le but était de contraindre les forces américaines à quitter Hawaï pour se replier sur les bases de Californie. Il fallait par ailleurs réduire en cendres les docks, les ateliers de réparation et le champ de réservoirs contenant les approvisionnements en mazout pour la flotte du Pacifique, sans oublier les aérodromes de Wheeler Field et d'Hickham Field. Le Japon voulait aussi effacer l’humiliation des sanctions économiques prises par Washington. Les préparatifs de l'attaque furent confiés au commandant en chef de la flotte Isoroku Yamamoto. Les préparatifs de l'opération Isoroku Yamamoto Approuvé officiellement le 5 novembre 1941 par Hirohito, le plan d’attaque de Pearl Harbor avait quant à lui été élaboré dès le début de l’année 1941. Ce plan devait surmonter deux difficultés. Premièrement, l’isolement relatif d’Hawaï rendait impossible le recours aux navires de guerre classiques. Deuxièmement, les eaux peu profondes de la rade de Pearl Harbor empêchaient l’utilisation de torpilles conventionnelles qui auraient explosé sur le fond marin avant d’atteindre leur cible. La stratégie japonaise reprenait les éléments décisifs de deux batailles sur mer : le premier était l'effet de surprise de l'attaque japonaise menée par l'amiral Heihachirō Tōgō contre la flotte russe à Port-Arthur en février 1904 ; le second était le lancement de plusieurs bombardiers-torpilleurs Fairey Swordfish depuis un porte-avions de l'escadre menée par l’amiral britannique Andrew Cunningham contre la flotte italienne à la bataille de Tarente en novembre 1940. En 1941, l’amiral Isoroku Yamamoto envoya des experts japonais en Italie pour recueillir des informations qui permettraient de transposer cette stratégie dans le Pacifique. La délégation revint avec des renseignements sur les torpilles que les ingénieurs de Cunningham avaient imaginées. Les plans japonais ont sans doute été aussi influencés par ceux de l’amiral américain Harry Yarnell qui anticipait une invasion d’ Hawaï. Au cours d’un exercice militaire du 7 février 1932, ce dernier avait mis en évidence la vulnérabilité d’Oahu en cas d’attaque aérienne par le nord-ouest. La simulation avait montré que des avions ennemis pourraient infliger de sérieux dommages et que la flotte ennemie, restée à l'écart des côtes, serait indétectable pendant 24 heures. À l'académie navale de Tokyo, les jeunes officiers savaient qu’ au cas où le gros de la flotte de l’ennemi serait stationné à Pearl Harbor, l’idée devrait être d’ouvrir les hostilités par une attaque aérienne surprise. Le jeune officier Minoru Genda, concepteur du plan d'attaque de Pearl Harbor. Yamamoto eut du mal à faire accepter son plan d'attaque : par exemple, l’amiral Nagano jugeait l’entreprise particulièrement risquée. L’empereur ne souhaitait pas une attaque surprise sans déclaration de guerre. Les réticences venaient du fait que l’opération devait engager une grande partie de la marine de guerre et parcourir des milliers de kilomètres sans être repérée. Il s'agissait d'une attaque exceptionnelle. Yamamoto menaça de démissionner pour que son plan soit finalement adopté, en octobre 1941. Cela laissa donc peu de temps à Minoru Genda pour préparer l’expédition, essayer les nouvelles torpilles et entraîner les hommes pour la mission. Pour que la bataille ait des chances de réussir, il fallait qu’elle soit précisément définie et menée dans le plus grand secret. Les ingénieurs militaires japonais créèrent des torpilles spéciales Type 91 munies d’ailerons pour les stabiliser. Ils produisirent également des bombes capables de percer la coque des navires. Le 3 novembre, l'amiral Nagano expliqua en détail le plan d'attaque à Hirohito. Le 5 novembre, l'empereur approuva en conférence impériale le plan d’attaque. Les renseignements fournis par des Japonais d’Hawaï furent déterminants dans la réussite de l’opération : il fallait attaquer un dimanche car la flotte américaine n’était pas en manœuvre le week-end et de nombreux équipages n’étaient pas complets. Il n’y avait aucune patrouille ce jour-là. Les espions japonais fournirent également des informations sur la situation de la flotte américaine. Le départ de la flotte japonaise Le 14 novembre 1941, la flotte combinée se concentra dans la baie d’Hito-Kappu, au sud des îles Kouriles. Elle se composait d'une force de choc avec sa force aéronavale, le Kidô Butai, qui comportait notamment six porte-avions Akagi, Hiryū, Kaga, Shōkaku, Sōryū, Zuikaku et plus de 400 avions : des avions de chasse Mitsubishi A6M les Zéros, des bombardiers-torpilleurs Nakajima B5N Les Kate et des bombardiers en piqué Aichi D3A les Val. Une flotte de reconnaissance comprenait 22 sous-marins, cinq sous-marins de poche Ko-hyoteki, emportant chacun deux hommes et deux torpilles de 450 mm et trois croiseurs légers. Huit bateaux de ravitaillement en carburant accompagnaient l’expédition. Le 26 novembre, alors que les deux gouvernements étaient encore en pourparlers, l'armada de la marine impériale japonaise quitta secrètement le Japon. Elle se dirigea vers l'archipel d'Hawaï par le nord en empruntant une route peu fréquentée. Le 1er décembre, Hirohito approuva en conférence impériale la Guerre de la Grande Asie orientale et autorisa le bombardement de Pearl Harbor. Lorsque la flotte reçut l'ordre officiel d'attaquer le 2 décembre, les pourparlers se poursuivaient encore. Le 6 décembre, la flotte qui se trouvait à 200 milles marins 370 km au nord de Pearl Harbor, reçut le signal d’attaque : Grimpez sur le mont Niitaka Rupture des négociations et déclaration de guerre Les négociations entre le Japon et les États-Unis, reprises en novembre 1941, se trouvaient bloquées à la veille de l'attaque : les Japonais exigeaient l'arrêt du soutien américain aux Chinois. Le secrétaire d'État Cordell Hull réclamait quant à lui le retrait des troupes nipponnes de Chine. Le 6 décembre 1941, Roosevelt transmit un télégramme à l’empereur Hirohito afin de reprendre les négociations qui avaient lieu à Washington. Le même jour, le ministère des affaires étrangères japonais envoya à ses négociateurs et à l'ambassadeur Kichisaburo Nomura en place à Washington un document codé en 14 points, texte diplomatique signifiant la rupture des relations diplomatiques ; ils avaient pour consigne de le remettre au secrétaire d’État américain le lendemain à 13 h, soit 7 h 30, heure d’Hawaï. Mais le message ne fut pas remis à l’heure prévue en raison de retards dans le décryptage de ce texte long et complexe. Les services américains de renseignement réussirent à décoder le message bien avant l’ambassade japonaise : seul le dernier point du mémorandum, c’est-à-dire la déclaration de guerre, n’avait pas été déchiffré par les Américains. Le dimanche 7 décembre à 11 h 58, heure de Washington 6 h 28 à Hawaï, le général George Marshall lut le message ; inquiet par sa teneur, Marshall fut persuadé qu'une attaque se préparait. Il expédia un télégramme pour donner l'alerte aux bases américaines situées aux Philippines, à Panama, à San Diego et à Pearl Harbor. En raison de défaillances techniques, l'alerte arriva trop tard à Hawaï, plusieurs heures après les bombardements. Le message parvint à l’ambassadeur américain au Japon environ dix heures après la fin de l’attaque. La préparation de l’attaque L’attaque est préparée pendant plusieurs semaines sur une maquette de la base. Deux des six porte-avions, le Kaga et le Zuikaku, en route pour les îles Hawa Une partie des pilotes du porte-avion Kaga prennent la pose la veille de l’attaque. Les pilotes du Kaga en briefing sur un dessin de la rade, la veille de l’attaque. À l’aube du 7 décembre, sur le Shokaku, la première vague d’assaut s’apprête à décoller. L'attaque Isoroku Yamamoto et d’autres généraux avaient prévu une attaque en trois vagues mais le vice-amiral Chuichi Nagumo décida de n’en retenir que deux. Le nombre total d’avions impliqués dans l’attaque était de 350. 91 avions furent engagés dans la protection des porte-avions et des navires. Ce fut dans la nuit du 6 au 7 décembre que les opérations débutèrent massivement, l'aube permettant de réduire les précautions à prendre pour éviter d'être repéré et accélérer ainsi la vitesse de progression. Il est à noter que l'attaque sur la Malaisie, le 8 décembre, a lieu en fait au même moment, car de l'autre côté de la ligne de changement de jour. Les missions de reconnaissance Vers minuit, les sous-marins de haute mer lancèrent cinq sous-marins de poche qui se dirigèrent vers l'île d'Oahu. À 3 h 58, le dragueur de mines USS Condor signala la présence d’un sous-marin dans la rade de Pearl Harbor au destroyer USS Ward. Ce dernier se mit alors à sa recherche sans succès : l'intrus avait rapidement disparu. L'amirauté de Pearl Harbor ne donna pas l'alerte. À 6 h 37, le Ward repéra un autre sous-marin qui était chargé de renseigner la flotte japonaise et le détruisit. La première vague C'est entre 6 h et 7 h 15 que la première vague de 183 avions, conduite par le capitaine Mitsuo Fuchida, s'envola vers Pearl Harbor. Elle comprenait : 49 bombardiers moyens d'altitude horizontaux Nakajima B5N2 Kate, 51 bombardiers en piqué Aichi D3A1 Val, 40 bombardiers torpilleurs Nakajima B5N2 Kate 43 avions de combat Mitsubishi A6M2 Zéro. Leur présence ne fut détectée que vers 7 h par deux soldats américains George Elliot Jr. et Joseph Lockard à la station d’Opana Point un radar SCR-270 situé près de la pointe nord d'Oahu. Ces derniers ne sont pas pris au sérieux par un nouvel officier, le lieutenant Kermit A. Tyler, convaincu qu’il s’agissait de six bombardiers B-17 qui arrivaient de Californie42 et qui étaient attendus pour se ravitailler avant de rejoindre leur destination finale de Clark Field dans les îles Philippines43. Vers 7 h 30, le premier avion japonais fit une reconnaissance dans les alentours et donna le signal : Pearl Harbor dort. Les premiers avions survolèrent la base américaine à 7 h 40. Les avions torpilleurs volaient à basse altitude et provenaient de différentes directions. Les bombardiers volaient quant à eux à haute altitude. À 7 h 53, les premières bombes nipponnes furent larguées et les avions se mirent en formation d’attaque. Le contre-amiral Patrick Bellinger donna l'alerte. Cinq sous-marins Ko-hyoteki torpillèrent les bateaux américains après le début des bombardements. Sur les dix hommes qui se trouvaient à bord des sous-marins, neuf trouvèrent la mort ; le seul survivant, Kazuo Sakamaki, fut capturé et devint le premier prisonnier de guerre japonais fait par les Américains au cours de la Seconde Guerre mondiale. Une étude de l’institut naval américain conduite en 1999 indique qu’une torpille toucha l'USS West Virginia qui devint la première cible de l’attaque japonaise. Cette première attaque était divisée en six unités dont une dirigée sur le poste militaire de Wheeler Field. Les Japonais exploitèrent les premiers moments de surprise pour bombarder les navires les plus importants, surtout à l'est de la rade. Chacune des attaques aériennes commençait par les bombardiers et finissait par les unités de combat afin de contrer les poursuites éventuelles. La première attaque engagea le flanc droit de l’ennemi. La deuxième vague À 8 h 30, la deuxième phase de l'attaque forte de 167 appareils visa le flanc gauche et utilisa davantage de bombardiers en vol horizontal. Elle comprenait : 54 bombardiers moyens d'altitude horizontaux Nakajima B5N2 Kate, 78 bombardiers en piqué Aichi D3A1 Val, et 35 chasseurs Mitsubishi A6M2 Zéro. Elle fut menée par le lieutenant-commandant Shigekazu Shimazaki. Elle était divisée en quatre unités dont l’une fut lancée sur la base de Kānehohe, à l'est de Pearl Harbor. Les différentes formations arrivèrent presque en même temps sur le site depuis plusieurs directions. Au cours de la deuxième vague, un sous-marin de poche venu en surface fut pris pour cible par le Curtiss et coulé par le destroyer USS Monaghan. La seconde vague s’acheva à 9 h 45. Après l'attaque, des avions survolèrent le site afin d’étudier les dommages et de faire un rapport. Défense américaine Les hommes qui se trouvaient à bord des navires américains furent réveillés par les explosions. Le fameux message Air raid Pearl Harbor. This is not a drill, Attaque aérienne sur Pearl Harbor. Ceci n’est pas un exercice fut prononcé par le commandant Logan Ramsey à 7 h 58, cinq minutes après les premières bombes. L'amiral Husband Kimmel alerta Washington quelque temps après. En dépit du manque de préparation et des scènes de panique, plusieurs militaires se sont illustrés durant la bataille. L’amiral Isaac C. Kidd et le capitaine Franklin Van Valkenburgh se ruèrent sur le pont de l'USS Arizona afin d’organiser la défense et furent tués par l’explosion d'un dépôt d’armes tout proche. Les deux hommes furent honorés de manière posthume par la médaille d’honneur. L’enseigne Joe Taussig mit l'USS Nevada en route pendant l’attaque. L’un des destroyers, l’USS Aylwin, fit de même avec seulement quatre officiers à son bord, le reste de l'équipage étant composé d'enseignes qui avaient peu d’expérience en mer. Le capitaine Mervyn Bennion, commandant l'USS West Virginia, dirigea son équipage jusqu’à ce qu'il fut tué par des fragments de bombes. Les premières victimes de l’attaque aérienne se trouvaient sur le sous-marin USS Tautog qui abattit également le premier Japonais. L'Afro-Américain Doris Dorie Miller, qui servait comme cuisinier sur l'USS West Virginia, prit le contrôle d’une mitrailleuse de lutte anti-aérienne et s’en servit pour tirer sur des avions japonais : il en toucha au moins un alors que son navire était bombardé dans le même temps. Il reçut la croix de la marine Navy Cross après la bataille. Quatorze marins et officiers furent par ailleurs récompensés par la médaille d’honneur. Une distinction militaire spéciale, la Pearl Harbor Commemorative Medal, fut par la suite décernée à tous les vétérans de l’attaque. Dans le ciel, la seule opposition importante vint d’une poignée de Curtiss P-36 Hawk et de Curtiss P-40 Warhawk qui firent vingt-cinq sorties et par les défenses anti-aériennes. Des avions décollèrent pour tenter de repérer la flotte japonaise, en vain. Une troisième vague avortée Certains officiers pressèrent l'amiral Nagumo de lancer une troisième attaque afin d'anéantir les dépôts de carburant et les infrastructures de Pearl Harbor. Certains historiens ont suggéré que la destruction des réserves de carburant et des équipements de réparation aurait fortement handicapé la flotte du Pacifique, bien plus que la perte des navires de ligne. Cependant, Nagumo décida de renoncer à une troisième attaque pour plusieurs raisons : en premier lieu, les succès des défenses antiaériennes furent plus nombreux au cours de la seconde vague et occasionnèrent les 2/3 des dommages nippons. L'effet de surprise avait disparu et une troisième vague risquait d’accroître les pertes japonaises. Ensuite, la préparation d'une troisième attaque aurait pris beaucoup trop de temps, laissant aux Américains la possibilité d'attaquer les forces de Nagumo situées à moins de 400 km au nord d'Oahu. L'armada pouvait rapidement être localisée et prise en chasse par les sous-marins ennemis. En outre, les Japonais ignoraient toujours la position des porte-avions américains et avaient atteint la limite de leurs capacités logistiques : rester plus longtemps augmentait le danger de manquer de carburant. La deuxième vague avait atteint l'objectif initial de la mission, à savoir neutraliser la flotte américaine du Pacifique. On se souvient que les autorités japonaises avaient été réticentes devant cette opération, c'est pourquoi l'expédition devait s'arrêter là. Il était donc temps de partir, d'autant que le Japon avait d'autres objectifs stratégiques dans le Sud-Est asiatique. Bilan de l'attaque Les pertes de l’US Navy classées par durée d’immobilisation des navires Nom Type Mise en service Touché par Tués Retour au combat Mois d’immob° et commentaires Navires détruits 1 Arizona Cuirassé 1916 2 bombes de 800 kg 1 177 Définitif 2 Oklahoma Cuirassé 1916 5 torpilles 429 Définitif 3 Utah Bateau cible 1911 2 torpilles 58 Définitif Navires endommagés 4 West Virginia Cuirassé 1923 7 torpilles, 2 bombes de 800 kg 1 défectueuse 106 juillet 1944 31 5 Oglala Mouilleur de mines 1917 1 torpille dommages indirects 0 février 1944 26 6 Cassin Destroyer 1936 2 bombes de 250 kg 0 février 1944 26 7 California Cuirassé 1921 2 torpilles, 1 bombe de 250 kg 105 janvier 1944 25 8 Downes Destroyer 1937 1 bombe de 250 kg 12 novembre 1943 23 9 Nevada Cuirassé 1916 1 torpille, 5 bombes de 250 kg 57 octobre 1942 10 Échoué pour éviter la submersion dans le chenal. 10 Vestal Navire atelier 1913 2 bombes de 250 kg 1 défectueuse 7 août 1942 8 11 Shaw Destroyer 1936 3 bombes de 250 kg 24 juin 1942 6 12 Helena Croiseur léger 1939 1 torpille 34 juin 1942 6 13 Pennsylvania Cuirassé 1916 1 bombe de 250 kg 32 mars 1942 3 14 Tennessee Cuirassé 1920 2 bombes de 800 kg défectueuses 5 février 1942 2 15 Maryland Cuirassé 1921 2 bombes de 800 kg défectueuses 4 février 1942 2 16 Raleigh Croiseur léger 1924 1 torpille, 1 bombe de 250 kg 0 février 1942 2 17 Curtiss Porte-hydravions 1940 1 bombe de 250 kg 21 janvier 1942 1 18 Honolulu Croiseur léger 1938 1 bombe de 250 kg dommages indirects 0 janvier 1942 1 19 Helm Destroyer 1937 2 bombes de 250 kg dommages indirects 0 décembre 1941 0 20 New Orleans croiseur lourd 1931 Dommages indirects 0 décembre 1941 0 Dommages légers Du côté américain Le bilan humain de l'attaque fut lourd : 2 403 Américains sont morts et 1 178 ont été blessés. Les pertes se répartissent ainsi : US Army; 218 morts et 364 blessés. US Navy; 2008 morts et 710 blessés. US Marine Corp, 109 morts et 69 blessés. Civils, 68 morts et 35 blessés, tués ou blessés par les bombes ou les éclats de bombes tombés dans les zones civiles, jusqu'à Honolulu. Près de la moitié des pertes américaines, soit 1 177 hommes, fut provoquée par l'explosion et le naufrage de l'USS Arizona. Celui-ci explosa à cause d'un obus de marine de 400 mm modifié de façon telle qu'il puisse être utilisé comme une bombe par un avion, largué par Tadashi Kusumi. La bombe frappa le navire au niveau de la tourelle avant de 356 mm. Ayant un blindage de pont plus fin cette bombe s’arrêta dans la soute à munitions et explosa. La coque de l'Arizona sert aujourd'hui de mémorial. Il continue d’ailleurs de perdre un peu de carburant, plus de 70 ans après l’attaque. L'attaque avait visé les cuirassés stationnés dans la rade : l'USS Nevada fut endommagé par une torpille et un incendie ; il fut la cible de nombreuses bombes japonaises lorsqu'il se mit en route pour éviter la submersion dans le chenal et finit par toucher le fond de la rade par l'avant. Il fut renfloué par la suite. L'USS California fut touché par deux bombes et deux torpilles. L'équipage reçut l'ordre d'évacuer le navire. Il fut renfloué par la suite. L'USS Utah, ce cuirassé d’un modèle ancien était utilisé comme cible de bombardement mobile. Il constituait une cible facile et fut touché deux fois par des torpilles. Sept torpilles affectèrent l'USS West Virginia et la dernière eut pour conséquence de détacher le gouvernail. L'USS Oklahoma fut frappé par cinq torpilles et chavira. L'USS Maryland fut atteint par deux obus de marine de 400 modifiés sans subir de dommages sérieux. L'USS Pennsylvania fut touché par une bombe de 250 kg au cours de la deuxième vague d'attaque alors qu'il était en cale sèche sans subir de dommages sérieux. L'USSWest Virginia fut touché par 7 torpilles et 2 bombes de 800 kg. Il fut renfloué par la suite. L'USS Tennessee fut touché par 2 bombes de 800 kg défectueuses occasionnant seulement des dommages légers Même si les Japonais ont concentré leurs tirs sur les navires de ligne, ils n'ont pas épargné les autres cibles. Le croiseur léger USS Helena fut torpillé et le choc provoqua le chavirement du mouilleur de mines USS Oglala situé à côté. Deux destroyers en cale sèche furent détruits lorsque des bombes touchèrent leur réservoir de carburant. L’incendie se propagea à d'autres navires. Le croiseur léger USS Raleigh fut touché par une torpille qui ouvrit une brèche. Le croiseur léger USS Honolulu fut endommagé mais resta en service. Le destroyer USS Cassin chavira et le destroyer USS Downes fut sérieusement endommagé. Le bateau de réparation USS Vestal, rangé bord à bord avec l’Arizona alors en feu, fut gagné par les flammes qui ravageaient ce dernier et finit par sombrer à son tour. Le navire ravitailleur USS Curtiss fut également endommagé. La quasi-totalité des 188 avions stationnés à Hawaï furent détruits ou endommagés. Lorsque les Japonais arrivèrent au-dessus des aérodromes américains, ils trouvèrent 155 avions stationnés aile contre aile pour éviter le sabotage 40 % de la population de l'île d'Oahu étant des Américano-japonais mais constituant ainsi des cibles idéales. Les attaques sur les casernes tuèrent des pilotes et d’autres membres du personnel. Des tirs amis ont abattu plusieurs avions américains. L'aéronavale perdit 13 chasseurs, 67 bombardiers, trois avions de transport et quatre forteresses volantes en plus de la moitié des avions de combat qui se sont retrouvés cloués au sol parce qu'ils avaient été disposés aile contre aile ce qui les empêcha de décoller rapidement. L'aviation de l'armée de terre fut aussi gravement touchée : 12 B-18, 20 A-9, 2 A-20, 4 P-26, 20 P-36 et 32 P-40. Dans le camp japonais Du côté japonais, les pertes humaines furent beaucoup moins lourdes : 64 morts 55 aviateurs et neuf sous-mariniers ; l'enseigne Kazuo Sakamaki fut capturé, premier prisonnier de guerre japonais du conflit. Le bilan matériel fut aussi limité : les cinq sous-marins de poche engagés furent coulés ou capturés et un sous-marin de croisière a été coulé le 10 décembre le I-70 avec 121 membres d'équipage fut détruit par des avions de l'USS Enterprise. Sur les 441 avions japonais disponibles, 350 prirent part à l’attaque et 29 furent abattus durant la bataille, neuf au cours de la première vague, vingt dans la seconde. 74 autres furent touchés par les défenses antiaériennes et l’artillerie au sol. Le plan audacieux de Yamamoto et de Genda avait atteint ses objectifs. Un succès à relativiser Vengez Pearl Harbor - Nos balles le feront. Cependant, l'armada japonaise s'en retourna sans qu'aucun porte-avions américain ne fût détruit car ils ne se trouvaient pas à Pearl Harbor. L'USS Enterprise rentrait au port et se trouvait à 300 km au début de l'attaque six des dix-huit SBD qu'il avait fait décoller à 6 h 20 en direction d'Hawaï ont été détruits, l'USS Lexington livrait des avions aux îles Midway et l'USS Saratoga était à San Diego en train d'embarquer son groupe aérien et de subir des réparations. D'autre part, presque tous les navires touchés étaient des vieux bâtiments ; 80 % d'entre eux furent remis en état et modernisés après l'attaque. Les destroyers Cassin et Downes furent gravement endommagés mais leurs machines furent sauvées et elles équipèrent d’autres bâtiments portant leur nom d’origine. Les pertes matérielles les plus graves furent celles des 155 avions et des dégâts matériels dans la base. Finalement, l'attaque japonaise sur Pearl Harbor fut une brillante réussite tactique mais un échec du point de vue stratégique. Malgré les pertes, la base resta opérationnelle le port, les pistes, les réservoirs de carburant et les ateliers de réparation n'ont pas été détruits ou marginalement. Yamamoto aurait dit : Je crains que tout ce que nous avons réussi à faire est de réveiller un géant endormi et de le remplir d'une terrible résolution. Contrainte de se battre sans cuirassés, la marine américaine développa par la suite de nouvelles tactiques navales reposant sur des Task forces combinant des porte-avions et des sous-marins, reprenant la stratégie japonaise employée à Pearl Harbor. Ces nouvelles méthodes permirent de freiner l'avance japonaise en 1942, délai que l'amiral Yamamoto estimait avoir donné au Japon avant que la capacité industrielle démultipliée des États-Unis ne leur donne une supériorité écrasante. Paradoxalement, la doctrine navale japonaise continuait à ce moment à considérer les cuirassés comme les navires les plus importants. Conséquences, entrée en guerre des États-Unis Après l'attaque japonaise sur la base navale américaine, le président Roosevelt engagea son pays dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés des Alliés. Les Japonais firent une déclaration de guerre officielle mais à cause de divers contretemps, elle ne fut présentée qu'après l'attaque. Le 8 décembre 1941, le président Roosevelt déclara : " Hier, 7 décembre 1941 - une date qui restera à jamais marquée dans l'Histoire comme un jour d’infamie - les États-Unis d'Amérique ont été attaqués délibérément par les forces navales et aériennes de l'empire du Japon. Les États-Unis étaient en paix avec le Japon et étaient même, à la demande de ce pays, en pourparlers avec son gouvernement et son empereur sur les conditions du maintien de la paix dans le Pacifique. Qui plus est, une heure après que les armées nippones eurent commencé à bombarder Oahu, un représentant de l'ambassade du Japon aux États-Unis a fait au secrétariat d'État une réponse officielle à un récent message américain. Cette réponse semblait prouver la poursuite des négociations diplomatiques, elle ne contenait ni menace, ni déclaration de guerre …. J'ai demandé à ce que le Congrès déclare depuis l'attaque perpétrée par le Japon dimanche 7 décembre, l'état de guerre contre le Japon. " Le Congrès américain déclara la guerre au Japon à la quasi unanimité ; seule la pacifiste Jeannette Rankin députée républicaine du Montana s'opposa à cette décision. Roosevelt signa la déclaration le jour même. Avec la loi sur la conscription du 20 décembre 1941, la mobilisation s'élargit à tous les Américains entre 20 et 40 ans. Le 22 décembre 1941 débuta la conférence Arcadia au cours de laquelle Churchill et Roosevelt décidèrent d'unir leurs forces contre l'Allemagne nazie. La Déclaration des Nations unies du 1er janvier 1942 prévoyait la création de l'ONU. Enfin, le pays dut convertir son économie pour répondre aux besoins de la guerre, un processus qui commença le 6 janvier 1942 avec l'annonce du Programme de la Victoire. L'entrée en guerre des États-Unis marquait un tournant dans la mondialisation du conflit. Le lendemain, 9 décembre, l'Angleterre déclarait la guerre au Japon et Winston Churchill écrira plus tard dans ses Mémoires : Aucun Américain ne m'en voudra de proclamer que j'éprouvai la plus grande joie à voir les États-Unis à nos côtés. Je ne pouvais prévoir le déroulement des événements. Je ne prétends pas avoir mesuré avec précision la puissance guerrière du Japon, mais je compris que, dès cet instant, la grande République américaine était en guerre, jusqu'au cou et à mort. Nous avions donc vaincu, enfin ! . Réaction du Japon et de ses alliés Dans les heures qui suivirent, le Royaume-Uni et son empire colonial, le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud entrèrent en guerre contre le Japon. L'Allemagne nazie et l'Italie fasciste déclarèrent la guerre aux États-Unis le 11 décembre 1941, quatre jours après l'attaque de Pearl Harbor. Selon les termes du pacte tripartite, Hitler et Mussolini n'étaient pourtant pas obligés de déclarer la guerre. Cependant, les relations entre les pays européens de l’Axe et Washington s'étaient détériorées depuis 1937. Les adversaires du New Deal de Roosevelt, notamment le Chicago Tribune, rendirent public le plan de guerre américain pour l’Europe. Hitler estimait qu'un conflit avec les États-Unis était inévitable. Ce sentiment fut renforcé par la publication du plan américain, par l’attaque de Pearl Harbor et par le discours de Roosevelt. Le Führer méprisait les Américains, en particulier les Noirs qu'il tenait pour inférieurs. Il sous-estima également la puissance productive des États-Unis, leur capacité à combattre sur deux fronts à la fois (en Europe et dans le Pacifique) et les conséquences du prêt-bail sur ses adversaires. Les nazis escomptaient qu'à la suite de la déclaration de guerre contre les États-Unis, le Japon s'engagerait davantage contre l'URSS (avec laquelle il est en paix depuis la conclusion du pacte nippo-soviétique du 13 avril 1941) et les possessions européennes en Asie55. Toutefois, le front chinois et le théâtre d'opération méridional accaparèrent l'essentiel des forces de l'empire du Japon. Dans les heures qui ont suivi l'attaque de Pearl Harbor, les Japonais attaquèrent diverses colonies et bases militaires britanniques et américaines en Asie et dans le Pacifique : la Malaisie, Hong Kong, Guam et Wake. Peu après les événements de Pearl Harbor, les bombardiers de la 11e flotte aérienne japonaise s'en prirent à la 7e flotte de l'Air Force américaine basée aux Philippines et à la force Z britannique ce qui ouvrait la voie à la capture des deux premiers objectifs visés. Le 16 décembre, les forces nippones contrôlaient le nord de l'île de Bornéo, Hong Kong capitula le 25 décembre et Singapour tomba en janvier 1942. L’évènement vu par les Japonais Bien que la propagande anti-américaine eût préparé l'opinion publique japonaise à la guerre contre les États-Unis, il semble que la plupart des Japonais furent surpris lorsqu'ils apprirent la nouvelle : l'attaque avait en effet été menée dans le plus grand secret. Elle était présentée et ressentie comme un coup d'éclat et finit par rallier les sceptiques face à la guerre. Pour l'état-major et le gouvernement japonais, l'attaque de Pearl Harbor n’était qu’une réponse juste à la politique agressive de Washington. Il considérait que les Alliés, et particulièrement les États-Unis, multipliaient depuis longtemps les provocations à l'égard des Japonais. Aussi, l’attaque de Pearl Harbor ne relèverait pas de la trahison car Washington se préparait depuis longtemps à la guerre. Aujourd'hui encore, un certain nombre de Japonais pensent que leur pays a été poussé à se battre pour protéger la sécurité nationale et leurs intérêts. En 1991, le ministre japonais des affaires étrangères rappela que le Japon avait donné une déclaration de guerre à 13h00 le message en 14 points, heure de Washington DC, 25 minutes avant le début de l’attaque de Pearl Harbor. Le sentiment anti-japonais aux États-Unis Les photographies des bâtiments en flamme et des destructions à Pearl Harbor soulevèrent une émotion certaine dans le monde entier. L'attaque japonaise galvanisa la nation américaine et l'unit pour atteindre un but : celui de faire capituler l'Empire du Soleil Levant. Le comité pacifiste America First décida lui-même sa dissolution et les adversaires politiques de Roosevelt cessèrent provisoirement leurs attaques. Le sentiment de trahison et la peur du sabotage ou de l’espionnage rendirent suspects les Japonais vivant sur le sol américain et les Américains d'origine japonaise. Le général John DeWitt et le secrétaire à la Marine Frank Knox évoquèrent l'existence d'une cinquième colonne sur le sol américain. Dans les jours qui suivirent l’attaque, plusieurs rumeurs circulèrent : les ouvriers nippons de l’île auraient coupé les champs de canne à sucre pour former des flèches indiquant le chemin vers Pearl Harbor. D'autres rumeurs touchèrent le président Roosevelt et Marshall qui auraient été au courant de l’attaque. Enfin, la crainte d'un débarquement japonais à la suite de l'attaque ajouta un élément à la confusion qui régnait à Hawaï. C'est dans ce contexte que 110 000 Japonais et citoyens américains d'origine japonaise60 furent rassemblés et surveillés dans des camps d'internement War Relocation Centers. L'ordre exécutif 9066 du 19 février 1942 fut signé par Roosevelt et concerna l'ouest du pays où se concentraient les populations japonaises ; des camps furent ouverts dans des régions isolées des États de Washington, de Californie et de l'Oregon. Cependant, les Japonais des îles Hawaï ne furent pas internés car l'armée et la marine avaient besoin de main d'œuvre. Des Américains d'origine japonaise furent incorporés dans l'armée américaine notamment dans le 442nd Regimental Combat Team qui combattit en Europe à partir de 1943 et subit de lourdes pertes. En 1988, le Congrès présenta officiellement ses excuses pour ces arrestations arbitraires en votant une loi qui indemnisait les victimes encore vivantes. Pearl Harbor peut également expliquer la détermination des États-Unis à procéder aux bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki. Portée et signification Pearl Harbor est toujours considéré par les Américains comme l'un des événements les plus importants de leur histoire : c'était en effet la première fois depuis la guerre de 1812 que le sol américain était attaqué par un pays étranger. Soixante ans plus tard, les journalistes comparèrent les attentats du 11 septembre 2001 à l'attaque du 7 décembre. De nombreux films japonais et américains ont relaté cet épisode de la Seconde Guerre mondiale. Tant qu'il y aura des hommes réalisé en 1953 par Fred Zinnemann évoque la vie des militaires à Pearl Harbor. Le film Tora! Tora! Tora! de Richard Fleischer en 1970 donne une description assez réaliste des événements, prenant à la fois les points de vue américain et japonais. Le film documente notamment la longue liste d'erreurs et d'accidents qui rendirent cette attaque si destructrice pour les forces américaines. Le titre reprend le mot Tora qui signifie « tigre ». Il s'agit du message radio envoyé par Mitsuo Fuchida, le commandant de la mission. Le film 1941, réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1979, évoque le climat de panique après l'attaque. Dans Nimitz, retour vers l'enfer de Don Taylor 1980, un porte-avions nucléaire voyage dans le temps et se retrouve à Pearl Harbor, la veille de l'attaque, avec la possibilité de changer l'Histoire. Pearl Harbor 2001 de Michael Bay reprend des scènes de Tora! Tora! Tora! comme celle du cuisinier-mitrailleur. Un événement controversé L'attaque de Pearl Harbor fit l'objet de nombreuses polémiques dès les lendemains des événements : entre décembre 1941 et juillet 1946, sept commissions administratives et une commission spéciale enquêtèrent pour établir les responsabilités et les négligences. Les commissions d'enquête La première commission, dirigée par Owen Roberts, fut constituée dès le mois de décembre 1941 et rendit ses conclusions au Congrès des États-Unis en janvier 1942. Elle accusa les officiers de la base (Walter Short et Husband Kimmel) de manquement à leur devoir, en particulier dans la défense de Pearl Harbor ; les deux hommes furent relevés de leurs fonctions. Cependant, le Sénat des États-Unis vota leur réhabilitation en mai 1999 (non signée ni par Clinton ni par Bush). Les négligences et erreurs américaines Walter Short L'attaque de Pearl Harbor par les Japonais provoqua un choc immense dans l'opinion publique, à la tête de l'armée et de l'État. Les journalistes et les politiques posèrent rapidement la question des responsabilités. Il paraissait en effet évident que plusieurs erreurs avaient été commises : encore fallait-il déterminer si elles l'avaient été de manière intentionnelle ou non. Une série de défaillances se sont accumulées et permettent de comprendre le désastre : l'entrée de la rade n'était pas protégée par des filets anti torpilles. Les navires américains, alignés côte à côte sur ordre de Claude C. Bloch à cause du manque de place, offraient des cibles idéales. Les soldats américains de Pearl Harbor croient lors des premiers bombardements qu'il s'agit d'exercice, pensant que les avions venaient de Californie, les Japonais ayant longé les côtes russes. Le général Short estimait que le danger le plus immédiat pour les terrains d'aviation était le sabotage, et avait par conséquent ordonné que les avions soient concentrés en des endroits faciles à surveiller, situation qui facilita leur destruction par l'attaque aérienne ; Short ne croyait pas à l’efficacité du radar, une invention relativement nouvelle. L'équipe de surveillance du radar n'avait pas été remplacée après 7 heures ; aucune patrouille n'était de service le dimanche matin. Les diverses installations militaires n'étaient pas camouflées. La cryptanalyse des codes secrets Code 97 des purple machines aurait dû aider Pearl Harbor mais les Japonais pratiquaient la contre-information et ils n’ont pas été transmis à temps George Marshall préféra utiliser le télégraphe au téléphone qu'il pensait être victime d'interceptions par les Japonais, d'autant plus qu'il n'y avait aucun décodeur à Hawaï. Enfin, les divergences qui existaient entre Short et Kimmel expliquent en partie le manque de coordination et les dysfonctionnements dans le système de défense de Pearl Harbor. Les révélations d'un agent double De nombreux signes et avertissements n'ont pas été entendus ou compris. Quatre mois avant l'attaque, l'espion serbe Dušan Popov, à l'instar de Richard Sorge, informe les services secrets anglais, puis américains des intentions nippones. Les actualités de Paramount dès le 13 novembre 1941 montraient qu'une attaque pourrait avoir lieu sur Pearl Harbor. Dans sa synthèse historique récente Comment Roosevelt fit entrer les États-Unis dans la guerre, Arnaud Blin indique65 que l'agent double Dusko Popov avait dévoilé par un questionnaire des services secrets britanniques MI:5 que les amiraux japonais avaient réclamé à l'Abwehr une étude détaillée du bombardement par la RAF de la flotte italienne dans le port de Tarente les 11 et 12 novembre 1940. Bien que le directeur du FBI J. Edgar Hoover ait reçu l'espion Popov le 12 août 1941 dans son bureau, il ne transmit qu'un échantillon du questionnaire à la Maison Blanche. L’amiral Harold Rainsford Stark, chef des opérations navales américaines, avait envoyé un message d’alerte au commandant en chef des flottes de l’Asie orientale et du Pacifique à Hawaï. L'état-major américain redoutait donc une attaque japonaise, il ne l'attendait pas à Pearl Harbor : ils avaient une confiance aveugle dans l'isolement de l'île, située à plusieurs milliers de kilomètres du Japon. L'état-major américain était pour sa part convaincu que l’attaque aurait lieu aux Philippines ou à Singapour, ce qui ne constituait pas une cause de guerre selon les déclarations de Roosevelt. Arnaud Blin a donc la conviction que la surprise de Roosevelt était bien réelle lorsque Frank Knox l'informa de l'attaque. Le 7 décembre 1941, lorsqu'il apprend que Pearl Harbor a été attaquée, le secrétaire à la marine Frank Knox s'écria incrédule : " Mon Dieu, ça ne peut pas être vrai. Il s'agit sûrement des Philippines ! " Les défenses naturelles de Pearl Harbor semblaient la protéger efficacement. Les officiers américains craignaient davantage un acte de sabotage ou un débarquement plutôt qu'une attaque aérienne, jugée impossible. Les menaces qui leur furent transmises ne furent pas prises au sérieux. La mise en cause du président Roosevelt L'amiral Kimmel, déchu de son poste, contributeur de la thèse sur Roosevelt. Une thèse très controversée affirme que Roosevelt était au courant de l'attaque et qu'il laissa faire pour provoquer l'indignation de la population et faire entrer son pays dans la guerre. Cette théorie fut d'abord avancée par les officiers déchus par les commissions d'enquête : Husband Kimmel se dit victime d'un complot visant à cacher la responsabilité du gouvernement et de l'état-major. Il diffusa cette idée dans ses Mémoires parus en 1955. Le contre-amiral Robert Alfred Theobald, qui à Pearl Harbor commandait les destroyers, écrivit dans un ouvrage traduit en français : " Notre conclusion principale est que le président Roosevelt contraignit le Japon à faire la guerre en exerçant en permanence sur lui une pression diplomatique et économique, et l'incita à ouvrir les hostilités par une attaque surprise en maintenant la flotte du Pacifique dans les eaux hawaïennes comme appât." Cette thèse fut ensuite reprise par les adversaires de Roosevelt et de sa politique extérieure. Les négligences furent utilisées par les républicains pour discréditer le camp démocrate après 1945. Plus tard, plusieurs historiens américains, tels que Charles Beard et Charles Tansill ont essayé de prouver l'implication du président. Les faits cités à l'appui de cette hypothèse sont notamment l'absence supposée providentielle des trois porte-avions en manœuvre le jour de l'attaque et qui n'ont pas été touchés, le fait que les nombreux messages d'avertissement aient été ignorés et enfin les négligences locales. Certains soupçonnent le gouvernement américain d'avoir tout fait pour ne recevoir la déclaration de guerre japonaise qu'après le bombardement. Les partisans de cette thèse sont convaincus que Roosevelt a poussé les Japonais à la guerre tout au long des années 1930 afin de convaincre le peuple américain majoritairement isolationniste et partisan de la neutralité. Le président américain Roosevelt signant la déclaration de guerre contre le Japon, une fois son discours prononcé devant le Congrès. Il est cependant difficile d'imaginer que Roosevelt ait laissé détruire autant de bâtiments de la marine juste pour engager son pays dans la guerre. En effet, la valeur tactique des porte-avions était méconnue en 1941, même si d'évidence, compte tenu des investissements réalisés, les Japonais et les Américains fondaient de gros espoirs sur cette nouvelle unité marine. C'était encore le cuirassé qui faisait figure de navire principal dans les flottes de guerre et même l'amiral Yamamoto envisageait la confrontation finale entre les deux pays sous la forme d'un combat entre cuirassés. Dès lors, tout officier au courant de l'attaque aurait fait en sorte de protéger les cuirassés qui seraient alors partis au large en sacrifiant les porte-avions. Ce choix aurait été logique pour les autorités de la marine et aurait été paradoxalement plus néfaste aux Américains dans la poursuite de la guerre. L'amiral Chester Nimitz livre une analyse similaire dès 1945 : " Si l'amiral Husband Kimmel, alors commandant des forces américaines à Pearl Harbor, avait reçu 24 heures à l'avance la nouvelle de l'attaque, il aurait fait partir toutes nos forces à la rencontre des Japonais. Nous n'avions pas un seul porte-avions capable de s'opposer à la formation des porte-avions de l'amiral Nagumo, et les Japonais auraient coulé chacun de nos bateaux en haute mer. Nous aurions perdu 60 000 hommes et la quasi-totalité de notre flotte du Pacifique. " Quant au message d’alerte, il est arrivé trop tard à Pearl Harbor à cause du décalage horaire, du jour un dimanche, de maladresses et de problèmes techniques38. En outre, les services de renseignement américains travaillaient séparément et étaient souvent incompétents. Si la plupart des messages secrets ennemis étaient déchiffrés, ceux de la marine japonaise restaient souvent mystérieux. Les services japonais pratiquaient le jeu de la désinformation Par conséquent, rien ne permet d’affirmer que Roosevelt était au courant de l'attaque de Pearl Harbor, même s'il fait peu de doute qu'il a accumulé les actes contraires à la neutralité durant les années 1930. Cependant, les sanctions économiques visaient avant tout les Allemands, et le président américain donnait la priorité au théâtre d’opération européen comme le montre par exemple la conférence Arcadia, et la guerre contre le Japon ne fut jamais sa priorité absolue. Si Roosevelt et son entourage étaient conscients des risques de guerre provoqués par la politique de soutien au Royaume-Uni, à l'URSS et à la Chine, il n'y a pas d'indication qu'il ait souhaité l'attaque de Pearl Harbor. Le désastre fut provoqué par la préparation minutieuse des Japonais, par une série de négligences locales et par des circonstances particulièrement défavorables aux Américains. Liens http://youtu.be/pHBc4casyyo Pearl Harbour extrait de film en Français http://youtu.be/Ni_C4Ui06ck La bataille de Pearl Harbour et la chute de Singapour ( en anglais) http://www.ina.fr/video/AFE85000888/a ... aux-iles-hawai-video.html L'attaque jamponaise http://www.ina.fr/video/AFE86001080/i ... que-en-flammes-video.html Le pacifique en feu http://www.ina.fr/video/CPF91008495/l ... -partie-banzai-video.html La bataille du Pacifique    [img width=600]http://ww2history.com/uploaded_files/show/131_Pearl_Harbour_key_m
#4145
William Bligh
Loriane
Posté le : 06/12/2014 17:45
Le 7 décembre 1817 meurt William Bligh
à 63 ans, à Londres, né le 9 septembre 1754, administrateur colonial britannique et un officier de la Royal Navy.Il était marié avec Elizabeth Betham. Il est surtout connu pour la mutinerie qu'il subit alors qu'il commandait la Bounty, en avril 1789. Après celle-ci, nommé gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud, son administration est encore à l'origine d'une insurrection, la Révolte du rhum, dirigée par John MacArthur en 1808. Il fera toutefois une carrière honorable dans la Royal Navy, ayant commencé comme mousse à sept ans et terminant Vice-amiral. En bref La Bounty, vaisseau britannique commandé par un ancien officier de Cook, le lieutenant William Bligh, était venue chercher à Tahiti en 1789 des plants d'arbre à pain pour les colonies anglaises des Antilles. Le 29 avril, une mutinerie éclata à bord. Les causes en ont été discutées : il est possible que l'autorité de Bligh, exercée sévèrement, ait été contestée par certains de ses officiers. L'un deux, Fletcher Christian, suivi de quelques autres, se débarrassa de Bligh et de dix-huit de ses hommes en les abandonnant en pleine mer à bord d'une chaloupe. Après une traversée de plus de 5 000 kilomètres, la chaloupe réussit à gagner l'île de Timor le 12 juin, tandis que Fletcher Christian ramenait la Bounty à Tahiti, espérant s'y établir avec les mutins. Le projet échoua en partie puisque seulement seize mutins restèrent à Tahiti ; les autres, au nombre de vingt-sept Européens et dix-huit Tahitiens et Tahitiennes, Fletcher en tête, durent repartir pour atteindre une île, inconnue des cartes maritimes de l'époque, celle de Pitcairn, dans laquelle ils établirent une colonie. En 1791, Bligh ayant survécu, la frégate Pandora commandée par le capitaine Edward est envoyée dans les mers du Sud à la recherche des mutins. Ceux qui étaient restés à Tahiti, vivant dans l'entourage du roi Pomaré Ier, sont livrés par celui-ci. Le retour en Angleterre est mouvementé et la Pandora fait naufrage près de l'Australie. Parmi les survivants, arrivés en Angleterre et traduits en justice, cinq seront acquittés, deux bénéficieront des circonstances atténuantes, et les trois derniers seront pendus. Quant à Fletcher Christian et à ses compagnons, ils s'entretuèrent et il ne resta qu'un survivant mâle, Alexander Smith, sur l'île de Pitcairn. La colonie demeura dans l'île jusqu'en 1831, date à laquelle elle fut ramenée à Tahiti. Un des officiers de la Bounty a écrit un Journal qui, le premier, a fourni une documentation précieuse sur la société et l'histoire de l'île de Tahiti Société des océanistes, Paris, 1966. Mark Twain a repris le thème de cette mutinerie dans l'une de ses nouvelles. Sa vie William Bligh naît à Tinten Manor, dans le village de St Tudy en Cornouailles. Il est le fils unique de Francis Bligh décédé le 27 décembre 1780 et de Jane Pearce elle meurt lorsque William a quatorze ans, une veuve dont le nom de jeune fille était Balsam. William a son premier contact avec la mer en 1762, à l'âge de sept ans. Il embarque comme serviteur personnel du capitaine du HMS Monmouth. En 1770, il s'engage dans la Royal Navy sur le HMS Hunter et devient midship, l'équivalent d'aspirant l'année suivante en 1771, il sert ensuite sur le HMS Crescent et le HMS Ranger. Très tôt, il est remarqué pour son intelligence et ses dons en sciences et en mathématiques, ainsi que pour son talent pour le dessin et l'écriture. Il embarque avec James Cook sur le Resolution comme maître d'équipage. Ce voyage est marqué par la fin tragique de James Cook le 14 février 1779 aux îles Hawaï. Durant cette période, Bligh a observé les méthodes de Cook pour maintenir son équipage en bonne santé, notamment l’usage des agrumes contre le scorbut et l’exercice physique quotidien de l’équipage par de la danse sur le pont avec un musicien. Il reprendra tout cela à son compte, mais il ne sera pas compris par ses hommes sur la Bounty. Le 14 février 1781, profitant d’une période d'inactivité de douze mois, il épouse Elizabeth Betham, la fille d’un contrôleur des douanes dans l’église paroissiale d’Onchan, sur l’Île de Man. Il est déjà lieutenant de vaisseau, et il a effectué d’importants travaux hydrographiques pour la Navy. Peu de temps après son mariage, il réintègre le service et prend part à la bataille de Dogger Bank le 5 août 1781 et combat aussi aux côtés de Lord Howe à Gibraltar en 1782. Mutinerie de la Bounty. Le 16 août 1787, il prend le commandement du HMAV Bounty, à l’âge de trente-trois ans. Il appareille le 23 décembre 1787 du port de Spithead, laissant derrière lui sa femme et leurs deux filles. La suite est bien connue : Bligh tente de rallier Tahiti, but de sa mission. Il doit y embarquer des plants d’arbre à pain pour nourrir les esclaves des plantations des Antilles en passant par l’ouest. Pendant un mois, l'équipage tente en vain de franchir le cap Horn pour finalement rebrousser chemin et prendre la route du Cap de Bonne-Espérance où il fait escale. Après une deuxième escale à Adventure Bay en Tasmanie, l'expédition relâche à Tahiti le 26 octobre 1788. Ce contre-temps fait arriver la Bounty à la mauvaise saison pour récolter les arbres à pain, et Bligh doit patienter six mois pour embarquer sa précieuse cargaison. Pendant ce laps de temps la discipline se relâche, d’autant que l’accueil de la population est plus qu’amical. Finalement la Bounty appareille le 4 avril 1789 et fait route à l’ouest, prenant le même chemin qu’à l’aller. Le 27 avril Bligh annonce à son équipage son intention de faire route à l’est en passant par le cap Horn et de faire ainsi le tour du globe. Cette idée n’enchante guère l’équipage, l'échec du passage du cap Horn étant encore dans toutes les mémoires. Profitant du mécontentement d’une partie de l’équipage, le lieutenant Fletcher Christian prend la tête d’une mutinerie et s’empare du navire dans la nuit du 28 au 29 avril. Il décide d’abandonner Bligh et une partie de ceux qui lui sont fidèles 18 personnes dans une chaloupe... Il faut noter que la chaloupe ne pouvait pas accueillir plus de 19 personnes en tout, on peut supposer que parmi les personnes restées à bord du navire certaines ne faisaient pas partie du groupe des mutins, elles y prirent part malgré elles. C’est ici que commence l’exploit maritime, Bligh ne trace pas la route la plus facile pour atteindre un port espagnol d'où lui et ses hommes pourront être rapatriés, avec une attente probable, vers la Grande-Bretagne. Au lieu de cela, confiant dans ses dons de navigateur et considérant qu'il est de sa mission d'informer au plus vite l'Amirauté de la mutinerie, de façon à faire poursuivre les mutins, il prend la direction de Timor, ce qui implique une navigation de 3 618 milles marins soit 6 701 km. Bligh, sur une chaloupe non pontée d'à peine sept mètres de long, surchargée de dix-neuf hommes, sans carte ni boussole et avec à peine une semaine de vivres au départ, va naviguer de mémoire au travers du Pacifique, de la Grande barrière de corail pour arriver quarante et un jours plus tard à Kupang, dans l'île alors sous la souveraineté hollandaise. Il aura parcouru tout ce périple en bravant les tempêtes et les peuplades hostiles, ainsi que le début d’une nouvelle mutinerie, tant les conditions de survie sont dures, ne perdant qu’un seul homme, le premier maître Norton sur l’île de Tofoa. Un tel exploit ne peut être que le fait d’un marin exceptionnel. Bligh, de retour en Grande-Bretagne, passe en cour martiale devant l’Amirauté qui l'acquitte le 15 mars 1790 pour la perte du HMAV Bounty et même le félicite pour son exploit dans la chaloupe. À ce jour, les raisons de la mutinerie sont toujours discutées. Pour certains, c'est la tyrannie de Bligh qui força l'équipage à s'emparer du navire. D'autres pensent que l'équipage, ayant goûté à la vie facile de son escale tahitienne, ne pouvait se résoudre à se plier de nouveau à la discipline de bord, très dure à cette époque, et qu'en s'emparant du navire, il pouvait espérer retourner sur l'île pour y poursuivre une vie de confort et de plaisirs. Suite de sa carrière Bligh se voit confier le commandement de la HMS Falcon, puis il embarque sur la HMS Medea. En 1792, il commande la HMS Providence et se voit désigné pour recommencer la même mission qu’avec la Bounty. Il réussit sa mission avec succès cette fois-ci, en fait les esclaves des Antilles ne voudront jamais manger des fruits de l’arbre à pain, mais Bligh n’y est pour rien. Au cours de cette dernière mission, Bligh a pu aussi introduire le aki dans les Caraïbes, mais on n'a pas de certitudes sur ce fait ; néanmoins, cette plante a été nommée d'après lui, dans la classification, sous la forme Blighia sapida. En 1797 Bligh est commandant du HMS Director. Comme beaucoup de commandants, Bligh eut à subir la mutinerie du Nore en avril 1797. Il fut simplement déposé à terre par l'équipage de son navire au mouillage du Nore situé dans l'estuaire de la Tamise face à la mer du Nord. À l'issue de la mutinerie, Bligh toujours sur le HMS Director participe le 11 octobre 1797 à la bataille de Camperdown, il engage trois vaisseaux hollandais — le Haarlem, le Alkmaar et le Vrijheid. Alors qu'il inflige de lourdes pertes aux vaisseaux ennemis, seuls sept de ses hommes seront blessés durant le combat. Il reçoit la reddition du Haarlem. Au XIXe siècle, Dublin était considérée comme la deuxième ville des îles Britanniques, les bateaux y affluaient, mais le risque de s’ensabler dans la baie et le port trop étroit empêchaient le développement économique de la ville. Bligh suggère dans une étude faite en 1801 la construction d’un mur-digue parallèle à celui existant sur la rive sud de l’embouchure de la rivière Liffey. En canalisant le courant les deux digues doivent se resserrer vers la sortie du port la force de la rivière sera augmentée et elle creusera plus profond le lit de la baie, facilitant l’entrée des gros bâtiments qui seront ensuite à l’abri des digues par mauvais temps. La construction du North Bull Wall s’est déroulée de 1819 à 1824 pour une longueur de 1,7 km. Au fil du temps et des marées, le sable s’est accumulé le long du mur pour former aujourd’hui des dunes de 6 mètres de haut qui ne cesse de croître en direction de la mer, refuge artificiel des oiseaux et des phoques. Puis le 2 avril 1801, c'est en tant que commandant du HMS Glatton qu'il prend part à la bataille de Copenhague sous les ordres de l'amiral Nelson. Ce dernier le félicite pour sa bravoure lors du combat. C'est aussi cette année qu'il est élu membre de la Royal Society, elle l'avait déjà recommandé pour la mission du Bounty en considération de ses services tant en navigation qu’en botanique. 1805 le voit nommé comme gouverneur de la toute jeune colonie de Nouvelle-Galles du Sud. Encore une fois, son administration rigide mais surtout la corruption des militaires du 102e régiment d’infanterie de la garnison seront à l'origine d'une insurrection, la Révolte du rhum dirigée par John MacArthur, un marchand de laine, à Sydney en 1808. Il est déposé de son poste par le Major George Johnston et emprisonné durant deux années. C’est son remplaçant, envoyé pour remettre de l’ordre avec un nouveau régiment, qui le délivre. À son retour, la Cour le lave de toute responsabilité et fait enfermer Johnston à l’hôpital de Chelsea. Bligh est ensuite promu Contre-amiral de la Flotte bleue en 1810 puis finit Vice-amiral en 1814. Il passe les dernières années de sa vie dans son manoir de Farningham, dans le Kent, mais c'est à Londres, dans Bond Street qu'il meurt le 7 décembre 1817 à l’âge de 63 ans. Il est enterré dans la partie est du cimetière de l’église de Lambeth, où il repose à côté de son épouse qui lui a donné six filles. Sa tombe est surmontée d'une sculpture d'un fruit de l'arbre à pain. Dans les années 1980, un de ses lointains descendants qui vivait en Australie tenta de rééditer l'exploit de la traversée en chaloupe faite depuis la Bounty avec une équipe de sportifs et de scientifiques, mais ils durent arrêter en cours de route leur challenge devant la difficulté et la mésentente. Le cinéma au travers de trois films a donné l'image d'un William Bligh, capitaine tyrannique qui malmène l'équipage de son navire, la Bounty, face à l'un de ses officiers, Fletcher Christian, défenseur des opprimés. Il est probable que Bligh n'ait pas été plus cruel que les autres commandants britanniques de son époque. Il a été, sans aucun doute, un marin hors pair ; sa navigation après la mutinerie de la Bounty, aussi bien que son comportement lors des batailles navales, en sont les preuves incontestables. Ces qualités lui furent d'ailleurs reconnues par ses supérieurs, puisqu'il fit une carrière honorable dans la Royal Navy, ayant commencé mousse à sept ans et terminant Vice-amiral. Carrière militaire Dates Grade et navire ou fonction 1er juillet 1762 engagement comme mousse et serviteur du commandant sur le HMS Monmouth 27 juillet 1770 Matelot breveté sur le HMS Hunter. 5 février 1771 Aspirant sur le HMS Hunter. 22 septembre 1771 Aspirant sur le HMS Hunter. 2 septembre 1774 Matelot breveté sur le HMS Ranger. 30 septembre 1775 Second maître HMS Ranger. 20 mars 1776 Maître d'équipage sur le HMS Resolution dernière expédition de James Cook. 14 février 1781 Maître d'équipage sur le HMS Belle Poule. 5 octobre 1781 Lieutenant sur le HMS Berwick. 1er janvier 1782 Lieutenant sur le HMS Princess Amélia. 20 mars 1782 Lieutenant HMS Cambridge. 14 janvier 1783 Bligh rejoint la marine marchande comme Lieutenant. 1785 Commandant en tant que Lieutenant du navire marchand Lynx. 1786 Lieutenant sur le navire marchand Brittania. 1787 Bligh retourne au service actif de la Royal Navy. 16 août 1787 promu en tant que Lieutenant comme commandant du HMAV Bounty. 14 novembre 1790 promu Capitaine de vaisseau, commandant du HMS Falcon. 15 décembre 1790 Capitaine de vaisseau HMS Medea. 16 avril 1791 Capitaine de vaisseau HMS Providence. 30 avril 1795 Capitaine de vaisseau HMS Calcutta. 7 janvier 1796 Capitaine de vaisseau HMS Director. 18 mars 1801 Capitaine de vaisseau HMS Glatton. 12 avril 1801 Capitaine de vaisseau HMS Monarch. 8 mai 1801 Capitaine de vaisseau HMS Irresistible. 2 mai 1804 Capitaine de vaisseau HMS Warrior. 14 mai 1805 Gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud Australie. 27 septembre 1805 Capitaine de vaisseau HMS Porpoise. 31 juillet 1808 promu Commodore, HMS Porpoise. 3 avril 1810 Commodore HMS Hindostan. 31 juillet 1810 nommé Contre-amiral de la flotte Bleue Rear Admiral of the Blue. 4 juin 1814 nommé Vice-amiral de la flotte Bleue Vice Admiral of the Blue. Liens http://www.ina.fr/video/CPB78051961/l ... ltes-du-bounty-video.html Les révoltés de la Bounty http://youtu.be/_hmhY7ETetk Les révoltés de la bounty (anglais) http://youtu.be/MXHp0WATp8k Les révoltés sur Pitcairn http://youtu.be/BPrWYgcl9AQ Révoltés du Bounty        [img width=600]http://media.liveauctiongroup.net/i/9882/10658278_2.jpg?v=8CE70FE1D1F1900[/img]  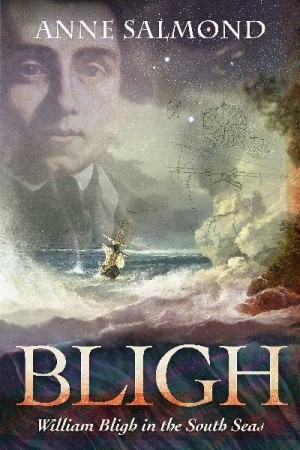
#4146
Jean Mermoz 1
Loriane
Posté le : 06/12/2014 17:32
Le 7 décembre 1936, à 34 ans, disparaît Jean mermoz dans l'Atlantique sud, né le 9 décembre 1901à Aubenton dans l'aisne, aviateur français, figure légendaire de l'Aéropostale, surnommé l"Archange .Il est aussi un des fondateurs en 1936 du Parti social français PSF avec le colonel de La Rocque. Après avoir appartenu, de 1920 à 1924, à l'armée de l'air, il entra chez Latécoère et devint l'un des pilotes de l'Aéropostale, s'illustrant notamment par l'établissement de la ligne Buenos Aires-Rio de Janeiro 1928 et le franchissement de la cordillère des Andes (1929). Le 12 mai 1930, il réussit la traversée de l'Atlantique sud sans escale, dans le sens est-ouest, puis, le 15 mai 1933, la traversée en sens inverse, de Natal à Saint-Louis du Sénégal. Il disparut en mer, au large de Dakar, à bord de l'hydravion Croix-du-Sud. Le 7 décembre 1936 disparaissait dans l'Atlantique Sud le Latécoère "Croix du Sud" avec à son bord Jean Mermoz et son équipage, Cruveilher, Ezan, Lavidalie et Pichodou. La stature et la réputation d'invulnérabilité de ce géant de l'aviation qu'était Mermoz étaient telles que sa disparition semblait impossible. Longtemps, Saint-Exupéry, et avec lui une foule de gamins, attendront une nouvelle résurrection du "Grand". Sa vie Il est le fils de Jules Mermoz, maître d'hôtel, et de Gabrielle Gillet dite Mangaby -1880-1955, chevalier de la Légion d'honneur en 1952. Le couple se sépare dès 1902 et divorcera en 1922. Mermoz passe une partie de son enfance chez son grand-père à Mainbressy, village situé au sud d'Aubenton avant d'intégrer l'École supérieure professionnelle d'Hirson en tant que pensionnaire, puis le lycée d'Aurillac. En 1917 sa mère l'amène à Paris où il est admis au lycée Voltaire avec une bourse de demi-pensionnaire. En 1930, Jean Mermoz épouse Gilberte Chazottes, qui, veuve, se remariera avec l'ingénieur René Couzinet. Gilberte Chazottes et René Couzinet se suicideront le 16 décembre 1956. Engagement dans l'armée En avril 1920, Jean Mermoz signe un engagement dans l'armée pour quatre ans ; il choisit l'aviation sur les conseils de Max Delty, un chanteur d'opérette. Après un passage à la 7e escadrille du 11e régiment de bombardement de Metz-Frescaty, il a l'occasion de quitter les casernes et de partir en Syrie en 1922 : il y réalise six cents heures de vol en dix-huit mois et découvre le désert, notamment lors d'un atterrissage forcé. Cependant, il doit revenir en France au 1er régiment de Chasse à Thionville-Basse-Yutz . Son dégoût pour la chose militaire se renforce. Il est démobilisé en mars 1924. C'est alors que Mermoz connaît l'une des périodes les plus noires de son existence. Ne trouvant pas d'emploi auprès des compagnies aériennes, il connaît la misère et doit vivre de petits emplois. Enfin, il reçoit le 28 septembre 1924 une proposition de contrat des Lignes aériennes Latécoère, dirigées par Didier Daurat. L'épopée de l'aviation postale Le désert Mermoz commence comme mécano. Mais il est rapidement affecté en qualité de pilote sur la ligne Toulouse-Barcelone, sur Breguet XIV. La ligne franchissant les Pyrénées est un défi pour les avions de l'époque. En 1925, Mermoz assure la liaison Barcelone-Malaga et, en 1926, prend en charge le courrier sur la liaison Casablanca-Dakar. En mai 1926, perdu au milieu du désert avec son mécano, il est capturé par les Maures, puis est libéré contre rançon. En novembre, il sauve Éloi Ville, contraint à atterrir dans le désert. Les 10 et 11 octobre 1927, Mermoz et Négrin réussissent un vol sans escale de Toulouse à Saint-Louis du Sénégal à bord d'un Laté 26. Cependant, à la suite d'un incident à l'atterrissage, sans dommage pour l'équipage, la traversée de l'Atlantique Sud est reportée. L'Amérique du Sud et la cordillère des Andes En 1927, Marcel Bouilloux-Lafont, président et fondateur de la Compagnie générale aéropostale qui prend la suite des Lignes aériennes Latécoère envoie Mermoz à Rio de Janeiro afin de développer de nouvelles liaisons en Amérique du Sud. Pour cela, il faut franchir un obstacle majeur : la cordillère des Andes. Au cours d'une tentative de franchissement, Mermoz doit se résoudre à un atterrissage en montagne, puis parvient à redécoller acrobatiquement en lançant son avion dans un précipice et à rebondir à trois reprises sur des crêtes en deçà, parvenant ainsi à prendre de la vitesse en piquant. Le 15 juillet 1929, il ouvre la ligne des Andes avec Henri Guillaumet. En mai 1930, avec le radiotélégraphiste Léopold Gimié et le navigateur Jean Dabry, il réalise sur avion Latécoère, la première liaison entièrement aérienne entre la France, Dakar et l'Amérique du Sud. Il établit plusieurs lignes régulières. La traversée de l'Atlantique Sud Les 12 et 13 mai 1930, il relie d'un trait Saint-Louis à Natal au terme d'un vol de 21 heures et 10 minutes sur un hydravion Laté 28-3 baptisé le Comte de la Vaulx, du nom du président de la Fédération aéronautique internationale FAI qui venait de disparaître tragiquement dans un accident d'avion. Mermoz prouve ainsi que le courrier peut être transporté d'un continent à l'autre avec le même appareil alors que, avant cet exploit, il fallait en utiliser plusieurs. Moins de trois ans plus tard, parti le 12 janvier 1933 de l'aérodrome de Paris-Le Bourget, Mermoz atterrit à Buenos Aires le 22 à bord du Couzinet 70 Arc en Ciel. Entre 1930 et 1936, Mermoz aura effectué vingt-quatre traversées de l'Atlantique Sud. L'avion qu'il pilote, la Croix-du-Sud, un Latécoère 300, disparaît en mer le 7 décembre 1936 avec à son bord Alexandre Pichodou, copilote, Henri Ézan, navigateur, Edgar Cruvelhier, radio, et Jean Lavidalie, mécanicien. À 10 h 43, Edgar Cruvelhier lance le dernier message radio depuis la Croix-du-Sud : Avons coupé moteur arrière droit, sans détail supplémentaire, et complète en répétant les coordonnées de position : 11°08 Nord, 22°40 Ouest. Malgré de nombreuses recherches, on ne retrouva aucune trace de l'appareil ni de son équipage. La politique Déçu par le manque de volonté politique des gouvernements qui se succèdent en France, Mermoz tente de sauver la ligne postale aérienne France-Amérique du Sud menacée par l'Allemagne et les États-Unis en usant d'un porte-voix politique. Il rejoint alors le mouvement nationaliste Croix-de-feu en adhérant à l'association des Volontaires nationaux. Les Croix-de-Feu, en effet, ne regroupent dans leurs rangs que des anciens combattants décorés de la Croix de guerre, ce qui n'est pas le cas de Mermoz, né en 1901. Pendant cette période, il imagine et prône une aviation où la jeunesse française pourra accéder à des valeurs sociales exemptes d'intérêts politiques partisans. Améliorez sa qualité à l'aide des conseils sur les sources ! Il enseigne notamment les bases de l'aéronautique à des jeunes issus de milieux modestes à l'Association philotechnique de Colombes, près de Paris. Son idée sera reprise plus tard par les créateurs de l'aviation populaire. Après la dissolution des ligues par le Front populaire, Mermoz deviendra vice-président du Parti social français PSF, fondé par François de La Rocque, dernier président des Croix-de-Feu. Hommages France Jean Mermoz est fait commandeur de la Légion d'honneur le 4 août 1934. En 1934, Il est lauréat du Prix Henri Deutsch de la Meurthe de l'Académie des sports, qui récompense un fait sportif pouvant entraîner un progrès matériel, scientifique ou moral pour l’humanité. En 1937, trois timbres postaux, un vert-gris, un vert-jaune valant tous deux 30 ct et un lilas valant 3 francs sont émis. En 1998, l'équipage du Catalina périple de Mermoz et du Courrier du Sud, composé de Patrick Baudry, Franklin Devaux et Patrick Fourticq, s'est vu décerner le Prix André de Saint-Sauveur de l'Académie des sports pour son exploit commémoratif. Les pilotes d'Air France ont longtemps porté la cravate noire, mais depuis peu peuvent opter pour du bleu marine, pour rappeler le deuil de Mermoz et de Guynemer pour les militaires. Parmi toutes les manifestations qui ont salué en France le cinquantenaire de la disparition de Jean Mermoz, deux initiatives laisseront une trace plus durable : une plaque à l'effigie du pilote est dévoilée, le 4 décembre 1986, sur l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, par Jacques Douffiagues, le ministre chargé des Transports. Quelques jours plus tard, à Aubenton, où est né l' Archange , le maire Christian Pillot et le docteur Alain Schlienger inaugurent un musée Mermoz sur la place du village : À jamais, Aubenton gardera ta mémoire, Aubenton, ô Mermoz ! que tu couvres de Gloire. Le stade du club de football de l'AS Orly Val-de-Marne porte le nom de Jean-Mermoz. Les collèges des villes de Laon, Yutz, Marly en Moselle, de Biscarrosse Landes, de Faches-Thumesnil, de Bois-Colombes, de Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales ainsi que les lycées des villes de Montpellier dans l'Hérault, Saint-Louis dans le Haut-Rhin et Aurillac dans le Cantal ainsi que le lycée de Dun-sur-Meuse Meuse portent le nom de Jean Mermoz. L'ancien aéroport de Grenoble, dénommé aéroport de Grenoble-Mermoz fermé en 1967 Amérique Latine Dans les pays latino-américains, la mémoire de Mermoz est vive. À Buenos Aires, capitale de l'Argentine, une plaque rappelle le lieu où se trouvait le bureau de l'Aéropostale. À l'aéroport, un monument est dédié à Jean Mermoz y sus compañeros. Au lycée franco-argentin qui porte son nom, construit en forme d'avion, les élèves ont dessiné pour le cinquantenaire de sa mort des épisodes de sa vie. Grâce au pont aérien qu'il organisa sur la cordillère des Andes. Le Chili garde reconnaissance de l'avoir sorti de son isolement. Santiago, la capitale, a baptisé une de ses artères en son honneur. On y trouve une stèle avec cette phrase de Kessel : La route céleste l'attirait comme un aimant. Une autre stèle lui est dédiée sur l'aéroport de Campos dos Alfonsos aéroport militaire de Rio de Janeiro au Brésil. Sénégal À Dakar, on trouve plusieurs lieux qui rappellent son passage : – un hôtel sur l'avenue Albert-Sarraut porte le nom de son avion, la Croix du Sud ; – l'un des plus prestigieux quartiers situé à 4 km du centre-ville porte son nom; ce quartier est au bord de l'ancienne piste d'atterrissage de la base française ; – le lycée français de Dakar porte son nom. Mes vols par Jean Mermoz Œuvres et citations Citations de Mermoz L'accident, pour nous, ce serait de mourir dans un lit. Ce sont les échecs bien supportés qui donnent le droit de réussir. La vie moderne autorise les voyages, mais ne procure pas d’aventure Tu sais, je voudrais ne jamais descendre. Récit de Philippe Ballarini " Avons coupé moteur arrière droit " Né en 1901, le jeune garçon timide qui se passionnait pour la poésie devint rapidement une sorte de géant à l'épaisse chevelure dont la carrure athlétique fera tourner la tête à nombre de femmes de par le monde. Rien ne semblait pourtant destiner cet adolescent sensible qui se vouait à la sculpture ou au journalisme à une glorieuse carrière d'aviateur. Une enfance austère, une adolescence bousculée par la Grande Guerre, il terminait ses études en 1919 en échouant à l'oral du baccalauréat : Jean ne réalisera pas le rêve de sa mère tant aimée, "Mangaby" Gabrielle, qui rêvait pour lui d'une préparation à l'École Centrale. Alors qu'il allait s'engager dans l'Armée, c'est sur les conseils d'un chanteur d'opérettes, Max Delby, qu'il opta pour l'aviation, signant en avril 1920 un engagement de quatre ans. Après ses classes, il fut envoyé comme élève pilote à la base d'Istres. Pilote-né, Jean Mermoz ne l'était sans doute pas, puisqu'il échoua à deux reprises à son brevet de pilote avant de le décrocher le 2 février 1921. Après sa formation, le caporal Jean Mermoz dut rejoindre la 7éme escadrille du 11ème régiment de bombardement de Metz-Frescaty il s'y ennuya ferme avant de partir l'année suivante, en 1922, pour la Syrie où il connut ses premiers contacts avec le désert : après un atterrissage forcé, il mit quatre jours de marche dans la montagne et le désert avant de rejoindre sa base. En mars 1923, il lui fallut s'arracher aux délices du Levant. C'en fut fini des nuits de Beyrouth et de la liberté de Palmyre. Après un voyage de retour où se manifesta le paludisme qu'il avait contracté au Moyen-Orient, il dut se résoudre au retour à la vie de caserne au 1er Régiment de Chasse à Thionville. Mermoz, qui n'avait guère de goût pour l'armée, se mit à la détester. C'est un pilote aguerri qui, en mars 1924, fut démobilisé… et se retrouva sans emploi. Sans doute l'aviation était-elle en plein essor, mais elle ne manquait pas de pilotes démobilisés. Aussi c'est sans succès qu'il frappa à la porte de compagnies d'aviation ou de constructeurs, traversant une période très dure, où il fut réduit à la soupe populaire et aux asiles de nuit sordides. C'était l'époque où, à Toulouse, Latécoère lançait l'extraordinaire aventure de sa ligne. Son génie avait consisté à s'entourer des meilleurs pilotes de la dernière guerre à peine éteinte, sans distinction de camp, comme l'ex commandant de la célèbre escadrille des Cigognes, Dombray, ou Doerflinger, qui avait été son adversaire... Et c'est à l'intraitable Didier Daurat que Latécoère avait confié l'exploitation de la "Ligne". Mermoz, ayant entendu dire que Latécoère embauchait, se rendit donc à Toulouse et se présenta à Didier Daurat. Lorsque ce dernier lui indiqua un appareil sur la piste et lui demanda de faire un petit vol d'essai, Mermoz fut enchanté: cette fois était la bonne! Avec ses 600 heures de vol, et sa maîtrise du pilotage, il était certain d'être engagé. Il effectua une démonstration de ses talents, enchaînant des figures aériennes avant de se poser, radieux. Il dut vite déchanter. Daurat n'était même plus sur la piste: il avait simplement regagné son bureau. C'est un Mermoz désappointé qui alla le rejoindre. Daurat fut net: ici, on avait besoin de pilotes, pas d'acrobates! Mermoz, dépité, allait franchir le seuil du bureau quand Daurat le rappela: il allait commencer comme mécano, après, on verrait bien! L'homme de fer de Latécoère avait jaugé son homme: certainement un très bon pilote, mais à qui il appliquerait, comme aux autres, la rigueur qui était de règle chez Latécoère. Mermoz l'acrobate aurait tout le temps de le faire lorsqu'il sera pris dans une tourmente au-dessus des Pyrénées. L'histoire d'amour qui se tissera entre la "Ligne" et Mermoz était née dans le coup de gueule de Daurat. C'est dans cette entreprise folle qu'était la "Ligne" que Mermoz deviendra Mermoz, le "Grand", comme l'appellera Saint-Exupéry. Daurat ne le laissera guère moisir dans les ateliers: il l'affectera bien vite à la ligne Toulouse-Barcelone, vraisemblablement soucieux de ne pas laisser filer un bon pilote. Si de nos jours, un tel trajet semble anodin, voire banal, il suffit de jeter un œil sur ce qu'étaient les machines de l'époque. Le Breguet XIV utilisé pour cette liaison était certes une excellente machine, l'un des artisans méconnus de la victoire de 1918, mais passer les Pyrénées par tous les temps avec un tel engin n'était pas une sinécure. La "Ligne" Latécoère, qui joignit d'abord Toulouse à l'Espagne, s'étirait de plus en plus loin. Le saut de puce qui avait porté ses couleurs à Barcelone, dès la fin de la Grande Guerre, s'était mué en long périple qui, après Alicante, atteignant le Maroc où Latécoère avait livré le journal de la veille à l'emblématique Lyautey, sans oublier un bouquet de violettes de Toulouse pour Madame la Maréchale. Puis ce fut le dangereux survol du désert mauritanien pour joindre les étapes de Cap-Juby, Villa Cisneros, Port Etienne et enfin Saint-Louis du Sénégal et Dakar. Comme ses autres compagnons, Mermoz survolera régulièrement la partie du Sahara qui longe l'Atlantique, lieu de tous les dangers. Une panne de moteur, par ailleurs assez fréquente, et c'était la catastrophe. Les options étaient aussi nombreuses que peu réjouissantes: la noyade dans l'Atlantique, l'écrasement au sol, la soif et la mort par petit feu sous le soleil africain, à moins que les bandes de bandits qui hantaient la région n'égorgent proprement le pilote perdu dans le désert. Mermoz aura plus de chance que certains de ses compagnons: en mai 1926, à la suite d'une panne, il fut capturé par les Maures et libéré contre rançon. La "Ligne" ne fut pas qu'une aventure extraordinaire, ce fut le lieu d'une mystique où la carte postale expédiée de Toulouse à un fiancé en poste au Sénégal valait la vie d'un pilote. Outre un gouffre financier, ce fut le tombeau d'un grand nombre de navigants: entre 1920 et 1923, un de chez Latécoère disparaissait chaque mois. Pour mettre fin à cette hécatombe, Latécoère se lança en 1927 dans la construction d'appareils plus performants, destinés à remplacer les bons vieux Breguet XIV. Ce fut la naissance des Laté 25 et Laté 26 qui donnaient aux pilotes davantage de chances de parvenir sains et saufs à destination. Si le trajet Casablanca-Dakar, sur lequel était affecté Mermoz n'était pas encore de la routine, au moins ne relevait-il plus du déraisonnable. Acheminer la poste jusqu'à Dakar, c'est bien, mais il fallait aller plus loin. De l'autre côté de l'Atlantique Sud, d'autres pilotes et mécaniciens talentueux, comme Vachet, Hamm et Lafay, avaient défriché les lignes d'Amérique du Sud, de Natal à l'extrême ouest du Brésil à Rio de Janeiro, Montevideo et Rio de Janeiro avant de se lancer à l'assaut de la cordillère des Andes pour atteindre la côte de l'Océan Pacifique à Santiago du Chili. L'objectif était de joindre Toulouse à Santiago dans des délais de plus en plus courts. L'acheminement du courrier entre Saint-Louis du Sénégal et Natal s'effectuait par voie maritime à bord d'un aviso. Il devenait urgent que la "Ligne", devenue en 1927 l'Aéropostale lorsque Latécoère céda ses parts au dynamique industriel Bouilloux-Lafont, mette en place une liaison entièrement aérienne entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud. La concurrence allemande se faisait jour sous la forme d'une liaison alliant sur l'Atlantique Sud hydravion et bateau, qu'allaient bientôt remplacer les "Zeppelin". En attendant un appareil capable vaincre l'Atlantique Sud de façon régulière, Mermoz travailla à la mise en place des vols de nuit, établissant une liaison nocturne entre Rio de Janeiro et Buenos Aires les 16 et 17 avril 1928. C'est l'année suivante, en mars 1929, qu'avec Collenot, il se lança dans une nouvelle tentative d'établir une route par-dessus les Andes. Rabattus contre la montagne par des vents violents, les deux hommes mirent quatre jours à rafistoler leur appareil dans des conditions épouvantables, avant de s'envoler à nouveau dans des conditions relevant de l'acrobatie et de gagner Santiago du Chili. Il devint évident en 1930 à Marcel Bouilloux-Lafont que la mise en place d'une liaison exclusivement aérienne relevait de l'urgence. C'est ainsi que le 12 mai 1930, Mermoz, accompagné du navigateur Jean Dabry et du radio Léopold Gimié, embarqua à bord du Laté 28, un monomoteur à flotteurs baptisé "Comte de la Vaulx", pour joindre Natal, assurant ainsi la première liaison aérienne postale sur l'Atlantique Sud, après un trajet de vingt et une heures. La liaison postale aérienne reliant la France à l'Amérique du Sud via les côtes africaines était née, l'Aéropostale, quant à elle, vivait ses dernières heures. Si la crise économique de 1929 et la révolution brésilienne n'avaient pas suffi à briser l'élan de l'énergique Bouilloux-Lafont, le lâchage sordide dont il fut la victime sonnèrent le glas de sa prestigieuse entreprise dont il dut déposer le bilan en 1931. Au début des années trente, Mermoz fit la connaissance d'un constructeur aux idées de génie, René Couzinet, qui lui confiera l'un des appareils les plus élégants de l'histoire de l'aviation, l'Arc en Ciel. A bord de ce trimoteur racé et efficace, il effectua en janvier 1933 une liaison spectaculaire entre Paris et Buenos-Aires, accompagné comme à l'accoutumée d'un équipage éprouvé. Il effectua plusieurs rotations avec l'"Arc en Ciel". C'est l'année suivante qu'il ouvrira la liaison régulière entre la France et l'Amérique du Sud. Entre temps, on a préféré au Couzinet "Arc en Ciel" les nouveaux hydravions à coque de Latécoère, la série des Laté 300. C'est à bord de l'un d'entre eux, le Laté 300 "Croix du Sud", que Mermoz effectua 24 traversées entre 1934 et 1936. Air France était née le 30 août 1933: on nomma en 1935 Jean Mermoz Inspecteur Général. Il avait été fait commandeur de la Légion d'Honneur en 1934 et, l'été 1935, s'était lancé dans des liaisons rapides entre la France et l'Afrique du Nord à bord d'un De Havilland DH 88 "Comet", un petit bimoteur exceptionnel. Le 7 décembre 1936, pour sa 25e traversée sur "La Croix du Sud", l'hydravion quadrimoteur effectuait un faux départ en raison d'une fuite d'huile. Après réparation, l'appareil décollait, emportant vers leur destinée son équipage. Quelques heures après, ce fut le dernier message: « Avons coupé moteur arrière droit. » On peut raisonnablement penser aujourd'hui à une rupture de l'arbre d'hélice de ce moteur arrière droit qui avait donné du souci au décollage. Cette hélice, se détachant, aurait-elle percuté et profondément cisaillé, voire coupé le fuselage au moment même où Edgar Cruveilher lançait son dernier message ? Nul ne peut confirmer ou infirmer cette hypothèse plausible avec certitude. Jean Mermoz, une sorte d'idole de son époque, avait disparu, après 8200 heures de vol. Ironie du sort, celui qui avait tant prêché avec son ami René Couzinet la cause de l'avion "terrestre" rapide, avait péri avec son équipage dans un hydravion à coque. Sa droiture, son courage et son intégrité en avaient fait un meneur respecté. Respecté, mais dérangeant. Son refus de voir immoler l'Aéropostale et son soutien à Marcel Bouilloux-Lafont, celui qu'il apporta à René Couzinet et à ses avions terrestres alors qu'un puissant courant se manifestait en faveur de l'hydravion, l'avaient amené à une opposition manifeste au Ministère de l'Air. Quand bien même Mermoz, vraisemblablement profondément déçu par les manœuvres économico-politiques qui sonnaient le glas de l'Aéropostale, et ultérieurement de René Couzinet, n'avait pas caché ses sympathies pour les "Croix de feu" du colonel Delarocque, il reçut un vibrant hommage du Ministre le l'Air socialiste Pierre Cot, le 30 décembre 1936 aux Invalides et fut cité à l'Ordre de la Nation. Cette fois, Mermoz, le "Grand", ne ressusciterait pas. Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=7402#forumpost7402
#4147
Jean Mermoz 2 et histoire de l'aviation
Loriane
Posté le : 06/12/2014 17:27
Histoire de l'aviation
L'histoire de l'aviation prend sa source dans le désir immémorial des hommes de s'élever dans les airs ; la légende d'Icare en témoigne. Mais c'est à la Renaissance, avec Léonard de Vinci, que la première étude raisonnée sur le vol humain trouve son expression. On remarque que, si l'art de la navigation a pu se développer empiriquement au cours des siècles et au hasard des rivages, l'histoire de l'aviation est indissolublement liée aux progrès mêmes de la science ; pour imiter ce que les oiseaux font en se jouant, l'homme est obligé d'en appeler aux ressources les plus abstraites de son génie. Les ascensions réussies de la montgolfière gonflée d'air chaud en 1783 et le développement des ballons à hydrogène auraient retardé la naissance et les progrès de l'aviation si ceux-ci n'avaient dépendu du perfectionnement du moteur à explosion. Il n'en fallut pas moins l'entêtement ou le génie des promoteurs du planeur ou de l'hélice pour triompher de l'idée que, pour évoluer dans l'air, il fallait être plus léger que lui. Si l'oiseau bat des ailes ou plane, si le ballon ou le dirigeable flotte dans l'air, le planeur ne vole que parce qu'il tombe. Dans sa chute, il acquiert la vitesse qui la retarde. Course de l'air sous l'aile au profil calculé et attraction terrestre sont les composantes de la force qui soulève l'avion vers le ciel. L'hélice en brassant l'air, le réacteur en propulsant l'appareil lui donnent cette vitesse qui l'appuie sur le vent comme sur un solide. C'est pourquoi on ne parlera ici ni de l'aérostation ou vol des ballons ni de l'astronautique déplacement des astronefs dans le vide. Entre le premier vol – contesté – de Clément Ader 1890 et le premier vol contrôlé effectué par les frères Wright, il s'est écoulé quatorze ans. Cinq ans plus tard, en 1909, Louis Blériot traverse la Manche, et les chancelleries mesurent les conséquences de l'événement. Deux guerres allaient contribuer aux progrès foudroyants de l'aviation, élément désormais caractéristique de la civilisation mécanique. Seuls les pays disposant d'un haut potentiel industriel sont en mesure aujourd'hui de posséder une aviation. Louis Blériot 1872-1936, ingénieur français, industriel et pionnier de l'aviation, fut le premier à traverser la Manche, le 25 juillet 1909. Des origines aux environs de 1900 Avant même de voler, le premier problème qui s'est posé à l'homme désireux d'imiter les oiseaux a été celui de quitter le sol. La légende cède peu à peu la place à l'histoire et, après les livres saints de toutes les religions, dont certains sont de véritables « volières », les textes des chroniqueurs apportent quelque précision sur les « mécanismes ingénieux » capables de faire voler l'homme. Aristote et Galien se penchent sur le problème, Aulu-Gelle décrit la fameuse colombe d'Archytas et les poètes célèbrent le malheureux Icare, tandis que les mathématiciens s'intéressent davantage à son père, l'inventeur Dédale. Accrochés à des oies, des condamnés à mort sont précipités du haut des falaises ; d'autres, des ailes sur le dos, s'élancent de points élevés, tours et collines, font quelques battements et tombent ou atterrissent un peu plus loin et un peu plus bas que leur point de départ. Beaucoup y laissent leur vie. L'histoire retient parfois leur nom. Vers 1500, Léonard de Vinci, le premier, étudie scientifiquement le problème. Des pages et des pages d'écriture, plus de quatre cents dessins l'attestent : le Florentin a pressenti l'hélicoptère, le parachute. On dit même qu'il aurait essayé un planeur en vraie grandeur. Au XVIe siècle, l'Anglais Bate introduit en Europe la mode du cerf-volant, empruntée aux anciens Chinois. Guidotti, Burattini, Allard sont les héros de tentatives malheureuses. En 1673, on signale un serrurier du Mans, Besnier, qui, avec des surfaces à clapets, aurait réussi à voler. En 1742, le marquis de Bacqueville aurait parcouru quelque trois cents mètres au-dessus de la Seine, à Paris. En 1783, la découverte de l' aérostat par les frères Montgolfier suscite un engouement tel pour les globes que les recherches sur les appareils plus lourds que l'air seront suspendues et vont prendre un certain retard. Blanchard, Resnier de Goué, Degen, Berlinger deux Français, un Suisse, un Allemand proposeront bien quelques solutions et tenteront même quelques expériences en vol, mais il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle pour trouver celui que les Anglais ont appelé l'inventeur de l' aéroplane , sir George Cayley. En 1796, reprenant les travaux des Français Launoy et Bienvenu, il construit un hélicoptère. En 1799, il grave sur un disque d'argent la représentation des forces aérodynamiques sur un profil d'aile. En 1808, il dessine un ornithoptère à l'échelle de l'homme. En 1809, il construit un planeur qui vole sans passager. En 1843, il dessine le premier modèle de convertiplane et, en 1849, construit un planeur qui aurait été expérimenté avec un passager. Montgolfière Le 21 novembre 1783, au château de la Muette, à Paris, Pilâtre de Rozier et le marquis d'Arlandes effectuent la première ascension à bord d'un ballon à air chaud conçu par les frères Montgolfier. Vers la même époque, deux autres Anglais, Henson et Stringfellow, furent bien près de trouver la solution. Si l'Ariel, dont nous possédons de très nombreuses gravures publiées à l'époque, ne fut jamais construit, il n'en reste pas moins que Stringfellow, continuant les travaux de Cayley et de Henson, fit voler pour la première fois dans l'histoire un modèle réduit d'aéroplane à vapeur. C'est en 1856, avec le Français Jean-Marie Le Bris, que les premiers essais de planeur avec passager ont lieu, et c'est encore avec lui, en 1868, que sera prise la première photographie d'un plus lourd que l'air, en vraie grandeur. En 1862, on aura noté l'invention du mot aviation par Gabriel de La Landelle, le lancement de la campagne de la sainte hélice par Nadar et la construction, par Ponton d'Amécourt, d'un hélicoptère à vapeur, première application de l'aluminium au plus lourd que l'air. Depuis Cayley, l'attention des chercheurs a été attirée sur l'importance des données aérodynamiques. Un pas décisif sera fait dans ce domaine par un autre Anglais, Wenham, qui construira le premier tunnel, on dira soufflerie par la suite pour l'expérimentation des maquettes. La notion d'essai systématique apparaît, remplaçant bientôt les tâtonnements. En France, Pénaud et Gauchot proposent en 1876 un aéroplane avec train escamotable, hélices à pas variable, gouvernes compensées et commande unique pour la profondeur et la direction. D'autre part, vers 1874, le Français Félix du Temple parvient à lancer son aéroplane à vapeur le long d'un plan incliné, avec un jeune marin à bord. Mais pour qu'il y ait décollage, il ne faut ni plan incliné ni moyen additionnel catapulte, contrepoids, et, pour qu'il y ait vol, il faut : trajectoire soutenue, dirigeabilité, enfin atterrissage à un niveau au moins égal à celui du point de départ. Nous arrivons à la fameuse controverse relative au premier vol de l'histoire : Clément Ader a-t-il volé le premier, le 9 octobre 1890 au château d'Armainvilliers ou le 14 octobre 1897 à Satory ? Les témoignages que l'on cite à l'appui sont-ils valables ? Si l'on répond par la négative à la première question, c'est aux frères Wright, disent les Américains, qu'il faut attribuer l'exploit, réalisé le 17 décembre 1903 à Kitty Hawk, en Caroline du Nord. Les historiens sont partagés. Aucun procès-verbal officiel n'a été établi sur le moment, ni pour l'un ni pour l'autre de ces vols. Il est certain dans les deux cas qu'il y a eu soulèvement. Peut-on dire qu'il y a eu vol soutenu du fait du moteur ? En tout cas, il n'y a pas eu virage. C'est le 15 septembre 1904 seulement que l'on voit apparaître dans les carnets des frères Wright la notion de demi-cercle. Il convient également de se replacer à l'époque : on constate alors que les constructeurs, aussi bien Ader que les frères Wright, tenaient à entourer leur invention du plus grand secret. Ce n'est que bien plus tard, au bout de quelques années, que se firent jour les déclarations d'antériorité. Entre 1890 et 1905, le public, pour passionné d'aviation qu'il fût, était assez mal informé des expériences précises de nos précurseurs. C'est aujourd'hui seulement, avec un certain recul, que nous avons en main les données du problème : travaux d'Ader, des frères Wright, mais également recherches et expériences de Mojaïski en Russie, de Maxim en Angleterre, de Jatho en Allemagne, de Kress en Autriche, de Langley aux États-Unis. Tous ceux que nous venons de citer ont essayé de décoller avec un moteur, mais cela ne doit pas faire oublier les noms de ceux qui ont fait faire de grands progrès à l'aviation au moyen du planeur : c'est en premier lieu l'Allemand Lilienthal, puis l'Écossais Pilcher, les Américains Montgomery et Maloney, les Français Ferber, Charles et Gabriel Voisin. Il ne faut pas oublier non plus les expériences de Hargrave en Australie, avec ses cerfs-volants cellulaires, et les études sur le vol des oiseaux des Français Mouillard et Marey. Il faut enfin se rappeler qu'il s'en est fallu de bien peu pour qu'un autre Américain, Langley, décollât avant les frères Wright, si ses expériences sur le Potomac avaient été couronnées de succès le 8 décembre 1903. Les frères Wright Le premier vol réalisé par Orville Wright 1871-1948, le 17 décembre 1903, sur la plage de Kill Devil, en Caroline du Nord, sous les yeux de son frère Wilbur 1867-1912. Cet appareil, le Wright Flyer, effectuera le même jour trois autres vols dont le dernier, réalisé par Wilbur à 5 mètres d'altitude et sur une distance de 260 mètres. Les débuts de l'aviation C'est le 17 décembre 1903 que les frères Orville et Wilbur Wright inaugurent l'ère de l'aviation. Au cours de ce vol historique de 59 secondes, qui s'effectue devant cinq témoins, ils parcourent une distance de près de 260 mètres. Après eux, nombreux sont les hommes qui vont œuvrer au développeme L'ingénieur allemand Otto Lilienthal 1848-1896 et son planeur, en 1894. Il réalisa plus de deux mille cinq cents vols avant de s'écraser au sol et de se tuer. Henri Farman et Gabriel Voisin Henri Farman, à gauche 1874-1958, et Gabriel Voisin, deux pionniers de l'aviation, en 1908. Qui a volé le premier ? Qu'importe si l'exploit a été réalisé en France ou en Amérique, en 1890, 1897 ou 1903. Ce qu'il faut retenir de cette époque héroïque, c'est la passion avec laquelle tous ces pionniers se dévouaient à l'aviation, risquant leur vie et leur fortune et – il faut bien le dire – profitant tous de leurs découvertes respectives, dans la mesure où le secret n'empêchait pas l'échange des informations. L'un des théoriciens de l'époque, Octave Chanute, avait très bien compris cette nécessité de la circulation et de l'échange de la documentation. Il est certain qu'on lui doit beaucoup, non seulement en raison de ses propres travaux, mais encore pour tous les contacts qu'il sut établir entre les Américains et les Français. De 1906 à 1914 Théoriciens et aviateurs travaillent ferme en même temps dans tous les pays : Phillips en Angleterre, Ellehamer au Danemark, Joukovski en Russie, Crocco en Italie, Esnault-Pelterie en France, Drzewiecki en Pologne. La grande difficulté est de trouver un moteur léger et puissant. C'est un Français, Levavasseur, qui y parvient le premier avec le moteur Antoinette, mais c'est un Brésilien, Alberto Santos-Dumont, qui va inscrire – avec ce moteur et sur un aéroplane de sa construction, le 14 bis – son nom à la première ligne d'un palmarès unique au monde, celui des records d'aviation. L'Aéro-Club de France fondé en 1898 et la F.A.I. Fédération aéronautique internationale, fondée en 1905 s'étaient en effet portés garants de l'homologation de ces performances officielles. Le 12 novembre 1906, sur la pelouse de Bagatelle, Santos-Dumont allait donc s'attribuer les trois premiers records du monde : durée, distance et vitesse 41,292 km/h. De l'altitude, il n'était pas encore question, puisqu'il arrivait aux commissaires de se plaquer sur l'herbe pour constater que les roues avaient bien quitté le sol. Précisons que les vols du 12 novembre 1906 s'étaient effectués en moyenne à 6 mètres de haut. Robert Esnault-Pelterie Le Français Robert Esnault-Pelterie 1881-1957, aviateur et ingénieur, s'illustra en aéronautique et en astronautique. Il commence dès le début du XXe siècle par construire ses propres appareils, les monoplans baptisés R.E.P. selon ses initiales, puis il met au point le moteur en étoile… Aviation : records entre 1906 et 1914 Évolution des records entre 1906 et 1914. Une autre date importante : le 13 janvier 1908. Ce jour-là, sur un Voisin à moteur Antoinette, Henri Farman s'adjuge le prix offert par les mécènes Deutsch et Archdeacon ; il réussit le premier kilomètre en circuit fermé officiellement contrôlé. Un peu plus tard, en octobre de la même année, il réussira une autre première, la liaison de ville à ville Bouy-Reims, 27 km. En octobre 1908 également, Wilbur Wright, en France, bat le record de distance avec 66,6 km. Il terminera l'année avec 124,7 km. Le vrai départ est donné, courses et meetings vont se succéder au cours desquels de nouveaux noms vont apparaître : Blériot, Breguet, Delagrange, Latham, Paulhan, Curtiss, Roe, Rolls, Cody, Grahame-White. Henri Farman Le 13 janvier 1908, Henri Farman 1874-1958 réussit le premier kilomètre en circuit fermé officiellement contrôlé, à Issy-les-Moulineaux, sur un appareil Voisin équipé d'un moteur Antoinette. Il s'adjuge ainsi le prix offert par les mécènes Deutsch et Archdeacon. Louis Blériot va associer son nom à un exploit spectaculaire : la traversée de la Manche. Le 25 juillet 1909, en 37 min, sur un Blériot, moteur Anzani de 25 ch, il réussit, battant de justesse le courageux Latham qui, sur Antoinette, deux fois de suite, tombe dans la mer. L'année suivante, l'Anglais Charles Rolls effectue avec succès la double traversée, tandis que son compatriote Grahame-White perd la course Londres-Manchester, au profit du Français Paulhan. 1910 est également l'année pendant laquelle le record d'altitude passe de 1 000 m Latham à 3 000 m Legagneux. De même, le 10 juillet, les 100 km/h sont dépassés par Morane, et, le 25 août, les 500 km en distance par Tabuteau. Blériot, Voisin et Farman sont les marques des avions respectivement vainqueurs. Enfin, toujours en 1910, les Alpes sont traversées par un jeune Péruvien, Geo Chavez, qui se tue à l'atterrissage. Pionniers de l'aviation De gauche à droite : le général Bares, Gabriel Voisin, le général Pujo, Henri Farman, Louis Blériot, le général Niesel, le maréchal Franchet d'Esperey, Santos-Dumont vers 1920. Les militaires commencent alors à s'intéresser à l'aviation et organisent les premières manœuvres avec des avions avant de les employer en opérations en 1911 guerre italo-turque en Tripolitaine. L'année 1910 voit encore de nombreuses innovations : le premier hydravion du Français Fabre, le premier «avion à réaction du Roumain Coanda, le premier décollage du pont d'un navire par l'Américain Ely, la première liaison radio air-sol, les premières vues cinématographiques prises d'avion. Cette année-là, l'aviation a fait vingt-neuf morts Hydravion Le Français Henri Fabre 1882-1984 fit décoller le premier hydravion à moteur, en 1910. Premier appontage Après s'être posé, le 18 janvier 1911, à l'arrière du croiseur USS Pennsylvania, l'Américain Eugene Burton Ely réussit à redécoller aux commandes de son Albany Flyer pour rejoindre Selfridge Field, son lieu de départ. Cela n'empêche pas l'idée d'aviation de s'imposer dans le public. En 1911, on a construit 1 350 aéroplanes dans le monde, on a fait 13 000 voyages au-dessus de la campagne , et 12 000 aviateurs ont parcouru un total de 2 600 000 km... Mais on a consommé 8 000 hélices ! Il faut dire que l'on casse du bois assez souvent à l'atterrissage. Très vite, dès 1911, nous voyons apparaître le métal dans la construction aéronautique : les frères Morane revêtent de tôles d'acier le fuselage de leur monoplan, tandis que Ponche et Primard créent le Tubavion avec voilure entièrement en aluminium. C'est également l'époque à laquelle Levavasseur lance le monobloc, monoplan à aile cantilever montée en porte à faux, sans hauban, et recouvre le moteur et les roues de surfaces profilées. Bientôt, on parle d'aérobus, puisque Breguet et Sommer se livrent un duel épique à qui transportera le plus de passagers : le 23 mars, Sommer en fait décoller douze avec un moteur de 70 ch. Le 18 février 1911 a lieu, aux Indes, un grand événement : la première poste aérienne au monde, avec le Français Henri Péquet sur Sommer, moteur 50 ch. Après les frères Voisin, les premiers constructeurs ouvrent leurs usines : Bristol, Farnborough, de Havilland, Avro, Hawker, Short en Angleterre, Martin avec Bell, Douglas et McDonnell, Curtiss et Cessna aux États-Unis ; Morane-Saulnier, Caudron, Hanriot, Nieuport en France ; Fokker aux Pays-Bas, et Sikorsky en Russie, qui construira le premier quadrimoteur du monde, le Bolchoï, en 1913. Cependant, on donne de plus en plus d'importance aux questions de sécurité et les instruments de bord viennent un à un prendre place dans les avions : notons l'indicateur de vitesse du capitaine Etévé et l'anémomètre qui fera du nom de Badin un nom commun. Ainsi équipés, les aviateurs peuvent affronter la nuit : le 11 février 1911, Robert Granseigne survole Paris à 3 heures du matin sur un Caudron. Une sécurité supplémentaire apparaît à la même époque : le parachute. C'est l'Américain Berry qui, le premier, saute d'un avion, le 1er mars 1912, au-dessus de Saint Louis. L'Exposition de 1912 réservait une surprise à ses visiteurs : un monoplan construit par Deperdussin présentait pour la première fois la formule monocoque rigidité de la coque obtenue par le seul revêtement qui allait permettre un important gain de place. De plus, cette trouvaille allait faire gagner des kilomètres : c'est sur un Deperdussin que Védrines et Prévost devaient battre le record du monde en 1912 et 1913 Prévost dépassera le premier les 200 km/h, le 29 septembre 1913, avec un moteur Gnome de 160 ch. Les grands voyages commencent à intéresser les aviateurs. Les 366 km séparant Paris du puy de Dôme, enjeu du prix Michelin, sont franchis par Renaux et Senouque sur appareil Maurice Farman, moteur Renault de 60 ch, le 7 mars 1911 le prix avait été fondé en 1908. En mai 1911, la course Paris-Madrid est gagnée par Védrines, le seul à terminer le parcours ; Paris-Rome voit la victoire de Beaumont devant Garros. Beaumont devance Garros encore au circuit européen 11 étapes et 1 710 km et Védrines au tour d'Angleterre 2 200 km. Aux États-Unis, on applaudit la première traversée du continent par Rodgers en 49 jours et 68 escales soit un temps de vol de 82 h. L'année suivante, 1912, marque un tournant décisif pour les raids. Brindejonc des Moulinais réalise le premier circuit des capitales ; Marc Bonnier, Barbier et Védrines relient Paris au Caire ; enfin – exploit qui fera date, comme celui de Blériot en 1909 – Roland Garros traverse la Méditerranée. Il est à bord d'un Morane et met 7 h 53 min à franchir les 730 km qui séparent Saint-Raphaël de Bizerte, avec un parcours au-dessus de l'eau de 500 km. Roland Garros 1888-1918 L'aviateur français Roland Garros s'est rendu célèbre le 23 septembre 1913 en effectuant la première traversée de la mer Méditerranée en aéronef. Il parcourt avec un Morane-Saulnier les 730 km qui relient Saint-Raphaël à Bizerte en 7 h 53 minutes. Engagé dans la Première Guerre mondiale, il est fait… Et une nouvelle sensationnelle arrive d'Allemagne : le pilote Reinhold Bœhm vient de voler pendant plus de 24 h sur son Albatross, moteur Mercedes 75 ch. Nous sommes en juillet 1914. À cette date, un mois avant le déclenchement du premier conflit mondial, les progrès réalisés en moins de dix ans par l'aviation sont énormes. Il suffit de comparer les records officiels de la F.A.I. de 1906 et de 1914. De 1914 à 1918 Avant la Première Guerre mondiale, l'avion avait déjà fait ses premières armes. La mission du capitaine italien Piazza, au-dessus des lignes turques, près de Tripoli, le 22 octobre 1911, consistait en une reconnaissance avec un Blériot. Le baptême du feu en avion fut effectué par le capitaine Moizo, avec un Nieuport 25 octobre 1911. Mais ce sont les Turcs qui emploient pour la première fois l'artillerie contre les avions. Le premier combat aéronaval fut celui d'un hydravion grec contre une canonnière turque. Depuis le 29 mars 1912, les Français ont une loi portant création de l'Aéronautique militaire, et depuis le 13 avril de la même année, les Anglais ont créé le Royal Flying Corps, ancêtre de la R.A.F. Rappelons enfin qu'à partir de l'été 1913, l'avion a prouvé qu'il pouvait prendre toutes les positions dans le ciel : le Russe Nesterov et le Français Pégoud ont déjà bouclé la boucle , c'est-à-dire fait un looping. Dans les premiers jours de la guerre, les grands chefs, des deux côtés, estiment que l'aviation est seulement un moyen supplémentaire d'information pour voir de l'autre côté de la colline. Ce sont les aviateurs eux-mêmes qui vont prouver que ce «service peut être considéré comme une arme ; ils donneront peu à peu à cette arme un caractère offensif qui ne s'affirmera que vers 1918. Dès 1915, le bombardement s'organise avec le commandant de Göys de Mezeyrac, et la chasse avec le commandant de Rose ; la reconnaissance s'intéresse à la photographie aérienne. Du côté allemand, Boelcke formule les principes du combat aérien, tandis que, du côté français, Garros cherche à réaliser le tir à travers l'hélice. Mais c'est Fokker qui en trouvera la solution. Junkers met au point un avion entièrement métallique, tandis que la firme Hispano-Suiza crée son fameux moteur 8 cylindres en V, dont plus de 50 000 exemplaires seront construits. On commence à spécialiser les avions pour certaines missions : les Voisin, les Breguet et les Handley-Page serviront au bombardement, tandis que les chasseurs seront construits par Morane, Nieuport, Spad, Bristol, Fokker. Quant à la reconnaissance, elle empruntera surtout des Caudron et des Farman. Manfred von Richthofen et son Fokker La Première Guerre mondiale a vu la naissance de l'aviation militaire. Les exploits de certains « as », comme le « Baron rouge » (ou « Diable rouge »), l'Allemand Manfred von Richthofen, sont entrés dans la légende. En 1916, les progrès continuent : Yves Le Prieur fixe des fusées sur les haubans d'un Nieuport ; Sperry, dont les travaux ont été repris par les Anglais Follands et Low, est à l'origine du premier avion guidé par radio. Douhet, en Italie, préconise l'emploi des bombardiers Caproni en masse, et Sikorsky, en Russie, construit en série ses quadrimoteurs. Les Américains ne sont pas encore en guerre, mais certains volontaires, après être passés par la Légion étrangère, ont constitué une escadrille, qui deviendra bientôt l'escadrille La Fayette. Parmi les progrès réalisés pendant la guerre, il faut noter, en 1916, l'étonnant exploit d'un pilote français, le lieutenant Marchal : avec un Nieuport équipé spécialement, il réussit à couvrir 1 370 km, ce qui lui aurait valu largement le record du monde si les homologations de la F.A.I. n'avaient été interrompues pendant les hostilités ; parti de Nancy, après avoir lancé des tracts au passage sur Berlin, il atterrit non loin des lignes russes, mais il est fait prisonnier avant d'avoir pu réaliser le premier raid « navette » de l'histoire. Les civils même reconnaissent à quel point l'aviation s'est imposée : les Anglais ouvrent l'Air Ministry et les Allemands créent un Commandement de l'air unique. En 1917, les effectifs des forces aériennes ont augmenté dans des proportions énormes et l'on commence à songer sérieusement à employer les bombardiers en masse pour une action offensive. Les Français sortent le fameux Breguet XIV et les Allemands lancent la première bombe de 1 000 kg 16 février 1918. Deux décisions importantes sont à signaler en 1918 : les Anglais groupent le Royal Flying Corps et le Royal Navy Air Service et forment la Royal Air Force R.A.F., tandis que les Français créent la Ire division aérienne, représentant un ensemble de 600 avions de chasse et de bombardement sous un commandement unique ; le commandement unique est également adopté du côté britannique : le général Trenchard est nommé à la tête de l'Independent Air Force. De 1918 à 1939 La Première Guerre mondiale n'était même pas terminée qu'un bombardier britannique Handley-Page 0/400 donnait le signal des liaisons pacifiques en reliant Londres au Caire au mois de juillet 1918, piloté par le major McLaren. Dans un premier temps, en effet, les nations disposant de nombreux surplus militaires vont s'appliquer à adapter les avions de guerre aux besoins du transport civil. Mais, avant de tracer des lignes sur la carte, il reste encore des terres à explorer, des mers à traverser, des montagnes à franchir : ce sera l'époque des grands raids. L'Atlantique d'abord : trois hydravions de la marine américaine, avec le lieutenant-commander Read, relient en 1919 les États-Unis à l'Angleterre en trois étapes. Dans le même sens, mais sans escale cette fois, c'est encore un bombardier, un Vickers Vimy, qui, la même année, réussit l'exploit avec Alcock et Brown. Dans les deux cas, il faut noter que l'on a fait un large appel aux différents équipements de bord et de navigation. Aviation : records entre 1920 et 1939 Les Français Bossoutrot, Coli, Lemaître, Dagnaux, Vuillemin ; les Italiens Ferrarin, Masiero ; les Australiens Ross et Keith Smith sillonnent les ciels d'Afrique, d'Asie et d'Australie, cependant que les Portugais Cabral et Countinho franchissent l'Atlantique Sud 1922. De 1919 à 1923, les premières grandes compagnies aériennes jettent les bases de leurs réseaux : Deutsch Luft Rederei en Allemagne, B.A.T. en Grande-Bretagne, K.L.M. aux Pays-Bas, Ad Astra en Suisse, S.A.B.E.N.A. en Belgique, Q.A.N.T.A.S. en Australie, Messageries aériennes, Franco-Roumaine, Lignes Latécoère en France. La liaison Casablanca-Dakar est réalisée en 1923. De 1924 à 1927, les surplus de la guerre étant épuisés, on voit les constructeurs se pencher sur le problème de l'avion de transport proprement dit, ce qui représente une nouveauté dans l'histoire de l'aviation : ce sont Farman, Breguet, Caudron, Lioré et Olivier en France ; Douglas, Boeing aux États-Unis ; de Havilland en Grande-Bretagne ; Fokker aux Pays-Bas. À la même époque, le tourisme aérien s'impose peu à peu aux esprits et un marché privé s'intéresse aux Caudron en France ou aux Moth en Angleterre, bientôt aux Cessna aux États-Unis. En 1924, le tour du monde a été réalisé par trois Douglas de l'armée américaine. Parti de Rome pour atteindre le Japon, l'Italien de Pinedo fait le tour de l'Australie, 55 000 km, la plus longue randonnée en avion à cette date. En 1926, Byrd et Bennett ont survolé le pôle Nord avec un Fokker. Quant à 1927, on peut dire que c'est l'année de l' Atlantique : Nungesser et Coli disparaissent, ayant échoué de peu sans doute, le 8 mai. Quelques jours plus tard, Lindbergh va réussir, à bord du Spirit of St. Louis que lui a construit Ryan. C'est un nouveau triomphe du pilotage aux instruments. Charles Lindbergh Le Spirit of Saint Louis de Charles Lindbergh, peu de temps après son arrivée triomphale au Bourget, le 21 mai 1927, après qu'il eut réussi à traverser l'Atlantique nord sans escale. L'année 1927 est aussi celle du Pacifique : Maitland et Hegenberger relient San Francisco à Honolulu 3 890 km les 28 et 29 juin. Un nouveau record est créé, qui indique bien les préoccupations du monde de l'aviation à cette époque : le record de distance en ligne droite. Les compagnies continuent leur travail de défrichement : Mermoz sur l'Amérique du Sud, Noguès vers l'Orient, tels sont les deux grands noms français qui resteront associés à ces efforts, tandis que les compagnies aériennes Pan American, Lufthansa, Imperial Airways et Dobrolet (en Russie) voient le jour et accordent une place de plus en plus importante au confort des passagers. Dès 1928, l'Allemagne relève la tête et reprend sa place parmi les constructeurs. Avec les Italiens, les Allemands ne vont pas tarder à faire parler d'eux dans les compétitions internationales. L'aviation, qui tient la première page dans les journaux, est véritablement entrée dans les mœurs. En France, le ministère de l'Air « intégral » est fondé en 1928 et les ingénieurs de tous les pays font preuve d'une imagination telle que les progrès techniques sont très rapides : Doolittle réalise le premier vol entièrement sous capote, grâce aux instruments de Sperry ; la construction métallique se généralise ; le premier décollage « assisté » par fusées a lieu en 1929 (Junkers 33) ; l'avion au service de l'agriculture apparaît aux États-Unis ; enfin le pôle Sud est survolé à son tour Byrd et Balchen. Si, pendant huit ans, le Français Bonnet garde le record de vitesse sur avion «terrestre , l'hydravion prend de l'avance et ne cédera la place à l'avion qu'en 1937. Français et Italiens se livrent une lutte passionnée pour le record de distance en circuit fermé aussi bien qu'en ligne droite : Breguet XIX contre Savoia-Marchetti. D'un côté Ferrarin et Del Prete, de l'autre Costes, Codos, Bellonte, Bossoutrot, Rossi. Les 1er et 2 septembre 1930, Costes et Bellonte font Paris-New York en 37 h 18 min sur le Breguet Point-d'Interrogation, traversant d'est en ouest l'Atlantique Nord, qu'en sens inverse venaient de franchir trois autres Français, Assollant, Lefèvre et Lotti (sans parler d'un jeune Américain passager clandestin !) sur Oiseau-Canari, au mois de juin 1929. Quant à l'Atlantique Sud, il est traversé en 1930 au cours d'un vol commercial avec Mermoz, Gimié et Dabry sur l'hydravion Laté 28 Comte-de-La-Vaulx : il ne faut plus que cinq jours pour transporter le courrier de Toulouse à Santiago du Chili. À la même époque, le trajet New York-Los Angeles ne demande plus que 36 heures ; il est devenu entièrement aérien. Enfin, signalons que la ligne la plus longue du monde est inaugurée par la K.L.M. : il s'agit d'Amsterdam-Batavia, soit 13 740 km en douze jours. Vers les années trente, cette fois, on peut dire qu'il n'y a plus d'imprévu en aviation. Les lignes aériennes mettent l'accent sur la sécurité, le passager est confortablement installé, le pilotage automatique commence à entrer en jeu. Une des grandes conquêtes de cette époque est celle de l'altitude qui doit permettre de réaliser d'appréciables économies : en 1934, l'Italien Donati a dépassé les 14 000 m sur un Caproni. Cependant, l'Américain Wiley Post tient pendant huit heures, à 10 000 m. En vitesse pure, l'Italien Agello détient le record du monde, avec son hydravion qu'il a poussé jusqu'à 709 km/h, le 23 octobre 1934. L'aviation est vraiment devenue populaire . Les avions légers, grâce à des subventions gouvernementales, sont mis à la portée d'un plus grand nombre : Potez, Caudron, Morane-Saulnier et Farman, en France, rivalisent avec de Havilland en Angleterre et Taylor aux États-Unis, des amateurs commencent à construire eux-mêmes leurs propres modèles, et les fêtes d'aviation n'ont jamais été aussi fréquentées. On y applaudit les spécialistes de la voltige, Détroyat, Doret, la patrouille d'Étampes avec Fleurquin ; Cobham, Scott, Stewart, Tyson en Angleterre ; Udet, Fieseler en Allemagne ; Locklear, Chennault en Amérique. Les femmes prennent leur part de raids ou de voltige avec Maryse Bastié, Maryse Hilsz, Hélène Boucher, Amy Johnson, Amelia Earhart, Vera von Bissing ou Liesel Bach. Les 4 et 5 octobre 1931, la traversée du Pacifique sans escale est réalisée par les Américains Pangborn et Herndon, du Japon à Seattle : ils terminent ainsi un très spectaculaire tour du monde. Très spectaculaire aussi la démonstration de Balbo qui, par deux fois, va s'attaquer à l'Atlantique en vol de groupe avec ses hydravions Savoia S-55. En 1931, c'est l'Atlantique Sud avec dix appareils ; en 1933, c'est l'Atlantique Nord, aller et retour avec vingt-quatre équipages. Autre démonstration de masse d'équipages militaires : la Croisière noire du général Vuillemin, randonnée de 22 000 km à travers l'Afrique ; vingt-huit Potez 25, sur les trente qui avaient pris le départ, sont à l'arrivée (8 nov. 1933 – 15 janv. 1934). C'est sur un Lockheed Vega que, le 23 juin 1931, Harold Gatty et Wiley Post partent pour un tour du monde qu'ils réaliseront en huit jours. Sur le même appareil, baptisé Winnie Mae, Wiley Post, seul cette fois, devait renouveler l'exploit en 1933, faisant entièrement confiance à son pilotage automatique. Le Français Couzinet construit l'Arc-en-Ciel, sur lequel Mermoz va traverser l'Atlantique Sud, le 16 janvier 1933. La Croix-du-Sud, hydravion piloté par le commandant Bonnot, lui succédera. Un trimoteur du même Couzinet, le Biarritz, va réaliser, du 6 mars au 5 avril 1932, un Paris-Nouméa avec Verneilh, Devé et Munch. Et c'est sur un autre trimoteur, construit par Dewoitine, que Noguès trouvera la mort, au retour de Saigon le 15 janvier 1934. L'événement sans doute le plus important de ces années trente est la course Londres-Melbourne, qui allait démontrer les possibilités des avions commerciaux. Vingt concurrents se sont inscrits ; ils partent le 20 octobre 1934. Cinq escales obligatoires sont prévues le long des 18 185 km : Bagdad, Allahabad, Singapour, Port Darwin, Charleville. Si la course est gagnée par un Comet spécialement construit par de Havilland, il importe de noter que les deuxième et troisième places sont prises par des avions de ligne : un Douglas DC 2 de la K.L.M. et un Boeing 247. Ce fut une exceptionnelle démonstration au profit des constructeurs américains, dont les appareils de transport allaient être offerts en nombre aux compagnies européennes ; il y a là un virage caractéristique dont on ne saurait trop souligner l'importance. Autre événement important de l'époque : en 1933, la fusion de plusieurs compagnies françaises donne naissance à Air France, qui se trouve alors disposer d'une flotte de 260 appareils sur un réseau de 38 000 km. De 1935 à 1939, tout se passe comme si les nations, délaissant les exploits pacifiques, se livraient une concurrence acharnée pour préparer et expérimenter les flottes de guerre les plus puissantes. À l'inverse de ce qui s'est passé au lendemain de la Première Guerre mondiale, les constructeurs semblent avoir pour souci de réaliser des appareils civils qui pourront s'adapter rapidement aux missions militaires, et si possible à toutes les missions, d'où la notion d'avion « polyvalent » qui fait son apparition, mais qui, finalement, provoquera de cuisantes désillusions. C'est en 1935 qu'est sorti le B-17 de Boeing, ainsi que le Hurricane de Hawker, le 142 de Bristol et le fameux DC-3 de Douglas. Celui-ci, qu'on allait bientôt appeler C-47 puis Dakota, allait commencer une brillante carrière plus de 11 000 exemplaires avec ses deux moteurs Pratt et Whitney de 1 000 ch chacun. Il transporte vingt et un passagers à 340 km/h : le transport aérien devient rentable. Dakota Un procédé vient d'être mis définitivement au point, celui du vol aux instruments : le major Eaker traverse le continent américain entièrement « sous capote ». Une vieille querelle prend fin : l'avion terrestre enlève à l'hydravion le record du monde de vitesse, avec Hans Dieterle Allemagne sur Heinkel 112 746,604 km/h le 30 mars 1939. En altitude, le record établi par l'Italien Mario Pezzi, avec 17 083 m sur Caproni 161 bis, est encore valable de nos jours pour les avions à hélices. En distance, les 10 000 km représentant le quart de la circonférence de la Terre sont dépassés par les Soviétiques Gromov, Youmachev et Daniline Moscou-Los Angeles, du 12 au 14 juillet 1937, en 62 h 17 min. En 1938, deux Vickers Wellesley devaient porter ce record à 11 520 km entre Ismaïlia et Darwin. Ce sont deux Japonais, Fujita et Takahashi, qui battent le record du monde de distance en circuit fermé en 1938 11 651 km avant de céder la place aux Italiens Dagasso et Vignoli, avec 12 935 km en 1939. On pense à une course New York-Paris annulée en 1937, à la suite de la catastrophe du dirigeable Hindenburg, mais finalement on organise un Istres-Damas-Paris qui voit le triomphe des Savoia-Marchetti italiens en 1938. Le 28 juin 1939, on salue le premier vol transatlantique avec passagers : un hydravion quadrimoteur Boeing 314 relie Port Washington à Marseille. Göring, ministre de l'Air du Reich et commandant en chef de la Luftwaffe, développe une flotte aérienne moderne et puissamment articulée, tandis que les Anglais commencent leurs travaux sur le radar. Les Italiens expérimentent leurs forces aériennes en Éthiopie, et la malheureuse Espagne va servir de banc d'essai aux différentes armées de l'air allemande, italienne, soviétique et, plus modestement, française. On commence à parler du Messerschmitt 109, du Stuka et du Heinkel 111. De 1939 à 1945 À la date du 27 septembre 1939, jour de la capitulation de Varsovie, après la victoire sur la Pologne à laquelle l'aviation d'assaut et de bombardement n'a pas peu contribué, le Reich dispose de 3 500 appareils (dont 1 500 chasseurs). Dans le camp adverse, Français et Britanniques peuvent aligner environ 2 500 avions de types très variés. En l'espace d'une année, la guerre va s'étendre peu à peu sur presque toute la planète : Finlande, Danemark, Norvège, campagne de France, bataille dans le ciel d'Angleterre, Gibraltar, Alexandrie, Malte, Italie, Crète, partout les aviateurs et les parachutistes jouent un rôle déterminant. Pearl Harbor est une victoire aérienne des Japonais. Les cuirassés sont désormais à la merci des avions ; et la revanche américaine dans la mer de Corail n'est rendue possible que par l'utilisation stratégique de l'aviation. Pearl Harbor En ce qui concerne la guerre sur terre, la mobilité, condition du succès des stratèges, a en effet réalisé des progrès inouïs, grâce aux avions de transport militaire dont l'importance, dans cette nouvelle guerre, est au moins aussi grande que celle des avions de chasse ou de bombardement. Nouvel aspect qui oriente les constructeurs vers de nouveaux modèles : il s'agit, bien sûr, de transporter le plus d'hommes et de matériel possible, mais aussi de franchir tous les obstacles, mers et montagnes, de résister à tous les climats polaire ou tropical et de décoller et d'atterrir quel que soit le terrain. Il convient également d'équiper ces avions de transport avec des instruments de navigation de plus en plus perfectionnés tandis que, dans l'autre camp, il est d'une urgence vitale de mettre au point des installations de radar pour avertir du danger qui s'approche. Si la bataille d'Angleterre, au cours de laquelle 600 Hurricane et Spitfire tiennent tête à 3 000 appareils de la Luftwaffe, marque un tournant capital de l'histoire de la guerre, il en est un autre sur lequel il faut attirer l'attention : le premier bombardement de Tōkyō par les Américains. Il a été réalisé par les avions B-25 Mitchell du lieutenant-colonel Doolittle, partis d'un porte-avions, le Hornet, dans le Pacifique, à 1 300 km de leur cible, et dont l'aventure devait se terminer en Chine. Bataille d'Angleterre Dès 1942 tabl. 5, la production industrielle allemande est considérablement ralentie par les bombardements anglo-américains, tandis qu'au contraire la production des usines d'aviation des États-Unis augmente dans des proportions étonnantes : 5 500 avions dans le mois de décembre, contre 600 pour décembre 1940. L'avion se spécialise. À côté du bombardement, de la chasse et de la reconnaissance, notions héritées du conflit précédent, à côté du transport, élément nouveau, apparaissent de nouvelles missions et de nouveaux types d'appareils : les planeurs pour transporter les troupes ; les boîtes volantes, aux faibles vitesses, véritables P.C. du champ de bataille; les bombardiers de précision, capables de faire sauter un barrage ou d'ouvrir une brèche dans les murs d'une prison. Chaque guerre voit fleurir de nombreuses inventions. Ces armes secrètes, si elles n'ont pas toujours apporté la décision à ceux qui les ont employées les premiers, si elles n'ont pas toujours vu le jour, auront au moins eu pour conséquence de contribuer aux progrès scientifiques d'après la guerre. V 1 et V 2 se trouvent ainsi à l'origine de l'astronautique. Les premiers jets , Gloster Meteor, Messerschmitt Me-262, participent aux opérations, tandis que les deux camps s'attaquent au problème de la propulsion par réaction et mettent au point un grand nombre de prototypes, de l'avion-fusée au bélier volant. Par la bombe atomique, le combattant tombe sous la dépendance du savant. En tout cas, on constate que 675 000 avions ont été construits dans le monde au cours des cinq années du conflit. Radar, turboréacteur, Liens http://youtu.be/QTOis9qY5ek jean Mermoz et l'Arc en ciel http://youtu.be/hyP_PfEFOg4 Hommage à Jean Mermoz     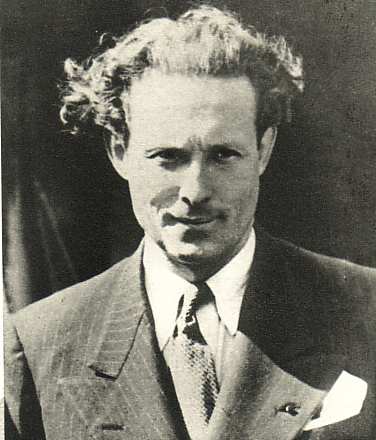  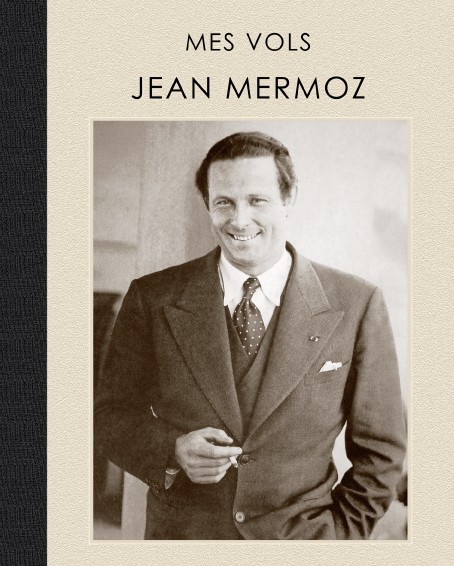 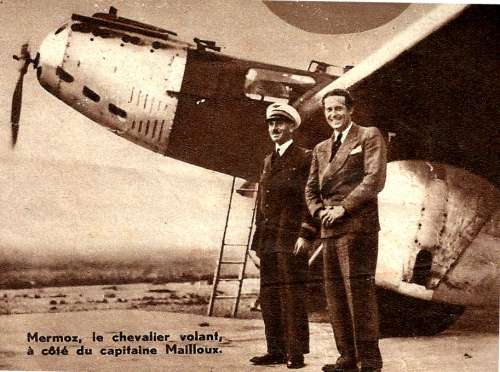    
#4148
Ferdinand de Lesseps
Loriane
Posté le : 06/12/2014 17:23
Le 7 décembre 1894 meurt Ferdinand Marie, vicomte de Lesseps
à 89 ans, à La Chesnaye près de Guilly Indre né à Versailles le 19 novembre 1805, diplomate et entrepreneur français. Il est surtout connu pour avoir fait construire le canal de Suez et pour être à l'origine du scandale de Panama pour lequel il a été condamné. Il était le neveu du diplomate Jean-Baptiste Barthélemy, baron de Lesseps Diplomate, Ferdinand de Lesseps occupa des postes successifs en Égypte, où il devint l'ami du prince héritier Sa‘īd. Ministre à Madrid, puis à Rome en 1849, au moment de l'intervention des troupes françaises, il y signa un accord qui dépassait ses pouvoirs et fut désavoué. Il quitta alors la diplomatie. Consul au Caire en 1833, il se lie avec le prince héritier Said, et s'intéresse aux projets des saint-simoniens relatifs à un canal entre la Méditerranée et la mer Rouge en perçant l'isthme de Suez. Rappelé par Said devenu souverain 1854, il obtient un acte de concession novembre 1854, puis forme la Compagnie universelle du canal maritime de Suez. Le canal est inauguré le 17 novembre 1869 par l'impératrice Eugénie. Lesseps s'intéresse ensuite 1876 à un canal dans l'isthme de Panamá, négocie avec la Colombie et fonde une compagnie 1880 dont la faillite 1889 provoquera le scandale de Panamá. Académie française, 1884. Après l'accession au trône de son ami Sa‘īd pacha 1854, il conçut le projet d'un percement de l'isthme de Suez ; l'idée provenait des saint-simoniens au nombre desquels était Lesseps. Il obtint un acte de concession et fonda la Compagnie du canal de Suez. Bénéficiant de l'appui de Napoléon III, il sut mener à bien l'achèvement du canal qui fut inauguré par l'impératrice Eugénie le 17 novembre 1869. L'admiration qu'il inspirait aux Français résista même au scandale de Panamá qui mit fin, en février 1889, à la Compagnie du canal interocéanique de Panamá qu'il avait fondée en mars 1881 et qui engloutit dans sa faillite l'épargne de bon nombre de Français. Ferdinand de Lesseps et son fils Charles furent condamnés à cinq ans de prison après une interminable instruction. Mais la raison du grand homme avait sombré avec la faillite de son œuvre et il mourut en ignorant sans doute ce suprême opprobre. Il avait été élu à l'Académie des sciences en 1873 et à l'Académie française en 1884. En bref Ferdinand Marie, vicomte de Lesseps, Diplomate français, promoteur du percement de l'isthme de Suez, né à Versailles le 19 novembre 1805, mort à La Chenaie, près de Guilly Indre, le 7 décembre 1894. Il était le frère cadet du comte Théodore de Lesseps. Il fit de brillantes études au collège auj. lycée Henri IV, à Paris, fut attaché en 1825 au consulat de Lisbonne, revint en 1827 à Paris, passa une année dans les bureaux de la direction commerciale du ministère des affaires étrangères, fut nommé en 1828 élève-consul à Tunis, en 1831 vice-consul et en 1833 consul au Caire, et géra, à deux reprises, le consulat général d'Alexandrie. La première fois, ce fut pendant la terrible peste de 1834-1835, qui emporta le tiers des habitants; il se dévoua pour combattre le fléau, transformant sa résidence en ambulance, soignant lui-même les malades et s'efforçant de rassurer tout le monde par son sang-froid. Durant le second intérim 1836-1838, il s'employa principalement à obtenir d'Ibrahim Pacha de nouvelles garanties pour les catholiques de Syrie et à rétablir les bons rapports entre le sultan et le vice-roi d'Egypte, Mohammed Ali, qui avait été autrefois l'ami de son père, le comte Mathieu de Lesseps. En 1838, il fut envoyé à Rotterdam, en 1839 à Malaga, en 1842 à Barcelone. Lors de la sanglante insurrection qui désola cette ville et de son bombardement par le général Espartero en novembre 1842, il déploya pour la sauvegarde des étrangers de toute nationalité une énergie, un courage et une habileté qui eurent dans l'Europe entière un grand retentissement. Les gouvernements, celui de la reine Isabelle en tête, le comblèrent de remerciements et le couvrirent de décorations; son buste fut placé dans la grande salle de l'Hôtel de Ville. En 1847, il fut promu consul général sur place. Dénoncé comme monarchiste au gouvernement provisoire de 1848, Ferdinand de Lesseps fut rappelé télégraphiquement à Paris le 25 mars; mais le 10 avril. Lamartine le renvoya en Espagne, cette fois comme ministre plénipotentiaire. Il n'y resta que dix mois. Il trouva le temps, néanmoins, de négocier un traité postal très avantageux et de faire aboutir les revendications des Français relatives à l'administration de l'église et de l'hospice français de Saint-Louis de Madrid. Le 10 février 1849, il dut céder la place à Napoléon-Joseph Bonaparte, cousin du nouveau président de la République. Demeuré quelque temps en disponibilité, il se préparait à aller prendre possession de l'ambassade de Berne, lorsque le ministre des affaires étrangères, Drouin de Lhuys, le dépêcha en Italie avec mission de faire exécuter le vote de blâme rendu le 7 mai par l'Assemblée constituante contre le général Oudinot, qui, favorable à la restauration du pape, venait d'attaquer Rome avec les troupes françaises. Trois semaines durant, l'éminent diplomate se dépensa en vaines tentatives de conciliation, accusé d'un côté de partialité pour les révolutionnaires romains par le général Oudinot, lequel avait reçu en secret de Louis-Napoléon des instructions contraires à celles ostensiblement données à l'envoyé officiel, soupçonné d'autre côté par les Romains, qui avaient à leur tête Mazzini, de vouloir les amuser par des négociations stériles. Une lettre de rappel datée du 29 mai vint l'arracher à cette critique et humiliante situation. L'Assemblée législative avait remplacé la Constituante, elle voulait l'écrasement de la république romaine et la reprise générale des hostilités : carte blanche fut donnée au général. Quant à Ferdinand de Lesseps, qui n'avait pas craint de représenter les fâcheuses conséquences qu'entraînerait l'occupation violente de Rome et d'émettre sur Mazzini une opinion très favorable, il fut déféré au conseil d'Etat pour l'examen des actes relatifs à sa mission. Il se justifia complètement. Mais il n'obtint que sa mise en disponibilité sans solde et se retira dans la propriété de La Chenaie, que sa belle-mère, Mme Delamarre, venait d'acquérir. Cette disgrâce lui valut l'immortalité Surnommé le Grand Français, Ferdinand de Lesseps a été le principal promoteur des deux projets de canaux les plus ambitieux de son temps, le canal de Suez puis le canal de Panama. Ce dernier projet fit perdre tant d'argent aux actionnaires que le promoteur fut condamné à cinq ans de prison, peine qu'il ne purgea pas en raison de son grand âge 88 ans et de son état de santé précaire. Sa statue trône sur la place de France à Panama avec son nom écrit de cette manière : Fernando Maria Vizconce de Lesseps. Origine L'origine de sa famille remonterait à la fin du xvie siècle. Son plus ancien ancêtre connu en ligne paternelle est un maître charpentier né dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Un de ses arrières-grands-pères est le secrétaire de la reine Marie-Anne de Neubourg, veuve de Charles II d'Espagne, exilé à Bayonne après l'accession au trône de Philippe V. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, les ancêtres de Ferdinand de Lesseps suivent la carrière diplomatique, dans laquelle lui-même occupe plusieurs fonctions de 1825 à 1849. Son oncle est anobli par le roi Louis XVI, et son père, Mathieu de Lesseps 1774-1832, est fait comte par Napoléon Ier. Sa mère, Catherine de Grevignée, est espagnole, et tante de la comtesse de Montijo, mère de l'impératrice Eugénie. Sa vie Il est né à Versailles, rue des Réservoirs, le 19 novembre 1805. Il passe ses premières années en Italie, où son père est en poste. Il suit ses études au lycée Henri-IV à Paris. Son éveil intellectuel se serait produit, selon le témoignage de l’intéressé, dans un cycle de conférences donné par l’abbé de La Mennais et ses amis ultramontains. Bachelier à Amiens, le futur perceur d’isthme s’inscrit aux cours de droit commercial en vue du quai d’Orsay, mais il préfère de loin les séances d’équitation. Il deviendra un cavalier remarquable, d’une adresse qui lui donnera grand crédit auprès de ses partenaires arabes. De 1825 à 1827, il est vice-consul auxiliaire à Lisbonne, où son oncle, Barthélemy de Lesseps, est chargé d'affaires. Cet oncle embarqua sur l'Astrolabe, commandée par Fleuriot de Langle, et participa ainsi à l'expédition de La Pérouse. Alors que l'expédition faisait relâche à la presqu'île de Kamtchatka, La Pérouse lui demanda d'apporter ses documents à Versailles journaux, cartes et notes, lui sauvant ainsi la vie, sans le savoir. Ferdinand de Lesseps se marie deux fois, en premières noces, à Agathe Delamalle 1819-1853, petite-fille de Gaspard Gilbert Delamalle, qui lui donne cinq fils : Charles-Théodore, Charles-Aimé, Ferdinand-Marie, Ferdinand-Victor et Aimé-Victor, puis en secondes noces après le décès d'Agathe, à Louise-Hélène Autard de Bragard 1848-1909, originaire d'Ile Maurice, qui lui donne douze autres enfants : Mathieu-Marie, Ferdinand-Ismaël 1871-1915, mort pour la France, Ferdinande-Hélène, Eugénie-Marie, Bertrand 1875-1917, mort pour la France, Marie-Consuelo, Marie-Eugénie, Marie-Solange, Paul, Robert 1882-1916, mort pour la France, Jacques 1883-1927, pionnier de l'aviation et Giselle. Sa carrière Diplomatie En 1828, Ferdinand de Lesseps est envoyé en tant que vice-consul auxiliaire à Tunis, où son père est consul-général. Il facilite courageusement l'évasion d'un certain Yusuf, poursuivi par les soldats du Bey dont il est un des officiers. Yusuf se montrera reconnaissant de cette protection française en se distinguant dans les rangs de l'armée française à l'heure de la conquête de l'Algérie. Ferdinand se voit ensuite confier par son père une mission auprès du comte Clauzel, général en chef de l'armée de conquête en Algérie. Dans une lettre du 18 décembre 1830 à Mathieu de Lesseps, le général écrit : J'ai eu le plaisir de rencontrer votre fils, qui promet de soutenir avec grand crédit le nom qu'il porte. En 1832, Ferdinand de Lesseps est nommé vice-consul à Alexandrie. Afin de le faire patienter pendant la quarantaine du navire, le Diogène des Postes françaises qui l'a conduit en Égypte, Monsieur Jean-François Mimaut, consul-général de France à Alexandrie, lui envoie plusieurs livres, parmi lesquels le mémoire écrit, selon les instructions de Bonaparte, par l'ingénieur Jacques-Marie Le Père, membre de l'expédition scientifique d'Égypte, chargé d'étudier le creusement d'un canal à travers l'isthme de Suez. De ces lectures et de sa rencontre avec les saint-simoniens voir Cercle Saint-Simon venus là marier l'Orient et l'Occident, naît le projet du Canal dans l'imagination de Ferdinand. Des circonstances bien particulières facilitèrent la réalisation du projet. Mehemet Ali, qui était le vice-roi d'Égypte, devait, au moins dans une certaine mesure, sa position aux recommandations faites au gouvernement français par Mathieu de Lesseps, consul-général en Égypte quand Mehemet Ali n'était qu'un simple colonel. Ferdinand fut donc amicalement et affectueusement accueilli par le vice-roi. Plus tard, c'est Saïd Pacha fils de Mehemet Ali, qui lui accordera la concession pour la construction du canal de Suez. En 1833, Ferdinand de Lesseps est nommé consul au Caire, et peu après consul général à Alexandrie, poste qu'il tient jusqu'en 1837. Pendant cette période, une terrible épidémie de peste sévit pendant deux années, coûtant la vie de plus d'un tiers des habitants du Caire et d'Alexandrie. Faisant preuve d'une ardeur imperturbable, Ferdinand poursuit sa mission, allant d'une ville à l'autre selon la présence du danger. En 1839, il est nommé consul à Rotterdam, et l'année suivante, transféré à Malaga, dans le pays d'origine de la famille de sa mère. En 1842, il est envoyé à Barcelone, et bientôt promu au rang de consul général. Au cours d'une insurrection sanglante en Catalogne, qui finit par le bombardement de Barcelone, Ferdinand de Lesseps fait preuve du courage le plus persistant en sauvant de la mort, sans distinction, des hommes appartenant aux factions rivales, et en protégeant non seulement les Français en danger mais aussi des étrangers de toutes les nationalités. En 1859 il crée une école pour scolariser les enfants des français immigrés à Barcelone, cet établissement6 qui porte son nom est aujourd'hui le plus ancien établissement français de la péninsule Ibérique. De 1848 à 1849, il est ministre de la France à Madrid. Promoteur du canal de Suez Alors que la France est enferrée dans l'expédition de Rome, Ferdinand de Lesseps est nommé ambassadeur plénipotentiaire avec pour mission de négocier un accord amiable entre Pie IX et les révolutionnaires qui viennent de fonder la République romaine. La réélection de Louis-Napoléon Bonaparte bouleverse la politique étrangère de la France. Le corps expéditionnaire commandé par le général Oudinot reçoit l'ordre d'assiéger Rome. Désavoué, Ferdinand de Lesseps entre en dissidence selon son expression et démissionne du service diplomatique. Il est alors accusé de collusion avec l'ennemi et sera défendu devant la Chambre par Ledru-Rollin après avoir été déféré par l'Assemblée conservatrice devant la juridiction du Conseil d'État qui l'accuse d'avoir reconnu au gouvernement romain une autorité morale et point seulement de fait. Il rédige un mémoire qui est rendu public en juillet 1849. En 1853, il perd en l'intervalle de quelques jours son épouse et un de ses fils d'une épidémie de scarlatine. En 1854, l'accession au trône de vice-roi d'Égypte de son vieil ami, Saïd Pacha, donne une nouvelle impulsion aux idées qui l'avaient hanté pendant les vingt-deux dernières années au sujet du canal de Suez. Ferdinand de Lesseps est invité par Saïd Pacha, et le 7 novembre 1854 débarque à Alexandrie. Le 30 du même mois, Saïd Pacha signe la concession autorisant Ferdinand de Lesseps à percer l'isthme de Suez. Des ingénieurs saint-simoniens, que la dispersion de leur secte avait conduits en Egypte, s'étaient préoccupés, quinze ans auparavant, de la réunion de la Méditerranée à la mer Rouge et avaient même tenté un barrage du Nil (Enfantin et Lambert Bey). Ferdinand de Lesseps était alors consul au Caire. Il avait lu, vers le même temps, à Alexandrie, un rapport écrit en 1800 sur la question par un ingénieur de l'expédition d'Egypte, l'architecte Lepère, et il y avait souvent réfléchi depuis. A La Chenaie, où il ne s'occupait guère que d'agriculture, il eut le loisir de méditer et de mûrir l'idée et, lorsqu'au mois de juillet 1854 il apprit la mort du vice-roi Abbas Pacha, sa conviction était déjà faite, et son plan arrêté. Les circonstances étaient on ne peut plus favorables. Ferdinand de Lesseps avait été le grand ami d'enfance du nouveau souverain, Saïd Pacha, quatrième fils de Mohammed Ali, et le jeune prince, devenu homme, lui avait conservé une vive affection. Il s'embarqua dès le mois d'octobre pour l'aller féliciter de son avènement, et, le 15 novembre au soir, tandis que tous deux chevauchaient à travers le désert Lybique, se rendant d'Alexandrie au Caire, il s'ouvrit à lui de ses projets. Saïd Pacha les approuva sur-le-champ et promit de les seconder. De Lesseps ne perdit pas un instant. Déployant, malgré ses cinquante ans, une activité à peine concevable, il réunit une commission internationale, la conduisit en Egypte, fit déterminer le tracé, s'occupa en même temps de lancer l'affaire, organisa des réunions, fit des conférences, persuada les incrédules, confondit ses adversaires et triompha finalement de toutes les hésitations et de toutes les résistances, grâce à une ardeur, à une énergie et à une ténacité que ni déboires ni revers ne parvinrent jamais à abattre. Sur ses indications, un premier plan est immédiatement dessiné par deux ingénieurs français, Louis Maurice Adolphe Linant de Bellefonds et Eugène Mougel. Après avoir été légèrement modifié, le plan est adopté en 1856 par la commission Internationale pour le percement de l'isthme des Suez à laquelle il a été soumis. Encouragé par ce verdict, pas plus l'opposition de Lord Palmerston, qui craint alors pour la position commerciale du Royaume-Uni, que les avis amusés prédisant le comblement du canal par les sables du désert, n'arrêtent Lesseps.Il prend d'ailleurs cette année-là comme secrétaire un journaliste, humoriste et auteur dramatique anglais Charles Lamb Kenney, qui a néanmoins le diplôme d'avocat. Parmi les trois propositions qui fait Ferdinand de Lesseps, c'est l'ingénieur italien Luigi Negrelli qui a été choisi, celui qui avait proposé la canalisation directe, le respect de la forme et de l'absence des écluses à l'embouchure du canal. La direction générale du travail a ensuite été assigné à Negrelli mais il est mort après quelques jours de maladie, et donc les travaux seront continue matériellement par Ferdinand sur les plans établis de Negrelli. Poussé par ses convictions, soutenu par l'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie, il réunit par souscription plus de la moitié du capital de deux cents millions de francs nécessaires pour fonder la Compagnie Universelle du canal maritime de Suez. Le gouvernement égyptien souscrit pour quatre-vingts millions. La compagnie de Ferdinand de Lesseps construit le canal de Suez entre 1859 et 1869. Dans l’affaire, Lesseps s’est entouré d’un vaste réseau de compétences, sinon de connivences, notamment dans la presse, qui lui seront toujours de la plus grande utilité. En 1869, après l'inauguration du canal de Suez, Napoléon III propose de le nommer duc de Suez. Instruit par le précédent des lacs Amers, il est le premier à applaudir au projet Roudaire. Il le soutiendra en même temps que d’autres grandes entreprises telles que le creusement d’un tunnel sous la Manche, l’établissement de liaisons ferroviaires à travers l’Asie, le canal de Panama, ou le transsaharien. Phare du Tout-Paris, homme clé des relations de l’Occident avec l’Orient, pape de la géographie et de l’expansion européenne en Afrique, président de la Société de géographie en 1881, membre de la Société protectrice des indigènes. L'Angleterre avait pourtant bien lutté. Ses hommes d'Etat et ses ingénieurs, lord Palmerston et Stephenson en tête, avaient déclaré impossible, absurde, le projet du canal, tout en menaçant la Sublime Porte des plus violentes représailles si elle signait le firman de ratification de la concession; ses financiers avaient entravé de tout leur pouvoir les émissions d'actions en propageant dans le public les bruits les plus alarmants et en vouant d'avance les souscripteurs à la banqueroute. Un puissant parti français avait également mené une vive campagne de déconsidération. Malgré tout, une concession en règle fut accordée 5 janvier 1856, le gouvernement égyptien souscrivit à 177 642 actions, et les travaux commencèrent le 25 avril 1859. Ils se poursuivirent pendant quatre ans sans incidents graves. Mais en 1863, Saïd Pacha étant mort, son successeur, Ismaïl Pacha, poussé par l'Angleterre et la Turquie, fit mine de s'opposer à leur continuation. De nouveau Ferdinand de Lesseps se multiplia, Napoléon III intervint, et, l'année suivante, les travaux purent reprendre. L'inauguration officielle eut lieu le 17 novembre 1869. Ce fut par le monde entier un enthousiasme indescriptible. Ferdinand de Lesseps fut mis au rang des plus illustres célébrités; les souverains, accourus à Port-Saïd pour le féliciter, lui conférèrent les plus hautes dignités de leurs ordres les plus honorifiques; le gouvernement français, notamment, le nomma grand-croix de la Légion d'honneur 1869 sans qu'il eût passé par le grade de grand officier; les Anglais eux-mêmes ne voulurent pas demeurer en arrière, et Londres lui accorda sa faveur la plus recherchée, le droit de bourgeoisie 1870. Pendant quinze années, il fut certainement le citoyen du monde le plus populaire, en même temps que le plus admiré et le plus respecté; on ne l'appela plus que le grand Français, et sa vie devint comme une longue et glorieuse apothéose. Il payait de mine, du reste, avec sa physionomie martiale, sa taille bien prise et esthétiquement serrée dans sa redingote noire, ses épaules larges, sa démarche aisée et cette auréole de triomphateur qui ne quittait guère son large front. C'était en outre un cavalier d'élite, et il dut en grande partie à cette qualité son ascendant sur les Egyptiens. Echecs politiques Il n'y eut qu'en politique que Ferdinand de Lesseps ne fut pas heureux. Aux élections de 1869, l'Empire le porta candidat officiel contre Gambetta dans la deuxième circonscription de Marseille; il échoua. Il échoua également le 15 mars 1876, par 84 voix contre 174 données à Ricard, comme candidat de la droite sénatoriale à un siège de sénateur inamovible. Il ne professa jamais, du reste, des opinions bien extrêmes. Sa conduite dans les affaires de Rome en 1849 et les mesures prises alors contre lui avaient fait quelque temps supposer qu'il était républicain. Mais il s'était incontestablement réconcilié avec Napoléon III, et il entretenait les meilleures relations avec l'impératrice, qui était sa cousine. Ce fut même lui qui la fit évader des Tuileriesle 4 septembre 1870 et qui la conduisit en lieu sûr. Dès 1873, Ferdinand de Lesseps étudia un autre grand projet. Il s'agissait, cette fois, d'une voie ferrée qui, allant d'Orenbourg à Peshawar, à travers l'Asie centrale, devait relier les réseaux russe et anglo-indien. Ce fut l'un de ses fils, Victor, attaché d'ambassade, qui se rendit dans l'Inde pour examiner sur place la question, mais elle resta sans solution. Quelques années plus tard, à la suite d'une visite qu'il fit lui-même aux chotts algériens et tunisiens, il se déclara hautement pour la création, sur leur emplacement, d'une mer intérieure africaine dont les eaux seraient amenées de la Méditerranée par un canal de 160 kilomètres partant de Gabès. Les plans avaient été dressés par le commandant Roudaire. Des ingénieurs refirent les études et constatèrent que les parties à submerger étaient au-dessus du niveau de la mer. Ferdinand de Lesseps fut aussi l'un des promoteurs du canal de l'isthme de Corinthe. Il ne s'en occupa toutefois qu'en passant. D'autres idées le hantaient. Il voulait un digne pendant à l'isthme de Suez. Il ambitionnait de faire plus grand encore. Le canal de Panama. Le percement de la longue langue de terre qui sépare les deux Amériques avait, à maintes reprises, depuis le commencement du siècle, obsédé les rêves de marins et d'ingénieurs. Deux officiers de la flotte française, Wyse et Reclus, avaient plus récemment recherché le tracé d'un canal entre Panama, sur l'océan Pacifique, et Colon, sur l'Atlantique. Ferdinand de Lesseps se mit à la tête d'un comité chargé d'étudier leur avant-projet. Un congrès international d'ingénieurs se réunit à Paris au mois de mai 1879. Plusieurs plans, tous insuffisamment préparés d'ailleurs, lui furent soumis. Mais Lesseps avait son idée arrêtée. Le canal de Panama devait être, comme son frère d'Egypte, à niveau constant et sans écluses; il n'en admettait pas d'autre. La situation était pourtant bien différente. Au lieu d'un long ruban de sable à draguer, c'était toute une montagne de roche dure dans laquelle il allait falloir creuser une gigantesque cuvette. Ferdinand de Lesseps ne voulut pas prendre en considération les observations réitérées que lui firent à cet égard deux sous-commissions techniques. Il avait en son étoile une confiance absolue. Si l'on demande, disait-il, à un général qui a gagné une première bataille s'il veut en gagner une autre, il ne peut refuser. Il se contenta, pour l'évaluation des dépenses et de la durée des travaux, de données vagues et incertaines, et il entraîna assez facilement la majorité du congrès, qu'hypnotisait le succès de Suez. Une première tentative d'émission publique échoua août 1889. Malgré ses soixante-quinze ans, il paya de sa personne, comme vingt ans plus tôt pour son premier canal, organisa toute une campagne de conférences, fonda le Bulletin du canal interocéanique et, au mois de décembre, partit pour le Panama avec sa femme, deux de ses enfants et toute une escorte d'ingénieurs, d'économistes et de journalistes. Le 1er janvier 1880, la petite Ferdinande de Lesseps donna le premier coup de pioche. On resta vingt jours. L'observation des difficultés fut forcément très superficielle. On alla ensuite aux Etats-Unis, où l'opposition était fort vive et on revint en Europe. Au mois de décembre, une nouvelle émission fut lancée. Elle fut couverte plusieurs fois. Le 3 mars 1881, la Compagnie du canal interocéanique fut définitivement constituée. L'inauguration devait avoir lieu le 1er octobre 1887! Cependant, Ferdinand de Lesseps n'en avait pas fini avec le canal de Suez et avec les Anglais. En 1875, le gouvernement de la reine Victoria avait acheté au khédive pour une valeur de 100 millions de francs les 176 602 actions dont il était propriétaire. En 1881, il mit à profit la révolte d'Arabi Pacha pour débarquer en Egypte et tenter de s'emparer du canal, que l'amiral Hoskins, excité aux plus violentes mesures par le Times et par quelques autres journaux anglais, ne craignit pas d'occuper militairement. Vainement, Ferdinand de Lesseps, accouru immédiatement à Ismaïlia, protesta-t-il contre cette atteinte à la propriété privée. Son attitude énergique sauva néanmoins la situation. Arabi Pacha lui promit de respecter la neutralité du canal, et l'amiral anglais lui demanda spontanément d'en reprendre l'exploitation normale. Les attaques des journaux d'outre-Manche n'en furent que plus acharnées. Ils alléguèrent d'abord les allures insolentes du président de la Compagnie, puis l'insuffisance du canal, et ils réclamèrent le percement d'une seconde voie pour le service spécial de L'Angleterre. Lesseps sut tenir tête à tous les orages. Trois ans après un nouveau et dernier voyage en Egypte 1884, il remporta une victoire décisive par la signature de la convention franco-anglaise du 23 octobre 1887, qui assurait, sous la garantie des principales puissances, la neutralité du canal et qui reconnaissait le privilège exclusif de la compagnie concessionnaire. Le grand Français jouissait encore à cette époque de toute sa popularité et de tout son prestige. Membre libre de l'Académie des sciences de Paris depuis 1873, il avait été choisi en 1884 par l'Académie française pour succéder à Henri Martin, bien que ni la nature de ses écrits, qui ne sont en général que des recueils de documents, ni son style fort relâché ne parussent devoir le désigner aux suffrages d'une compagnie littéraire. La plupart des sociétés savantes de l'étranger s'étaient fait également un honneur de s'attacher à des titres divers le perceur d'isthmes, et il présidait, plus ou moins effectivement, une multitude d'associations, de cercles, de congrès, etc. Au mois de mars 1887, il fut envoyé par le gouvernement français à Berlin, sans qu'on ait jamais su exactement si cette mission était relative à une invitation secrète de l'Allemagne à l'exposition universelle de 1889 ou à quelque démarche tendant à la révision du traité de Francfort. Il reçut en tous cas de l'empereur, du prince de Bismarck et de toute la cour les marques les plus ostensibles de sympathie et de déférence. Malheureusement, l'oeuvre de Panama marchait rapidement à la ruine, et la considération de Ferdinand de Lesseps allait bientôt sombrer dans ce cataclysme financier. En 1885, la situation de la Compagnie était déjà critique. En 1886, son président effectua un nouveau voyage dans l'isthme, au cours duquel il consentit à reconnaître que le canal à niveau était pour le moment impossible et qu'il fallait se contenter, temporairement au moins, d'un canal à écluses. Mais de toute façon il fallait beaucoup d'argent : or les caisses étaient vides, plus d'un milliard avait déjà été dépensé et la défiance grandissait. Il y eut alors une série d'émissions infructueuses, entremêlées d'enquêtes gouvernementales et de vifs débats parlementaires. Seul Ferdinand de Lesseps ne désespérait pas et, dans une nouvelle campagne de publications et de conférences, il annonçait contre toute évidence l'ouverture du canal avant la fin de 1890. Il dut pourtant, le 11 décembre 1888, abandonner la lutte. Le 4 février 1889, la liquidation judiciaire de la Compagnie fut prononcée. Les bruits les plus graves commencèrent à circuler : les travaux réellement utiles ne représentaient, disait-on, qu'une faible part des sommes dépensées; des travaux incohérents et un gaspillage éhonté avaient absorbé le reste. Sous la pression de l'opinion publique, la Chambre des députés vota, le 4 janvier 1892, à l'unanimité de 509 votants, un ordre du jour réclamant une répression énergique. Le 9 février 1893, la cour de Paris condamna Ferdinand de Lesseps et son fils aîné, Charles, qui avait été depuis le début des études du canal de Panama son collaborateur de tous les instants, à cinq années d'emprisonnement et à 3000 F d'amende. Charles avait seul comparu. Son père, littéralement écrasé par la ruine de son oeuvre, vivait depuis le commencement de l'année 1889 au fond de sa propriété de La Chenaie, dans un état de somnolence sénile qui avait permis à sa famille de tout lui cacher : le procès et l'arrestation de son fils. Il ne connut pas davantage sa condamnation. Elle ne lui fut du reste jamais notifiée et on n'eut pas ainsi à le rayer des cadres de la Légion d'honneur Ferdinand de Lesseps mourut à La Chenaie à quatre-vingt-neuf ans. Son corps fut ramené à Paris, où les honneurs militaires ne lui étaient pas régulièrement dus, et un silencieux cortège de fidèles admirateurs le conduisit à sa dernière demeure. Le désastre avait fait trop de victimes et trop de dupes, lui-même y avait trop directement contribué par des fautes et par une légèreté indiscutables, pour qu'il pût éviter le ressentiment populaire. Mais l'histoire oubliera certainement les égarements de sa vieillesse trop présomptueuse et trop confiante pour se souvenir seulement qu'il fit Suez, qu'à l'âge de soixante-dix ans encore sa gloire était intacte et que, s'il laissa commettre de honteuses dilapidations, il ne fut lui-même, entre les mains d'industriels et de financiers sans scrupules, qu'un instrument à peu près inconscient; elle ne verra plus en lui que l'incarnation de l'esprit d'entreprise dans sa plus haute acception, que l'initiateur de la plus grande révolution matérielle qui ait eu lieu dans ce monde (Francis Charmes. Il ne recueillit du reste que bien peu de chose du maniement de tous ces millions. Il semble même plutôt avoir compromis sa fortune dans cette affaire, car le 5 juin 1894 l'Assemblée générale des actionnaires de la Compagnie du canal de Suez dut voter à sa femme et à ses enfants, pour assurer leur avenir, une pension viagère de 120 000 francs. Ferdinand de Lesseps s'était marié, alors qu'il était consul en Egypte, avec Mlle Delamalle, morte en 1854. Elle lui laissa deux fils : Charles-Aimé-Marie, né en 1849, et Victor, l'un et l'autre cités dans le cours de cet article. Le 23 novembre 1869, il épousa à Ismailia une créole de l'île Maurice qu'il avait rencontrée dans un salon parisien, Mlle Hélène Autard de Bragard. Elle avait alors dix-huit ans. Elle lui donna à son tour neuf charmants enfants bien connus des Parisiens, qui virent souvent leur joyeuse cavalcade remonter à poney l'avenue des Champs-Elysées. Fin de carrière Le perceur d’isthme laisse derrière lui des zones d’ombre propice au culte comme à la suspicion. En 1893, poursuivi pour trafic d’influences et détournement de fonds dans le cadre des suites judiciaires dû au scandale de Panamá, Ferdinand de Lesseps est condamné à cinq ans de prison qu’il n’effectuera pas. Ferdinand de Lesseps mourut à quatre-vingt-neuf ans, dans sa demeure berrichonne de La Chesnaye à Guilly dans l'Indre. Son corps fut ramené à Paris, où les honneurs militaires ne lui étaient pas régulièrement dus, et un silencieux cortège de fidèles admirateurs le conduisit à sa dernière demeure. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris division 6 mais une partie de son sang repose au cimetière de Guilly. Distinctions et récompenses Académie française 1884 Académie des sciences 1873 Grand-croix de la Légion d'honneur 1869 Hommages 2009, la Plaça de-Lesseps à Barcelone, rénovée Son nom a été donné à : un paquebot des Messageries maritimes le Ferdinand-de-Lesseps une place de Barcelone, la Plaça de Lesseps dans le quartier de Gràcia, inaugurée en 1895, dernière rénovation en 2008 une station du Métro de Barcelone sur la première ligne en 1924, aujourd'hui ligne L3 un collège : Vatan Indre à quelques kilomètres de sa propriété de La Chesnaye de nombreuses rues à Paris et dans des communes de l'Indre Liens http://youtu.be/UiKXpE8_hX8 un homme, un rêve, un canal http://youtu.be/UnbHMyfOIkE Sa vie en 4 épisaodes http://youtu.be/wEbjkdUBEu4 Ferdinand de Lesseps       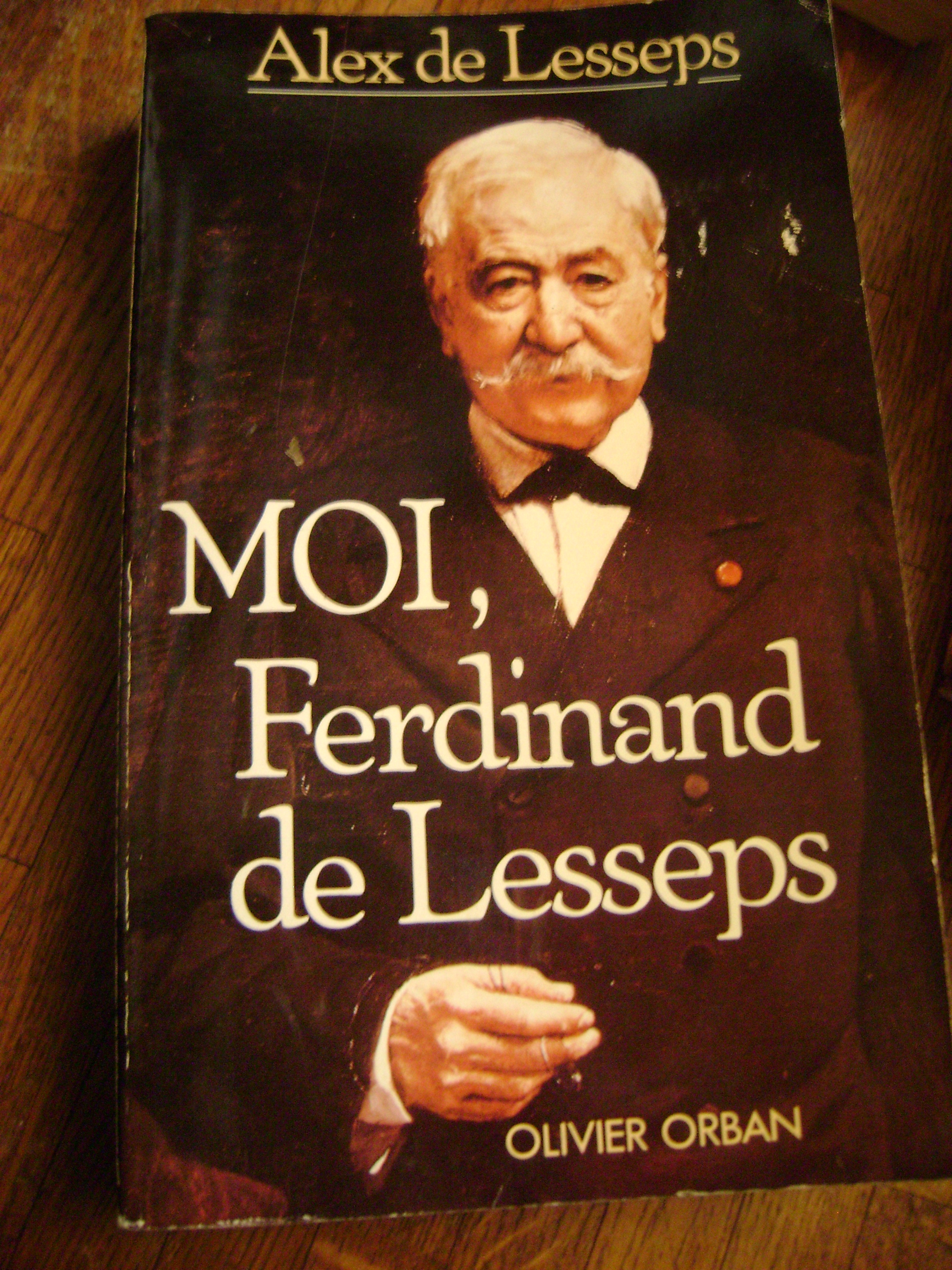     
#4149
Cicéron 1
Loriane
Posté le : 06/12/2014 17:14
Le 7 décembre 43 av J.-C. est assassiné Cicéron
en latin Marcus Tullius Cicero,à 63 ans, à Gaète, né le 3 janvier 106 av. J.-C. à Arpinum en Italie, philosophe romain, homme d'État et un auteur latin, il est Pater Patriae, Questeur, Édile, Préteur, Proconsul. il avait pour mère helvia, pour père Marcus Tullius Ciceron, son épouse est Terentia de 79 à à 46, puis après son décès Publia de 46 à 45 ses Enfants sont Tullia et Marcus. Citoyen romain issu de la bourgeoisie italienne, Cicéron n’appartient pas à la noblesse, ce qui en principe ne le destine pas à un rôle politique majeur. Contrairement à ses contemporains Pompée et Jules César, la carrière militaire ne l’intéresse pas, et après une solide formation à la rhétorique et au droit, il réussit grâce à ses talents d’avocat à se constituer suffisamment d’appuis pour parvenir en 63 av. J.-C. à la magistrature suprême, le consulat. Dans une République en crise menacée par les ambitieux, il déjoue la conjuration de Catilina par la seule énergie de ses discours, les Catilinaires. Ce succès qui fait sa fierté cause ensuite son exil en 58 av. J.-C., pour avoir exécuté des conjurés sans procès. Revenu à Rome en 57 av. J.-C., il ne joue plus de rôle important sur la scène politique, dominée par Pompée et César. Durant la guerre civile qui débute en 49 av. J.-C., il rallie Pompée avec hésitation, puis est forcé de s'accommoder du pouvoir de César, avant de s’allier à Octave contre Antoine. Sa franche opposition à Antoine lui coute la vie en 43 av. J.-C. Orateur remarquable, il publie une abondante production considérée comme un modèle de l’expression latine classique, et dont une grande partie nous est parvenue. Il consacre sa période d’inactivité politique à la rédaction d’ouvrages sur la rhétorique et à l’adaptation en latin des théories philosophiques grecques. En partie perdus pendant le Moyen Âge, ses ouvrages connaissent un regain d’intérêt durant la renaissance carolingienne puis la renaissance italienne et l'époque classique. En revanche, au XIXe siècle et dans la première moitie du XXe siècle, il n'est considéré que comme un simple compilateur des philosophes grecs et sa vie politique est diversement appréciée et commentée : intellectuel égaré au milieu d’une foire d’empoigne, parvenu italien monté à Rome, opportuniste versatile, instrument passif de la monarchie larvée de Pompée puis de César selon Theodor Mommsen et Jérôme Carcopino1. Selon la vision plus positive de Pierre Grimal, il est l’intermédiaire précieux qui nous transmit une partie de la philosophie grecque. En bref Homme d'État, orateur prodigieux, théoricien de l'éloquence, mais aussi philosophe, Cicéron a été victime, aux yeux de la postérité, de tous ses dons ; il a été surtout victime du fait d'être devenu trop tôt, de son vivant même, un auteur classique et scolaire, faisant toujours un peu figure d'écrivain égaré dans la politique. Une tradition moderne, qui remonte à Mommsen, a, de parti pris, tenté de condamner l'homme privé et public, de décrier le politicien et même de rabaisser le philosophe qui ne serait qu'un adaptateur brillant et superficiel : Cicéron, s'il a des amis, a toujours beaucoup d'ennemis. Une réhabilitation, comme voudraient la tenter les auteurs de cet article, serait de peu d'intérêt s'il ne s'agissait que de défendre une mémoire. Il est plus intéressant de montrer que cette réhabilitation permet d'écarter plusieurs contresens invétérés, concernant aussi bien la carrière, l'action politique, l'œuvre théorique que la philosophie de Cicéron. Du coup, on lui restitue une dimension, une cohérence, une humanité qui justifient son prodigieux succès culturel : car sur lui repose en partie l'« humanisme ». Il est intéressant aussi de savoir que cette tradition qui traite l'homme, le politique et le penseur avec tant de désinvolte mépris a été systématiquement forgée par ceux-là mêmes qui l'avaient assassiné – Octave et ses complices – assassinant, du même coup, les libertés romaines. Dès 61, les populaires avec Clodius et César, les aristocrates conservateurs avec Caton, Pompée enfin revenu triomphant d'Orient attaquent de tous côtés la politique de Cicéron ; le Sénat retire aux chevaliers les avantages financiers qu'il leur avait consentis, les populaires accusent Cicéron de tyrannie et lui reprochent d'avoir utilisé la loi martiale lors de la répression. Pompée, César et Crassus s'entendent en sous-main pour se partager le pouvoir : le gage de ce marché sera l'exil de Cicéron, manigancé en 58 par Clodius, devenu tribun de la plèbe. Cicéron, abandonné par les chefs de parti, se refuse à déclencher la guerre civile et s'enfuit à Brindes et en Grèce. Mais, en 57, devant l'indignation de l'Italie, Pompée se reprend, et le Sénat finit par obtenir le vote d'une loi de rappel : c'est le retour triomphal sur les épaules de l'Italie. Cependant Cicéron ne retrouve pas son influence de jadis ; il ne peut que louvoyer entre Pompée et César et tenter de rallier un parti modéré à très large assiette sociale, où l'Italie des municipes serait fortement représentée Pro Sestio, 56 av. J.-C.. Il se rapproche alors de César, dans la mesure même où Pompée glisse vers les aristocrates conservateurs plaidoyer Pro Rabirio, 54 av. J.-C. Mais en même temps, il s'élève au-dessus de la mêlée et écrit ses chefs-d'œuvre de philosophie politique (De oratore, De re publica, De legibus. En 52, il défend Milon accusé du meurtre de Clodius Pro Milone ; en 51, il est proconsul en Cilicie, où il mène une campagne victorieuse contre les Parthes et s'acquitte avec une grande honnêteté de ses fonctions. À son retour, la guerre civile est menaçante. Cicéron tente de s'y opposer, mais, en janvier 49, malgré ses sympathies secrètes, il choisit la légitimité et suit Pompée, bien qu'il redoute en lui un nouveau Sylla. Après Pharsale, il regagne l'Italie et, sans se rallier ouvertement à César, reprend son siège au Sénat et presse César de rétablir la légalité Pro Marcello. Il se consacre de plus en plus, cependant, à ses travaux littéraires et philosophiques. Après les ides de mars 44, à la préparation desquelles il n'a point pris part, il apparaît cependant comme le plus prestigieux des hommes politiques républicains, un point de ralliement pour l'opinion égarée. Il retrouve pour quelques mois son prestige, son influence et tente, en face des généraux tyrannochtones et du consul Marc Antoine qui se présente comme l'héritier de César, d'imposer le retour au régime sénatorial les Philippiques, discours contre Antoine. Mais Antoine finit par s'entendre, contre Cicéron, avec Caius Octavius, le petit-neveu de César, dont Cicéron avait voulu d'abord se servir : lorsque Antoine, Octave et Lépide, par un coup d'État, se font confier un triumvirat constituant, Cicéron figure au premier rang des proscrits. Il meurt courageusement à Gaète. On a souvent critiqué, chez Cicéron, le caractère de l'homme politique, sans se rappeler que c'est d'abord un de ceux dont nous connaissons le mieux les angoisses ou les hésitations, sans considérer non plus les difficultés que pouvait rencontrer dans la Rome de cette époque un homme nouveau ne disposant ni de clientèle ni d'argent, un avocat et un intellectuel répugnant au pouvoir militaire, un homme de goût et d'étude détestant la démagogie, qui connaissait et regrettait la grandeur passée de Rome et l'âge d'or de la République modérée. Il apparaît au contraire que, loin d'être médiocre et inférieur à l'orateur ou au philosophe, l'homme politique, lucide, habile, parfois sans doute hésitant, a tenté en général de trouver des solutions neuves et de mettre son action en accord avec ses principes. Sa vie Marcus Tullius Cicero est né à Arpinum, en pays volsque, à une centaine de kilomètres à l'est de Rome. "Cicéron" naît en 106 av. J.-C., le troisième jour du mois de janvier, dans le municipe d’Arpinum, à 110 km au sud-est de Rome. Sa famille, fort honorable, appartenait à l'ordre équestre et comptait des magistrats municipaux et des officiers supérieurs de l'armée ; elle était en outre directement alliée avec celle de Marius qui gérait alors son deuxième consulat. Sa mère se prénommait Helvie. Il est, par son père, d’une famille membre de la gens des Tullii d'origine plébéienne élevée au rang équestre. Son cognomen, Cicero, peut être traduit par pois chiche, verrue. Ce cognomen lui viendrait d’un de ses ancêtres dont le bout du nez aurait eu la forme du pois chiche ou qui aurait été marchand de pois chiches.Son grand-père, son père et ses oncles, particulièrement cultivés, entretenaient des relations avec les plus grands orateurs et les plus grands juristes de Rome, Marc Antoine, le grand-père du triumvir, Lucius Licinius Crassus, Aemilius Scaurus, Quintus Mucius Scaevola. Élevé dans un milieu lettré et ouvert à la politique, le jeune Cicéron manifeste très tôt des dons intellectuels éclatants. Comme les jeunes sénateurs, il étudie la poésie, la rhétorique et le droit ; il s'intéresse aussi, ce qui est moins fréquent, à la philosophie. En 89, il est attaché à l'état-major de Cneius Pompeius Strabo, père du grand Pompée, pendant la guerre Sociale ; sa famille ayant des sympathies chez les partisans de Marius un de ses cousins germains sera deux fois préteur, en 85 et 84, il s'éloigne pour terminer ses études en Grèce et à Rhodes. En 81, il débute au barreau, puis, avec l'appui de la puissante famille des Metelli, plaide contre un des affranchis de Sylla, le tout-puissant Chrysogonus : ce discours, Pro Sexto Roscio Amerino, n'est sans doute pas étranger à l'abdication de Sylla. Cependant, il doit s'éloigner encore une fois de Rome. Cicéron et son frère Quintus sont envoyés à Rome pour étudier. Le poète Archias les forme aux classiques grecs Homère et Ménandre. L'initiation aux activités publiques se fait comme auditeur des personnalités les plus actives du forum. Ainsi Cicéron fréquente assidument les orateurs Crassus puis Antoine et le jurisconsulte Scævola l'Augure. La guerre sociale éclate pendant cette période de formation. Cicéron s'engage dans l'armée à 17 ans, une obligation pour qui veut faire ensuite une carrière publique : il se trouve sous les ordres du consul Pompeius Strabo, puis de Sylla ; c’est vraisemblablement à cette époque qu’il fait la connaissance de Pompée fils de Strabo, qui a le même âge que lui. Peu désireux de faire une carrière militaire, il quitte l'armée à la fin du conflit en 88 av. J.-C. et revient à ses études, tandis que les vainqueurs de la guerre civile Marius et Sylla se disputent le pouvoir. Après le décès de Scævola l'Augure, Cicéron poursuit l'étude du droit avec son cousin Quintus Scævola le pontife. Le stoïcien Aelius Stilo lui transmet son intérêt pour le passé et la langue de Rome. Sa formation philosophique est assurée en grec par des philosophes que la guerre contre Mithridate VI oblige à s'installer à Rome : après l'épicurien Phèdre, Cicéron travaille la dialectique avec le stoïcien Diodote et suit les enseignements de l’académicien Philon de Larissa. Philon a la particularité de combiner la philosophie et la rhétorique grecque, spécialités habituellement professées par des maîtres différents, et pratique comme Carnéade avant lui la discussion selon les points de vue opposés pour approcher la vérité. Cicéron se passionne pour sa philosophie, comme il le confiera sur la fin de sa vie. Cicéron fait un début remarqué comme avocat en 81 av. J.-C. avec une affaire complexe de succession, le Pro Quinctio. En 79 av. J.-C., il défend Sextus Roscius accusé de parricide ; soutenu par les Caecilii Metelli, une des grandes familles de la nobilitas, il s’attaque à un affranchi du dictateur romain Sylla, tout en veillant à épargner ce dernier. Il gagne le procès mais s'éloigne quelque temps de Rome pour parfaire sa formation en Grèce, de 79 à 77 av. J.-C. À Athènes où il se lie d’amitié avec son compatriote Atticus, il suit l’enseignement d’Antiochos d'Ascalon, académicien comme Philon de Larissa mais plus dogmatique6, des épicuriens Zénon de Sidon et Phèdre, du savant stoïcien Posidonius d'Apamée. Puis à Rhodes de 78 à 77 av. J.-C., il perfectionne sa diction auprès du célèbre rhéteur Molon. Plutarque rapporte qu'à son premier exercice, Cicéron impressionne son maître par sa maîtrise de l'expression grecque et la qualité de son argumentation. De Molon, Cicéron apprend à maîtriser sa voix sans les excès qui l'épuisent. À la fin de cette période de formation, tant oratoire qu’intellectuelle et philosophique, Cicéron revient à Rome et reprend son activité d'avocat, ce qui entretient sa réputation et développe ses relations. Ses contacts avec la nobilitas lui permettent d'épouser la riche et aristocratique Terentia10. Elle lui donne une fille, Tullia, et un fils, Marcus peu avant son consulat. Défenseur de la légalité En 77, il épouse Terentia, d'une famille de la noblesse, et aborde la carrière des honneurs. Il est élu questeur en 76, à l'âge légal, et exerce cette magistrature en Sicile : c'est le début d'une magnifique carrière d'homme nouveau, qui doit l'essentiel de sa réussite au mérite personnel et non au jeu des clientèles. Le parti démocratique, décimé et battu depuis 82, mais soutenu par une partie de l'ordre équestre, relevait alors la tête. Il combattait pour l'abolition de la Constitution de Sylla et le rétablissement des droits des tribuns de la plèbe, pour l'inscription effective des Italiens dans la cité romaine et surtout pour la fin du monopole sénatorial sur les tribunaux politiques. En 71, les deux généraux les plus prestigieux, Marcus Licinius Crassus et Pompée, se mirent d'accord pour soutenir ces revendications. Le procès en concussion du propréteur de Sicile, Verrès, offrait l'occasion de discréditer la justice sénatoriale : Cicéron prit la défense des Siciliens contre Verrès et s'attira ainsi la reconnaissance du parti populaire (les Verrines, 70 av. J.-C.), tout en soulevant l'opinion en faveur des sujets de Rome, trop souvent opprimés. Préteur urbain en 66, Cicéron soutint de sa parole et de son autorité la loi Manilia, qui proposait de confier à Pompée le commandement suprême en Orient contre Mithridate : c'est là son premier grand discours politique (Pro lege Manilia). Déjà pèse sur Rome la double menace d'un coup d'État militaire et de la subversion révolutionnaire, entretenue et facilitée par les impuissances du régime sénatorial qui ne sait se dégager des luttes de factions. En 64, un aristocrate décavé, Lucius Sergius Catilina, ancien syllanien devenu démagogue, déjà battu au consulat, réunit dans une conjuration hétéroclite tous les mécontents et se propose, avec la complicité de certains hauts magistrats et de nombreux sénateurs, de s'emparer du gouvernement par l'émeute et par la force. Cicéron, bien qu'homme nouveau, apparaît aux conservateurs modérés et à l'opinion italienne, du fait de ses liens avec l'ordre équestre et de ses sympathies « populaires », comme le seul homme capable de sauver la légalité. Il est triomphalement élu consul pour 63, mais se heurte sur-le-champ à la fois aux projets de Catilina, à l'inimitié de la noblesse et aux manœuvres de César. Avec courage, éloquence et habileté, il combat sur les deux fronts, voulant éviter la guerre civile, empêcher la subversion, faire pièce aux démagogues. Pour cela, il s'appuiera sur l'opinion publique, sur une partie du Sénat et sur l'ordre équestre qu'il essaie d'associer aux décisions politiques de son gouvernement la concordia ordinum moyennant quelques concessions de la part du Sénat Catilinaires ; Pro Murena ; Pro C. Rabirio ; De lege agraria. Le succès immédiat de cette politique fait de Cicéron le sauveur de Rome, un rival possible pour Pompée. Les débuts en politique Ayant atteint l'âge minimum légal de 30 ans pour postuler aux magistratures, Cicéron se lance dans la carrière politique : en 75 av.J.-C. il entame le cursus honorum en étant élu questeur, fonction qu'il exerce à Lilybée en Sicile occidentale, et qui lui ouvre l'admission au Sénat. Il acquiert sa célébrité en août 70 av.J.-C. en défendant les Siciliens dans leur procès contre Verres, ancien propréteur de Sicile qui est impliqué dans des affaires de corruption, et qui a mis en place un système de pillage d’œuvres d’art. Tandis que Verres tente, en achetant les électeurs, de faire échouer la candidature de Cicéron à l'édilité, ce dernier recueille de nombreuses preuves en Sicile tout en se faisant élire édile. En août 70, l’accusation portée par Cicéron est si vigoureuse et si bien soutenue par un imposant défilé de témoins à charge que Verrès, qui va pourtant être défendu par le plus grand orateur de l’époque, le célèbre Hortensius, s’exile à Marseille immédiatement après le premier discours l'actio prima. Cicéron fait malgré tout publier l’ensemble des discours qu’il a prévus les Verrines, afin d’établir sa réputation d’avocat engagé contre la corruption. Après cet événement qui marque véritablement son entrée dans la vie judiciaire et politique, Cicéron suit les étapes du cursus honorum comme édile en 69 av.J.-C. Les Siciliens le remercient par des dons en nature, qu'il emploie au ravitaillement de Rome, faisant ainsi baisser le prix du blé, et augmentant sa popularité. Il devient préteur en 66 av.J.-C. : il défend cette année-là le projet de loi du tribun de la plèbe Manilius, qui propose de nommer Pompée commandant en chef des opérations d’Orient, contre Mithridate VI ; son discours De lege Manilia marque ainsi une prise de distance par rapport au parti conservateur des optimates, qui sont opposés à ce projet. À cette époque, il suit les cours de Gnipho ; dès cette époque, il songe à incarner une troisième voie en politique, celle des viri boni hommes de bien, entre le conservatisme des optimates et le réformisme de plus en plus radical des populares ; pourtant, de 66 av.J.-C. à 63 av.J.-C., l’émergence de personnalités comme César ou Catilina dans le camp des populares, qui prônent des réformes radicales, conduit Cicéron à se rapprocher des optimates. La glorieuse année 63 av. J.-C. Désormais proche du parti conservateur, Cicéron est élu pour l'année 63 av. J.-C. consul contre le démagogue Catilina, grâce aux conseils de son frère Quintus Tullius Cicero. Il est le premier consul homo novus, élu n’ayant pas de magistrats curules parmi ses ancêtres depuis plus de trente ans, ce qui déplaît à certains : Les nobles … estimaient que le consulat serait souillé si un homme nouveau, quelque illustre qu’il fût, réussissait à l’obtenir. Durant son consulat, il s'oppose au projet révolutionnaire du tribun Rullus pour la constitution d'une commission de dix membres aux pouvoirs étendus, et le lotissement massif de l'ager publicus. Cicéron gagne la neutralité de son collègue le consul Antonius Hybrida, ami de Catilina et favorable au projet, en lui cédant la charge de proconsul de Macédoine qu'il doit occuper l'année suivanteA 8. Son discours De lege agraria contra Rullum obtient le rejet de cette proposition. Pour protéger l'approvisionnement de Rome et sécuriser son port Ostie des menaces des pirates, Cicéron lance les travaux de réfection des murailles et des portes d'Ostie, qui seront achevés par Clodius Pulcher en 58 av.J.-C.. Catilina, ayant de nouveau échoué aux élections consulaires en octobre 63 av. J.-C., prépare un coup d'État, dont Cicéron est informé par des fuites. Le 8 novembre, il apostrophe violemment Catilina en pleine session du Sénat : on cite souvent la première phrase de l’exorde de la première Catilinaire : Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra ? Jusqu'à quand, Catilina, abuseras-tu de notre patience ?, et c’est dans ce même passage - même si ce n’est pas le seul endroit dans l'œuvre de Cicéron - que l’on trouve l’expression proverbiale O tempora ! O mores ! Quelle époque ! Quelles mœurs !. Découvert, Catilina quitte Rome pour fomenter une insurrection en Étrurie, confiant à ses complices l'exécution du coup d'État à Rome. Le lendemain, Cicéron informe et rassure la foule romaine en prononçant son deuxième Catilinaire, et promet l’amnistie aux factieux qui abandonneront leurs projets criminels. Puis il parvient à faire voter par le Sénat romain un senatus consultum ultimum procédure exceptionnelle votée lors de crises graves, et qui donne notamment à son, ses bénéficiaires le droit de lever une armée, de faire la guerre, de contenir par tous les moyens alliés et concitoyens, d'avoir au-dedans et au-dehors l'autorité suprême, militaire et civile. Mais un scandale politique vient soudain compliquer la crise : le consul désigné pour 62 av. J.-C., Lucius Licinius Murena, est accusé par son concurrent malheureux Servius Sulpicius Rufus d’avoir acheté les électeurs, accusation soutenue par Caton d'Utique. Pour Cicéron, il est hors de question dans un tel contexte d’annuler l’élection et d’en organiser de nouvelles. Il assure donc la défense de Murena pro Murena et le fait relaxer, malgré une probable culpabilité, en ironisant sur la rigueur stoïcienne qui mène Caton sur des positions disproportionnées et malvenues : si toutes les fautes sont égales, tout délit est un crime ; étrangler son père n'est pas se rendre plus coupable que tuer un poulet sans nécessité. Dans l’intervalle, les conjurés restés à Rome s’organisent et recrutent des complices. Par hasard, ils contactent des délégués allobroges, promettant de faire droit à leurs plaintes fiscales s’ils suscitent une révolte en Gaule narbonnaise. Les délégués, méfiants, avertissent les sénateurs. Cicéron leur suggère d’exiger des conjurés des engagements écrits, qu’ils obtiennent. Ayant récupéré ces preuves matérielles indiscutables, Cicéron confond publiquement cinq conjurés, troisième Catilinaire, du 3 décembre, dont l’ancien consul et préteur Publius Cornelius Lentulus Sura. Après débat au Sénat, quatrième Catilinaire, il les fait exécuter sans jugement public, approuvé par Caton mais contre l’avis de Jules César, qui a proposé la prison à vie. Catilina est tué peu après avec ses partisans dans une vaine bataille à Pistoia. Dès lors, Cicéron s’efforce de se présenter comme le sauveur de la patrie il fut d’ailleurs qualifié de Pater patriae, Père de la patrie, par Caton d'Utique et, non sans vanité, fait en sorte que personne n’oublie cette glorieuse année -63. Pierre Grimal estime toutefois que ce trait d'orgueil est dû à un manque de confiance en soi et tient plus de l'inquiétude que de l'arrogance. Conjuration de Catilina.Sa fortune Cicéron est devenu membre du Sénat romain, sommet de la hiérarchie sociale, milieu aristocratique et fortuné. Sa richesse est essentiellement basée sur un patrimoine foncier, estimé à 13 millions de sesterces. C’est une fortune à peine supérieure à celle de la masse des sénateurs et des chevaliers, ordre dont est issu Cicéron, et qui est généralement de quelques millions de sesterces, mais moindre que celle de son ami Atticus, située entre 15 et 20 millions de sesterces, et très en deçà de la richesse des Crassus, Lucullus ou Pompée, qui égalent ou dépassent les cent millions de sesterces. Cicéron possède à Rome même quatre immeubles, et une somptueuse domus sur le Palatin, vieux quartier patricien, qu’il a achetée en 62 av. J.-C. à Crassus pour 3,5 millions de sesterces. S’y ajoutent dans la campagne italienne dix exploitations agricoles villae rusticae, sources de revenus, plus six deversoria, petits pied-à-terre. Après son achat de -62, il plaisante avec son ami Sestius sur sa situation financière : Apprenez que je suis maintenant si chargé de dettes que j’aurais envie d’entrer dans une conjuration, si l’on consentait à m’y recevoir. Quoique sa fortune soit très loin de celle des richissimes Lucullus ou Crassus, Cicéron peut et veut vivre luxueusement. Dans sa villa de Tusculum, il fait aménager un gymnase et d'agréables promenades sur deux terrasses, lieux de détente et de discussion qu’il nomme Académieet Lycée, évocations de l'école de Platon et de celle d’Aristote. S'aidant des conseils d'Atticus, il décore sa villa d’Arpinum d'une grotte artificielle, son Amalthéum, évoquant Amalthée qui allaita Jupiter enfant. Son activité d’avocat pratiquée gratuitement est la seule activité honorable pour un sénateur, interdit de pratique commerciale ou financière. Cela ne l’empêche pas de fréquenter les milieux d’affaires, plaçant ses surplus de trésorerie ou empruntant chez son ami le banquier Titus Pomponius Atticus. Il investit parfois par l’intermédiaire de ses banquiers, plaçant par exemple 2,2 millions de sesterces dans une société de publicains. Parmi ces relations intéressées, Cicéron nous parle aussi de Vestorius spécialiste du prêt, qui n’a de culture qu’arithmétique, et dont la fréquentation pour cette raison ne lui est pas toujours agréable et de Cluvius, financier qui lui léguera en 45 av. J.-C. une partie de ses propriétés, dont des boutiques à Pompéi, en fort mauvais état ; mais Cicéron est un investisseur philosophe : … deux de mes boutiques sont tombées ; les autres menacent ruine, à tel point que non seulement les locataires ne veulent plus y demeurer, mais que les rats eux-mêmes les ont abandonnées. D’autres appelleraient cela un malheur, je ne le qualifie même pas de souci, ô Socrate et vous philosophes socratiques, je ne vous remercierai jamais assez !… En suivant l'idée que Vestorius m'a suggérée pour les rebâtir, je pourrai tirer par la suite de l'avantage de cette perte momentanée Cet enrichissement par des legs est une pratique courante à l'époque, et Cicéron admet lui-même fin 44 av. J.-C. avoir hérité de ses amis et parents pour plus de vingt millions de sesterces. Vicissitudes dans une République à la dérive Après le coup d’éclat de l’affaire Catilina, la carrière politique de Cicéron se poursuit en demi-teinte, en retrait d’une vie politique dominée par les ambitieux et les démagogues. Après la formation en 60 av. J.-C. d’une association secrète entre Pompée, César et Crassus le premier triumvirat, César, consul en 59 av. J;-C., propose d’associer Cicéron comme commissaire chargé de l'attribution aux vétérans de terres en Campanie, ce que ce dernier croit bon de refuser. En mars 58 av. J.-C., ses ennemis politiques, menés par le consul Gabinius et le tribun de la plèbe Clodius Pulcher qui lui voue une haine tenace depuis qu’il l’a confondu en 62 av. J.-C. dans l’affaire du culte de Bona Dea, le font exiler pour procédés illégaux contre les partisans de Catilina, exécutés sans procès règulier. Isolé, lâché par Pompée et l'autre consul Pison dont le fils a épousé sa fille Tullia, Cicéron quitte Rome le 11 mars, veille du vote de la loi qui condamne tout magistrat qui a fait exécuter un citoyen sans jugement. Désigné liquidateur de ses biens, Clodius fait détruire sa maison sur le Palatin, et consacrer à la place un portique à la Liberté. Dans le même temps, Gabinius pille la villa de Cicéron à Tusculum. Quant à Cicéron, il déprime dans cette retraite forcée à Dyrrachium, puis à Thessalonique. Pompée, protecteur de Cicéron. À Rome, ses amis tentent d'organiser un vote annulant la loi de Clodius. Son frère sollicite Pompée, qui s'est brouillé avec Clodius, tandis que Publius Sestius obtient la neutralité de César. Mais Clodius s'oppose à toutes les tentatives légales grâce aux vetos des tribuns, puis avec ses bandes armées. Le nouveau tribun de la plèbe Titus Annius Milon, partisan de Cicéron, forme à son tour des bandes ; les affrontements se multiplient. Pour avoir l'avantage du nombre, Pompée fait venir en masse à Rome des citoyens de villes italiennes, et obtient le 4 août 57 av. J.-C. un vote annulant l'exil de Cicéron. Cicéron peut revenir triomphalement à Rome début septembre 57 av. J.-C. Il reprend aussitôt l’activité judiciaire et défend avec succès Publius Sestius Pro Sestio, puis Caelius pro Caelio, impliqués dans les émeutes qui opposent désormais les bandes armées de Milon à celles de Clodius. Par son discours de retour au Sénat Post Reditum in Senatu, il obtient que l’État l’indemnise de 2 millions de sesterces pour la destruction de sa maison du Palatin, de 500 000 pour sa villa de Tusculum, de 250 000 pour celle de Formies, ce qu'il trouve trop peu d'ailleurs, écrit-il à Atticus en reprochant leur jalousie aux sénateurs. Obstiné, Cicéron veut reconstruire sa maison, mais récupérer son terrain est problématique puisqu'il lui faudra détruire un espace consacré. Cicéron parvient à faire casser la consécration par les pontifes pour vice de forme discours Pro domo sua, mais Clodius, élu édile, l’accuse de sacrilège devant l'assemblée des comices ; ses bandes harcèlent les ouvriers qui ont commencé les travaux, incendient la maison du frère de Cicéron, attaquent celle de Milon. Pompée doit intervenir pour ramener l’ordre et permettre la reconstruction de la maison de Cicéron. En 56 av. J.-C., enhardi par ses succès oratoires, Cicéron tente de revenir en politique : après s'être abstenu d'assister à la réunion des triumvirs à Lucques à l'inverse de nombreux sénateurs, il attaque publiquement Publius Vatinius, un des appuis de César, puis s'oppose à la loi agraire qu'avait promulgué ce dernier. Les triumvirs le remettent à l'ordre, Pompée lui fait rappeler la protection qu'il lui doit. Cicéron doit prononcer au Sénat le de Provinciis Consularibus et obtenir la prolongation du pouvoir proconsulaire de César sur la Gaule, ce qui permet à ce dernier de poursuivre la Guerre des Gaules. Cette palinodie embarrassante, selon les termes de Cicéron est suivie d'une autre lorsqu'il doit plaider pour la défense de Vatinius. Les luttes politiques dégénèrent en affrontements violents entre groupes partisans des populares et des optimates, empêchant la tenue normale des élections. Clodius est tué début 52 av. J.-C. dans l'une de ces rencontres ; Cicéron prend naturellement la défense de son meurtrier, Milon. Mais la tension est telle lors du procès que Cicéron, apeuré, ne peut plaider efficacement et perd la cause. Milon anticipe une probable condamnation en s'exilant à Marseille. Cicéron publiera néanmoins la défense prévue dans son fameux Pro Milone. Proconsulat en Cilicie 51-50 La Cilicie et les régions voisines En 53 av. J.-C., le Sénat impose un intervalle de cinq ans entre l'exercice d'une magistrature et celui de la promagistrature correspondante en province, afin de mettre un frein aux endettements contractés lors des campagnes électorales qui sont ensuite remboursés par le pillage des provinces. La mesure contraint en 51 av. J.-C. à trouver des remplaçants pour les consuls sortants, qui doivent attendre pour rejoindre leur province. Le Sénat pallie ce problème en attribuant ces provinces aux anciens magistrats qui n'ont pu exercer leur promagistrature. Cicéron qui avait renoncé à la Macédoine lors de son consulat obtient donc un mandat de proconsul en Cilicie, petite province romaine d’Asie mineure, charge qu'il prend sans enthousiasme. À l'époque, cette province couvre un territoire plus large que celui qu'elle aura sous l'empire, et comprend aussi la Lycie, la Pamphylie, la Pisidie, la Lycaonie et aussi Chypre que Rome vient d'annexer. Selon Plutarque, Cicéron gouverne avec intégrité. Pour Levert, c'est l'occasion pour Cicéron de mettre en pratique sa philosophie de gouvernement des provinces, basée sur la paix et la justice, essentiellement fiscale : il rencontre les élites locales des villes qu'il traverse, supprime les charges fiscales injustifiées, modère les taux d'intérêt usuraires, noue alliance avec Dejotarus, roi de Galatie et Ariobarzane de Cappadoce. Au début de son mandat, Cicéron doit mater une révolte dans les Monts Amanus proches de la Syrie, où Antioche est sous la menace des raids parthes. Il lève des troupes et nomme légat son frère, qui a acquis l'expérience de l'action militaire lors de la guerre des Gaules. Après deux mois de siège de la cité de Pindenissus, foyer de l'insurrection, les insurgés capitulent. Pour ce fait d'armes somme toute modeste, Cicéron est salué imperator par ses soldats, et songe à demander à son retour la célébration du triomphe, par vanité ou pour se hisser au niveau d'importance des Pompée et César. Cicéron quitte sa province fin juillet -50, et revient en Italie en plusieurs mois. Le solde des comptes de sa gestion lui laissent un reliquat personnel et légal de 2,2 millions de sesterces. La tourmente de la guerre civile À son retour en Italie fin 50 av. J.-C., une crise politique aiguë oppose César à Pompée et aux conservateurs du Sénat. Cicéron rencontre Pompée le 25 décembre, mais stationne hors de Rome, attendant selon l'usage que le Sénat l'autorise à y pénétrer en triomphateur. Il n'assiste donc pas aux séances du Sénat qui déclenchent le conflit avec César. Lorsque ce dernier envahit l’Italie en janvier 49 av. J.-C., Cicéron fuit Rome comme la plupart des sénateurs, et se réfugie dans une de ses maisons de campagne. Sa correspondance avec Atticus exprime son désarroi et ses hésitations sur la conduite à tenir. Il considère la guerre civile qui commence comme une calamité, quel qu’en soit le vainqueur. César, qui souhaite regrouper les neutres et les modérés, lui écrit puis lui rend visite en mars, et lui propose de regagner Rome comme médiateur. Cicéron refuse et se déclare du parti de Pompée. César le laisse réfléchir, mais Cicéron finit par rejoindre Pompée en Épire en mai 49 av. J.-C.. Selon Plutarque, Cicéron, mal accueilli par Caton qui lui dit qu’il aurait été plus utile pour la République qu'il soit resté en Italie, se comporta en poids mort et ne prit part à aucune action militaire menée par les pompéiens. Après la victoire de César à Pharsale en 48 av. J.-C., il abandonne le parti pompéien et regagne l'Italie, où il est bien accueilli par César, qui se montre modéré et n'exerce pas de représailles contre ses opposants. Sur l'instance d'un groupe de sénateurs, il gracie même l'exilé Marcellus. Cicéron fait un éloge enthousiaste de cette clémence et exhorte César à réformer la République en prononçant le discours Pro Marcello, puis en profite pour obtenir la grâce de plusieurs de ses amis avec le Pro Q. Ligario et le Pro rege Deiotaro. Mais il déchante bientôt quand il ne constate aucun retour du pouvoir sénatorial. Dans une lettre à Varron du 20 avril 46 av. J.-C., il donne ainsi sa vision de son rôle sous la dictature de César : Je vous conseille de faire ce que je me propose de faire moi-même - éviter d’être vu, même si nous ne pouvons éviter que l’on en parle… Si nos voix ne sont plus entendues au Sénat et dans le Forum, que nous suivions l’exemple des sages anciens et servions notre pays au travers de nos écrits, en se concentrant sur les questions d’éthique et de loi constitutionnelle Retraite politique et travaux philosophiques Cicéron met ce conseil en pratique durant la période 46/44 av. J.-C. Il réside le plus souvent dans sa résidence de Tusculum et se consacre à ses écrits, à la traduction des philosophes grecs, voire à la rédaction de poésies. Il anime un cercle de jeunes aristocrates désireux d'apprendre la rhétorique à son contact et d'admirateurs comme Hirtius, Pansa et son gendre Dolabella, menant des exercices oratoires sur des thèmes d'actualité comme les moyens de ramener la paix et la concorde entre les citoyens. Il déploie une intense activité rédactionnelle et publie en quelques mois ses ouvrages philosophiques majeurs, une façon selon lui de travailler au bien public en ouvrant au plus grand nombre l'accès à la philosophie : ainsi se succèdent l’Hortensius, la Consolation, les Académiques, les Tusculanes, le De finibus, De la nature des Dieux, De la divination, De la vieillesse. Sa vie privée est néanmoins perturbée : il divorce de Terentia en 46 av. J.-C., et épouse peu après la jeune Publilia, sa pupille. Selon le témoignage de Tiron après la mort de Cicéron, celui-ci, gestionnaire en fideicommis des biens de Publilia, l'aurait épousée pour éviter de lui restituer ces biens si elle convolait avec un tiers. En février 45 av. J.-C., sa fille Tullia meurt, lui causant une peine profonde. Il divorce alors de Publilia qui s'était réjouie du décès de Tullia. Ses relations avec César sont devenues assez distantes. Si César n’est pas le modèle de dirigeant éclairé que Cicéron théorisait dans son De Republica, il n’est pas non plus le tyran sanguinaire qu’on avait craint ; de toute façon, il est désormais maître absolu de Rome. Cicéron s’en accommode donc. Il rédige un panégyrique de Caton, qu’il qualifie de dernier républicain, petite manifestation d’indépendance d’esprit à laquelle César répond en publiant un Anticaton, recueil de ce que l’on peut reprocher à Caton. Cicéron conclut ce duel rédactionnel en complimentant d’égal à égal César pour la qualité littéraire de son écrit. En décembre 45 av. J.-C.39, César et sa suite s’invitent à dîner dans la villa de Cicéron à Pouzzoles. Au grand soulagement de Cicéron, César ne recherchait qu'une soirée de détente ; la conversation est agréable et cultivée, n’abordant que des sujets littéraires : Services magnifiques et somptueux. Propos de bon goût et d’un sel exquis. Enfin, si vous voulez tout savoir, la plus aimable humeur du monde. L’hôte que je recevais n’est pourtant pas de ces gens à qui l’on dit : au revoir cher ami, et ne m’oubliez pas à votre retour. C’est assez d’une fois. Pas un mot d’affaires sérieuses. Conversation toute littéraire. Telle a été cette journée d’hospitalité ou d’auberge si vous l’aimez mieux, cette journée qui m’effrayait tant, vous le savez, et qui n’a rien eu de fâcheux Dernier engagement politique Trois mois plus tard, Cicéron est surpris par l’assassinat de César, aux Ides de Mars, le 15 mars 44 av. J.-C., car les conjurés l'avaient laissé hors de la confidence en raison de son anxiété excessive. Dans le flottement politique qui suit, Cicéron tente de se rallier le Sénat romain, et fait approuver une amnistie générale qui désarme les tensions tandis que Marc Antoine, consul et exécuteur testamentaire de César, reprend le pouvoir un instant vacillant. Il fait confirmer toutes les décisions prises par César et organise ses funérailles publiques, qui tournent à l'émeute contre ses meurtriers. Comme d'autres sénateurs, Cicéron se replie dans ses villae de Campanie, où il continue sa production littéraire tout en se tenant au courant de l'évolution politique. Cicéron reprend espoir lorsque son gendre Dolabella qui exerce le consulat en alternance avec Antoine interdit les manifestations populaires à l'emplacement où César a été incinéré. De plus, Dolabella lui accorde le titre de légat, ce qui l'autorise à quitter l'Italie s'il le désire. Octave jeune, que Cicéron, son aîné de plus de quarante ans, ne put influencer. Le jeune Octave, héritier de César, arrive en Italie en avril. Par ses distributions d'argent, il développe son influence auprès des vétérans de César démobilisés. Cicéron se montre hésitant. Il songe à rejoindre son fils à Athènes, mais renonce en cours de route et revient à Rome fin août. Début septembre 44 av. J.-C., il commence à attaquer Marc-Antoine dans une série de discours de plus en plus violents, les Philippiques. En novembre -44, Octave écrit plusieurs fois à Cicéron, qu'il finit par convaincre de son adhésion à la cause républicaine contre Antoine. Fin décembre -44, Cicéron prononce devant le Sénat la troisième Phlippique, puis la quatrième devant le peuple, tandis qu'il encourage les gouverneurs des Gaules Plancus et Decimus Brutus à résister à la mainmise d'Antoine sur leurs provinces. En janvier -43, Antoine et Dolabella sont remplacés au consulat par Hirtius et Pansa, que César avait nommés d'avance et qui sont d'anciens élèves de rhétorique de Cicéron. Cicéron continue ses Philippiques, mais ne parvient pas à faire proclamer Antoine ennemi public par les sénateurs. Au contraire, il doit accepter qu'on lui envoie des négociateurs. En mars, accompagnés d'Octave, Hirtius et Pansa attaquent Antoine qui assiège Decimus Brutus dans Modène. Antoine est repoussé, mais Hirtius et Pansa sur qui Cicéron comptait sont morts dans les combats. Lorsque la nouvelle parvient à Rome en avril, Cicéron dans sa dernière Philippique couvre d'honneurs Octave et obtient enfin qu'Antoine soit déclaré ennemi du peuple romain. Pour remplacer les consuls décédés, selon l'historien Appien, Octave propose que Cicéron et lui se portent candidats. Octave n'a ni l'âge ni le parcours politique pour être légalement consul, les sénateurs refusent donc, mais commettent la maladresse de repousser les élections à l'année suivante, laissant la République sans dirigeant. Autre motif de préoccupation pour Cicéron, une lettre de Decimus Brutus lui révèle qu’un proche d’Octave l’incite à se méfier de lui. Fin juillet, une délégation de soldats force le Sénat à accorder le consulat à Octave, ce qu'un vote populaire ratifie le 19 août. Octave s’entend alors avec Marc-Antoine et Lépide, et constitue le Second triumvirat, qui reçoit fin octobre -43 les pleins pouvoirs avec comme programme Venger César de ses meurtriers. Les trois hommes s’accordent pour éliminer leurs ennemis personnels. Malgré l’attachement d’Octave pour son ancien allié, il laisse Marc-Antoine proscrire Cicéron, après trois jours de négociations selon Plutarque. L'orateur est assassiné le 7 décembre 43 av. J.-C. au moment où il quitte sa villa de Gaète ; sa tête et ses mains sont exposées sur les Rostres, au forum, sur ordre de Marc-Antoine, ce qui choque fortement l'opinion romaine. Son frère Quintus et son neveu sont exécutés peu après dans leur ville natale d'Arpinum. Seul son fils qui est en Macédoine échappe à cette répression. La mort de Cicéron Le culte de la mort honorable et héroïque était très fort dans la Rome antique et tout homme savait qu'il serait aussi jugé sur son attitude, ses poses ou ses propos lors de ses derniers moments. En fonction de leurs intérêts politiques ou de leur admiration envers Cicéron, ses biographes ont parfois considéré sa mort comme exemple de lâcheté Cicéron a été assassiné alors qu'il était en fuite ou plus souvent, au contraire, comme un modèle d'héroïsme stoïque il tend son cou à son bourreau, qui ne peut supporter son regard. La version de l’évènement que donne Plutarque combine habilement ces deux visions : À ce moment, survinrent les meurtriers ; c'étaient le centurion Herennius et le tribun militaire Popilius que Cicéron avait autrefois défendu dans une accusation de parricide. … Le tribun, prenant quelques hommes avec lui, se précipita … Cicéron l'entendit arriver et ordonna à ses serviteurs de déposer là sa litière. Lui-même portant, d'un geste qui lui était familier, la main gauche à son menton, regarda fixement ses meurtriers. Il était couvert de poussière, avait les cheveux en désordre et le visage contracté par l'angoisse. … Il tendit le cou à l'assassin hors de la litière. Suivant l'ordre d'Antoine, on lui coupa la tête et les mains, ces mains avec lesquelles il avait écrit les Philippiques. Cette tête et ces mains coupées furent exposées à la tribune des Rostres, exhibition macabre que Marius puis Sylla avaient auparavant ordonnée après l'exécution de leur opposants. Œuvres de Cicéron. Cicéron est considéré comme le plus grand auteur latin classique, tant par son style que par la hauteur morale de ses vues. La partie de son œuvre qui nous est parvenue est par son volume une des plus importantes de la littérature latine : discours juridiques et politiques, traités de rhétorique, traités philosophiques, correspondance. Malgré le biais qu’impose le point de vue de l’auteur, elle représente une contribution prépondérante pour la connaissance de l’histoire de la dernière période de la République romaine. Les textes qui nous sont parvenus sont des versions révisées et parfois réécrites par Cicéron, avec l'aide de son esclave et sténographe Tiron, tandis qu'Atticus se chargea de les faire copier et mettre en vente50. Cicéron affranchit Tiron en 53 av. J.-C., et Tiron devenu Marcus Tullius Tiro resta son collaborateur. Après la mort de Cicéron, il édita sa correspondance et de nombreux discours, éditions dignes de confiance si l'on en croit Aulu-Gelle, qui les lut deux siècles plus tard. Les ouvrages de rhétorique Cedant arma togae. Cicéron n'avait pas d'autres moyens d'action et d'influence que son éloquence. C'est en ce sens qu'on peut assimiler à un traité politique ses trois livres de dialogues à la manière d'Aristote, De oratore 55 ; il avait déjà écrit, vers 88, deux livres De inuentione, dont il devait plus tard condamner la forme scolaire. À partir de 46, profitant des loisirs forcés offerts par la révolution césarienne, Cicéron écrit un Brutus, histoire de l'éloquence à Rome, un Orator qui reprend le De oratore en un livre, en insistant particulièrement sur les problèmes esthétiques. Il va rédiger des ouvrages plus courts : les Partitiones oratoriae manuel d'une structure très originale, pour son fils, le De optimo genere oratorum, bref traité sur la primauté du style démosthénien et surtout les Topiques, où il étudie de façon approfondie et magistrale la dialectique de l'orateur. On doit mesurer toute l'audace et l'originalité qu'il y a pour un homme d'État important, un ancien consul, à publier ainsi des œuvres généralement réservées à des personnages de moindre rang, à des professeurs. Cicéron, homo nouus, reste proche des érudits de l'ordre équestre ; surtout, il pousse jusqu'à ses conséquences extrêmes sa conception de l'action : pour lui, action et culture sont inséparables. Haïssant toute violence, cherchant l'efficacité, il ne peut la trouver que dans la parole agissante, dans l'éloquence, mais encore dans une éloquence savante, et même philosophique. Car c'est ici qu'il faut insister surtout : la culture oratoire, telle que la conçoit Cicéron, dépasse l'éloquence même dans ce que celle-ci paraît avoir de complaisant. Puisque l'homme d'État est un éducateur, il doit lui-même recevoir une formation universelle : il faut d'abord forger tout l'homme pour obtenir un personnage politique. Ainsi naît la notion moderne d' humanisme : humanitas ne signifie plus seulement amour de l'humain, mais en même temps culture. Tel est le premier problème qui se pose : celui de la culture. Cicéron se trouve entre trois options : les professeurs d'éloquence de son temps essaient de ramener leur art à quelques recettes de routine ; Isocrate avait conçu ce que nous appelons la « culture générale », étendue, sélective cependant, ennemie des curiosités excessives et des spécialisations ; avant Isocrate, les sophistes avaient rêvé d'un savoir universel et approfondi, et certains philosophes, Aristote, le stoïcien Posidonius, avaient essayé plus ou moins de réaliser cet idéal. Cicéron rejette la première solution et balance entre les deux autres. Si la position d'Isocrate représente le moindre mal, celle des philosophes offre un idéal dont on peut se rapprocher, soit individuellement, soit en suivant l'évolution des cultures et des traditions. Cette attitude à la fois nuancée et exigeante est dictée à Cicéron par les penseurs de l' Académie, en particulier Charmadas, élève de Carnéade, dont l'influence lui a été transmise à la fois par ses maîtres romains, de grands orateurs sénatoriaux, Antoine et Crassus, qu'il fait parler dans le De oratore, et par son propre professeur de philosophie, Philon de Larissa, scholarque de la Nouvelle Académie, qui mêlait à son enseignement des cours de rhétorique, De oratore, III, 110. On comprend donc que la philosophie tienne une très grande place dans la rhétorique de Cicéron ; elle intervient pour lui fournir une technique : l'esthétique du De oratore, III, fortement influencée par Théophraste, cherche à combiner la grâce ou convenance, avec la beauté ; la psychologie d'inspiration platonicienne et stoïcienne tend à dominer les passions, sans rejeter pour autant la douleur si elle est sympathie, pitié, amour – amor, caritas, misericordia – ; la théorie de l'ironie est proche à la fois d'Aristote et de Platon ; enfin et surtout, une réflexion de type aristotélicien s'établit sur les lieux communs, schémas généraux de toute argumentation dialectique, qui peuvent être appliqués, comme Aristote l'avait déjà montré dans ses Topiques, à tout type de question, juridique, politique, philosophique. À cela se rattache une théorie originale des thèses, ou questions générales Cicéron montre que toute question particulière, ou hypothèse, peut et doit être ramenée à une question générale. Cet effort pour nourrir la rhétorique de philosophie permet à Cicéron de fournir une réponse originale à une question célèbre depuis Platon : la rhétorique, chère aux sophistes, n'est-elle pas une anti-philosophie ? La grande digression philosophique du De oratore, III, 54 et suiv., qui apporte la solution, propose un classement des doctrines qui s'inspire manifestement de Philon de Larissa. Cicéron, Lucullus, 116 et suiv.. Or ce philosophe, d'une part, était un platonicien et, par son maître Carnéade, il avait pu connaître la valeur de certaines doctrines péripatéticiennes ; mais, comme Carnéade, il était avant tout un ami de la Nouvelle Académie qui, dans la tradition d'Arcésilas, empruntait aux sophistes comme Gorgias tout un art de douter. Ainsi s'esquisse dans l'éloquence, telle que Cicéron la conçoit, la réconciliation du doute sceptique et de l'idéalisme platonicien, de l'action stoïcienne et de la contemplation péripatéticienne, de Platon, d'Isocrate et de Gorgias. L'influence qu'un tel enseignement a pu exercer dans l'histoire de la pensée européenne est alors claire. Par la place qu'il donne à la philosophie, à l'histoire, au droit, il est à l'origine de notre conception des lettres. En empruntant à Aristote Rhétorique, III le souci d'unir étroitement forme et fond, Cicéron fournit à l'avance au classicisme quelques-unes de ses justifications essentielles. C'est en leur nom que, luttant contre les néo-atticistes, César par exemple, et sans se laisser entraîner comme parfois son rival Hortensius par la pompe asianiste, il défend dans l'Orator son droit à la grandeur d'expression, qui est nécessaire lorsqu'on traite un grand sujet, et alors seulement. Mais, revenons-y pour finir, il ne s'agit pas seulement des théories d'un doctrinaire. Il suffit de lire ici ce qui concerne l'action et la philosophie de Cicéron pour voir que son éloquence se confond avec sa vie, et même avec sa mort. Qu'on y songe : l'ami et l'inspirateur commun d'Antoine et de Crassus s'appelait Drusus ; il luttait en 91 pour éviter la guerre civile en Italie. C'est à cette date que Cicéron situe le De oratore. Drusus, puis Antoine, ont été assassinés. Quant à Cicéron... Telles sont les victoires de l'éloquence. Dans la mort, la toge ne cède point aux armes. Et l'humanisme demeure. Le théoricien politique Dans l'histoire de la pensée européenne, l'œuvre de Cicéron revêt une importance considérable dans la mesure où il fut le premier homme d'État à tenter de concilier les exigences de la pratique politique et les résultats de la spéculation philosophique. Sans doute les Grecs, et surtout Platon et Aristote, avaient-ils déjà fondé à proprement parler la philosophie politique. Mais le premier le faisait en métaphysicien et en moraliste, sans véritable responsabilité d'homme d'État ; et le second, en savant, cherchant à cataloguer les diverses formes de Constitutions et à en faire l'histoire. Cicéron, au contraire, dans ses principales œuvres de philosophie politique, le De oratore, le De re publica, le De legibus, le De officiis, ne perd jamais de vue ni son expérience concrète d'homme d'État, ni son dessein d'appliquer au cas particulier de Rome, maîtresse du monde il est vrai, les principes qu'il déduit de sa philosophie. Lorsqu'il écrit ces œuvres, la crise de la Constitution romaine est évidente : chacun s'interroge sur le meilleur régime à établir, sur les devoirs que créent aux citoyens les révolutions et les guerres civiles. Ce serait une erreur de croire que Cicéron, dans une période de sa vie où l'action lui était pratiquement interdite, où le pouvoir lui avait échappé, ait improvisé, à partir d'une lecture éclectique des Grecs, des œuvres théoriques qui ne seraient en somme que des palliatifs. Dès sa jeunesse, à la différence de la plupart de ses contemporains, il avait considéré la philosophie comme une vocation exigeante et essentielle ; mais il avait refusé les échappatoires qu'offraient alors les doctrines stoïcienne ou épicurienne, qui permettaient à certains, dont son ami intime Atticus, de refuser l'engagement dans la vie politique ; il avait toujours, au contraire, essayé de soutenir l'une par l'autre ces activités à ses yeux complémentaires. Il n'est pas difficile, en effet, de retrouver dans des textes politiques très antérieurs aux grands traités, dans des discours comme le De lege agraria 63, le Pro Murena 63, ou le Pro Sestio 56, qui sont des œuvres de circonstance mais aussi des sortes de manifestes, ou dans sa fameuse Lettre à Quintus en 61 sur les devoirs d'un proconsul, quelques-uns des thèmes qu'il développera et justifiera philosophiquement plus tard. Mais on peut sans doute découvrir aussi, dans l'exposition de ces thèmes, un enrichissement permanent, un passage du simple programme à la théorie, une élévation vers une sorte de mysticisme religieux qui nous fait insensiblement passer du domaine de la politique contingente à celui des vérités éternelles. Autour de la formule de la concordia ordinum, Cicéron élabore, vers 63, un programme de réformes politiques qui se situe au niveau de la simple pratique : aménager la Constitution syllanienne centrée autour du Sénat, en ouvrant largement celui-ci à la noblesse municipale italienne des hommes nouveaux ; régler une fois pour toutes la vieille rivalité entre les chevaliers et les sénateurs en reconnaissant définitivement aux chevaliers leurs privilèges financiers et judiciaires, mais en les associant plus étroitement aux décisions de l'Assemblée ; éviter l'intervention du pouvoir militaire dans la politique intérieure. Au cours des années 58-56, l'échec de cette politique, l'expérience amère de l'exil lui font souhaiter, sous le nom de consensus universorum, le rassemblement de tous ceux qui, quelle que soit leur origine sociale et c'était très neuf, s'accordaient sur certains principes modérés ; quant aux hommes politiques, ils ne devaient désirer qu'une chose : le repos otium, c'est-à-dire l'absence de guerre et de luttes inexpiables, le refus du pouvoir excessif, dans le respect des droits de tous dignitas. Le De re publica, écrit au moment où apparaissent les prodromes de la guerre civile, où l'on redoute la dictature de Pompée et les armées de César, prend les choses de plus loin. Ce dialogue sur la meilleure Constitution et sur le meilleur homme d'État se présente fictivement comme un retour aux spéculations des grands ancêtres de la génération de Scipion Émilien, dont le prestige, la culture, la sagesse auraient pu sauver Rome en 129, juste avant la poussée révolutionnaire du second des Gracques. C'est une méditation en six livres sur les origines des sociétés humaines, les lois du développement des cités, les rapports entre le droit et la raison, la nature et la loi. L'histoire y apparaît comme l'accomplissement du dessein de la divinité, qui est souverainement bon et dont Rome est l'achèvement. Cicéron croit, comme Polybe dont il s'inspire, que Rome doit ses succès à ses mérites, en particulier au fait qu'elle présente le meilleur modèle possible de Constitution, la « Constitution mixte », qui offre à la fois des traits monarchiques, aristocratiques et démocratiques. Encore faut-il que cet équilibre ne soit pas celui de la terreur réciproque et que tous les éléments de la cité collaborent harmonieusement ; c'est pour cela qu'il faut susciter un petit nombre d'hommes d'élite, les princes, dont la vertu et l'autorité, fondées sur l'éducation romaine et la sagesse grecque, sauront intervenir en cas de crise. Ce n'est donc pas, comme on l'a dit, un plaidoyer pour la monarchie, ni même l'appel à un principat qui aurait pu être celui de Pompée : c'est bien plutôt le rêve d'une république où des hommes comme Cicéron et Pompée sauraient collaborer. Le texte s'achève, à la manière platonicienne, sur un mythe, le Songe de Scipion, qui montre comment l'action politique et le dévouement à la patrie sont, pour l'homme d'élite, le seul gage d'immortalité. Ce texte très riche, dont on n'a retrouvé les fragments qu'en 1818, est, à plus d'un titre, une troublante anticipation de certains aspects de l'Empire : Auguste pourtant en interdira jalousement la lecture. Écrit en même temps, et faisant peut-être partie du même plan initial, le De legibus, qui ne fut publié que beaucoup plus tard, est une réflexion sur la philosophie du droit religieux et du droit civil dont la partie la plus intéressante est sans doute un véritable projet de Constitution présenté par Cicéron qui se met en scène lui-même. Il ne touche pas aux principes de la Constitution traditionnelle, mais propose un certain nombre d'innovations remarquables, précisant la hiérarchie des magistratures, réduisant les pouvoirs des tribuns, moralisant l'emploi du scrutin secret et surtout conférant au Sénat un véritable pouvoir législatif. Certaines de ces innovations sont d'inspiration grecque. L'État que rêvait Cicéron n'était pas une monarchie, c'était une république, aristocratique sans doute, mais ouverte aux talents, libérale, fondée sur le respect du droit, de la raison et de la justice, que gouverneraient des philosophes éloquents. L'œuvre philosophique L'œuvre philosophique de Cicéron a exercé dans l'histoire de la pensée occidentale une influence très profonde – et l'influence, précisément, qu'il avait souhaitée. Il est apparu non pas comme un créateur mais comme un médiateur, un honnête homme qui, parmi les doctrines existantes, cherchait à définir non pas les plus commodes, mais les plus fécondes pour un humanisme exigeant. Il a fallu les confusions saugrenues de quelques modernes pour voir en lui un simple copiste, on prétend qu'il ne comprend pas ses modèles, mais c'est en général qu'on ne le comprend pas lui-même ou pour lui demander des innovations, des créations qui n'entraient point dans son propos. L'itinéraire de l'homme d'action Ce fut une conception exigeante de l'action et notamment de l'éloquence qui le conduisit à la philosophie. Cela prit d'abord la forme de la réflexion politique. On peut affirmer que, lorsqu'il achève le De legibus, Cicéron a déjà tout dit. Mais ce n'était encore que le temps de la demi-retraite. La victoire de César rend impossible toute action : elle détermine surtout une crise de conscience, une remise en question générale de toutes les valeurs, un retour au fondamental. La mort de Tullia, sa fille très aimée, en 45, achève d'obliger l'orateur à s'attacher désespérément à la sagesse : il ne veut plus retomber dans les désarrois du temps de l'exil. Vraiment, il est philosophe à son corps défendant. De là le double mouvement d'une œuvre qui, d'une part, répond à tout instant aux exigences de l'action, du présent, de l'événement et, d'autre part, précisément puisqu'elle veut obéir aux exigences de la sagesse, suit l'ordre de la raison. D'abord, Cicéron écrit trois ouvrages qui, de manières diverses, remettent en question sa culture et la philosophie même. Dans l'Hortensius, l'un des grands textes de l'Antiquité, malheureusement perdu à l'exception de quelques fragments, il écrit une exhortation préalable à la philosophie, un « protreptique », qui le conduit à placer au second rang la culture oratoire, représentée précisément par Hortensius. Dans les Paradoxa stoicorum, il justifie, au-delà des stoïciens, ce que peut avoir d'apparemment scandaleux pour le sens commun la vie philosophique telle que Socrate l'avait conçue. Les Académiques ont été rédigés en deux fois : il ne nous reste que I, 2 appelé aussi Lucullus et II, 1. Cicéron, à propos de l'Académie, y traite le problème du vrai. Ensuite viennent les applications. Les cinq livres De finibus bonorum et malorum posent, en discutant les thèses des principales écoles, le problème du souverain bien. Les cinq livres des Tusculanes, conversations où Cicéron intervient lui-même, situées dans sa villa de Tusculum, présentent une théorie des passions et du bonheur. Il s'agit en somme dans ces deux ouvrages d'une morale théorique. Puis Cicéron aborde les problèmes religieux : trois livres De natura deorum, deux livres De diuinatione, un livre De fato. On remarque bien que ces questions, qui certes touchent à la métaphysique, sont aussi celles qui intéressent directement un augure romain. Le souci de la morale pratique va s'affirmer dans les dernières œuvres : De senectute, dominé par le personnage de Caton l'Ancien ; De amicitia où Lélius, ami de Scipion Émilien, est protagoniste ; enfin trois livres De officiis, sur les devoirs, où Cicéron, dans le temps où il commence sa dernière lutte contre Marc Antoine, adresse des préceptes à son fils. En même temps, l'œuvre de rhétorique n'a pas été interrompue, et les Philippiques commencent ; ainsi s'accomplit totalement cette union de l'action et de la méditation dont Cicéron avait toujours rêvé. Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=7399#forumpost7399
#4150
Cicéron 2
Loriane
Posté le : 06/12/2014 17:10
La recherche du fondamental
L'œuvre philosophique de Cicéron, toute tournée qu'elle soit vers des applications pratiques, échappe au pragmatisme par sa recherche initiale du fondamental. À cet égard, les problèmes qui se posent sont exposés dans les Académiques : Cicéron doit choisir entre les deux principaux maîtres qu'il a connus dans sa jeunesse, Antiochus d'Ascalon et Philon de Larissa. Les modernes ont eu peine à discerner les enseignements de ces deux scholarques rivaux de la Nouvelle Académie : il suffit pourtant de se référer au Lucullus en particulier et suiv.. D'une part, Antiochus s'était séparé de Philon sur les points suivants : à la différence de la Nouvelle Académie, il croyait, suivant en cela les stoïciens, qu'il existait un critère de certitude sans lequel toute connaissance serait impossible ; d'autre part, avec les péripatéticiens, il attribuait, dans sa conception du bonheur, une certaine place aux biens du corps et aux biens extérieurs. Les biens de l'âme suffisaient d'après lui à procurer la uita beata, mais non la uita beatissima, pour laquelle les autres biens étaient nécessaires aussi. Selon Antiochus, ces thèses avaient déjà été défendues par les premiers disciples de Platon, les maîtres de l'ancienne Académie, Speusippe, Xénocrate, Polémon, puis par les premiers péripatéticiens. Philon, restant fidèle à Carnéade, critiquait essentiellement la théorie du critère ; il affirmait, dans un esprit authentiquement platonicien sans doute, que nos connaissances sont seulement probables, que le vrai existe, que nous le percevons, mais seulement de manière inadéquate. Cela permettait sur tout problème, dans la tradition d'Arcésilas, une certaine suspension de jugement. Cependant Philon semble s'être inspiré du Gorgias pour rejeter la théorie de la uita beatissima et pour affirmer que le bonheur réside dans la seule vertu – affirmation seulement vraisemblable à ses yeux, notons-le bien. En somme la différence entre Antiochus et Philon résidait en ceci : le premier s'était à la fois rapproché des stoïciens, il était, disait-on, un vrai stoïcien et des péripatéticiens : il avait ainsi sacrifié le scepticisme académique et la rigueur morale du platonisme ; mais vainement, car les deux écoles dont il s'inspirait étaient en contradiction sur la morale. Cicéron préfère Philon qui, comme son maître Carnéade, utilise parfois l'enseignement des péripatéticiens, parle leur langage en rejetant par exemple la théorie stoïcienne des préférables, mais, pour la rigueur de la doctrine, s'en tient à Platon et Arcésilas : il y a une vérité, dans le monde des idées ; elle est perçue sans critère sous forme d'opinion et non de certitude ; la vertu suffit au bonheur. Une telle doctrine accorde le doute avec la recherche du vrai, l'esprit de tolérance, déjà visible dans un discours, le Pro Murena, et fondamental chez Cicéron avec le sens de l'absolu. Cela conduit à deux grandes applications. En matière de religion, Cicéron affiche par exemple dans le Songe de Scipion, ou encore dans une traduction du Timée de Platon, des croyances proches de celles de ce philosophe : il n'est pas nécessaire de faire intervenir Posidonius. Mais il souligne dans le De natura deorum qu'il n'y a aucune certitude sur l'existence réelle du divin. Cela ne l'empêche pas d'en concevoir la vraisemblance ou la probabilité, le Songe, après tout, n'est qu'un rêve. En revanche, cela lui permet de nier la divination et la croyance en un destin prévisible, puisqu'ici c'est de la connaissance de l'avenir, de l'adéquation des signes qui semblent l'annoncer qu'il s'agit. Du même coup, un certain nombre de superstitions, vivaces dans la vie quotidienne, s'effondrent et la religion peut subsister. Grand progrès pour la pensée. Une sagesse pratique En ce qui concerne la morale pratique, elle est dominée, dans le De officiis, par le conflit apparent entre l'honnête et l'utile. Cicéron déclare s'inspirer du philosophe stoïcien Panétius dans les deux premiers livres. Mais en fait, là et surtout dans le troisième livre, il se réfère directement au platonisme pour affirmer, comme les stoïciens aussi l'on fait après Platon, qu'il n'y a d'utile que l'honnête. Cela résout à la fois le conflit et donne leur sens véritable aux paradoxes de la vie philosophique. Il faudrait encore parler, à propos du De legibus, des grands textes sur la loi naturelle qui combinent, dans l'esprit de Carnéade, les traditions platoniciennes, stoïciennes, péripatéticiennes. Ils soulignent que l'esprit des lois est la raison divine et que la loi suprême est l'amour universel du genre humain. La pointe du doute académique vient même insinuer dans cette foi religieuse la nuance de scepticisme qu'on retrouvera plus tard chez Grotius et Montesquieu : même si la nature n'était pas si bonne, il vaudrait mieux croire qu'elle l'est. Telle est la sagesse de Cicéron. Cette partie de son œuvre est souvent la plus difficile et la plus austère, malgré le ton de conversation raffinée qu'il donne à ses dialogues, malgré l'admirable beauté d'une langue qui se cherche encore, qui se crée sous nos yeux. Pourtant la fécondité de ces livres a été et reste immense, puisque, dans sa quête profonde, ou plutôt dans sa découverte, son invention de l'humanisme, Cicéron apportait à la fois le modèle d'une recherche de l'absolu, d'une préservation de la tolérance, d'une simplification du langage – tout ce qu'il faut pour communiquer, pour se comprendre, pour affirmer à tous les plans l'universalisme de l'humain. Cicéron est un maître à la fois pour saint Augustin et pour Voltaire, pour Érasme et pour Jean-Jacques Rousseau. Plaidoiries et discours En près de quarante ans, Cicéron prononça environ cent cinquante discours. Parmi ceux-ci, 88 sont identifiés par leurs titres cités dans d'autres textes, ou par des fragments, et 58 ont été conservés. Ils se répartissent en discours judiciaires et en harangues politiques prononcées devant le Sénat ou devant le peuple. Les plaidoiries composées à l'occasion de procès s'intitulent Pro xxx ou In xxx, le nom xxx étant le nom de la partie représentée par Cicéron Pro ou de la partie adverse In. Selon la loi romaine, l'avocat ne peut toucher d'honoraires, son assistance rentre dans le système de relations sociales, fait de services rendus et d'obligations en retour. Si les premières plaidoiries de Cicéron contribuent à lui constituer un réseau de soutien pour son ascension politique, les plaidoiries prononcés après son consulat sont des remerciements à ses amis : il défend son vieux maître de grec Archias pro Archia, Sulla pro Sulla qui lui avait consenti un crédit pour l'achat de sa maison du Palatin, Flaccus Pro Flacco qui l'avait soutenu contre Catilina. Plancius, Sestius et Milon qui l'ont physiquement protégé pendant et après son exil sont à leur tour défendus en justice. En revanche, certains discours sont des services imposés par les triumvirs, comme la défense de Publius Vatinius, auparavant vilipendé par Cicéron dans le In Vatinium, ou celle d'Aulus Gabinius responsable de son exil en -58. L'absence de publication ultérieure du pro Vatinio et du pro Gabinio se comprend aisément. On sait pour plusieurs discours comme le Pro Milone que Cicéron a remis en forme et publié son texte après le procès. Dion Cassius, très critique à l'encontre de Cicéron, affirme même que tous ses discours ont été composés en chambre pour simuler une éloquence qu'il n'avait pas, point de vue repris par certains modernes comme Antonio Salieri. Stroh recentre cette vue : selon lui, Cicéron préparait ses discours par des notes, dont de rares fragments nous sont parvenus, et par un plan avec les têtes de chapitre. Seul le début du discours était rédigé puis appris par cœur. Après l'avoir prononcé, et s'il décidait de le publier, Cicéron le mettait par écrit de mémoire à partir de son plan. Selon Stroh, il est même possible que Cicéron ait fait des coupures pour la publication, si l'on considère des temps de parole sur plusieurs heures lors des audiences. Liste des traités de rhétorique. Les Romains ont consacré peu d'ouvrages aux techniques oratoires avant l'époque de Cicéron, on ne connaît que celui que Caton l'Ancien rédigea pour son fils. Un autre manuel de rhétorique, également en forme de guide pratique, La Rhétorique à Herennius, fut longtemps attribué à Cicéron, et comme tel publié à la suite du De Inventione. Quoique ce traité puisse être daté de l'époque de Cicéron d'après les personnages qu'il évoque, cette paternité n'est plus retenue de nos jours en raison des opinions exprimées dans l'ouvrage qui sont fort différentes de celles de Cicéron. Cicéron consigne des règles de l'art oratoire dans une œuvre de jeunesse datée de 84 av. J.-C., le De inventione, sur la composition de l’argumentation en rhétorique, dont deux des quatre livres qui le composaient nous sont parvenus. Se positionnant par rapport aux maîtres grecs, Aristote qu'il suit et Hermagoras de Temnos qu'il réfute, Cicéron consacre une longue suite de préceptes à la première étape de l'élaboration d'un discours, l'inventio ou recherche d'éléments et d'arguments, pour chacune des parties du plan type d'un discours : l'exorde, la narration, la division, la confirmation, la réfutation et la conclusion. Pour les autres étapes, Cicéron renvoie à des livres suivants, perdus ou peut-être jamais écrits. Toutefois, lorsqu'il atteint sa maturité, il semble regretter cette publication précoce et quelque peu scolaire, qu'il critique dans le De Oratore et la qualifie d' ébauches encore grossières échappées de mes cahiers d'école. Néanmoins, le De inventione propose une classification originale des arguments présents dans un discours politique, distinguant ce qui est utile et ce qui est moral ou beau honestum, les deux pouvant être dans le même discours. Plus tard dans sa carrière politique, Cicéron met en pratique cette approche, argumente devant le Sénat sur ce qui est utile et moral, tandis qu'il développe davantage l'utile dans ses discours au peuple. En 55 av. J.-C. soit presque trente ans plus tard, et fort de son expérience, Cicéron reprend ses réflexions théoriques avec le célèbre Dialogi tres de Oratore, Les trois dialogues sur l'orateur. Il adopte une nouvelle approche pour en faire une œuvre philosophique et littéraire, la première du genre à Rome. Il présente son ouvrage sous forme de dialogue platonicien entre les grands orateurs de la génération précédente : Antoine, Crassus et Scævola, ce dernier ensuite remplacé par Catulus et son frère utérin César Strabon. Ils s'entretiennent avec Sulpicius et Cotta, jeunes débutants avides de s'instruire auprès d'hommes d'expérience. Leur réunion date de l'année 91 av. J.-C., période agitée qui précède la guerre sociale puis la sanglante rivalité entre Marius et Sylla, ce qui fait volontairement écho selon Levert à la situation politiquement troublée qui prévaut à la publication de cette œuvre. Le premier livre débat de la définition de la rhétorique et des qualités nécessaires de l'orateur. Dans le second dialogue, ils dissertent des différentes étapes définies par la rhétorique pour l'élaboration du discours, l'invention, la disposition et la mémorisation, et ils critiquent les règles scolaires grecques généralement admises. L'humour manipulateur a même sa place, sous forme de raillerie pour le ton du discours, ou de bons mots pour réveiller l'intérêt du public ou calmer son excitation. Le dernier dialogue porte sur l'élocution et l'action. L'ensemble forme un traité complet, sans avoir la lourdeur d'un manuel grâce au style dialogué. Cicéron présente dans cette œuvre sa célèbre théorie des trois objectifs de l'orateur : prouver la vérité de ce qu'on affirme, se concilier la bienveillance des auditeurs, éveiller en eux toutes les émotions utiles à la cause , ou avec plus de concision instruire, plaire, émouvoir. Dans un dernier traité important sur la rhétorique, l’Orator ad Brutum Sur l’Orateur publié en 46 av. J.-C., Cicéron développe une nouvelle théorie fondamentale pour l’esthétique latine, sur les trois niveaux de style que doit maîtriser l’orateur idéal, les styles simple, médian ou élevé, à appliquer selon l’importance du sujet du discours et l’objectif de l’orateur, informer, plaire ou ébranler l’auditoire. Cicéron revient à des exposés didactiques dans deux ouvrages techniques de portée plus limitée. Le De partitionibus oratoriis, sur les subdivisions du discours, daté de -54, est un abrégé méthodologique destiné à son fils. Le Topica est rédigé en quelques jours en 44 à la demande de son ami Trebatius Testa, qui le prie d'expliquer les règles d'Aristote sur les topoï, éléments de l’argumentation. Lettres de Cicéron, Lettres à Atticus et Epistulae ad familiares. La correspondance de Cicéron fut abondante tout au long de sa vie. Il nous reste quelque 800 lettres, et une centaine des réponses qui lui ont été adressées. Nous pouvons ainsi suivre mois après mois depuis novembre -68, date de la première lettre conservée, son évolution politique et philosophique, ses relations personnelles et ses projets rédactionnels. Cette correspondance, ainsi que les Discours, donnent aux historiens de nombreux témoignages sur divers aspects de la vie de l’époque, dont les activités financières et commerciales de la couche supérieure de la société formée par les sénateurs, les chevaliers, les banquiers et les grands commerçants negociatores. La publication de ces lettres, durant l'Antiquité, se fera de manière posthume. Ces lettres sont regroupées par destinataires, son ami Atticus, ses interlocuteurs officiels et ses clients, son frère Quintus et son ami Brutus. Poésies de Cicéron. L'art oratoire de Cicéron Cicéron jouit d’une réputation d’excellent orateur, de son vivant et plus encore après sa disparition. Selon Pierre Grimal, nul autre que lui n’était capable d’élaborer une théorie romaine de l’éloquence, comme mode d’expression et moyen politique. Cicéron rédige sur ce sujet de nombreux ouvrages, didactiques ou théoriques, et même historique. Parmi ceux-ci, il désigne comme ses cinq livres oratoires majeurs : Dialogi tres de Oratore Les trois dialogues sur l'orateur composés en -55, Orator ad Brutum Sur l’Orateur et Brutus sive dialogus de claris oratoribus (Brutus ou dialogue sur les orateurs illustres, deux ouvrages publiés en -46. L'éloquence à Rome À partir du iie siècle av. J.-C., la maîtrise du discours devient une nécessité pour les hommes politiques qui se font concurrence, lors des procès qui se multiplient, dans les débats au Sénat, et les prises de parole pour séduire une opinion publique de plus en plus présente. Les Romains se mettent à l'école des rhéteurs grecs, véritables professionnels de la parole. À l'époque de Cicéron, plusieurs styles sont en vogue, tous d'origine hellénique : l'asianisme, forme de discours brillante et efficace originaire d'Asie, mais tendant à l'enflure et au pathos, à l'exagération, aux effets faciles, usant de tournures maniérées et recherchées. L'école de Rhodes professe une éloquence sobre et au débit calme, dont Démosthène était le modèle. Le style de Cicéron Selon Cicéron, certains excès d'émotion de l'asianisme ne conviennent pas à la gravitas, le sérieux et la mesure du caractère romain. Il se range dans l'école de Rhodes, plus modérée, où il suivit les enseignements de Molon, et voua une grande admiration à Démosthène. L'expression de Cicéron est souvent redondante, reprenant la même idée avec des mots nouveaux, multipliant les expressions redoublées. Cette abondance lui permet de composer de longues phrases en période, dont les propositions s'enchaînent pour créer l'attente de la fin et donner une impression d'équilibre concinnitas. Enfin, il accorde une grande attention à la sonorité de ses phrases, et veille au « nombre oratoire », emploi de mesures enchaînant les syllabes longues et brèves du latin classique, pour un effet identique aux pieds de la poésie. Pour la prononciation de ses périodes, Cicéron adopte une élocution lente et réfléchie, qui s’écoule sans heurt et que Sénèque compare à une eau qui se répand et forme une nappe tranquille. Un exemple permet d'observer quelques-unes des caractéristiques du style cicéronien : ceci est l'introduction du discours que Cicéron prononce en -66, le Pro lege Manilia dit aussi De imperio Cn. Pompei. Cicéron est alors en pleine ascension politique, et s'adresse pour la première fois au peuple du forum, depuis la tribune des Rostres : Quamquam mihi semper frequens conspectus vester multo iucundissimus, hic autem locus ad agendum amplissimus, ad dicendum ornatissimus est visus, Quirites, tamen hoc aditu laudis qui semper optimo cuique maxime patuit non mea me voluntas adhuc sed vitae meae rationes ab ineunte aetate susceptae prohibuerunt Bien que j'aie toujours le plus grand plaisir à vous revoir souvent, que ce lieu me soit toujours apparu, pour agir, le plus puissant, pour parler, le plus magnifique, citoyens de Rome, ce chemin vers la gloire, toujours très ouvert aux meilleurs, ce n'est pas délibérément que j'en suis resté éloigné jusque-là, mais à cause des principes de vie que je me suis donnés dès ma jeunesse. Cette longue période commence par trois propositions subordonnées, qui font monter l'attente, et redescend après le Quirites citoyens sur trois autres propositions. L'éloge du lieu est redoublé le plus puissant pour agir, le plus magnifique pour parler. La répétition des superlatifs suffixés en -issimus crée un rythme sonore homéotéleute dans la première partie, comme les agendum/dicendum, avec l'élision du um en raison de la voyelle qui suit le mot. La fin de la période reprend un autre effet d'assonance avec la répétition de quatre diphtongues ae. D'autres effets de diction font appel à la scansion poétique, avec la succession d'une syllabe longue, une brève, une longue crétiqu ou l'alternance d'une brève, une longue, une brève, une longue double trochée. La suite du discours est non moins soignée, avec un plan en trois parties, sur l'art de la guerre, la grandeur de cet art, et quel général choisir. Dans cette dernière partie, l'énoncé des qualités nécessaires en quatre points est un procédé d'énumération classique en rhétorique. L’humour est fréquent dans la rhétorique de Cicéron, qui pratique tous les styles : ironie, dérision dans le Pro Murena qui tourne en ridicule la rigueur stoïcienne, jeu de mots dans les Verrines, exploitant le double sens du péjoratif iste Verres, ce Verrès, pouvant aussi se comprendre ce porc. Il sait ridiculiser un adversaire : il met en scène Clodius qui s'était déguisé en femme lors du scandale de Bona Dea. P. Clodius a quitté une crocota robe safran, un mitra turban, des sandales de femme, des bandelettes de pourpre, un strophium soutien-gorge, un psaltérion, la turpitude, le scandale, pour devenir soudain ami du peuple. Outre l'habituelle accumulation terminée par une chute en contraste comique, Cicéron multiplie les mots grecs, pour jouer sur le préjugé anti-grec de son auditoire. Critique et défense de son style Ce style d'éloquence a néanmoins des détracteurs, partisans d'une éloquence imitée des anciens orateurs attiques, particulièrement de Lysias et groupés autour de Licinius Calvus. Centrés sur la clarté d'expression, la correction du langage et un certain dépouillement, ces orateurs attiques critiquent Cicéron pour son manque de simplicité, ses figures de style, son pathétique. Ils l'ont trouvé surabondant, ampoulé inflatus, tumidus, tendant à se répéter inutilement redundans et faisant dans la démesure superfluens, se complaisant trop au balancement des périodes terminées sur les mêmes rythmes. Cicéron répond à cette polémique en 46 av. J.-C. Il affirme dans le De optimo genere oratorum Du meilleur style d'orateur que ses compatriotes qui se disent attiques ne le sont pas. Après avoir souligné les limites stylistiques de Lysias, il étaye son point de vue par deux exemples de ce qu’il qualifie de véritable atticisme, en traduisant depuis le grec deux plaidoyers d'Eschine et Démosthène. De cette œuvre, il ne nous reste que la préface introductive de Cicéron, les traductions proprement dites sont perdues. Il poursuit par un second traité, l'Orator ad Brutum Sur l’Orateur, où il fait l'éloge d'un style abondant et soigné, quasi musical par son rythme, qu'il fait sien contre l'atticisme étriqué et monochrome. Selon lui, cet atticisme que certains rendent aride est plus propre à plaire à un grammairien qu'à séduire et convaincre la foule. S'il prend Démosthène comme modèle dans les Philippiques, ses derniers discours, Cicéron reste plus exubérant que son maître. Quand Démosthène accuse Eschine d’être à l’origine de la guerre contre Philippe II de Macédoine, il emploie une comparaison imagée et balancée : Car celui qui a semé la semence, celui-là est aussi responsable des plantes. Cicéron la reprend contre Marc Antoine, qu’il rend responsable de la guerre civile : Ut igitur in seminibus est causa arborum et stirpium, sic huius luctuosissimi belli semen tu fuisti.Comme dans la semence se trouve le principe des arbres et des plantes, ainsi tu as été la semence de cette guerre si douloureuse Cicéron amplifie l'argument initial avec une répétition arbres et plantes, un superlatif luctuosissimi dérivé du pathétique luctus douleur, deuil, et module avec sa finale habituelle en ditrochée tū fŭīstĭ, : une longue, une brève, une longue, une brève. De la rhétorique à l'Histoire Cicéron considère que les lois de la rhétorique peuvent tout à fait s'appliquer à la composition d'ouvrages sur l'Histoire, et que celle-ci est un travail particulièrement propre à un orateur. En -46, il rédige une brève histoire de l’éloquence avec son Brutus sive dialogus de claris oratoribus, une première pour la rhétorique latine et un document précieux pour la connaissance des auteurs romains. Comme ses précédents traités, elle est présentée sous forme de dialogue. Elle fait un panorama de la rhétorique grecque puis dresse la chronologie des orateurs romains célèbres, depuis les débuts de la République jusqu'à César, dont la qualité d'expression est appréciée, et qui prononce un éloge de Cicéron ! En même temps, Cicéron retrace le lent perfectionnement de la rhétorique latine, et répond aux critiques des néo-attiques. En -44, Cicéron exprime dans sa correspondance son désir d'écrire d'autres ouvrages historiques, et de valoriser ainsi le passé de Rome. Il commence à réunir de la documentation, mais les circonstances qui l'accaparent empêchent ce projet. L'idée demeure et est réalisée quelques années plus tard en prose par la monumentale Histoire romaine de Tite-Live et en vers par l'Énéide de Virgile. Rôle de l'orateur dans la République Toutefois pour Cicéron, l'exercice oratoire ne se résume pas à l'apprentissage des procédés grecs de rhétorique. Il l'insère dans une vision plus vaste, développe une théorie de l'éloquence, et répond ainsi à la critique de Platon qui n'y voit qu'un exercice qui se réduirait à un art du faux-semblant. Pour Cicéron, l'orateur doit être la figure centrale de la vie publique romaine, affirmation qui répond à l'ambition des imperators, qui recherchent gloire et pouvoir par leurs succès militaires et leurs triomphes. Dans son Brutus, il affirme à propos de César la supériorité de la gloire de l'éloquence sur celle des armes ou selon une formule célèbre que les armes le cèdent à la toge, c'est-à-dire au pouvoir civil. L'orateur doit posséder au préalable des qualités fondamentales : une philosophie et une culture. Dans son Orator ad Brutum, Cicéron affirme que la parole repose sur la pensée, et ne saurait donc être parfaite sans l'étude de la philosophie. D'autre part, l'art de bien dire suppose nécessairement que celui qui parle possède une connaissance approfondie de la matière qu'il traite. Liste des œuvres philosophiques de Cicéron. La philosophie à Rome avant Cicéron Le goût des spéculations philosophiques pour elles-mêmes était étranger aux Romains. Rome accueille les idées grecques à partir du iie siècle av. J.-C. avec une certaine méfiance incarnée par l'anti-hellénisme de Caton l'Ancien, tandis que des aristocrates comme les Scipions manifestent leur intérêt : les sénateurs ne veulent pas que le peuple et la jeunesse s’adonnent à des études qui absorbent toute l’activité intellectuelle, font rechercher le loisir, et produisent l'indifférence pour les choses de la vie réelle ; ainsi en 173 av. J.-C. deux philosophes épicuriens Alkios et Philiskos sont chassés de Rome soupçonnés de pervertir la jeunesse avec une doctrine basée sur le plaisir, et en 161 av. J.-C., le préteur est autorisé à expulser philosophes et rhéteurs. Et les trois scolarques députés auprès du sénat par Athènes en 155 av. J.-C., Carnéade, Diogène et Critolaüs, ne comprennent aucun épicurien. C'est le stoïcisme qui pénètre d’abord à Rome, avec Panétios de Rhodes, protégé de Scipion Émilien, et qui exerce une profonde influence sur les membres de son cercle Laelius, Furius, Aelius Stilo et les jurisconsultes Q. Ælius Tubéron et Mucius Scévola. Mais les autres doctrines ne tardent pas à s’introduire aussi à Rome, et y avoir des disciples. L'épicurisme revient à la fin du iie siècle av. J.-C. Après la prise d’Athènes par Sylla en 87 av. J.-C., les écrits d’Aristote sont apportés à Rome ; Lucullus réunit une vaste bibliothèque, où sont déposés les monuments de la philosophie grecque. En même temps, les Romains voient arriver dans leur ville les représentants des principales écoles de la Grèce. Selon l'opinion commune des contemporains de Cicéron, les stoïciens, les académiciens et les péripatéticiens expriment les mêmes choses avec des mots différents. Tous soutiennent le civisme de la tradition romaine et s'opposent en bloc à l'épicurisme, qui prône le plaisir, le repli sur la vie privée, dans le cercle restreint des amis. Son objectif : latiniser la philosophie Si l’on met à part Lucrèce et son De natura rerum, poème qui n’a pas la forme d’un exposé dogmatique, Cicéron est le premier des auteurs romains qui rédige en latin des ouvrages de philosophie. Il le rappelle avec fierté et en débat dans ses préambules, s’opposant à ses contemporains qui dédaignent l’étude ou qui comme Varron préfèrent lire directement les ouvrages des Grecs sur cette matière. Cicéron parle couramment le grec, son éducation à Rome et ses voyages en Grèce et en Asie lui ont fait rencontrer les maîtres grecs des diverses écoles philosophiques. Il se documente en puisant dans les bibliothèques de ses amis et voisins, comme celle de la villa du fils de Lucullus à Tusculum, ou celle du fils de Sylla, riches de livres rapportés des campagnes militaires en Grèce et en Orient. Son ami Atticus lui procure aussi des ouvrages des auteurs grecs, ou des résumés de ces ouvrages. Cicéron définit lui-même le mode de rédaction de ses synthèses philosophiques, par sélection et reformulation : Je ne fais pas office de traducteur. Je conserve ce qui a été dit par ceux dont je fais le choix et j'y applique ma façon de penser ainsi que mon tour de style. Il donne aussi une coloration romaine en parsemant ses textes de citations de poètes latins, d'anecdotes et de souvenirs personnels, d'exemples de grandes figures historiques romaines, car il exalte le passé de Rome et en tire des leçons morales. L’expression Cicéron traducteur des Grecs montre son succès à travers les termes philosophiques qu’il a inventés en latin à partir des mots grecs et qui ont connu une grande fortune en Occident. C’est lui qui élabore un vocabulaire spécifique pour rendre compte de la philosophie grecque. Au plus simple, Cicéron reprend directement le grec ancien, par exemple ἀήρ, aêr, qui devient le latin aer l’air, un des quatre éléments, mot également tiré du grec elementa. Dans d’autres cas, il forge un néologisme latin, comme qualitas qualité équivalent du grec poiotês, ou providentia traduisant le grec pronoia providence, ce qui veille sur les astres et les hommes, formée sur videre, voir. En revanche, et Cicéron s’en fait l’écho dans ses traités, la traduction des concepts théoriques est plus délicate et requiert des périphrases, surtout pour le Stoïcisme qui emploie une terminologie qui lui est propre, qui n’est pas celle du grec populaire ni celle de Platon. Ainsi phantasia représentation mentale comprise chez Aristote comme faculté de l’esprit évolue en représentation sensorielle chez le stoïcien Zénon de Cition, ce que Cicéron rend par quod est visum , ce qui est vu. La thèse de Roland Poncelet inventorie les expressions et les procédés latins pour rendre les argumentaires grecs et traduit les difficultés et les solutions adoptées par Cicéron : par exemple, une difficulté à exprimer les raisonnements, reflétée par une surabondance de prépositions traduisant des relations concrètes de lieu vers, en venant de, etc. en place de relations modales comme en tant que, du point de vue de, conformément à ; ou encore le remplacement d'un concept général par une série d’exemples particuliers pour en extraire un comme représentatif. Une présentation en forme de dialogue La présentation des traités philosophiques de Cicéron suit une forme inspirée des dialogues platoniciens, habituelle pour ce type d’œuvre. Toutefois, ce sont rarement des questionnements socratiques qui enchaînent de rapides répliques, mais plutôt des conversations tenues dans des villas de campagne par des aristocrates romains, qui exposent à tour de rôle les théories des écoles philosophiques auxquelles ils sont censés adhérer. Cette mise en scène permet à Cicéron de présenter les divers points de vue, d’opposer le pour et le contre, en latin in utramque partem selon la méthode dialectique pratiquée par les philosophes de l’Académie. De surcroit, ce choix de protagonistes est une manière d'affirmer que des Romains illustres peuvent s'intéresser à la philosophie sans déchoir. Pour introduire ces conversations, Cicéron s’est constitué une série de prologues interchangeables, son liber prooemiorum dans lequel il puisse à mesure de ses rédactions. Le procédé requiert quelque attention, et par distraction, il place à nouveau le prologue du livre III des Académiques au début du De Gloria, erreur rectifiée en le republiant avec une autre introduction. Mais en comparaison des dialogues de Platon, le philosophe Pierre Pellerin estime peu crédible ce formalisme entre, selon son expression, de solennels raseurs mondains , peu vraisemblables défenseurs de spéculations philosophiques qui les dépassent. Cicéron en perçoit lui-même le caractère artificiel et ajuste cette forme au fil de ses ouvrages : il réécrit la première version des Académiques pour changer des interlocuteurs qui ne pouvaient soutenir le ton philosophique qu’il leur prêtait. Dans ses premiers dialogues comme le De Republica, Cicéron n’intervient qu’en retrait, dans la tradition, dit-il, des traités d’Héraclide du Pont. Puis à partir de juin 45, il change de formule et déclare suivre la tradition d’Aristote : le ou les participants ne sont plus des interlocuteurs actifs, lui-même se place en acteur principal, et il s’exprime comme un maître à son disciple, dans les Tusculanes avec un jeune homme non désigné, puis dans le De fato avec Hirtius comme simple auditeur. Enfin, le dernier traité, De officiis, se présente comme une longue lettre adressée à son fils Marcus, âgé d'une vingtaine d'années : Cicéron renonce dans cet ouvrage à l'artifice de lui prêter des répliques appropriées. Les écrits politiques La production philosophique de Cicéron alterne avec ses activités politiques et judiciaires. Il ne publie que lorsque les événements l’éloignent de la vie politique, comme il le reconnait lui-même. Il affirme toutefois n’avoir jamais renoncé à s’adonner à la philosophie après ses études de jeunesse, ce que montre la présence diffuse de termes et de thèmes philosophiques dans les œuvres de sa période d’activité. Après avoir traité l'art rhétorique dans le De oratore, et tandis que les affrontements dans Rome entre les bandes armées de Clodius et celles de Millon font craindre une nouvelle guerre civile, Cicéron rédige avec le De Republica publié en 54 av. J.-C., puis le De Legibus en 52 av. J.-C., ses réflexions sur les institutions politiques romaines. Pour lui, les meilleures institutions ne sont pas celles de la République de Platon, toutes théoriques, mais celles de la République romaine du début du IIe siècle av. J.-C., l'époque de Caton l'Ancien et des Scipions. Elle combinait alors le meilleur des formes monarchique, aristocratique et démocratique dans un équilibre qu'il faut rétablir, et disposait de grands hommes dont l'esprit civique n'était pas encore corrompu par les ambitions égoïstes. La crise à Rome que constate Cicéron impose de recourir à un tuteur de la République, un fondé de pouvoir de l'État, sage et expérimenté, un ancien consul doté de pouvoirs spéciaux et temporaires. Cicéron se verrait bien dans ce rôle, lorsqu'en 56 av. J.-C., il propose à Pompée d'être son conseiller politique, proposition que ce dernier rejette avec un orgueil offusqué. Le départ de Cicéron en 51 av. J.-C. pour un proconsulat en Cilicie puis la guerre civile entre Jules César et les Républicains interrompent ces travaux rédactionnels. Cicéron publie néanmoins en 47 av. J.-C. les Paradoxes des stoïciens, petit traité inclassable dans lequel il déclare s’être amusé à reprendre quelques sentences stoïciennes pour les rendre plus accessibles au public. C’est aussi un pamphlet dirigé –sans les nommer - contre Clodius qui provoqua son exil et contre les imperatores avides de richesse et de gloire comme Jules César et Crassus. Les écrits philosophiques La seconde période de production de Cicéron s’étend sur environ deux ans de 46 à 44 av. J.-C., pendant sa retraite politique forcée par la dictature de César. Cicéron entame alors le vaste projet de doter la littérature latine d’un exposé de la philosophie contemporaine, essentiellement grecque jusqu’alors, en commençant par la publication de l'Hortensius, ouvrage disparu au Moyen Âge qui vante l'utilité de l’étude de la philosophie. Mais le décès soudain de sa fille Tullia en février -45 interrompt son projet et le plonge dans un profond chagrin. Il sort de cette expérience douloureuse en composant pour lui-même la Consolation, rédigée probablement entre le 7 et le 11 mars et aujourd’hui perdue. Autant pour tromper sa douleur que pour persévérer dans son projet, Cicéron reprend son travail avec une fébrilité intense que permet de suivre sa correspondance avec Atticus. Il va répartir ses traités suivants selon la division classique de la pensée hellénistique en trois domaines majeurs, la philosophie morale guide de l’action humaine, la logique et la philosophie naturelle ou physique, quoiqu’il n’aborde cette dernière que de façon restreinte. Pour chaque domaine, Cicéron présente par la bouche de ses protagonistes les doctrines des principales écoles philosophiques, leurs évolutions et leurs critiques. Du fait de l’absence d’œuvres écrites des maitres du stoïcisme, de l’épicurisme et de l’académisme, ces traités sont avec ceux de Plutarque et ceux de Sextus Empiricus les ouvrages qui donnent une vue d’ensemble des débats philosophiques entre le IIIe et le ier siècle avant notre ère. Philosophie logique : la détermination du Vrai Dans la philosophie antique, la logique, relative à la raison et à l’argumentation, est la voie qui permet de distinguer le vrai du faux, de reconnaître la cohérence et le contradictoire. Elle est donc l’instrument qui sous-tend les théories bâties dans les deux autres domaines philosophiques, la physique et la morale. En effet, toute action réfléchie exige de distinguer entre ce qu’il convient de faire et ce qu’il convient de ne pas faire, donc chercher des certitudes sur lesquelles appuyer son choix. Cicéron commence donc par faire le point des réflexions sur cette recherche de Vérité, de la certitude ou de l'opinion avec ses Académiques. La rédaction est laborieuse, une première version faite au printemps 45 av. J.-C. en deux livres est rapidement suivie d’une seconde en quatre livres. Ces éditions ne sont parvenues à notre époque que très partiellement, plus des trois quarts de l’ouvrage sont perdus. La question est d’établir ce que l’être humain peut appréhender comme vrai au moyen de ses perceptions et de sa raison. Cicéron présente les diverses positions soutenues par les successeurs de Platon, dont celles d’Arcésilas de Pitane, qui réfute les conclusions des stoïciens sur la possibilité des certitudes, de Carnéade, qui introduit la notion de probable, de Philon de Larissa qui atténue le scepticisme d'Arcésilas et d’Antiochos d'Ascalon qui veut concilier les positions des uns et des autres. Toutefois, Cicéron refuse de s'aligner sur la doctrine d'une école particulière et rejette les conclusions trop dogmatiques : puisque à son avis la vérité absolue est hors de portée, chaque thèse a sa part de probabilité, plus ou moins grande, sa méthode est de les mettre en présence, de les opposer ou de les faire s'appuyer mutuellement. Philosophie morale : comment bien vivre Après avoir examiné le problème de la recherche de la Vérité, Cicéron enchaine sur la question fondamentale du bonheur, but de tout homme. Rédigé en parallèle avec les Académiques et publié en juillet 45 av. J.-C., le De finibus bonorum et malorum Des suprêmes biens et des suprêmes maux, parmi les traductions proposées développe cette notion en présentant en cinq livres les réponses offertes par les écoles philosophiques grecques contemporaines de Cicéron. Chaque école a sa définition du bonheur, autrement dit du Bien suprême : le plaisir, ou bien l’absence de douleur, ou encore la conformité à la Nature, mais quelle Nature, celle du corps ou celle de l’esprit ? Cicéron au travers de dialogues fictifs va exposer la position de chaque doctrine, puis la critique de cette doctrine afin que le lecteur puisse se forger sa propre opinion. L’ordre de présentation suit les préférences de Cicéron, il commence par l’épicurisme qu’il rejette complètement, enchaîne sur le stoïcisme, et conclut par la nouvelle Académie. La parution des Tusculanes suit en août 45 av. J.-C. Cicéron y aborde les questions existentielles traitées traditionnellement par les écoles philosophiques, mais donne une forme originale et personnelle aux cinq livres du traité, les présentant comme des conférences dans lesquelles il explique lui-même à un jeune homme anonyme les grands thèmes : la mort, la douleur physique, la douleur morale, les passions qui affectent l'âme, la vertu et le bonheur. Après les Tusculanes et continuant de séjourner près de Rome, Cicéron rédige début 44 deux petits traités, le premier sur la vieillesse et l'autre sur l’amitié, adressés à Atticus et évocateurs d'un passé mythifié. Dans le premier traité, le Cato Maior de Senectute Sur la vieillesse, un Caton l'Ancien très âgé converse avec Scipion Émilien et son ami Laelius, alors jeunes. Il répond aux critiques que l'on formule à l'encontre de cette dernière période de la vie. Cicéron réaffirme l'utilité que peut avoir un vieillard prudent et expérimenté comme conseiller dans la gestion des affaires publiques. Il avait déjà décrit ce rôle dans le De Republica, et semble exprimer son espoir de participer ainsi à la vie publique. Face à la mort, inévitable issue de la vieillesse, il espère en la survie de l’âme, fusse-t-elle une illusion dont il ne voudrait pas être privé tant qu'il vit. On retrouve là l'argumentaire sur la mort que Cicéron exprimait déjà dans l’Hortensius,le Songe de Scipion et les Tusculanes . Dans le traité, Laelius de Amicitia Sur l'Amitié, le même Laelius qui vient de perdre son ami Scipion s'entretient avec ses gendres de la pratique de l'amitié. La mort de Scipion Émilien en -129 marque pour Cicéron la fin de l'âge d'or de la République, auparavant gérée par un petit groupe d'hommes liés par l'amitié. Cicéron justifie par des arguments théoriques et philosophiques la pratique romaine de l'amitié et en fait un programme politique, une nécessité pour que la société retrouve cette vertu. Le De gloria Sur la gloire, commencé vers le 26 juin et terminé le 3 juillet 44 av. J.-C, est un texte en deux livres dont il ne reste que de brèves citations dans les Nuits Attiques. Alors qu'à Rome certains parlent de diviniser le défunt Jules César, il y est question de l’évhémérisme, concept grec de divinisation des grands hommes par leurs compatriotes. Cicéron a déjà abordé le thème de la gloire dans le De Republica et les Tusculanes, et revient sur la question dans son traité suivant De officiis. Selon Pierre Grimal, Cicéron veut sans doute faire œuvre de propagande en opposant une gloire vraie et juste, traduite par l'affection des citoyens, à une fausse gloire, applaudie par des partisans mal intentionnés qui espèrent en tirer un profit personnel. Philosophie naturelle : le refus du fatalisme La philosophie naturelle recouvre la physique, c'est-à-dire les principes visibles et invisibles qui donnent forme, cohésion et vie à la matière. Cicéron ne s'intéresse toutefois guère aux théories explicatives du monde, l'atomistique des épicuriens ou la théorie des quatre éléments, mais se concentre sur ce qui transcende l’existence humaine, manifestations ou volontés divines, et qui peut influer sur notre liberté individuelle d’action. Une série de traités publiés en l'espace d'une année constitue une réflexion d’ensemble sur la métaphysique : les De Natura Deorum De la nature des dieux, De divinatione Sur la divination et De fato Sur le destin. Après le De natura deorum, s'intercale à l'automne 45 av. J.-C. la traduction en latin que fait Cicéron du récit du Timée de Platon, dont il reste des fragments importants. Sa préface apprend qu'il s'est entretenu avec le néopythagoricien Nigidius Figulus lors de son voyage vers la Cilicie. Ils ont discuté de physique selon le sens antique, c'est-à-dire des spéculations sur l'Univers et les causes qui l'ont produit, et la traduction de Cicéron est présentée comme la suite de cette rencontre. Le premier passage étudie l'opposition entre l'éternel et le mouvant, entre ce qui est dans le devenir et l'immobile, entre le mortel et l'immortel, et relie l'éternel à la Beauté. La traduction expose ensuite un résumé de la genèse de tout ce qui existe, en particulier la naissance des dieux. Ce récit, dans lequel Platon comme Cicéron ne voient probablement qu'un mythe, est sa seule incursion dans la partie de la physique antique consacrée à l'histoire du Monde et sa structure. Après l’étude des dieux, deux problèmes dérivés font l’objet d’une étude approfondie : la divination, liée à l’emploi politique et civique de la théologie, et le destin, dont l’analyse va déterminer le degré de liberté de l’action humaine. Le De divinatione est un des seuls traités antiques consacré à la divination qui nous soit parvenu, il présente donc un intérêt historique pour la connaissance de pratiques de divinations grecque, étrusque et latine et des attitudes antiques face aux phénomènes hors de l'expérience ordinaire. Cicéron y analyse avec scepticisme les diverses formes de la divination comme les oracles et l’haruspicine étrusque. Il critique les théories des stoïciens qui la défendent et refuse d’admettre le principe que tout événement dépende d’une cause implique que les événements futurs puissent être prédéterminés. Il est néanmoins moins critique sur les augures romains, non parce qu’il est lui-même augure, mais parce que ceux-ci ne servent pas à prédire l’avenir, mais seulement à obtenir l'avis préalable des dieux lors des actes importants des magistrats. En cela ils ont une utilité politique et sociale pour la République. Dans le De fato, Cicéron récuse à nouveau tout déterminisme et refuse la conception stoïcienne qui rendrait l’acte individuel librement choisi soit irréalisable soit totalement déterminé en dehors de la volonté humaine. Le dernier traité, moral et politique Le traité des Devoirs De Officiis est le dernier ouvrage à portée philosophique de Cicéron, publié à la fin de l'année 44 av. J.-C., alors qu'il reprend son activité politique avec ses premiers discours contre Antoine. L'ouvrage, volontairement concret, donne des prescriptions et des conseils à son fils et plus largement aux hommes de bien les boni viri de la classe sociale de Cicéron pour se comporter convenablement en toute circonstance au sein de sa famille, de la société et de la cité. Cet ouvrage n'est pas seulement un traité pratique de morale, il exprime aussi les souhaits de Cicéron d'un gouvernement romain régi par la Justice, exprimée par le respect de la propriété privée et des biens publics, et par la Fides, la Bonne Foi romaine, dans l'observation des contrats et des traités, dans la protection des cités et des peuples alliés de Rome, et enfin la stabilisation de l'Empire avec la fin des guerres de conquête. Ceux qui sont à la tête de l'État doivent se comporter comme des tuteurs de la République, veillant au bien de tous et non à l'avantage d'une faction, concept énoncé dix ans plus tôt dans le De Republica. Il faut non seulement agir avec justice, mais aussi lutter contre l'injustice, et s'en abstenir revient à commettre une injustice. Cicéron est maintenant résolu à lutter contre Marc Antoine et, dit-il, à offrir sa vie pour la liberté, selon une formule grandiloquente mais prémonitoire. Postérité de Cicéron La notion d'éloquence développée par Cicéron a exercé une influence considérable sur la culture occidentale dans l'Antiquité, au Moyen Âge, à la Renaissance et à l'époque moderne. Période impériale La disparition de Cicéron et des orateurs de sa génération se traduit par le déclin de l'art oratoire de l'avis de Sénèque l'Ancien, puis de Tacite, quoique Marcus Aper estime que le goût a évolué au profit des formules brèves et brillantes ou de la précision du vocabulaire, et n'admet plus les lourdes périodes et les digressions cicéroniennes. À la fin du ier siècle, le goût littéraire se développe pour les auteurs considérés comme classiques, dont Cicéron et d'autres plus anciens pour la langue latine, tandis que Démosthène et l'Atticisme deviennent la référence pour l'expression grecque. Les bibliothèques publiques et privées fleurissent, on copie les textes, Asconius commente dans ses éditions plusieurs discours de Cicéron les Scholies, imité par ses continuateurs pseudo-Asconius. L'enseignement de la rhétorique latine se systématise, grâce notamment à Quintilien, qui promeut Cicéron comme modèle absolu de l’éloquence dans son manuel De institutione oratoria, et qui comme lui voit dans la culture et la morale les compléments obligés de la rhétorique pour une formation complète de l'homme et du citoyen. Cicéron est mis au rang des grandes figures historiques et sa fin est prise pour sujet d'exercice de déclamation, sur le thème Cicéron délibère s'il brûlera ses œuvres, sur la promesse d'Antoine de lui laisser la vie sauve. Sénèque l'Ancien note avec humour que personne à sa connaissance n'a soutenu la thèse sauvant Cicéron et sacrifiant ses œuvres. Si l’influence de Cicéron est patente sur l’art oratoire romain, son ambition d’implanter la philosophie dans la langue latine n’est pas couronnée d’autant de succès : le grec reste le mode d’expression privilégiée de la philosophie, même pour un Romain comme Marc-Aurèle, et des doxographes comme Sextus Empiricus ou Diogène Laërce ne font aucune mention de Cicéron. Antiquité tardive et Moyen Âge On continue de se référer aux textes de Cicéron au Bas Empire : au ive siècle, le grammairien Nonius y puise de nombreux exemples, tandis que Lactance copie dans les Institutions Divines des passages entiers pour argumenter contre la religion traditionnelle et les mœurs antiques, et Marius Victorinus commente le De inventione. L’Histoire Auguste suit cette mode de la citation en nommant Cicéron dix-neuf fois, et faisant une quarantaine d’allusions ou d’imitations à la manière de Cicéron, aisément reconnaissables par un lecteur cultivé de l’époque. Au siècle suivant, Macrobe rédige un Commentaire au Songe de Scipion, et son contemporain Augustin d'Hippone doit sa passion pour la philosophie à sa découverte de l'Hortensius. Les citations que fait Augustin prouvent une connaissance approfondie des traités philosophiques et rhétoriques de Cicéron, même s'il reste réservé sur sa pensée lorsqu'il la compare à la doctrine chrétienne. Augustin apprécie hautement Cicéron, qui est pour lui le fondateur de l'art oratoire romain. L'approche rhétorique d'Augustin reprend le projet de Cicéron, de placer la sagesse sapientia au-dessus de l'éloquence, mais pour Augustin, la sagesse est la connaissance de l'écriture sainte. Il reprend la théorie que Cicéron formule dans l'Orateur en faveur de la maîtrise des trois styles, simple, moyen et élevé, pour les trois missions de l'orateur : enseigner, réjouir, émouvoir docere, delectare, movere. Dans le quatrième livre de son De Doctrina christiana, Augustin adapte ces préceptes à la prédication, nécessairement de style élevée, qui doit enseigner de façon compréhensible, plaire pour qu'on l'écoute volontiers et ébranler les auditeurs par l'exhortation morale. Au Moyen Âge, la rhétorique est une des branches du Trivium, un enseignement qui s'appuie essentiellement sur trois traités antiques didactiques, le De inventione de Cicéron, la Rhétorique à Herennius, qui lui est attribué, et l'Institution oratoire de Quintilien. Grâce à l'enseignement, le De inventione est un des textes les plus copiés du Moyen Âge. En revanche, les discours de Cicéron, mis à part les Catilinaires et les Philippiques, et ses ouvrages philosophiques ou personnels sont négligés. La transmission des ouvrages au fil des siècles est altérée par la détérioration des manuscrits et la corruption des textes engendrée par les recopies successives. Par exemple, un recueil de traités philosophiques groupant les De Natura deorum, De divinatione, De fato, De Legibus, Timée, Topica, Paradoxa, Lucullus est connu par sept manuscrits datés entre les IXe et XIe siècle, qui d'après leurs importantes lacunes communes sont tous issus d'un unique manuscrit inconnu, antérieur au IXe siècle et déjà mutilé par la perte de plusieurs feuillets et la permutation de cahiers de 4 pages. Malgré la raréfaction des exemplaires, la pensée de Cicéron reste une référence. Au IXe siècle lors de la renaissance carolingienne, Hadoard, bibliothécaire du scriptorium de l'Abbaye de Corbie, dispose d'exemplaires de la plupart des ouvrages philosophiques de Cicéron, avec lesquels il constitue un florilège classique d'extraits choisis et retravaillés pour les placer dans une perspective morale et chrétienne. Redécouverte de Cicéron Au XIIe siècle, l'intérêt renait pour les dialogues philosophiques de Cicéron, l'école de Chartres spécule sur le Commentaire au Songe de Scipion rédigé par Macrobe, et l'humaniste Jean de Salisbury perçoit des options presque chrétiennes dans le De officiis, le De amicitia et le De senectute. Un nouvel élan est donné quand les humanistes de la Renaissance se mettent en quête dans les abbayes de manuscrits contenant des textes antiques. Dans les années 1330, Pietro di Malvezzi constitue à Vérone un recueil qui regroupe la plupart des traités philosophiques et rhétoriques de Cicéron, et plusieurs discours. Ce manuscrit est offert à Pétrarque, grand admirateur de Cicéron. Ce dernier retrouve aussi d'autres textes, et surtout reconstitue la correspondance de Cicéron. Il met en lumière grâce à elle son côté humain. À son tour, le Pogge découvre en 1416 un codex contenant les commentaires d'Asconius de cinq discours de Cicéron. Certains manuscrits originaux disparaissent après leur découverte comme le De oratore, mais leurs textes subsistent grâce aux copies des humanistes. Le développement de l'imprimerie permet enfin une diffusion large et cette fois pérenne des œuvres de Cicéron : un premier recueil des textes philosophiques de Cicéron est publié à Rome en 1471 Lorsque les Jésuites fixent en 1599 les principes fondamentaux de leur enseignement avec le Ratio Studiorum plan raisonné des études, ils prennent Quintilien et surtout Cicéron comme base de leur pédagogie. Les préceptes rhétoriques qu'enseignent ensuite leurs collèges sont presque tous repris de Cicéron. L'enseignement secondaire des XIXe et XXe siècles continue cet esprit cicéronien au travers des classes de rhétorique et des classes de philosophie. La langue de Cicéron est alors le modèle incontesté du latin classique Jugements sur l'homme et son action Si les biographes et les littéraires imprégnés de son œuvre lui sont généralement favorables, plusieurs historiens de renom ont émis des jugements très critiques à l'encontre de Cicéron, et de son attitude politique. Visiblement, le Cicéron des historiens du XIXe et du début du XXe siècle n’est pas celui des latinistes. Ainsi la Geschichte Roms Histoire de Rome de Wilhelm Drumann publiée entre 1834 et 1844 contient une bibliographie qui est un réquisitoire soigneusement référencé contre Cicéron. La monumentale Histoire romaine de Theodor Mommsen parue entre 1850 et 1857 le traite au fil de ses pages d'avocat à tout faire, parvenu gonflé d'orgueil, nageur entre deux eaux, girouette politique. L'appréciation reste sévère chez des historiens français du siècle suivant : homme d'État malhabile, juriste médiocre, artiste admirable, maladroit dans ses rapports avec Pompée, manipulé par César durant son consulat et dépourvu de sens politique et de psychologie avec Octave selon André Piganiol. Le jugement est non moins critique dans l'Histoire romaine de Jérôme Carcopino, très réservé sur la sincérité de certaines attitudes de Cicéron, sur la continuité de ses vues politiques, l’efficacité de son action. En 1947, Carcopino a tiré d'une analyse à charge de la correspondance de Cicéron un portait extrêmement dépréciatif : feignant le désintéressement et l’intégrité mais obsédé par l'argent, dépensier et endetté pour satisfaire son goût du luxe, mouillé dans des montages financiers parfois douteux, capteur d’héritages, mauvais père, fantoche apeuré manipulé par les triumvirs, courtisan opportuniste avec les grands et médisant en privé, etc. L’interprétation est si négative que Carcopino avance l’idée que ces lettres auraient été sélectionnées et publiées durant le second triumvirat dans un but de propagande, pour dénigrer Cicéron et justifier sa proscription par Octave. Cette théorie a été réfutée par Pierre Boyancé dans son article Cicéron contre Cicéron ?, paru en 1949. Pierre Grimal explique les errances politiques attribuées à l'irrésolution et la faiblesse de caractère de Cicéron par sa formation devenue une habitude de pensée, consistant à peser le pour et le contre avant de décider, en face de situations politiques complexes et mouvantes. Les partisans de Cicéron excusent les compromissions de ses plaidoyers d'avocat, qu'ils jugent comme une adaptation au client et à la cause, ce que Cicéron revendique : on se trompe en croyant avoir dans les discours que nous avons tenus devant les tribunaux nos opinions dûment consignées : tous ces discours sont ce que veulent les causes et les circonstances. Quitte à s'éloigner de la vérité pour défendre un coupable : il appartient … à l'avocat, parfois, de plaider le vraisemblable, même s'il n'est pas le plus vrai. Jugements sur sa philosophie Durant la Renaissance et l’époque classique, Cicéron est un acteur reconnu dans les débats philosophiques. Mais à partir des années 1830, lorsque sont publiées les éditions savantes des auteurs grecs et latins, le point de vue change : Cicéron n’est plus considéré comme un philosophe véritable, mais juste comme un passeur de la pensée grecque, un doxographe résumant des textes sans apport qui lui soit personnel. La préface rédigée en 1928 par Jules Martha dans sa traduction du De finibus bonorum et malorum est représentative de cette dépréciation : il n’a pour bien traiter, les matières de la philosophie la tournure d’esprit qui convient. Il est rapide, superficiel. Il est trop porté à voir les choses par le coté oratoire et n’a pas assez le souci d’aller au fond. Il n’a pas la rigueur dans l’analyse et la méthode qu’exigent l’exposé ou la critique des problèmes philosophiques. Jules Martha reconnait du moins l’intérêt de son travail de vulgarisation, parfois comme seul témoin qui subsiste de certains aspects des doctrines grecques. Considérer Cicéron comme un simple transcripteur des philosophes grecs à destination d'un public latin a pour corolaire au XIXe siècle un courant de recherche systématique dans ses traités de sources grecques pour chacun de ses énoncés, mis à part les références à la mythologie et à l’histoire romaine, et les anecdotes personnelles. Les travaux des philologues allemands comme Rudolf Hirzel ont fait longtemps autorité dans cette approche, dite du Quellenvorschung, Recherche des sources. Cette approche fondée sur un préjugé réducteur et menée trop systématiquement est aujourd'hui critiquée et rejetée, même si Carlos Lévy estime que ses études de détail sur tel ou tel aspect des ouvrages de Cicéron restent précieuses pour effectuer de nouvelles recherches. Une certaine réhabilitation de Cicéron se dessine toutefois à la fin du XXe siècle : ainsi Pierre Boyancé définit l’humanisme cicéronien par son sens de l’humain, son sens de la culture, qui permet à l’homme de se réaliser, et son sens de la bienveillance, exprimée dans les rapports sociaux. Pierre Pellegrin rappelle que Cicéron n'a jamais été considéré comme un philosophe original, et qu'il n'a jamais prétendu l'être. S'il parle avec sympathie de la Nouvelle Académie et s'en fait le porte-parole dans certains traités, il ne s'est pas posé en successeur d'Antiochus d'Ascalon, dernier maître officiel de cette école. Évocations artistiques Œuvres artistiques Pierre-Henri de Valenciennes peint en 1787 Cicéron découvrant le tombeau d'Archimède Cesare Maccari décore en 1880 le palais Madama d'une fresque dans laquelle Cicéron dénonce Catilina Romans historiques Florence Dupont, L'affaire Milon : meurtre sur la voie Appienne, Paris, Denoël, 1987 Steven Saylor, L'énigme de Catilina, 10/18, 1999. Robert Harris, Imperium, Plon, 2006 et Pocket, 2008 Colleen McCullough, Les Maîtres de Rome série Œuvres cinématographiques Alan Napier incarne Cicéron dans le film Jules César de Mankiewicz 1953. Dans la série télévisée Rome créée en 2005, figure Cicéron en personnage secondaire, joué par David Bamber. L'Affaire Sextus est un téléfilm historique coproduit par la BBC et Discovery Channel sorti en 2006 et inspiré du procès Pro Roscio Armerino de Cicéron. -e et ses mains sanglantes. Lien http://www.ina.fr/audio/00107078/la-conversation-audio.html La conversation  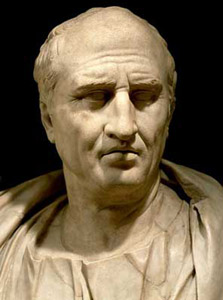  [img width=600]http://www.historiweb.com/showimg.ashx?img=272[/img]       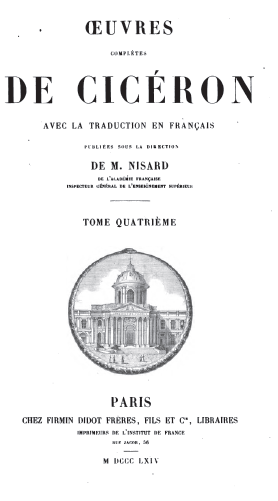 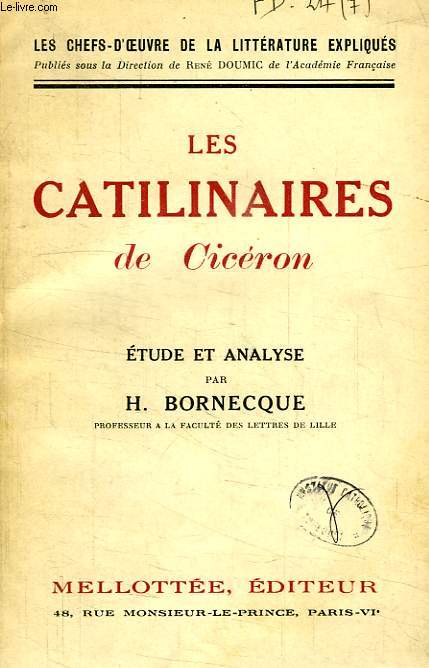 |
Connexion
Sont en ligne
46 Personne(s) en ligne (25 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0 Invité(s): 46 Plus ... |
| Haut de Page |