|
|
Re: Défi du 12 décembre 2015 |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
06/08/2013 20:30
De Le Havre
Niveau : 25; EXP : 53
HP : 0 / 613
MP : 268 / 19535
|
Toujours aussi mélomane Donald. Aurais je le temps de participer cette fois ? Je l espère.
Posté le : 13/12/2015 13:37
|
|
|
|
|
Heinrich Heine 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 13 décembre 1797 naît Christian Johann Heinrich Heine,
à Düsseldorf, Duché de Berg, sous le nom de Harry Heine et mort le 17 février 1856 à Paris 8e arrondissement sous le nom de Henri Heine, fut l'un des plus grands écrivains allemands du XIXe siècle.
Heine est considéré comme le « dernier poète du romantisme » et, tout à la fois, comme celui qui en vint à bout. Il éleva le langage courant au rang de langage poétique, la rubrique culturelle et le récit de voyage au rang de genre artistique et conféra à la littérature allemande une élégante légèreté jusqu'alors inconnue. Peu d'œuvres de poètes de langue allemande ont été aussi souvent traduites et mises en musique que les siennes. Journaliste critique et politiquement engagé, essayiste, satiriste et polémiste, Heine fut aussi admiré que redouté. Ses origines juives ainsi que son positionnement politique lui valurent hostilité et ostracisme. Ce rôle de marginal marqua sa vie, ses écrits et l'histoire mouvementée de la réception de son œuvre.
En bref
Plus d'un siècle après sa mort, Heine demeure un écrivain discuté, en particulier dans son propre pays. Sans qu'on lui dénie du talent, sa personne est souvent mise en cause et son nom passionne les débats. Auteur de lieder, et parmi les plus populaires dans les pays de langue allemande, il semblerait devoir, par là, échapper aux polémiques ; mais son œuvre lyrique compte aussi de grandes parties satiriques dont les traits portent et réveillent d'anciennes blessures.
Il a échoué au théâtre et ne s'est jamais essayé au roman, mais il a découvert, avec le récit de voyage, une forme flexible, capable de supporter toutes les digressions et toutes les variations, et il a su, avec une exceptionnelle virtuosité, y mêler la prose et les vers, la rêverie et la moquerie, les bons mots et les aperçus soudainement révélateurs. Aussi a-t-il été, sa vie durant, journaliste, principalement à Paris où il vint après la révolution de Juillet.
Il lui apparut alors que sa mission serait de servir d'interprète aux deux littératures, analysant l'Allemagne pour le public français et faisant à ses lecteurs allemands le tableau de Paris. Ce dédoublement lui a été quelquefois reproché, surtout du côté allemand où on lui pardonne souvent mal sa liberté de jugement, son goût de l'irrévérence. Pourtant, c'est le chancelier Bismarck lui-même qui l'a défendu, un jour, au Reichstag : « N'oubliez pas, Messieurs, qu'il est, après Goethe, l'auteur des plus beaux lieder en langue allemande. »
Heinrich Heine a écrit que toute sa carrière, au long de sa vie, s'expliquait par ses origines. Il voulait rappeler par là qu'il était né dans une famille juive, à Düsseldorf, au bord du Rhin, en un temps où cette ville était française (elle devait le demeurer durant la période napoléonienne). Les juifs de Düsseldorf jouissaient en 1799 de plus de libertés et de droits que dans la plupart des autres villes allemandes et, si l'on en croit ses souvenirs, le jeune Heinrich, d'abord appelé Harry, a beaucoup vécu dans les rues et dans les cours, avec les enfants du voisinage, à écouter le soir des histoires et des chansons. Légendes pieuses et histoires de bourreaux, chansons d'amour et de malheur, peuplées de spectres et de démons familiers, c'est le fond où le poète devait, plus tard, largement puiser ; c'est la source d'où sont sortis les « esprits élémentaires » qui revivent dans ses vers comme dans les contes romantiques. Beaucoup plus sensible aux sons qu'aux couleurs et aux formes, Heine a été, dès son enfance, très réceptif aux mots, avant même d'en mesurer toujours le sens, et il était encore écolier qu'il savait déjà conter et jeter sur le papier des histoires imaginées, à la grande joie de sa sœur Charlotte.
Après les légendes du Rhin, ce sont les souvenirs de l'épopée napoléonienne qui ont marqué ses jeunes années : le tambour de la vieille garde qui raconte ses campagnes ; les cavaliers de Murat dans le Hofgarten de Düsseldorf ; enfin, quand tout est fini, la troupe misérable des grenadiers, revenus de leur captivité en Sibérie, que Heine raconte avoir vue un jour dans ce même Hofgarten et qu'il a immortalisée dans sa ballade.
Pour assurer l'avenir du jeune Harry qui se révélait inapte au commerce, son oncle Salomon Heine, qui avait édifié une grande fortune à Hambourg, lui fit faire des études de droit. Médiocre étudiant, il fut bon patriote libéral, fervent d'un passé national que la génération romantique de la guerre de libération (1813-1815) venait de sauver de l'oubli et qu'on cultivait particulièrement à Bonn. Heine passa deux semestres dans cette ville, suivant les cours de Schlegel et de Arndt, souvent en compagnie de Simrock qui devait consacrer sa vie à la poésie allemande ancienne.
À Göttingen, l'année suivante, rejeté par un milieu rétrograde et borné, il prit conscience de l'antisémitisme et dut quitter la place ; mais il avait découvert aussi des cibles de choix pour ses premiers Tableaux de voyage (Reisebilder I, 1826).
C'est seulement à Berlin qu'il devait trouver, dans le salon de Rachel von Varnhagen, et en écoutant les cours de philosophie politique de Hegel en 1821-1822, le milieu intellectuel et mondain qui l'a accueilli et stimulé.
Intitulé simplement Poèmes (Gedichte), son premier recueil a été publié à Berlin en 1822 ; ce sont les pièces, ballades et sonnets, qui forment aujourd'hui la première partie du Livre des chants (Das Buch der Lieder), et auxquels il devait donner ensuite le titre Jeunes Souffrances (Junge Leiden, 1817-1821). Chants de malheur et rêveries, appels et désespoirs, empoisonnés par le souvenir lancinant de la vaine cour qu'il fit à Amélie, sa belle cousine de Hambourg : « Il a perdu son trésor, c'est le tombeau qui lui convient ; c'est là qu'il aimerait le mieux reposer, jusqu'au jour du Jugement Dernier » (« Le Pauvre Pierre »).
En 1823 paraissait l'Intermezzo (Tragödien nebst einem lyrischen Intermezzo), entre deux tragédies historiques dans le goût de Walter Scott, un intermède lyrique où se trouvent quelques-unes des brèves et fulgurantes plaintes d'amour qui inspireront le musicien Robert Schumann. En 1826, avec les premiers Tableaux de voyage, Heine publiait la série de poèmes intitulée Le Retour (Die Heimkehr) où le désenchantement déchirant, le rire sur son propre malheur se révèlent comme les modes d'expression favoris du poète. Un an plus tard, avec les deux cycles de La Mer du Nord (Die Nordsee) s'ajoutant aux précédents, Heine publiait ce Livre des chants qui devait connaître treize éditions successives du vivant de l'auteur et faire de lui un poète majeur. Ballades, chansons d'amour et de deuil, tableaux de genre piquants et touchants, enfin les vastes évocations, colorées et sifflantes de la mer du Nord, les premières en langue allemande, montraient la virtuosité d'un musicien du verbe, doué dans tous les registres lyriques.
Docteur en droit en 1825, baptisé peu après dans une église luthérienne (il prend alors le prénom de Heinrich), Heine cherche, des années durant et sans succès, un emploi stable dans une administration, une université ou un journal. Ses espoirs se sont tournés vers Munich où régnait Louis Ier de Bavière, un roi ami des artistes. Mais Heine était ressortissant prussien, juif bien que baptisé ; sa plume redoutable lui avait fait beaucoup d'ennemis après les Tableaux de voyage, et il avait la réputation d'être joueur et libertin. Il ne demeura pas longtemps à Munich où il rédigeait un journal, et partit pour l'Italie ; il en revint, y retourna, et en rapporta les dernières parties des Tableaux de voyage qu'il acheva de rédiger à Berlin et à Potsdam, où il vécut un temps après la mort de son père. Berlin ne lui offrit pas l'emploi que Munich lui avait refusé et, en septembre 1829, il reprenait le chemin de Hambourg, « berceau de ses malheurs » où, naguère, il s'était juré de ne jamais retourner et où ses écrits polémiques faisaient scandale, en ville et dans sa famille.
Le dernier de ses grands recueils poétiques, le Romanzero a été publié en 1851. Il est le plus riche et il contient ses pièces les plus émouvantes, en particulier ses méditations sur la maladie, la mort, le dieu des Hébreux et le destin des âmes.
Depuis 1848, Heine était atteint de paralysie, et il était habité par la pensée de la mort (qui surviendra huit ans plus tard à Paris). Il faisait, à l'envers, le chemin de Lazare, et revenait à ses origines, aux sources de son être. Le retour était déjà le titre d'un de ses premiers recueils, les Lamentations (Lamentationen), les Mélodies hébraïques (Hebräische Melodien), le Livre de Lazare (Das Buch Lazarus), réunies dans le Romanzero, méritaient pleinement ce titre-là. C'est le retour à la Bible de son enfance et aux récits d'antan, présents tout au long de sa carrière poétique : « Oui, je suis revenu à Dieu, comme l'enfant prodigue, après avoir longtemps gardé les cochons avec les disciples de Hegel [...] Pour ce qui est de la théologie, je dois reconnaître que j'ai fait un retour en arrière ; comme je l'ai déjà avoué, je suis revenu à une vieille superstition, la croyance en un Dieu personnel » (Postface au Romanzero, Paris, 30 sept. 1851).
Mais l'univers du poète demeurait aussi riche en évocations du Moyen Âge, des mondes exotiques, des scènes amères de sa jeunesse, du « château des affronts » de Hambourg. La lampe est la compagne de ses nuits sans sommeil : quand la flamme baisse jusqu'à s'éteindre, il pense s'éteindre lui-même.
À la fin la mèche geint et siffle
Désespérément, et elle s'éteint.
Cette pauvre lumière c'était mon âme.
Durant la période hitlérienne, son nom fut rayé, en Allemagne, partout où il pouvait l'être. Il avait disparu des anthologies, mais pas tout à fait sa poésie ; il avait fallu, au moins, y laisser la Lorelei, le plus populaire de ses chants ; trop d'écoliers allemands l'avaient appris par cœur. Alors, pour ne pas imprimer au bas de ses vers le nom du poète maudit, on avait mis seulement : « auteur inconnu ». Mais ceux qui le persécutaient ainsi rendaient à son génie un hommage involontaire : même sans son nom, ses vers demeuraient. Pierre Grappin
Sa vie
La ville de Dusseldorf est très belle, et quand au loin on pense à elle et que par hasard on y est né, on se sent tout drôle. J’y suis né, et dans ces cas-là je crois que je dois rentrer à la maison tout de suite. Et quand je dis rentrer à la maison, je veux dire la Bolkerstrasse et la maison où je suis né…
Si le lieu de naissance de Heine n'a jamais fait le moindre doute, la date précise de sa naissance reste aujourd'hui incertaine. Tous les documents qui auraient pu fournir des indications à ce sujet ont été perdus au cours des deux derniers siècles. Heine lui-même s'est qualifié, en plaisantant, de "premier homme du siècle", car il serait né au Nouvel an 1800. De temps en temps, il mentionne aussi 1799 comme année de naissance. Les spécialistes de Heine considèrent aujourd'hui la date du 13 décembre 1797 comme la plus vraisemblable. À la suite de la Révolution française, son enfance et sa jeunesse se passent dans une époque de grands bouleversements.
La présence de la famille Heine est attestée à Bückeburg depuis le XVIIe siècle. Harry Heine — de son nom de naissance — était l'aîné des quatre enfants du drapier Samson Heine * 19 août 1764 à Hanovre; † 2 décembre 1829 à Hambourg et de sa femme Betty à l'origine Peira, née van Geldern *27 novembre 1770 à Dusseldorf; † 3 septembre 1859 à Hambourg. Betty était l'arrière-petite-fille de Joseph Jacob van Geldern, banquier et membre de la Chambre des comptes du prince-électeur Jean-Guillaume de Neubourg-Wittelsbach. C'est dans la maison de Joseph Jacob van Geldern que fut aménagée la première synagogue de Dusseldorf, au début du xviiie siècle.
sa famille:
Gustav v. 18033 in Dusseldorf; † 15 novembre 1886 à Wien, le futur baron Heine-Geldern et éditeur de la Fremden-Blatt de Vienne,
Maximilian v. 18043; † 1879, plus tard médecin à Saint Petersbourg.
Tous, ils grandirent dans une famille imprégnée de l'esprit de la Haskala les Lumières juives et très largement assimilée.
À partir de 1803, Harry Heine fréquenta l'école privée israélite de Hein Hertz Rintelsohn. Lorsqu'en 1804, le gouvernement de Bavière-Palatinat, dont dépendait le duché de Berg et sa capitale Dusseldorf, autorisa la fréquentation des écoles chrétiennes aux enfants juifs, il intégra la Grundschule école primaire de la ville, puis, en 1807, la classe préparatoire du lycée de Dusseldorf, qui dispensait un enseignement dans l'esprit des secondes Lumières. Il fréquenta le lycée lui-même à partir de 1810, mais le quitta en 1814, sans certificat de fin de scolarité, pour suivre la tradition familiale et se préparer à un métier marchand, dans une école de commerce.
En 1811, Heine, âgé de 13 ans, assiste à l'entrée de Napoléon dans Dusseldorf. En 1806, le roi Maximilien Ier de Bavière avait cédé sa souveraineté sur le duché de Berg à l'Empereur des Français. Certaines biographies avancent l'hypothèse infondée, selon laquelle Heine aurait pu, pour cette raison, prétendre à la citoyenneté française. Contrairement aux assertions ultérieures de Heinrich von Treitschke, il ne le fit jamais. Son pays natal devint le grand-duché de Berg, gouverné par le beau-frère de Napoléon, Joachim Murat, de 1806 à 1808, puis par Napoléon lui-même jusqu'en 1813. État membre de la Confédération du Rhin, le grand-duché subissait une forte influence de la France. Durant toute sa vie, Heine admira l'Empereur pour l'introduction du Code civil, qui fit des juifs et des non-juifs des égaux aux yeux de la loi.
Salomon Heine 1767–1844 par Friedrich Carl Gröger; Jusqu'à sa mort, cet oncle fortuné apporta son soutien à son neveu.
En 1815 et 1816, Heine travailla, d'abord comme stagiaire chez le banquier francfortois Rindskoppf. C'est dans la Judengasse Juiverie de Francfort qu'il découvrit alors l'oppressante existence des Juifs dans les Ghettos, une vie qui lui était, jusqu'alors, restée étrangère. Heine et son père fréquentèrent à cette époque la loge franc-maçonnique francfortoise Zur aufgehenden Morgenröte ». Parmi les francs-maçons, ils connurent la reconnaissance sociale, qui, en tant que juifs, leur était souvent refusée. De nombreuses années plus tard, en 1844, à Paris, Heine devint membre de la loge Les Trinosophes.
En 1816, il entra dans la banque de son oncle Salomon Heine à Hambourg. Salomon, qui, contrairement à son frère Samson, avait vu prospérer ses affaires et était plusieurs fois millionnaire, prit en charge son neveu. Jusqu'à sa mort en 1844, il lui apporta un soutien financier, bien qu'il n'eût que peu de compréhension pour les penchants littéraires de celui-ci. Salomon disait à propos d'Heinrich : « S'il avait appris quelque chose d'utile, il n'aurait pas à écrire des livres. Au cours de sa scolarité au lycée, Harry Heine s'était déjà essayé à la poésie. Depuis 1815, il écrivait régulièrement. En 1817, pour la première fois, des poèmes de sa main furent publiés dans la revue Hamburgs Wächter.
Amalie Heine, une cousine d'Heinrich et son premier amour
Puisque Heine ne montrait ni goût ni talent pour les affaires d'argent, son oncle lui ouvrit un commerce de draps. Mais, dès 1819, Harry Heine & Comp. se trouva dans l'obligation de déposer le bilan. Son propriétaire préférait déjà se consacrer à la poésie. Les amours malheureuses de Heine avec sa cousine Amalie vinrent également troubler la paix familiale. Par la suite, il fit de cet amour non partagé le sujet de poèmes amoureux romantiques dans Le Livre des Chants. Dans le poème Affrontenburg, il décrivit l'atmosphère oppressante qui régnait dans la maison de son oncle, dans laquelle il se sentait de plus en plus indésirable.
Études à Bonn, Göttingen et Berlin
Vraisemblablement les dissensions au sein de la famille ont-elles enfin convaincu Salomon de faire cesser les pressions sur son neveu et de lui permettre de faire des études loin de Hambourg. En 1819, Heine entreprit des études de droit et de science camérale, bien qu'il n'eût que peu d'intérêt pour ces deux disciplines' il écrit dans ses Mémoires qu'il a "gaspillé trois des belles années de ma jeunesse" et qualifie le Corpus juris de "Bible de l'égoïsme"7. Il s'inscrivit tout d'abord à l'Université de Bonn, mais n'y suivit que quelques cours de droit.
August Wilhelm Schlegel
En revanche, durant le semestre d'hiver 1819/20, il assista aux cours d'August Wilhelm Schlegel sur « L'histoire de la langue et de la poésie allemande ». Le cofondateur du romantisme exerça une grande influence sur le jeune Heine, ce qui n'empêcha pas ce dernier de tenir des propos moqueurs sur Schlegel dans ses œuvres ultérieures. La même chose arriva à un autre de ses professeurs bonnois, Ernst Moritz Arndt, dont il prit, par la suite, les opinions nationalistes pour cibles dans plusieurs de ses poèmes et textes en prose. Durant cette période passée à Bonn, Heine traduisit en allemand des ouvrages du poète romantique anglais Lord Byron.
Durant le semestre d'hiver 1820, il fréquenta l'Université de Göttingen, qu'il dut cependant quitter, après quelques mois seulement, à la suite d'une affaire de duel : en raison du mépris dont les Juifs étaient l'objet dans la société allemande de l'époque, Heine avait tout fait pour dissimuler ses origines. Lorsqu'un autre étudiant l'insulta, du fait de sa judéité, il le provoqua en duel. L'Université le renvoya alors, en février 1821, ainsi que son adversaire, pour un semestre. Le même mois, il fut exclu de la Burschenschaft Société d'étudiant, pour cause d'atteinte à l'exigence de chasteté. À Bonn, en 1819, il avait adhéré à la communauté étudiante. En 1821, à Göttingen, il devint membre du Corps Guestphalia.
Quelques années plus tard, avec beaucoup de sarcasmes et d'ironie, il écrivit dans Le voyage dans le Harz, à propos de Göttingen :
En général, les habitants de Göttingen sont partagés en étudiants, en professeurs, en philistins et en bétail, quatre états entre lesquels les lignes de démarcation sont pourtant très marquées. Celui du bétail est le plus considérable. Rapporter ici les noms de tous les étudiants et de tous les professeurs ordinaires et extraordinaires serait trop long; d'ailleurs, je ne me rappelle pas en ce moment les noms de tous les étudiants, et parmi les professeurs il en est qui n'ont pas de nom du tout. La quantité de philistins de Göttingen doit être très grande, comme le sable, ou, pour mieux dire, comme la boue aux bords de la mer. En vérité, quand je les voyais, le matin, avec leurs figures sales et leurs blancs mémoires à payer, plantés devant la porte du sénat académique, je pouvais à peine comprendre comment Dieu avait pu créer tant de semblables canailles.
Heine partit pour l'Université de Berlin, où il étudia de 1821 à 1823 et où il suivit les cours de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Bientôt il se lia avec les cercles littéraires de la ville et devint un hôte régulier du salon d'Elise von Hohenhausen 1789-1857 ainsi que du second salon de Rahel Varnhagen. Rahel et son époux, Karl August Varnhagen von Ense, restèrent très proches de Heine et lui apportèrent leur soutien, en faisant l'éloge de ses premières œuvres et en lui apportant d'autres contacts, par exemple avec la sœur de Varnhagen, Rosa Maria Assing, dont il fréquenta le salon à Hambourg. Jusqu'à la mort de Heine, Varnhagen von Ense entretint avec lui une abondante correspondance épistolaire.
C'est durant sa période berlinoise que Heine débuta en tant qu'écrivain. Au début de l'année 1822, ses Poèmes parurent dans les librairies maçonniques, puis, en 1823, ses Tragédies avec un intermède lyrique aux éditions Dümmler. Heine avait d'abord accordé beaucoup d'importance à ses tragédies Almansor et William Ratcliff, elle n'eurent cependant aucun succès. La première d'Almansor, en 1823, à Brunswick, dut être interrompue, en raison des protestations du public. Ratcliff ne fut jamais joué de son vivant.
De 1822 à 1824, Heine se consacra, pour la première fois, de façon intensive, au judaïsme : à Berlin, il fut membre actif du Verein für Cultur und Wissenschaft der Juden Association pour la Culture et la Science des Juifs, il entra en relation avec Leopold Zunz, l'un des fondateurs de la « Science juive » et entreprit en 1824 l'écriture du roman Le Rabbin de Bacharach, resté inachevé.
Lors d'un voyage à Poznań, qu'il fit en 1822, il découvrit, pour la première fois, le judaïsme hassidique, qui le fascina, avec lequel il ne put pourtant pas s'identifier. Au printemps 1823, deux ans avant sa conversion au christianisme, il écrivit, dans une lettre à son ami Immanuel Wohlwill : « Je n'ai pas la force de porter une barbe, de me faire insulter de « Judemauschel », de jeûner, etc. »11 Après sa conversion, les thèmes relatifs au judaïsme passèrent certes au second plan, mais ils l'occupèrent cependant toute sa vie et revinrent avec plus de force au premier plan dans son œuvre tardive, par exemple dans les Mélodies hébraïques, le troisième livre de Romancero.
Doctorat, conversion et affaire Platen
En 1824, Heine retourna à Göttingen. En mai de l'année suivante, il passa ses examens et devint docteur en droit en juillet 1825. Cependant, son projet de s'installer comme avocat à Hambourg échoua encore à la fin de cette même année.
Pour augmenter ses chances de travailler en tant que juriste, Heine s'était fait baptiser selon le rite protestant, juste après son succès aux examens, en juin 1825, à Heiligenstadt et avait pris les prénoms de Christian Johann Heinrich. Désormais, il s'appela Heinrich Heine. Il tenta d'abord de tenir ce baptême secret : c'est ainsi qu'il n'eut pas lieu à l'église, mais dans la maison du pasteur, avec le parrain pour seul témoin. Alors tout à fait indifférent au fait religieux, il ne voyait, de toute façon, dans le certificat de baptême qu'un billet d'entrée vers la culture européenne. Il dut cependant constater que bien des porteurs de cette culture n'acceptaient pas un juif, même converti, comme faisant partie des leurs. Heine n'était cependant pas prêt à supporter les humiliations et les discriminations sans répliquer.
Ceci fut démontré de façon très claire par la dite affaire Plate : une dispute littéraire avec le poète August von Platen, auquel il était reproché sa manie orientalisante, dégénéra en affrontement personnel, au cours duquel Heine fut attaqué du fait de ses origines juives. Ainsi, dans la comédie Der romantische Ödipus parue en 1829, Platen le décrivait comme le « Pétrarque de la fête des cabanes. Il lui reprochait sa fierté des synagogues et écrivait : « […] mais je ne voudrais pas être sa petite chérie […] Car ses baisers sécrètent une odeur d'ail. Heine considéra ces propos comme faisant partie d'une campagne destinée à faire échouer sa candidature à une chaire de professeur à l'Université de Munich.
Lorsque, tout d'abord, les prêtres m'ont attaqué à Munich et s'en sont pris au juif dans Heine, je n'ai fait que rire : j'envisageais cette manœuvre comme une simple sottise. Mais, lorsque j'eus éventé le système, quand je vis le ridicule fantôme devenir peu à peu un vampire, quand je pénétrai l'intention de la satire de Platen, […] alors je ceignis mes reins, et je frappai aussi dru, aussi vite que possible.
Le coup porta, sous forme littéraire, dans la troisième partie des Tableaux de voyage : dans les Bains de Lucques, Heine critique les poèmes de Platen jugés stériles et attribue cela à l'homosexualité du comte, qu'il rend ainsi publique. Il le décrivait sous les traits d'un « ami chaleureux et écrivait que le comte était plus un homme de croupe qu'un homme de tête.
Le conflit porta gravement préjudice aux deux adversaires. Platen, socialement déconsidéré et menacé par une enquête policière, s'exila en Italie. Heine, pour sa part, ne rencontra que peu de compréhension et pas plus de soutien public pour son procédé. Jusqu'à un passé très récent, à cause de ses propos, des critiques lui reprochèrent constamment sa bassesse, sans évoquer les motifs et circonstances de l'affaire. D'autres, comme son contemporain, le critique littéraire Karl Herloßsohn, concédèrent en revanche à Heine qu'il n'avait fait que rendre à Platen la monnaie de sa pièce.
Heine vit dans les attaques antisémites de Platen, mais pas seulement, la raison pour laquelle le roi Louis Ier de Bavière ne lui accorda pas la chaire de professeur, qu'il pensait déjà assurée. C'est pour cette raison qu'il gratifia, par la suite, le monarque de toute une série de vers moqueurs, par exemple dans les Chants de louange du roi Louis :
« Voici Sire Louis de Bavière.
De semblable il y en a peu ;
Le peuple des Bavares honore en lui
Le roi devant qui l'on balbutie. »
Le baptême de Heine n'eut pas les conséquences espérées et il a, par la suite, à de multiples reprises, regretté explicitement sa conversion au christianisme.
«Je me repens beaucoup de m'être fait baptiser ; je ne vois nullement que, dès lors, les choses aient mieux tourné pour moi : au contraire, je n'ai eu, depuis, que malheur.
Presque toutes les biographies insistent sur le caractère significatif des origines juives de Heine pour sa vie et son œuvre. En particulier, le critique littéraire Marcel Reich-Ranicki est de l'avis que l'émigration de Heine vers la France est moins politique que, bien plus, motivée par son exclusion de la société allemande. En France, Heine était considéré comme allemand et donc comme un étranger, alors qu'en Allemagne il restait un juif et un pari.
Avec l'affaire Platen avait échoué la dernière tentative de Heine pour obtenir un emploi de juriste dans un État allemand. Il décida alors de gagner sa vie en tant qu'écrivain indépendant, ce qui était plutôt inhabituel pour l'époque.
Premiers succès littéraires
En 1816, durant son séjour hambourgeois, Heine publia ses premiers poèmes Un rêve, certes bien étrange, De roses, de cyprès dans la revue Hamburgs Wächter, sous le pseudonyme de Sy. Freudhold Riesenharf anagramme de « Harry Heine, Dusseldorff. En décembre 1821, il publia son premier recueil de poésie, Poèmes, à Berlin, sous le nom de H. Heine. En 1823 suivirent les Tragédies avec un intermède lyrique. Dans la tragédie Almansor, parue en 1821, Heine s'intéresse pour la première fois, de façon détaillée, à la culture islamique en Andalousie mauresque, qu'il a célébré, toujours et encore, et dont il a déploré la disparition, dans de nombreux poèmes. Dans Almansor apparaît son premier propos politique :
« Ce n’était qu’un début. Là où on brûle
des livres, on finit par brûler des hommes. »
Almansor
En 1824 parut le recueil Trente-trois poèmes, dans lequel on trouve le texte de Heine aujourd'hui le plus célèbre en Allemagne : La Loreley. La même année, lors d'un voyage dans le Harz, il se rendit à Weimar pour rencontrer Johann Wolfgang von Goethe, pour lequel il avait une grande admiration. Deux ans auparavant, il lui avait déjà envoyé son premier volume de poèmes, avec une dédicace. Cette visite se révéla cependant décevante pour Heine, car il se montra inhibé et gauche - tout à l'opposé de son naturel habituel - et Goethe le reçut avec politesse, mais resta distant.
Julius Campe, éditeur de Heine
En 1826, Heine publia le récit de voyage Voyage dans le Harz, qui fut son premier grand succès public. La même année, il entra en affaires avec l'éditeur hambourgeois Hoffmann und Campe. Jusqu'à la mort de Heine, Julius Campe devait rester son éditeur. En octobre 1827, il édita le recueil Le Livre des Chants, qui fit la renommée de Heine et est resté populaire jusqu'à nos jours. La tonalité romantique, souvent proche des chants populaires, de ces poèmes et d'autres encore, qui furent, entre autres, mis en musique par Robert Schumann dans son œuvre Dichterliebe Les amours du poète, toucha le public au-delà de son temps.
Mais Heine surmonta bientôt cette tonalité romantique. Pour la saper, il utilise l'ironie21 et use également des moyens stylistiques de la poésie romantique pour des vers à contenu politique. Lui-même se qualifiait de « romantique échappé. Voici un exemple de cette rupture ironique, dans lequel il se moque du rapport sentimentalo-romantique à la nature :
« La demoiselle au bord de la mer
Poussait de grands soupirs,
Elle était émue profondément
Par le coucher du soleil
Ne vous tourmentez pas, mademoiselle,
C'est une vieille chanson.
Il disparaît par devant
Pour réapparaître par derrière. »
Paris
Il était aux bains de mer, sur le rocher nu et rouge d'Héligoland, quand lui parvint la nouvelle des journées de juillet 1830 et du changement de régime à Paris. Patriote et libéral comme l'était alors la jeunesse universitaire allemande, victime de la politique de restauration qui lui avait fermé une porte après l'autre, se sentant à l'étroit dans le cadre provincial des cités dynastiques d'Allemagne, Heine regardait depuis longtemps vers Paris. C'était la capitale des lettres et de la liberté, la patrie d'élection des exilés, des révoltés et des prophètes. Après avoir, encore une fois, échoué dans une candidature à un emploi à Hambourg, Heine prend la route de Paris où il arrive au début de mai 1831 ; il devait y passer le reste de ses jours.
Plus facilement que dans aucune ville allemande d'alors, on pouvait mener à Paris la vie libre d'un homme de lettres. Ses bons mots, son esprit lui ouvrent les salles de rédaction, et il devient rapidement une figure des cafés littéraires. Sur les boulevards et dans les salons du monde de la finance, il passe pour « l'homme le plus spirituel de l'Europe moderne ». « Quoiqu'il y eût encore en sa parole un restant d'accent tudesque, les maîtresses de maison suppliaient leurs amis de l'amener », rapporte ce même témoin qui a parlé aussi de la griserie de Heine quand il s'est vu introduit dans le milieu romantique parisien. Théophile Gautier a été son ami le plus sûr, il a été lié durablement aussi avec Gérard de Nerval qui a traduit ses poèmes en français. Ses amis parisiens parlent de lui comme d'un demi-dieu moqueur et douloureux : « Beau comme la beauté, avec un nez un peu juif ; c'est, voyez-vous, Apollon mélangé de Méphistophélès », a dit Théophile Gautier ; et Philarète Chasles : « Quand ces yeux bleus germaniques riaient de concert avec cette bouche qui mordait, on découvrait l'amertume de tant de gaieté. » L'auteur des lieder touchants et troublants du Livre des chants est aussi celui d'âpres satires, et il devait chanter les grisettes du Palais-Royal après avoir adoré Lorelei. Ses contradictions, son rire sans gaieté, ses larmes qui se donnent pour feintes et ne le sont peut-être pas, ses indignations rares et bientôt oubliées, sa subtilité et sa susceptibilité ont toujours attiré et dérouté.
L'Allemagne et la France
Continuant madame de Staël, Heine compose bientôt, à l'usage des Français, une histoire de L'École romantique allemande et une autre de La Religion et la philosophie en Allemagne publiées en 1835 dans la Revue des deux mondes. La seconde étude donne une vue rapide mais pénétrante des croyances, des confessions, des philosophies, du Moyen Âge à Hegel, en passant par Luther et Spinoza. L'ouvrage s'achève sur des pages célèbres où Heine prophétise le réveil de l'Allemagne de 1830, encore rêveuse, et où il souligne l'importance européenne de la pensée de Hegel. L'événement est venu confirmer la prophétie du poète.
En même temps qu'il expliquait aux Parisiens les mystères de la Germanie, il faisait, pour le public des journaux allemands alors en plein essor, des tableaux de Paris. Ses correspondances pour la Augsburger allgemeine Zeitung font revivre avec vivacité le Parlement, la presse, le monde des arts et des théâtres sous la monarchie de Juillet ; elles furent rassemblées en plusieurs volumes : Les Peintres français (Die französischen Maler, 1830) ; De la France (Französische Zustände, 1839) ; Lutèce (Lutezia, 1854).
La poésie engagée a fait aussi son apparition dans la vie de Heine durant sa première période parisienne, celle de sa liaison puis de son mariage avec une jeune normande rencontrée dans une boutique du Palais-Royal, Mathilde Mirat, celle aussi des combats politiques et philosophiques dont ses poèmes porteront la trace.
Entre 1830 et 1848, les Allemands étaient nombreux à Paris où les ateliers attiraient des ouvriers et où les exilés politiques se rencontraient dans des associations que Heine a connues. Il y a retrouvé Ludwig Börne, qui venait de Francfort, et Karl Marx qui passa quelques mois à Paris en 1843-1844. Il a collaboré au Vorwärts, qui devait être, plus tard, un journal socialiste, et aux éphémères Annales franco-allemandes, où écrivait le jeune Marx.
Pourtant, un des grands poèmes satiriques de Heine, Atta-Troll, est une charge contre les poètes libéraux allemands de son temps, signe de la difficulté qu'il éprouve à aimer tous ceux qui auraient dû être de ses amis politiques. Son esprit de franc-tireur incapable de résister au plaisir de railler fleurit avec une verve plus heureuse dans l'Allemagne, conte d'hiver (Deutschland, ein Wintermärchen, 1844). Heine a laissé quelques belles pièces politiques, ainsi Les Tisserands de Silésie (Die Schlesischen Weber) pour lequel il a même repris une image qu'il avait trouvée dans le chant des « canuts » insurgés de Lyon en 1832. Poète de la liberté, Heine savait donner de la résonance aux grands mots populaires ; il disait de lui-même qu'il était « un bon tambour ».
Il se vantait volontiers aussi d'avoir marqué une date dans l'histoire de la poésie allemande en mettant fin à l'époque de l'art pour l'art, celle des classiques de Weimar ; il se voulait le premier poète « moderne » de langue allemande, divisé contre lui-même et tirant de son propre tourment une délectation subtile. Mais, au milieu de la vie parisienne, il entendait aussi le cor des postillons du Harz et le chant des filles du Rhin ; le premier, il a raconté à Richard Wagner l'histoire du Hollandais volant, qui devint Le Vaisseau fantôme, et celle de ce chevalier Tannhäuser, déchiré entre les maléfices de Vénus et la grandeur de sainte Elisabeth de Thuringe.
Nouveaux poèmes
Heine lui-même ne vit la mer pour la première fois que dans les années 1827 et 1828, durant ses voyages en Angleterre et en Italie. Il dépeignit ses impressions dans les Tableaux de voyage, qu'il publia entre 1826 et 1831. On y trouve le cycle Mer du Nord, ainsi que Les Bains de Lucques et Idées. Le Livre Le Grand, et enfin une profession de foi en faveur de Napoléon et des accomplissements de la Révolution française. La vénération de Heine pour Napoléon n'était cependant pas absolue. Il le formule dans les Tableaux de voyage : […] mon hommage ne vaut pas pour les actes, mais uniquement pour le génie de l'homme. Je ne l'aime inconditionnellement que jusqu'au jour du 18 Brumaire - il trahit alors la liberté.
Il se révèle commentateur spirituel et sarcastique, lorsqu'il écrit, par exemple, pendant son voyage à Gènes, en Italie : « Oui, il me semble parfois que le diable, la noblesse et les jésuites n'existent qu'aussi longtemps que l'on y croit »24 Une citation du même ouvrage montre combien l'humour de Heine pouvait être méchant : « Les Tyroliens sont beaux, enjoués, probes, honnêtes, et d'esprit borné au-delà de toute idée. C'est une race d'hommes saine, peut-être parce qu'ils sont trop sots pour pouvoir être malades. »
Heine s'entendait aussi à égratigner la censure, à laquelle étaient soumises toutes ses publications en Allemagne, comme en 1827, dans Le Livre Le Grand, avec le texte suivant, prétendument censuré :
Heine connut la censure à partir de novembre 1827, lorsqu'il devint rédacteur des Neue allgemeine politische Annalen à Munich. C'est, à peu près, à partir de cette époque que Heine fut peu à peu perçu comme un grand talent littéraire. À partir du début des années 1830, sa renommée s'étendit en Allemagne et en Europe.
Les années parisiennes
C'est lors d'un séjour de détente sur l'île d'Heligoland, durant l'été 1830, que Heine apprit le début de la Révolution de Juillet, qu'il salua dans ses Lettres de Helgoland - qui ne parurent qu'en 1840, en deuxième livre de son mémoire sur Ludwig Börne. Le 10 août 1830, il écrivait :
Moi aussi, je suis le fils de la révolution, et de nouveau je tends les mains vers les armes sacrées, sur lesquelles ma mère a prononcé les paroles magiques de sa bénédiction… Des fleurs ! Des fleurs ! je veux en couronner ma tête pour le combat. La lyre aussi, donnez-moi la lyre, pour que j'entonne un chant de guerre… Des paroles flamboyantes, qui en tombant incendient les palais et éclairent les cabanes…
De plus en plus attaqué - surtout en Prusse -, à cause de ses prises de position politiques, et exaspéré par la censure en Allemagne, il partit pour Paris en 1831. C'est ici le début de la seconde période de sa vie et de son œuvre. Durant toute sa vie, Heine devait avoir la nostalgie de l'Allemagne, comme l'atteste son poème A l'étranger :
« J'avais autrefois une belle patrie.
Le chêne
Y croissait si haut, les violettes opinaient doucement.
C'était un rêve.
Elle m'embrassait en allemand, et en allemand prononçait
(On imagine à peine comme cela sonne bien)
Les mots : "Je t'aime !"
C'était un rêve. »
Nouveaux poèmes
Il ne devait plus revoir sa patrie que deux fois encore, mais il resta en contact constant avec ses relations sur place. Son premier écrit à Paris fut le compte-rendu de l'exposition de peinture au Salon de Paris de 1831 pour la revue allemande Morgenblatt für gebildete Stände. Il y traite, entre autres, en détail, du tableau de Delacroix peint en 1830, La Liberté guidant le peuple.
À partir de 1832, Heine fut correspondant à Paris du journal augsbourgeois Allgemeine Zeitung, le quotidien en langue allemande le plus lu alors, créé par Johann Friedrich Cotta, l'incontournable éditeur des classiques de Weimar.
Johann Friedrich von Cotta
Pour ce journal, il rédigea une série d'articles, qui devaient paraître la même année sous la forme d'un livre, avec pour titre La Situation Française. Ces articles furent ressentis comme une bombe politique. Le journal de Cotta publiait certes les correspondances de façon anonyme, mais, pour tous ceux qui s'intéressaient à la politique, leur auteur ne faisait pas de doute. Autant les lecteurs étaient enthousiastes, autant les autorités étaient indignées de ces articles et exigeaient qu'ils soient censurés. En effet, à la suite de la révolution de juillet 1830 à Paris, l'opposition démocratique, nationale et libérale s'était formée en Allemagne et réclamait, avec toujours plus de force, des constitutions pour les états de la Confédération germanique. Le chancelier autrichien Metternich intervint auprès de Cotta, pour que la Allgemeine Zeitung arrête la série d'articles et ne publie plus le chapitre IX, écrit par Heine.
Son éditeur hambourgeois, Julius Campe, réédita cependant l'ensemble des articles de La Situation Française, en décembre 1832, non sans avoir, contre la volonté de Heine, remis le manuscrit à l'autorité de censure. Les autorités réagirent par des interdictions, des perquisitions, des saisies et des interrogatoires. C'était surtout la préface de Heine à l'édition allemande du livre qui provoquait leur mécontentement. Aussi Campe édita-t-il alors un tiré à part, qu'il dut cependant à nouveau mettre au pilon.
À la suite de cela, les ouvrages de Heine - présents et futurs - furent interdits, d'abord en Prusse, en 1833, puis dans tous les États membres de la Confédération germanique, en 1835, par décision Parlement de Francfort. Le même destin attendait les écrivains de la Jeune-Allemagne. Le Parlement expliquait sa décision en indiquant que les membres de ce groupe tentaient de s'attaquer à la religion chrétienne de la manière la plus impudente, de dégrader la situation actuelle et de détruire toute discipline et toute forme de moralité, sous couvert d'un style s'apparentant aux belles lettres et accessible à toutes les classes de lecteurs
De l'avis de nombreux historiens et spécialistes de la littérature, avec La Situation Française, Heine fonda le journalisme politique moderne. Avec cette série d'articles, Heine commence son historiographie du présent, un nouveau genre, dans lequel les journalistes et écrivains rendent compte de leur temps. Son style influence, encore aujourd'hui, les pages culturelles allemandes. De ce fait, elle reste un fait marquant de l'histoire de la littérature et de la presse allemandes. De surcroît, Heine prit, dès lors, le rôle d'un médiateur spirituel entre l'Allemagne et la France et il se plaça également pour la première fois dans un cadre général européen. En 2010, les éditions Hoffmann und Campe ont publié un fac-similé du manuscrit de La Situation Française, dont l'original passait jusqu'alors pour avoir disparu.
Après l'interdiction de ses œuvres en Allemagne, Paris devint définitivement le lieu d'exil de Heine. Durant ces années, apparurent les premiers symptômes de la maladie - crises de paralysie, migraines et problèmes de vue -, qui devaient le clouer au lit pendant les huit dernières années de sa vie. Mais, d'abord, il profita de la vie parisienne. Il entra en contact avec les grands noms de la culture européenne qui y vivaient, tels que Hector Berlioz, Ludwig Börne, Frédéric Chopin, George Sand, Alexandre Dumas et Alexander von Humboldt. Pendant un temps, il se rapprocha également des socialistes utopiques, comme Prosper Enfantin, un élève de Henri de Saint-Simon. L'espoir de Heine de trouver, dans le mouvement quasi-religieux de ses derniers, un nouvel évangile, un troisième testament, a contribué à sa décision de partir s'installer à Paris. Malgré sa fascination initiale, il se détourna bientôt des saint-simoniens, entre autres parce qu'ils attendaient de lui qu'il mette ses talents d'écrivain à leur service. En 1835, après que l'échec du mouvement fut devenu manifeste, Heine écrivit :
« Nous [les panthéistes] ne voulons ni sans-culottes, ni bourgeoisie frugale, ni présidents modestes; nous fondons une démocratie de dieux terrestres, égaux en béatitude et en sainteté. […]Les saint-simoniens ont compris et voulu quelque chose d'analogue; mais ils étaient placés sur un terrain défavorable, et le matérialisme qui les entourait les a écrasés, au moins pour quelque temps. On les a mieux appréciés en Allemagne.
Histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne
Paris inspira à Heine une abondance d'essais, d'articles politique, de polémiques, de mémorandums, poèmes et œuvres en prose. Alors qu'il cherchait à rapprocher les Allemands de la France et les Français de l'Allemagne, il mena à bien des analyses quasi prophétiques, par exemple en conclusion de Histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne. Heine écrivit ce texte en 1834, à l'adresse des Français, 99 ans avant la prise du pouvoir par ceux qui allaient brûler ses livres :
« Le christianisme a adouci jusqu'à un certain point cette brutale ardeur batailleuse des Germains, mais il n'a pu la détruire, et quand la croix, ce talisman qui l'enchaîne, viendra à se briser, alors débordera de nouveau la férocité des anciens combattants, l'exaltation frénétique des Berserkers que les poètes du Nord chantent encore aujourd'hui.
Alors, et ce jour, hélas, viendra, les vieilles divinités guerrières se lèveront de leurs tombeaux fabuleux, essuieront de leurs yeux la poussière séculaire; Thor se dressera avec son marteau gigantesque et démolira les cathédrales gothiques. [...] Ne riez pas à ces avertissements, quoiqu'ils viennent d'un rêveur qui vous invite à vous défier de kantistes, de fichtéens, de philosophes de la nature; ne riez pas du poète fantasque qui attend dans le monde des faits la même révolution qui s'est opérée dans le domaine de l'esprit. […]
La pensée précède l'action comme l'éclair le tonnerre. Le tonnerre en Allemagne est bien à la vérité allemand aussi : il n'est pas très leste, et vient en roulant un peu lentement ; mais il viendra, et quand vous entendrez un craquement comme jamais craquement ne s'est fait encore entendre dans l'histoire du monde, sachez que le tonnerre allemand aura enfin touché le but. À ce bruit, les aigles tomberont morts du haut des airs, et les lions, dans les déserts les plus reculés de l'Afrique, baisseront la queue et se glisseront dans leurs antres royaux. On exécutera en Allemagne un drame auprès duquel la révolution française ne sera qu'une innocente idylle. »
— De l'Allemagne, 1835 Histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne
Bien avant la plupart de ses contemporains, Heine prit conscience du caractère destructeur du nationalisme allemand, qui - à la différence de la France - s'éloignait de plus en plus des idées de démocratie et de souveraineté du peuple. Le poète y ressentait, plus exactement, une haine sous-jacente de tout ce qui était étranger, comme il l'écrivait dans le poème En deçà et au-delà du Rhin :
Nous autres Allemands, nous nous entendions mieux à la haine.
Elle sourd des profondeurs de l’âme,
la haine allemande ! Et pourtant elle se gonfle, géante,
et peu s’en faut qu’elle ne remplisse de ses poisons
le tonneau de Heidelberg
Poésies inédites
La controverse avec Ludwig Börne
L'École Romantique 1836, le roman inachevé Le Rabbin de Bacharach et le mémorandum Sur Ludwig Börne 1840 sont d'autres ouvrages importants de ces années-là.
Heine y réagit aux Lettres de Paris de son ancien ami, dans lesquelles ce dernier lui reproche d'avoir trahi les idéaux de la Révolution. De même que lors du conflit avec Platen, des animosités personnelles jouèrent un rôle dans son affrontement avec Ludwig Börne, qui fut, en son temps, plus célèbre que Heine. Les causes profondes étaient cependant de nature fondamentale et reposaient sur l'idée que le poète et l'artiste se faisait de lui-même en général.
L'ensemble de l'œuvre de Heine est marquée par ses efforts pour être un artiste au-dessus des partis. Il se voulait être un poète et journaliste libre, indépendant, et, sa vie durant, il ne se considéra jamais engagé dans aucun courant politique. Il se démarquait encore du publiciste, Ludwig Börne, républicain radical, d'une manière que Börne pouvait ressentir comme bienveillante : « Je suis une guillotine ordinaire et Börne une guillotine à vapeur. Mais quand il s'agissait d'art et de poésie, Heine accordait toujours un rang plus élevé à la qualité de l'œuvre qu'à l'intention ou à la manière de penser de l'artiste.
Börne voyait de l'opportunisme dans cette attitude. À de multiples reprises, il reprocha à Heine son manque d'opinion et il exigeait d'un poète qu'il se positionnât clairement dans le combat pour la liberté. Avec cette controverse pour savoir si, et à quel point, un écrivain peut être partial, Heine et Börne annoncent des polémiques à venir sur la morale politique en littérature, telles que celles qui, au XXe siècle ont opposé Heinrich et Thomas Mann, Gottfried Benn et Bertolt Brecht, Georg Lukács et Theodor W. Adorno, Jean-Paul Sartre et Claude Simon. C'est pourquoi Hans Magnus Enzensberger a tenu la dispute entre Heine et Börne pour la controverse la plus importante de l'histoire de la littérature allemande.
Le mémorandum ne parut qu'en 1840, trois ans après la mort de Börne, sous le titre équivoque, non autorisé par Heine, de Heinrich Heine sur Ludwig Börne. Même des lecteurs par ailleurs bien disposés à son égard en tinrent rigueur à Heine, ainsi que des railleries qu'il contenait, sur la relation triangulaire de Börne avec son amie Jeannette Wohl et l'époux de celle-ci, le marchand francfortois Salomon Strauss. Strauss, qui se sentit ridiculisé par cette publication, affirma par la suite qu'il avait giflé le poète en public, à cause de ses propos. Heine le provoqua alors en duel et fut légèrement blessé à la hanche, tandis que Strauss en sortit indemne.
Mariage, voyage en Allemagne et conflit successoral
Un peu avant le duel, Heine épousa, en 1841, à l'église St-Sulpice l'ancienne vendeuse de chaussures Augustine Crescence Mirat, qu'il appelait Mathilde et qu'il voulait savoir à l'abri du besoin, au cas où il viendrait à mourir. Le mariage eut lieu, selon son souhait à elle, selon le rite catholique. Toute sa vie durant, Heine lui a dissimulé ses origines juives.
En 1833, il avait fait la connaissance de la jeune fille, alors âgée de 18 ans, et vivait avec elle, vraisemblablement, depuis octobre 1834. Depuis 1830, Mathilde était ce que l'on appelait une grisette parisienne, c'est-à-dire une jeune ouvrière, non mariée, qui, selon les normes de l'époque, n'était pas respectable. Elle était séduisante, avait de grands yeux sombres, une chevelure brune, un visage rond et une silhouette très admirée. Reconnaissable entre toutes, sa « voix de fauvette » haut perchée lui donnait un air infantile, mais fascinait Heine. Il semble s'être épris de Mathilde très soudainement38. Bon nombre de ses amis, en revanche, parmi lesquels Marx et Engels, désapprouvaient cette liaison avec une femme simple et joviale. Mais Heine semble aussi l'avoir aimée pour ces raisons, car elle lui apportait l'exact opposé de son entourage intellectuel. Au début de leur relation, il avait essayé de rehausser un peu le niveau d'instruction de son amie, issue de la campagne. Grâce à lui, elle apprit à lire et à écrire. Il lui finança plusieurs séjours dans des institutions d'éducation pour jeunes femmes.
Leur vie commune connut des turbulences : à de violentes scènes de ménage, souvent provoquées par la prodigalité de Mathilde, succédaient les réconciliations. À côté d'affectueuses descriptions de sa femme, on trouve également chez Heine des vers pleins de méchanceté, comme ceux du poème Célimène:
« Tes lubies, tes perfidies,
Je les ai endurées en silence
D'autres à ma place
T'auraient depuis longtemps assommée.
Heine l'estimait, bien que Mathilde ne parlât pas allemand ou - plus exactement - parce qu'elle ne parlait pas l'allemand et, de ce fait, ne pouvait se faire une idée réelle de sa valeur en tant que poète. Ce propos de Mathilde nous est parvenu : Mon mari écrivait des poèmes à longueur de temps ; mais je ne crois pas que cela avait beaucoup de valeur, car il n'en était jamais content. Pour Heine, cette ignorance était justement le signe de ce que Mathilde l'aimait pour l'homme qu'il était et non en tant que poète éminent.
En 1843, Heine écrivit son poème Pensées nocturnes:
« Quand je pense à l’Allemagne dans la nuit,
C'en est fini de mon sommeil,
Je ne peux plus fermer l’œil,
Et mes larmes brûlantes s'écoulent.
Il finit par ces vers :
« Dieu merci ! par ma fenêtre se réfracte
La lumière du jour, française et joyeuse ;
Arrive ma femme, belle comme l'aube,
Et d'un sourire chasse les préoccupations allemandes.
Les préoccupations allemandes » de Heine ne concernaient pas seulement la situation politique outre-Rhin, mais aussi sa mère, désormais veuve et seule. C'est notamment pour la revoir et lui présenter son épouse, qu'il entreprit, en 1843 L'Allemagne. Un conte d'hiver et 1844 ses deux derniers voyages en l'Allemagne. À Hambourg, il rendit visite à son éditeur Campe et, pour la dernière fois, à son oncle et soutien de toujours, Salomon Heine. À la mort de Salomon, en décembre 1844, un conflit de succession éclata entre son fils Carl et son neveu Heinrich Heine, conflit qui allait durer plus de deux ans. Après la mort de son père, Carl cessa de payer la rente annuelle que Salomon avait accordée à son neveu en 1838, mais dont il n'avait pas prévu la poursuite dans ses dispositions testamentaires. Heinrich Heine, qui en éprouva de l'humiliation, usa également de sa plume au cours de ce conflit et fit ainsi publiquement pression sur son cousin. En février 1847, ce dernier finit par accepter la poursuite du paiement de la rente, à la condition que Heinrich Heine ne publiât plus d'écrits sur la famille sans son assentiment.
Le conflit trouva son origine dans le souci constant qu'avait Heine d'assurer sa situation financière et celle de son épouse. Par ailleurs, en tant qu'écrivain, son succès n'était pas qu'artistique, mais aussi économique : durant ses meilleures années parisiennes, il gagna jusqu'à 34700 francs par an, ce qui correspondrait aujourd'hui 2007 à plus de 200 000 euros. Il devait une partie de ce revenu à un apanage de l'État français, qui sera cependant supprimé après la Révolution de février 1848. Heine ressentit cependant toujours sa situation financière comme incertaine et, en public, la décrivait souvent plus mauvaise qu'elle ne l'était en vérité. Durant les années qui suivirent, il s'agit surtout, pour lui, d'assurer l'avenir matériel de sa femme.
Après la mort de Heine, Mathilde se révéla d'ailleurs particulièrement douée pour les affaires. C'est très favorablement qu'elle négocia avec Campe pour l'exploitation à venir des ouvrages de son époux. Elle lui survécut plus d'un quart de siècle et mourut en 1883. Leur union resta sans enfants.
Posté le : 13/12/2015 13:28
|
|
|
|
|
Heinrich Heine 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Heine et le socialisme
Du milieu des années 1840 datent les grandes épopées en vers de Heine Atta Troll et — nourri par son voyage en Allemagne de 1843 — Allemagne. Un Conte d'Hiver. Il y commentait, avec un mordant tout particulier, la situation de l'État, de l'Église et de la société en Allemagne. Il décrit ainsi, dans les vers d'introduction, une scène juste après le passage de la frontière, où une jeune fille chante un air pieux, sur une harpe, « avec de vrais sentiments et une fausse voix :
Elle chantait le chant du vieux renoncement,
Le tra-la-la du paradis
Avec lequel, quand il pleurniche, on assoupit
Le peuple, ce grand malappris.
J'en connais la mélodie, j'en connais les paroles,
Je connais même Messieurs les auteurs ;
Je sais, qu'en secret, ils buvaient du vin
Et prêchaient l'eau à leurs auditeurs.
Je veux vous composer, mes amis,
Un chant nouveau, ce qu'il y a de mieux !
Nous voulons déjà, ici-bas sur terre,
Fonder le royaume des cieux.
Nous voulons être heureux sur terre,
Et cesser d'être dans le besoin ;
Le ventre paresseux ne doit pas digérer
Le produit du dur labeur de nos mains.
Karl Marx
Dans ces vers résonnent des idées de Karl Marx. Il avait fait sa connaissance durant ces années-là, ainsi que celle du futur fondateur de la social-démocratie allemande, Ferdinand Lassalle. Par la suite, Heine collabora aux revues de Marx, le Vorwärts ! et les Deutsch-Französische Jahrbücher. Il publia ses nouveaux chants, en 1844, dans le recueil Nouveaux Poèmes, dans lequel le Conte d'hiver apparaissait également au départ.
Depuis le début des années 1840, le ton de Heine s'était considérablement radicalisé. Il fit partie des premiers poètes allemands qui prirent conscience des conséquences de la révolution industrielle en marche et soulevèrent dans leurs œuvres la question de la misère de la toute nouvelle classe ouvrière. Son poème Les Tisserands Silésiens, de juin 1844, est exemplaire à ce sujet. Il était inspiré de la révolte des tisserands, qui avait éclaté, le même mois, dans les villes silésiennes de Peterswaldau et Langenbielau.
« Les Tisserands Silésiens
L'œil sombre et sans larmes,
Devant le métier, ils montrent les dents ;
Allemagne, nous tissons ton linceul.
Nous le tissons d'une triple malédiction -
Nous tissons, nous tissons !
Maudit le dieu que nous avons prié
Dans la froideur de l'hiver, dans les jours de famine ;
Nous avons en vain attendu et espéré,
Il nous a moqués, bafoués, ridiculisés -
Nous tissons, nous tissons !
Maudit le roi, le roi des riches,
Que notre misère n'a pu fléchir,
Qui nous a arraché jusqu'au dernier sou
Et nous fait abattre comme des chiens -
Nous tissons, nous tissons !
Maudite l'hypocrite patrie,
Où seuls croissent l'ignominie et la honte,
Où chaque fleur s'affaisse bien tôt,
Et la pourriture, la putréfaction régalent la vermine -
Nous tissons, nous tissons !
La navette vole, le métier craque,
Nous tissons avec ardeur, et le jour, et la nuit -
Vieille Allemagne, nous tissons ton linceul,
Nous le tissons d'une triple malédiction,
Nous tissons, nous tissons !
Ce poème, également connu sous le nom de Chant des Tisserands parut le 10 juin 1844, sous le titre Les Pauvres Tisserands, dans le journal Vorwärts !, édité par Karl Marx, et, tiré à 50 000 exemplaires, il fut distribué, sous forme de tract, dans les régions où avait lieu la révolte. Le ministre de l'intérieur de Prusse, Adolf Heinrich von Arnim-Boitzenburg, décrivit ce texte, dans un rapport au roi Frédéric-Guillaume IV, comme « une harangue aux pauvres parmi le peuple, au ton séditieux et remplie de propos criminels. La Chambre Royale de justice de Prusse décréta l'interdiction du poème. En 1846, en Prusse, un récitant, qui avait, malgré tout, eu l'audace de dire ce poème en public, fut condamné à la prison. Friedrich Engels, qui avait fait la connaissance de Heine en août 1844, traduisit le Chant des Tisserands en anglais et le fit publier, en décembre de la même année, dans le journal The New Moral World.
Depuis le début de sa période parisienne, Heine entretenait des liens avec des représentants du saint-simonisme, l'un des premiers courants socialistes. Malgré ces contacts et ses relations amicales avec Marx et Engels, il eut cependant toujours une attitude ambivalente à l'égard de la philosophie marxiste. Heine reconnaissait la misère de la classe ouvrière naissante et soutenait ses revendications. En même temps, il craignait que le matérialisme et la radicalité des idées communistes ne détruisent beaucoup de ce qu'il aimait et admirait dans la culture européenne. Dans la préface de l'édition française de Lutèce, Heine écrivait, un an avant sa mort :
Cet aveu, que l'avenir appartient aux communistes, je le fis d'un ton d'appréhension et d'angoisse extrêmes, et hélas ! ce n'était nullement un masque ! En effet, ce n'est qu'avec horreur et effroi que je pense à l'époque où ces sombres iconoclastes parviendront à la domination : de leurs mains calleuses ils briseront sans merci toutes les statues de marbre de la beauté, si chères à mon cœur ; ils fracasseront toutes ces babioles et fanfreluches fantastiques de l'art, qu'aimait tant le poète ; ils détruiront mes bois de lauriers et y planteront des pommes de terre ; […] et hélas ! mon Livre des Chants servira à l'épicier pour en faire des cornets où il versera du café ou du tabac à priser pour les vieilles femmes de l'avenir. Hélas ! je prévois tout cela, et je suis saisi d'une indicible tristesse en pensant à la ruine dont le prolétariat vainqueur menace mes vers, qui périront avec tout l'ancien monde romantique. Et pourtant, je l'avoue avec franchise, ce même communisme, si hostile à tous mes intérêts et mes penchants, exerce sur mon âme un charme dont je ne puis me défendre ; deux voix s'élèvent en sa faveur dans ma poitrine, deux voix qui ne veulent pas se laisser imposer silence […]. Car la première de ces voix est celle de la logique. […] et si je ne puis réfuter cette prémisse : que les hommes ont tous le droit de manger, je suis forcé de me soumettre aussi à toutes ses conséquences […]. La seconde des deux voix impérieuses qui m'ensorcèlent est plus puissante et plus infernale encore que la première, car c'est celle de la haine, de la haine que je voue à un parti dont le communisme est le plus terrible antagoniste, et qui est pour cette raison notre ennemi commun. Je parle du parti des soi-disant représentants de la nationalité en Allemagne, de ces faux patriotes dont l'amour pour la patrie ne consiste qu'en une aversion idiote contre l'étranger et les peuples voisins, et qui déversent chaque jour leur fiel, notamment contre la France.
La révolution échouée
Proche du mouvement libéral constitutionnel, Heine suivit les événements de l'année 1848 en Europe avec des sentiments mélangés. Il était largement en accord avec la situation politique instaurée en France par la Révolution de juillet 1830. C'est pourquoi il n'avait aucun problème à accepter une rente de l'État français. De ce point de vue, il regarda la révolution parisienne de février et ses répercussions avec un scepticisme grandissant. Dans une lettre du 9 juillet 1848 à Julius Campe, par exemple, il qualifiait les événements d'anarchie universelle, embrouillamini mondial, folie divine devenue manifeste !
En revanche, en Allemagne, il fallait absolument créer un État national et avec une constitution démocratique. Cet objectif, que Heine soutenait, était alors également celui que poursuivaient les libéraux durant la Révolution de Mars dans les États de la Confédération germanique. Cependant, les défenseurs d'un régime républicain et démocratique restaient minoritaires, non seulement dans les parlements des différents États, mais également au Parlement de Francfort : déçu, Heine se détourna bientôt de l'évolution des événements en Allemagne. Dans la tentative du premier parlement élu en Allemagne de créer une monarchie impériale héréditaire, il ne vit que le rêve romantique, et politiquement impropre, de la résurrection du Saint-Empire romain germanique, disparu en 1806.
Dans le poème Michel après mars, il écrit :
« Lorsque le drapeau noir-rouge-or,
Le bric-à-brac de la vieille Allemagne,
Parut à nouveau, alors l'illusion chancela
Ainsi que la féerie suave des contes.
Je connaissais les couleurs de cette bannière
Et leur présage :
De la liberté allemande, elles m'apportaient
Les pires nouvelles.
Je voyais déjà le Arndt et le père Jahn
Ces héros d'un autre temps
S'extirper de leurs tombeaux
Et se battre pour l'Empereur.
Toute cette faune d'étudiants
Sortis de mes jeunes années
Qui s'enflammaient pour l'Empereur,
Lorsqu'ils étaient ivres.
Je voyais la gent grissonante à force de péchés
Des diplomates et des prêtres,
Les vieux chevaliers servants du droit romain,
S'affairant au temple de l'unité - (…)
Les couleurs noir-rouge-or étaient donc, aux yeux de Heine, un symbole tourné vers le passé, les couleurs des Burschenschaften allemandes, à qui il reprochait leur teutomanie et leur « patriotisme pompeux. À ceux qui critiquaient cette position, il avait déjà répondu en 1844, dans la préface de Allemagne. Un conte d'hiver : Plantez les couleurs noir-rouge-or au sommet de la pensée allemande, faites-en l'étendard de la liberté des hommes, et je verserai pour elle le meilleur sang de mon cœur. Tranquillisez-vous, j'aime la patrie, tout comme vous. La première phase de la révolution échoua lorsque le roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV refusa la couronne impériale, que lui proposait la majorité à l'assemblée nationale. En réaction, de nouveaux soulèvements démocratiques eurent lieu, à l'ouest et dans le sud-ouest de l'Allemagne. L'objectif était d'imposer aux princes la constitution de Francfort. Mais, entre l'été et l'automne, cette seconde vague révolutionnaire fut bientôt vaincue, en grande partie par les troupes prussiennes. Résigné, Heine commente les événements dans son poème En octobre 1849:
« Les vents violents se sont couchés
Et le calme revient au pays.
Germania, la grande enfant
se réjouit à nouveau de ses arbres de Noël.
(…)
Dans une douillette intimité se reposent le fleuve et la forêt,
baignés d'un doux clair de lune ;
Ne reste parfois qu'un bruit sec - Est-ce un coup de feu ? -
C'est un ami peut-être, que l'on fusille.
Le tombeau-matelas
En février 1848, alors que la révolution éclatait à Paris, Heine fit une grave crise. Presque totalement paralysé, il devra passer ses huit dernières années alité, dans ce qu'il appela lui-même son « matelas-tombeau ». Depuis 1845, une maladie neurologique le rongeait, s'aggravant de façon dramatique par crises successives. En 1846, il fut même déclaré mort. Des séjours dans des lieux de cure, à Barèges dans les Pyrénées en 1846 ou à la campagne près de Montmorency en 1847, par exemple, ne lui apportèrent aucun soulagement sensible. S'y ajoutèrent les désagréments occasionnés par le conflit de succession qu'il eut, des années durant, avec son cousin de Hambourg, Carl Heine, conflit qui ne sera réglé qu'en 1847. L'état de santé de Heine était alors déjà très dégradé.
Friedrich Engels rapportait, en janvier 1848, soit encore avant la crise décisive : Heine est au plus mal. Il y a quinze jours, je suis allé le voir, il était au lit et venait d'avoir une crise nerveuse. Hier, il était debout, mais faisait peine à voir. Il ne peut plus faire trois pas. En s'appuyant aux murs, il se glisse du fauteuil au lit, et vice versa. En plus de cela, le bruit dans sa maison, qui le rend fou.
Heine lui-même semblait convaincu d'être malade de la syphilis et certains se prononcent, encore aujourd'hui, en faveur au moins du caractère syphilitique de son mal. De nombreux biographes reprirent d'abord ce diagnostic, qui est pourtant, depuis peu, de plus en plus remis en question. Une étude plus poussée de tous les documents contemporains relatifs aux antécédents de Heine attribue plutôt les symptômes les plus importants à une maladie tuberculeuse, tandis qu'une analyse des cheveux du poète, effectuée en 1997, suggère un saturnisme chronique54,55. Une autre hypothèse circule, selon laquelle il aurait souffert de sclérose latérale amyotrophique ou de sclérose en plaques.
La puissance créatrice et intellectuelle de Heine ne faiblit pas durant les années passées dans son lit de douleur. Alors qu'il ne pouvait quasi plus écrire lui-même, il dictait le plus souvent ses vers et ses écrits à un secrétaire ou confiait à celui-ci la recopie des brouillons écrits de sa propre main. La relecture des manuscrits, dont il se chargera jusqu'à la fin, constituait pour Heine, presque aveugle, un tourment supplémentaire. Malgré ses conditions difficiles, il publia encore tout une série d'œuvres essentielles, au nombre desquelles le volume de poésie Romancero 1851, ainsi que Le Docteur Faust et, en 1854, trois volumes d'Écrits mêlés, qui comprenaient, entre autres, son testament politique Lutèce et Les poèmes. 1853 et 1854.
Dans le poème Enfant perdu tiré du Romancero, il tire le bilan de sa vie politique:
« Sentinelle perdue dans la guerre de la liberté,
J'ai tenu, fidèle, pendant trente années.
J'ai combattu sans espoir de vaincre.
Je savais que je ne rentrerais pas indemne.
[…]
Mais je tombe invaincu, et mes armes
Ne se sont pas brisées - Mon cœur seul s'est brisé.
Dans les années qui ont précédé sa mort, Heine développa une vision plus indulgente de la religion. Dans son testament du 13 novembre 1851 il déclare sa foi en un Dieu personnel, sans pour autant se rapprocher de l'une des Églises chrétiennes ou du judaïsme. Il s'y exprime ainsi :
Bien que, par mon acte de baptême, j'appartienne à la confession luthérienne, je ne souhaite pas que des représentants de cette Église soient invités à mon enterrement ; de même, je refuse que tout autre prêtre officie, lors de l'inhumation de mon corps. Ce souhait n'est pas une lubie de libre-penseur. Depuis quatre ans, j'ai renoncé à tout orgueil philosophique et suis revenu vers des idées et des sentiments religieux ; je meurs dans la croyance en un Dieu unique, le créateur éternel de ce monde, dont j'implore la miséricorde pour mon âme immortelle. Je regrette d'avoir parfois parlé de choses saintes sans le respect qui leur était dû, mais j'étais entraîné bien plus par l'esprit de mon époque que par mes propres penchants. Si j'ai, sans le savoir, offensé les bonnes mœurs et la morale, essence véritable de toutes les religions monothéistes, alors j'en demande pardon à Dieu et aux hommes.
Elise Krinitz,
Déjà en septembre 1851, il avait justifié, par sa longue maladie, sa foi renouvelée en un Dieu capable d'aider. Il comparait, en même temps, la conviction de l'immortalité de l'âme, qui accompagnait cette foi, avec un os à moelle que le boucher, content de son client, lui glisse dans le panier, en guise de cadeau. D'un tel os, on fait de délicieux bouillons, qui, pour un pauvre malade languissant, constituent un festin tout à fait bénéfique. Le texte s'achève finalement par le refus de toute religiosité organisée :
« Je dois pourtant démentir formellement la rumeur, selon laquelle mes pas en arrière m'auraient mené jusqu'au sein ou même au seuil de quelque Église que ce soit. Non, mes convictions et opinions religieuses sont restées libres de tout clergé ; aucun son de cloche ne m'a séduit, aucun cierge ne m'a ébloui. Je n'ai joué d'aucune symbolique et n'ai pas tout à fait renoncé à ma raison. Je n'ai rien abjuré, pas même mes vieilles divinités païennes, dont je m'étais certes détourné, mais ne m'en séparant qu'avec amour et amitié.
Postface de Romancero
Malgré sa souffrance, l'humour et la passion ne firent pas défaut à Heine. Les derniers mois de sa vie furent rendus plus supportables par les visites de son admiratrice Elise Krinitz, qu'il appelait tendrement Mouche, faisant référence à l'animal figurant sur le cachet de ses lettres. La jeune femme, âgée de 31 ans, étaient née en Allemagne et était venue à Paris avec ses parents adoptifs. Elle vivait en donnant des cours de piano et de langue allemande. Par la suite, elle deviendra écrivain sous le pseudonyme de Camille ou de Camille Selden. Heine fit d'elle sa fleur de lotus adorée et son gracieux chat musqué. Elise Krinitz aimait sincèrement cet homme moribond, quasi aveugle. Il avait été le poète favori de ses jeunes années. À cause de l'état de Heine, cette passion ne put pourtant s'épanouir que sur un plan purement intellectuel. Il commenta cela avec beaucoup d'auto-dérision dans les vers suivants :
« Des mots ! Des mots ! Pas de faits !
jamais de viande, poupée chérie.
L'esprit toujours et pas de rôti,
pas de boulettes dans la soupe
Sa capacité à plaisanter encore de la mort - ainsi que la pleine conscience qu'il avait de son rang au sein de la littérature allemande -, c'est ce que montre ce poème
:
« En mon sein sont morts
Tous les désirs vains de ce monde,
Quasi morte aussi en moi
La haine des méchants, et même le sens
De ma propre misère, comme de celle des autres -
En moi ne vit encore que la mort !
Le rideau tombe, la pièce est jouée,
Et maintenant, lassé, il rentre chez lui
Mon cher public allemand,
Les bonnes gens ne sont pas stupides,
Réjoui, il mange jusqu'à la nuit,
Et boit son verre, chante et rit -
Il a raison, le noble héros,
qui jadis disait, dans le livre d'Homère :
Le moindre philistin vivant
De Stuckert sur Neckar, est bien plus heureux
Que moi, le Pélide, le héros mort,
Le prince de l'ombre dans le monde souterrain.
Plaque commémorative Henri Heine au 3 avenue Matignon à Paris
Le 17 février 1856, Heinrich Heine mourut au 3 avenue Matignon à Paris dans l'ancien 1er arrondissement actuellement dans le 8e arrondissement. Trois jours plus tard, il fut enterré au cimetière de Montmartre. Selon ses dernières volontés, Mathilde, dont il avait fait sa légataire universelle, sera enterrée avec lui, après sa mort, 27 ans plus tard. Le tombeau, construit en 1901, a été décoré par un buste en marbre du sculpteur danois Louis Hasselriis et du poème Où ?.
Tombe de Heine à Paris et poème "Où ?"
« Le dernier repos de celui que le voyage
A fatigué, où sera-t-il ?
Sous les palmiers du sud ?
Sous les tilleuls du Rhin ?
Serai-je, quelque part dans le désert,
Enfoui par des mains étrangères ?
Ou reposerai-je sur les bords
D’une mer, dans le sable ?
Quoi qu’il en soit ! le ciel de Dieu
m’entourera, là-bas comme ici
Et en guise de veilleuses flotteront
La nuit au-dessus de moi les étoiles. »
Importance et héritage
En raison de son originalité autant que de son étendue, tant au niveau de la forme que du fond, l'œuvre de Heine ne peut être clairement classée dans aucun courant littéraire. Heine est issu du romantisme, mais il en a très vite dépassé la tonalité et la thématique - même en poésie. Son biographe Joseph A. Kruse voit dans son œuvre des éléments issus de l'Aufklärung les Lumières allemandes, du classicisme de Weimar, du réalisme et du symbolisme.
Il était surtout un auteur critique du Vormärz. Son aspiration au changement politique, à plus de démocratie dans toute l'Europe, et particulièrement en Allemagne, le rapproche des écrivains de la Jeune-Allemagne, au nombre desquels on le compte parfois. Qu'il puisse concevoir la démocratie dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle, comme celle du « Roi Citoyen », Louis-Philippe Ier, lui a valu la critique des républicains convaincus. Par contre, la prise de distance de Heine avec la littérature engagée, qu'il comparait à des « articles de journaux rimés »68 eut lieu bien moins pour des motifs politiques qu'esthétiques. Heine était proche de Karl Marx et de Friedrich Engels, sans pour autant partager tout à fait leur philosophie politique.
Heine divisait déjà ses contemporains, notamment parce que lui-même ne reculait pas devant des jugements clivants. Il attaquait ses adversaires, réels ou supposés, aussi durement qu'il était attaqué lui-même, et ne s'effrayait d'aucune polémique. Après sa mort, l'âpreté des débats à son égard s'accrut encore - et persista encore plus d'un siècle.
Le conflit de la mémoire
Symptomatique fut le conflit autour de l'édification d'un monument à la mémoire de Heine en Allemagne, qui fit dire à Kurt Tucholsky en 1929 : Dans ce pays, le nombre des monuments allemands élevés à des guerriers se rapporte au nombre des monuments allemands à Heine comme le pouvoir à l'esprit.
Depuis 1887, il existait des initiatives pour l'érection d'un monument en l'honneur du poète dans sa ville natale de Dusseldorf, afin de célébrer le prochain centenaire de sa naissance. Mais la perception de Heine par le public était alors de plus en plus influencée par des spécialistes littéraires aux arguments nationalistes et antisémites. Ainsi, dans son fameux essai publié en 1906 Heinrich Heine. Un monument aussi, Adolf Bartels dénonçait, après coup, les projets de monument de Dusseldorf comme une capitulation devant le judaïsme » et Heine lui-même comme Juif de la décadence. En 1893, face à de semblables attaques, le conseil municipal de Dusseldorf avait déjà retiré son approbation à l'érection du monument conçu par le sculpteur Ernst Herter. Cette représentation de la Loreley fut finalement acquise par des germano-américains pour le quartier du Bronx à New York. Aujourd'hui connue sous le nom de Lorelei fountain, elle se trouve à proximité du Yankee Stadium. À Dusseldorf, on apposa plus tard une plaque commémorative sur la maison natale de Heine, qui fut toutefois démontée et fondue en 1940.
Entreprise en 1931, une seconde tentative à Dusseldorf pour ériger un monument à Heine échoua deux ans plus tard, avec l'arrivée des nazis au pouvoir. La sculpture allégorique, déjà achevée, le Jeune homme montant fut exposée, sans référence explicite à Heine, d'abord dans un musée, puis, après-guerre, au Ehrenhof de Dusseldorf. Ce n'est que depuis 2002 qu'une inscription sur son socle désigne Heine. La ville natale de Heine n'a honoré le poète officiellement, avec l'érection d'un monument, qu'en 1981, soit près de 100 ans après les premières initiatives dans ce sens, et cela a, à nouveau, généré un conflit. La Heinrich-Heine-Gesellschaft souhaitait l'exécution d'un projet qu'Arno Breker avait déjà conçu pour le concours de 1931. Breker, admirateur de Heine, mais également l'un des sculpteurs officiels au temps du national-socialisme, avait réalisé une figure assise idéalisée, qui représente le poète sous les traits d'un jeune homme lisant. Le responsable du service culturel de Dusseldorf refusa cependant cette sculpture. Par la suite, elle fut exposée sur l'île Nordeney. C'est finalement le projet du sculpteur Bert Gerresheim qui a été réalisé, l'actuel monument à Heine sur le Schwanenmarkt de Dusseldorf.
Tout comme à Dusseldorf, l'érection d'un monument à Hambourg posa problème. L'impératrice Élisabeth d'Autriche, qui admirait Heine et avait soutenu la première initiative en faveur de l'érection d'un monument à Dusseldorf, voulut offrir à la ville hanséatique une statue en marbre représentant Heine assis, que le danois Louis Hasselriis - également créateur du buste ornant la tombe de Heine - avait exécutée en 1873. Cependant la ville refusa ce cadeau. L'impératrice fit alors exposer cette statue, en 1892, dans le parc de l'Achilléon, son château sur l'île de Corfou. En 1909, sur ordre de l'empereur allemand Guillaume II, qui, entre-temps, avait acquis le château, la statue fut retirée. L'empereur qui considérait Heine comme le pire saligaud de tous les poètes allemands, céda la statue à l'éditeur hambourgeois Heinrich Julius Campe, le fils de Julius Campe. Celui-ci voulut en faire cadeau, pour la seconde fois, au sénat de Hambourg. Mais elle fut à nouveau refusée, au motif de la prétendue attitude anti-patriotique de Heine. À cette occasion, un débat public avait également eu lieu, auquel Adolf Bartels prit part, avec une argumentation antisémite. Le monument fut enfin érigé sur la propriété de la maison d'édition Hoffmann und Campe dans la Mönckebergstraße. Il ne fut exposé publiquement à Altona qu'en 1927. Afin de le protéger de la destruction par les nazis, la fille de Campe le fit démonter en 1934 et, en 1939, elle le fit transporter dans sa résidence de Toulon, dans le sud de la France. Durant la période de l'occupation allemande, la statue fut cachée et ne trouva son emplacement définitif qu'en 1956, dans le jardin botanique de Toulon. Il y a quelques années, une initiative du comédien Christian Quadflieg pour ramener la sculpture à Hambourg fut conclue par un échec.
Ce n'est qu'en 1926 que Hambourg eut un monument dédié à Heine, lorsqu'une statue, réalisée en 1911 par le sculpteur Hugo Lederer, fut inaugurée dans parc municipal de Winterhuder70. Ce monument fut enlevé par les nazis, dès 1933, et fondu pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1982, une nouvelle statue de Heine, du sculpteur Waldemar Otto, se trouve sur le Rathausmarkt.
Le premier monument, sans doute, qui fut érigé en Allemagne, en l'honneur de Heine, fut le fruit d'une initiative privée : en 1893, la baronne Selma von der Heydt fit ériger, sur le Friedensaue à Küllenhahn aujourd'hui annexé à Wuppertal, une pyramide tronquée d'environ deux mètres de haut, dans laquelle étaient enchâssées trois plaques commémoratives. Un mât de drapeau qui en faisait partie avait déjà disparu en 1926, le reste fut détruit à l'époque nazie, par les jeunesses hitlériennes73. En 1958, la ville de Wuppertal inaugura un nouveau monument dans le Von-der-Heydt-Park. Le sculpteur Harald Schmahl utilisa trois blocs en calcaire coquillier, issus des ruines du Barmer Rathaus.
Le plus vieux monument à Heine encore existant se trouve à Francfort-sur-le-Main. Il s'agit également du premier érigé par les pouvoirs publics. En 1913, Georg Kolbe, qui allait également recevoir, 20 ans plus tard, la commande du monument à Heine pour le Ehrenhof de Dusseldorf, avait déjà réalisé, à la demande de la ville de Francfort, une sculpture allégorique représentant un jeune homme marchant. Durant la période nazie, cette œuvre fut cachée dans la cave du Städel-Museum sous le nom inoffensif de Chant du printemps. Il fut ainsi le seul monument allemand dédié à Heine qui survécut à la dictature hitlérienne et à la Seconde Guerre mondiale. Il est aujourd'hui, à nouveau, sur le Wallanlagen.
Bert Gerresheim, le créateur du monument de Dusseldorf, érigé en 1981, a également réalisé le buste de marbre de Heinrich Heine, inauguré le 28 juillet 2010 au Walhalla. Le cercle des amis de Heine de Dusseldorf s'y était employé dix années durant. En 2006, le gouvernement bavarois a approuvé l'entrée de Heine dans ce « panthéon », qu'il avait lui-même qualifié, de façon ironique, de cimetière pour crânes de marbre.
Réception controversée jusqu'après-guerre
Durant le Troisième Reich, les œuvres de Heine furent interdites et furent victimes des autodafés de 1933. Après-guerre, le germaniste Walter Arthur Berendsohn affirma que La Loreley de Heine était parue dans des manuels de la période nazie, avec la mention « poète : inconnu ». Theodor W. Adorno contribua à diffuser cette assertion, cependant cela n'a, encore aujourd'hui, pas été attesté.
Même après 1945, la réception de Heine et de son œuvre en Allemagne est restée encore longtemps ambivalente et l'objet de multiples conflits, auxquels contribua notamment la division de l'Allemagne. Alors que, dans la République fédérale d'Allemagne du temps d'Adenauer, Heine était plutôt reçu avec réserve, et tout au plus comme un poète romantique, la RDA se l'était approprié plutôt rapidement, conformément au concept d'« héritage culturel, et s'efforçait de populariser son œuvre. C'étaient, en fait, surtout Allemagne. Un conte d'hiver et ses liens avec Karl Marx qui étaient au centre de cet intérêt. Le premier congrès scientifique international consacré à Heine fut organisé à Weimar, en 1956, année de commémoration de sa mort. La même année parut, pour la première fois, l'édition de ses œuvres en cinq volumes dans la Bibliothek Deutscher Klassiker chez Aufbau-Verlag. Le germaniste est-allemand Hans Kaufmann livra, en 1967, la monographie de Heine, aujourd'hui encore la plus importante de l'après-guerre.
En 1956, à Dusseldorf, la Heinrich-Heine-Gesellschaft (de) fut certes fondée, à l'occasion du centième anniversaire de sa mort. Mais ce n'est que dans les années 1960 que l'intérêt pour Heine se fit également sentir en RFA. Dusseldorf, sa ville de naissance, s'imposa peu à peu comme le centre de la recherche ouest-allemande sur Heine. À partir des archives sur Heine se développa progressivement le Heinrich-Heine-Institut (de) avec des archives, une bibliothèque et un musée. Depuis 1962 paraît régulièrement le Heinrich-Heine-Jahrbuch, qui est devenu le forum international de la recherche sur Heine. Par ailleurs, depuis 1972, la ville de Dusseldorf décerne le Prix Heinrich Heine. Le débat autour de Heine persista cependant. Le projet de donner à l'Université de Dusseldorf le nom du plus important poète que la ville ait jamais donné, fut l'occasion d'un conflit de près de 20 ans. Ce n'est que depuis 1989 que l'université s'appelle Heinrich-Heine-Universität.
L'image de Heine aujourd'hui
Indépendamment des hommages officiels, l'écrivain politique Heinrich Heine connaît un regain d'intérêt auprès des jeunes chercheurs et des lecteurs politiquement engagés - phénomène accéléré par le mouvement étudiant de 1968. L'organisation en 1972 de deux congrès concurrents consacrés à Heine montre clairement que la RFA a rattrapé la RDA en matière de réception de l'œuvre de Heine. Autre conséquence de cette concurrence germano-allemande, les premiers volumes de deux éditions critiques et historiques de grande envergure paraissent de façon quasi simultanée : la Düsseldorfer Heine-Ausgabe et la Heine-Säkularausgabe à Weimar.
Dans les années 1980, le conflit autour de Heine, fortement idéologique, s'apaise sensiblement et tend à une certaine normalisation. La recherche se tourne vers des aspects jusqu'alors négligés, comme, par exemple, l'œuvre tardive de Heine. Son œuvre prend une place grandissante dans les programmes de lecture et d'enseignement des écoles et des universités, ce qui a conduit également à une augmentation significative de la littérature à vocation didactique sur Heine. La renaissance heinienne a atteint son apogée temporaire avec les nombreuses manifestations organisées en 1997, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance.
En dépit de débats idéologiques et scientifiques, la poésie de Heine, tout particulièrement, jouit d'une popularité intacte. Ses poèmes romantiques et souvent proche du style du Volkslied, les poèmes de Heine sont mis en musique voir ci-dessous - en premier lieu le Livre des Chants. Au théâtre, en revanche, les propres pièces de Heine sont peu présentes. Par contre, lors de l'année Heine, en 1997, Tankred Dorst a fait du poète l'objet d'une pièce : Harrys Kopf.
Réception par les écrivains et les journalistes
De nombreux écrivains du XIX et XXe se sont emparés de l'œuvre de Heine, parmi eux les grands romanciers Theodor Fontane et Thomas Mann. Comme Heine, Bertolt Brecht et Kurt Tucholsky ont osé l'équilibre délicat entre poésie et politique. Les lauréats du Prix Heine Wolf Biermann et Robert Gernhardt se situent également dans la tradition de Heine. En 1979, Biermann, par exemple, a dédié à son modèle le chant Au cimetière de Montmartre. Dans une diction typique de Heine, on peut y lire :
« Sous le marbre blanc gèlent
Dans l'exil ses ossements
Avec lui repose là madame Mathilde
Aussi n'y gèle-t-il pas seul. »
Gernhardt a également parodié, dans son recueil Klappaltar de 1997, le style de Heine et son poème Loreley, pour attirer l'attention sur l'absence de l'œuvre du poète dans les écoles allemandes jusqu'en plein xxe. Après le premier vers tiré de la Loreley Je ne sais ce que cela signifie, il énonce les préjugés que sa génération, influencée par Karl Kraus, a nourri à l'encontre de Heine, et ce depuis le tout jeune temps de l'école. Il conclut :
« Heine est nul, apparemment,
S'est dit alors l'élève.
C'est ce qu'avec son chant
Le professeur Kraus a fait. »
Le style de la prose de Heine imprègne le journalisme, en particulier les pages culturelles, encore aujourd'hui. Beaucoup de notions portant son empreinte sont entrées dans la langue allemande courante, telles que le mot Fiasko, emprunté au français, ou que la métaphore Vorschusslorbeeren éloges anticipés qu'il utilise dans son poème contre Platen.
Réception de Heine dans le monde
Si Heine a longtemps été rejeté en Allemagne à cause de ses origines juives, en Israël, il reste aujourd'hui controversé, pour s'être détourné du judaïsme. On a ainsi assisté à un débat à Tel Aviv entre juifs séculaires et orthodoxes à propos de la dénomination d'une rue en hommage à Heine. Alors que les uns voient en lui une figure majeure du judaïsme, les autres jugent sa conversion au christianisme impardonnable. C'est finalement une rue située isolée dans une zone industrielle qui a été baptisée de son nom, au lieu d'une rue à proximité de l'université, comme le proposaient les défenseurs de Heine. L'hebdomadaire de Tel Avivi Ha'ir a, à l'époque, ironisé sur l'exil de la rue Heine, dans lequel la vie du poète se reflétait symboliquement. Depuis d'autres rues portent le nom de Heine, à Jérusalem74 et Haifa. Une société Heine est également active en Israël.
La réception de Heine dans le reste du monde s'est passée, pour l'essentiel, sans heurt. Heine a été l'un des premiers auteurs allemands dont l'œuvre a pu être lue dans toutes les langues. Ainsi s'explique l'influence qu'il a exercé sur les autres littératures nationales. En plus de la France, en Angleterre, en Europe de l'Est et en Asie, il jouit d'une reconnaissance toute particulière.
Heine et la musique
Heinrich Heine ne jouait d'aucun instrument de musique et était également profane en matière de théorie de la musique. Mais, puisque, selon sa compréhension des choses artistiques, il n'y avait aucune frontière entre les différentes formes d'art, il commenta, en tant que journaliste - par exemple, dans le Augsburger Allgemeine Zeitung -, bon nombre de représentations et d'œuvres musicales de son époque, parmi lesquelles quelques-unes de renommée internationale composées par Giacomo Meyerbeer, Franz Liszt, Robert Schumann ou Richard Wagner.
Son intérêt pour la musique transparaît également dans sa poésie, par exemple dans le poème ironique De la téléologie :
« Des oreilles, Dieu nous en donna deux,
Pour écouter les chefs-d'œuvre
De Mozart, Gluck et Haydn -
S'il n'y avait eu que les coliques musicales
Et les sonorités hémorroïdales
Du grand Meyerbeer,
Une oreille déjà aurait suffi ! »
Malgré ses lacunes théoriques dans le domaine de la musique, beaucoup de compositeurs et interprètes de son temps accordaient de l'importance à son opinion, vraisemblablement parce qu'ils lui reconnaissaient, en tant que poète, une certaine compétence en matière musicale. Il serait cependant incorrect de considérer Heine comme un critique musical. Il était conscient des limites de ses compétences dans le domaine et écrivait toujours en tant que feuilletoniste, abordant la thématique d'une pièce de façon subjective et intuitive.
Plus importantes encore que les propos de Heine sur la musique sont les adaptations de beaucoup de ses œuvres par des compositeurs. La première date de 1825, avec la mise en musique par Carl Friedrich Curschmann du poème Gekommen ist der Maie Le mois de mai est arrivé.
Dans son ouvrage Heine in der Musik. Bibliographie der Heine-Vertonungen75, Günter Metzner établit la liste chronologique de toutes les adaptations musicales des poèmes de Heine. Pour l'année 1840, il répertorie 14 musiciens, qui ont composé 71 pièces à partir d'œuvres de Heine. Quatre ans plus tard, ce sont déjà plus de 50 compositeurs et 159 œuvres. La raison de cette augmentation rapide fût sans doute la publication du recueil Nouveaux poèmes chez Campe. Le nombre des mises en musique des œuvres de Heine atteignit son apogée presque 30 ans après la mort du poète, en 1884 - avec 1093 pièces par 538 musiciens et compositeurs. Jamais auparavant ni plus jamais après, un seul poète ne vit ses œuvres être à l'origine d'autant de compositions musicales en une seule année. Au total, la biographie de Metzner recense 6833 adaptations de Heine, parmi lesquelles celles de Franz Schubert, Robert et Clara Schumann, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn, Franz Liszt, Richard Wagner, Piotr Ilitch Tchaikovski, Alexander Borodin, Wendelin Weißheimer, Alma Mahler-Werfel et Charles Ives. Entre autres, le Liederkreis et le Dichterliebe de Schumann, ainsi que le Schwanengesang (D 957) de Franz Schubert appartiennent au répertoire régulier des salles de concert du monde entier. L'adaptation musicale de Heine la plus populaire en Allemagne est sans doute La Lorelei de Friedrich Silcher.
Comme Schumann, Richard Wagner, qui entretint, à Paris, des relations amicales avec Heine, adapta également le poème faisant l'apologie de Napoléon Les grenadiers, toutefois dans une traduction française. Un récit tiré de Dans les mémoires de monsieur von Schnabelewopski“ de Heine inspira Wagner pour son opéra Le Hollandais volant.
L'importance de Heine pour la création musicale perdura jusqu'à la Première Guerre mondiale. Par la suite, l'antisémitisme croissant fit considérablement retomber le « boom Heine, jusqu'à ce qu'il cesse tout à fait au temps du national-socialisme en Allemagne. En 1972, encore, la chanteuse de Schlager et de variété, Katja Ebstein fut très critiquée par les conservateurs, pour avoir sorti un album avec des chants de Heinrich Heine. Aujourd'hui, musiciens et compositeurs s'emparent à nouveau de l'œuvre de Heine, parmi eux également des compositeurs d'opéra comme Günter Bialas, dont l'opéra Aus der Matratzengruft a été donné pour la première fois en 1992.
Publications
Gedichte Poèmes, 1821.
Tragödien, nebst einem lyrischen Intermezzo, F. Dümmler, Berlin, 1823. contient William Ratcliff, Almansor et Lyrisches Intermezzo
Reisebilder Tableaux de voyage, Hoffmann und Campe, Hambourg, 1826-31.
Die Harzreise Le Voyage dans le Harz, 1826.
Ideen, das Buch le Grand Idées : le livre de Le Grand, 1827.
Englische Fragmente Fragments anglais, 1827.
Buch der Lieder, Hoffmann und Campe, Hambourg, 1827 Le Livre des chants, Éditions SDE, 2004.
Französische Zustände Particularités françaises, Heideloff und Campe, Leipzig, 1833.
Zur Geschichte der neueren schönen Literatur in Deutschland (De l'histoire de la nouvelle et belle littérature en Allemagne), Heideloff und Campe, Paris/Leipzig, 1833.
De l'Allemagne sur Gallica, essai de critique littéraire visant à faire connaître la culture allemande en France, d'abord paru en français sous ce titre en 1834 dans la Revue des Deux-Mondes 2° partie ici, avec article v. et en 1835 à la Librairie de Renduel (v. BnF catalogue; puis en Allemagne sous le titre Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland autres titres français: La religion et la philosophie en Allemagne, Histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne.
Die romantische Schule L'École romantique, Hoffmann und Campe, Hambourg, 1836.
Der Salon Le Salon, Hoffmann und Campe, Hambourg, 1836-40.
Le Rabbin de Bacharach, 1840.
Shakspeares Maedchen und Frauen, Brockhaus und Avenarius, Leipzig, 1839.
Über Ludwig Börne (À propos de Ludwig Börne, Hoffmann und Campe, Hambourg, 1840.
Neue Gedichte (Poèmes tardifs, Hoffmann und Campe, Hambourg,1846.
Deutschland. Ein Wintermärchen Allemagne - un conte d'Hiver, Hoffmann und Campe, Hambourg, 1844.
Atta Troll. Ein Sommernachtstraum Atta Troll - Rêve d'une nuit d'été, 1847
Romanzero, Hoffmann und Campe, Hambourg, 1851.
Der Doktor Faust Le Docteur Faust, Hoffmann und Campe, Hambourg, 1851.
Les Dieux en Exil, A. Lebègue, Bruxelles, 1853.
Lutezia, 1854.
Letzte Gedichte und Gedanken Dernières pensées et poèmes, 1869 - posthume.
Mémoires de Henri Heine traduction de J.Bourdea - posthume, Paris, Calmann-Lévy, 1884, 142 p.
‘‘Mémoires et Aveux éditions de Paris, Max Chaleil, 1887 - posthume.
Écrits juifs, Éditions du Sandre.
Lutèce, Lettres sur la vie politique, artistique et sociale de France, précédé d'une présentation de Patricia Baudouin,
Bibliographie
En français
Augustin Cabanès, Grands névropathes, t. 3, Paris, Albin Michel, 1935, « Henri Heine », p. 37-72.
Armand Colin, Heine le médiateur, Romantisme no 101, Paris, 2002,
Gerhard Höhn, Heinrich Heine : un intellectuel moderne. Paris, Presses universitaires de France, 1994; 190 pages. .
Marie-Ange Maillet, Heinrich Heine. Paris, Éditions Belin 2006 = Voix allemandes. Vol. 12, 223 pages, Euro 16,50
Camille Mauclair, La vie humilié de Henri Heine", Le roman des grandes existences, no 32, Éditions Plon 1930
Eugène de Mirecourt: Henri Heine, G. Havard Paris, 1856, 1 vol. (96 p.-1 f. de front.-1 dépl. autographe ; in-16, disponible sur Gallica
Michael Werner et Jan-Christoph Hauschild, Heinrich Heine, une biographie, trad. de Stéphane Pesnel
Norbert Waszek, "L'excursion panthéiste dans l'Histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne (1834/35 de Heinrich Heine". - In: Dieu et la nature. La question du panthéisme dans l'idéalisme allemand. Ed. par Christophe Bouton. Hildesheim, Olms, 2005 [Europaea Memoria, Bd. 40, p. 159-178.
Heine à Paris : témoin et critique de la vie culturelle française, sous la direction de Marie-Ange Maillet et Norbert Waszek. Paris, éditions de l'éclat, 2014.
En allemand
Dietmar Goltschnigg et Hartmut Steinecke dir., Heine und die Nachwelt. Geschichte seiner Wirkung in den deutschsprachigen Ländern, Berlin, Schmidt, 2006–2011
tome 1
tome 2
tome 3
(de) Jan-Christoph Hauschild et Michael Werner, Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst. Heinrich Heine. Eine Biographie, Cologne, Kiepenheuer & Witsch, 1997, nouvelle édition en 2005 chez Zweitausendeins,
(de) Ernst Pawel, Der Dichter stirbt. Heinrich Heines letzte Jahre in Paris, Berlin, Berlin Verlag, 1997
(de) Marcel Reich-Ranicki, Der Fall Heine, Stuttgart, DVA, 1997 et chez dtv, à Munich en 2000,
Filmographie
Dans son long métrage La Femme-Enfant 1980, l'écrivain et réalisatrice Raphaële Billetdoux rend hommage au poète juif allemand Heinrich Heine en abordant une de ses œuvres Die Harzreise Le Voyage dans le Harz, 1826.
Dans La Salamandre 1971 du réalisateur suisse Alain Tanner co-scénarisé avec John Berger, un texte de Heinrich Heine est lu de la 67e à la 68e minute: "[...] Une nouvelle génération se lèvera, engendrée dans des embrassements librement choisis, et non plus sur une couche de corvée et sous le contrôle de percepteurs du clergé [...]". Il est extrait du "Voyage de Munich à Gênes", 1828 (dans H. Heine, Riesebilder. Tableaux de voyage, nouvelle édition, Paris 1856, vol. 2, p. 104).  [img width=600]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Heinrich_Heine(IsidorPopper1843).jpg/220px-Heinrich_Heine(IsidorPopper1843).jpg[/img]     
Posté le : 13/12/2015 13:20
|
|
|
|
|
Re: Défi du 12 décembre 2015 |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
18/02/2015 13:39
De Dijon
Niveau : 39; EXP : 1
HP : 190 / 950
MP : 767 / 25999
|
Très chères Loréennes et Loréens,
En revenant non de Nantes ni de Tours, je reviens de mes concerts de Noël au cours desquels j'ai donné toute ma voix de basse. Quel bonheur de chanter des vieux Noëls du Moyen Age, de la Renaissance et de l'époque baroque. Des petites merveilles musicales!
J'étais d'ailleurs, un peu ambassadeur et me voici maintenant troubadour!
Que d'honneurs vraiment que je ne suis pas certain de mériter, mais j'aime cependant ces qualificatifs, je dois bien le reconnaître.
J'ai compris, je m'en vais consulter Morphée pour un poème que je vous chanterai peut être. Je pourrais bien le mette en musique. Et pourquoi pas!
Je pars réfléchir à quelque chose.
Comme je suis heureux de retrouver notre ami Serge.
Bises à toutes et à tous.
Amitiés de Dijon.
Posté le : 12/12/2015 23:42
|
|
|
|
|
Maximilien de Sully |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 13 décembre 1559 naît Maximilien de Béthune, duc de Sully
né à Rosny et mort à Villebon le 22 décembre 1641, pair de France, maréchal de France, prince souverain d'Henrichemont et de Boisbelle, baron puis marquis de Rosny, marquis de Nogent-le-Rotrou, comte de Muret et de Villebon, vicomte de Meaux, est un militaire protestant et un compagnon d'armes du roi Henri IV de France dont il devint l'un des principaux conseillers.
Ses grades militaires sont Maréchal de France, il participe aux conflits de Guerres de religion, guerre franco-savoyarde, ses faits d'armes sont la bataille de Coutras, la bataille d'Arques, la bataille d'Ivry, le siège d'Amiens, le siège de Charbonnières, le siège de Montmélianses distinctions sont Pair de France, ses autres fonctions sont surintendant des finances en 1598, grand maître de l'artillerie de France en 1599, grand voyer de France en 1599, gouverneur de la Bastille en 1602, surintendant des fortifications. Il appartient à la maison de Béthune, son père est François de Béthune, sa mère Charlotte Dauvet, il a pour épouse Anne de Courtenay, puis Rachel de Cochefilet, ses enfants sont Maximilien, François, Marguerite et Louise
En bref
L'une des figures les plus populaires de l'histoire française, Sully est devenu presque légendaire avec sa phrase sur le labourage et le paturage. Cadet d'une famille protestante, il prend part aux campagnes du jeune Henri IV, ce qui lui vaut une ascension politique rapide : directeur des Finances et surintendant général en 1596, grand maître de l'artillerie et des fortifications ainsi que grand voyer en 1599, surintendant des Bâtiments en 1604, gouverneur du Poitou, enfin duc et pair en 1606. L'historien doit nuancer une image trop classiquement univoque : souple plus qu'on ne l'a dit, capable d'entrer en négociations secrètes avec les Guise, Sully a été poussé au pouvoir par Gabrielle d'Estrées. Tallemant des Réaux, qui ne l'aime guère, assure que « jamais il n'y eut surintendant plus rébarbatif. Comme il est ladre et intéressé, sa politique financière manque de dynamisme. Il faut, cependant, mettre à son actif une stricte économie qui permet de réaliser, à partir de 1600, des excédents budgétaires notables. Les moyens utilisés sont très empiriques. La réduction réelle mais temporaire de la taille est compensée par une conversion de la dette, procédé classique, indispensable et efficace, mais mené sans ménagement aucun, surtout pour les petits rentiers. L'augmentation des recettes provient de celle des impôts indirects. Au-delà de ces mesures techniques, Sully est un terrien ne voyant de prospérité que par la terre : il encourage les réformes de l'agriculture et l'élevage du ver à soie préconisés par Olivier de Serres. Sully se méfie des innovations commerciales, mais facilite la circulation des marchandises par l'abolition de nombreux péages et la construction de ponts et de routes. Il est responsable, avec Paulet, de l'institution de l'impôt intitulé la paulette 1604 qui légalise progressivement l'hérédité des charges. Cet impôt constitue l'une des innombrables ressources extraordinaires dont Sully fait usage. Après l'assassinat de Henri IV, Sully fit partie du conseil de Régence jusqu'en 1616. Quoique directement visé par la création de la Chambre royale de 1617 et refusant d'abjurer le protestantisme, il s'abstient de participer aux révoltes des Rohan et utilise ses loisirs pour rédiger son autobiographie justificatrice, intitulée Mémoires des sages et royalles économies d'estat, domestiques, politiques et militaires de Henry le Grand. Il s'y attribue un rôle extraordinaire. Dans la réalité, Henri IV a toujours su équilibrer dans son entourage tous les courants importants, quitte à imposer sa volonté. Jean Meyer
Sa vie
Né le 13 décembre 1559 au château de Rosny-sur-Seine, il appartient à la branche cadette, peu fortunée et calviniste, d'une famille descendante des comtes souverains d'Artois, apparentée aux comtes de Flandres. Second fils de François de Béthune et de Charlotte Dauvet1, il devient l’héritier de la baronnie de Rosny à la mort de son frère aîné, Louis de Béthune, en 1578. En 1572, élève au collège de Bourgogne, à Paris, il échappe au massacre de la Saint-Barthélemy, et devient le compagnon du roi Henri III de Navarre, futur roi de France, qu'il suit dans toutes ses guerres. À ses côtés il se distingue par son intrépidité. En 1576, il combat dans les armées protestantes en Hollande pour récupérer la vicomté de Gand dont il n'avait pu hériter de son parrain, un catholique convaincu.
En 1583, au château de Bontin, le seigneur de Rosny épouse Anne de Courtenay, une riche héritière. Des spéculations commerciales très heureuses, comme le commerce des chevaux pour l'armée, voire les dépouilles des villes prises par les Protestants l’enrichissent en peu de temps. En 1580, il devient chambellan ordinaire, puis membre du Conseil de Navarre. Il est chargé de négocier avec Henri III de France, afin de poursuivre une lutte commune contre la Ligue des Guise. Mais le traité de Nemours en 1585 rapproche le roi de France des Guise aux dépens du roi de Navarre. En 1587 commence son compagnonnage avec le roi Henri de Navarre, il combat à côté d'Henri de Navarre à Coutras, puis devant Paris, ensuite à Arques en 1589, puis à Ivry en 1590 où il est blessé. Il est de nouveau blessé à Chartres en 1591. Devenu veuf, il épouse en 1592 Rachel de Cochefilet, fille de Jacques de Cochefilet seigneur de Vaucelas. Entretemps le roi Henri III de France a été assassiné.
Le ministre
En 1593, Sully conseille au nouveau roi de se convertir au catholicisme, afin de pacifier le royaume, mais refuse lui-même d’abjurer. Il négocie alors le ralliement de quelques chefs de la Ligue, marquis de Villars, duc de Guise. Lors du siège d'Amiens en 1597, il s'illustre à la tête de l’artillerie.
Henri IV comprend tardivement qu'il peut confier les finances du royaume à l'homme qui administre si bien ses propres affaires. Il le nomme en 1596 au Conseil des Finances puis, vers 1598, surintendant des finances. Sully remet alors de l'ordre dans les comptes, en créant en 1601, une Chambre de justice destinée à lutter contre les malversations financières.
Sully a de brillants conseillers, comme l'économiste Barthélemy de Laffemas, qui développe les manufactures, l'artisanat, et donne un coup de pouce à l'histoire de la soie par la plantation de millions de mûriers.
Il fait rentrer un arriéré fiscal considérable, paie des dettes écrasantes près de 30 millions de livres, suffit aux dépenses des guerres en Espagne et en Savoie, et à l'achat des places qui restent encore aux mains des chefs ligueurs. En 1598, il fait annuler tous les anoblissements décrétés depuis 20 ans. Il supprime les petits offices de finances et judiciaires. Il crée de grands approvisionnements de guerre, lutte contre l'abus et les prodigalités et amasse un trésor, 300 000 livres tournois par an, soit 4 millions d'euros actuels tout en diminuant les impôts. Il fait restituer au roi une partie du domaine royal qui avait été aliénée. L’arrivée en Europe des métaux précieux américains, depuis le début du siècle, a permis à Sully comme à ses prédécesseurs de bénéficier de rentrées fiscales, mais lui va équilibrer le budget et faire des économies. Il se fait nommer gouverneur de la Bastille en 1602, où il entrepose une partie du trésor royal qui s'élève à 12 millions de livres.
Aux environs du 25 août 1600, durant la guerre franco-savoyarde, le Roi Henri avait envoyé le duc de Sully visiter plusieurs citadelles qui étaient investies. Sully vint coucher à Bourg-en-Bresse où il fut bien accueilli par Biron. Le jour de son départ pour Lyon, Sully reçut un avis qu'un groupe de 200 hommes ennemis venaient d'arriver dans un château proche du lieu où il devait passer la nuit. Sully demanda à Biron de lui donner une escorte jusqu'à Lyon. Biron donna comme escorte ses propres gardes qui accompagnèrent Sully jusque Villars où l'escorte le quitta. Je fis recharger mes mulets et fis encore environ 4 lieues et ne m'arrêtai qu'à Vimy ou je me crus en sûreté. Le doute que j'avais, que Biron avait entrepris de me livrer au duc de Savoie, se changea alors en certitude. Trois heures après que je fut parti de Villars, les 200 hommes vinrent fondre sur la maison ou ils croyaient que j'étais, et parurent très fâchés d'avoir manqué leur coup.
Le 29 août, Sully est à pied d’œuvre lors du siège du château de Charbonnières en tant que grand maître de l'artillerie de France.
La paulette est instaurée en 1604, pour instituer l'hérédité des offices et augmenter les recettes de l'État.
En 1599, il est nommé Grand maître de l'artillerie de France et Grand voyer de France, il contrôle alors toutes les voies de communication. Les routes principales sont retracées, remblayées, pavées. En prévision des besoins en constructions et de la marine, il fait planter des ormes aux bords des routes les fameux ormes de Sully.
Il encourage surtout l'agriculture en répétant une phrase devenue célèbre : Labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée, les vraies mines et trésors du Pérou. Dans ce but, il proclame la liberté du commerce des grains, et abolit un grand nombre de péages qui sont autant de barrières entre les provinces, il ouvre de grandes voies de communication, et il fait creuser plusieurs canaux, notamment le canal de Briare qui relie la Seine à la Loire, commencé en 1604 et terminé en 1642.
Il va pousser les paysans à produire plus que nécessaire afin de vendre aux autres pays. Pour cela, il décide d'augmenter la surface cultivée en faisant assécher des marais. Afin de les protéger du fisc, il interdit la saisie des instruments de labour et accorde aux paysans une remise sur les arriérés de la taille. Il va aussi faire cesser la dévastation des forêts, étendre la culture de la vigne…
Comme surintendant des fortifications il fait établir un arsenal et fortifie les frontières. En 1606, il est nommé duc et pair de Sully et acquiert, la même année, le château de Montrond, le rénove entièrement pour en faire la plus forte place du Berry.
La mise à l'écart
Mémoires, édition originale de 1639
Il était devenu impopulaire, même parmi les protestants, et auprès des paysans qu'il avait dû accabler d'impôts pour faire face aux dépenses en vue de la guerre contre l'Espagne
Après l'assassinat d'Henri IV en 1610, il est nommé membre du Conseil de régence et prépare le budget de 1611. En complet désaccord avec la régente Marie de Médicis, il démissionne de ses charges de surintendant des finances et de gouverneur de la Bastille 1611 ; il conserve cependant le gouvernement du Poitou. En 1616, il abandonne la majeure partie de ces fonctions et vivra désormais loin de la cour, d'abord sur ses terres de Sully puis surtout en Quercy, tantôt à Figeac et plus précisément à Capdenac-le-Haut tantôt sur sa seigneurie de Montricoux, à quelques lieues de Montauban. Il se consacre à la rédaction de ses mémoires, mais reste très actif sur le plan politique et religieux. Son fils François de Béthune, comte d'Orval est le gouverneur de Figeac, place de sûreté calviniste.
Ce dernier épouse Jacqueline de Caumont, fille du marquis de la Force, qui commande la défense militaire de Montauban en 1621.
Cette même année, il est intervenu en conciliateur et a intercédé en modérateur dans les luttes entre les protestants français et la royauté, après les 96 jours du siège de Montauban par Louis XIII, en 1627-1628, lors du siège de La Rochelle et avant la reddition de Montauban. Proche du réseau diplomatique de Richelieu, il a été nommé maréchal de France en 1634.
Il décède au château de Villebon Eure-et-Loir le 22 décembre 1641. Son tombeau est à Nogent-le-Rotrou7.
Alliances et descendance
Maximilien de Béthune se marie deux fois :
en 1583, avec Anne de Courtenay 1564-1589, à l'église Saint-Eustache de Paris dont :
Maximilien II de Béthune, qui continue la lignée ;
en 1592, avec Rachel de Cochefilet, veuve du seigneur de Châteauperse 1562-1659, dont :
François de Béthune, duc d'Orval ;
Marguerite qui épouse Henri II de Rohan, et postérité ;
Louise qui épouse Alexandre de Lévis Mirepoix, maréchal de la Foi.
Sources manuscrites
Les papiers personnels de Maximilien de Béthune sont conservés aux Archives nationales sous la cote 120AP.
Sources imprimées
Les Œconomies royales de Sully, éditées par David Buisseret et Bernard Barbiche, tome I 1572-1594, tome II 1595-1599, Paris, Librairie C. Klincksieck, 1970-1988. Consultable sur Google Livres
Travaux historiques
Bernard Barbiche et Ségolène de Dainville-Barbiche, Sully, l'homme et ses fidèles, Paris, Fayard, 1997.
Isabelle Aristide, La fortune de Sully, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, collection Histoire économique et financière de la France, 1990.
Laurent Avezou, Sully à travers l'histoire. Les avatars d'un mythe, École des Chartes, collection « Mémoires et documents de l'École des Chartes, 2001.
Laurent Avezou, Du retour aux sources à la nostalgie du bon vieux temps. Sully dans les arts de Louis XVI à Louis-Philippe, in Bibliothèque de l'école des chartes, no 163-1, 2005, p. 51-78.
Collectif, Sully tel qu'en lui-même. Journée d'études tenue à Sully-sur-Loire le 23 octobre 1999, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, collection « Histoire économique et financière de la France , 2004.
Germán A. de la Reza, La invención de la paz. De la República cristiana del duque de Sully a la Sociedad de naciones de Simón Bolívar, Siglo XXI Editores, México, 2009 170 p..
Divers
Hôtel de Sully
Maison de Béthune
Château de Sully-sur-Loire
Principauté souveraine de Boisbelle
Henrichemont
Sully a sa statue parmi les Hommes illustres Louvre
Chronologies
Maximilien de Béthune duc de Sully Précédé par Suivi par Nicolas de Harlay sieur de Sancy Surintendant des finances, Guillaume de L'Aubespine, Pierre Jeannin, Jacques-Auguste de Thou création du poste
Ministre Principal d'Henri IV 1589-1610
      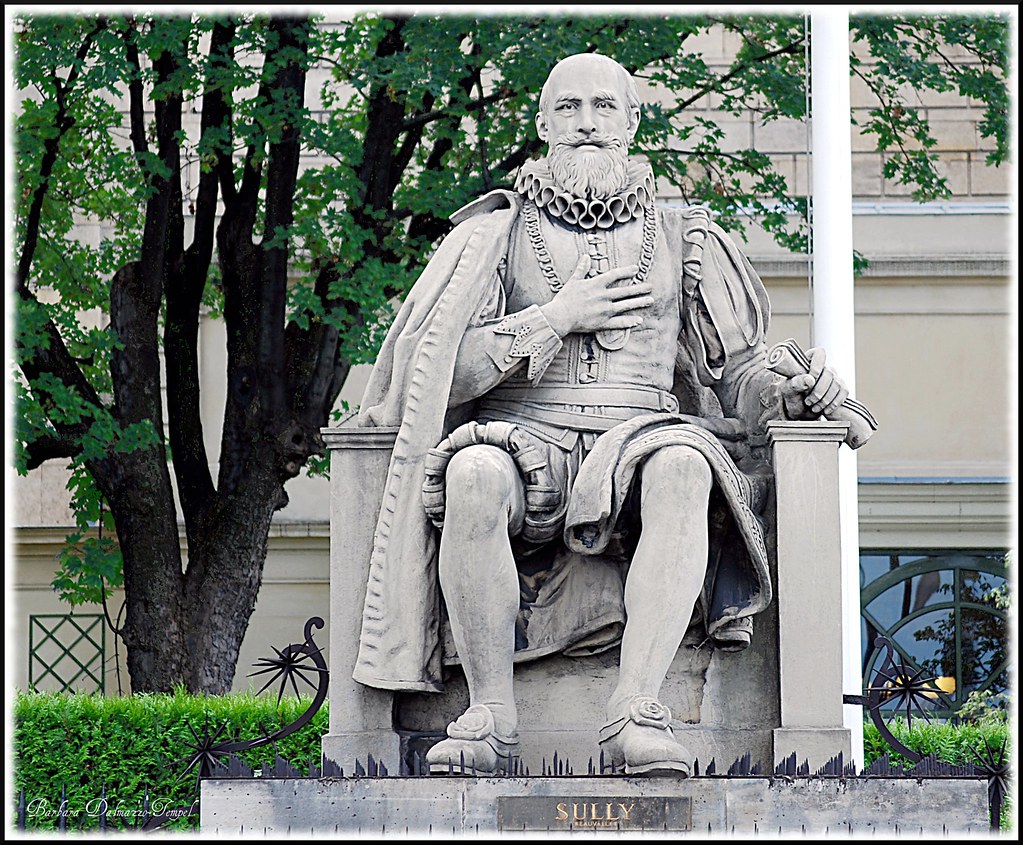 
Posté le : 12/12/2015 21:22
Edité par Loriane sur 13-12-2015 19:11:20
|
|
|
|
|
Re: Défi du 12 décembre 2015 |
|
Modérateur  
Inscrit:
21/03/2013 20:08
De Belgique
Niveau : 44; EXP : 15
HP : 215 / 1078
MP : 1072 / 35550
|
Mon Donald,
Je ne suis pas restée de pierre face à ce coeur de Pyrex. Ton texte est enflammé. Cette Maria semblait pourtant celle de toujours mais en effet, il est parfois compliqué de rester en feu sans se consumer et mourir à petit feu.
Merci pour ce joli défi.
Je m'en vais cogiter dans mon sommeil et je vous dis "adieu"... non à demain !
Couscous
Posté le : 12/12/2015 20:17
|
|
|
|
|
Re: Défi du 12 décembre 2015 |
|
Modérateur  
Inscrit:
21/03/2013 20:08
De Belgique
Niveau : 44; EXP : 15
HP : 215 / 1078
MP : 1072 / 35550
|
Mon Titi est de retour !
Tu connais bien les femmes, je constate...
L'idée est bonne d'user la femme d'un autre.
Je reçois avec joie tes embrassades.
Bises
Couscous
Posté le : 12/12/2015 20:12
|
|
|
|
|
Henri IV 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 13 décembre 1553 à Pau naît Henri IV
surnommé Henri le Grand, né Henri de Bourbon et assassiné le 14 mai 1610 à Paris, roi de Navarre Henri III de Navarre, 1572-1610 puis roi de France et de Navarre 1589-1610, premier souverain de la branche dite de Bourbon de la dynastie capétienne.
Il était le fils de Jeanne III, de son nom patronymique Jeanne d'Albret, reine de Navarre, et d'Antoine de Bourbon, chef de la maison de Bourbon, descendant du roi Louis IX et premier prince du sang. En vertu de la loi salique cette filiation fera d'Henri le successeur naturel du roi de France à la mort de François, duc d'Anjou frère et héritier du roi Henri III, en 1584.
Roi de France du 2 août 1589 au 14 mai 1610 soit 20 ans 9 mois et 12 jours. Le Couronnement a lieu le 27 février 1594, en la cathédrale de Chartres son premier ministre est Maximilien de Béthune. Son prédécesseur est Henri III. son successeur Louis XIII. Il est Roi de Navarre sous le titre Henri III du 9 juin 1572 au 14 mai 1610 durant donc 37 ans 11 mois et 5 jours. Son prédécesseur est Jeanne III, son successeur est Louis XIII. Il appartient à la maison de Bourbon. Son père est Antoine de Bourbon, duc de Vendôme et sa mère est Jeanne III de Navarre. Il épouse Marguerite de Valois de 1572 à 1599, puis Marie de Médicis de 1600 à 1610. Ses Enfantsspnt Louis XIII, Élisabeth de France, Christine de France, Monsieur d’Orléans, Gaston de France, Henriette de France, Héritier Charles de Bourbon 1589-1590, Henri de Bourbon-Condé
dr1590-1601, Louis de France de 1601 à 1610. Il a sa résidence au Palais du Louvre
Confronté aux guerres de religion, il y fut d'abord impliqué en tant que prince du sang et chef protestant avant d'accéder au trône de France baptisé catholique à sa naissance, il changea plusieurs fois de religion avant son accession au trône. Pour être accepté comme roi de France, il se reconvertit à sa religion d'origine, le catholicisme, et signa l'Édit de Nantes, traité de paix tolérant dans certaines limites le culte protestant, qui mit fin à deux décennies de guerres de religion. Alors qu'il préparait une guerre contre l'Espagne, il fut assassiné le 14 mai 1610 par un fanatique charentais, François Ravaillac, rue de la Ferronnerie à Paris.
En bref
Nul roi ne fut, de son vivant, plus passionnément discuté. Nul non plus ne fut, mort, plus pleuré, adulé. Nul crime politique n'a tant « choqué » les contemporains que l'assassinat du 14 mai 1610. Personnalité complexe, Henri IV est entré dans l'histoire française comme le symbole d'un monarque idéal, tel que pouvait le rêver l'opinion française de 1789 ; de même, il a servi de porte-drapeau à la Restauration.
En fait, ce Gascon était capable des pires coups de tête. Sceptique, indulgent, politique sachant pardonner, chef de guerre avisé payant de sa personne, il est, tout autant, l'autoritaire né. Peu porté à croire aux hommes, il s'est tourné passionnément vers les femmes, qu'il a aimées au point de leur donner, par moments, barre sur sa politique. Il serait aisé de multiplier ces contradictions. Suivre le destin de l'homme, le confronter à l'atmosphère générale d'une France en pleine crise, dont la moins grave n'est pas celle des mentalités : telle est la double nécessité qui, d'emblée, s'impose. Plus que l'atavisme, plus que les doctrines, ce sont les circonstances qui ont forgé le monarque. Et cependant, l'étonnant personnage qu'il s'est, en partie et très complaisamment, forgé lui-même domine une génération troublée. La conquête du royaume De l'adolescent au chef de parti : Né à Pau en 1553, il tient de son père Antoine de Bourbon (1518-1562) sa versatilité. Les trois conversions du roi ont été précédées par celles de son père, d'abord passé au protestantisme, puis retourné en 1560 au catholicisme. Mais il est surtout marqué par sa mère, Jeanne d'Albret, huguenote énergique et souveraine efficace d'une Navarre défendue contre vents et marées. Dès 1568, elle emmène l'adolescent de quinze ans participer au siège de La Rochelle, puis, en 1570, à la défense de la Navarre, pour le conduire enfin, le 18 août 1572, à ce mariage manqué d'avance avec Marguerite de Valois. Orphelin de père depuis 1562, sa mère morte peu de jours avant son mariage, Henri IV se retrouve sans famille. Il finira par faire annuler en 1599 ce mariage raté, et la raison d'État, ici financière, lui fera épouser l'année suivante l'acariâtre Marie de Médicis. Son premier mariage eut, du moins, l'avantage de le sauver de la Saint-Barthélémy, au prix, il est vrai, d'une première abjuration et d'une longue captivité dorée à la cour, dont il réussit à s'échapper au bout de quatre ans, en 1576. Il se retrouvait à vingt-trois ans chef du parti protestant écrasé par l'événement de 1572, quand, en juin 1584, mourut le duc d'Alençon. Henri IV devenait l'héritier virtuel du trône de France. La guerre civile rebondit. Par-delà les épisodes de ce soubresaut suprême, la décennie 1584-1594 marque l'apogée d'une Ligue hostile à tout roi protestant. Le chef de guerre eut beau prouver son efficacité, battre le duc de Joyeuse à Coutras (1587), s'allier aux protestants allemands ou anglais, la Ligue, aidée par l'Espagne et la Savoie, bloquait l'accès d'un trône au demeurant chancelant. D'où le rapprochement avec Henri III qui, sur son lit de mort, le désignait comme seul héritier légitime 1er août 1589. Le roi en quête de capitale : Face à l'homme de trente-six ans mûri sur les champs de bataille, la France se dresse divisée en trois partis : le protestant, le catholique, le « mal content ». Il fallait, dans une première étape, souder catholiques et « mal-contents », transformer ces derniers en catholiques loyaux, amalgamer ces éléments hétérogènes en une armée cohérente. Les grands qui, presque par hasard, le soutenaient, n'entendaient pas jouer perdant. Une aisance personnelle déconcertante, un panache militaire éclatant, une prise directe sur les hommes lui permirent de réussir. Au surplus, la déclaration de Saint-Ouen lui avait rallié quelques évêques, dont celui de Nantes et l'archevêque de Bourges. Politique partielle qui devait, pensait le « roi titulaire », se décider par la prise de la capitale. Il tenta trois fois l'aventure : deux sièges (1589, 1590) soldés par un double échec, mal compensé par les brillantes victoires remportées sur le duc de Mayenne à Arques (23 sept. 1589) et à Ivry (14 févr. 1590). La décision militaire se révélant impossible, il fallait laisser jouer les divisions du parti adverse, attendre le moment propice. La manœuvre fut double. D'une part, le roi gagna progressivement le monde parlementaire et la haute bourgeoisie parisienne, épouvantés par les excès de la Ligue. D'autre part, le roi abjura le 25 juillet 1593 à Saint-Denis, pour se faire sacrer à Chartres le 27 juin 1594. Il pouvait, de ce fait, entrer enfin à Paris le 22 mars 1594.
On a longuement épilogué sur cette conversion. Qui ne connaît la phrase fameuse : « Paris vaut bien une messe » ? Il serait vain de méconnaître le caractère politique de l'opération, recommandée par Sully, lui-même protestant convaincu. Il serait tout autant hasardeux de ne pas croire à la sincérité du roi. Quoi qu'il en soit, la reddition de Paris, si elle ne signifia pas la fin de la guerre, marquait cependant le début du règne effectif. Le « roi de droit et fort peu de fait, monarque d'un double parti jaloux l'un de l'autre » devenait le roi tout court. La fin de la guerre étrangère : La situation demeurait trouble. Toute une partie de l'opinion catholique ne désarmait pas. Le 27 décembre 1594, Jean Châtel manquait tuer le roi. L'absolution pontificale de Clément VIII (17 sept. 1595) contribua à apaiser les consciences. Le calme ne fut, cependant, jamais général. Les paysans, victimes des exactions militaires et accablés de charges, se révoltaient (Croquants du Limousin, du Périgord, du Languedoc, etc.). Les Espagnols, installés en Bretagne et dans le Nord, restaient menaçants. Combiner la négociation avec l'achat des « consciences », pardonner sans illusions, séduire toujours ne suffisait pas. La victoire de Fontaine-Française (5 juin 1595), l'expulsion par le maréchal d'Aumont des Espagnols hors de la presqu'île de Roscanvel et, enfin, l'épuisement complet des deux adversaires en présence, décidèrent de la paix. Le 2 mai 1598, le traité de Vervins confirmait la paix de Cateau-Cambrésis. Une expédition militaire eut raison de la dernière résistance du duc de Mercœur en Bretagne, et la chevauchée royale s'acheva par l'acte hautement politique de l'édit de Nantes, signé le 13 avril 1598 dans l'ancien château des ducs. Le règne effectif La remise en ordre : La reprise en main du royaume devait, nécessairement, s'appuyer sur un certain nombre de forces politiques. Apparemment, trois groupes coexistèrent : le parti protestant, le groupe des catholiques royalistes, celui des catholiques ligueurs ralliés à temps, composé des parlementaires parisiens et des puissances « féodales », princes et grands nobles redoutables par leurs clientèles. Il existait entre ces groupes un consensus politique (l'urgence de la paix et de la reprise des affaires) et un support social commun (propriétaires seigneuriaux et acquéreurs d'offices). Enfin, la bourgeoisie d'affaires se retrouvait à la fois dans le camp protestant, catholique et parlementaire. Les divergences de détail restaient innombrables, les oppositions fondamentales profondes. Mais, momentanément, le dénominateur commun de la paix intérieure incarnée en Henri IV, ressenti comme une nécessité étatique par tous ceux qui étaient sensibles au « bien public », allait dans le sens de l'action royale. Le gouvernement de Henri IV représente donc une coalition de riches, regroupant provisoirement tous les détenteurs de grandes fortunes, ce qui explique la présence d'un entourage des plus composites. On y trouve le fidèle Sully, entré en 1596 au Conseil des finances (en droit seulement en 1601), grand voyer et grand maître de l'artillerie en 1599. Il n'occupe pas encore la première place au Conseil. À ses côtés, l'autre personnage protestant de marque est Barthélemy de Laffemas qui, dès 1596, exposait ses vues mercantilistes à l'assemblée des notables de Rouen. Face aux protestants, Villeroy, rallié de 1594, est chargé des affaires étrangères. Il est secondé par le président Jeannin, négociateur du traité de Vervins. Ainsi s'établit un premier équilibre de forces, les catholiques détenant le gage capital de la direction de la politique extérieure, qu'ils infléchissent souvent dans un sens pro-espagnol. L'économie et les finances reviennent aux protestants. Le personnage de premier plan est Pomponne de Bellièvre. Chancelier en 1599, l'ancien conseiller du Sénat de Savoie est devenu, pour un temps, une sorte de Premier ministre, marquant l'accord avec les Parlements.
À l'hétérogénéité de cet entourage politique correspond celui de la cour. Le mariage florentin, acte non seulement financier, mais aussi d'engagement politique catholique, a renforcé le groupe italien déjà solidement implanté depuis Catherine de Médicis. Pourtant le raffinement de l'ancienne cour des Valois est singulièrement compromis par l'arrivée en force des anciens chefs de guerre, bretteurs, querelleurs, avides au jeu. Henri IV s'entoure d'un sérail mêlé, où dominent les Gabrielle d'Estrées, Jacqueline de Bueil, Charlotte des Essarts, la marquise de Verneuil, toutes sensibles aux intrigues politiques. Cohabitant, sans trop de difficultés, avec ces aimables pécheresses, la cohorte des réformateurs religieux, tribu fort bien traitée, tente, non sans succès, d'influencer le roi. Parmi eux, la figure exceptionnelle d'un François de Sales ou d'un Bérulle annonce le « renouveau » de l'Église de France.
Il est difficile de qualifier cette politique. Elle est faite de pardons, de générosités calculées au plus juste, d'achats de consciences, tragi-comédie qu'interrompt parfois un indispensable coup de force du maître. La finesse narquoise du prince excelle à ces jeux subtils qui, cependant, l'impatientent de plus en plus. Partout « l'œuvre » progresse.
Au-dehors, Lyon, deuxième ville du royaume, restait très exposée. De plus, l'une des grandes voies royales de l'empire espagnol, conduisant de Milan aux Flandres par l'intermédiaire de la Franche-Comté, longeait la France. Une promenade militaire, amplement justifiée par la non-restitution du marquisat de Saluces et les incessantes intrigues savoyardes, aboutit au traité de Lyon (1601). La Bresse, le Bugey, le Valromey et le pays de Gex parurent aux contemporains une médiocre compensation à l'abandon du marquisat de Saluces. Mais Lyon était désormais mieux protégée, et la route espagnole occidentale coupée.
À l'intérieur, Sully procédait aux trop classiques mesures de rétablissement des finances : annulation des lettres de noblesse accordées entre 1578 et 1598, économies, ventes d'offices, mais aussi diminution progressive des tailles (1598-1609), entérinée par le règlement de 1604. En même temps, il réussissait à reconstituer l'intégrité du domaine royal, plus ou moins démantelé aux époques précédentes. L'essentiel du règne se trouve cependant ailleurs. Les gouverneurs de province, dont les guerres de la Ligue avaient révélé le danger, voient se restreindre leurs prérogatives. Doublés par des lieutenants généraux, quelques-uns regimbent. En 1602, il fallut exécuter le maréchal de Biron, gouverneur de Bourgogne, puis, plus tard, ramener à raison le duc de Bouillon : l'un était catholique, l'autre protestant. La grande nouveauté est la systématisation du procédé d'envoi de commissaires départis, ancêtres des intendants. La monarchie centralisatrice s'installe. jean Meyer
Sa vie
Henri IV naît dans la nuit du 12 au 13 décembre 1553 à Pau, alors capitale de la vicomté souveraine de Béarn, dans le château de son grand-père maternel le roi de Navarre. Henri d’Albret désirait depuis longtemps que sa fille unique lui donnât un héritier mâle. Selon la tradition rapportée par les chroniqueurs Jean-Baptiste Legrain, André Favyn, Henri, aussitôt né, est donc remis entre les mains de son grand-père qui l'emmène dans sa chambre, lui frotte les lèvres avec une gousse d'ail et lui fait respirer une coupe de vin, sans doute de Jurançon, où le roi de Navarre possédait une vigne achetée en 1553. Ce baptême béarnais est une pratique courante avec les nouveau-nés, dans le but de prévenir les maladies et ce type de bénédiction persiste les siècles suivants pour les baptêmes des enfants de la maison de France. Henri d’Albret lui offre une carapace de tortue, qu'on montre encore dans une pièce du château de Pau qu'une tradition incertaine donne pour être la chambre d'Henri IV qui faisait partie de l’appartement de Jeanne d'Albret. Suivant l'usage de la couronne de Navarre, il reçoit en tant que fils aîné le titre de prince de Viane.
Le futur Henri IV est baptisé dans la religion catholique quelques semaines après sa naissance, le 6 mars 1554, dans la chapelle du château de Pau, par le cardinal d'Armagnac. Ses parrains sont le roi de France Henri II et Henri II de Navarre d'où le choix du prénom Henri , ses marraines sont la reine de France Catherine de Médicis et Isabeau d'Albret, sa tante, veuve du comte de Rohan. Pendant la cérémonie, le roi de France Henri II est représenté par le cardinal de Vendôme, frère d'Antoine de Bourbon.
Henri passe une partie de sa petite enfance dans la campagne de son pays au château de Coarraze. Il fréquente les paysans au cours de ses parties de chasse, et acquiert le surnom de meunier de Barbaste. Fidèle à l'esprit du calvinisme, sa mère Jeanne d'Albret prend soin de l'instruire dans cette stricte morale, selon les préceptes de la Réforme.
À l'avènement de Charles IX en 1561, son père Antoine de Bourbon l'amène vivre à la cour de France. Il y côtoie le roi et les princes de la maison royale qui sont de son âge. Ses parents s'opposent sur le choix de sa religion, sa mère désirant l'instruire dans le calvinisme, et son père dans le catholicisme.
Durant la première guerre de religion, Henri est placé par sécurité à Montargis sous la protection de Renée de France. Après la guerre et le décès de son père, il est retenu à la cour comme garant de l'entente entre la monarchie et la reine de Navarre. Jeanne d'Albret obtient de Catherine de Médicis le contrôle de son éducation et sa nomination comme gouverneur de Guyenne 1563.
De 1564 à 1566, il accompagne la famille royale durant son grand tour de France et retrouve à cette occasion sa mère qu'il n'avait pas revue depuis deux ans. En 1567, Jeanne d'Albret le fait revenir vivre auprès d'elle dans le Béarn.
En 1568, Henri participe à titre d'observateur à sa première campagne militaire en Navarre. Il poursuit ensuite son apprentissage militaire durant la troisième guerre de religion. Sous la tutelle de l'amiral de Coligny, il assiste aux batailles de Jarnac, de La Roche l'Abeille et de Moncontour. Il combat pour la toute première fois en 1570, lors de la bataille d'Arnay-le-Duc.
Roi de Navarre À la cour de France
En 1572, succédant à sa mère Jeanne d'Albret, Henri de Navarre devient roi de Navarre sous le nom de Henri III. Le 18 août 1572, il est marié à Paris à la sœur du roi Charles IX, Marguerite de Valois davantage connue à partir du XIXe siècle sous le sobriquet romancé de reine Margot Ce mariage auquel s'était opposée Jeanne d'Albret dans un premier temps, a été arrangé pour favoriser la réconciliation entre catholiques et protestants. Comme Marguerite de Valois, étant catholique, ne peut se marier que devant un prêtre, et que Henri ne peut entrer dans une église, leur mariage fut célébré sur le parvis de Notre-Dame. C'était d'ailleurs coutume au Moyen Âge que le mariage fût célébré devant le porche de l'église. S'ensuivent plusieurs jours de fête.
Cependant, dans un climat très tendu à Paris, et à la suite d'un attentat contre Gaspard de Coligny, le mariage est suivi quelques jours plus tard du massacre de la Saint-Barthélemy. Épargné par les tueries du fait de son statut de prince du sang, Henri est contraint quelques semaines plus tard de se convertir au catholicisme. Assigné à résidence à la cour de France, il se lie politiquement avec le frère du roi François d'Alençon et participe au siège de La Rochelle 1573.
Après sa participation aux complots des Malcontents, il est retenu prisonnier avec le duc d'Alençon au donjon de Vincennes Avril 1574. La clémence du roi lui fait éviter la peine de mort mais il reste retenu à la cour. À l'avènement de Henri III, il reçoit à Lyon un nouveau pardon du roi et participe à la cérémonie de son sacre à Reims.
La cour de Nérac
Après avoir passé plus de trois ans comme otage à la cour, il profite des troubles de la cinquième guerre de religion pour s'enfuir, le 5 février 1576. Ayant rejoint ses partisans, il renoue sans éclat avec le protestantisme, en abjurant le catholicisme le 13 juin. Il soutient naturellement la cause des Malcontents association de catholiques et de protestants modérés contre le gouvernement, mais animé d’un esprit modéré, il ne s’entend pas avec son cousin le prince de Condé qui, d’un tempérament opposé, se bat avec zèle pour le triomphe de la foi protestante. Henri de Navarre entend ménager la cour de France et s'assurer en Guyenne la fonction de gouverneur représentant administratif et militaire du roi. En 1577, il participe timidement à la sixième guerre de religion menée par son cousin.
Henri est désormais confronté à la méfiance des protestants qui lui reprochent son manque de sincérité religieuse. Il se tient à l’écart du Béarn qui est fermement tenu par les calvinistes. Henri est plus encore confronté à l’hostilité des catholiques. En décembre 1576, il manque de mourir dans un piège organisé dans la cité d’Eauze ; Bordeaux, pourtant capitale de son gouvernement, refuse même de lui ouvrir ses portes30. Henri s’installe alors le long de la Garonne à Lectoure et à Agen qui a l’avantage d’être situé non loin de son château de Nérac. Sa cour est composée de gentilshommes appartenant aux deux religions. Ses conseillers sont essentiellement protestants, tels Duplessis-Mornay et Jean de Lacvivier.
D’octobre 1578 à mai 1579, la reine mère Catherine de Médicis lui rend visite pour achever la pacification du royaume. Espérant le maintenir plus facilement en obéissance, elle lui ramène son épouse Marguerite.
Pendant plusieurs mois, le couple Navarre mène grand train au château de Nérac. La cour s’amuse notamment en parties de chasse, de jeux et de danses, ce dont se plaignent amèrement les pasteurs. Sous l’influence de l’idéal platonique imposé par la reine, une atmosphère de galanterie règne sur la cour qui attire également un grand nombre de lettrés comme Montaigne et Du Bartas. Henri se laisse aller lui-même aux plaisirs de la séduction — il s'éprend tour à tour de deux filles de la reine : Mlle Rebours et Françoise de Montmorency-Fosseux.
Henri participe ensuite à la septième guerre de religion relancée par ses coreligionnaires. La prise de Cahors, en mai 1580, où il réussit à éviter pillage et massacre malgré cinq jours de combats de rue, lui vaut un grand prestige à la fois pour son courage et son humanité.
Henri de Navarre entretient entre 1582 et 1590 une relation avec la catholique Diane d'Andoins à laquelle il promet le mariage et qui le soutient financièrement, la seule de ses maîtresses à être associée à ses affaires : elle semble avoir joué le rôle tant de conseillère politique que de confidente36. Les aventures féminines du roi créent la discorde au sein du couple qui n'a toujours pas d'enfants et provoquent le départ de Marguerite pour Paris. Le coup d'éclat de Marguerite à Agen 1585 consommera leur rupture définitive.
Héritier du trône de France
En 1584, le frère cadet du roi de France, François d'Anjou, meurt sans héritier. N'en ayant pas lui-même, le roi Henri III envisage de confirmer Henri de Navarre comme son héritier légitime. Il lui envoie le duc d'Épernon pour l'inviter à se convertir et à revenir à la cour. Mais quelques mois plus tard, contraint par les Guise de signer le traité de Nemours, il lui déclare la guerre et met hors la loi tous les protestants. La rumeur dit qu'en une nuit, la moitié de la moustache du futur Henri IV blanchit.
Commence alors un conflit où Henri de Navarre affronte à plusieurs occasions le duc de Mayenne. Relaps, Henri est de nouveau excommunié par le pape, puis il doit affronter l'armée royale qu'il bat à la bataille de Coutras en 1587.
Plusieurs revirements apparaissent en 1588. La mort du prince Henri de Condé le place clairement à la tête des protestants. L'élimination violente du duc de Guise l'amène à se réconcilier avec Henri III. Les deux rois se retrouvent tous les deux au château de Plessis-lèz-Tours et signent un traité le 30 avril 1589. Alliés contre la Ligue qui contrôle Paris et la plus grande partie du royaume de France, ils parviennent à mettre le siège devant Paris en juillet. Le 1er août 1589, avant de mourir le lendemain des blessures que vient de lui infliger le moine fanatique Jacques Clément, le roi Henri III reconnaît formellement son beau-frère et cousin issu de germain le roi de Navarre comme son successeur légitime, et celui-ci devient le roi Henri IV.
Pour Henri IV commence la longue reconquête du royaume, car les trois quarts des Français ne le reconnaissent pas pour roi. Les catholiques de la Ligue refusent de reconnaître la légitimité de cette succession.
Roi de France : la reconquête du royaume
La guerre contre la Ligue
Conscient de ses faiblesses, Henri IV doit d’abord commencer par conquérir les esprits. Les royalistes catholiques lui demandent d’abjurer le protestantisme, lui qui à neuf ans avait déjà changé trois fois de religion. Il refuse, mais dans une déclaration publiée le 4 août, il indique qu’il respectera la religion catholique. Beaucoup hésitent à le suivre, certains protestants comme La Trémoille quittent même l’armée, qui passe de 40 000 à 20 000 hommes.
Affaibli, Henri IV doit abandonner le siège de Paris car les seigneurs rentrent chez eux, ne voulant pas servir un protestant. Appuyés par l'Espagne, les ligueurs relancent les hostilités, le contraignant à se replier personnellement à Dieppe, en raison de l'alliance avec la reine Élisabeth Ire d'Angleterre, tandis que ses troupes refluent partout.
Cependant, Henri IV est victorieux de Charles de Lorraine, duc de Mayenne, le 29 septembre 1589 lors de la bataille d'Arques. Au soutien des nobles, huguenots et politiques rassurés par ce chef de guerre solide et humain, s’ajoutent ceux de Conti et Montpensier princes du sang, Longueville, Luxembourg et Rohan-Montbazon, ducs et pairs, des maréchaux Biron et d’Aumont, et d’assez nombreux nobles Champagne, Picardie, Île-de-France.
Il échoue par la suite à reprendre Paris, mais prend d’assaut Vendôme. Il arrive devant Le Mans, après avoir pris en passant quelques villes de Touraine. Là aussi, il veille à ce que les églises restent intactes, et à ce que les habitants ne souffrent pas du passage de son armée. Grâce à cet exemple, toutes les villes entre Tours et le Mans se rendent sans combat. La plupart des villes voisines, suite à la chute du Mans, n'essaient pas de résister. Beaumont, Sablé, Château-Gontier ouvrent leurs portes. Guillaume Fouquet de La Varenne est dépêché dans le Maine et l'Anjou pour y répandre la nouvelle de ce succès. Laval se rend à son tour, Henri de Navarre y entre le 9 décembre 1589. En quittant Laval, Henri se dirige vers Mayenne dont il s'assure, puis vers Alençon où Biron l'attend.
Il bat à nouveau les Ligueurs et les Espagnols à Ivry le 14 mars 1590, assiège Dreux sans succès puis affame Paris, mais ne peut prendre la ville, qui est ravitaillée par les Espagnols. L'approche du duc de Mayenne et du duc de Parme lui fait lever le siège.
Les protestants lui reprochent de ne pas leur donner la liberté de culte : en juillet 1591, il rétablit par l’Édit de Mantes à ne pas confondre avec l'Édit de Nantes de 1598 les dispositions de l’édit de Poitiers 1577, qui leur donnait une liberté très limitée du culte. Le duc de Mayenne, alors en guerre contre Henri IV, convoque les États généraux en janvier 1593, dans le but d’élire un nouveau roi. Mais il est déjoué : les États négocient avec le parti du roi, obtiennent une trêve, puis sa conversion. Encouragé par l'amour de sa vie, Gabrielle d'Estrées, et surtout très conscient de l'épuisement des forces en présence, tant au niveau moral que financier, Henri IV, en fin politique, choisit d'abjurer la foi calviniste. Le 4 avril 1592, par une déclaration connue sous le nom d'expédient, Henri IV annonce son intention d'être instruit dans la religion catholique.
Henri IV abjure solennellement le protestantisme, le 25 juillet 1593 en la basilique Saint-Denis. On lui a prêté, bien à tort, le mot selon lequel Paris vaut bien une messe » 1593, même si le fond semble plein de sens. Afin d’accélérer le ralliement des villes et des provinces et de leurs gouverneurs, il multiplie les promesses et les cadeaux, pour un total de 25 millions de livres. L’augmentation des impôts consécutive multiplication par 2,7 de la taille provoque la révolte des croquants dans les provinces les plus fidèles au roi, Poitou, Saintonge, Limousin et Périgord.
Au début de 1594, Henri IV assiège avec succès Dreux puis il est sacré le 27 février 1594 en la cathédrale de Chartres : il est l'un des trois rois de France sacrés ailleurs qu'à Reims et Paris, qui étaient en effet tenus par l'armée de la Ligue. Son entrée dans Paris le 22 mars 1594, l'expression de son pardon royal[pas clair et, pour finir, l'absolution accordée par le pape Clément VIII le 17 septembre 1595, lui assurent le ralliement progressif de toute la noblesse et du reste de la population, malgré des réticences très fortes des opposants les plus exaltés, tel ce Jean Châtel qui tente d'assassiner le roi près du Louvre le 27 décembre 1594. Il bat de manière définitive l'armée de la Ligue à Fontaine-Française.
Le développement économique
Sur le plan économique, Henri IV fait appel à Olivier de Serres. En 1601, vingt mille mûriers sont plantés dans les jardins des Tuileries. Mieux encore – et ceci témoigne d'une conception nouvelle de l'action administrative – le chapitre « sériciculture » du Théâtre d'agriculture d'Olivier de Serres est tiré à part, à raison de 16 000 exemplaires, un par paroisse. En 1599, Laffemas fait venir l'ingénieur hollandais Humfroy Bradley. En douze ans, la petite Flandre du bas Médoc et la partie aval des marais poitevins sont asséchées. Les édits mercantilistes se succèdent, tout comme fleurissent les essais d'industries nouvelles : tapisserie des Gobelins, verrerie de Melun, soierie de Dourdan, dentelles de Senlis, draperies de Reims et de Senlis. Le but est clair : diminuer les importations coûteuses d'étoffes de luxe, faire du pays un exportateur de ces mêmes produits. En 1602, Laffemas devient contrôleur général du commerce. Les corporations elles-mêmes n'échappent pas à la réglementation, limitée, il est vrai, par les privilèges et les monopoles accordés aux artisans et aux manufacturiers novateurs (édit de 1597 sur l'extension des maîtrises et des corporations).
Le renforcement de l'autoritarisme royal
L'équilibre précaire des forces antagonistes ne pouvait durer longtemps. Dès 1602, les signes de crise se multiplient. En fait, les ultras des deux bords s'accommodaient d'autant plus mal de l'état de choses existant qu'il ne manquait pas, dans l'Europe, de boutefeux intéressés. La paix avec l'Espagne faillit être rompue en 1604 ; Henri IV céda. Mais l'allié hollandais, déçu, réclama un soutien financier accru. Expéditions internes préventives, accroissement de l'effort d'équipement militaire français, exigences financières des alliés de l'intérieur et de l'extérieur ne pouvaient que compromettre les effets du redressement financier. Dès 1603, il faut de nouveau recourir aux expédients, aux traitants. Villeroy passe au second plan tandis que s'impose l'autorité bougonne de Sully. Gouverneur du Poitou en 1604, il prend la première place au Conseil l'année suivante. Sa mission est de trouver de l'argent. Le plus spectaculaire des expédients est, toujours en 1604, la création de la paulette, concession majeure accordée aux parlementaires. À longue échéance, la mesure marque tout aussi profondément la monarchie française que celles qui concernent les commissaires départis. Elles sont contradictoires entre elles et contiennent virtuellement quelques-unes des raisons majeures de l'écroulement de l'Ancien Régime. Mais Henri IV pouvait-il faire autrement ? Face à l'instabilité de la situation extérieure, face aux dangers intérieurs, le renforcement de la bureaucratie royale et la diminution des pouvoirs traditionnels, il fallait lâcher du lest. La garantie donnée par l'édit de la Paulette aux propriétaires d'offices devenus propriété privée, constituait la concession indispensable.
Le renforcement de l'autorité royale, inscrite dans les faits, correspond bien à l'évolution de la personnalité du souverain. En 1604, Henri a cinquante et un ans. Il éprouve, après huit ans d'exercice du pouvoir, une sorte d'impatience devant l'accumulation des obstacles. Il s'accommode de plus en plus mal des réticences, discute moins, ordonne plus. Bellièvre perd son poste de chancelier en 1605, quitte le Conseil en 1607. L'étoile de Sillery, l'adversaire de Sully, monte. C'est vraisemblablement le signe de la nécessité qu'éprouve le roi de donner des gages. Le rappel des Jésuites, en 1603, procède de cette même optique, tout comme le choix du père Coton comme confesseur. La pression financière s'accentue. Les réserves sont constituées au prix d'acrobaties financières discutables. Plus que jamais, les grands financiers se tiennent dans l'ombre du trône, dont ils sont l'un des plus sûrs soutiens. Les dépenses non politiques diminuent, l'effort mercantiliste se ralentit.
La guerre contre l'Espagne puis la Savoie
En 1595, Henri IV déclare officiellement la guerre à l'Espagne. Le roi éprouve alors d'énormes difficultés à repousser les attaques espagnoles en Picardie. La prise d'Amiens par les Espagnols et le débarquement d'une troupe hispanique en Bretagne, où le gouverneur Philippe Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur, cousin des Guise et beau-frère du feu roi Henri III, ne reconnaît toujours pas Henri IV pour roi, laisse celui-ci dans une situation périlleuse.
Le roi perd également l'appui de la noblesse protestante. À l'imitation de La Trémoille et de Bouillon, elle s'abstient de paraître au combat. Choqués par sa conversion et par les nombreuses personnalités qui l'imitent, les protestants en plein désarroi reprochent au roi de les avoir abandonnés. Ils se réunissent régulièrement en assemblée pour réactiver leur organisation politique. Ils vont jusqu'à se saisir de l'impôt royal pour leur propre compte.
Après avoir soumis la Bretagne et avoir repris Amiens aux Espagnols, Henri IV signe, le 13 avril 1598, l'Édit de Nantes qui met en place une paix entre protestants et catholiques. Les deux armées étant à bout de forces, le 2 mai 1598 est signée la paix de Vervins entre la France et l'Espagne. Après plusieurs décennies de guerres civiles, la France connaît enfin la paix.
Toutefois, l'article de la paix de Vervins concernant le duc de Savoie devint la cause d'une nouvelle guerre. Le 20 décembre 1599, Henri IV reçut Charles-Emmanuel Ier de Savoie à Fontainebleau afin de régler le différend. En mars 1600, le duc de Savoie demanda un délai de réflexion de trois mois et repartit pour ses États. Le terme de trois mois étant écoulé, Henri IV fit sommer Charles-Emmanuel de se déclarer. Le prince répondit que la guerre lui serait moins préjudiciable qu'une paix comme celle qu'on lui offrait. Immédiatement, Henri IV lui déclara la guerre, le 11 août 1600.
Posté le : 12/12/2015 18:50
|
|
|
|
|
Henri IV 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Guerre franco-savoyarde . Roi de France : la pacification Le mariage
Henri IV approche de la cinquantaine et n'a toujours pas d'héritier légitime. Depuis quelques années, Gabrielle d'Estrées partage sa vie mais, n'appartenant pas à une famille régnante, elle ne peut guère prétendre devenir reine. Se comportant tout de même comme telle, Gabrielle suscite de nombreuses critiques, tant de l'entourage royal que des pamphlétaires, qui la surnomment la duchesse d'Ordure. Sa mort survenue brutalement en 1599, sans doute d'une éclampsie puerpérale, permet au roi d'envisager de prendre une nouvelle épouse digne de son rang.
En décembre 1599, il obtient l'annulation de son mariage avec la reine Marguerite, et épouse, à la cathédrale Saint-Jean de Lyon, le 17 décembre 1600, Marie de Médicis, fille de François Ier de Médicis et de Jeanne d'Autriche, et nièce de Ferdinand Ier, grand-duc de Toscane alors régnant. La naissance d'un dauphin l'année suivante assure l'avenir de la dynastie de Bourbon.
Henri IV compromet son mariage et sa couronne en poursuivant sa relation extraconjugale, commencée peu de temps après la mort de Gabrielle d'Estrées, avec Henriette d'Entragues, jeune femme ambitieuse, qui n'hésite pas à faire du chantage au roi, pour légitimer les enfants qu'elle a eus de lui. Ses requêtes repoussées, Henriette d'Entragues complote à plusieurs reprises contre son royal amant.
En 1609, après plusieurs autres passades, Henri se prendra de passion pour la jeune Charlotte-Marguerite de Montmorency.
Reconstruction et pacification du royaume
Henri IV s'appuie, pour gouverner, sur des ministres et conseillers compétents comme le baron de Rosny, futur duc de Sully, le catholique Villeroy et l'économiste Barthélemy de Laffemas. Les années de paix permettent de renflouer les caisses. Henri IV fait construire la grande galerie du Louvre qui relie le palais aux Tuileries. Il met en place une politique d'urbanisme moderne. Il poursuit ainsi la construction du Pont Neuf commencé sous son prédécesseur. Il fait bâtir à Paris deux nouvelles places, la place Royale aujourd'hui Place des Vosges et la place Dauphine.
Son règne voit cependant le soulèvement des paysans dans le centre du pays et le roi doit intervenir à la tête de son armée.
En 1601, après la guerre franco-savoyarde, le traité de Lyon établit un échange territorial entre Henri IV et Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie : le duc céda à la France les territoires de la Bresse et du Bugey et en plus les pays de Gex et de Valromey, de plusieurs siècles possession du Duché de Savoie, au lieu du marquisat de Saluces, situé en territoire italien. Après le traité, Henri IV doit faire face à plusieurs complots dirigés depuis l'Espagne et la Savoie. Il fait ainsi exécuter le duc de Biron et embastiller le duc d’Angoulême, le dernier des Valois, fils bâtard de Charles IX.
Pour rassurer les anciens partisans de la Ligue, Henri IV favorise également l'entrée en France des jésuites qui pendant la guerre avaient appelé à l'assassinat du roi, crée une « caisse des conversions » en 1598. Il se réconcilie avec le duc de Lorraine Charles III et marie avec le fils de celui-ci, sa sœur Catherine de Bourbon. Henri IV se montre fervent catholique — sans être dévot — et pousse sa sœur et son ministre Sully à se convertir aucun d'eux ne le fera.
Une période d'essor économique et des arts et métiers
Petit à petit, la France doit être remise en état. La production agricole retrouve son niveau de 1560 en 1610. Le désir de paix est unanime : il favorise la mise en place de l’édit de Nantes, la reconstruction, dans le Languedoc et le Nord de la France, a un effet d’entraînement sur toute l’économie.
La manufacture des Gobelins est créée, les arts et techniques encouragés. Barthélemy de Laffemas et le jardinier nîmois François Traucat s'inspirent des travaux de l'agronome protestant Olivier de Serres et jouent un rôle majeur dans l'histoire de la soie en faisant planter des millions de mûriers dans les Cévennes, à Paris et d'autres régions.
Le canal de Briare reliant la Seine et la Loire pour le développement agricole est le premier canal de transport fluvial creusé en France. D'autres projets sont préparés mais ensuite abandonnés à la mort d'Henri IV. Le roi n'institua pas la poule au pot comme le plat national français comme on l'a dit. Mais dans une querelle avec le duc de Savoie, il aurait prononcé son désir que chaque laboureur ait les moyens d'avoir une poule dans son pot. Le duc de Savoie, en visite en France, apprenant que les gardes du roi ne sont payés que quatre écus par mois, propose au roi de leur offrir à chacun un mois de paye ; ce à quoi le roi, humilié, répond qu'il pendra tous ceux qui accepteront, et évoque alors son souhait de prospérité pour les Français, symbolisé par la poule au pot. Son ministre Sully explique dans ses mémoires intitulés Les Œconomies royales sa conception de la prospérité de la France, liée au développement de l'agriculture : « pâturage et labourage sont les deux mamelles de la France.
La société reste cependant violente : les soldats congédiés forment des bandes organisées militairement qui écument les campagnes, et qui doivent être poursuivies militairement pour disparaître progressivement dans les années 1600. La noblesse reste elle aussi violente : 4 000 morts par duel en 1607, les enlèvements de jeunes filles à marier provoquent des guerres privées, où là aussi le roi doit intervenir.
Implantation française en Amérique
Dans la continuité de ses prédécesseurs, Henri soutient les expéditions navales en Amérique du Sud et favorise le projet d'une implantation au Brésil. Mais c'est en Nouvelle-France que les Français parviennent à se fixer durablement. Dès 1599, le roi accorde le monopole du commerce des fourrures à Tadoussac, en Nouvelle-France, à François Dupont-Gravé et à Pierre Chauvin. Par la suite, Henri IV donne le monopole du commerce des fourrures et charge Pierre Dugua de Mons protestant de monter une expédition, sous les ordres de Samuel de Champlain, et d'établir un poste français en Acadie. Ce sera en premier sur l'Île Sainte-Croix maintenant Dochet Island au Maine), en 1604 et par la suite à Port-Royal, en Nouvelle-France au printemps 1605. Mais le monopole est révoqué en 1607, ce qui mettra fin à la tentative de peuplement. Le roi charge Samuel de Champlain de lui faire rapport de ses découvertes. En 1608, le monopole est rétabli pour un an seulement. Champlain est envoyé, avec François Dupont-Gravé, pour fonder Québec, qui est le départ de la colonisation française en Amérique, pendant que de Mons reste en France pour faire prolonger le monopole.
L'assassinat de Henri IV, rue de la Ferronnerie à Paris
La fin du règne d'Henri IV est marquée par des tensions avec les Habsbourg et la reprise des hostilités contre l'Espagne. Henri IV intervient dans le conflit de succession qui oppose l'empereur de confession catholique aux princes allemands protestants qu'il soutient, dans la succession de Clèves et de Juliers. La fuite du prince de Condé en 1609 à la cour de l'infante Isabelle ravive les tensions entre Paris et Bruxelles. Henri IV estime son armée prête à reprendre le conflit qui s'était arrêté dix ans plus tôt. Le 25 avril 1610, François de Bonne de Lesdiguières, représentant d'Henri IV de France dans le château de Bruzolo en Val de Suse, signe le traité de Bruzolo, avec Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie.
Le déclenchement d'une guerre européenne ne plaît ni au pape, soucieux de la paix entre princes chrétiens, ni aux sujets français, inquiets de leur tranquillité. Ne pouvant accepter une alliance avec des princes protestants contre un souverain catholique, des prêtres ravivent par leurs sermons les esprits échauffés des anciens Ligueurs. Le roi voit également un parti qui s'oppose à sa politique au sein même de l'entourage de la reine. Le roi est dans une position fragile qui n'est pas seulement le fait des catholiques, puisque les protestants cherchent à maintenir grâce à l'édit de Nantes leurs privilèges politiques.
Tout en préparant la guerre, on s'apprête au couronnement officiel de la reine à Saint-Denis qui se déroule le 13 mai 1610. Le lendemain, Henri IV meurt poignardé par François Ravaillac, catholique fanatique, dans la rue de la Ferronnerie à Paris. L'enquête conclut à l'action isolée d'un fou. Un examen des archives au XXie siècle suggère pourtant l'idée d'un possible complot.
Après autopsie et embaumement son cœur placé dans une urne de plomb contenue dans un reliquaire d'argent est envoyé à l’église Saint-Louis de La Flèche, le roi ayant promis sa relique royale au collège des jésuites de La Flèche, le corps est exposé dans une chambre de parade du Louvre puis son effigie dans la salle des Cariatides.
Henri IV est enterré à la basilique Saint-Denis le 1er juillet 1610, à l'issue de plusieurs semaines de cérémonies funèbres qui commencent déjà à faire naître la légende du bon roi Henri. Au cours du lit de justice tenu le 15 mai, son fils aîné Louis futur Louis XIII, âgé de neuf ans, proclame la régence de sa mère la reine Marie de Médicis
Ascendance d'Henri IV de France
Enfants légitimes et Enfants légitimes
Son premier mariage avec Marguerite de France fut stérile. Le roi était en effet atteint d'une malformation congénitale des organes reproducteurs connue sous le nom d'hypospadias ayant pour conséquence une courbure de la verge accompagnée d'un phimosis. Sa malformation ne fut corrigée que par une opération alors que le roi avait plus de quarante ans. Henri IV eut six enfants de son mariage avec Marie de Médicis :
Louis XIII 27 septembre 1601-14 mai 1643, roi de France de 1610 à 1643 épouse en 1615 Anne d'Autriche, infante d'Espagne 1601-1666 ;
Élisabeth de France 22 novembre 1602-6 octobre 1644, épouse Philippe IV 1605-1665, roi d'Espagne le 25 novembre 1615 à Bordeaux ;
Christine de France 10 février 1606-27 décembre 1663, épouse Victor-Amédée Ier de Savoie 1587 - 1637 le 10 février 1619 à Paris ;
Monsieur d’Orléans, à tort prénommé « Nicolas » par certains auteurs, mort avant d'avoir été solennellement baptisé et nommé, titré à sa naissance duc d'Orléans 13 avril 1607-17 novembre 1611 ;
Gaston de France, duc d'Anjou puis d'Orléans à la mort de son frère 24 avril 1608-2 février 1660, épouse en 1626 Marie de Bourbon 1605-1627 puis en 1632 Marguerite de Lorraine 1615-1672 ;
Henriette de France 25 novembre 1609-10 septembre 1669, épouse Charles Ier d'Angleterre le 13 juin 1625, à la Cathédrale de Cantorbéry.
Descendants illégitimes Henri IV eut également au moins 12 enfants illégitimes :
Un seul avec Louise Borré :
Hervé Borré 1576-1643.
Un seul avec Françoise de Montmorency-Fosseux:
Une fille mort-née en 1581.
Un seul avec Esther Imber ou Ysambert, rochelaise :
Gédéon, dit Gédéon Monsieur, né fin 1587 ou début 1588 et mort le 30 novembre 1588.
Trois avec sa maîtresse Gabrielle d'Estrées : ces trois enfants furent légitimés :
César de Bourbon, 1594-1665, duc de Vendôme,
Catherine Henriette de Bourbon 1596-1663, dite Mademoiselle de Vendôme, mariée à Charles II de Lorraine, duc d'Elbeuf ;
Alexandre de Vendôme 1598-1629, dit le Chevalier de Vendôme.
Trois également avec Catherine Henriette de Balzac d'Entragues, marquise de Verneuil :
Henri de Verneuil, né en 1600, mort peu après ;
Henri de Bourbon, duc de Verneuil 1601-1682, évêque de Metz ;
Gabrielle-Angélique de Verneuil 21 janvier 1603-1627, Mademoiselle de Verneuil, qui épouse Bernard de Nogaret de La Valette d'Epernon.
Un seul avec Jacqueline de Bueil :
Antoine de Bourbon-Bueil 1607-1632, comte de Moret.
Deux avec Charlotte des Essarts :
Jeanne-Baptiste de Bourbon 11 janvier 1608-1670, abbesse de Fontevrault ;
Marie Henriette de Bourbon 1609-1629, abbesse de Chelles.
La légende du bon roi Henri Un culte tardif
Dès son règne, à la demande de ses conseillers tel Philippe Duplessis-Mornay, Henri IV utilise des imprimeries itinérantes pour diffuser portraits et tracts tentant de le faire passer pour un prince idéal. Néanmoins les catholiques le considèrent comme un usurpateur, certains protestants l'accusent de trahison puisqu'il a changé six fois de religion et le peuple voit en lui un tyran prélevant de nombreux impôts. Son assassinat par François Ravaillac le transforme en martyr.
C'est au XVIIIe siècle que s'est formée et développée la légende du bon roi Henri. Icône devenue si populaire qu'elle en est restée une image d'Épinal. En l'honneur d'Henri IV, Voltaire écrit en 1728 un poème intitulé La Henriade.
Malgré cette image positive, son tombeau de Saint-Denis n'échappe pas à la profanation en 1793, due à la haine des symboles monarchiques sous la Révolution française. La Convention avait ordonné l'ouverture de toutes les tombes royales pour en extraire les métaux. Le corps d'Henri IV est le seul de tous les rois à être trouvé dans un excellent état de conservation en raison de son exsanguination. Il est exposé aux passants, debout, durant quelques jours. Les dépouilles royales sont ensuite jetées, pêle-mêle, dans une fosse commune au nord de la basilique, excepté quelques morceaux de dépouilles qui sont conservés chez des particuliers. Louis XVIII ordonnera leur exhumation et leur retour dans la crypte, où elles se trouvent encore aujourd'hui.
Dès 1814, on pense à rétablir la statue équestre du roi détruite sous la Révolution. Fondue en 1818, la nouvelle statue équestre a été réalisée à partir du bronze de la statue de Napoléon de la colonne Vendôme. Le siècle romantique pérennisera la légende du Bon Roy Henry, roi galant, brave et bonhomme, jouant à quatre pattes avec ses enfants et grand chantre de la fameuse Poule-au-pot.
En fait, l'État avait, après les troubles récents, grand besoin de restaurer, une image positive de la Monarchie ; Chilpéric et Charlemagne semblaient trop lointains ; les Louis :… VII, VIII, X, XII étaient trop obscurs ou mieux trop pâles ; Louis IX jugé, sans doute, trop religieux. Les autres Louis : XI, XIII, XIV, etc. éveillaient de bien mauvais souvenirs… Il fallait donc dans une véritable opération publicitaire trouver un monarque qui recueillît le maximum de suffrages : le bon Roy tint ce rôle pour la postérité. Alexandre Dumas en fait ainsi un héros épique dans son œuvre Les Grands Hommes en robe de chambre : César, Henri IV, Richelieu en 1856.
Le château de Pau continue de cultiver la légende du bon roi Henri. On peut encore y voir son berceau fait d'une carapace de tortue de mer. C'est dans la tradition béarnaise que son premier baptême se fit : ses lèvres furent humectées de vin de Jurançon et frottées d'ail, ceci pour lui donner force et vigueur. Il doit son surnom de Vert-galant à son ardeur envers ses 73 maîtresses officielles recensées, lui donnant 22 enfants légitimes ou non reconnus qui vivent à la Cour.
Dans le premier chapitre de L'Homme aux quarante écus, Voltaire mentionne pour le peuple un âge d'or sous Henri IV et Louis XIII en raison de la modicité relative de l'impôt.
Plus récemment, l'historiographie contemporaine a rétabli l'image d'un roi qui fut peu apprécié par ses sujets et qui eut beaucoup de mal à faire accepter sa politique. De plus, ses allées et venues d'une confession à l'autre, l'abjuration d'août 1572 et celle solennelle du 25 juillet 1593, lui valurent l'inimitié des deux camps. Ce roi en avait bien conscience et on lui prête vers la fin de sa vie les paroles suivantes : « Vous ne me connaissez pas maintenant, vous autres, mais je mourrai un de ces jours, et quand vous m'aurez perdu, vous connaîtrez lors ce que je valais.
Un objet de haine
Avant d'être aimé du peuple, Henri IV fut donc l'un des rois les plus détestés, surtout par le parti catholique, son effigie brûlée et son nom associé au diable ou à l'Antéchrist comme dans les sermons fanatiques du ligueur Jean Boucher. À cause du martèlement quotidien des prêtres ligueurs durant la dernière guerre de religion, on dénombre pas moins d'une douzaine de tentatives d'assassinat, contre lui, dont le batelier orléanais Pierre Barrière arrêté à Melun armé avec intention déclarée le 27 août 1593 et qui fut roué et brulé sur la place du Martroy à Melun et Jean Châtel qui, lui, blessa le roi au visage rue saint-Honoré, chez sa maîtresse, le 27 décembre 1594. Son assassinat par Ravaillac est même vécu par certains comme une délivrance, au point qu'une rumeur d'une nouvelle Saint-Barthélemy se répand durant l'été 1610.
Attaques incessantes : physiques ou morales ou religieuses… sans même parler de l'affaire Marthe Brossier grossièrement montée par la Ligue (voir la : « Nouvelle collection des mémoires pour servir à l'histoire de France », de Joseph Fr. Michaud, Jean Joseph François Poujoulat - 1838 - France.
Une popularité essentiellement posthume
Vitrail de Linard Gontier provenant de l'ancien hôtel des arquebuses de Troyes XVIIe siècle
La popularité croissante du roi peut tenir à son attitude lors des sièges : il veille à ce que les villes prises ne soient pas pillées, et leurs habitants épargnés et ce, dès le siège de Cahors en 1580. Il se montre magnanime également avec ses anciens ennemis ligueurs, notamment après la reddition de Paris. Il préfère acheter les ralliements, que faire la guerre pour conquérir son royaume. L'historiographie contemporaine a également confirmé l'attachement réel du roi pour le catholicisme après sa conversion, malgré un recul marqué à l'égard des dogmes religieux qu'ils soient catholiques ou protestants.
Ayant été le dernier comte de Foix, Henri IV est à ce titre resté un roi d'une grande importance pour les Ariégeois et souvent cité dans l'histoire locale.
La chanson Vive Henri IV ! qui a été écrite en son honneur a été durablement populaire en France à partir de 1774. Sous la Restauration, son air est fréquemment joué dans les cérémonies se déroulant hors de la présence du Roi et de la famille royale. Il fait alors figure de chanson quasi-officielle de la monarchie.
La fin d'un règne
On voit à quel point la réalité du règne correspond mal aux images d'Épinal : la vision idyllique du paysan trouvant chaque dimanche sa « poule au pot », la phrase fameuse « labourage et pâturage, mamelles de la France ». Contrainte à un jeu d'équilibre constant entre deux idéologies toujours prêtes à s'affronter, toujours méfiantes, s'appuyant sur une coalition temporaire d'intérêts provisoirement attachés au même maître, la royauté n'a guère la possibilité d'avoir une action profonde sur le pays.
L'abandon de la masse paysanne
Composer d'un côté, imposer de l'autre, à tour de rôle ; la victime de cette nécessité est le peuple des campagnes. Le monde urbain, surtout le parisien, en souffre moins. Au relâchement du mercantilisme créateur correspond (cause ou effet ?) une véritable politique de rénovation urbaine. La sensibilité artistique du roi n'est probablement guère en cause. Il cherche, tout simplement, à relancer la construction. D'où le plan grandiose de la place Royale, conçue primitivement pour les ouvriers d'une manufacture de soie et de fils d'argent ; d'où encore l'aménagement de la place Dauphine, la construction du pont Neuf (1609), du pont Marchant (1608) et des lotissements des bords de Seine. Parallèlement, la vogue des châteaux privés s'exaspère. La grande vague de pierre qui s'apprête à recouvrir la France débute : signe qui témoigne de l'enrichissement des « classes » nouvelles et de l'exploitation du monde rural. Le fragile équilibre politique paraît s'être traduit par un abandon partiel de la masse rurale aux politiques économiques rurales nouvelles, résumées entre autres par la métairie. L'ambassadeur anglais Carew écrivait en 1609 : « On tient les paysans de France dans une telle sujétion qu'on n'ose pas leur donner des armes [...]. On leur laisse à peine de quoi se nourrir. » Pour sombre que paraisse l'affirmation, elle ne laisse pas de correspondre à quelque réalité. Il convient donc de ramener l'importance des mesures prises par la royauté en faveur des paysans à de plus justes proportions ; ce sont des mesures de circonstances destinées à pallier les effets des abus les plus criants : abaissement de la taille (pas toujours durable), restitution des communaux aux paysans, encouragements divers – dont on peut se demander quelle a été leur efficacité. À la vérité, le redressement rural est le fait de la paix retrouvée, parfois aussi des efforts de reconstruction des propriétaires.
En même temps, la reprise du mouvement démographique s'amorce. Ainsi, dans le comté nantais, le règne correspond au redressement de la courbe de natalité rurale, en baisse depuis les années 1560-1570. Dans le Languedoc, même reprise démographique, sur un rythme ralenti par rapport au XVIe siècle. Dans le Beauvaisis, l'époque 1580-1645 doit être considérée comme un « plafond démographique ». La tendance à la reprise paraît donc nette, mais d'ampleur variable de région à région.
Au surplus, il n'existe pas encore de véritable unité économique française. Par la force même des choses, le rythme de la respiration économique, partant de celui des prix et des crises, est orienté, dans le nord de la France, par celui des grands foyers de la Méditerranée nordique, de l'Angleterre au Sund, en passant par la Hollande. Dans l'Ouest, en revanche, les liens de causalité sont plutôt ceux que déterminent les convois d'argent américain, alors que le Midi est soumis, de plus en plus, aux pulsations très particulières d'un monde méditerranéen qui a perdu de son importance. Ces domaines s'imbriquent et se superposent : les moyens d'action royaux restent, face à ces courants fondamentaux, des plus restreints. Finalement, l'activité royale permet la paix, la création d'embryons d'industries de luxe plus ou moins solides, la mise en chantier de quelques grands travaux de communication : canal de Briare, routes royales bordées d'ormes. La paysannerie peut d'autant moins apprécier ces réalisations que la royauté, s'appuyant sur les forces nobiliaires et bourgeoises en pleine crise de réadaptation structurelle, est obligée de composer avec elles. L'écart de fait, sinon institutionnel, entre les deux groupes, a provisoirement diminué à la suite de la pénétration de la noblesse terrienne par une bourgeoisie en plein essor. Non que la première ait été, nécessairement, en déclin, comme on s'est hâté de l'affirmer. Il ne fait cependant pas de doute que la bourgeoisie s'installe dans l'État, et surtout par les offices. Que la guerre extérieure reprenne, la superposition des charges rurales nouvelles aux exigences accrues de la fiscalité royale crée, à la fois, un climat révolutionnaire, et, rétrospectivement, l'image fausse d'un paradis perdu.
L'assassinat
L'assassinat se situe au moment précis où la reprise de la guerre européenne, quasi certaine, compromet, aux yeux de beaucoup, le modus vivendi établi depuis 1594. Bien des choses sont remises en question. La paix des consciences catholiques est troublée par l'alliance protestante, la lutte anti-espagnole. L'effort de guerre peut, à juste titre, sembler démesuré. Or, le temps n'a pu encore jouer en faveur de l'effacement des théories théologico-politiques antiroyales, tant des Ligueurs que des protestants. La disparition du roi est souhaitée par beaucoup. Le coup de couteau de Ravaillac n'est pas un accident. La postérité n'a gardé toutefois du Vert-Galant qu'une image idéalisée et consacrée par le martyre, image qui a été celle des contemporains le lendemain de l'assassinat, mais non point celle de la veille. Certes le règne n'a été marqué de « nul mécompte national », et s'il constitue une étape décisive dans l'instauration de la monarchie dite absolue, les mesures de circonstance y sont pour beaucoup. Il reste, provisoirement, l'acquis de l'édit de Nantes, dicté lui aussi par la nécessité. La gloire réelle d'Henri IV réside sans doute dans cette soumission exceptionnelle aux événements, qui lui a permis de les infléchir. Jean Meyer
Controverse autour de la tête d'Henri IV 2010-2013
En 2010 et 2012, une équipe de scientifiques rassemblée autour du médecin légiste Philippe Charlier serait parvenue à authentifier la tête momifiée du roi qui aurait été séparée de son corps à la Révolution - même si aucun document d'archives ne le rapporte. Sous la Terreur, le tombeau du roi à la basilique de Saint-Denis fut, comme ceux des autres monarques, profané. Son corps, exposé au public durant deux jours, fut ensuite jeté, avec celui des autres rois, dans une fosse commune. Au début du xxe siècle, un collectionneur prétendait posséder la tête momifiée du roi. Il fallut attendre le quadricentenaire de l'assassinat du roi en 2010 pour que des analyses scientifiques soient effectuées sur la présumée relique.
Une première étude aurait trouvé trente points de concordance confirmant que l'identité de la tête embaumée était bien celle du roi Henri IV avec, selon les auteurs de cette étude, 99,99 % de certitude. Cette conclusion fut confirmée en 2012 par une seconde étude à l'Institut de biologie évolutive de Barcelone qui parvint à extraire de l'ADN et à le comparer avec l'ADN supposé de Louis XVI à partir d'un mouchoir qui aurait été trempé dans le sang du roi le jour de son exécution. À l'occasion de l'annonce des résultats, une image du visage royal créé virtuellement en 3D fut présentée au public.
Cette authentification est contestée par plusieurs historiens, généticiens, médecins-légistes, archéologues et paléoanthropologues, comme Joël Cornette, Jean-Jacques Cassiman, Geoffroy Lorin de la Grandmaison, Yves de Kisch, Franck Ferrand, Gino Fornaciari74 ou Philippe Delorme.
En décembre 2010, le prince Louis de Bourbon s'adresse au président Nicolas Sarkozy pour obtenir la réinhumation de la tête présumée de son aïeul dans la nécropole royale de la basilique de Saint-Denis. Selon Jean-Pierre Babelon, Nicolas Sarkozy prévoit initialement une cérémonie pour mai 2012. Cependant, la controverse autour de la relique et la campagne présidentielle repoussent la date de la célébration et le projet est ensuite abandonné par François Hollande.
Le 9 octobre 2013, un article scientifique publié dans l’European Journal of Human Genetics, cosigné par les généticiens Maarten Larmuseau et Jean-Jacques Cassiman de l'université catholique de Louvain, ainsi que par l'historien Philippe Delorme, a démontré que le chromosome Y de trois princes de la maison de Bourbon actuellement vivants différait radicalement de la signature ADN trouvée dans la tête comme dans le sang analysés au cours de l'étude de 2012. La conclusion de cet article est qu'aucune de ces deux reliques n'est authentique.
Dans les arts
Armoiries de Navarre du premier roi de la dynastie des Bourbon : parti d'azur à trois fleurs de lys d'or et de gueules aux chaînes d'or posées en orle, en croix et en sautoir, chargées en cœur d'une émeraude au naturel.
En littérature
François Bayrou, Henri IV : le Roi libre, éd. Flammarion, 1999
George Chapman 1559-1634, The Conspiracy and Tragedy of Byron 1608, éd. John Margeson Manchester: Manchester University press, 1988.
Abel Hugo, La Naissance de Henri IV, nouvelle dans la revue Le Conservateur littéraire, 1820
Heinrich Mann, Le roman d'Henri IV, Paris, Gallimard NRF, 1972, 3 vol
Michel Peyramaure, Henri IV, Robert Laffont, 1997, 3 vol.
M. de Rozoy, Henri IV, Drame lyrique, 1774.
Marcelle Vioux Le Vert-Galant, vie héroïque et amoureuse de Henri IV ; illustré par le fac-similé de portraits et tableaux historiques Fasquelle, 1935
Au cinéma
La Bouquetière des innocents 1922, film français réalisé par Jacques Robert.
Le Vert galant 1924, film français réalisé par René Leprince. Ce film retrace le parcours qui mena Henri de Navarre jusqu'au trône de France.
La Reine Margot 1954, film français réalisé par Jean Dréville. Rôle interprété par André Versini.
Vive Henri IV, vive l’amour 196), film français réalisé par Claude Autant-Lara. Rôle interprété par Francis Claude. Ce film montre un roi populaire, franc buveur, solide mangeur, paillard et grivois, heureux dans ses bonnes fortunes.
La Reine Margot 1994, film français réalisé par Patrice Chéreau. Rôle interprété par Daniel Auteuil.
Henri 4 2010, film allemand réalisé par Jo Baier, d’après Le Roman d’Henri IV de Heinrich Mann. Rôle interprété par Julien Boisselier.
Au théâtre
Henri IV le bien-aimé, écrit et mis en scène par Daniel Colas, avec Jean-François Balmer et Béatrice Agenin, Théâtre des Mathurins, 2010
Dessins, peintures Sculptures
1834 - 1838 - Henri IV statue équestre en bronze du roi coiffé de lauriers par le sculpteur Philippe Joseph Henri Lemaire. Vestige de l'incendie de l'Hôtel de Ville de Paris par les Communards en 1871, aujourd'hui au Musée Carnavalet
Numismatique
Le billet 5 000 francs Henri IV 1957-1959 et le billet 50 nouveaux francs Henri IV 1959-1961.
      
Posté le : 12/12/2015 18:33
Edité par Loriane sur 13-12-2015 19:19:23
|
|
|
|
|
Michel de L'Hospital |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 13 Décembre 1578 meurt Michel de l'Hospital
au château de Bélesbat à Boutigny-sur-Essonne, né vers 1506 au château de la Roche à Aigueperse dans le Puy-de-Dôme, conseiller au parlement de Paris 1537, ambassadeur au concile de Trente, maître des requêtes, surintendant des finances 1554, chancelier de France 1560 et poète latin. Son nom reste associé aux tentatives royales de pacification civile durant les guerres de religion. « … le plus grand homme de France, si ce titre est dû au génie, à la science et à la probité réunies. » écrivit Voltaire, Éssai sur les mœurs et l'esprit des nations ch. 172 p. 522
En bref
Ayant commencé une brillante carrière de juriste humaniste à l'université de Padoue, d'abord comme étudiant, puis comme professeur de droit civil, Michel de L'Hospital fait un long séjour en Italie (il a été, entre autres, auditeur de la Rote à Rome) qui lui vaut une grande réputation de savant. Délégué aux Grands Jours de justice de Moulins (1540), de Riom (1542) et de Tours (1546), il devient premier président de la Chambre des comptes de Paris. Sa carrière politique débute en 1560, quand Catherine de Médicis l'appelle pour mener une politique de réconciliation entre catholiques et protestants. Rêvant d'un concile national impossible, il se heurte rapidement aux Guise qui ont arraché aux états généraux de Fontainebleau la condamnation des Rohan, qu'il refuse de signer. Après la mort du roi François II, il trace son programme dans le célèbre discours des états généraux d'Orléans en 1560, dont le premier volet est formé par la diminution du nombre des officiers (ordonnance de janvier 1561). Le second volet (ordonnance d'avril 1561), libéral vis-à-vis des protestants, se heurte aux réticences du Parlement. L'Hospital essaie alors d'harmoniser les points de vue des uns et des autres au Colloque de Poissy en 1561 ; il échoue totalement. Abandonné, puis rappelé par Catherine de Médicis, il s'attaque au problème financier en faisant vendre des biens du clergé pour une valeur de 100 000 écus de revenu, mesure qui procura, en cinq ans, quelque 100 millions à la royauté. Importante et mal étudiée sur le plan de ses conséquences sociales, la vente ne suffit cependant pas à compenser les effets de l'inflation des prix de la seconde moitié du XVIe siècle. La fixation autoritaire du taux de l'intérêt à 5 p. 100 réussit encore beaucoup moins. Il est plus heureux avec la création des consulats (tribunaux spécialisés dans les affaires commerciales) et l'ordonnance de Moulins (1566) qui contribue à fixer le droit français. Michel de L'Hospital est cependant, avant tout, le symbole de la politique de tolérance. En dépit de l'appui de Ronsard, en dépit aussi du grand voyage de présentation du jeune Charles IX à son peuple (1564-1566), qui montre combien le gouvernement se préoccupe encore de contacts personnels, le champion de l'accord entre Français échoue complètement. La décennie 1560-1570 montre d'une manière décisive que la France bascule définitivement du côté catholique, rendant ainsi un affrontement sanglant inévitable. On en rendit L'Hospital responsable. Celui-ci se retire en 1568. Écrivain très renommé (ses Épîtres furent comparées à celles d'Horace), il est le grand protecteur de la Pléiade. Mais sa politique a échoué parce qu'elle venait trop tôt. Jean Meyer
Sa vie
Michel de l'Hospital est le fils de Jean de l'Hospital, premier médecin et conseiller de Charles duc de Bourbon connétable de France par la suite celui de sa sœur Renée, Duchesse de Lorraine et de Bar, bailli de Montpensier et auditeur des comptes. Jean de Galuccio, son ancêtre, était originaire du Royaume de Naples. Arrivé en France, il fut adopté par Jean de l'Hospital, clerc des Arbalétriers de France dont il prit le nom et les armes en 1349 grâce à des Lettres de Naturalisation. Les armes de la famille de l'Hôspital sont : « d'azur à la tour d'argent, posée sur un rocher de même, au chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or ».
Avocat sans le sou, il ne peut prétendre à une place de conseiller au parlement. Un ami, Pierre Le Filleul, archevêque d'Aix et gouverneur de Paris, ancien président de la Cour des comptes, lui conseille de se marier. C'est ainsi, qu'en 1537, il épouse, Marie Morin, fille de Jean, lieutenant criminel du Châtelet, ayant obtenu en reconnaissance de services rendus au roi un office de conseiller clerc au parlement de Paris pour la dot de sa fille. De leur union naquirent trois filles, dont seule la fille aînée Madeleine accédera à l'âge adulte, et sera éduquée en protestante, sa mère s'étant nouvellement convertie au culte réformé.
Il habitait sa terre du Vignay, commune de Gironville canton de Milly. Au début de l'année 1573, il se rend à 10 km, au château de Belesbat, demeure depuis 1556, de sa fille Madeleine et de son gendre Hurault de Belesbat, maître des requêtes, avec leurs 9 enfants. Il expédie deux lettres à Charles IX, avec l'acte de démission de sa fonction de chancelier, et fait rédiger son testament par son petits-fils Michel Hurault. Il meurt peu après, le 13 mars, à l'âge d'environ 70 ans, en pleine guerres de Religion, il est enterré en pleine nuit dans l'église Sainte-Madeleine de Champmotteux (à une vingtaine de kilomètres d'Étampes où l'on peut encore voir son tombeau.
Une formation de juriste
Michel de l'Hospital est avant tout un juriste. Humaniste de son temps, l'Italie est pour lui un passage obligé. Il y fait ses études et y voyage beaucoup. Il débute sa formation en Italie à l'université de Padoue, où il deviendra professeur de droit civil. Cette formation peut en partie expliquer l'ampleur des réformes judiciaires voulues par Michel de l'Hôspital. Il s'est également rendu à Rome, lieu de pèlerinage traditionnel où il a été, entre autres, auditeur de la Rote, ce qui lui vaut une grande réputation de savant. Sa carrière de juriste se poursuit lorsqu'il est nommé délégué aux Grands Jours de justice de Moulins en 1540, de Riom en 1542 et de Tours en 1546, et plus particulièrement quand il devient premier président de la Chambre des comptes de Paris.
L'œuvre politique L'œuvre législative
Juriste de formation, Michel de l'Hospital, nommé Chancelier de France le 1er mai 1560 par le roi François II, est le principal collaborateur de la régente Catherine de Médicis. Il convoque les représentants des religions catholiques et réformées au Colloque de Poissy 1561 et essaie d'harmoniser les points de vue des uns et des autres. Confronté au fanatisme des deux camps, il échoue totalement.
Extrait du discours des États d'Orléans : « Tu dis que ta religion est meilleure. Je défends la mienne. Lequel est le plus raisonnable, que je suyves ton opinion ou toy la mienne ? Ou qui en jugera si ce n'est un saint concile ? Ostons ces mots diaboliques, noms de parts, factions et séditions, luthériens, huguenots, papistes. Ne changeons le nom de chrestien. ».
Le 17 mai 1563, Michel de l'Hospital rend compte de la situation financière du royaume devant le parlement de Paris pour le pousser à accepter un édit : La France, en la personne du jeune roi Charles IX, a 50 millions de livres de dettes, dont cinq sont nécessaires pour payer les troupes et expulser les Anglais hors du Havre. Les recettes de l'année précédente sont de 850 000 livres environ et les dépenses de 18 millions. L'édit du 13 mai 1563 prévoit de vendre les biens du clergé pour créer des rentes de 100 000 écus par an. Le Parlement d'abord hostile finit par accepter.
Michel de l'Hospital œuvra pour la simplification du droit français. La tradition attribue une grande partie des édits promulgués entre 1563 et 1567 au chancelier dont la généralisation en 1565 des tribunaux des juges et des consuls, les actuels tribunaux de commerce, le premier ayant été créé à Paris en 1563. Il aurait joué un rôle décisif dans l'assemblée du Conseil élargi où siègent les princes de sang, grands officiers, présidents des parlements qui s'ouvre à Moulins en 1566 et qui débouche sur l'ordonnance de Moulins. Selon cette ordonnance, les parlements ne pourront refuser d'enregistrer les édits ou ordonnances ni de les faire appliquer, même si les remontrances qu'ils pourront présenter sur ses lois seront rejetées. L'édit de Moulins quant à lui affirme l'inaliénabilité du domaine royal sauf les apanages. C'est le promoteur des édits de Fontainebleau sur l'arbitrage et la transaction. Après la mort de François II 1560, il a pour projet de diminuer le nombre d'officiers.
La question de la majorité royale
La minorité de Charles IX de France est un handicap sérieux, l'autorité d'un roi mineur n'a pas le même poids que celle d'un roi adulte. La référence en matière de majorité est l'ordonnance de Charles V de 1374 qui fixe la majorité des rois de France à « 13 ans révolus ». Cependant, à la mort de son auteur, elle n'a pas été appliquée et sa valeur est critiquée par les conjurés d'Amboise. Les termes de cette ordonnance sont ambigus : la quatorzième année est-elle le lendemain du treizième anniversaire ou le jour du quatorzième ? La première des innovations du 17 août 1563 consiste à déclarer la majorité du jeune souverain lors d'un lit de justice non au Parlement de Paris mais dans un parlement de province, celui de Rouen. La seconde est l'interprétation que le chancelier fait de l'ordonnance de Charles V : la quatorzième année doit être commencée et non accomplie. Cette déclaration de majorité est aussi l'occasion pour le chancelier de rappeler deux principes qui lui sont chers, le principe de la continuité monarchique et celui du roi législateur la souveraineté réside dans le pouvoir de faire les lois et seul le roi a ce pouvoir.
Les guerres de religion
Huguenot dissimulé aux yeux des catholiques de son temps, il est partisan de l'unité et de la tolérance. Bien qu'il doive sa première carrière à une protectrice de la Réforme, Marguerite de Berry, sœur d'Henri II, et bien que sa femme et sa fille se soient converties, c'est grâce à l'influence du cardinal de Lorraine, un catholique, qu'il est promu chancelier en 1560. Influencé au départ par les idées de concorde religieuse de ce dernier, après l'échec du colloque de Poissy, son évolution le conduit à accepter une tolérance civile, solution politique qui correspond à son profond respect des libertés de conscience. Son gallicanisme le pousse à tenir des positions fermes concernant l'indépendance temporelle de l'Église et de la couronne vis-à-vis du pape, et explique sa rupture en 1564 avec le cardinal de Lorraine qui, revenu du concile de Trente, voulait en faire accepter les décrets en France. Sa volonté de maintenir l'équilibre instauré par l'édit d'Amboise le pousse à une certaine violence. En 1566, on lui reproche même de n'être pas passé par le Conseil pour envoyer des lettres patentes autorisant les protestants à appeler des pasteurs à leur chevet. Il aurait voulu supprimer la vénalité des offices.
Cependant, il échoue dans ses tentatives d'apaisement du conflit. Rêvant d'un concile national impossible, il se heurte rapidement aux Guise qui ont arraché aux États généraux de Fontainebleau la condamnation des Rohan, qu'il refuse de signer, à la difficulté d'application de l'édit d'Amboise et au manque de tolérance de ses compatriotes.
La paix de Longjumeau apparaît comme une ultime tentative pour sauver sa politique de tolérance civile. Elle suscite une flambée de la colère catholique. Michel de l'Hospital tente alors l'impossible pour s'opposer aux intransigeances. Il refuse ainsi le sceau à la publication d'une bulle papale autorisant une deuxième aliénation des biens du clergé parce que la condition en est l'engagement du roi de France à extirper l'hérésie. Les sceaux lui seront retirés peu après alors que la troisième guerre a déjà commencé. Le nouveau garde des sceaux, Jean de Morvillier, est un modéré proche du chancelier, mais le départ de Michel de l'Hospital marque l'échec de la politique de tolérance civile.
Un philosophe de son temps Un partisan de la tolérance
Michel de L'Hospital est avant tout, le symbole de la politique de tolérance. Malgré l'appui de Ronsard et le voyage de présentation du nouveau roi à son peuple, sa politique de réconciliation échoue totalement. Dès 1560, le pouvoir bascule définitivement du côté ultra-catholique, rendant ainsi un affrontement sanglant inévitable. On en rendit Michel de L'Hospital responsable. Il se retire en 1568 pour s'établir dans sa propriété de Vignay, sur la paroisse de Champmotteux. Lors de la Saint-Barthélemy, il aurait fait ouvrir les portes de son château à une foule fanatique, qui lui laissa la vie sauve. Michel de l'Hospital reste encore aujourd'hui un symbole de tolérance; ainsi, il figure parmi les quatre statues d'hommes illustres placées devant le Palais Bourbon.
« Le couteau vaut peu contre l'esprit ».
Un protecteur de la Pléiade
Ronsard fréquentait les proches du roi : Marguerite, Jean de Morel (1510-1581), Jean de Brinon mais aussi Michel de l'Hospital. Les Amours de Ronsard sont publiés avec son Cinquième Livre des Odes dans lequel on trouve une Ode à Michel de l'Hospital. À partir de 1551, des poètes courtisans, dont Mellin de Saint-Gelais, raillèrent auprès du roi les métaphores pindariques et les obscurités des Odes. Mais, protégé par Marguerite de Navarre et Michel de L'Hospital, Ronsard finit par se réconcilier avec ses rivaux et revient à une inspiration plus simple, à la fois moins érudite et moins ésotérique, en abandonnant Pindare et sa conception du poète inspiré.
Un écrivain
Michel de l'Hospital fut considéré comme un écrivain talentueux. Ses Épîtres furent comparées à celles d'Horace. Il écrit des poésies, mais la majorité de ses œuvres sont cependant en rapport avec son rôle politique : Traité de la réformation de la justice, Harangues, mercuriales et remontrances, Mémoire sur la nécessité de mettre un terme à la guerre civile 1570, Le but de la guerre et de la paix 1570, Discours pour la majorité de Charles IX et trois autres discours.
Œuvres
Harangues 1560
Traité de la réformation de la justice
Harangues, mercuriales et remontrances
Mémoire sur la nécessité de mettre un terme à la guerre civile 1570
Le but de la guerre et de la paix 1570
Poésies 1585, 1732. Édition critique du livre I: Michel de l’Hospital. Carmina. Livre I. Édité, traduit et commenté par Perrine Galand et Loris Petris, avec la participation de David Amherdt. Genève, Droz, 2014.
Discours pour la majorité de Charles IX et trois autres discours, édition établie, présentée et annotée par Robert Descimon, Paris : Imprimerie Nationale coll. Acteurs de l'histoire, 1995.
Établissement qui porte son nom
Collège Michel-de-l'Hospital à Riom 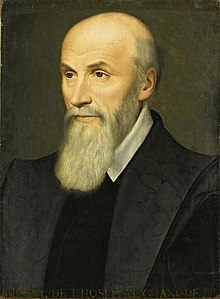   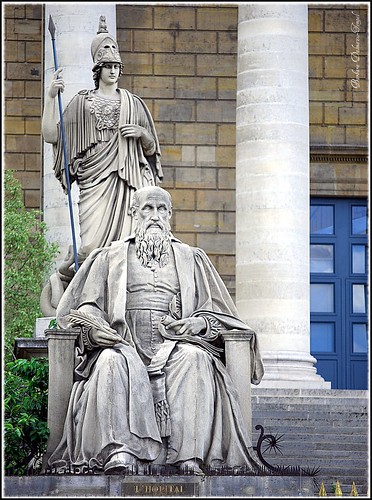 
Posté le : 12/12/2015 17:34
Edité par Loriane sur 13-12-2015 19:02:25
Edité par Loriane sur 13-12-2015 19:03:40
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
69 Personne(s) en ligne ( 43 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 69
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages