|
|
Re: Défi du 19 décembre 2015 |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
14/03/2014 18:40
De Paris
Niveau : 29; EXP : 25
HP : 0 / 706
MP : 370 / 21252
|
Année Zéro L’ordinateur de bord égrenait son compte à rebours : 3000,2999,2998… XXX réglait les derniers instruments de navigation, ajustait les paramètres techniques et préparait le vaisseau pour un atterrissage optimal. Le manifeste ne laissait aucune place au doute quant à l’objet de la mission. Il ne restait plus qu’à trouver l’endroit précis, sur la seule base de croyances datées, de récits passés de bouche en bouche, d’interprétations imprécises d’un vieux livre crée de bric et de broc par des scribes anonymes. Même venu du trente quatrième siècle, XXX ne pouvait deviner le lieu exact des événements, parce que justement rien n’en prouvait la réalité, aucune preuve n’en attestait la réalité, seuls de maigres indices permettaient d’émettre des hypothèses, fort aléatoires. XXX termina ses réglages puis se cala dans son fauteuil. Il en profita pour se laisser aller à ses souvenirs, quand la Haute Autorité lui avait signifié sa mission. — Vous êtes conscient de l’importance de votre voyage, avait commencé un Conseiller de niveau Quatre. — Je crois, monsieur. — Il ne s’agit pas de croire, justement, mais de prouver. Notre civilisation a rebondi, après des siècles d’errance et de faux-semblants. Vous, les XXX, en êtes devenus les symboles, ceux de notre avenir glorieux à travers les étoiles, au-delà de l’horizon, loin des croyances d’antan. — Oui, monsieur. — Nos prédécesseurs se sont fourvoyés, au nom de prophètes disparus dans les limbes de la mémoire collective. Ils se sont combattus pour un bout de désert, un morceau de parchemin ou une brique dans un mur. Leurs enfants ont remplacé l’épée ou le cimeterre par l’atome et les virus. Des générations ont vécu dans la peur de l’autre, la haine du voisin, le mensonge érigé en religion et propagé par des vieillards barbus, au nord et au sud, à l’est et à l’ouest. XXX savait tout ça, comme chaque enfant de sa caste, celle des exécutants et des techniciens. Il avait été choisi parmi des milliers de XXX, après un processus de sélection particulièrement ardu, puis entrainé au voyage temporel, à la navigation multidimensionnelle, aux techniques de pilotage non-relativiste, à un ensemble complet de savoir-faire indispensables pour remonter le temps. Il avait avalé des quantités d’informations sur l’Histoire d’avant, quand son espèce biologique s’affublait du nom d’Humanité, depuis son premier crâne brisé à coup de hache en silex. C’était le passé, révolu pour toutes les castes du monde des XXX mais il fallait le connaitre, le comprendre, avant de l’affronter. XXX s’assoupit un instant. Son cerveau passa en phase subconsciente, dénuée des couches d’éducation et de conditionnement imposées aux XXX. Il profita de ses rares moments de liberté pour rêver. Son univers intérieur s’afficha comme un ensemble de couleurs, d’abord sans relief puis avec des incidentes, des hauts et des bas, des creux et des bosses. XXX se retrouva dans un décor inconnu, multicolore, où d’autres individus paraissaient bien moins perdus que lui. Leur apparence, hétérogène et dénuée de logique, transgressait les plus élémentaires règles du système de castes. Certains cerclaient des bottes de paille, d’autres creusaient des tranchées dans le sol, tous travaillaient en parlant, dans une langue pleine d’accents chantants telle une mélodie flutée. XXX tenta d’ouvrir la bouche, d’émettre un son mais il n’en sortit rien d’autre qu’une sorte de frôlement, comme un bruit d’élytre, celui d’un insecte enfermé dans une cage de plexiglas. Les autres le regardèrent bizarrement, sans montrer de signe agressif ou de contrariété. XXX se sentit une singularité dans un monde illogique où la variété semblait la norme. Ce sentiment, inconnu des XXX depuis avant leur naissance, accentua son malaise, le stressa davantage au point de le réveiller. L’écran affichait 1650 et continuait son compte à rebours. XXX s’essuya les yeux, étonné d’avoir pleuré durant son sommeil, puis se leva pour remettre de l’ordre dans sa routine, revenir aux fondamentaux de sa condition. Il procéda à quelques contrôles, ajusta deux paramètres, vérifia les constantes de navigation et jugea la situation sous contrôle. XXX termina le processus par la rédaction d’un mémorandum, une étape obligatoire dans tous les voyages hors des limites planétaires. XXX à Haute Autorité.
Point de départ : Luna 12, année 3366.
Point d’arrivée : Terre, Palestine, année 0.
Dimensions prévues : cinq passages hors temps, deux accélérations.
Incidents : aucun.
Probabilités d’impact positif : 98%.
Risques calculés : faibles, une dérive à l’est, d’un facteur inférieur au degré.XXX signa son rapport puis l’enregistra. Il se cala ensuite dans son fauteuil et attendit la phase d’accélération, premier passage dans le temps cible. Dans le vaisseau, tout était automatisé, des conditions de vie propre à l’habitacle en passant par les fluctuations de la coque, conditions indispensables pour la sécurité du matériel et de l’équipage. La pression changea de façon imperceptible, la composition de l’air se modifia, la luminosité baissa d’intensité. XXX se sentit partir dans une sorte de torpeur, signe de son passage en stase intermédiaire, un état de conscience où l’homme devenait chrysalide et se débarrassait de ses dernières peurs avant de plonger dans le temps. XXX sombra dans l’infiniment profond, un absolu sans rêves ni souvenirs embarqués sur son écran cérébral. Il subit la plongée gravitationnelle, le changement de dimension, sans ressentir la moindre douleur alors que sa matière devenait exotique, basée sur une biologie très éloignée de la physique traditionnelle en cours sur la Terre et aux alentours. S’il avait perçu les modifications de son corps, l’explosion de ses quarks, XXX aurait crié dans l’espace devenu autre chose, sans étoile ou planète, pour des oreilles improbables et des peuplades indigènes qui ne le voyaient pas. XXX vécut deux accélérations successives, un record dans l’histoire du voyage temporel, du moins dans les annales officielles. Le temps ne compta plus, ni pour lui ni pour le vaisseau, le haut ne remplaça pas le bas, la profondeur devint obsolète, Dieu arrêta de jouer aux dés. Revenu dans son univers physique, dans un état proche de l’initial, à la variable temps près, le vaisseau lança la procédure de sortie de stase, ouvrit la chrysalide et permit au nouveau XXX d’émerger. L’ordinateur de bord effectua lui-même les mesures, sans l’aide d’un pilote trop fatigué par son périple à travers les dimensions, puis corrigea sa trajectoire d’entrée sur la planète Terre afin d’arriver dans les meilleures conditions, sans bruit et sans fureur. Enfin, dans le strict respect de la procédure, il enregistra un mémorandum, à destination de son équipage humain et de sa hiérarchie. Vaisseau à XXX, à Haute Autorité
Impact positif à 99,7%
Point d’arrivée confirmé : Terre, Palestine, Bethléem, année zéro.
Incidents : aucun, l’équipage composé d’un XXX a survécu sans dommage notable.
Risques constatés : nuls, la dérive initiale a été amendée.Dans le ciel de Palestine, ce jour précis, les habitants relatèrent une suite de phénomènes inexpliqués. Un scribe de Cisjordanie regroupa des témoignages dans une sorte de gazette locale à destination des plus fortunés et de leurs érudits. Au début de cette fameuse journée, des paysans ont vu dans le ciel des lumières très brillantes. Plus tard, aux alentours de Bethléem, ils ont constaté un réchauffement ambiant. Selon eux, l’air piquait la peau et les yeux, de plus en plus fort. Se mouiller le visage ou s’enduire de matière grasse ne changeait rien. Les animaux commençaient à se comporter bizarrement. Puis les premiers signes de folie sont apparus : le bétail s’est échappé des enclos, les enfants se sont mis à crier, les mères à pleurer, les hommes à se battre entre eux. La bataille s’est transformée en curée, comme si une voix intérieure leur ordonnait de tuer tout ce qui vivait dans les environs. Les rares survivants parlent de tueurs aux yeux fous, de paroles célestes dans une langue inconnue, de maisons incendiées et de roulements de tonnerre au loin à l’horizon.Le gouverneur de Palestine, alarmé par ces témoignages, isola le territoire incriminé, contingenta le risque de contamination aux quelques survivants, de jeunes fermiers de Bethléem. Il déclara l’état d’urgence, interdisant de publier des nouvelles sur des événements similaires dans toute la région, et fit donner la garde contre les rares opposants qui voyaient en ce phénomène la manifestation du divin contre l’occupant romain. Quelques langues furent coupées, des gens écartelés puis tout rentra dans l’ordre, comme Rome l’avait ordonné. XXX rédigea son dernier rapport, pour la postérité. Il avait mené à bien sa mission, au prix de sa propre existence, mais ne pouvait pas revenir dans son temps initial parce que c’était le prix à payer pour servir son espèce. XXX à Haute Autorité.
Lieu actuel : Terre, Palestine, Bethléem, année zéro.
Etat de la mission : achèvement complet, tout le territoire impliqué est pacifié, le père et la mère sont neutralisés, l’enfant n’a pas survécu.
Incidents : peu, la population locale s’est comportée comme prévu, leurs gouvernants ont fermé les frontières et isolé le périmètre.
Risques calculés : la civilisation occupante devrait se maintenir encore quelques centaines d’années avant de s’effondrer sous le poids de sa propre décadence. Les peuplades locales vont reprendre le contrôle, sous formes de potentats tribaux, de la zone pendant quelques dizaines d’années, avant de tomber à leur tour sous la domination d’une puissance coloniale. Le risque est faible que cette dernière invoque un quelconque prophète pour imposer son modèle, si nos autres missions dans la zone se concluent de la même manière.XXX enregistra son mémorandum. Il se souvint de sa dernière discussion avec son instructeur, avant de partir en mission. — Pourquoi devons nous, tous les missionnaires, rédiger des rapports alors qu’ils ne peuvent vous parvenir et que vous n’existerez plus ? — Parce que c’est la procédure, XXX. Sans règlement, nous ne sommes rien d’autre que de grands singes savants, des animaux préoccupés par leur seule survie, des prédateurs à peine plus intelligents que les autres. — Mais notre mission, si elle réussit, va modifier le passé et donc le futur. Il n’y aura plus de castes, d’ordre établi, de vie sur la Lune et de civilisation mécanisée. — C’est ça l’idée, XXX, donner une seconde chance à notre espèce, en repartant de zéro. FIN
Posté le : 19/12/2015 20:15
|
|
|
|
|
Conte de Noël La Noël du petit violoniste |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
La noël du petit joueur de violon 1873
de Camille Lemonnier 1844-1913
I
- Jean, dit à son domestique M. Cappelle de la maison Cappelle et Cie, allez donc voir quel est ce tapage à la porte de la rue.
- Je n'ai pas besoin de me déranger, monsieur Cappelle, pour savoir que c'est le petit mendiant à qui vous m'avez fait donner deux sous ce matin, répondit Jean en regardant par la fenêtre du bureau.
- Ces mendiants ne nous laisseront donc jamais tranquilles, s'écria M. Cappelle. Tous les ans, je donne cent francs au bourgmestre pour les pauvres de la ville. Dites-lui cela, Jean, de ma part, et faites-le partir.
- Attendez un peu que j'aie fini d'épousseter votre grand fauteuil, monsieur Cappelle, et vous verrez si je n'irai pas le lui dire. C'est incroyable comme il y a toujours de la poussière dans votre bureau. Comment donc! cent francs aux pauvres de la ville! Je lui dirai cela, soyez tranquille, et s'il lui prend envie de recommencer, je lui dirai par-dessus le marché que je n'ai pas le temps de courir du matin au soir après des rien-du-tout, des gueux, des rats, monsieur Cappelle...
Et Jean donnait de si furieux coups de son plumeau sur le fauteuil que les plumes se détachaient par poignées... - Oui, monsieur Cappelle, des rats. Cent francs par an! vous badinez, je pense.
- Doucement, s'il vous plaît, Jean, vous allez déchirer le cuir de mon fauteuil. J'entends de nouveau le violon. Sortirez-vous à la fin?
- Oui, monsieur Cappelle, fit Jean, en passant son plumeau sous son bras. Mettez-vous seulement un peu à la fenêtre pour entendre comment je vais l'arranger.
Puis il se planta au milieu du bureau, croisa ses bras, et regardant son maître d'un air attendri, la tête sur le côté, s'écria :
- Est-il Jésus Dieu possible que des rien-du-tout, des gueux, des rats, oui, des rats, monsieur Cappelle, viennent ennuyer jusque dans sa maison un monsieur si honnête, et qui donne cent francs par an aux pauvres de la ville? Non, monsieur, cela n'est pas croyable.
Ayant ainsi parlé, Jean se dirigea lentement du côté de la porte, les bras croisés et le nez en terre, avec de petits hochements de tête, comme un homme qui médite sur ce qu'il vient de dire, mais, au moment de sortir, il releva les yeux, et interpellant son maître :
- Ainsi donc, monsieur Cappelle, je lui dirai de votre part... Qu'est-ce qu'il faudra dire, s'il vous plaît, monsieur ?
- Jean! attendez un peu, cria en ce moment une joyeuse voix de petite fille.
Et Hélène, que tout le monde appelait Leentje dans la maison, entra en sautillant dans le bureau de son père. Oh! la jolie enfant! Elle avait dix ans, les joues roses, les cheveux blonds, les yeux bruns, et sa grande tresse serrée dans des noeuds de soie bleue battait son dos, comme une gerbe d'épis tressés.
- Père, supplia-t-elle, un petit sou pour le joueur de violon qui est devant la porte de la maison. Jean ira le lui porter.
Mais M. Cappelle lui répondit avec humeur :
- Qu'as-tu à t'occuper de cet affreux petit drôle? J'en ai assez de sa manivelle.
- Ah! père, il est si gentil, fit l'enfant en joignant les mains, très doucement, et il joue si bien; il n'a peut-être plus de père, car enfin... Est-ce que tu me laisserais aller jouer du violon aux portes des maisons, père ?
- Leentje, voilà une sotte question... Qu'y a-t-il de commun entre nous et les pauvres gens? Tu es la fille de Jacob Cappelle, de la maison Cappelle et Cie.
- La plus riche maison de la ville, Leentje, dit Jean en crachant derrière sa main, dans le corridor.
- Eh bien, père... Tiens! je voulais te dire quelque chose de très raisonnable et voilà que j'ai oublié... Attends. Ah! je sais maintenant... Je ne voudrais jamais que ma poupée manquât de rien tant que je serai vivante, et pourtant je ne suis que sa maman. Voyons, un petit sou, s'il te plaît, papa, ou je le prends sur l'argent de mes économies.
- Tiens, voilà le sou, Leentje, mais c'est le dernier qu'aura ce petit mendiant. À votre âge, mademoiselle, j'étais déjà plus sérieux : je m'occupais des intérêts de la maison, au lieu de prendre attention à des coureurs de rue.
- Je suis pourtant bien sage, père. Je sais tous les jours ma leçon et j'ai eu hier encore trois bons points pour mon écriture.
- Oui, ma chérie, mais tu es pendue tout le jour à ma poche. Un sou est un sou, et dix sous font un franc, et un franc avec d'autres francs font au bout de l'année un joli intérêt. Crois-tu qu'on nous donnerait comme cela des sous à la porte des maisons si nous étions pauvres?
Ici Jean crut devoir intervenir, et crachant encore une fois derrière sa main, dans le corridor, il s'écria :
- Ah bien, non, Leentje, qu'on ne nous les donnerait pas. Un si bon monsieur et qui, tous les ans, donne cent francs aux pauvres! Ah bien, non, et pour ma part, monsieur Cappelle, je vous dirais : Allez-vous-en ; nous avons bien assez déjà de nos pauvres, auxquels nous payons cent francs par an. Est-ce que je mendie, moi? Je suis domestique chez monsieur Cappelle et je travaille. Eh bien, travaillez aussi. Voilà ce que je dirais.
M. Cappelle haussa les épaules, et poussant du doigt Leentje vers la porte :
- Allons, fillette, dit-il, va avec Jean. Voici la fin de l'année et j'ai à revoir mes livres de comptes.
Ils descendirent et brusquement Jean se mit à crier de toute la force de ses poumons :
- Hé! Là-bas! Hé! Mendiant! Garnement! Propre à rien!
L'archet cessa de faire grincer les cordes du violon et un jeune garçon se leva de la marche en pierre sur laquelle il était assis, dans l'encoignure d'une porte. Alors Jean prit un air majestueux et la main tendue, comme un avocat qui commence un plaidoyer :
- Monsieur Cappelle vous fait dire, de sa part, qu'il donne cent francs par an aux pauvres de la ville et que...
- Venez, petit, venez par ici, interrompit Leentje, poussant à travers la porte sa jolie tête rose.
Et de la main, elle lui faisait signe d'approcher.
Le petit mendiant qui avait ôté son chapeau, en souriant gauchement, quand Jean s'était mis à lui parler, entra dans le grand vestibule peint en marbre blanc, étonné, regardant la hauteur des voûtes, avec de réitérés mouvements de tête humbles et lents pour saluer.
Jean ferma la porte, examina le garçon des pieds à la tête et tout à coup indigné, montra Leentje et s'écria :
- Savez-vous bien à qui vous parlez? À Leentje, la fille de M. Cappelle. Et M. Meganck, le notaire lui-même, n'est pas plus riche que M. Cappelle, quoique son cocher ait un frac avec de l'argent dessus.
Mais l'enfant avait posé le doigt sur les haillons du musicien :
- N'ayez pas peur, dit-elle, et répondez-moi. Vous n'avez plus de père, petit ?
Il fixait à présent les yeux sur la pointe de ses pauvres vieux souliers, haussant les épaules, doucement, pour montrer qu'il ne comprenait pas ; puis par contenance, un poing sur sa hanche, il se mit à siffler dans ses dents, d'un air à la fois timide et résolu.
- Bon! c'est un sourd-muet, s'exclama Jean. J'ai vu ça de suite. Voyons, répondez. N'est-ce pas que vous êtes sourd-muet ?
- Comment voulez-vous qu'il soit sourd-muet, Jean, puisqu'il chantait hier en jouant du violon ?
Alors le jeune garçon mit son instrument sous son menton et ouvrit la bouche comme s'il s'apprêtait à chanter ; mais Leentje posa la main sur l'archet et lui dit :
- Moi, j'aime le violon, mais mon papa ne l'aime pas. Je vous ai demandé si vous n'aviez plus de papa ? Est-ce que vous ne m'avez pas compris ?
Il leva sur Leentje deux beaux grands yeux noirs, doux comme du velours, et haussa de nouveau ses épaules ; mais cette fois un triste sourire plissait le coin de sa petite bouche bien formée.
- Ah! s'écria tout à coup Leentje gaiement, en frappant ses mains l'une dans l'autre, il veut dire qu'il n'est pas du pays. D'où viendrait-il, Jean ?
Jean fit alors le tour du jeune garçon, les mains derrière le dos, levant et abaissant son long nez de travers pour mieux voir les habits du petit mendiant, et une grimace dédaigneuse plissait le bas de sa grosse figure bien nourrie.
- Tenez, lui dit Leentje. j'ai demandé à mon père un sou que voici et j'y joins trois sous qui m'appartiennent. Cela vous fait quatre sous pour vous acheter un gâteau, car c'est la Noël ce soir. J'ai bien encore vingt sous dans ma tirelire, mais j'ai promis de les donner à la vieille Catherine. Amusez-vous bien : une autre fois je vous montrerai ma poupée. Vous ne la connaissez pas ? Elle a coûté vingt francs. C'est une poupée très jolie.
Et Leentje mit ses quatre sous dans les doigts du jeune garçon. Il eut un beau geste reconnaissant, et de la main dans laquelle Leentje avait glissé les sous il frappa sa poitrine avec tant de vivacité qu'elle le regarda pour savoir s'il ne s'était pas fait de mal. Il baissa aussitôt les yeux et une grosse larme coula sur ses joues pâles, tandis qu'il portait son argent à sa bouche et le baisait religieusement.
- Il poverello! cria-t-il tout à coup d'une seule voix, avec une grande énergie.
Et glissant très vite son violon sous son menton, il posa l'archet sur les cordes et ouvrit la bouche, en regardant en l'air, la tête sur l'épaule.
- Leentje! Leentje! cria une voix dans l'escalier.
Et Mina, la bonne, parut dans le corridor, tout essoufflée.
- Que faites-vous ici, Leentje? Je vous cherche dans toute la maison. Est-il permis de faire courir ainsi les gens! Dieu du ciel! Mon corset vient de craquer. Je serai obligée de remettre une agrafe.
Mais elle, toute à son admiration :
- Voyez, Mina, quel gentil petit garçon! C'est le même qui nous a suivies dimanche quand nous sommes allées, Nelle et moi, à la boutique de M. Pouffs, le marchand de volailles, car vous étiez retournée ce jour-là chez vos parents, Mina. Il jouait du violon en nous suivant. Nelle a voulu le chasser en lui montrant son poing, mais il n'a pas eu peur de Nelle, et seulement il a mis son violon sous son bras. Ne trouvez-vous pas qu'il est bien gentil, Mina ?
- Comment pouvez-vous trouver gentil un affreux petit garçon sale, noir, mal lavé et qui porte les cheveux si longs, Leentje ? Je n'ai jamais rien vu de plus laid que ce vilain petit singe, et vous feriez mieux de ne pas m'exposer à prendre un rhume en vous attendant.
- Mina! Mina! pourquoi dites-vous du mal de mon petit mendiant après l'avoir trouvé si gentil hier au soir, car je vous ai donné hier une pièce neuve de cinquante centimes pour la lui remettre, et vous êtes remontée en disant que vous n'aviez jamais vu un plus doux ni plus joli mouton.
- Bon, Leentje, ce que je vous en dis aujourd'hui est pour vous mettre un peu en colère contre moi. C'est un doux mouton, voilà.
- Un doux et un joli mouton, Mina.
- Oui, tout ce que vous voudrez, Leentje, un doux et joli mouton. Êtes-vous contente ? Je sais très bien que vous m'avez donné une jolie pièce de cinquante centimes toute neuve, avec la tête du roi Léopold dessus. Oui, je la vois encore d'ici.
Elle toussait en parlant, un peu gênée, car elle l'avait gardée pour elle.
Et Mina était, en effet, descendue la veille pour remettre la pièce au jeune garçon ; mais au moment d'ouvrir la porte, elle avait vu le fils du sacristain Klokke à genoux dans la neige et cherchant à regarder par la fenêtre de la cave. Et Klokke, qui était jaloux, lui avait dit :
- Pourquoi venez-vous à la porte, Mina ? Est-ce que vous m'avez entendu frapper contre la vitre ? J'ai pourtant frappé bien doucement. Je suis sûr que quelqu'un a rendez-vous à cette heure avec vous. Est-ce le gros Luppe, le Crollé, ou Metten, le cocher de M. Meganek ? Dites-le-moi, Mina, ou je vous pince.
- Qu'est-ce que vous me chantez là? s'était écriée la grosse petite bonne. Vous êtes toujours planté devant le carreau pour savoir ce que je fais. Klokke ! c'est fini. Je ne veux plus rien avoir pour vous. Mariez-vous ailleurs. J'en ai assez de toutes vos raisons. Qu'est-ce que vous dites ?
- Eh bien, si c'est comme cela, je m'en vais. J'en ai assez de tous les museaux que je vois tourner par ici. Vous avez beau dire, je pars pour ne plus revenir.
- Je ne dis rien.
- Non, non, c'est inutile. Nous irons chacun de notre côté. J'en connais qui vous valent bien, et il n'y a que le choix qui m'embarrasse. Votre amie Justine...
- Eh bien! prenez Justine je vous l'abandonne, avec son cou sur le côté et son air de n'y pas toucher. Votre ami Dirk...
- Prenez Dirk. Voilà un joli mufle. Sans compter qu'il boit tout son mois en un jour. Il y a bien de quoi faire la fière!
- Vous me rendrez mon mouchoir et mon gant, s'il vous plaît, avant dimanche, car je ne veux plus que vous ayez rien à moi.
- Ni moi non plus. Vous me rendrez le cent d'aiguilles et le petit pot de pommade.
- Le petit pot de pommade! Il y a beau temps qu'il n'y en a plus, de la pommade, dans votre petit pot. Allez, ne me retenez pas plus longtemps. Je suis bien sotte de vouloir encore causer avec vous.
- Eh bien! gardez le petit pot, Mina, en souvenir de moi, et s'il vous en faut encore un...
- Je ne vous connais plus.
- Hein ?
- Bonsoir.
- Voyons, Mina, est-ce moi que vous attendiez, ou un autre ?
- Rien.
- Dites-moi si tout est fini entre nous ?
- Bonsoir.
- Ah! Mina, le pauvre Klokke a-t-il mérité d'être aussi durement traité ?
- Prenez Justine.
- Ce sont là des histoires, ma petite Mina ; je n'ai rien pour Justine.
- Il n'y a que le choix qui vous embarrasse.
- J'étais venu avec l'intention de vous donner...
- Hein ?
- Mais c'est inutile, puisque tout est rompu.
- Dites toujours.
- Non, cela ne sert à rien.
- Voyons un peu.
- À quoi bon ?
- C'est pour voir.
- Ce sera pour une autre.
- Alors, bonsoir.
- Mina, dites-moi pourquoi vous êtes venue à la porte et je vous dirai...
- Ah! Klokke, vous ne méritez pas qu'on vous aime. Qu'est-ce que c'est que vous me donnez ?
- Mina, je vous apportais une petite broche en jais.
- Montrez un peu pour voir. Mon petit Klokke, c'est très gentil d'avoir pensé à votre Mina. On voit bien l'amitié que les gens ont pour quelqu'un aux cadeaux qu'ils lui font.
- Maintenant, Mina, nous ne nous quitterons plus. Dites-moi pourquoi vous avez ouvert la porte ?
- Ah! Klokke, c'est pour cet affreux mendiant qui jouait tantôt du violon devant la maison. Où est-il? L'avez-vous vu partir ?
- Le voilà qui tourne le coin de la rue.
- Leentje m'a donné de l'argent pour lui.
- Hem! hem!
- Pourquoi faites-vous hem! hem! Klokke ?
- C'est que si j'étais à votre place, Mina...
- Que feriez-vous à ma place?
- Je sais bien ce que je ferais. Les mendiants sont assez riches comme cela.
- N'en dites rien à personne, Klokke. Nous le mettrons avec les autres pour le jour de notre mariage.
- Ah! Mina, il y aura toujours du pain sur la planche avec une femme comme vous.
Et voilà comment il se fait que le petit mendiant n'eut pas la jolie pièce que Leentje avait donnée pour lui à la bonne amie de Klokke, le fils du sacristain. Mais la fine Mina n'avait garde d'en rien laisser paraître et elle faisait à présent semblant de se rappeler très bien qu'elle la lui avait donnée.
- C'est égal, Leentje, dit-elle, vous feriez mieux de ne pas vous occuper de ces petits traîneurs de pavé. Ce sont tous des fripons et des fils du diable. J'en ai vu comme cela pas mal à Bruxelles, quand j'étais en service chez M. Schoreels, le ferblantier, et j'entendais dire autour de moi qu'ils venaient de si loin que c'était au moins de Macaroni ou d'Italie, je ne sais plus au juste, mais c'est quelque chose comme cela.
- Mina! Mina! C'est donc plus loin que Bruxelles. Ah! pauvre petit garçon! Je lui garderai certainement un morceau du gâteau de Noël.
- Voilà votre père qui vous appelle. Rentrez vite, de peur qu'il ne vous trouve encore dans le vestibule.
- Bonsoir, petit mendiant, dit alors l'enfant, en faisant aller ses mignonnes mains ; maman m'a appris à prier Dieu pour les pauvres. Je dirai dimanche à la messe une prière pour que vous soyez toujours un gentil petit garçon.
Alors Jean, redevenu hautain, le bourra dans les épaules.
- Allons, sortez d'ici. M. Cappelle vous fait dire de sa part qu'il donne tous les ans cent francs aux pauvres de la ville.
- Vous êtes bien dur, Jean, dit Leentje.
- Qui ça? Moi, dur, Leentje? On m'a toujours dit que j'avais un coeur de poulet.
- Vous le rudoyez.
- Le rudoyer! moi! Sortirez-vous à la fin, vilain rat ?
Le petit mendiant regarda l'argent qu'il avait dans la main, murmura quelques mots que personne ne comprit et gagna la rue. Au moment de sortir, il leva ses yeux noirs sur Jean, avec colère.
- Allez! allez! lui cria Jean, je me moque de vos grands yeux. Vous ne pouvez rien contre moi. Je suis ici dans un bon service où je ne manque de rien et où je gagne de bon argent. Propre à rien! Brigand!
Et la porte se ferma.
II
Le petit joueur de violon remit son chapeau sur sa tête, serra autour de ses reins le vieux manteau bleu qu'une corde attachait à son corps et se mit à remonter la rue en frappant ses pieds gelés sur le pavé plein de neige.
Le soir tombait et le long des façades les vitres s'éclairaient l'une après l'autre. Des lampes brillaient sur les tables. De temps en temps, une fenêtre s'ouvrait sur la lumière chaude des chambres ; un homme ou une femme se penchait, fermait les volets. Les vitrines des boutiques, scintillantes de givre, étalaient des arabesques, légères comme des dentelles, sur lesquelles dansait l'ombre des brosses, des torchons, des paquets de chandelles et des nattes en paille qui pendaient à l'étalage. On voyait les boutiquiers aller et venir avec empressement derrière leur comptoir, en riant, parce que les gros sous pleuvaient ce soir-là dans leur tiroir, et les chalands tapaient leurs sabots à terre pour se réchauffer, en attendant leur tour d'être servis.
La vitrine du marchand de vin était une vraie merveille ; le malin compère avait rangé l'une à côté de l'autre, sur les planches, toute une armée de bouteilles, renfermant de belles liqueurs roses, brunes, jaunes et violettes que la lumière de la lampe faisait miroiter comme des topazes, des rubis, des améthystes et des saphirs. Et sur le trottoir, la neige se colorait de feux qui reflétaient la nuance des liqueurs dans les bouteilles. Près de là, le charcutier avait pendu à sa fenêtre de longs chapelets de saucissons, enguirlandés de fleurs en papier d'or, et de la belle saucisse luisante tournait en rond sur une assiette, à côté d'un grand foie de porc dont le brave homme était en train de couper une tranche.
L'enfant poussa la porte qui se mit à carillonner, et du doigt montra le foie.
- Qu'est-ce que c'est, mon petit bonhomme ? lui dit le marchand. Je veux bien vous donner une tranche de foie, mais il faut me la payer.
Et en même temps il frottait plusieurs fois de suite son pouce contre son index pour donner plus de poids à ses paroles.
L'enfant tira de sa poche un de ses sous et le mit sur le comptoir, en passant sa main dessus, de crainte que l'homme ne le prit avant de l'avoir servi. Le grand couteau luisant plongea alors dans le foie et une tranche s'en détacha ; puis le petit mendiant ôta sa main de dessus le sou et s'en alla, emportant sa marchandise. Il avait grand'faim, il mordait dans la tranche à belles dents, et en un instant il n'en resta plus rien. Il glissa alors sa main dans sa poche pour voir s'il avait encore ses autres sous et continua son chemin.
Le pâtissier avait imaginé pour la Noël une montre extraordinaire. Des cramiques étalaient leurs dos bruns piqués de raisins, laissant sortir par places la miche dorée ; et une pièce montée, superbe, avait la forme d'une tour. Cette tour, dont la base était en pâte de pouding, étageait trois rangs de galeries circulaires ; en haut de la dernière, parmi les fruits confits qui brillaient sur le sucre de la croûte glacée, une petite femme en jupe blanche, posée sur l'orteil du pied gauche, haussait en l'air sa jambe droite en ouvrant les bras comme si elle allait s'envoler. Puis des meringues soulevaient, non loin de la tour, leur écume figée au milieu de laquelle deux cerises et une prune semblaient des îlots battus par les flots. Contre la vitre, de grandes couques hérissées de drapeaux en soie rouge et bleue et de plumes frisées posaient debout, à côté d'hommes en spikelaus et en biscuit, qui avaient l'air de dire bonjour aux passants. Il y avait aussi des assiettes remplies de dragées, de pralines au chocolat, de fondants, de sucres de couleur, de caramels, mais la plus belle chose était certainement la tour aux trois étages, à cause de sa hauteur et de ses fruits.
Le petit vagabond s'arrêta longtemps devant ces merveilles, n'ayant jamais rien vu d'aussi beau. Il se baissait, se haussait, se penchait à droite, se penchait à gauche, faisait avec son haleine des trous dans le givre des vitres, pour mieux voir. Et tantôt il sautait sur une jambe tantôt sur l'autre, frappant ses vieilles semelles sur le trottoir et chantant entre ses dents un air de son pays. Doucement il passa le bout de sa langue sur la vitre et lécha le givre à petits coups, croyant lécher les confitures.
Le pâtissier s'aperçoit tout à coup qu'il y a quelqu'un derrière sa vitrine et il fait un geste de colère. Le petit joueur se sauve alors ; mais le boulanger, lui aussi, a fait de grands hommes en spikelaus, des cramiques de fine farine, des couques en forme d'oiseau, avec des plumes et des drapeaux. Et l'enfant s'arrête de nouveau, regarde ces belles choses avec le désir d'en manger.
Il n'a pris, depuis le matin, pour toute nourriture, qu'un petit pain de deux sous et une tranche de foie. À la fin il se décide, pousse la porte vitrée du maître mitron, montre du doigt les bonshommes qui sont à la vitrine, et parmi ceux-là le plus beau. Mais la boulangère appuie le pouce de sa main droite sur la paume de sa main gauche, l'avertissant ainsi qu'il doit avant tout payer. Il tire son sou et le pose sur le comptoir.
La méchante femme hausse alors les épaules et lui dit d'une voix aigre :
- Avez-vous pensé vraiment, petit drôle, que vous auriez ce grand bonhomme pour un sou ?
Puis elle prend le sou, le tourne dans ses doigts et lui donne un petit pain blanc, le plus sec de la fournée.
Comme c'est bon, du pain! Il l'avale en quelques coups de dents et porte ensuite sa main à sa bouche pour y ramasser les miettes roulées dans les coins.
III
Constamment la sonnette des marchands carillonne ses drelin drelin ; car de riches et pauvres vont à la boutique, ce soir-là, pour acheter les cadeaux de Noël. Les ménagères passent en courant, la tête baissée sur la poitrine, les mains pelotonnées dans leur tablier, à cause de la bise qui rougit le nez et les doigts : et l'une tient dans les bras un cramique qui répand derrière elle une bonne odeur de pâte aux oeufs, l'autre porte à son poignet un cabas d'où sortent des goulots de bouteilles. Des petits garçons et des petites filles passent aussi, chargés de provisions, et quelques-uns s'arrêtent pour ouvrir les paquets et prendre délicatement un bonbon, un morceau de sucre, un macaron.
De vieilles femmes, enveloppées de manteaux et le capuchon sur les yeux, sortent de l'église en marmottant entre leurs dents, qui claquent de froid, et il y en a qui tiennent à la main une chaufferette par les trous de laquelle le vent fait pétiller la braise.
Le petit musicien voit briller dans la noire église les hautes fenêtres en forme de trèfle ; la porte étant restée ouverte, un flot de lumière se répand sur le parvis, jusqu'à ses pieds, avec une tiède odeur d'encens. Il pénètre sous les voûtes jaunies par le reflet des cierges, et se dirige vers le poêle où se meurt un petit feu de houille. Il tend avidement ses mains et ses pieds vers la fonte brûlante : il passe ensuite ses mains sur ses jambes et sur ses bras pour les imprégner de la chaleur du poêle, et une douce action de grâces s'élève de son coeur pour remercier le Sauveur qui, aux approches de la grande nuit de Noël, lui donne du feu pour se réchauffer.
L'église est silencieuse : on n'entend dans les nefs muettes que le grincement des chaises sur les dalles bleues, le pas du sacristain dans le choeur, et le claquement des sabots, lorsque les vieilles femmes en manteau noir se dirigent du côté du bénitier afin d'y tremper leurs doigts avant de sortir. Et de temps à autre une d'entre elles s'arrête près du poêle et ouvre au feu ses petites mains sèches, en regardant de côté avec défiance le jeune vagabond. Il sent alors glisser dans son sang une chaude langueur; sa tête retombe sur sa poitrine ; il s'affaisse dans son vieux manteau troué dont il s'est fait un oreiller. Une voix irritée éclate tout à coup à son oreille. C'est le sacristain qui lui fait signe de partir. Il se lève, regarde fièrement cet homme qui le chasse, ramasse son violon et s'en va, lentement, en boitant, car ses pieds ont gonflé dans les vieilles bandelettes de cuir qui retiennent ses souliers à ses jambes. Il ouvre la porte, et la bise glacée le frappe de nouveau au visage.
Alors le jeune garçon se parle ainsi à lui-même :
- Francesco, mon pauvre Francesco, pourquoi as-tu quitté la montagne ? Tu avais une mère à la montagne et tu l'as quittée. Où sont les autres, ceux qui m'ont précédé dans mon tour du monde ? Paolo est mort dans la campagne, pendant qu'il faisait chaud encore et que les arbres étaient verts. Il a bien du bonheur, Paolo! Un jour, quand il gèle et qu'on n'a plus la force de marcher, on regarde derrière soi et l'on cherche de quel côté du ciel est la montagne. C'est alors, mon Francesco, que le chemin parait long et l'on se dit qu'on n'arrivera jamais. J'ai perdu en chemin Paolo, et Pietro aussi, mon cher Pietro, plus jeune que moi de deux ans, et les autres m'ont quitté en me disant : Bon voyage. Buppo était le plus grand, mais il toussait. Que sera-t-il arrivé de lui et des autres ? Bonjour, Buppo, Paolo, Pietro et les autres. Ce sera tantôt la nuit de Noël ; il y a fête dans le ciel et ceux de la montagne sont descendus vers Naples. Tous les ans, à la Noël, nous allions à Naples, avec les cornemuses et les violons, et les gens nous donnaient de la galette, du fromage, des fruits ou de petites pièces de monnaie, tout le long du chemin. Naples! Naples! Et tout le long du chemin, il y avait des crèches avec l'âne, les mages et notre Sauveur, devant lesquelles ronflaient les cornemuses et chantaient les hommes de la plaine. Chez les hommes d'ici il n'y a point de crèches et les mains ne jettent que du cuivre rouge. Ma mère me disait : « Francesco, tu es le dernier de mes entrailles et je te vois partir avec douleur. Mais on est riche où tu vas : voilà pourquoi je ne veux pas te retenir. Dieu soit avec toi! Quand tu reviendras, je pourrai mourir. Va donc, mon cher enfant. » Puis elle m'a donné ce violon et elle est venue avec les autres mères jusqu'aux montagnes qui paraissent bleues quand on les voit de loin. Ensuite elles sont restées les bras tendus, et quand le soir est venu, nous avons joué de la cornemuse et du violon, afin qu'elles pussent encore nous entendre. Et maintenant, je reviens, mais plus pauvre que lorsque je suis parti, car je n'ai plus d'espérance.
En ce moment il entendit à quelques pas de lui trois petits garçons qui chantaient à la porte d'une maison, et l'un d'eux tenait au bout d'un bâton une lanterne où brûlait une chandelle. C'étaient des enfants de la campagne, en sabots, avec des écharpes sur la tête, et ils chantaient des complaintes de Noël pour gagner quelques sous. Le plus grand se haussait sur la pointe des pieds et chantait à travers le trou de la serrure, afin qu'on l'entendît mieux de l'intérieur ; le second chantait en tournant sur lui-même, les mains dans les poches, et l'on voyait sa bouche large ouverte, car il criait de toutes ses forces ; le troisième criait aussi, mais il s'interrompait à tout moment pour renifler car son nez coulait, et il se remettait à crier avec une telle force que sa voix semblait devoir se briser. Et tantôt l'un, tantôt l'autre disait : « Plus fort », pendant que celui qui avait le nez à la serrure tapait de petits coups du bout de son sabot contre la porte : alors ils se mettaient à crier tous les trois comme des diables. Et leur chanson était à l'unisson ; mais l'un avait déjà fini quand l'autre commençait, et le dernier courait toujours après le premier, sans pouvoir l'atteindre. La petite chandelle tremblante éclairait leurs nez rouges et faisait danser leur ombre derrière eux jusqu'au bout de la rue : et eux-mêmes dansaient à la dernière note de la chanson, en sautant et en retombant sur le plat de leurs sabots, sans rire. Et voici ce que disait leur chanson :
- Noël! ils sont venus, les petits - Les petits et les plus petits encore - Dire bonjour à l'âne du Seigneur - De Notre Seigneur Jésus-Christ. - Il y a du foin et des navets cuits - Des carottes et du pain bénit. - Mangez, les gens, les bêtes aussi, - Koekebakken et pain cuit. - Noël! Noël! Amen!
- Noël! baas! dirent les rois. - Du foin pour nos trois chevaux, - Mais pour nous des koekebakken - Lesquels nos dents couperont. - S'il en reste un tout petit morceau, - Mettez de côté pour les cochons. - Mangez, les gens, les bêtes aussi, - Koekebakken et pain cuit. - Noël! Noël! Amen!
- Pour chandelle une petite étoile - Montre là où dort Notre Seigneur - Dans son maillot cousu de fil blanc. - Sur la paille qui est dans la crèche, - Il dort, le joli petit mouton. - Blokke kloppen - S'il s'éveille, c'est pour mourir. - Mangez, les gens, les bêtes aussi, - Koekebakken et pain cuit. - Noèl! Noèl! Amen!
- Car il mourra pour nous sauver de l'enfer, - Jésus-Christ, le fils de notre chère Dame. - Les petits et les plus petits encore - Auront le cramique et du beurre en paradis - Avec de la bonne musique de violon. - Mangez, les gens, les bêtes aussi, - Koekebakken et pain cuit. - Noël! Noël! Amen!
- Oh! baas, Si vous êtes contents des petits ènfants, - Donnez-leur, par amour de Christus, - De l'argent pour acheter des couques - Des couques avec des prientjes dessus. - Blokke kloppen. Nous ôterons nos sabots pour y faire coucher le chat. - Mangez, les gens, les bêtes aussi, - Koekebakken et pain cuit. - Noël! Noël! Amen!
Les trois petits garçons allaient recommencer pour la troisième fois leur complainte quand ils entendirent tout à coup jouer du violon à côté d'eux : c'était Francesco qui, humble et souriant, les accompagnait, et du pied il battait la mesure pour tâcher d'être d'accord avec eux. Ils cessèrent alors de chanter, et le plus grand mit son poing sous le nez de Francesco en lui disant :
- Nous ne voulons partager notre argent avec personne.
Ainsi chassé, il s'en va, de rue en rue, jouant à la porte des maisons et devant les boutiques, mais l'archet glisse à peine sur les cordes, car les crins en sont gelés.
Où passera-t-il la nuit ? Au fond d'une cour sombre, sous un hangar, une charrette de paille est remisée. Il pénètre doucement dans le hangar et soulève la paille pour se glisser dessous. Un chien sort en ce moment de sa niche et fait entendre des aboiements furieux. Il revient sur ses pas et se dirige vers cette maison où la charité, la grâce et la douceur lui sont apparues sous les traits de Leentje! Voici, en effet, la belle maison blanche avec sa grande porte peinte en chêne sur laquelle les poignées de bronze imitent des têtes de lions, et un peu au-dessus, dans le panneau de gauche, une superbe plaque de cuivre reluisante étale le nom de CAPPELLE et Cie, gravé en grosses lettres. Il regarde les fenêtres partout closes, et il y en a trois au premier étage qui sont éclairées.
Qui donc est encore éveillé dans la maison? Les sons d'un piano, comme une musique de paradis, s'échappent par les fentes des volets, et bientôt une petite voix d'or s'élève dans le silence de la nuit. Cette voix lui rappelle le murmure avec lequel sa mère le berçait, les chants des petits enfants de la montagne, le vent dans les arbres, mille choses tendres et lointaines. Puis la voix cesse, mais il l'entend longtemps encore, comme un chant de Noël, au fond de son coeur.
Des portes s'ouvrent dans la rue et il en sort des ombres qui marchent rapidement ; quelques-unes balancent à la main de petites lanternes qui rougissent la neige, car les réverbères de la ville sont éteints. Toutes ces petites lanternes se dirigent du même côté, là où la cloche sonne pour la messe de minuit. La porte de la maison Cappelle et Cie s'ouvre aussi et une joyeuse lumière se répand au-dehors : des hommes et des femmes, chaudement vêtus, serrent la main au maître de la maison, et une petite voix, celle qui a chanté, leur jette le bonsoir; puis la compagnie se sépare en riant, la porte se referme et les fenêtres où brillait l'éclat des lampes, une à une s'obscurcissent. Ah! M. Cappelle a voulu fêter le réveillon et il a bien fait les choses : on a bu du thé, du vin chaud et du punch; la table est encore remplie de beaux pâtés et de belles tartes dans lesquels le couteau a taillé de grandes brèches. Mina déshabille Leentje et la couche dans des draps chauds, après l'avoir embrassée; et au moment de s'endormir, Leentje tourne la tête du côté de son arbre de Noël, qu'elle a fait monter dans la chambre, avec la poupée, les étuis, les boîtes à ouvrages et les cornets de dragées. Alors la lumière qui danse au haut de la maison sur le rideau de Leentje, comme une étoile dans le brouillard, s'éteint à son tour, et l'obscurité enveloppe le doux sommeil de la fille de M. Cappelle.
IV
Ah! qu'ils sont gais, les petits flocons de neige, lorsque, pareils à des papillons d'hiver bondissant sur le tremplin de la bise, ils montent, descendent, montent encore et qu'un enfant passe, à travers la fenêtre entr'ouverte, sa main dodue pour les saisir! Qu'ils sont gais pour tout autre que le pauvre Francesco, dans cette nuit glacée de Noël! De grosses larmes roulent au bord de ses yeux, tandis qu'il souffle son haleine sur le bout de ses doigts. Le monde est bien dur! Que va-t-il faire maintenant? Il voit dans l'ombre une porte profonde dont la neige n'a pas recouvert le seuil; il y va. Tenez, le voilà qui s'assied, après avoir eu soin de tirer son manteau sous lui ; et son menton sur ses genoux, il s'endort.
Tout à coup il lui semble que la terre s'est dérobée sous ses pieds. Est-ce lui qui monte ? Est-ce la terre qui descend ? Qu'importe! ce qui se découvre à ses yeux est bien plus beau que la terre. Et tout de suite il sent une odeur délicieuse, comme celle qui sortait de la cave du pâtissier. L'air est embaumé de vanille, de safran, de cannelle, de citron, et un petit vent chaud répand ces bonnes odeurs au loin. Dieu! qu'elles sont enivrantes! Il les sent couler dans ses veines comme le jus des fruits mûrs.
De magnifiques campagnes s'étendent à présent devant lui, avec des tons de pourpre, d'émeraude et de turquoise, jusqu'aux horizons de montagnes qui dentellent l'azur du ciel. Et un abricot, étincelant comme un soleil, répand sa lumière sur les gelées, les sirops et les crèmes du paysage. Jamais le vrai soleil ne lui a paru à la fois si brillant et si humide!
« Seigneur! Seigneur! que tout cela est bon et qu'il fait doux de vivre! » Ainsi se parle Franeesco, car il vient de prendre un bain dans la crème et il a mangé trois îles coup sur coup.
Puis une montagne en caramel se dresse devant lui, surmontée de la même tour qu'il a vue chez le pâtissier. Qui donc habite la tour ? Ce ne peut être qu'une fée, et la fée sans doute est la reine du pays qu'il vient de parcourir.
Mais comment pénétrer dans la muette et splendide tour ? Il cherche en vain la sonnette. Toc, toc! fait-il enfin. Et une voix, douce comme de la confiture, lui répond du fond de la tour : Entrez.
Il entre.
De grands escaliers en sucre montent d'une galerie de pouding vers une galerie de nougat. Toc, toc! fait-il encore. Et la même voix répond : Plus haut.
Toujours frappant, il arrive à la dernière galerie, qui est en biscuit aux amandes, après avoir passé par toute sorte de merveilles ; et tout à coup il se trouve en présence de la petite danseuse du pâtissier. Elle lui sourit très gentiment et lui dit :
- Je t'attendais, mon petit Francesco.
À vrai dire, elle n'était plus posée sur la pointe de son orteil, la jambe droite levée, comme il l'avait aperçue la première fois, au haut de la tour, chez le pâtissier. Non, elle était debout sur ses deux pieds et lui tendait la main, à présent.
Jamais Francesco n'avait vu une si jolie personne, ni plus mignonne, ni plus potelée, ni mieux faite, et elle était tout en sucre, avec des couleurs éclatantes qui la rendaient encore plus à son goût. Oh! c'était de bon sucre, allez! et Si appétissant que Francesco, qui ne savait que répondre à la jolie personne, se mit à lui lécher le cou, sous ses cheveux blond cendré.
D'où vient qu'il pensa tout à coup que cette jolie créature était la même que celle qui lui avait fait la charité, tandis qu'il se trouvait encore sur la terre ? Et comme si la petite danseuse eût compris ce qui se passait en lui, elle lui dit :
- Oui, c'est bien moi. Voici ma main : épousons-nous. Mon royaume sera aussi le tien.
Alors, Francesco mit sa main dans la sienne et ils furent mariés.
Le bel abricot couleur de soleil s'obscurcit en ce moment : aussitôt une teinte crépusculaire revêtit la crête des monts, et la plaine entière se couvrit d'une couche glacée de confitures aux lueurs sombres.
- Voici la nuit, Francesco, lui dit la petite fille en sucre, nous allons nous séparer.
Et Francesco la vit fondre lentement, comme une étoile dans les clartés croissantes du matin, et la tour se fondit, et les montagnes se fondirent et les paysages se mirent à fondre aussi pendant que lui-même se sentait fondre, fondre toujours un peu plus.
Jusqu'à ce que...
Le matin la servante de la maison, en ouvrant la porte pour aller chez le boulanger, trouva sur le seuil un petit cadavre glacé.
- Chut! ne le réveillons pas. Il est parti, le pauvre Francesco, sur l'aile du rêve à travers la nuit de Noël.
 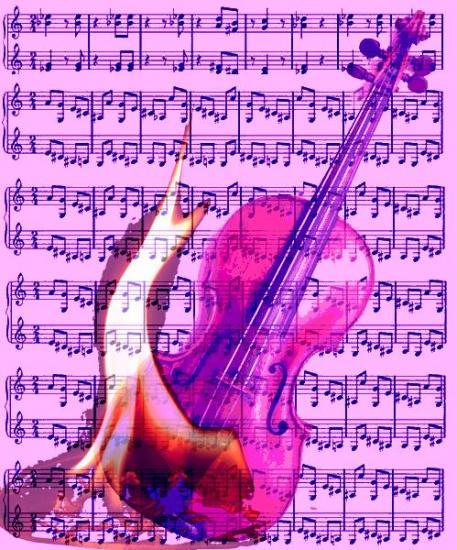   
Posté le : 19/12/2015 19:00
|
|
|
|
|
Ambroise Paré |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 20 décembre 1590 meurt Ambroise Paré
à Paris à 80 ans, né vers 1510 ou 1509 selon les sources au Bourg-Hersent, près de Laval, est un chirurgien et anatomiste français.
Ambroise Paré, chirurgien du roi et des champs de bataille, est souvent considéré comme le père de la chirurgie moderne. Inventeur de nombreux instruments, il participe à l’amélioration et à la diffusion d’une technique de cautérisation d’un nouveau genre. L'utilisation généralisée des armes à feu confronte les chirurgiens à des plaies d'une sorte nouvelle, que l’on cautérise au fer rouge ou à l’huile bouillante au risque de tuer le blessé. Paré met au point la ligature des artères, qu'il substitue à la cautérisation, dans les amputations.
" Je le pansay, Dieu le guarist ".
On cite volontiers cette phrase modeste de Paré pour résumer sa philosophie citation en moyen français signifiant : Je le pansai, Dieu le guérit.
En bref
Chirurgien français, Ambroise Paré a été nommé le « père de la chirurgie moderne ». Né près de Laval, il s'initie à la médecine chez un chirurgien de Vitré. Arrivé à Paris vers 1529, il devient aide-chirurgien-barbier à l'Hôtel-Dieu ; puis maître chirurgien (1536), et entre au service du duc de Montejean qu'il suit au siège de Turin. À la bataille du Pas de Suse (1537), il pratique la première désarticulation du coude et, manquant de l'huile que l'on répandait bouillante sur les blessures par arme à feu, il panse la plaie avec un mélange de jaune d'œuf, d'huile de rosat et de térébenthine ; ses malades guérissent sans présenter les complications habituelles (fièvres, tuméfactions, etc.) rencontrées avec la cruelle cautérisation.
À la mort de son maître, il revient à Paris, se marie, entre dans la corporation des chirurgiens-barbiers (1541), et tient boutique rue de l'Hirondelle à l'enseigne des Trois Bassins. En 1542, il est au service du comte de Rohan qui dirige le siège de Perpignan, et soigne les nombreux blessés ; pour extraire une balle particulièrement mal logée dans l'épaule du maréchal de Brissac, il replace le blessé dans la position qu'il occupait au moment de l'arrivée du projectile qu'il trouve plus facilement ensuite. L'année suivante, il est avec l'armée en Basse-Bretagne où l'on craint un débarquement anglais. Le jour de la Toussaint 1543, il assiste à la bataille de Landrecies contre les impériaux, puis rentre à Paris et commence à rédiger le récit de ses voyages et les observations faites durant ses campagnes. Il obtient, le 20 août 1545, le privilège du roi et fait imprimer la Méthode de traicter les playes faictes par harquebutes et aultres bastons à feu et de celles qui sont faictes par flèches, dards et semblables, qui soulève l'indignation de la faculté de médecine de Paris : l'auteur reconnaît n'avoir pas lu Galien, n'entendre ni le grec ni le latin son ouvrage est rédigé en français.
Après la mort de François Ier en 1547, Paré, dans sa boutique parisienne, prodigue à sa clientèle les soins nécessaires à l'opération de la taille, de la cataracte, à la réduction des fractures ; il pratique les accouchements ; il confectionne et vend des emplâtres. En 1552, la guerre reprend avec la maison d'Autriche, et Paré suit l'armée du comte de Rohan au siège de Danvilliers. Là, il doit amputer un gentilhomme, opération peu pratiquée car l'on craignait l'hémorragie des vaisseaux que l'on cautérisait au fer rouge ; Paré, perfectionnant une vieille technique, ligature les artères du blessé qui survit.
À la mort du comte de Rohan, Paré entre au service d'Antoine de Bourbon qui vante à Henri II les mérites de son chirurgien ; le roi s'attache Paré comme chirurgien ordinaire. En octobre 1552, les soldats du duc François de Guise, assiégés dans Metz par Charles Quint, sont démoralisés par la mortalité à la suite des blessures ; Henri II envoie Paré dont la présence et les soins réconfortent l'armée. L'année suivante, il est fait prisonnier au siège de Hesdin, mais il soigne l'un des vainqueurs qui le renvoie à Paris. Il souhaite alors être reçu docteur en chirurgie, mais la Faculté dresse des obstacles contre cet autodidacte, et il faut l'appui du roi pour qu'il reçoive le bonnet de docteur du Collège de Saint-Côme, le 8 décembre 1554, avec une thèse rédigée en français et sans subir les examens en latin. En 1559, il soigne mais ne peut guérir Henri II, blessé lors d'un tournoi. Il ne peut davantage sauver, en 1560, François II, de santé délicate. Il conserve cependant la confiance de Charles IX, qui, le 1er janvier 1562, le nomme son « premier chirurgien » un mois plus tard, paraît la Méthode curative des playes et fractures de la teste humaine.
Les guerres de Religion vont ensanglanter la France trente ans durant, et Paré va à Rouen soigner Antoine de Bourbon, devenu roi de Navarre et père du futur Henri IV, puis puis à Dreux 1562 et au Havre 1563 où il soigne catholiques et protestants. À son retour, il publie en 1564 les Dix Livres de la chirurgie avec le magasin des instruments nécessaires à icelle, parmi ces instruments, certains figurent encore, à peine modifiés, de nos jours. De 1564 à 1566, Charles IX, voyageant autour de son royaume, emmène son chirurgien qui, à son retour, soigne les blessés des affrontements de Saint-Denis 1567 et de Moncontour 1569. À l'avènement de Henri III il demeure premier chirurgien du roy, mais ne voyage plus ; il défend ses méthodes nouvelles, ligature des artères, traitement des plaies sans huile bouillante, simplification du traitement des luxations et des trépanations, et rédige un Traicté de la peste, de la petite vérolle et rougeolle 1568, ouvrage dans lequel il insiste sur la notion de contagion. La faculté de médecine déclare ces textes contraires aux bonnes mœurs et demande qu'ils soient brûlés en place publique. La protection du roi permet leur publication en 1575. Cette œuvre influence la chirurgie des siècles suivants en la libérant de l'obéissance aux Anciens. Paré disait : Ce n'est pas grand-chose de feuilleter des traités et de caqueter en chaire si la main ne besogne ; ce que fit la sienne durant un demi-siècle passé auprès des blessés. Cette œuvre ne concerne pas seulement la chirurgie militaire où il termine l'exposé de chaque cas par : Je le pansay, Dieu le guarit, mais l'obstétrique Précis d'anatomie et des accouchements, l'ophtalmologie, l'urologie, la pédiatrie, et d'autres domaines encore...
À côté de l'aspect purement médical, se dégage de l'œuvre de Paré un profond sentiment de bonté, de générosité. De nombreuses pages de ses œuvres sont des appels à l'apaisement, à l'entente fraternelle.
Paré fut-il huguenot ? Si tous les actes de sa vie passent par l'église Saint-André-des-Arts, ses deux mariages, les baptêmes de ses enfants, sa sépulture en bas de la nef proche le cloché et s'il fut au service de quatre rois catholiques, son cœur semble bien avoir été du côté protestant. Il ne faut en tout cas pas voir, dans le silence de Paré, une fuite devant sa conscience ou une marque d'indifférence, mais bien au contraire preuve de son amour de l'humanité : avouer son protestantisme aurait signifié, en ce temps de persécution, monter au bûcher, et Paré se savait utile aux hommes ; il sut garder un mutisme digne sur ses convictions personnelles et ne montrer qu'un soin inlassable et généreux à guérir ses semblables.Jacqueline Brossolet
Sa vie
Il est né au Bourg-Hersent, en Mayenne, près de Laval et d'Avesnières, probablement en 1510. Son père, agriculteur et fabricant de coffres, eut quatre enfants : Jean Paré, qui fut barbier-chirurgien à Vitré, en Bretagne ; X. Paré, qui alla s’établir aussi coffretier à Paris, rue de la Huchette ; Anne Paré, laquelle épousa Claude Viart, chirurgien juré à Paris morte le 19 septembre 1581 et Ambroise.
L'instruction d'Ambroise est confiée à un chapelain, qui se dédommage de l'extrême modicité de la pension en faisant de son élève son domestique au lieu de lui enseigner le latin. Ambroise Paré, qui ignorera toute sa vie le grec et le latin, quitte cette place sans avenir et entre comme marmiton chez le comte de Laval. On remarque son sérieux, son intelligence et son adresse ; le barbier du comte le prend pour apprenti. Il coupe le poil, arrange les perruques et va ici et là panser les ulcères. Il devient ensuite aide-soignant d'un barbier d'Angers puis travaille à Vitré avec son frère Jean, lui aussi chirurgien-barbier.
Le métier de chirurgien.
En 1529, il entre comme compagnon chirurgien à l'Hôtel-dieu et déclare : Ce n'est rien de feuilleter les livres de gazouiller, de caqueter en chaire de la chirurgie, si la main ne met en usage ce que la raison ordonne. Durant trois années, Paré côtoie tout ce qui peut être d'altération et maladies au corps humain. Il observe malades et cadavres et enrichit son savoir anatomique. À la fin de ses études, il choisit, sans doute pour des raisons financières, de s'attacher au service du baron René de Montjean, lieutenant-général d'infanterie. Il devient maître barbier-chirurgien en 1536.
Le chirurgien des champs de bataille
Les blessures de guerre selon Ambroise Paré.
Accompagnant le lieutenant-général, il reçoit le baptême du feu en 1537 à la bataille du Pas de Suse huitième guerre d'Italie. Il y pratique la première désarticulation du coude et découvre que la poudre des arquebuses n'empoisonne pas les blessures comme on le croyait. Il voit des scènes atroces et tente avec succès d'adoucir les méthodes de guérison trop brutales qui consistent par exemple à cautériser les plaies à l'huile bouillante. À la mort de Montjean, Ambroise Paré est de retour à Paris. Il se marie le 30 juin 1541 avec Jeanne Mazelin à Saint-André-des-Arts elle décédera, et sera inhumé à église Saint-André-des-Arts, le 4 novembre 1573 en lui laissant la garde de leur fille âgée de treize ans, Catherine, et celle de leur nièce de dix-neuf ans, Jeanne Paré. Il entre alors une première fois au service de René de Rohan.
En 1542, il assiste au siège de Perpignan, alors ville espagnole. Les tentatives de René Ier de Rohan pour reprendre la ville échouent, mais Paré, lui, continue d'élaborer de nouvelles techniques chirurgicales. Le maréchal de Brissac ayant reçu une balle dans l'épaule, il a l'idée de replacer le blessé dans la position initiale au moment de l'impact pour révéler l'emplacement de la balle perdue et ainsi permettre au chirurgien du Dauphin Nicole Lavernault de l'extraire.
En 1543, Ambroise Paré accompagne René Ier de Rohan qui vient dans l'ouest de la Bretagne défendre la province menacée par un débarquement anglais dans le cadre de la guerre entre 1542 et 1546 entre Henry VIII d'Angleterre, allié à Charles Quint, et François Ier.
En 1544, il guérit brillamment François de Lorraine, duc de Guise, grièvement blessé d'un coup de lance au visage, au siège de Boulogne.
La campagne achevée, il se met à la rédaction du récit de ses voyages qu'il souhaite faire paraître en français. Mais il lui faut le soutien du roi face à la faculté de médecine pour voir aboutir son projet ; en 1545 il publie la Méthode de traiter les plaies faites par les arquebuts et autres bastons à feu, et celles qui sont faites par la poudre à canon puis un Traité sur l'accouchement et l'anatomie.
Ambroise Paré utilisant la ligature à Damvillers
par Ernest Board 1877-1934
Au siège de Damvillers, il doit amputer l'un des gentilshommes de l'armée du comte de Rohan. Plutôt que d'appliquer le fer rouge pour éviter l'hémorragie, il tente sa nouvelle méthode et ligature les artères du blessé, qui se rétablira. À la mort de Rohan, tué près de Nancy, Paré entre au service de Antoine de Bourbon, roi de Navarre, puis à celui de Henri II de France, qui l'admit au nombre de ses chirurgiens ordinaires aux côtés de Nicolas Lavernot, Jean d'Amboise et Jean Fromager. Désormais, la carrière de Paré sera intimement liée au destin des souverains de son pays. Il participa à plusieurs campagnes militaires aux côtés du Roi.
En 1557, au siège de Saint-Quentin en Picardie, il note que les asticots d'une certaine mouche aident à la cicatrisation des plaies de blessés. L'asticothérapie est développée ou redécouverte à la fin du XXe siècle, utile contre les souches nosocomiales de bactéries notamment.
Le premier chirurgien du roi
En 1553, il est prisonnier au siège de Hesdin Vieil Hesdin actuellement avant sa destruction par Charles Quint.
À cette époque, la Confrérie de Saint-Côme, qui regroupait les barbiers-chirurgiens depuis le XIIIe siècle, avait été transformée depuis peu en collège de chirurgie. Cependant, les chirurgiens restaient sous la tutelle des médecins, et cherchaient a s'en affranchir, ou au moins à la limiter. Par exemple, les dissections et autopsies étaient effectuées par les chirurgiens, mais, en théorie, en présence d'un médecin, seul autorisé à en rédiger le compte-rendu. Paré ayant une grande réputation et le soutien du roi, le collège de Saint-Côme décida de s'adjoindre Paré. C'est ainsi qu'il reçu le bonnet de maître le 8 décembre 1554 , malgré l'opposition de la faculté de médecine et sa piètre connaissance du latin, pourtant obligatoire. L'appui du roi a été le plus fort.
En 1561 et 1562, il publie deux autres ouvrages dont son Anatomie universelle du corps humain. Le 1er janvier 1562, Catherine de Médicis le nomme premier chirurgien du roi Charles IX. Paré est ensuite renvoyé au secours des armées, d'abord à Rouen, puis à Dreux et au Havre. Les guerres de religion opposant catholiques et protestants huguenots ont repris de plus belle, ensanglantant le pays pour les trente années à venir. De 1564 à 1566, Paré accompagne Charles IX en visite à travers la France et en profite pour débusquer de nouvelles pistes de recherches. En 1564, il publie Dix livres de la chirurgie : avec le magasin des instrumens nécessaires à icelle, où se trouve le premier usage connu du mot bistouri en fait bistorie, féminin dans le sens chirurgical.
La plus grande innovation est, pour les amputations, de ligaturer les artères et de panser la plaie avec un mélange de jaune d'œuf, d'huile rosate et de térébenthine plutôt que de cautériser avec de l'huile bouillante. Il jure de ne plus brûler aussi cruellement les pauvres blessés. La légende raconte qu'eut lieu entre Charles IX et Ambroise Paré cet échange verbal :
« — J'espère bien que tu vas mieux soigner les rois que les pauvres ?
— Non Sire, c'est impossible.
— Et pourquoi ?
— Parce que je soigne les pauvres comme des rois.
Veuf en 1573 de Jeanne Mazelin, il se remarie le 18 janvier 1574 avec Jacqueline Rousselet et aura six autres enfants, le dernier à 73 ans. Un de ses petits-fils est François Hédelin. Couronné en 1574, Henri III de France garde Paré, auprès de lui, en tant que premier chirurgien.
Opinions religieuses
Ambroise Paré a traditionnellement été considéré par les historiens comme protestant. Cependant une polémique à ce sujet est née au xixe, certains historiens d’obédience catholique estimant détenir les preuves de son adhésion à la foi catholique. Certains autres voient en lui un catholique tolérant.
La version traditionnelle repose sur une concordance de témoignage. Celui de Brantôme, un catholique contemporain de Charles IX, et celui de Sully un protestant. Tous deux rapportent, entre autres, que lors du massacre de la Saint-Barthélémy, Ambroise Paré avait trouvé refuge chez le roi Charles IX qui l’avait dissimulé dans sa propre chambre. C’est donc à tout le moins qu’Ambroise Paré était tenu pour protestant à l’époque. La réponse exacte d’Ambroise Paré au roi qui le pressait de se convertir n'a sans doute que valeur d'anecdote "Par la lumière de Dieu, Sire, je crois qu'il vous souvient m’avoir promis de ne me commander jamais quatre choses, savoir : de rentrer dans le ventre de ma mère, de me trouer à un jeu de bataille, de quitter votre service et d’aller à la messe". Par ailleurs, Paré lui-même raconte qu'à la fin de l’année 1562, après la prise de Rouen, "me trouvay à disner en quelque compaignie où en avait quelques-uns qui me hayoient à mort pour la Religion" Œuvres, 1re édit., 1575, p. 939-940. Attaqué à cause de ce passage, Paré, dans sa Responce aux calomnies des médecins, se défendra d'avoir voulu nuire aux catholiques, mais ne protestera pas de son catholicisme. Par ailleurs, Jean-Michel Delacomptée estime que le sauvetage de Paré par Charles IX le jour de la Saint-Barthélemy, raconté par Brantôme, est une légende, mais souligne que Paré, qui, dans ses œuvres, parle de Dieu, de l'Ancien Testament et de Jésus-Christ, ne fait aucune place à la Vierge Marie et aux saints. M. Huchon relève que le chapitre De l'âme, dans le XVIIIe livre des Œuvres, contient un emprunt direct à Jean Calvin et un emprunt textuel au huguenot Philippe de Mornay
A l’appui de la thèse catholique, on relève qu’Ambroise Paré est resté attaché à Antoine de Bourbon après sa conversion au catholicisme et que, d’autre part, Ambroise Paré a continué à avoir une vie liturgique catholique lors des baptêmes, mariages et enterrements dans sa famille. Ces faits incontestables sont toutefois aujourd’hui considérés comme compatibles avec une adhésion à la foi réformée puisque d’une part, il aurait été difficile à un chirurgien tel que Paré de changer brutalement de service sans risquer de perdre son salaire, sa pratique et ses recherches et que d’autre part les curés avaient le monopole des actes d’état-civil. Dans le cadre d’une ville de Paris gagnée à la Ligue, il aurait été suicidaire de se mettre en avant comme protestant, par la même de risquer sa vie et de perdre toute inscription légale, d’autant plus que les édits de mars 1563 et 1567 avaient expressément prévu que les protestants seraient enterrés dans les cimetières catholiques. Jean-Pierre Poirier note de même qu'un document, mis en lumière par Paule Dumaître, attestant le catholicisme de Paré en faveur de son petit-fils pourrait être une attestation de complaisance.
La mort d'Ambroise Paré
Il meurt à Paris alors dominée par la Ligue, le 20 décembre 1590. Pierre de l'Estoile raconte que, quelques jours avant la levée du siège de Paris par Henri IV 29 août 1590, Paré avait adjuré, dans la rue, Pierre de Saint-Priest d'Épinac, archevêque de Lyon, d'intercéder en faveur de la paix pour soulager la misère du peuple et que Pierre d'Épinac en avait été ébranlé, encore que ce fût un langage de politique que le sien.
Ambroise Paré recevra de grandes funérailles à l'Église Saint-André-des-Arts où il fut inhumé. Sa tombe existait encore en 1790, mais on ignore si elle fut détruite lors des profanations révolutionnaire ou après la vente et la destruction de l'église en 1807. On suppose que la tombe, qui comportait sa statue en terre cuite, aurait été installée plus tard à l'église de la Charité rue des Saints-Pères qui fut détruite à la Révolution.
Anecdotes biographiques
Pour améliorer cet article il convient, si ces faits présentent un intérêt encyclopédique et sont correctement sourcés, de les intégrer dans d’autres sections.
À 50 ans, et alors qu'il faisait effectuer des travaux dans sa demeure de Meudon, la pioche de l'un des ouvriers fendit une grosse pierre en deux, d'où sortit… un énorme crapaud plein de vie. On a proposé des explications rationnelles du phénomène, par exemple la présence fortuite d'un crapaud hibernant à proximité de la pierre.
On prête à Ambroise Paré la description fantastique d'une comète qui serait parue en 1528. Dans son Livre des monstres, Paré écrit effectivement : Cette Comète était si horrible et épouvantable, qu'elle engendra si grande terreur au vulgaire qu'il en mourut d'aucune peur : les autres en tombèrent malades .... Mais Paré n'a jamais vu ce qu'il a décrit, et s'est contenté de recopier ce qu'en disait Pierre Boaistuau dans ses Histoires prodigieuses, qui lui-même recopiait un occasionnel de 1528, outrageusement mal traduit d'un exposé de l'astrologue Peter Creutzer, à propos d'un phénomène observé le 11 octobre 1527, et qui n'était pas une comète, mais probablement une aurore boréale. Le texte initial parlait de témoins à demi morts de peur. C'est l'occasionnel français qui les fait mourir de peur, et Paré n'est coupable que d'avoir trop fait confiance à sa source.
Les patients célèbres d'Ambroise Paré
Henri II de France après son accident mortel dans un tournoi, avec Vésale venu de Bruxelles.
François II de France
François de Guise, blessé au siège de Boulogne en 1544, d'où son surnom de Balafré
Anne de Montmorency, après sa blessure qui se révèlera fatale
Antoine de Bourbon, père de Henri IV, qui fut mortellement blessé le 3 novembre 1562 et qui mourut peu après, comme Paré l'avait annoncé, le 17, aux Andelys
Gaspard II de Coligny après sa tentative d'assassinat du 22 août 1572
L'apport d'Ambroise Paré à la chirurgie, à l'anatomie et à la médecine
Prothèses de jambes selon Ambroise Paré - 1575.
La main artificielle d'Ambroise paré.
Ambroise Paré a fait progresser la chirurgie, notamment par la préférence qu'il donna à la ligature des artères sur leur cautérisation après les amputations, par la suppression de l'huile bouillante dans le traitement des plaies par armes à feu et par les prothèses qu'il inventa ou perfectionna45. Il a également amélioré le traitement de la lithiase urinaire maladie couramment dite la pierre, même si, en cette matière, il a beaucoup emprunté sans le dire à Pierre Franco.
En anatomie, il cite ses prédécesseurs, mais les prend parfois en défaut, Vésale en particulier, et on lui doit des descriptions nouvelles ou améliorées.
Selon J.-P. Poirier, la principale originalité d'Ambroise Paré est la conception exigeante qu'il eut de sa profession, tant sur le plan technique que sur le plan humain, conception au service de laquelle il sut mettre un véritable génie de la communication, qui l'amena par exemple à publier ses livres en français, il n'écrivait pas le latin, mais aurait pu se contenter de publier les traductions latines qui furent faites de ses livres.
Paré eut également le mérite de réfuter quelques mythes répandus à son époque. En 1557, par exemple, doutant des propriétés d'antidote universel qu'on attribuait au bézoard, il proposa au roi qu'on en fasse l'essai après avoir empoisonné un condamné à mort. On offrit à un marmiton de la cour, condamné à la pendaison pour avoir volé de l'argenterie, de lui laisser la vie sauve s'il acceptait d'être empoisonné puis soigné à l'aide du bézoard et que le bézoard se montrait efficace. Le marmiton accepta. Paré utilisa alors la pierre de bézoard, sans succès puisque le cuisinier mourut sept heures plus tard. L'inefficacité du bézoard fut ainsi démontrée. Il reste que sa réputation d'antidote ne s'est pas éteinte du même coup.
Paré réfuta également le pouvoir thérapeutique de la mumie chair momifiée et l'existence de la licorne. En revanche, il accueillit sans critique des descriptions d'animaux monstrueux en réalité inexistants.
Œuvres et publications
Page titre ornementée - Les Œuvres d'Ambroise Paré, conseiller et premier chirurgien du roy, IVe édition, G. Buon, Paris, 1585.
Ambroise Paré suspend ses voyages pour se consacrer à la rédaction de ses ouvrages. Autodidacte ne sachant ni le grec ni le latin, il publia à dessein ses ouvrages en français, avec les encouragements de la cour et de ses illustres contemporains, dont Pierre de Ronsard. Ce dernier lui adressa deux poèmes, placés en tête du volume de ses œuvres en 1575. Je n'ai voulu escrire en autre langaige que le vulgaire de nostre nation, ne voulant estre de ces curieux, et par trop supersticieux, qui veulent cabaliser les arts et les serrer soubs les loix de quelque langue particulière, explique Paré dans son avis au lecteur. Paré n'étant pas docteur, la Faculté de médecine, en la personne de son doyen Étienne Gourmelen, tenta de s'opposer à la mise en vente du livre, prétextant qu'il contenait des choses abominables, contraires à la bonne morale. L'affaire fut menée devant le Parlement, sans succès et le livre fut distribué et mis en vente sans modifications.
Œuvres 1585
De chirugica dans la Bibliothèque numérique de l'Université de Strasbourg.
Briefve collection de l'administration anatomique, avec la maniere de cojoindre les os, et d'extraire les enfans tat mors que vivans du ventre de la mere, lors que nature de foy de peult venir a son effect.
Deux livres de chirurgie, de la génération de l'homme, & manière d'extraire les enfans hors du ventre de la mère, ensemble ce qu'il faut faire pour la faire mieux, & plus tost accoucher, avec la cure de plusieurs maladies qui luy peuvent survenir.
Opera chirurgica.
Discours d'Ambroise Paré : à savoir, De la mumie, De la licorne, Des venins, De la peste. Avec une table des plus notables matières contenues esdits discours.
Dix livres de la chirurgie : avec le magasin des instrumens nécessaires à icelle.
La maniere de traicter les playes faictes tant par hacquebutes, que par fleches, & les accidentz d'icelles, comme fractures & caries des os, gangrene & mortification, avec les pourtraictz des instrumentz nécessaires pour leur curation. Et la méthode de curer les combustions principalement faictes par la pouldre à canon. Paris, 1551. Réédition en fac-similé, Paris, P.U.F. Fondation Martin Bodmer, 2007.
La maniere de traicter les playes faictes tant par hacquebutes, que par flèches, & les accidentz d'icelles, come fractures & caries des os, gangrene & mortification, avec les pourtraictz des instrumentz nécessaires pour leur curation, éd. de Paris, 1552.
Les œuvres de M. Ambroise Paré : avec les figures & portraicts tant de l'anatomie que des instruments de chirurgie, & de plusieurs monstres.
Traicté de la peste, de la petite verolle & rougeolle... : avec une brefve description de la lèpre;
Traicté de la peste, de la petite verolle & rougeolle....
Œuvres complètes d'Ambroise Paré revues et collationnées par J.-F. Malgaigne, 3 volumes, Paris, 1840. En ligne : t. 1 ; t. 3. Réimpr. Slatkine, 1970.
Œuvres complètes remises en ordre et en français moderne, par F. de Bissy et R.-H. Guerrand, Union latine d'édition, 1983, 3 tomes et un index.
Des monstres et prodiges, Ed. L'Œil d'or, 2005, Réédition de trois ouvrages de Paré : Des animaux et de l'excellence de l'homme, Des monstres et prodiges et le Discours de la licorne.
Hommages posthumes
Timbre Ambroise, émis en 1943
Plusieurs hôpitaux et cliniques portent son nom dont :
Hôpital Ambroise-Paré de Boulogne-Billancourt
Hôpital Ambroise Paré de Marseille
Centre hospitalier et universitaire Ambroise Paré de Mons
Clinique Ambroise-Paré à Neuilly-sur-Seine
Clinique Ambroise-Paré à Toulouse
Clinique Ambroise-Paré à Thionville .
Il y a également le lycée Ambroise-Paré, à Laval, qui porte son nom.
Anniversaires
Hommage à Ambroise Paré, Allocution d'Alain Ségal, Vieil-Hesdin, 27 juin 2004.
Julien Pierre : « Hommage lavallois à Ambroise Paré » Revue d'histoire de la pharmacie, 79e année, No 288, 1991. p. 32-34.
Ambroise Paré, chirurgien et écrivain français, exposition de la Bibliothèque de l’ancienne Faculté de Médecine de Paris BIUM, conçue pour le 500e anniversaire de la naissance d’Ambroise Paré dédiée à Paule Dumaître - très riche iconographie.
Œuvres d'art
Hommage à Ambroise Paré par Laurent Vignais, Centre Hospitalier de Laval.
Musée du Vieux Château & Les sculptures de la ville de Laval à Laval.
Galerie
Ambroise Paré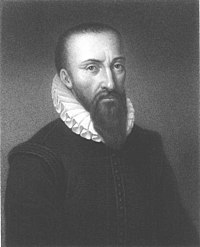       
Posté le : 19/12/2015 15:58
|
|
|
|
|
Nicolas-Toussaint Charlet |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 20 décembre 1792 naît Nicolas-Toussaint Charlet,
à Paris, mort dans la même ville le 30 décembre 1845 à 53 ans, peintre et graveur de nationalité française. Il a pour maître Antoine-Jean Gros et pour elève Charles Cournault il est reçoit pour distinction la légion d'honneur, il est fait officier, son Œuvre la plus réputée est "Tête de chien." Son portrait a paru dans la Galerie de la presse de la littérature et des beaux-arts en 1841.
En bref
Né pendant la Révolution, fils d'un soldat de la République mort au combat, Charlet entre dans l'atelier de Gros, peintre officiel de l'Empereur, en 1815, l'année de la chute de l'Empire, et il y restera jusqu'en 1820, de même que Bonington, Bellangé et Lami. Il manie très tôt le nouvel art de la lithographie (à laquelle il n'a pas, malgré la légende, initié Géricault), et, dès 1817, il donne chez Motte une série de Costumes militaires français, prélude à d'autres séries d'uniformes. En 1820, il accompagne à Londres son ami Géricault. À son retour, il devient l'ami des frères Gihaut, éditeurs lithographes qui publient pour les étrennes des albums à la mode, auxquels collabore Charlet, Croquis lithographiques, 1822-1824, par exemple) de 1822 à 1837. Son art, centré sur les types de l'enfant (Alphabet moral et philosophique à l'usage des petits enfants, Gihaut, 1835 et du soldat (Le Grenadier de Waterloo), montre la vie quotidienne des classes moyennes ; c'est celui du croquis saisi sur le vif, agrémenté d'une légende spirituelle, d'un mot qui transcrit le langage enfantin ou le français oral et populaire. Ce mot, il l'a peut-être noté dans une des guinguettes qu'il aime à fréquenter en compagnie de son imprimeur Villain. Ses opinions bonapartistes se manifestent sous la Restauration et la monarchie de Juillet dans une œuvre lithographique répétitive et abondante 1 200 gravures, ce qui n'empêche pas Louis-Philippe de faire appel à lui pour certaines peintures du musée de l'Histoire de France à Versailles. Ségolen Lemen.
Sa vie
Fils d’un dragon de l’armée de Sambre-et-Meuse, Charlet perd très tôt son père et, élevé à l’École des enfants de la patrie, reçoit une éducation très négligée. Il débute dans la vie par un médiocre emploi la mairie du 2e arrondissement de Paris, chargé d’enregistrer et de toiser les jeunes recrues. Ses opinions bonapartistes et la part active qu’il prend à la défense de la barrière de Clichy, lui font perdre sa place à la Restauration en 1816.
Charlet entre alors, en 1817, dans l’atelier d'Antoine-Jean Gros où il rencontre Gilles-François Closson et, forcé de produire pour vivre, il se voue dès lors tout entier à l’art, pour lequel il se sent une puissante vocation. Il débute par une lithographie, La Garde meurt et ne se rend pas, qui lui fait aussitôt un nom. Les dessins et les aquarelles de Charlet se succèdent alors rapidement et, inspirés par les mêmes sentiments, obtiennent la même popularité que les odes de Béranger.
Il réussit surtout dans le dessin et la lithographie, et acquiert bientôt une vogue immense en traitant les sujets militaires ou des scènes populaires que tout le monde connaît au XIXe siècle, comme Vous ne savez donc pas mourir ?, L’Aumône du soldat, La Résignation ou Le Grenadier de Waterloo.
Il s’exerça aussi avec succès dans la peinture, Épisode de la campagne de Russie, Passage du Rhin en 1796.
Il ouvre un atelier de lithographie dans les années 1820.
Géricault apprécie le talent de Charlet : les deux artistes se lient d’une vive amitié, et font ensemble le voyage d’Angleterre.
En 1832, c’est le général de Grigny qu’il accompagne au siège de la citadelle d'Anvers. En 1838, il est nommé professeur de dessin à l’École polytechnique.
Le caricaturiste Cham fréquente son atelier en 1840 ainsi que Théodore Valerio qui devient à la fois un élève et un ami.
Jules-Antoine Duvaux compte aussi parmi ses élèves.
L’œuvre lithographique de cet artiste infatigable se compose de près de 1 100 feuilles. Il a produit, en outre, près de 2 000 dessins à la sépia, à l’aquarelle, à la plume et des eaux-fortes, et son atelier était rempli d’ébauches à l’huile. Avec Auguste Raffet, Nicolas-Toussaint Charlet est l’un des principaux créateurs de la légende napoléonienne dans le domaine de l’illustration.
L’époque romantique et le Second Empire sont des périodes de vulgarisation de l’histoire dans le domaine du livre. Les ouvrages historiques illustrés se multiplient.
L’illustration est un art populaire dans lequel l’image est accessible à tous et qui doit être immédiatement compréhensible. Charlet crée une iconographie percutante qui va largement contribuer à ancrer la légende napoléonienne dans l’imaginaire collectif. À sa mort, il travaillait à une publication : L’Empereur et la Garde impériale, dont il n’a pu terminer que quatre dessins.
Étroitement mêlé à celui de la lithographie romantique, le nom de Charlet est aussi, comme ceux de Bellangé, Raffet ou Vernet, associé au mythe de Napoléon, dont la gloire rejaillit sur lui. Très populaire auprès de ses contemporains, il s'est spécialisé dans la scène de genre à sujet militaire ou enfantin. Gros admire son Bonaparte, général en chef de l'armée d'Italie, et Delacroix le place après Molière et La Fontaine pour la peinture des caractères ; mais Baudelaire, qui le compare à Béranger, ne l'aime pas du tout : C'est une grande réputation, une réputation essentiellement française, une des gloires de la France. Il a réjoui, amusé, attendri aussi, dit-on, toute une génération d'hommes vivant encore [...]. Cependant, il faut avoir le courage de dire que Charlet n'appartient pas à la classe des hommes éternels et des génies cosmopolites . Il persifle ensuite « le tourlourou et le grenadier » de Charlet le démagogue, et ses « gamins », « ces chers petits anges qui feront de si jolis soldats, qui aiment tant les vieux militaires, et qui jouent à la guerre avec des sabres de bois ». Finalement, il prophétise l'oubli de ce « fabricant de niaiseries nationales, commerçant patenté de proverbes politiques, idole qui n'a pas, en somme, la vie plus dure que tout autre idole » Quelques Caricaturistes français. Baudelaire a vu juste : Charlet a chu dans l'oubli... d'où il mérite d'être exhumé.
Il connut pourtant un regain de faveur à la fin du XIXe siècle : une exposition lui est consacrée en 1893, et Willette en compose l'affiche ; en 1897, une affiche de Hugo d'Alesi pour l'exposition du centenaire de la lithographie montre une Parisienne élégante chinant sur les quais ; elle admire une affiche de Charlet, qui est mise en parallèle avec une œuvre de Chéret, alors tenu pour le maître de l'affiche en couleurs. Charlet, il est vrai, peut être considéré comme l'un des premiers et des plus féconds propagateurs de l'art lithographique en France.
En 1838, il devient professeur à l'École polytechnique, poste qu'il occupe jusqu'à sa mort. Dans cette dernière période, sa production lithographique diminue ; la popularité de Gavarni lui porte ombrage, et se consacre davantage à la peinture ; surtout, il illustre le Mémorial de Sainte-Hélène de Las Cases (2 vol., Bourdin, 1842), et il fournit dans l'année les 500 croquis commandés par l'éditeur au début de 1841, comme pour répondre aux 500 vignettes de Horace Vernet qui ont illustré l'Histoire de l'empereur Napoléon de Laurent de l'Ardèche Dubochet, 1839 : le tirage à 22 000 exemplaires résume bien les gloires conjointes de Napoléon, après le retour des cendres 1840, et de Charlet, l'apôtre de sa légende.Ségolen Lemen
Il a aussi laissé quelques grands tableaux d’histoire, et son Épisode de la retraite de Russie, vers 1836, musée des beaux-arts de Lyon, admirée par Alfred de Musset, fait partie des classiques de la peinture française.
Il fut un bon vivant, aimant boire et chanter, habitué et doyen d’une goguette : les Frileux ou Joyeux.
Une rue du 15e arrondissement de Paris a reçu son nom. Un monument lui est dédié, portrait en médaillon en bronze ornant une colonne en pierre, avec une inscription : « À Charlet 1792-1845, à Paris dans le square de la place Denfert-Rochereau.
Collections publiques
musée d'Évreux :
Le Repos, aquarelle sur papier vélin
Méditation de l’Empereur Napoléon Ier, aquatinte avec rehauts de peinture
Musée des beaux arts de Lyon : Épisode de la retraite de Russie, vers 1836, huile sur toile
Illustrations
La Marseillaise, Paris : Laisné, 1840.
Élèves
Victor de Born-Schlegel
Cham en 1840
Jules-Antoine Duvaux
Théodore Valerio
       
Posté le : 19/12/2015 15:55
Edité par Loriane sur 21-12-2015 19:25:53
|
|
|
|
|
Padre Soler |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 20 décembre 1783 meurt Antonio Francisco Javier
José Soler Ramos, à 54 ans, à San Lorenzo de El Escorial, communauté de Madrid, il est plus connu sous le nom de Padre Soler baptisé le 3 décembre 1729 à Olot, Garrotxa, Espagne, religieux, compositeur, organiste et claveciniste espagnol d'origine catalane.
En bref
Antonio Soler est le principal compositeur espagnol du XVIIIe siècle pour le clavecin si l'on excepte Domenico Scarlatti, Italien qui passa les trente dernières années de sa vie en Espagne et y introduisit son style si particulier, influencé par la musique populaire de son pays d'adoption. Antonio Soler se place directement dans le sillage et la tradition du maître napolitain.
Né à Olot dans la province de Gérone en Catalogne, il commence ses études musicales à l'âge de six ans à l'Escolania de Montserrat. Entré ensuite en religion dans l'ordre des Hiéronymites et ordonné prêtre en 1752, il fait partie de la communauté hiéronymite de San Lorenzo de l'Escurial et devait y passer le reste de son existence tout en exerçant ses dons musicaux en tant que maître de chapelle. Il côtoie ainsi Scarlatti, au service de la monarchie espagnole, et y recueille probablement son enseignement et ses conseils. Parmi leurs points communs, il faut relever leur importante production de sonates pour le clavecin ; ce terme ne correspond d'ailleurs pas, chez ces deux compositeurs, à la sonate classique en 3 ou 4 mouvements : celles de Scarlatti sont en général à un seul mouvement de forme suite, c'est-à-dire de coupe binaire avec reprise, alors que celles de Soler adoptent des structures plus variées.
Sa vie
Organiste et compositeur catalan né à Olot, province de Gérone, le père Antonio Soler est le musicien le plus remarquable de l'Espagne du XVIIIe siècle, dans la mouvance de Domenico Scarlatti. Formé à l'Escolania de Montserrat, où il entra à l'âge de six ans, il apprit le solfège, l'orgue et la composition.
Il fut maître de chapelle à la cathédrale de Lérida, mais renonça à ces fonctions pour prendre l'habit des Hiéronymites au monastère royal de l'Escurial 1752, où il fit profession religieuse l'année suivante. Il fut organiste et maître de chapelle du couvent jusqu'à sa mort. Il y reçut les leçons de D. Scarlatti et de José de Nebra organiste madrilène mort en 1768.
Une grande partie de sa musique a disparu lors de l'occupation de l'Escurial par les troupes napoléoniennes 1808.
La renommée du padre Soler fut fort grande de son vivant.
Il écrivit environ cent vingt sonates pour clavier, dont XXVII Sonatas para clave, des pièces d'orgue intentos, versos, pasos, six concertos pour deux orgues ou clavecins obligés, six quintettes pour cordes et orgue ou clavecin obligé.
Sa production de musique religieuse est considérable et compte environ trois cents compositions : messes, répons, litanies, motets, psaumes, hymnes, antiennes, Magnificat, lamentations, séquences, Benedicamus Domino, invitatoires, leçons, cantates de Noël, villancicos à saint Laurent et à saint Jérôme, etc., le plus souvent à huit voix et jusqu'à douze, œuvres accompagnées d'un ou de deux orgues et ordinairement avec instruments. En musique profane, Soler écrivit quelques comedias, autos mystères, loas prologues de pièces dramatiques et bailes danses. L'écriture pour le clavier est toujours pétillante, primesautière, légère, rythmiquement alerte et pleine d'esprit.
On trouve dans ces ravissantes sonates des locutions qui ont un caractère ibérique, mais dont on est tenté d'attribuer le parrainage à Scarlatti.
À y regarder de plus près, il n'y a souvent qu'une rencontre d'autant plus naturelle qu'ils puisaient tous deux à un même fonds commun. À cet égard, Soler n'emprunte rien à son maître et c'est celui-ci qui s'enrichit de ses emprunts au folklore et au style espagnols R. Bernard. Soler fit aussi œuvre de théoricien : Llave de la modulación y antigüedades de la música, Madrid, 1762 ; Satisfaccíón a los reparos precisos hechos por Don Antonio Roel del Río a la Llave de la modulación, Madrid, 1765. Pierre-Paul Lacas
Antonio Soler meurt à l'Escurial en 1783.
L’œuvre
Fichiers audio
Sonate 84 en ré majeur
MENU0:00
Concerto n° 1 pour deux orgues
MENU0:00
Des difficultés à utiliser ces médias ?
modifier
Sa production musicale est très importante. Elle comprend :
plus de 200 sonates pour le clavecin, dont 29 d'entre elles n'ont été redécouvertes qu'en 2011 lors de l'achat d'un manuscrit par la Morgan Library de New York ;
6 quintettes pour orgue et quatuor à cordes ;
6 concertos pour deux orgues, composés pour l'Infant Gabriel d'Espagne ;
9 messes ;
25 hymnes ;
60 psaumes ;
5 motets ;
5 Requiem ;
13 Magnificat ;
12 Benedicamus ;
21 œuvres pour le service funèbre ;
132 villancicos.
La pièce la plus célèbre de Soler demeure un Fandango, redécouvert au début des années 1960 par le claveciniste Rafael Puyana. Son attribution à Soler est discutée, depuis 1980 en particulier, par Samuel Rubio, bien qu'il ait inclus cette œuvre dans son catalogue sous le numéro R 1461.
Le Padre Soler a aussi rédigé un traité théorique Llave de la modulación (Clef de la modulation) et réalisé des dispositifs mécaniques tels qu'un diviseur du ton majeur en 20 intervalles égaux.
Discographie
Musiques pour clavier
Clavecin
Œuvres pour clavecin, Sonates, Préludes & Fandango - Bob van Asperen, clavecin juin/octobre 1991/janvier 1992, 12 CD Astrée/Auvidis E 8780
Fandango & 9 Sonates pour clavecin 12, 15, 49, 54, 56, 69, 76, 84, 90, 146 - Scott Ross, clavecin décembre 1988, Erato/Warner 244 6417-73
Sonatas para clave I Fandango - 117, 104, 77, 90, 20, 21, 88, 113, 87, 89, 40, Mario Raskin, clavecin 1996, CD Pierre Vérany
Sonatas para clave II 48, 52, 27, 45, 37, 31, 84, 49, 15, 25, 83, 23, 36, 54, Mario Raskin, clavecin 1996, CD Pierre Vérany
Harpsichord Sonatas 84, 117, 47, 43, 100, 39, 81, 74, 78, 90, 21, 77, 10, Virginia Black, clavecin 1998, CD CRD
8 Sonates pour clavecin et Fandango 129, 87, 42, 18, 19, 24, 25, 54, Preludio no 2, Nicolau de Figueiredo, clavecin (CD Passacaille,
El Diablo vestido de fraile, Preludio no 1, no 5 et no 7, Fandango - 74, 11, 18, 81, 37, 10, 96, 90, 100, 84 et minuetto de la sonate 92), Diego Ares, clavecin (2009, CD Pan Classcs PC 10201
Sol de mi fortuna sonates inédites du manuscrit de la Morgan Library, Diego Ares, clavecin
Piano
16 Sonates pour clavier 129, 2, 87, 42, 18, 19, 24, 25, 54, 15, 85, 90, 154, 88, 86, 84, Luis Fernando Pérez, piano
Fandango & Sonates 84, 18, 87, 118, 49, 45, 78, 104, 24, 48, 88, 100, 15, Marcela Roggeri,
Orgue
6 Concertos pour 2 orgues, Tiny Mathot et Ton Koopman, orgues Gaetano Callido de 1785 et Pietro Nacchini de 1757 de la Basilique della Misericordia à Sant'Elpidio a Mare, Italie septembre 1990, Erato/Warner
Musique de chambre
6 Quintettes pour clavecin, 2 violons, alto et basse - Jean-Patrice Brosse, Concerto Rococo
Villancicos
Los Villancicos - Mystères de Noël - Escolania de la Abadia de Santa Cruz del Valle de los Caidos et Ensemble baroque Pygmalion, dir. Jean-Michel Hasler
Partitions éditées en fac-similé
6 Quintettes pour clavecin et cordes par Jean-Patrice Brosse Fuzeau
   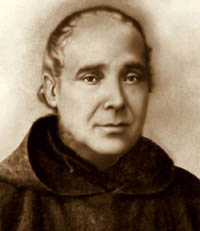  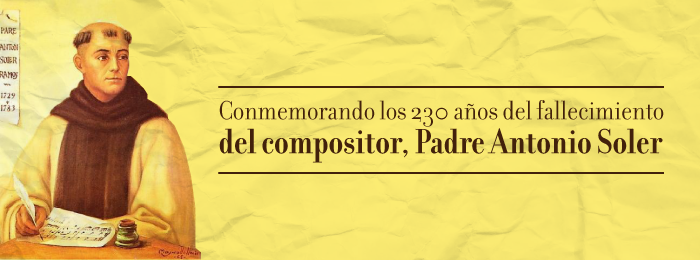  
Posté le : 19/12/2015 15:46
|
|
|
|
|
André Jolivet |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 20 décembre 1974 à Paris meurt André Jolivet
à 69 ans né le 8 août 1905 à Paris et mort le 20 décembre 1974 à Paris est un compositeur français. Il a pour maîtres Louis Feuillard, Paul Le Flem, Edgar Varèse. André Jolivet compte parmi les figures marquantes du XXe siècle musical. Ce chercheur infatigable, cet animateur dont la vitalité ne désarmait jamais a mis toutes ses qualités au service d'une conception supérieure de la musique : C'est le moyen d'exprimer une vision du monde qui est une foi. Viser si haut, cela signifie, pour lui, trouver des langages nouveaux, restituer le contenu du message musical à sa place originelle et chercher ce contenu dans une connaissance toujours approfondie de l'être humain
Sa vie
André Jolivet naît le 8 août 1905 à Montmartre d'un père peintre amateur et comptable à la Compagnie générale des omnibus et d'une mère pianiste amateur. Très jeune, il est attiré par l'art : la peinture, le théâtre, la poésie le passionnent. C'est l'abbé Théodas, maître de chapelle de Notre-Dame de Clignancourt, fondateur de la chorale "Les Menetriers" qui l'initie, dès 1913 aux techniques d'écriture et lui fait découvrir les polyphonies des xvie et xviie siècles1. Le préférant au piano, il apprend le violoncelle avec Louis Feuillard. C'est Georges Valmier, peintre cubiste et baryton, rencontré aux "Menetriers" en 1919, lorsque celui-ci revient s'installer à Montmartre après-guerre, avec qui il travaille la peinture qui, comprenant sa passion pour la musique, lui fait rencontrer Paul Le Flem.
En 1921, Jolivet rentre à l'École normale d'instituteurs d'Auteuil, et s'oriente parallèlement vers la musique. De 1927 à 1932, Paul Le Flem lui fait travailler l'harmonie et le contrepoint. Avec Le Flem, Jolivet apprend la rigueur et la discipline de l'écriture, découvre Schönberg, Berg et Bartók, pour lequel il aura une constante admiration, lui dédiant en 1945, année de la disparition de Bartók, sa sonate n°1 pour piano. En 1929, Le Flem le recommande à son ami Edgard Varèse dont il devient l'élève. De 1930 à 1933 Varèse lui enseigne le son matière et bouleverse radicalement son approche de la musique. De l'enseignement de son maître, Jolivet dira plus tard : Avant Varèse, j'écrivais avec des notes, après Varèse, je composais avec des sons. En 1935, avec Mana, six pièces pour piano, Jolivet a établi son langage personnel. Cette œuvre, qui permet à Jolivet de s'imposer dans le milieu musical, avait notamment la faveur d'Olivier Messiaen qui lui consacra un article élogieux.
En 1936, avec Yves Baudrier, Jean Yves Daniel-Lesur et Olivier Messiaen, il crée Jeune France, groupe destiné à promouvoir la nouvelle musique française et « propager une musique vivante dans un même élan de sincérité, de générosité, de conscience artistique Manifeste de la Jeune France. En 1939, Jolivet est mobilisé à Fontainebleau. L'expérience de la guerre lui inspire Les Trois Complaintes du soldat. De 1945 à 1959, il est directeur musical de la musique à la Comédie-Française. Les nombreuses musiques de scène qu'il compose alors ou réorchestre, viennent s'ajouter à un catalogue où figurent des œuvres aussi importantes que les douze concertos pour huit instruments différents, de nombreuses partitions symphoniques ou de musique de chambre.
En 1959, il fonde à Aix-en-Provence, le Centre français d'humanisme musical, lieu estival dont la vocation était d'être un lieu de rencontre entre compositeurs, musiciens et étudiants. Mais, victime du succès rencontré par cette entreprise, Jolivet dut y renoncer en 1964, préférant se consacrer essentiellement à la composition plutôt qu'à la lourde organisation de cette académie. Entre 1959 et 1962, il est appelé auprès d'André Malraux comme conseiller technique à la direction générale des Arts et lettres. De 1966 à 1970, il est professeur de composition au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.
Une formation originale
André Jolivet est d'abord attiré par le théâtre, puis par la peinture, et ce n'est qu'assez tard qu'il se tourne vers la musique. Ses premiers maîtres sont sa mère, le violoncelliste Louis Feuillard et l'abbé Aimé Théodas, maître de chapelle de Notre-Dame-de-Clignancourt, qui lui enseigne l'orgue, l'improvisation et l'analyse. Toute sa formation se situe en marge des établissements traditionnels et notamment du Conservatoire de Paris. Entre 1928 et 1933, il travaille la composition avec Paul Le Flem, qui le présente à Edgar Varèse en 1930 ; cette rencontre décisive va révéler au jeune compositeur sa voie véritable. Varèse lui fait découvrir le pouvoir du son et les ressources infinies que constitue l'apport des bruits à la musique. D'autres influences se font sentir à cette époque, notamment celles de Berg et de Bartók, mais Jolivet cherche à s'en dégager pour construire un langage personnel. Il ressent aussi la nécessité d'une action commune en faveur de la musique qui va se réaliser en 1935 avec La Spirale puis en 1936 avec le groupe Jeune France (André Jolivet, Olivier Messiaen, Daniel-Lesur, Yves Baudrier), destiné à promouvoir la jeune musique symphonique française.
La guerre interrompt une période d'activité intense où le jeune musicien s'est imposé par son audace. Puis il est successivement directeur de la musique à la Comédie-Française (1943-1959), conseiller technique à la Direction générale des arts et lettres (1959-1962), président de l'association des Concerts Lamoureux (1963-1968) et professeur de composition au Conservatoire de Paris (1966-1970). La consécration officielle ne viendra qu'assez tard : il reçoit le grand prix musical de la Ville de Paris en 1951, le grand prix international de la musique en 1954, le prix du Président de la République en 1958 et en 1972 et, à de nombreuses reprises, le grand prix du disque. Voyageur infatigable, il a dirigé sa musique dans le monde entier.
Une recherche solitaire
La richesse et la complexité de l'œuvre d'André Jolivet placent son auteur dans une position isolée. Loin de toute école, cet instinctif a cherché sa voie en solitaire, éclairé par les révélations sonores de Varèse et s'appuyant sur une parfaite connaissance des formes classiques. Sa musique est construite mieux que toute autre ; elle est aussi plus difficile que toute autre car le compositeur était toujours en quête d'un usage nouveau pour chaque instrument.
Le jeune André Jolivet se détache d'abord du système tonal pour retrouver, dans un langage incantatoire, les sources antiques de la musique. Il n'en adopte pas pour autant le système dodécaphonique dont s'éprennent alors tous les jeunes compositeurs, car il lui reproche d'étouffer les résonances naturelles de la musique. Son Quatuor à cordes (1934) est la première manifestation de cette esthétique ; il est suivi de Mana (1935), cycle de pièces pour piano qui suscite un article enthousiaste d'Olivier Messiaen et révèle le jeune compositeur au monde musical. Jolivet publie ensuite les Cinq Incantations pour flûte seule (1936), Incantation pour ondes Martenot (1937), Cosmogonie pour orchestre (1938) et Cinq Danses rituelles pour piano (1939), orchestrées par la suite. Les bases de son langage sont alors jetées et c'est autour de cette « atonalité naturelle » qu'il construit une « manifestation sonore en relation directe avec le système cosmique universel ». Il abandonne les procédés traditionnels de l'écriture polyphonique et crée une dynamique de la sonorité qui complète une nouvelle conception du rythme déterminée par le lyrisme, par le déroulement des phrases musicales : langage complexe où l'instinct joue un rôle essentiel et grâce auquel Jolivet ne se laissera jamais enfermer dans un système, la forme étant toujours pour lui au service du « chant de l'homme ».
Avec la guerre, il découvre la nécessité de parler une langue plus directe, qui le rapproche du public auquel il veut transmettre son message ; cette époque est marquée par un grand lyrisme : Trois Complaintes du soldat 1940, Symphonie de danses 1940, Dolorès, opéra bouffe 1942, Suite liturgique 1942, Guignol et Pandore, ballet créé à l'Opéra de Paris 1943, Chant de Linos 1944. Pour la Comédie-Française, il compose de nombreuses musiques de scène dont certaines, remaniées, s'imposent au concert parmi ses œuvres majeures Suite liturgique, Suite delphique, Suite transocéane.
Des apports extra-européens
La recherche est la vocation de cet homme qui est toujours en quête de nouveaux moyens d'expression. Aux découvertes instrumentales et aux recherches de timbres vient s'ajouter un langage puisé aux sources des musiques tropicales et exotiques. Il réalise une synthèse entre ces éléments nouveaux et le langage personnel qu'il s'est déjà forgé. Sa Sonate pour piano no 1 (1945) – à la mémoire de Bartók – marque le début de cette nouvelle période pendant laquelle vont naître les grands chefs-d'œuvre d'André Jolivet. Il s'oppose aussi bien à l'académisme qu'au raffinement sonore comme une fin en soi, qu'il soit debussyste ou webernien. En cela, il s'écarte de la tradition française. Sa musique est souvent violente, lyrique. C'est une lutte contre la matière sonore à l'état brut et elle s'impose par sa puissance.
Comme à ses débuts, Jolivet continue de refuser le sérialisme intégral, stérile à ses yeux. Mais il en accepte certains principes appliqués à des musiques modales et construit ses œuvres autour de notes pivots, d'accords ou de rythmes clefs, de groupes sonores. Si les apports extra-européens sont très sensibles dans le Concertino pour trompette (1948) ou le Concerto pour piano, dont la création déchaîne un fameux scandale à Strasbourg en 1952, si les apports des timbres nouveaux sont également prédominants dans le Concerto pour ondes Martenot (1947) – l'une des premières œuvres importantes écrites pour cet instrument – ou Épithalame (1953), une fusion parfaite de ces éléments se dessine progressivement dans des œuvres dont la force et la profondeur s'imposent : trois symphonies (1953, 1959, 1964), La Vérité de Jeanne, oratorio écrit sur le texte du procès de réhabilitation (1956), Le Cœur de la matière, cantate d'après Teilhard de Chardin (1965), Madrigal (1963-1970), Mandala pour orgue 1969, Heptade pour trompette et percussion (1971-1972), Le Tombeau de Robert de Visée pour guitare (1972).
Les formes classiques jouent un rôle déterminant dans l'œuvre de Jolivet. Il trouve notamment dans le moule du concerto un moyen d'expression idéal et n'en compose pas moins de douze pour divers instruments (ondes Martenot, 1947 ; trompette, 1948 et 1954 ; flûte, 1949 et 1965 ; piano, 1950 ; harpe, 1952 ; basson, 1954 ; percussion, 1958 ; violoncelle, 1962 et 1966 ; violon, 1972). On peut en rapprocher Songe à nouveau rêvé, cycle de mélodies sur des poèmes d'Antoine Goléa (1970) qui constitue un véritable concerto pour soprano. L'écriture de Jolivet réclame une grande virtuosité. Chacun de ces concertos a été élaboré en étroite liaison avec les instrumentistes auxquels il était destiné et, comme Ravel, Jolivet a joué un rôle essentiel dans l'évolution de la technique instrumentale et vocale. Ses dernières partitions s'adressent à des formations restreintes : La Flèche du temps (12 cordes solistes, 1973) et Yin-Yang (11 cordes solistes, 1974). Œuvres à thème, elles sont bâties sur les idées forces qui ont servi de jalon à la production de Jolivet : le temps qui passe trop vite, comme une flèche, la dualité et l'unité sublimées, confondues par la pensée musicale.
Au cours des deux dernières années de sa vie, il travaille à un opéra sur un livret de Marcel Schneider, Le Lieutenant perdu, que Rolf Liebermann lui avait commandé pour l'Opéra de Paris. L'ouvrage reste inachevé ; seuls les deux premiers actes sont pratiquement terminés. Une suite en a été tirée, et créée en 1982 sous le titre de Bogomilè.
La production d'André Jolivet se situe à une place isolée dans la musique du XXe siècle. Elle était pour lui la vibration même du monde et il est peut-être l'un des seuls à avoir compris qu'au-delà d'un simple divertissement, au-delà d'une pensée artistique profonde mais peu appréhendée, au-delà d'une esthétique véritable, la mission du compositeur se résumait en une éthique éclipsant finalement tous les moyens techniques. Alain Pâris
En 1972, Rolf Liebermann, directeur de l'Opéra de Paris, commande à Jolivet un opéra Bogomilé ou le lieutenant perdu sur un livret de Marcel Schneider. Le compositeur consacre les deux dernières années de sa vie à cette œuvre restée inachevée. André Jolivet meurt brusquement en décembre 1974.
Dans la tombe à côté de la sienne, repose Henri Sauguet au cimetière parisien de Montmartre inhumé avec son compagnon le peintre Jacques Dupont Section 27 près d'Hector Berlioz.
Prix
1951 : Grand Prix de la Ville de Paris
1954 : Grand Prix des Compositeurs au Festival International de Musique Contemporaine
1958 : Grand Prix du Président de la République
1961 : Grand Prix de la Musique Française de la SACEM
1965 : Grand Prix de la Musique Française de la SACD
1965 : Prix de la Radio-Télévision-Française
7 fois Grand Prix du Disque
Distinctions
Officier de la Légion d'honneur
Médaille militaire 1939-1945
Officier des Arts et des Lettres
Son style
On peut déterminer 3 grandes périodes dans la production de Jolivet. La 1re, qui couvre les années 1930 et dans laquelle il compose notamment Mana, la Danse incantatoire, les Danses rituelles, est caractérisée par une recherche de musique humaine, religieuse, magique et incantatoire, par un retour aux sources. L'influence de son maître Varèse n'y est pas étrangère. La seconde période est celle des années 1940, de l'expérience de la guerre, qui pousse Jolivet à se rapprocher du public en composant une musique plus accessible, écrite dans un langage plus simple Les Poèmes intimes, Les 3 Complaintes du soldat. La dernière période constitue une synthèse des deux autres, que l'on peut situer à partir de la composition de la Sonate pour piano n°1 et dans laquelle s'effectue l'alchimie entre toutes les composantes des autres périodes, c'est-à-dire entre lyrisme, clarté et langage complexe; audace et tradition humaniste; primitivisme, ésotérisme et simplicité. Mais c'est toujours l'émotion dans les œuvres de Jolivet qui prévaut sur la virtuosité.
Son œuvre
Jolivet utilisa les ressources techniques modernes pour composer une musique énergique, souvent modale aux sonorités et aux rythmes audacieux. Il s'est particulièrement attaché à l'écriture concertante avec des concertos virtuoses pour ondes Martenot — instrument électronique à clavier inventé en France en 1928 par Maurice Martenot —, pour trompette et piano, pour flûte, pour piano, pour harpe, pour basson et harpe, pour percussion, pour violoncelle et pour violon. On lui doit également des symphonies et de la musique de ballet — sur des textes de Molière, Claudel, Corneille ou Plaute — et pour des jeux de marionnettes.
Piano
Romance barbare 1920
Sarabande sur le nom d'Erik Satie 1925
Tango 1927
Deux Mouvements prélude, pastorale 1930
Danses pour Zizou 1934
Algeria-Tango 1934
Sidi-Ya-ya 1934
Madia 1935
El viejo camello 1935
Fom Bom Bo 1935
Mana, six pièces pour piano 1935
Cosmogonie 1938
Cinq Danses rituelles 1939
Étude sur des modes antiques (1944
Sonate pour piano n°1 1945
Sonate pour piano n°2 (1957
Musique de chambre :
Sonate pour violon & piano 1932
Quatuor à cordes de Jolivet 1934
Andante pour cordes 1935
Cinq Incantations pour flûte1936
Incantation Pour que l'image devienne symbole, pour flûte en sol 1937
Poèmes pour l'Enfant 1937
Petite suite pour flûte, alto et harpe 1941
Ballet des étoiles 1941
Suite Liturgique 1942
Nocturne pour violoncelle et piano 1943
Pastorales de Noël, pour flûte, basson et harpe 1943
Suite Delphique, pour 12 instruments1943
Chant de Linos, pour flûte, violon, alto, violoncelle et harpe 1944
Cabrioles, pour flûte et piano 1953
Fantaisie-Caprice, pour flûte et piano 1953
Sérénade, pour deux guitares dédiée au duo Presti - Lagoya 1956
Rhapsodie à sept, pour septuor à vent et cordes 1957
Sonate pour flûte et piano 1958
Adagio pour cordes 1960
Sonatine pour flûte et clarinette 1961
Alla Rustica, pour flûte et harpe 1963
Sonatine pour hautbois et basson 1963
Suite en concert pour flûte et percussion et quatre percussions 1965
Suite en concert pour violoncelle 1965
12 Inventions pour quintette à vent, trompette, trombone, et quintette à cordes 1966
Ascèses, pour flûte en sol 1967
Cérémonial, hommage à Varèse pour six percussions 1968
Tombeau de Robert de Visée, suite pour guitare 1972
Pipeaubec, pour flûte et percussion 1972
Une minute-trente, pour flûte et percussion partition inachevée 1972
Musique concertante :
Concerto pour ondes Martenot et orchestre 1947
Concertino pour trompette, orchestre à cordes et piano 1948
Concerto pour flûte et orchestre à cordes 1948
Concerto pour piano et orchestre 1951
Concerto pour harpe et orchestre de chambre 1952
Concerto pour basson, orchestre à cordes, harpe et piano 1954
Concerto pour trompette 1954
Concerto pour percussion 1958
Concerto pour violoncelle n°1 1962
Concerto pour flûte et percussion 1965
Concerto pour violoncelle n°2 1966
Concerto pour violon 1972
Musique orchestrale :
Cinq Danses rituelles version orchestrale, 1939
Danse incantatoire 1936
Cosmogonie version orchestrale, 1938
Symphonie n°1 1953
Symphonie n°2 1959
Symphonie pour cordes 1961
Symphonie n°3 1964
Orgue
Hymne à saint André, pour soprano et orgue 1947
Hymne l'univers, pour orgue 1961
Arioso Barocco, pour trompette et orgue 1968
Mandala, pour orgue 1969
Musique vocale : Chansons
Poèmes pour l'enfant, pour voix et onze instruments 1937
Les Trois Complaintes du soldat, pour voix et orchestre 1940
Suite liturgique pour voix soprano ou ténor, cor anglais prenant le hautbois, violoncelle et harpe 1942
Épithalame, pour orchestre vocal à 12 parties 1953
Songe à nouveau rêvé, concerto pour soprano et orchestre 1971 - 1972
Musique sacrée :
Messe pour le jour de la paix 1940
La vérité de Jeanne, oratorio 1956
Messe Uxor tua à 5 voix pour chœur mixte et 5 Instruments ou orgue 1962
Ballets :
Les Quatre Vérités, ballet en un acte sur un livret de H.R. Lonormand 1939
Ballet des étoiles 1941
Guignol et Pandore 1943
L'inconnue 1950
Ariadne 1964
Marines
Opéras :
Dolorès ou Le miracle de la femme laide 1942
Antigone
Bogomilé ou le lieutenant perdu inachevé   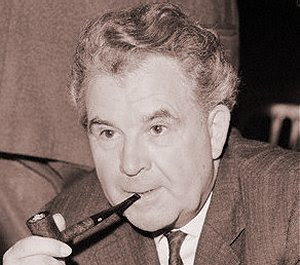  
Posté le : 19/12/2015 15:35
|
|
|
|
|
Arthur Rubinstein |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 20 décembre 1982 à Genève meurt Arthur Artur Rubinstein
il a 95 ans, il naît le 28 janvier 1887 à Łódź en Pologne, pianiste polonais naturalisé americain. Il fut un des interprètes majeurs du XXe siècle. Il fut le mari d'Anelia Mlynarska 1908-2001.
Il est donné à quelques-uns de personnifier la musique face à ceux qui ne l'approchent guère. Herbert von Karajan et Arthur Rubinstein étaient de ceux-là, même si les raisons de ce rayonnement sont très différentes pour chacun d'eux.
En bref
Rarement, pianiste aura exercé séduction plus irrésistible qu'Arthur Rubinstein sur un aussi vaste public. Connaît-on beaucoup d'artistes qui, venant assister à un concert, se font ovationner dès leur entrée dans la salle, comme s'ils saluaient entre deux bis sur l'estrade ? L'image même du bonheur de vivre ne peut manquer d'exercer cette fascination universelle. Le sourire rassurant d'Arthur Rubinstein plane au-dessus de deux guerres mondiales, de la grande crise de 1929, des persécutions raciales, des misères physiques de la vieillesse il avait presque perdu la vue. Avec ce plaisir de jouer évident et cette haine instinctive du travail, il incarne la victoire du don sur l'effort, le triomphe de la jeunesse quand viennent les cheveux blancs, l'inébranlable confiance dans les promesses de l'avenir malgré les difficultés du moment. Tel nous le montre le film – L'Amour de la vie 1975 – que lui ont consacré François Reichenbach et Bernard Gavoty. Débordant d'une stupéfiante vitalité, et cela jusqu'au dernier jour, cet éloge vivant de la paresse savait conquérir les plus réticents par un humour devenu légendaire. Ne confiait-il pas, au cours d'une journée hommage que lui consacrait France-Musique, avec cette célèbre voix rocailleuse : « Je ne suis pas le plus grand [...] je suis le plus vieux !
Arthur ou Artur Rubinstein naît à Łódź le 28 janvier 1887 dans une famille de juifs polonais. L'adversité n'épargne pas sa jeunesse. Son père, marchand de tissus, est ruiné ; il assiste à la brutale répression qu'exercent les Russes contre son peuple et sa religion. Mais, déjà, s'étend sur lui l'aile protectrice de la musique. Enfant prodigieusement doué, il donne son premier récital à cinq ans. À Varsovie, il travaille avec Aleksandr Różycki et peut approcher Ignacy Jan Paderewski. Il se perfectionne ensuite à Berlin avec Karl-Heinrich Barth, Robert Kahn et Max Bruch. Pour son premier concert important, il joue Mozart sous la baguette de Joseph Joachim à Berlin en décembre 1900. Suivent une tournée en Russie avec Serge Koussevitzky, son premier concert parisien en 1904, et ses débuts américains en 1906, avec l'Orchestre de Philadelphie au Carnegie Hall de New York. Paris devient alors son port d'attache, même s'il réside pendant la Première Guerre mondiale à Londres. Il boit, à cette époque, la vie à longs traits, avec une avidité sensuelle qui transparaît sans fard dans son autobiographie en deux volumes, My Young Years 1973 et My Many Years 1980. Mais cette existence à la fois passionnante et facile nuit à la qualité de son jeu, et son talent est bien près de sombrer.
Son mariage avec Aniela, fille d'Emil Młynarski, chef d'orchestre, violoniste et compositeur polonais 1870-1935, est pour lui une véritable planche de salut. Il se stabilise enfin, achète une maison à Paris 1938 et se met à travailler avec la même énergie qu'il avait employée à prendre le meilleur de l'instant qui passe. Les résultats ne se font pas attendre. Il donne des récitals de musique de chambre avec les plus grands Eugène Ysäye, Jascha Heifetz, Emanuel Feuermann... et commence, à plus de cinquante ans, une réelle carrière internationale. Le disque chez E.M.I. puis, surtout, chez R.C.A. le consacre comme une vedette immensément populaire qui s'illustre essentiellement dans le grand répertoire romantique, notamment dans Chopin. Sur les plus grandes scènes du monde, il donne des concerts jusqu'en 1976, faisant preuve d'une longévité musicale peu commune, à l'image d'un Pablo Casals, qui jouait encore en public à plus de quatre-vingt-dix ans. Stravinski avait transcrit pour lui trois danses de Petrouchka et écrit à son intention Piano-Rag-Music 1919. Parmi les partitions qui lui sont dédiées on retiendra la Quatrième Symphonie Symphonie concertante de Karol Szymanowski 1933, des œuvres de Heitor Villa-Lobos, de Germaine Tailleferre, Francis Poulenc (Promenades, 1921 et, surtout, la Fantasia Baetica de Manuel de Falla 1919, partition qu'il n'a jamais jouée, semble-t-il. Il s'éteint le 22 décembre 1982 à Genève, où il s'était fixé en 1980.
Sa vie
Né septième enfant d'une famille de tisserands polonais de la ville de Łódź, sa famille est de confession juive. Arthur Rubinstein n'a aucun lien de parenté avec le célèbre pianiste et compositeur russe Anton Rubinstein 1829-1894. Alors que sa sœur aînée prend des leçons de piano sans manifester grand intérêt, le jeune Arthur, âgé seulement de quatre ans, essaie de restituer les mélodies familières sur les touches. Son talent reconnu très tôt, ses parents le conduisent à Aleksander Różycki, un professeur de piano respecté. Sans trop de succès, car celui-ci dort constamment pendant les leçons d'Arthur. Ses parents n'abandonnent cependant pas.
Il donne son premier concert dans sa ville natale en 1894 et, dès 1898, le violoniste Joseph Joachim le prend sous sa protection, l’envoie étudier à la Hochschule für Musik de Berlin et le recommande au professeur de piano Heinrich Karl Barth. Il y apprend lors d'études exigeantes qui durent sept ans toutes les bases nécessaires pour devenir pianiste virtuose. Il entame sa carrière dans la capitale allemande et commence très vite à jouer dans d’autres pays, notamment en Pologne. Pendant son adolescence, il ne va pas au lycée, mais son précepteur lui donne une culture si solide que, dès ses quatorze ans, il lit les littératures polonaise, russe, française, anglaise et allemande dans le texte.
En 1904, il se rend à Paris où il rencontre Ravel, Dukas et joue même le Second Concerto pour piano de Saint-Saëns en présence du compositeur. En 1906, il fait ses débuts aux États-Unis avant de s'installer à Paris. En 1908, endetté et profondément déprimé, il tente de mettre fin à ses jours. La tentative échoue. Dès lors, débute une vraie carrière internationale entre les États-Unis, l’Australie, l’Italie, la Russie et la Grande-Bretagne. Durant la Première Guerre mondiale, il vit surtout à Londres puis en Espagne où en 1916, il entame une grande tournée de concerts ainsi qu'en Amérique du Sud, ce qui fera de lui un spécialiste de la musique latino-américaine. Ces voyages lui ont en effet permis de connaître les compositeurs tels que de Falla, Granados, Albéniz ou même Villa-Lobos. Ce dernier lui dédie d’ailleurs une pièce.
Mais il faut attendre les années 1930 pour que le pianiste jouisse vraiment d'une renommée internationale. En effet, jusqu'à cette date, les grands pianistes tels que Sergueï Rachmaninov ou Josef Hofmann font de l'ombre à Rubinstein, et plus globalement à tous les autres pianistes. Mais les années 1930 marquent la fin de carrière de ces deux géants, et laissent la place aux jeunes. Or, la plupart sont peu intéressants et percutent le piano. Rubinstein, avec son tempérament romantique, trouve alors sa place : à la fois successeur des grands pianistes post-romantiques et représentant d'une nouvelle génération.
En 1932, le pianiste se retire quelques mois de la scène pour travailler sa technique et son répertoire. Il se marie avec Aniela Młynarska, polonaise, danseuse, polyglotte elle aussi (sept langues et dotée de multiples talents, fille du chef d'orchestre Emil Młynarski. Ils eurent quatre enfants : Eva, Paul, Alina et John.
Durant la Seconde Guerre, il s'installe aux États-Unis et devient citoyen américain à part entière en 1946. En 1954, il se réinstalle à Paris, une ville dont il restera amoureux, avenue Foch, dans la maison qu'il détenait avant guerre et qui avait été réquisitionnée par la Gestapo ; sa fille Eva y vit toujours.
Il refusera à jamais de se produire sur le sol allemand à la suite de la guerre de 1914-1918. Il perdra ensuite plusieurs membres de sa famille polonaise au cours de l'Holocauste du second conflit mondial. Il donnera toutefois des concerts aux frontières de l'Allemagne pour le peuple allemand qui apprécie son art. En grand amoureux de la vie, il continuera à parcourir le monde et en famille durant trente ans, malgré un début de cécité qui se déclare en 1975. Son dernier concert a lieu le 10 juin 1976 à Londres.
Le premier tome de sa biographie paraît en 1973, le dernier en 1980. Il s'éteint deux ans plus tard, toujours jeune et plein d'humour mais presque aveugle, à l'âge de 95 ans, à Genève en Suisse.
À la question de Jacques Chancel lors de l'émission de télévision française Le Grand Échiquier qui lui est consacrée : Croyez-vous à l'au-delà ?, il répond: Non, mais ça me ferait une bonne surprise !. Le 20 décembre 1983 premier anniversaire de sa mort, une urne contenant ses cendres est enterrée en Israël, sur un terrain dédié maintenant surnommé Forêt Rubinstein qui surplombe la forêt de Jérusalem cela fut décidé avec les rabbins pour que la forêt principale ne tombe pas sous le coup des lois religieuses gouvernant les cimetières.
Le style de Rubinstein
Rubinstein est l'interprète inoubliable des Romantiques, promenant sur le clavier la grâce naturelle de son talent là où d'autres émergeaient à force de travail opiniâtre. Il contribue de façon majeure à faire sortir les œuvres de Frédéric Chopin de certaines dérives maniéristes exercées par plusieurs générations d'interprétations malheureuses. Il propage par le disque, nouvellement apparu, une interprétation lyrique et sans fard qui tâcha de souligner, selon ses mots, « la magnifique qualité d'esprit viril qui se cachait en Chopin ».
En effet, s’il garde l’esprit romantique, Rubinstein épure son style, et enlève tout le maniérisme qui peut émaner du jeu des pianistes comme Paderewski. Il garde les meilleurs éléments du courant romantique, mais en rejette les excès. Il est cependant parfois critiqué pour son jeu trop brillant et pas assez intérieur.
Pour Rubinstein, l’interprète doit refléter le message du compositeur tout en l’interprétant. Car sinon, un robot pourrait tout aussi bien le faire. Dans cette optique, il jette un regard peu laudatif sur la jeune génération des années 1960 : dans un entretien donné en 1964, il critique ces jeunes, qui « sont trop précautionneux avec la musique, n’osent pas assez, et jouent automatiquement et pas assez avec leur cœur ». Rubinstein joue en effet avec son cœur, sans larmoiement. Le pianiste Eugen Indjic rapporte que Rubinstein supportait mal, surtout vers la fin de sa vie, que les temps ne soient pas respectés. Autrement dit, il existe une fine limite entre le rubato approprié, et le rubato de mauvais goût. Limite que Rubinstein ne franchissait pas.
Son jeu très apprécié lui a permis d’obtenir de nombreuses récompenses, notamment un Grammy award pour ses interprétations de Beethoven et Schumann, mais aussi des Grammy awards récompensant ses interprétations en musique de chambre avec Pierre Fournier, violoncelle et Henryk Szeryng, violon ; le pianiste lui-même a donné son nom à un concours de piano à Tel-Aviv, qui récompense de jeunes pianistes talentueux.
Un génie complaisant
Qui d'autre, mieux qu'Arthur Rubinstein lui-même, pourrait résumer quatre-vingt-quatre ans de carrière musicale ? « La claire conception des structures d'une composition et l'osmose totale avec les intentions émotives du compositeur ne me posaient jamais de problèmes ; mais, à cause de mes habitudes de paresse, je négligeais de m'intéresser au détail comme au fini et à la précision dans l'exécution des passages difficiles que j'avais horreur de travailler. Je faisais porter tout le poids sur le message intérieur. » Avec une naïve franchise, il met en évidence les éléments qui ont fait de lui l'une des personnalités les plus fêtées de l'estrade mais aussi l'une des plus contestées par la critique. Cette dernière, en effet, ne lui a guère épargné ses flèches, le plus souvent à juste titre, le plus souvent aussi en vain. Et il s'agit moins ici de fausses notes, reflets attardés d'une certaine époque, que de coquetteries de style peu pardonnables, d'effets extérieurs complaisants, de trop fréquentes approximations techniques, d'une rigueur de jeu toute relative, du moins pendant son premier demi-siècle.
Si l'on se penche sur l'héritage discographique d'un interprète infiniment plus à l'aise au concert qu'en studio, force est de reconnaître que son jeu est souvent inégal. Parmi des prestations d'un intérêt tout relatif figurent quelques pépites qui expliquent le charme puissant sous lequel Rubinstein a souvent tenu le public. Tout d'abord, son compositeur d'élection, Chopin, dont il traduit la poésie avec une simplicité et un naturel que bien peu ont pu égaler : les Polonaises (1934), les Mazurkas 1966 et les Nocturnes (par deux fois, en 1936-1937 et en 1966). En compagnie de Jascha Heifetz et d'Emanuel Feuermann – Trio en si bémol de Schubert (1941), Trio opus 8 de Brahms 1941, Sonate pour violon et piano de Franck, 1937) –, du Quatuor Pro Arte – Quatuor no 1 pour piano et cordes de Brahms (1932) –, de Paul Kochanski – Sonate pour violon et piano no 3 de Brahms (1932) –, ou de Gregor Piatigorsky – Sonate pour violoncelle et piano no 1 de Brahms (1936) –, il nous laisse d'incomparables leçons de musique de chambre. Au goût de chacun de choisir entre l'amateurisme parfois génial de sa jeunesse et, malgré le déclin de ses moyens physiques, la sereine maîtrise de la fin de sa vie. Ses dons auraient certainement pu le placer au tout premier rang des musiciens de son temps. Quels que soient les regrets de sa vieillesse, Arthur Rubinstein aura préféré vivre. Tout simplement. Pierre Breton
Distinctions
Chevalier commandeur honoraire4 de l'Ordre de l'Empire britannique (KBE) en 1977
Filmographie
Sélection du Reader's Digest. Novembre 1948. Rubinstein l’aristocrate du piano par Winthrop Sargeant.
Sélection du Reader's Digest. Août 1966. Rubinstein virtuose de la vie. Condensé de Time.
Bernard Gavoty, Arthur Rubinstein. Édit. Kister, Genève 1955. Collect. « Les grands interprètes ».
Arthur Rubinstein : Mes longues années 3 volumes, éd. Robert Laffont, 1973-1980
L'Amour de la vie - Artur Rubinstein, film documentaire de François Reichenbach et Gérard Patris 1969.
 [img width=600]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/Arthur_Rubinstein_(1971).jpg/220px-Arthur_Rubinstein_(1971).jpg[/img]       
Posté le : 19/12/2015 15:13
|
|
|
|
|
John Steinbeck |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 20 décembre 1968 à New York meurt John Ernest Steinbeck JR
à 66 ans, né le 27 février 1902 à Salinas en Californie aux états-unis, écrivain Romancier, nouvelliste, correspondant de guerre américain du milieu du XXe siècle, dont les romans décrivent fréquemment sa Californie natale. Il a reçu le Prix Pulitzer en 1940, le prix Nobel de littérature en 1962, la médaille présidentielle de la Liberté en 1964. Il appartient au mouvement " Génération perdue "
Ses Œuvres principales sont Tortilla Flat, En un combat douteux, Des souris et des hommes, Les Raisins de la colère, La Perle, À l'est d'Eden, Voyage avec Charley
En bref
Steinbeck est avant tout l'écrivain de la générosité. Son œuvre fut une constante dénonciation de la misère des hommes au nom d'une confiance presque mystique en leur inépuisable possibilité de perfectionnement. Il est par là spécifiquement américain et trouve tout naturellement sa place dans une tradition qui remonte à Emerson ou Whitman. La diversité même de son inspiration, qui le mène du roman à la nouvelle, au reportage ou au théâtre, et qui est tour à tour passionnée et humoristique, naturaliste et fantastique, scientifique et poétique, dit bien essentiellement un amour profond de la richesse multiple de la vie qu'il faut savoir saisir sous des formes sans cesse renouvelées. Rien donc ne saurait étouffer pour Steinbeck, malgré les tragédies d'une époque difficile, le jaillissement d'un optimisme qui le pousse continuellement à rechercher le véritable dialogue humain, celui que l'on poursuit avec soi comme avec autrui dans la générosité retrouvée de la vie elle-même lorsque celle-ci est redevenue libre et naturelle. L'innocence d'un paradis perdu, lieu du dialogue originel avec la vie, voilà au fond ce dont, en bon Américain, Steinbeck ne cesse de ressentir la nostalgie.
John Steinbeck est né à Salinas en Californie, d'un père trésorier municipal et d'une mère institutrice, et il vécut en Californie toute son enfance et son adolescence. Ce fut là une circonstance décisive. Terre de soleil riche de vergers, la Californie est aussi terre de rencontre où les traditions venues d'Europe ou d'Orient se mêlent aux traditions des Indiens autochtones, terre neuve donc et à la fois ancienne. En outre, elle représente, pour de nombreux Américains, la dernière « frontière , le rêve américain d'une Terre promise étirée au long du Pacifique. Mais surtout, pour Steinbeck enfant et adolescent, la Californie et plus particulièrement la Grande Vallée » de Salinas, région encore exclusivement rurale à l'époque, fut le lieu du premier contact avec la terre immémoriale. Ne disait-il pas lui-même que ce qui avait le plus marqué son enfance, c'étaient des événements apparemment aussi insignifiants que la naissance d'un poulain ou la manière dont les moineaux au printemps sautillaient sur les chemins de terre. Cycle des saisons donc mais aussi terre des civilisations d'avant l'homme blanc dont les vestiges subsistent dans les clairières sacrées, ou terre d'avant l'homme puisque dans les profondeurs de la vallée on retrouve les coquillages et le sable qui témoignent de l'époque où le pays était recouvert par la mer, et, plus profondément encore, les vestiges pétrifiés des immenses forêts de séquoias que l'Océan a jadis englouties. C'est dans ces profondeurs que l'homme steinbeckien plonge ses racines. Le Nouveau Monde qu'est l'Amérique retrouve ainsi une histoire plus vaste que la simple histoire des hommes, et c'est par elle qu'il va essayer de se redéfinir, sa nouveauté n'étant que le signe de ses retrouvailles avec l'immémorial.
Le déracinement que symbolise le voyage constitue l'autre volet de l'œuvre. Le monde du XXe siècle arrache l'homme à la terre et le lance à la poursuite d'un nouveau rêve. Ce thème du voyage, lui aussi profondément américain, illustre alors l'inquiétude de l'homme moderne. Mais, chez Steinbeck, il se situe autant dans le temps que dans l'espace. Il trouve alors un sens car il est aussi retour aux sources, manière de retrouver le cycle éternellement recommencé de la vie par la référence à un passé mythique sans cesse répété, que ce soit par exemple l'Exode biblique et la quête de la Californie promise des Raisins de la colère, ou la chute et la recherche du paradis de À l'est d'Éden. La terre et le voyage, loin d'être opposés, sont ainsi intimement liés dans un éternel recommencement.
On voit donc comment, au-delà du réalisme steinbeckien, se dessine toujours un horizon mythique. Romancier social et naturaliste, romancier tellurique, Steinbeck est aussi le romancier d'une libération de l'imagination. La fantaisie, l'humour, le fantastique donnent à sa description du monde américain moderne des résonances symboliques qui y font constamment passer le souvenir de récits légendaires.
Sa vie
Il naît en Californie, à Salinas, le 27 février 1902. John Steinbeck Senior, son père, est trésorier, et sa mère, Olive Steinbeck, est enseignante. Il a trois sœurs : Elizabeth 1894-1992, Esther 1892-1986 et Mary 1905-1965. Son grand-père paternel, Johann Adolf Großsteinbeck était un allemand originaire de Heiligenhaus. Après le lycée à Salinas, il étudie à Stanford, mais abandonne ses études, et en 1925 il part à New York, où il occupe divers emplois reporter, apprenti peintre, maçon, ouvrier et chimiste. Il y travaille brièvement au New York American, mais rentre à Salinas dès 1926.
Il publie en 1929 un premier roman, La Coupe d'or Cup of Gold: A Life of Sir Henry Morgan, Buccaneer, With Occasional Reference to History, une fiction historique basée sur la vie de Henry Morgan, qui ne rencontre pas le succès. En 1930, il épouse Carol Henning et déménage à Pacific Grove. Il y rencontre Ed Ricketts, un biologiste avec qui il se lie d'amitié.
En 1932, il publie Les Pâturages du ciel The Pastures of Heaven, un recueil de nouvelles se situant dans la ville de Monterey. En 1933, il publie Le Poney rouge The Red Pony et Au dieu inconnu To a God Unknown. Il reste ensuite au chevet de sa mère qui meurt en 1934. Il commence à recueillir des informations sur les syndicats fermiers. Son père meurt en 1935.
Tortilla Flat, écrit en 1935, lui vaut son premier prix littéraire, la médaille d'or du meilleur roman écrit par un Californien décernée par le Commonwealth Club of California. Cette histoire humoristique lui assure le succès. Il devient ami avec son éditeur, Pascal Covici.
Avec Des souris et des hommes Of Mice and Men et En un combat douteux In Dubious Battle, publiés en 1936, ses œuvres deviennent plus sérieuses. Dans une lettre à un ami, il se désole : Il y a des émeutes dans Salinas et des meurtres dans les rues de cette chère petite ville où je suis né. Il reçoit le New York Drama Critics Award pour sa pièce.
Après La Grande Vallée The Long Valley en 1937 et Les Bohémiens des vendanges série de sept articles écrits en 1936 pour le San Francisco News intitulés The Harvest Gypsies et publié, sous forme de pamphlet, avec pour nouveau titre Their Blood Is Strong, un reportage sur les travailleurs immigrants, en 1938, il publie Les Raisins de la colère The Grapes of Wrath en 1939, qu'il considère comme sa meilleure œuvre. Néanmoins, estimant que son écrit est trop révolutionnaire pour connaître le succès, il conseille à son éditeur un petit tirage… Le livre connaît le succès. On lui reproche néanmoins le langage utilisé et les idées développées. Le livre est interdit dans plusieurs villes de Californie. En 1940, lorsque le roman est adapté au cinéma par John Ford sous le même titre The Grapes of Wrath, il reçoit le prix Pulitzer.
En 1941, il lance une expédition marine avec Ricketts, publie Dans la mer de Cortez Sea of Cortez, écrit en collaboration avec son ami. Puis Steinbeck publie Lune noire The Moon Is Down, traduit aussi sous le titre Nuits noires, en 1942. Cette même année, il divorce et épouse Gwyndolyn Conger en 1943. Lifeboat, dont il a écrit le script, sort au cinéma en 1944. La même année, il déménage à Monterey, mais y est mal accueilli par les habitants. Il déménage à New York. Il a un premier fils, Thom qui sera l'oncle du chanteur Johnny Irion.
Après avoir écrit Rue de la sardine Cannery Row en 1945, il déménage à Pacific Grove en 1948. Il commence ses recherches pour l'écriture de À l'est d'Éden East of Eden. En 1946, son second fils, John IV, vient au monde. Il essaye d'acheter le ranch où se déroulent les aventures du Poney rouge, mais il échoue. Les personnages de Rue de la sardine se retrouvent dans un autre roman, Tendre jeudi Sweet Thursday.
En 1947, il publie La Perle The Pearl et part en URSS, accompagné du photographe Robert Capa, pour le New York Herald Tribune. Il en tire Journal russe Russian Journal en 1948. Ricketts meurt dans un accident de voiture. Il divorce.
Il rencontre Elaine Anderson Scott en 1949 et l'épouse en 1950. En 1952, il participe au film de Elia Kazan, Viva Zapata! et publie À l'est d'Éden.
Il publie en 1954 Tendre jeudi Sweet Thursday. Une comédie musicale, Pipe Dream, en est tirée en 1955. Il déménage à Sag Harbor, dans l'État de New York. En 1957, la ville de Salinas propose de donner son nom à un lycée. Il refuse.
En 1958 est publié Il était une fois une guerre Once There Was a War, recueil de ses reportages durant la Seconde Guerre mondiale. Il a une attaque en 1959, ce qui l'encourage à voyager en Angleterre et au Pays de Galles, puis à parcourir l'Amérique en 1960.
En 1961, il publie L'Hiver de notre mécontentement The Winter of Our Discontent son dernier roman, traduit par la suite sous le titre Une saison amère, en espérant revenir en arrière de presque quinze ans et recommencer à l'intersection où il avait mal tourné. Il est alors déprimé, et estime que la célébrité l'a détourné des vraies choses.
Les premières critiques sur le livre sont mitigées, mais il reçoit néanmoins le Prix Nobel de littérature en 1962. Après un autre voyage en Europe en 1963 avec Edward Albee, il reçoit la médaille présidentielle de la Liberté en 1964.
En 1966 est publié son ultime livre, Un artiste engagé America and Americans, un recueil de reportages, de chroniques et d'essais politiques. Il meurt le 20 décembre 1968 à New York d'artériosclérose.
Son œuvre
On retrouve plusieurs dominantes dans l'œuvre de Steinbeck, avec d'abord la Californie en général, et en particulier les villes où il a vécu. Il met souvent en scène des personnages communs, de classe ouvrière, confrontés au Dust Bowl et à la Grande Dépression.
Tout au long de sa vie, John Steinbeck aime se comparer à Pigasus de pig, cochon en anglais et Pegasus, un cochon volant, attaché à la terre mais aspirant à voler. Elaine Steinbeck explique ce symbole dans une lettre en parlant d'une âme lourde mais essayant de voler.
The Moon Is Down est paru en 1942. Il en existe une version française publiée à Lausanne sous le titre Nuits sans Lune en 1943. Cette version comporte, par rapport au texte original certaines coupures et certaines altérations, et ce pour des raisons faciles à comprendre. En effet, si à aucun moment de son récit, Steinbeck n'a explicitement désigné l'armée d'invasion comme étant allemande, de nombreuses mentions y sont faites de l'Angleterre, de la guerre de Russie, de l'occupation de la Belgique vingt années auparavant, qui ne laissent subsister aucun doute, et avaient donc dû être supprimées dans l'édition de Lausanne. La traduction française intégrale est parue en 1994 sous le titre Lune noire.
Les premières œuvres : réalisme et fantaisie
Inscrit à l'université de Stanford où il étudie la biologie, le jeune Steinbeck supporte mal la vie universitaire. Il tâte alors un peu de tous les métiers ; il est ouvrier agricole, matelot, puis travaille sur le chantier du Madison Square Garden à New York. Il devient un moment journaliste, mais sans succès. Congédié, il retourne en Californie où il trouve un poste de gardien dans les montagnes près du lac Tahoe. C'est là qu'il écrit son premier roman, Coupe d'or Cup of Gold, 1929, récit d'aventures mettant en scène un boucanier gallois du XVIIe siècle, à la recherche à la fois de la femme idéale et du trésor de Panama. En 1930, il se marie et s'installe à Pacific Grove où il rencontre un biologiste, Edward Ricketts, qui aura une très grande influence sur sa pensée et deviendra dans son œuvre le prototype de l'homme de science ouvert à la vie. En 1932 paraissent Les Pâturages du ciel The Pastures of Heaven et en 1933 Au Dieu inconnu To a God Unknown, hymne panthéiste à la vie dont l'épigraphe est un extrait du Rigveda.
C'est seulement avec Tortilla Flat 1935 que Steinbeck connaît une certaine renommée. On y trouve une fantaisie faite d'humour et de mélancolie qui en assurent le succès. Le roman décrit à Monterey, petit port de pêche californien, la vie de Danny et de ses copains, des paisanos nés d'un assortiment de sang espagnol, indien, mexicain et caucasien. Gais, insouciants, totalement réfractaires à tout travail, aimant avant tout les femmes, le vin et la ripaille, ils vivent en marge de la société et deviennent, dans l'imagerie steinbeckienne, de modernes chevaliers de la Table ronde dont les aventures rocambolesques ont pour but de distraire et de faire rêver, sans trop y croire, d'un monde où tout serait plus simple.
Dans la veine de ces premiers romans, on voit se dégager les éléments de l'inspiration de Steinbeck, le réalisme des êtres simples croqués sur le vif, mais aussi la fantaisie qui sait dégager chez eux une manière de prendre la vie qui fait que l'échec n'est jamais complet puisqu'il est racheté par le rêve.
Dans Des souris et des hommes Of Mice and Men, 1937, l'inspiration s'élargit. C'est la peinture du monde des journaliers agricoles de l'Ouest, et on sent passer comme un lointain écho de la conception marxiste de la lutte des classes dans la structure dialectique du livre partagé entre les deux personnages principaux comme entre le monde des propriétaires et celui des ouvriers itinérants. Là aussi, le réalisme social et économique est métamorphosé par l'allégorie. Dans ce roman, il s'agit avant tout de l'innocence impossible, et on n'est pas sans remarquer ici des résurgences puritaines. Dans la condamnation de l'innocence de Lennie tenté par la femme, on reconnaît un thème biblique ; mais, dans le portrait de ce retardé mental qui ne peut aimer sans détruire, c'est l'innocence de la nature elle-même qui est mise en cause. On voit ainsi s'introduire un doute dans l'optimisme naturel de Steinbeck, qui réapparaîtra dans À l'est d'Éden.
Les grands romans sociaux
Si le doute s'insinuait dans Des souris et des hommes, le grand souffle épique de la révolte le dissimule dans Les Raisins de la colère The Grapes of Wrath, 1939 qui relate l'exode vers la Californie de fermiers endettés de l'Oklahoma, chassés par les grandes banques. La générosité de l'inspiration steinbeckienne, nourrie ici d'indignation autant que l'espoir, fait vibrer le style et exploser l'imagination en une multiplicité de références mythiques, l'Exode biblique, le sacrifice du Christ, la Vierge déesse mère nourricière, qui tentent de donner un sens à la tragédie des Okies. En fait, l'excessive abondance de ces justifications mythiques tend à dénaturer la vérité du sentiment en plaquant l'espoir théorique sur la réalité de la souffrance. En même temps, cela aboutit à une simplification des caractères et des problèmes posés. Mais on voit aussi se développer de nouveaux thèmes, celui en particulier du « groupe » et, au-delà, de la fraternité humaine des masses par opposition à un individualisme étriqué. Et c'est surtout la puissance des images, les descriptions de paysages, des forces élémentaires, qu'elles soient celles de la nature ou de masses d'hommes empoignés par la peur ou la colère, qui frappe. Un nouveau type de roman apparaît, le roman de masse – masse amorphe de chômeurs se mettant lentement et lourdement en marche –, roman brut, lui-même massif, tout d'une pièce et d'un seul mouvement. La référence au Déluge qu'on trouve à la fin dit bien la puissance grandissante, à la fois terrible et exaltante, de cette masse où se dessinent les premiers signes du mouvement.
Autres romans sociaux : En un combat douteux In Dubious Battle, paru en 1936, a pour thème les grèves des saisonniers californiens, et, de moindre envergure, Nuits noires The Moon is Down, 1942, qui se situe en Europe pendant l'occupation allemande, fait réapparaître la question du bien et du mal déjà posée dans Des souris et des hommes. On s'aperçoit alors qu'il y avait toujours eu, chez Steinbeck, sous l'apparente simplicité, une complexité morale. En fait, son imagination s'était constamment nourrie de contradictions internes. Elle va chercher maintenant à leur trouver une unité.
La recherche d'un humanisme
À l'est d'Éden East of Eden, 1952 illustre le mieux cette nouvelle étape. On y retourne dans la vallée de Salinas qui n'est plus maintenant paradis, mais jardin à l'est d'Éden où Adam et Ève vivent après la chute. C'est l'histoire, à peine déguisée, de Caïn et d'Abel, entremêlée de réflexions philosophiques où l'ancienne inspiration « panique » se conjugue difficilement avec le nouveau soupçon à l'égard de la nature humaine. Le dernier mot reste à Lee, vieux domestique chinois plein de sagesse, qui, en reprenant le mot biblique « timshel », qu'il traduit par « tu peux », réaffirme le libre choix humain. Steinbeck aboutit, en fin de compte, à un humanisme difficile, déchiré entre la possibilité du bien et celle du mal. Il y a beaucoup de banalités dans tout cela, même si la pensée se fait plus complexe, et le parallélisme exact avec l'histoire biblique impose au récit un cadre trop rigide pour que l'imagination s'y déploie à l'aise et pour que les personnages y vivent de leur vie propre. Mais il y avait dans ce livre, le dernier grand livre de Steinbeck, une ambition d'allégorie morale dans la tradition américaine qui méritait mieux que cette demi-réussite.
Steinbeck connaît alors une fin de carrière décevante que ne rachète pas le prix Nobel contesté qu'il reçoit en 1962. Son dernier roman, L'Hiver de notre mécontentement The Winter of Our Discontent, 1961, marque un désenchantement de l'auteur en même temps qu'un déclin. Steinbeck meurt à New York. Son œuvre, prise dans son ensemble, révèle un talent puissant mais parfois brouillon, plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Bien qu'aisément tenté par un sentimentalisme facile et un symbolisme excessif et mal contrôlé, d'une psychologie trop stéréotypée, il est souvent illuminé par la fraîcheur spontanée de l'imagination et la générosité passionnée qui l'inspire. Robert Rougé
Attribution du prix Nobel
Lorsqu'en 2012, la Fondation Nobel rend publiques les archives des délibérations vieilles de cinquante ans comme le stipule le règlement, elle révèle que John Steinbeck fut récompensé par défaut. Les quatre autres auteurs retenus dans la sélection finale de 1962 étaient la Danoise Karen Blixen, le Français Jean Anouilh puis les Britanniques Lawrence Durrell et Robert Graves. Il fut d'emblée décidé que Durell serait écarté. Blixen mourut un mois avant l'élection du gagnant et Anouilh fut évincé car sa victoire aurait été trop proche de celle Saint-John Perse, le dernier lauréat français. Graves, quant à lui, était connu comme poète bien qu'il ait publié quelques romans. Mais pour Anders Österling, secrétaire perpétuel d'alors de l'Académie suédoise, personne dans la poésie anglophone n'égalait le talent d'Ezra Pound dont il fut décidé qu'il serait privé de la récompense à cause de ses positions politiques. Steinbeck obtint finalement le prix. L'annonce de son couronnement fut mal reçue par la presse suédoise et américaine pour qui il était un auteur du passé. En effet, l'écrivain américain n'avait rien publié de marquant depuis longtemps et ses grands romans Les Raisins de la colère, Des souris et des hommes et À l'est d'Eden étaient derrière lui. Quand il répondit à un journaliste lui demandant s'il méritait la distinction, Steinbeck, lui-même surpris par sa victoire, répondit : Franchement, non.
Œuvres
Il existe une catégorie consacrée à ce sujet : Œuvre de John Steinbeck.
La liste ne répertorie que la première édition en français.
Romans
Cup of Gold 1929
Publié en français sous le titre La Coupe d'or, traduit par Jacques Papy, Paris, Gallimard, « Du monde entier », 1952
To a God Unknown 1933
Publié en français sous le titre Au dieu inconnu, traduit par Jeanne Witta-Montrobert, Paris, Gallimard, « Du monde entier », 1950
Tortilla Flat 1935
Publié en français sous le titre Tortilla Flat, traduit par Brigitte V. Barbey, Lausanne, Marguerat, « La Caravelle » no 7, 1944
In Dubious Battle 1936
Publié en français sous le titre En un combat douteux, traduit par Edmond Michel-Tyl, Paris, Gallimard, « Du monde entier », 1940
Of Mice and Men 1937
Publié en français sous le titre Des souris et des hommes, traduit par Maurice-Edgar Coindreau, Paris, Gallimard, 1939
The Grapes of Wrath 1939
Publié en français sous le titre Les Raisins de la colère, traduit par Marcel Duhamel et Maurice-Edgar Coindreau, Paris, Gallimard, 1947
The Moon Is Down 1942
Publié en français sous le titre Lune noire, traduit par Jean Pavans, Paris, J.-C. Lattès, 1994
Cannery Row 1945
Publié en français sous le titre Rue de la sardine, traduit par Magdeleine Paz, Paris, Gallimard, « Du monde entier », 1947
The Wayward Bus 1947
Publié en français sous le titre Les Naufragés de l'autocar, traduit par Renée Vavasseur et Marcel Duhamel, Paris, Gallimard, 1949
East of Eden 1952
Publié en français sous le titre À l'est d'Éden, traduit par J.-C. Bonnardot, Paris, Del Duca, 1956
Sweet Thursday 1954
Publié en français sous le titre Tendre Jeudi, traduit par J.-C. Bonnardot, Paris, Éditions Mondiales, 1956
The Short Reign of Pippin IV 1957
Publié en français sous le titre Le Règne éphémère de Pépin IV, traduit par Rose Celli, Paris, Del Duca, 1957
The Winter of Our Discontent 1961
Publié en français sous le titre L'Hiver de notre mécontentement, traduit par Monique Thiès, Paris, Del Duca, 1961
Courts romans
The Red Pony 1933
Publié en français sous le titre Le Poney rouge, dans La Grande Vallée, traduit par Marcel Duhamel et Max Morise, Du monde entier, 1946
The Pearl 1947
Publié en français sous le titre La Perle, traduit par Renée Vavasseur et Marcel Duhamel, Paris, Gallimard, Du monde entier, 1950
Burning Bright 1950
Publié en français sous le titre La Flamme, traduit par Henri Thiès, Paris, Del Duca, 1951
Recueils de nouvelles
The Pastures of Heaven 1932
Publié en français sous le titre Les Pâturages du ciel, traduit par Louis Guilloux, Paris, Gallimard, 1948
The Long Valley 1938
Publié en français sous le titre La Grande Vallée, traduit par Marcel Duhamel et Max Morise, Du monde entier, 1946
Récits, reportages et mémoires
The Harvest Gypsies ou Their Blood Is Strong 1938, recueil d'articles
Publié en français sous le titre Les Bohémiens des vendanges, traduit par Jean-François Chaix, Paris, Éditions Mille et une nuits, « Petite collection » no 254, 2000
The Log from the Sea of Cortez 1941-1951
Publié en français sous le titre La Mer de Cortèz, traduit par Rosine Fitzgerald, Paris, Éditions maritimes et d'outre-mer, 1979 ; réédition de la même traduction sous le titre Dans la mer de Cortez, Arles, Actes Sud, 1989
Bombs Away: The Story of a Bomber Team 1942
A Russian Journal 1948
Publié en français sous le titre Journal russe, traduit par Marcel Duhamel, Paris, Gallimard, 1949
Once There Was A War 1958
Publié en français sous le titre Il était une fois une guerre, traduit par Henri Thiès, Paris, Del Duca, 1960
Travels with Charley: In Search of America 1962
Publié en français sous le titre Mon caniche, l'Amérique et moi, traduit par Monique Thiès, Paris, Del Duca, 1962 ; réédition de la même traduction sous le titre Voyage avec Charley, Arles, Actes Sud, 1997
America and Americans 1966
Écrits posthumes
Journal of a Novel: The East of Eden Letters 1969
Viva Zapata! 1975, scénario du film d'Elia Kazan
Publié en français sous le titre Zapata, suivi de Viva Zapata !, traduit par Christine Rucklin, Paris, Gallimard, Du monde entier, 2003
The Acts of King Arthur and His Noble Knights 1976
Publié en français sous le titre Le Roi Arthur et ses preux chevaliers, traduit par Patrick et Françoise Reumaux, Paris, J.-C. Godefroy, 1982
Working Days: The Journals of The Grapes of Wrath 1982
Steinbeck in Vietnam: Dispatches from the War 2012
  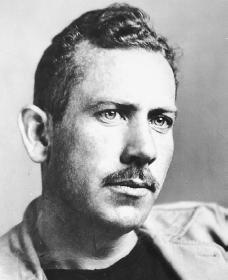 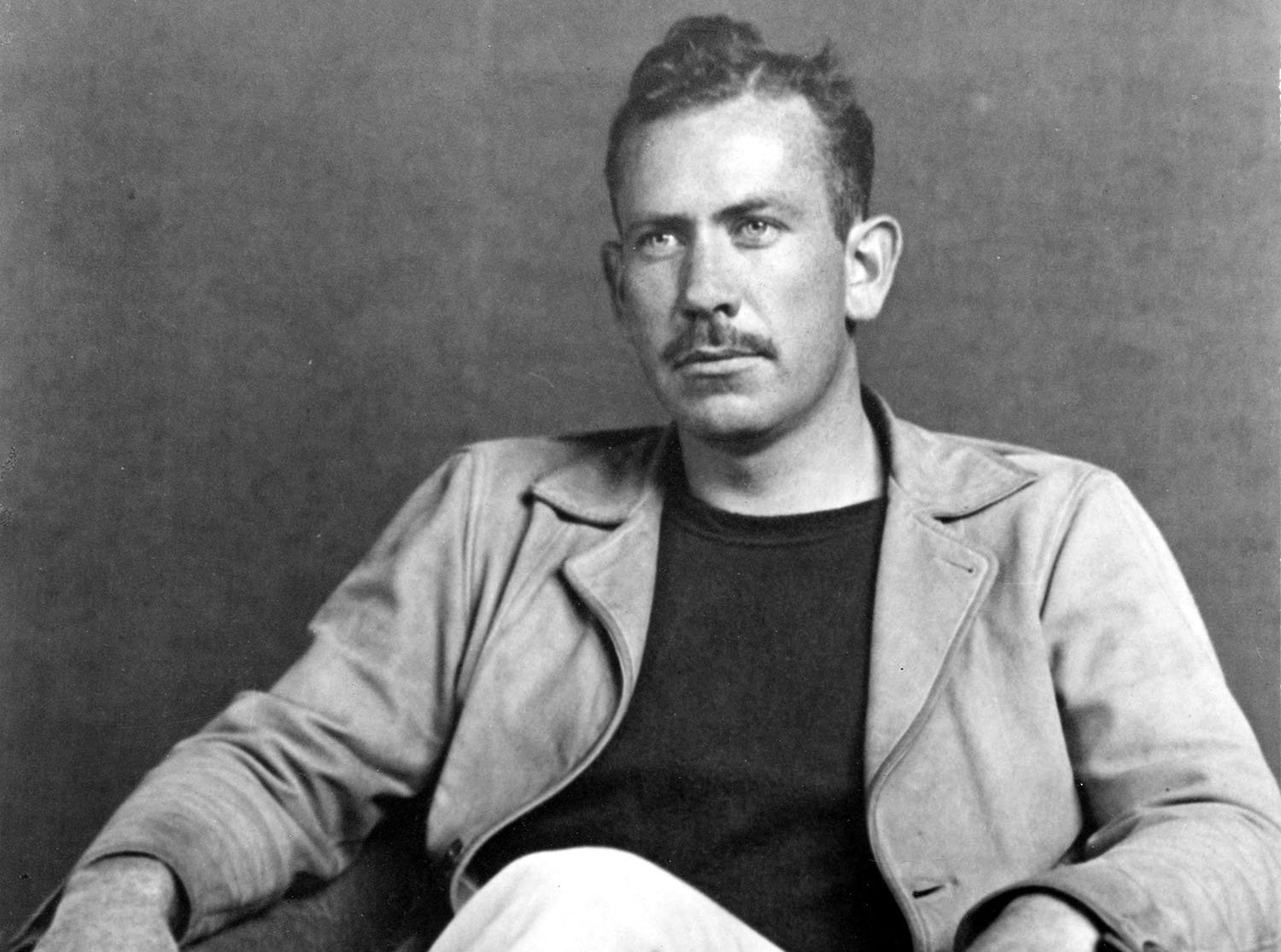    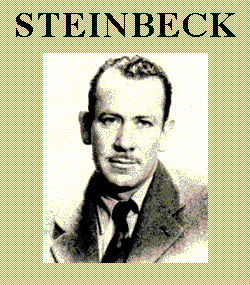
Posté le : 19/12/2015 14:53
|
|
|
|
|
Re: Défi du 19 décembre 2015 |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
10/07/2014 10:51
De vignes de la pettie fin
Niveau : 19; EXP : 7
HP : 0 / 451
MP : 140 / 13168
|
Chère Couscous
Quel beau défi!!!
Beau temps de Noel à chacun d'entre vous!
Magnifique temps de Noel où tout est possible!
Mille bises
Belle et lumineuse journée
Athéna
Posté le : 19/12/2015 06:53
|
|
|
|
|
Défi du 19 décembre 2015 |
|
Modérateur  
Inscrit:
21/03/2013 20:08
De Belgique
Niveau : 44; EXP : 15
HP : 215 / 1078
MP : 1072 / 35550
|
Bonjour à tous !
Ca sent bon les vacances de fin d'année... du moins en ce qui me concerne. J'espère que les vôtres aussi.
La fête de Noël se profile à la fin de cette semaine. Le sapin brille de milles feux et la crèche trône à son pied.
Pour mon défi, je souhaite vous proposer un voyage dans le temps : imaginez que vous vous retrouviez tout à coup 2015 ans avant, en plein coeur d'Israël, dans la petite ville de Bethléem, dans la nuit du 24 au 25 décembre. Qu'allez-vous découvrir ?
Je suis impatiente de vous lire et vous embrasse tendrement.
Passez de beaux moments de partage en famille.
Couscous
Posté le : 18/12/2015 20:02
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
121 Personne(s) en ligne ( 75 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 121
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages