|
|
Carl Linnæus |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 10 janvier 1778 à Uppsala Suède meurt Carl Linnæus
puis Carl von Linné, à 70 ans après son anoblissement, né le 23 mai 1707 à Råshult Suède, médecin zoologiste, naturaliste suédois qui a fondé les bases du système moderne de la nomenclature binominale. Considérant, selon la formule d'Edward Coke Nomina si nescis, perit cognitio rerum la connaissance des choses périt par l'ignorance du nom, que la connaissance scientifique nécessite de nommer les choses, il a répertorié, nommé et classé de manière systématique l'essentiel des espèces vivantes connues à son époque en s'appuyant sur ses propres observations comme sur celles de son réseau de correspondants. La nomenclature qu'il établit alors, et la hiérarchisation des classifications en classe, genre, ordre, espèce et variété, s'impose au xixe siècle comme la nomenclature standard.
En bref
Fondateur de l'histoire naturelle moderne, Linné n'est pas le premier en date des naturalistes. Il y avait des anatomistes avant Vésale, des chimistes avant Lavoisier. Néanmoins, dans la perspective de l'histoire des sciences, Vésale, Linné et Lavoisier apparaissent comme des initiateurs dans les disciplines où ils se sont illustrés.
Selon Condillac, une science est une langue bien faite. Si la formule est vraie, l'histoire naturelle ne commence à exister comme science qu'à partir du moment où Linné la dote d'une langue positive, rigoureuse et universelle, de même que Lavoisier, inspiré par Condillac, crée la langue de la chimie. La science de Linné est loin d'être parfaite, mais elle est perfectible. Désormais les naturalistes savent ce que parler veut dire. Leur activité se déploie dans un univers du discours cohérent ; une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, telle est la norme du nouvel espace épistémologique où se regroupent les éléments d'un savoir constitué en raison.
L'histoire naturelle avant Linné est un domaine confus où s'accumulent les éléments disparates, réels ou légendaires, que la critique ne se soucie guère de départager. Le naturaliste est un compilateur, dont la curiosité encyclopédique entasse pêle-mêle les données de l'observation et celles de l'érudition philologique. Albert le Grand au XIIIe siècle, K. von Gesner et U. Aldrovandi au XVIe siècle sont partagés entre le respect de l'autorité incarnée par Aristote, Théophraste ou Pline, et le sens de la documentation, de l'information objective. Il leur arrive de classer leurs matériaux, faute d'apercevoir un meilleur ordonnancement, par ordre alphabétique. La révolution galiléenne introduit un ordre nouveau dans le monde matériel, soustrait à la juridiction de la physique aristotélicienne. L'ordre biologique résiste plus longtemps à l'exigence de la nouvelle raison, du fait de sa plus grande complexité, et aussi parce que le génie d'Aristote en ce domaine intervient comme un obstacle épistémologique difficilement surmontable. La zoologie, la botanique demeurent en état de sous-équipement conceptuel, en dépit des efforts méritoires de l'Anglais John Ray (1627-1705) et du Français Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708), entre autres. Déjà s'esquissent des tentatives de classifications systématiques ; le problème de la méthode est clairement posé. L'œuvre de Linné n'est pas une création originale, mais la réussite qui vient couronner une série d'essais antérieurs.
Le mérite du savant suédois n'en demeure pas moins entier : grâce à lui, le seuil épistémologique de la science positive est franchi une fois pour toutes. L'histoire naturelle peut devenir, au XVIIIe siècle, une aventure de l'esprit et une passion de l'âme. La systématique
Fils d'un pasteur de campagne, né à Råshult (Suède), Linné manifeste dès l'enfance un intérêt exclusif pour les plantes et l'observation des réalités naturelles. Après des études dans les universités suédoises et sur le terrain, il acquiert en Hollande le grade de docteur en médecine et publie, en 1735, la première édition du Systema Naturae. Bientôt célèbre, professeur à l'université d'Upsal en 1741, il poursuit dès lors une carrière jalonnée de savants ouvrages ; sa gloire européenne lui vaut dans son pays un titre de noblesse. Il meurt, après des années obscurcies par la maladie, la même année que Voltaire et Rousseau.
Linné est d'abord un botaniste, et c'est à partir de ce domaine d'élection qu'il opère sa réformation de l'histoire naturelle. Le problème est posé par l'enrichissement des connaissances depuis que les savants de la Renaissance ont entrepris d'inventorier la richesse indéfinie du monde des plantes. À partir du XVIe siècle, les catalogues ne cessent de s'allonger, accablant les spécialistes sous la masse des informations. Pour que la raison reprenne ses droits, il faut découvrir un principe d'ordre, soumettant la variété des faits à une règle unitaire, elle-même fondée dans la nature des choses.
Reprenant sur ce point les idées de Ray et de Tournefort, Linné affirme : « La méthode, âme de la science, désigne à première vue n'importe quel corps de la nature, de telle sorte que ce corps énonce le nom qui lui est propre, et que ce nom rappelle toutes les connaissances qui ont pu être acquises, au cours du temps, sur le corps ainsi nommé ; si bien que, dans l'extrême confusion apparente des choses, se découvre l'ordre souverain de la Nature » (Systema Naturae, éd. 1766-1767).
La méthode correspond à la conversion de la réalité en un monde intelligible, schématisé selon les exigences de l'esprit scientifique. Le regard du savant opère une mutation du concret à l'abstrait. « La description, écrit Linné, est l'ensemble des caractères naturels de la plante ; elle en fait connaître toutes les parties extérieures ; elle doit comprendre pour chaque organe le nombre, la forme, la proportion et la position ; être faite dans l'ordre de succession des organes ; être divisée en autant de paragraphes séparés qu'il y a de parties distinctes, et n'être ni trop longue, ni trop succincte » (Philosophia botanica, 1751).
Avant Linné, les plus clairvoyants des botanistes avaient posé le problème de la détermination des espèces végétales sans pouvoir le résoudre. Devant la multiplicité des apparences, ils n'étaient pas parvenus à fixer des points exclusifs de ressemblance et de dissemblance susceptibles de permettre l'ordonnancement du domaine végétal dans son ensemble. Ray pensait qu'il fallait s'en tenir aux caractères des fleurs et des fruits ; Tournefort estimait qu'on devait y ajouter des caractères relatifs aux diverses parties de la plante. Ainsi les premières tentatives de systématisation ne permettaient pas de surmonter la diversité empirique.
Soucieux d'imposer dans la représentation de l'univers végétal un modèle descriptif opératoire, à la fois rationnel et universel, qui puisse s'appliquer aussi bien dans la géographie administrative ou dans l'art militaire, Linné, après des inventaires considérables, conclut que « la disposition des végétaux la plus recommandable doit être tirée du nombre, de la figure, de la proportion et de la situation de toutes les parties différentes de la fructification » (Philosophia botanica). Étamines et pistil fourniront le fil conducteur de la classification. Une rigoureuse économie de la pensée doit permettre, au sein des classes et des ordres, de désigner les espèces de chaque genre par un seul caractère distinctif, ce qui fonde une classification binaire. Les critères sexuels seront remplacés par d'autres dans le domaine de la zoologie, où ils ne fournissent pas une intelligibilité suffisante.
La première édition du Systema Naturae paraît en Hollande en 1735. Œuvre d'un homme de vingt-huit ans, elle se présente comme une brochure d'une dizaine de pages in-folio : deux pages pour les minéraux, trois pour les plantes, deux pour les animaux. De réédition en réédition, le document initial ne cessera de s'enrichir, jusqu'à devenir un ouvrage considérable, la bible des naturalistes. Le système linnéen des déterminations (classes, ordres, genres, espèces) et des dénominations s'est imposé dans tous les domaines intéressant les naturalistes, en dépit des résistances, dont celle de Buffon. L'histoire naturelle a désormais son code. Linné l'a dotée de termes nouveaux, si bien entrés dans les mœurs que l'on n'imagine pas qu'ils ont seulement deux siècles d'existence : flore, faune, mammifère, primate...
Le génie de Linné se situe dans le positivisme du regard qu'il porte sur la création ; il est le don de percevoir les êtres dans leur spécificité, mais aussi dans leurs rapports réciproques. Par la vertu du regard, la classification, fondée sur le choix de repères artificiels, semble rejoindre un ordre naturel. La systématique apparaît ainsi comme une phénoménologie et une morphologie. Nommer un être, c'est le mettre en place dans l'ensemble des êtres. La taxinomie n'est pas une mnémotechnique, mais une véritable science.
Histoire de son patronyme
Le grand nomenclateur que fut Linné, qui consacra sa vie à nommer la plupart des objets et êtres vivants, puis à les ordonner selon leur rang, eut lui-même maille à partir avec sa propre identité, son nom et même son prénom ayant été remaniés tant de fois au cours de sa vie qu’on ne dénombre pas moins de neuf binômes on voulait dire bi-noms, en deux noms et autant de synonymes.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la plupart des Suédois ne portent pas encore de noms patronymiques. Aussi le grand-père de Linné, conformément à la tradition scandinave, s’appelait Ingemar Bengtsson signifiant Ingemar, fils de Bengt et son propre fils, le père de Linné, fut d’abord connu sous le nom de « Nils Ingemarsson signifiant Nils, fils d’Ingemar.
Mais Nils, pour répondre aux exigences administratives lors de son inscription à l’université de Lund, doit choisir un patronyme. Sur les terres familiales pousse un grand tilleul. La propriété en porte déjà le nom : Linnagård ou Linnegård, toponyme formé de linn variante aujourd’hui obsolète de lind, tilleul en suédois et de gård, ferme. Plusieurs membres de la famille s’en sont déjà inspirés pour former des patronymes comme Lindelius à partir de lind ou Tiliander à partir de Tilia, tilleul en latin. Il est par ailleurs de bon ton, dans les milieux instruits de pratiquer le latin. Nils choisit donc une forme latinisée et devient Nils Ingemarsson Linnæus.
Honorant ensuite le très populaire souverain de Suède de l’époque Charles XII, en suédois Karl XII, 1682-1718, Nils donne le prénom du roi à son fils, qui débute donc son existence en s’appelant Carl Nilsson signifiant Carl, fils de Nils, puis Karl Linnæus, le plus souvent orthographié Carl Linnæus.
Lorsque Carl Linnæus s’inscrit à l’université de Lund à l’âge de vingt ans, son prénom est enregistré sous la forme latinisée de Carolus. Et c’est sous ce nom de Carolus Linnæus, qu’il publie ses premiers travaux en latin.
Parvenu à une immense notoriété et en qualité de médecin de la famille royale de Suède, il est anobli en 1761 et prend en 1762 le nom de Carl von Linné, Linné étant un diminutif à la française, selon la mode de l’époque dans nombre de pays de langue germanique de Linnæus et von étant la particule nobiliaire allemande. Dans le monde francophone comme en Suède, il est aujourd’hui communément connu sous le nom de Linné.
En botanique, où les citations d’auteurs sont souvent abrégées, on emploie l’abréviation standardisée L. Il est d’ailleurs le seul botaniste à avoir le grand privilège d’être abrégé en une seule lettre.
En zoologie, où il est d’usage de citer le nom patronymique complet de l’auteur du taxon, on emploie Linnæus ou sa graphie sans ligature latine Linnaeus, adoptée en anglais et plus pratique pour les utilisateurs de claviers dits internationaux à la suite des taxons qu’il a décrits, et plus rarement Linné, car c’est sous son nom universitaire Linnæus que ses principaux travaux de taxinomie zoologique jusqu’à 1761 ont été publiés sauf les 1 500 noms d’espèces d’animaux nouveaux établis en 1766/1767 dans la 12e édition de Systema naturae, pour lesquelles on utilise habituellement en français le nom d’auteur Linné. De plus, à la différence de son prénom Carolus, Linnæus n’est pas une transcription latine a posteriori, mais son véritable patronyme.
Quant à ses œuvres, elles furent publiées jusqu’en 1762 sous les noms de Caroli Linnæi qui est la forme génitive, signifiant « de Carolus Linnæus, ou encore Carl Linnæus ou seulement Linnæus. En 1762, sur la page de couverture de la seconde édition de Species plantarum, le nom est encore imprimé de cette manière. Mais ensuite, il n’apparaît plus imprimé que dans sa forme nobiliaire Carl von Linné ou Carolus a Linné le a ou ab étant la traduction latine de von. Dans quelques bibliothèques, il est généralement entré comme Linnaeus, Carolus Carl von Linné, d'autres utilisent Carl von Linné.
Généalogie de la famille de Linné.
Carl Linnæus naît le 23 mai 1707 à Råshult, dans la paroisse de Stenbrohult du comté de Kronoberg, dépendant à cette époque de la province suédoise méridionale du Småland. La région est riche en forêts et en lacs, l’environnement y est particulièrement propice à la contemplation et à l’observation de la nature.
Le père de Carl, Nils Ingemarsson Linnaeus 1674-1748 est alors un vicaire de l’église luthérienne et sa mère, Kristina Brodersonia 1688-1733 est la fille du pasteur de Stenbrohult, Samuel Brodersonius. Nils exerce cette charge d’assistant pastoral depuis son arrivée à Råshult en 1705, mais en 1709, à la mort de son beau-père, il devient lui-même le pasteur de la paroisse et la famille déménage de quelques centaines de mètres jusqu’au presbytère de Stenbrohult, au bord du lac de Möckeln.
Nils est un amoureux des plantes qui transmet sa passion à son jeune fils, permettant à celui-ci d’entretenir son propre jardin dès l’âge de 5 ans. Mais avec un père et un grand-père pasteurs, la destinée de Carl est de suivre leurs traces et de devenir aussi pasteur.
Carl quitte le foyer familial à 9 ans, le 10 mai 1716, pour entrer à l’école de Växjö à une quarantaine de kilomètres de Stenbrohult. Il poursuit ensuite ses études au lycée de la même ville, qu’il intègre le 11 juillet 1723 et qu’il quitte le 6 mai 1727.
Mais il ne montre guère d’enthousiasme pour les études et la vocation religieuse. Il préfère s’intéresser aux choses de la nature et y passer son temps. Ses camarades le surnomment déjà « le petit botaniste ». Les professeurs, notamment celui d’histoire naturelle, le Dr Johan Stensson Rothman 1684-1763, convainquent finalement les parents de Carl de ne pas lui imposer une carrière religieuse et de lui permettre de poursuivre des études de médecine.
C’est finalement son jeune frère, Samuel, qui succédant à son père et à son grand-père, deviendra pasteur de Stenbrohult.
Brillant étudiant de l’université d’Uppsala
Inscrit sous le nom de « Carolus Linnæus », il commence ses études à l’université de Lund en 1727. Il y reçoit notamment l’enseignement de Kilian Stobæus (1690-1742), le futur professeur et recteur de l’université, alors encore seulement docteur en médecine, qui lui offre son amitié et ses encouragements et lui ouvre ses collections et sa bibliothèque.
Cependant, sur les conseils de son ancien professeur de Växjö, le Dr Johan Stensson Rothman, il s’inscrit à la prestigieuse université d'Uppsala qu’il rejoint en septembre 1728, où il peut effectivement trouver la richesse générale de connaissance qui lui convient.
Fort peu développées à cette époque, les études de médecine n’étaient suivies que par une dizaine d’étudiants sur les cinq cents environ que comptait l’université et il n’était pas prévu que l’on puisse soutenir sa thèse de doctorat en Suède. Mais l’enseignement médical incluait une part importante de botanique, notamment l’apprentissage des caractères des plantes, de leurs vertus médicinales et de la manière de les préparer en pharmacie. Ces études furent sans doute le moyen, voire le prétexte, pour Carolus Linnæus de s’adonner à sa passion pour la botanique.
Arrivé à Uppsala sans un sou vaillant, il lui faut aussi subvenir à sa propre existence. Alors qu’à peine arrivé en ville, il visite le jardin botanique fondé par Olof Rudbeck 1630-1702, il est remarqué et pris en charge par Olof Celsius 1670-1756, le doyen de la cathédrale et oncle du savant Anders Celsius 1701-1744. Olof Celsius présente Linné à Olof Rudbeck le Jeune 1660-1740, lui-même médecin naturaliste, qui engage le jeune étudiant comme tuteur de ses fils et lui permet d’accéder à sa bibliothèque. Linné remplace un temps l’assistant de Rudbeck, Nils Rozén 1706-1773, alors en voyage à l’étranger.
Le jardin de Linné a été entretenu et peut actuellement se visiter à Uppsala
Linné a justement comme professeur Olof Rudbeck le Jeune, ainsi que Lars Roberg 1664-1742.
C’est à Uppsala, dès l’âge de 24 ans, qu’il conçoit sa classification des plantes d’après les organes sexuels et commence à l’exposer dans son Hortus uplandicus3.
C’est aussi à Uppsala, que Linné se lie d’amitié avec Peter Artedi 1705-1735, son aîné de deux ans, qui également issu d’un milieu d’église, destiné à devenir pasteur et venu étudier la théologie, s’intéresse finalement plus à l’histoire naturelle, particulièrement aux poissons.
À travers l’Europe : des voyages d’exploration à la notoriété
Il conduit des missions scientifiques en Laponie et en Dalécarlie, à l'époque régions inconnues. Il en rapporte une très riche collection de spécimens végétaux, animaux et minéraux et publie sa première étude qui utilise le système sexuel des plantes, Florula Lapponica qu'il améliora par la suite sous le nom de Flora Lapponica 1737. Bien qu’il donne des conférences de botanique et qu’il soit considéré à Uppsala comme un génie, il n’a pas encore de diplôme de médecine.
En 1735, il part aux Pays-Bas, avec l'intention d'y obtenir son diplôme de médecine et de publier ses écrits. Il met en forme ses notes et rencontre le botaniste Jan Frederik Gronovius 1686-1762 à qui il montre son manuscrit Systema Naturae. Celui-ci est si impressionné qu’il décide de financer son édition à Leyde4. En 1736, il fait un voyage à Londres où il rencontre les personnes en vue de l'université d'Oxford tel le physicien Hans Sloane, le botaniste Philip Miller et le professeur de botanique J.J. Dillenius. Il rentre à Amsterdam pour continuer l'impression de son travail Genera Plantarum, point de départ de sa taxinomie. Au cours de son séjour en Hollande, il rencontre également le droguiste Albertus Seba 1665-1736 et Herman Boerhaave 1668-1738 botaniste qui le met en relation avec l’influent George Clifford 1685-1760, président de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales et botaniste distingué. Il étudie et travaille au cours de l'année 1737 dans le jardin du riche banquier. Clifford est en relation avec les marchands hollandais et les plantes collectées dans le monde entier sont ramenées à Linné qui s'efforce de les intégrer dans son Systema naturae5. Son jardin à Hartekamp était fameux à l'époque, puisqu'il y avait plus de mille espèces différentes. Linné y écrit en collaboration avec Georg Dionysius Ehret, illustrateur botanique, une description de jardin anglais, l’Hortus Cliffortianus, publié en 1737.
Dans le frontispice d'Hortus Cliffortianus il est fait allusion au mythe prométhéen et au thermomètre de Celsius. En effet on attribue à Linné l'inversion de l'échelle des degrés centigrades 0 °C : fusion et 100 °C : vaporisation
Il obtient enfin son titre de docteur en médecine, après un court séjour à l’université de Harderwijk, puis il part pour l’université de Leyde, plus prestigieuse, où il reste une année au cours de laquelle son ouvrage Classes Plantarum est imprimé. Avant de rentrer en Suède, il va à Paris où il fait la rencontre de Bernard de Jussieu et de Claude Richard à Trianon.
Retour en Suède
Il retourne alors en Suède, où, ne recevant pas de proposition qui le satisfasse, il exerce la médecine à Stockholm en se spécialisant dans le traitement de la syphilis.
Il se marie le 26 juin 1739 avec Sara Elisabeth Moræa 1716-1806, originaire de Falun. Ensemble ils auront sept enfants, deux garçons et cinq filles : Carl 1741-1783, Elisabeth Christina 1743-1782, Sara Magdalena 1744, morte à l’âge de quinze jours, Lovisa 1749-1839, Sara Christina 1751-1835, Johan 1754-1757 et Sofia 1757-1830.
Finalement, en 1741, il obtient la chaire de médecine à l’université d’Uppsala puis celle de botanique, fonction qu’il occupera jusqu’à sa mort. Dans le jardin botanique de l'Université, il arrange les plantes selon sa classification. Il effectue trois expéditions en Suède et inspire une génération d'étudiants. Les compte-rendus de voyages sont publiés en suédois afin d'être accessible à tous. Outre la pertinence des observations de la vie de tous les jours, ces œuvres sont aussi appréciées pour leur qualité littéraire.
Linné continue de réviser son ouvrage, Systema Naturae, qui ne cesse de grossir au fil des ans et à mesure qu'il reçoit des quatre coins du globe des spécimens de végétaux et d'animaux qu'on lui expédie et qu'il doit classer. De la brochure de dix pages du début deux pages pour les minéraux, trois pour les plantes, deux pour les animaux, son œuvre devient un ouvrage de plusieurs volumes. Quand il n'est pas en voyage, il travaille sur l'extension du domaine minéral et animal. Il est si fier de son travail qu'il se voit tel un nouvel Adam nommant la nature, au point qu'il avait coutume de dire Deus creavit, Linnaeus disposuit, ce qui traduit du latin signifie « Dieu a créé Linné a organisé »
Il plante en 1745 la première horloge florale dans le Jardin botanique d'Uppsala.
En 1747, il devient médecin de la famille royale de Suède et obtient un titre de noblesse en 1761.
À la fin de sa vie il est si célèbre que Catherine II de Russie lui envoie des graines de son pays. Il entre aussi en correspondance avec Joannes A. Scopoli, surnommé le Linné de l'Empire autrichien, qui était docteur et botaniste à Idrija, duché de Carniole en actuelle Slovénie. Scopoli lui a transmis toutes ses recherches et ses observations pendant des années, sans qu'ils pussent se rencontrer à cause de la distance. Pour lui rendre hommage, Linné a nommé Scopolia une espèce de la famille des solanaceae.
Les dernières années sont marquées par une santé déclinante. Il souffre de la goutte et de maux de dents. Une attaque en 1774 le laisse très faible et une seconde, deux ans plus tard lui paralyse la partie droite. Il meurt le 10 janvier 1778, à Uppsala, au cours d'une cérémonie dans la cathédrale, où il est par ailleurs enterré.
Six années plus tard, suivant ses instructions posthumes, sa veuve vendit sa bibliothèque, ses manuscrits et la plus grande partie de ses collections à un acquéreur qui en prendrait grand soin. Ce dernier, un jeune Anglais nommé James Edward Smith, fonda une société scientifique chargée de recevoir ces trésors et l'appela la Linnean Society of London, où les collections sont conservées, protégées dans un sous-sol, mais disponibles aux chercheurs.
Carl von Linné était membre de l'Académie royale des sciences de Suède et de l'Académie royale danoise des sciences et des lettres.
Son œuvre Systema Naturæ
L’ouvrage le plus important de Linné est son Systema Naturæ les systèmes de la Nature qui connaît de nombreuses éditions successives, la première datant de 1735. Chacune d’elles améliore son système et l’élargit. C’est avec la dixième édition, de 1758, que Linné généralise le système de nomenclature binominale.
Mais sa classification est parfois totalement artificielle. Ainsi dans la sixième édition de Systema Naturæ 1748, il classe les oiseaux dans six grands ensembles pour répondre, harmonieusement, aux six ensembles qu’il utilise pour classer les mammifères.
Il définit clairement certains groupes comme la classe des amphibiens. Pour cela, il utilise les animaux décrits ailleurs comme dans les œuvres de Seba, Aldrovandi, Catesby, Jonston ou d’autres auteurs. Mais, la plupart du temps, il décrit les espèces d’après des spécimens qu’il peut lui-même étudier.
Précurseur du racisme scientifique, il divise les Homo sapiens en quatre variétés en 1735, mais c’est dans la dixième édition, celle de 1758, qu’il introduit une classification de différentes espèces humaines avec l’homme blanc Homo europaeus en haut de l’échelle et l’homme noir Homo afer en bas voir Linné, Systema Naturae, 10e éd., 1758 t. I, p. 20
Species plantarum
C’est en 1753 que Linné fait publier Species plantarum les espèces des plantes où il décrit environ 8 000 végétaux différents pour lesquels il met en application de manière systématique la nomenclature binominale dont il est le promoteur.
Ses correspondances
Mises en vente par la veuve de Linné en 1783 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses filles, les très nombreuses lettres à Linné des plus grandes figures de l’époque du monde des sciences et des idées révèlent toute la richesse intellectuelle du personnage et mettent en lumière les controverses qui agitaient alors la pensée européenne.
Les perles de culture
Lors de son voyage en Laponie en 1732, Linné visite une pêcherie de perles au lac de Purkijaure. Il faut ouvrir des milliers de coquillages pour trouver les si rares perles : cela l’intrigue. De retour à Uppsala, il tente une expérience, introduit une petite dose de plâtre fin dans des moules perlières et replace celles-ci dans la rivière de la ville, la Fyris. Six ans plus tard, il récolte plusieurs perles de la taille d’un pois.
Il perfectionne la technique utilisant alors un fil d’argent pour tenir le granule générateur éloigné de la paroi de la coquille. La nacre peut ainsi se déposer régulièrement pour former une perle sphérique. Il vend son brevet en 1762, mais l’acquéreur néglige d’en tirer profit.
Ce n’est qu’en 1900 que l’invention de Linné est redécouverte lors de la lecture de ses manuscrits conservés à Londres. Au XXe siècle, les Japonais développent alors la culture perlière et en améliorent les techniques.
Ses idées
Nomenclature linnéenne Nomenclature binominale.
Linnée boréale, Linnaea borealis, fleur discrète de Laponie dont Linné avait fait son emblème.
Linné met au point son système de nomenclature binominale, qui permet de désigner avec précision toutes les espèces animales et végétales (et, plus tard, les minéraux) grâce à une combinaison de deux noms latins. Ce binom ou binôme suivant un usage erroné trop répandu comprend :
un nom de genre au nominatif singulier ou traité comme tel, dont la première lettre est une majuscule ;
une épithète spécifique, qui peut être un adjectif, un nom au génitif ou un attribut, s’accordant avec le genre grammatical masculin, féminin ou neutre du nom de genre. Il est écrit entièrement en minuscules. L’épithète évoque souvent un trait caractéristique de l’espèce ou peut être formé à partir d’un nom de personne, de lieu, etc.
Il faut dire correctement binom, comme le Code de Nomenclature zoologique 4e édition, 1999 le précise en français, traduction de l'anglais binomen qui fut traduit par erreur par binôme en anglais binomial. Les rédacteurs de la dernière version française ont rectifié cette grotesque erreur - il n'y a aucun rapport entre ce concept algébrique et le nom des organismes en nomenclature binominale. Le code de Botanique a malheureusement entériné cette confusion, et, pire, admet l'expression de nomenclature binomiale.
Le nom de l’espèce est constitué par l’ensemble du binom. Ces noms sont réputés latins, quelle que soit leur origine véritable grecque, chinoise ou autre, et écrits en alphabet latin lettres de a à z et ligatures æ et œ, comme en français, mais sans diacritiques ni accents.
Ce système binominal permet d’éviter de recourir aux noms vernaculaires, qui varient d’un pays à l’autre, voire d’une région à l’autre. Par exemple, le renard roux est appelé en japonais aka-kitsune, mais un naturaliste japonais comprendra le nom latin, international, de Vulpes vulpes.
Toutefois, avec la multiplication des recombinaisons, des synonymes et des interprétations divergentes d’auteurs, les « noms scientifiques » actuels sont parfois instables et difficiles à manier, comme d'ailleurs les noms vernaculaires.
Systématique fixiste
Linné est un naturaliste fixiste. Pour lui, les espèces vivantes ont été créées par Dieu lors de la Genèse et n’ont pas varié depuis. Le but premier de son système est de démontrer la grandeur de la création divine. L’ordre hiérarchique des taxons y est fondé sur des critères de ressemblance morphologiques et d’affinités supposées, sans établir de relation génétique ou phylogénétique entre les espèces.
Mais, par la suite, au fur et à mesure de l’avancée des connaissances, notamment à partir des travaux de Lamarck et de Darwin, la systématique a pris diverses formes (phénétique, évolutioniste, phylogénétique…, pour aboutir de nos jours à une systématique pragmatique au quotidien qui essaie de prendre en compte les diverses données propres à chaque méthode.
Fixité ou mutabilité des espèces
Linné a été longtemps considéré comme un tenant du fixisme, c'est-à-dire de l'invariabilité des espèces naturelles. On a relevé dans ses écrits, en particulier dans les œuvres de jeunesse, des formules affirmant que le nombre des espèces est égal à celui des formes créées à l'origine. Le mythe biblique de la Création, religieusement respecté par Linné, semble fermer définitivement au soir du sixième jour la période des initiatives créatrices.
Mais Linné est assez génial observateur pour découvrir des faits qui ne concordent pas avec ses présupposés théologiques. Il reconnaît de bonne heure des formes monstrueuses, déviations et aberrations par rapport au type, en lesquelles il voit d'abord des ratés de la Création, ou même des « plaisanteries » du Créateur. Seulement un monstre ne saurait se reproduire ; or en 1744, Linné constate que la Peloria, une « monstruosité » de la Linaire, se reproduit. « Une conclusion stupéfiante s'impose, écrit-il, à savoir que de nouvelles espèces peuvent surgir dans le règne végétal [...]. Il y a là [...] de quoi faire sauter les classes naturelles des plantes. »
Il faut donc admettre une certaine plasticité des espèces. Linné cède à l'évidence ; il accepte la thèse d'un devenir temporel de la création. Seuls les genres ont été fixés à l'origine ; dans les limites du genre, « les espèces sont l'œuvre du temps », précise un texte de 1762. Lamarck et Darwin iront plus loin, mais il y a chez l'auteur du Systema Naturae des pierres d'attente pour les transformismes à venir.
L'anthropologie de Linné
On peut dire que l'histoire naturelle de l'homme commence avec Linné. L'inventaire systématique de la création ne serait pas complet si l'homme n'y figurait pas à sa place. Cette place est une place d'honneur, la première de toutes, mais c'est une place parmi les autres : l'espèce humaine doit se soumettre à la même curiosité qui soumet à sa juridiction toutes les autres espèces vivantes. La péripétie décisive s'accomplit dans la dixième édition du Systema Naturae (2 vol., Stockholm, 1758-1759) : l'homme y figure parmi les « animaux à mamelles », et dans l'ordre des « primates » qui comprend aussi les singes supérieurs. Il ne s'agit pas là de classification seulement, mais aussi d'une description précise, énumérant les signes distinctifs qui caractérisent l'homme en tant qu'homme.
L'initiative de Linné renoue avec une tradition qui remonte à Aristote et à Galien, mais a été interrompue par l'intervention du christianisme ; celui-ci fait de la condition humaine une sorte de position intermédiaire entre l'animalité et la divinité. De même que l'avènement de la science moderne finit par avoir raison du tabou de la dissection, qui interdisait l'autopsie, de même la nouvelle intelligence impose le thème de l'anatomie et de la physiologie comparées. Tous les êtres vivants ont, à des degrés divers, des structures communes et un fonctionnement commun. Selon l'ordre anatomique, observe Linné, il n'y a pas de différence décisive entre l'homme et l'orang-outang.
L'Homo sapiens de Linné se distingue du grand singe anthropoïde (Homo sylvestris) par des marques psychologiques et sociologiques plutôt que corporelles. L'histoire naturelle de l'homme, telle que l'esquisse Linné, complète les données de l'anthropologie culturelle ; la description des races est associée à celle des genres de vie.
Le décor mythico-religieux
Le positivisme de Linné, s'il triomphe d'interdits millénaires, n'implique nullement une rupture avec la religion traditionnelle. Linné est un chrétien aussi convaincu que Newton, ce qui n'est pas peu dire. Le Système de la Nature, en ses éditions définitives, s'ouvre par une profession de foi ; la Nature proclame la gloire du Dieu de la Genèse, et le naturaliste accomplit une œuvre d'apologétique.
Le schéma théologique de la Création, bien loin de jouer le rôle d'un obstacle épistémologique, fournit des éléments d'intelligibilité, en particulier ceux de la finalité des êtres naturels et de la hiérarchie des formes vivantes. Le thème de la grande chaîne des êtres qui groupe toutes les réalités selon l'ordre ascendant d'une échelle ontologique est un présupposé de l'œuvre linnéenne. Cette échelle se retrouve chez tous les naturalistes du temps et fournit le principe d'un ordre de complexité et de dignité croissantes, à mesure que l'on passe des réalités les plus humbles, de la vie endormie dans les minéraux aux espèces végétales et animales. Les primates sont ainsi dénommés par Linné parce qu'ils constituent le couronnement de la nature aux confins du surnaturel.
Chez Linné, comme chez Newton, la foi n'est pas un obstacle à la science. La conviction religieuse cautionne la recherche scientifique ; elle fournit à celle-ci le présupposé de l'unité et de l'harmonie de la création ; le discours scientifique n'en demeure pas moins autonome ; il ne met en œuvre que des éléments d'une rigoureuse positivité.
Cette positivité est, chez Linné, celle du regard qui saisit l'unité des formes avec l'intuition divinatrice du génie. L'auteur du Système de la Nature n'est pas un biologiste ; il n'explique pas, ou, quand il se mêle d'expliquer, il explique mal. Il est un visionnaire du réel dont le coup d'œil a su embrasser à la fois la prodigieuse diversité des formes et leur prodigieuse unité. Mieux qu'un penseur ou un savant, Linné est, comme Goethe, un Augenmensch, un génie du regard. Georges Gusdorf
Linné et la Bible
Linné, comme d’autres scientifiques de son temps, éprouve des difficultés pour concilier le contenu de la Bible avec ses connaissances. Il explique ainsi que le jardin d'Éden était comme une île tropicale qui devait comporter une haute montagne. Celle-ci, dont le climat change avec l’altitude, offre des habitats pour les autres formes de vie habituées aux régions tempérées et arctiques.
Place de l'humanité
Linné a appliqué le concept de race à l'homme (ainsi qu'aux créatures mythologiques. La catégorie Homo sapiens fut subdivisée en cinq catégories de rang inférieur, à savoir Africanus, Americanus, Asiaticus, Europeanus et Monstrosus. Elles étaient basées au départ sur le lieu d'origine selon des critères géographiques, puis plus tard, sur la couleur de peau. Chaque « race » possédait certaines caractéristiques que Linné considérait comme endémiques pour les individus qui la représentaient. Les Indiens d'Amérique seraient colériques, rouges de peau, francs, enthousiastes et combatifs; les Africains flegmatiques, noirs de peau, lents, détendus et négligents ; les Asiatiques mélancoliques, jaunes de peau, inflexibles, sévères et avaricieux ; les Européens seraient quant à eux sanguins et pâles, musclés, rapides, astucieux et inventifs. On trouverait enfin dans la catégorie des hommes monstrueux les nains des Alpes, les géants de Patagonie et les Hottentots monorchistes. Par la suite, dans Amoenitates academicae 1763, il définit l'Homo anthropomorpha comme un terme fourre-tout pour une variété de créatures mythologiques et proches de l'homme, tels le troglodyte, le satyre, l'hydre, le phœnix. Il prétendit que ces créatures n'existèrent pas vraiment mais qu'elles étaient des descriptions inexactes de créatures ressemblant aux grands singes.
Dans son Systema Naturae il définit aussi l'Homo ferus comme « chevelu, muet et à quatre pattes ». Il y inclut aussi le Juvenis lupinus hessensis ou garçons-loups qui furent élevés par des animaux, pensait-il ; dans le même esprit on y trouve le Juvenis hannoveranus Pierre de Hanovre et la Puella campanica où Linné évoque la fille sauvage de Songy.
L’influence de Linné
Ses élèves et son influence Liste des étudiants de Linné.
Linné a eu une immense influence sur les naturalistes de son époque. Nombreux sont ceux qui viennent assister à son cours, apprendre sa méthode pour l’appliquer dans leur pays. Nombreux sont ceux qui s’embarquent pour des contrées lointaines pour y reconnaître la flore, Linné lui-même les nomme ses apôtres. Tous ces naturalistes trouvent avec la systématique et la nomenclature linnéenne un moyen de faire progresser les connaissances.
C’est avec sa collaboration que Philibert Commerson put écrire son traité d’ichtyologie. Il eut aussi quelques autres correspondants tels que Frédéric-Louis Allamand.
Parmi ses nombreux élèves, citons : Anders Dahl, Johan Christian Fabricius, Charles de Géer, Christen Friis Rottbøll, Daniel Solander ou Martin Vahl.
Il faut citer également le naturaliste suédois Peter Artedi (1705-1735). Les deux hommes se rencontrent à l’université d'Uppsala, se lient d’amitié puis se séparent, Linné partant pour la Laponie et Artedi pour la Grande-Bretagne. Avant leur départ, ils se lèguent mutuellement leurs manuscrits en cas de décès. Mais Artedi se noie accidentellement à Amsterdam où il venait réaliser le catalogue des collections d’ichtyologie d’Albertus Seba (1665-1736). Suivant leur accord, Linné hérite des manuscrits d’Artedi. Il les fait paraître sous le titre de Bibliotheca Ichthyologica et de Philosophia Ichthyologica, accompagné d’une biographie de leur auteur, à Leyde en 1738.
Son influence s’exerce à travers tous les continents : Pehr Kalm en Amérique du Nord, Fredric Hasselquist en Égypte et en Palestine, Andreas Berlin en Afrique, Pehr Forsskål au Moyen-Orient, Pehr Löfling au Venezuela, Pehr Osbeck et Olof Torén en Chine et en Asie du Sud-Est, Carl Peter Thunberg au Japon, Johann Peter Falck en Sibérie…
Son caractère égocentrique, conjugué à une extrême ambition, le conduit, comme Buffon, à persécuter ceux qui n’optent pas pour son système. Mais il est le premier, suivant en cela John Ray, à utiliser un concept clair d’espèce qui n’est en rien diminué par sa conviction de l’immuabilité des espèces.
Dans son roman d'anticipation Vingt mille lieues sous les mers, Jules Verne met en scène le personnage de Conseil, domestique du professeur Aronnax, qui classe systématiquement toutes les espèces rencontrées durant le voyage selon le système linnéen.
Les critiques
Contrairement à la plupart des naturalistes européens qui reconnaissent la révolution linnéenne, des naturalistes et des philosophes français comme Julien Offray de La Mettrie, Denis Diderot, Buffon ou Maupertuis critiquent la systématique linnéenne. Ce qui lui est reproché est son caractère artificiel et fixiste. L’entreprise de Linné ne fait que partiellement appel à la raison, et peu d’incitation à l’expérimentation. Ils lui reprochent aussi une démarche empreinte de religiosité car Linné se voit en nouvel Adam décrivant et nommant la création. Pour toutes ces raisons les philosophes des Lumières en France ne peuvent le reconnaître comme l’un des leurs. Finalement, des idées de Linné, seule la nomenclature binominale survivra.
Le prénom Linnea
Courant en Suède, le prénom « Linnea » dérive d’une fleur des bois, nommée Linnaea borealis, en hommage à Carl von Linné, par son professeur Jan Frederik Gronovius.
Sociétés linnéennes
Hommage
Le portrait de Carl von Linné figure sur le billet de banque suédois de 100 couronnes.
Plusieurs voies de circulation en France et une en Belgique ont été nommées Rue Linné.
bibliographie Œuvres de Linné
La liste ci-dessous est limitées aux principales publications la date indique la première édition
Præludia sponsaliarum plantarum 1729
Fundamenta botanica quae majorum operum prodromi instar theoriam scientiae botanices per breves aphorismos tradunt 1732
Systema Naturae 1735
Fundamenta botanica 1735
Bibliotheca botanica 1736 Bibliotheca botanica recensens libros plus mille de plantis huc usque editos secundum systema auctorum naturale in classes, ordines, genera et species
Critica botanica 1736
Genera plantarum Ratio operis 1737
Corollarium generum plantarum 1737 sur Gallica
Flora lapponica 1737 Flora lapponica exhibens plantas per Lapponiam Crescentes, secundum Systema Sexuale Collectas in Itinere Impensis
Ichthyologia 1738, où Linné publie les travaux de son collègue et ami Peter Artedi décédé accidentellement
Classes plantarum sur Bibliotheca Augustana
Hortus Cliffortianus 1738
Flora suecica 1745
Fauna suecica 1746
Hortus Upsaliensis 1748
Philosophia botanica 1751
Species plantarum 1753
Flora anglica 1755
Animalium specierum, Leyde : Haak, 1759
Fundamentum fructificationis 1762
Fructus esculenti 1763
Fundamentorum botanicorum partes I et II 1768
Fundamentorum botanicorum tomoi 1778
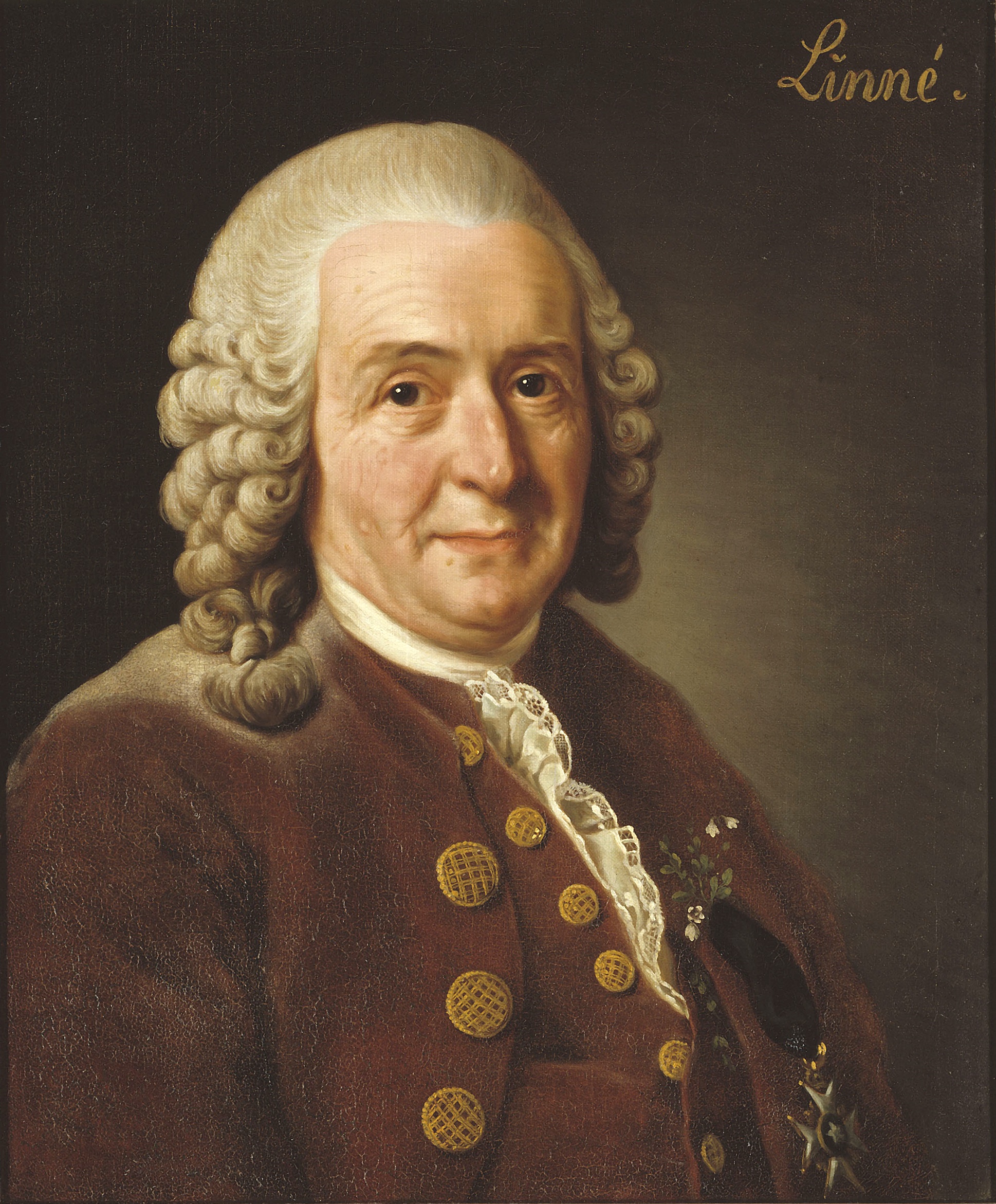      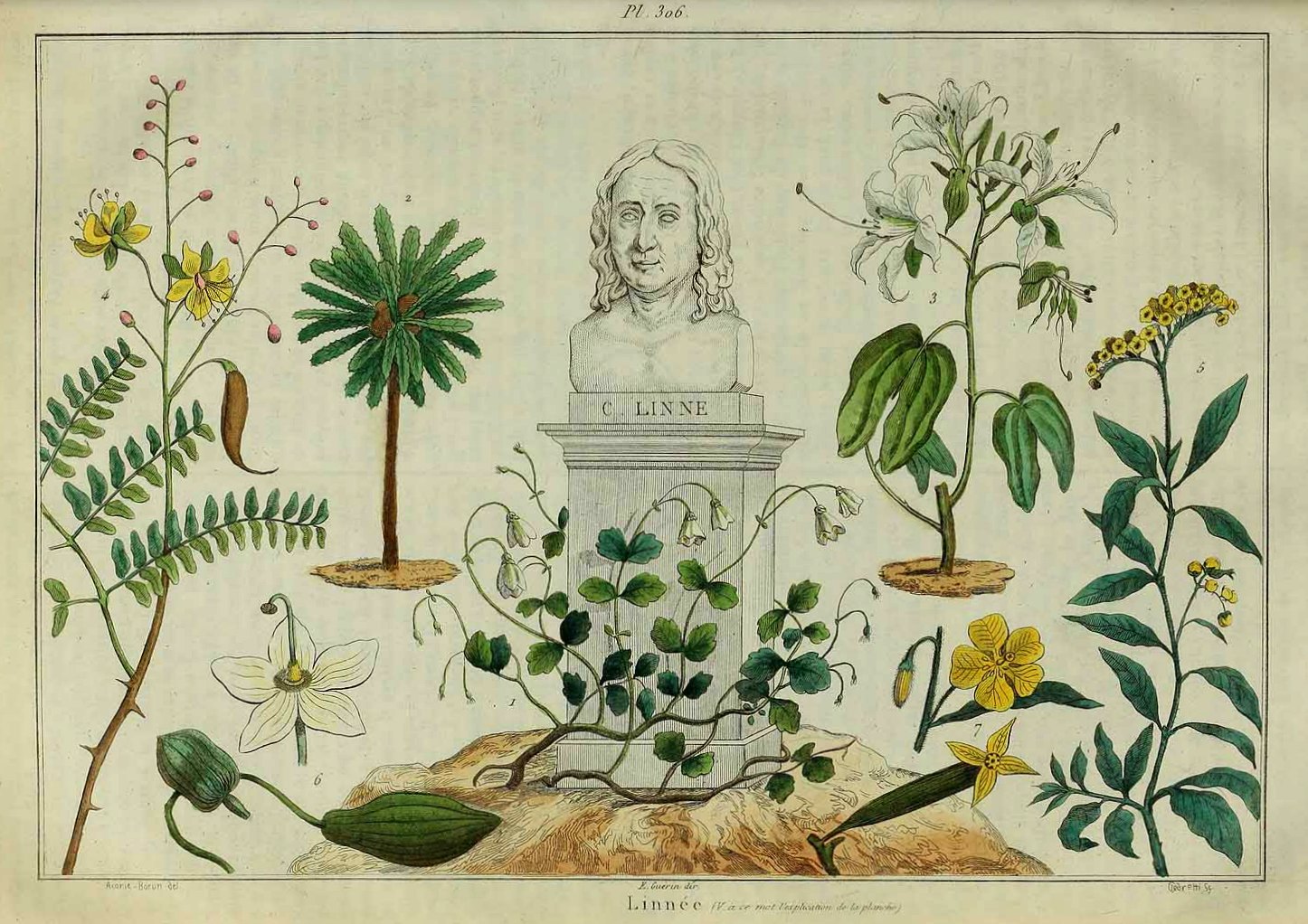  
Posté le : 08/01/2016 16:49
Edité par Loriane sur 10-01-2016 18:27:42
Edité par Loriane sur 10-01-2016 18:29:11
Edité par Loriane sur 10-01-2016 18:30:18
|
|
|
|
|
Le clown Grock |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 10 janvier 1880 naît Charles Adrien Wettach, dit Grock
à Loveresse, canton de Berne Suisse, mort le 14 juillet 1959 à Imperia en Italie, à 79 ans, clown, musicien, acteur Suisse, Grock est considéré par ses pairs comme le plus grand clown musical du XXe siècle. Il a conquis, en 60 ans de music-hall mondial, en 15 langues et sur autant d'instruments, des millions de spectateurs, et a composé plus de 2 500 mélodies.
En bref
Né en Suisse, dans une famille d'horlogers, Adrien Wettach fut d'abord acrobate amateur. Après avoir débuté en Hongrie, il devint le partenaire d'un clown nommé Brick et prit son nom de scène : Grock. Lorsque Brick se maria, Grock rejoignit le célèbre Antonet. En passant de la piste à la scène, à Berlin, ils essuyèrent d'abord des échecs, puis, maîtrisant leur technique, ils obtinrent un engagement à Londres en 1911. Deux ans plus tard, Grock met au point un numéro avec lequel il fera rire le monde entier et qu'il conservera jusqu'à la fin de sa carrière. Son héros est un nigaud qui, placé au milieu d'instruments de musique, cherche les cordes de son violon alors qu'il tient celui-ci du mauvais côté et s'efforce de s'asseoir plus près du piano en tirant ce dernier plutôt que le tabouret et ponctuant ses découvertes du célèbre : « sans blââgue ! ». Assimilé à la catégorie des clowns musicaux, Grock était aussi excellent acrobate ; son art, plus proche par ailleurs du music-hall, tendit vers une certaine forme d'universalité. En 1924, il quitta l'Angleterre et passa sur le continent. Il fit ses adieux à la scène, à Hambourg, en 1954.
Grock écrivit plusieurs livres parmi lesquels figure son autobiographie, Ma Vie de clown Die Memoiren des Königs der Clowns, 1956. Michèle Grandin.
Sa vie
1880 Naissance à Loveresse de Charles Adrien Wettach, fils de Jean Adolphe Wettach, horloger, aubergiste et cabaretier1
1880 déc. - 1882 avril : La Neuveville
1882 avril - automne : Le Landeron, Moulin-de-la-Tour
automne 1882 - 1885 octobre : Le Landeron, Rue de Soleure
1885 octobre - 1887 Le Locle, Rue de France
1887 - fin 1889 Col-des-Roches, Café National et bureau postal tenu par la mère. Fasciné par le cirque Wetzel, il joue au cirque pour ses copains.
fin 1889 - été 1891 : Les Replattes
été 1891 - 1892 printemps Bienne, Rue Haute
1892 printemps - 1893 février : Bienne, Rue du Milieu
Premier spectacle il a 13 ans
Café Paradisli à Bienne
1893 février - 1894 avril : Bienne, café Paradisli , Faubourg du lac
premières représentations avec sa sœur Jeanne, les Paradiesli-Folies
numéro musical en frappant sur des bouteilles plus ou moins remplies d'eau
homme serpent
morceau d'acrobatie avec sa sœur au piano
mange une portion de spaghetti avec les pieds
1894 avril - 1895 mai : Villeret, Auberge du Cerf
1894 : il fait quelques stages au cirque Weitzel, qui a ses quartiers d'hiver dans la région ; il observe les artistes et apprend le jonglage, l'acrobatie, le mime, le contorsionnisme, la musique et la danse
1894 mai : funambule, il traverse la place du marché neuf de Bienne en marchant sur une corde.
Début d'un apprentissage d'horloger 6 semaines
1895 mai - 1895 juillet : Villeret, La petite copè
1895 juillet - 1896 juillet : Malleray, rue Schäublin 3
1896 - 1897 octobre : Bienne, Rue Franche 29
1896 : 1re tournée avec sa sœur Jeanne à Berne, Lucerne, Zurich, Saint-Gall, Schaffhouse et Soleure
La Hongrie
1897 juillet Départ avec sa sœur Jeanne pour la Hongrie.
1897 Professeur de français pour les 3 fils d'un baron.
1899 Travaille à Budapest chez un fabricant d'instruments et comme violoniste.
Premiers pas de clown
1900 - Premiers pas comme partenaire du clown Alfred Prinz sous le nom d'Alfrediamos
Hiver : Accordeur de piano itinérant l'hiver, période pendant laquelle les cirques ne tournent pas.
Engagé par le cirque Krateily avec Prinz
1902 - Fin du travail avec Prinz, qui se marie.
Lyon avec Achille Conche. Cirque des frères Barazetta.
1903 - Cirque national suisse comme caissier, puis numéro avec Marius Galante qui avait eu du succès avec l'espagnol Brock. Il n'est pas enthousiaste de ce nom, il le change en Grock
Octobre à Nîmes : dans les arènes, 1re représentation de Brick et Grock
1904 - Brick et Grock sont engagés par le cirque Medrano
1906 - avril : Buenos Aires où il rencontre les célèbres Antonet 1er clown du Cirque de Paris et Little Walter. Alors qu'Antonet porte un frac élégant, Grock est coiffé d'une calotte de feutre, vêtu d'un immense paletot. Ses yeux de chien battu, son sourire de nigaud et son maquillage blanc lui composent un faciès malicieux à l'expression enfantine
1907 : Il tombe amoureux de Inès Della Casa, une chanteuse italienne de 17 ans avec qui il se mariera plus tard. Il tombe amoureux de Louise Bullot, artiste de Paris.
Marseille : Grock & Antonet remportent un gros succès. Tournée en Espagne
1909 : Il sait négocier son succès, les gages augmentent. Il s'achète une voiture de luxe de marque Grégoire.
1911 : Achat pour ses parents d'une résidence à Saint-Maur-des-Fossés près de Paris.
Variété et music-hall
1911 août Théâtre de Variété de Berlin Wintergarten. La première est un désastre. Grock remanie le programme, après un mois ils sont l’attraction. Engagement à Londres
1912 déc. Folies Bergère à Paris
1913 Rencontre avec Géo Lolé qui prend le rôle de conférencier du sérieux. Tournée en partant de Copenhague et ensuite l’Allemagne, la Hongrie et l’Autriche.
1914 Tournée en Russie, arrêtée car la guerre éclate.
1914 août Mariage avec Loulou à Copenhague et retour en Suisse où il est déclaré inapte au service militaire
1914 voyage à Paris chez ses parents.
1914 noël Olympia musical-hall alors proche de la banqueroute à Paris et tournée en province. Gros succès, l’Olympia est sauvé.
1915 sept. - 1916 mai Engagement avec Hayem Friedmann qui sera mobilisé au Coliseum à Londres
1916 Fondation avec le musicien Leon Silbermann de la maison d’édition L. Silbermann & A. Grock. Grock écrit toutes les chansons dont quelques-unes seront interprétées par des stars anglaises
1916 Sa sœur Jeanne se marie avec son ancien partenaire Geo Lolé qui se trouve sur le front.
1916 mai Rencontre avec le Hollandais Max van Embden 21 ans. Grock & Max font une tournée en Angleterre et Écosse.
1918 4 septembre, sa femme Loulou meurt de la tuberculose.
1919 A nouveau les Folies Bergère, Grock & Max font un triomphe. La solitude lui pèse, il se souvient d'Inès Della Casa qu'il avait aimée en 1907 en Amérique du Sud et qui vit séparée de son mari, il ne pourra l'épouser qu'en 1923.
1919 3 décembre, tournée au USA avec Inès et Max jusqu'à fin décembre 1920. Il est déçu du public américain. ..Pour les Yankees j’étais trop doux, trop peu excité et excitant...
1921 Grande-Bretagne jusqu’au 21 avril 1924 départ à cause de problèmes fiscaux.
1922 Il construit une villa pour ses beaux-parents à Oneglia/Imperia, sur la Riviera italienne. Il y habite dès 1924.
1922 Tournée en France et en Allemagne en commençant par L’Empire à Paris, il reprend Lolé comme partenaire.
1925 Film réalisé par Jean Kemm.
1927 Il joue de nouveau avec Max. Leur numéro est filmé et ils sortent un disque.
Il doit se séparer de Max qui demande des cachets plus élevés. Il joue à nouveau avec Lolé.
1927, Rencontre avec le fabricant d’accordéon Hohner qui lui demande de faire son numéro avec cet instrument. Il accepte à condition que ce dernier ait un clavier de piano. Hohner développe un tel instrument.
1930 Déménagement dans la maison qu’il s'est fait construire à Oneglia quartier d'Imperia en Italie, la villa Bianca nom de sa fille adoptée de 50 pièces dont le belvédère géant domine un parc de 2 hectares où l'effigie du clown est partout. Cette construction est un mélange de style perse, baroque, liberty et rococo, entourée par un jardin fascinant.
1930 Automne, commencement du tournage d’un film produit par lui-même en 5 langues.
1931 24 février, première à Berlin.
1931 Juillet il se rend compte que les propriétaires de la société de distribution sont partis avec son argent. Son film ne peut pas être distribué en Grande-Bretagne à cause de ses arriérés fiscaux. Il est couvert de dettes.
Avant-guerre
1934 - 24 janvier, Hitler voit son spectacle au Deutsche Theater à Munich et le félicite. Il revient 13 fois ! Grock pend des portraits d'Hitler dans sa villa5.
1934 - Noël Les nazis ne plaisent pas à Lolé, qui part chez sa femme à Paris
1938 Tournage d'un film publicitaire en couleur pour Hohner. Grock ne peut présenter le film qu'à condition de présenter un certificat d'arianité. Hitler commence à lui déplaire.
La guerre
1939 6 mai, il décide mettre fin à sa carrière, il se retire dans sa villa.
1940 17 avril, Goebbels lui demande de faire des représentations dans les hôpitaux de guerre.
1943 Oneglia est bombardée mais sa villa est épargnée.
1944 31 août, fuite en sécurité en Suisse à Zurich.
1944 Automne, il remonte sur scène.
1945 janvier, Lausanne où il prend domicile.
Après-guerre
1945 8 mai, capitulation de l'Allemagne nazie, il reprend ses tournées, gros succès malgré les accusations de nazisme.
1946 Il est proche de la ruine : à cause de la dévaluation du mark allemand et de la lire italienne, sa fortune ne vaut plus rien.
1950 Nouveau film « Au revoir, Mr Grock ». 1re mondiale au cinéma Métropole à Lausanne dans l'immeuble-même où il habite.
1951 Création d'un cirque de variété, grâce à un manège tournant de 9 mètres de diamètre cirque Grock de 4 500 places, 140 employés et 60 roulottes qui permet de le voir de tous les côtés. Première à Hamburg le 24 mars 1951 avec Schatz, gros succès.
1953 Mai, à Zurich commence sa dernière tournée en Suisse.
1954 10 octobre, dernière représentation dans son manège à Hamburg.
1957 Représentations à la télévision italienne
L'homme
Il parlait 6 langues couramment : français maternelle, anglais, italien, allemand, espagnol et hongrois.
Il jouait de 24 instruments en particulier le violon miniature.
De son Jura bernois natal, il a gardé une formation de sourcier, qu'il a utilisé de temps en temps.
Féru d'automobiles, il s'y ruinera, aura plusieurs accidents plus ou moins graves.
Il est nommé dans le 232e des 480 souvenirs cités par Georges Perec dans Je me souviens.
Il était franc-maçon, membre de la Grande Loge suisse Alpina.
Famille
Son père Jean Adolphe Wettach Reconvilier 1853-France 1921 horloger, aubergiste, cabaretier chanteur de jodel, guitariste,..., s'était distingué jeune en faisant l'acrobate et le pitre
1876-1880 horloger rhabilleur et paysan
1891 Bienne, horloger remonteur chez Brandt & Cie futur Omega
1893 Bienne, Restaurant Paradiesli faillite en 1894
1894 Villeret, Hôtel du Cerf
1895 Malleray,
1896 Bienne,
dès 1896 pas d'emploi fixe
1911 Saint-Maur-des-Fossés France
Sa mère Cécile née Péquegnat Loveresse 1853-Oneglia 1951
Sa sœur Jeanne 1881-1971
fait du piano dans les cafés-concerts en Russie
travaillera dans sa maison d'édition
Son beau-frère et partenaire Geo Lolé 1969 épouse sa sœur Jeanne en 1916
Sa sœur Fanny 1883-1955 Lucerne chez qui il habite en automne 1944
Sa nièce Madeleine Zurich chez qui il habite en été 1944
son petit neveu Raymond Naef 1948- a écrit « Grock ein Wiederentdeckung des Clowns
Sa sœur Cécile 1889-1970 épouse de Georges Bessire
Son frère Adolphe 1891-1892, qui s'est noyé dans un ruisseau
Sa 1re femme Louise Bullot dite Loulou 1875-4 septembre 1918
Sa 2e femme Inès Della Casa 1890-1974 née Ospiri
Sa fille adoptive Bianca 1909-1978 fille d'Inès Della Casa
Suit des cours au conservatoire de Turin
Sa petite fille Adrienne
Son petit fils Richard Wettach
Son arrière petit fils Florian Wettach
Son arrière petite fille Julie Wettach
Partenaires
Sa sœur Jeanne 1893-août 1897.
Alfred Prinz duo Alfrediamos 1899-mars 1900
Marius Galante dit Brick, Brick & Grock oct. 1903-juin 1907
Antonet Umberto Guillaume sept. 1907-sept. 1913
Georges Laulhé dit Lolé sept. 1913-juin 1914, en 1914 mobilisé, en 1916 marie sa sœur Jeanne,1924-1926 1927-1935
Moretti (déc. 1914-juin 1915
Hayem Friedmann juin 1915-mai 1916
Belin Fante mai 1916-juin 1916
Max von Embden juin 1915-avril 1924, Grock & Max
Lolé sept. 1924- sept 1925
Louis Allary sept. 1925- déc 1926
Max von Embden janv 1927-Févr 1932, Grock & Max
professeur Jean Niard 1932-1945 remplacement
Lolé mars 1932- déc. 1935
Alfred Schatz janv 1936- avril 1939
Jérôme Medrano fils, 1907-1998 janv 1937- oct 1937remplacement
Alfred Schatz automne 1941- printemps 42 camps de blessés
Sisto Lorrenzoni 1944-avril 1945
Max von Embden noël 1945 Grock & Max
Max von Embden mars 1947-mars 1949 Grock & Max
Louis Maïss mars 1949-oct. 1949
Alfred Schatz nov. 1949- oct. 1954
Max von Embden août-sept 1957 5 shows TV italiennE
Impresarios
1911 Marinelli
1914 Percy Riess
1924 Henri Lartigue
Entreprises
La maison d'édition L. Silbermann und A. Grock fondée avec le musicien Leon Silbermann en 1916. Sa sœur Jeanne y travaille.
Son manège tournant -9 m de diamètre - 4500 places trouvé par son neveu Jean-Jacques Bessire + une tente à 4 mats , 14 roulottes, 7 tracteurs, une grue et quelques camions.
L'entreprise Perfectone à Bienne, spécialiste en appareils acoustiques de précision, créée par ses neveux Henri et Jean-Jacques Bessire, il est l'actionnaire principal.
Gags
son expression Sans blague...
son numéro saut de la chaise : être debout dans une chaise percée, par un saut il se retrouve assis sur le dossier, un pied sur le bord de la chaise et l'autre jambe sur le genou, son petit accordéon toujours en main.
Avant de se mettre au piano, rapprocher ce dernier au lieu de pousser la chaise.
Le petit violon qu'il prend dans une immense valise.
Bricolages, inventions
Machine à mélanger les cartes
L'accordéon à touches silencieuses, trop cher pour être fabriqué !
L'idée d'ajouter un clavier de piano à un accordéon, réalisé par Hohner
La piste tournante de son cirque
sa serrure antivol, inventée par Lucien Witz
et d'autres
Maisons
Villa Bianca à Impéria en 2007
Achat pour ses parents d'une résidence dans Le Parc Saint Maur France
1922 Construction d'une Villa à Oneglia/Imperia
1928 Achat de la propriété voisine pour éviter la construction d'un tullière devant sa maison qu'il transforme en parc.
1930 Construction d'une nouvelle Villa 50 chambres"Villa Bianca" nom de sa fille
1944 Occupation par les nazis
1945 Occupation par les partisans
1975 Vente par sa fille Bianca.
1999 The Grock Foundation tente de sauver la maison qui est abandonnée et a été vandalisée
Cinéma Acteur
1926 : Son premier film ou Le Gardien du sérail de Jean Kemm
1927 : Pourquoi ? What for ?
1931 : Grock de Carl Boese version allemande : Grock
1931 : Grock de Carl Boese et Joë Hamman version française : Grock
1939 : Revue-Film der Akkordeon-Fabrik Hohner film en couleur
1954 : Le Dernier Spectacle de Grock
1957 : 5 séquences du programme de Grock télévision italienne RAI
1950 : Au revoir monsieur Grock de Pierre Billon : lui-même
Musique
Il a composé plus de 2500 mélodies
De nombreuses chansons publiées par sa maison d'édition L. Silbermann und A. Grock, par Hohner
Ces chansons ont été chantées par de grandes vedettes: Fred Barnes, Émilie Hayes, Florrie Forde, George d'Albert,...
Disques
Plusieurs disques produit par la maison Odéon
Iconographie
1950 - Portrait photographique par Émile Savitry.  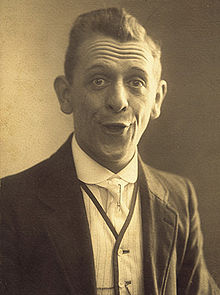    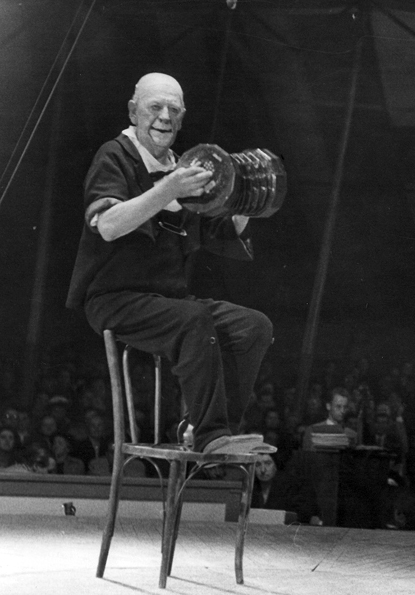  
Posté le : 08/01/2016 16:47
Edité par Loriane sur 10-01-2016 17:27:31
Edité par Loriane sur 10-01-2016 17:29:08
|
|
|
|
|
Re: Défi festif du 2 janvier 2016 |
|
Modérateur  
Inscrit:
21/03/2013 20:08
De Belgique
Niveau : 44; EXP : 15
HP : 215 / 1078
MP : 1072 / 35550
|
Ah ah la foudre s'est crue la plus forte ! On lui a bien rabattu le caquet.
Personnellement, je suis du côté de l'Arc-en -ciel qui ma ravit chaque fois que je le voit dans le ciel.
Une fable bien sympathique.
Je suis toujours admirative devant les termes recherchés que tu emploies. J'en apprends des choses en te lisant.
Un grand merci mon ami. Que la santé te soit acquise à vie !
Bises
Couscous
Posté le : 07/01/2016 20:01
|
|
|
|
|
Re: Défi festif du 2 janvier 2016 |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
18/02/2015 13:39
De Dijon
Niveau : 39; EXP : 1
HP : 190 / 950
MP : 767 / 25999
|
Chères Loréennes et chers Loréens,
Il eût été décalé que je ne réponde point à ce défi.
Alors me voici avec ma réponse que vous trouverez peut être de circonstance (sourire).
Je l'ai appelé "la foudre et l'arc en ciel fêtent la Saint Sylvestre à l'Olympe".
Les dieux de L’olympe se voulant être sages,
Et désireux d’honorer tout leur entourage,
Invitent à la Saint Sylvestre les éléments
Du ciel, pour contrebalancer les manquements
De quelque dieu trublion peu accommodant.
Pour glorifier ce bel appel affriandant,
Tous viennent sous l’égide de l’arc en ciel
Sauf la foudre, qui se croyant un officiel,
Exige qu’une invitation lui soit tenue,
Et qu’à la fête lui soit ouverte une avenue.
Cette fête commence dans la bonne humeur,
Et se poursuit dans la vive joie et les clameurs.
Alors que Bacchus égaye ce beau festin,
La foudre s’invite en provocateur mutin.
Quel est ton dessein réel lui dit l’arc-en-ciel,
Lucide sur ses désirs si peu factuels.
Arrosons cette fête d’un peu de folie
Lui dit la foudre hypocrite mais polie !
Il en résulte dans la fête une bourrasque
Qui voit quelques dieux se complaire dans des frasques.
Je peux accepter de vous quelques errements
Mais pas une grande pagaille assurément.
Faisant fi de ces mots, la foudre bien surprise
Poursuit son œuvre sans croire en une méprise.
Devant votre provocation renouvelée,
Comprenez que ma colère soit redoublée,
Lui lance l’arc-en-ciel, se sentant aculé.
Votre provocation est un enfantillage.
Quel est l’intérêt de choquer son entourage,
Sauf à vouloir tant créer une zizanie
Qui se termine toujours dans une avanie ?
Acceptons le changement lui répond la foudre,
Appréciant indubitablement d’en découdre.
Parce que tu veux être dans le firmament
Tu nous agites pour semer l’enfièvrement
Mais ainsi tu te confines dans un tonneau
Dans lequel ton fatum est d’être penaud,
Lui dit l’arc-en-ciel, soucieux de rester serein.
La provocation nécessaire est mon destin
Lui répond la foudre se croyant vertueuse.
Mais penses-tu que cette violence tueuse
Conduira au changement que tu espères tant ?
Les mutations que nous souhaitons tous autant
Ne se construisent pas dans la témérité,
Mais seulement très loin de la médiocrité.
Gaie, elle continue à mettre le feu aux poudres,
Mais son acharnement, devenant agaçant,
Ne présente plus le même effet menaçant
Auprès des dieux qui la trouve peu charitable,
Au point de la trouver bien misérable.
J’en appelle à Zeus pour défendre mes intérêts
Lui dit la foudre, bien peureuse et aux aguets.
Mais Le roi des dieux demeure très silencieux
Devant l’agitateur soudain moins audacieux.
Loin de lui, je vois que ton courage s’efface
Au point que vous en perdez sûrement la face.
Tous les éléments du ciel s’unissent alors,
Et contraignent la foudre à assumer son sort.
Et Bacchus donne à la fête un nouvel essor.
Quelle est la morale de cette simple page.
Que croyez qu’il advienne après un orage ?
La foudre ne sera plus de votre entourage,
De l’arc-en-ciel vous verrez sûrement l’ouvrage
Qui éloignera le souvenir de toute rage.
A une fête, il y a toujours une mort
Mais la provocation n’en est pas le passeport.
Elle croit avoir gagné alors qu’elle s’est perdue
Dans sa propre mort qui est plus tôt apparue.
In fine, la provocation n’est qu’un ruisseau
Qui finit son cours dans un modeste verre d’eau.
Amitiés.
Jacques
Posté le : 06/01/2016 19:39
|
|
|
|
|
Jaroslav Hašek |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 3 janvier 1923 à 39 ans meurt Jaroslav Hašek
à Lipnice nad Sázavou en Tchécoslovaquie, né le 30 avril 1883 à Prague, romancier, humoriste et journaliste libertaire d'origine tchèque, rendu célèbre par son chef-d'œuvre satirique Le Brave Soldat Chvéïk. Il représente, avec Franz Kafka, le renouveau littéraire pragois du début du XXe siècle. Le nom de Hašek, hors du territoire de l'ancienne Tchécoslovaquie, est souvent méconnu, même de ses lecteurs. Mais Švejk alias Chveïk, Schweyk, Shweik et vingt autres graphies, le bonhomme Švejk surgit dès qu'on le nomme, dans toute sa rondeur et sa force d'inertie, avec son clair regard provocateur, son désarmant « visage naïf, souriant comme la pleine lune », et sa parole intarissable. Hašek serait-il l'homme d'un seul livre, lequel, par son succès même, l'aurait relégué dans une quasi-inexistence ?
En bref
Pourtant Jaroslav Hašek, auteur d'un millier de contes publiés dans des revues, humoriste, journaliste, anarchiste et alcoolique, exista bel et bien pour ses amis bohèmes du Prague d'avant 1914 et pour ses ennemis jurés les fonctionnaires de la police autrichienne, pour ses camarades russes des débuts de la révolution d'Octobre, enfin pour ses compatriotes d'après 1920, indignés qu'au moment où l'État récemment créé se devait de s'établir dans la respectabilité bourgeoise on osât proposer du Tchèque, à la face du monde, la scandaleuse image de l'anti-héros. Et s'il est vrai que « Švejk, c'est Hašek », que le livre a bénéficié de tout le vécu de son auteur, on gagne certes à interroger l'existence de ce dernier. Mais des milliers de lecteurs et de spectateurs de par le monde connaissent Švejk sans rien savoir de Hašek, ni parfois des Tchèques, des Habsbourg, de 14-18, de l'Europe. Le livre, pour eux, se dresse seul, autonome et intense.
Un milieu petit-bourgeois paupérisé, un père autoritaire et tôt disparu expliquent les orientations fondamentales de Hašek : sa conscience de l'exploitation capitaliste et son travail de sape contre l'autorité, son instabilité encore. Jaroslav Hašek est né à Prague en 1883. À la mort du père (1896), professeur « suppléant » de mathématiques puis employé de banque, la mère vit de travaux de couture. Jaroslav, lycéen, inaugure la vie mouvementée qu'il ne quittera plus. Apprenti chez un marchand de couleurs, il revient ensuite aux études dans une école commerciale. Chaque été il entendra l'appel de la route et parcourra toute l'Europe centrale. Premiers essais littéraires en 1900, premiers contacts avec les groupes anarchistes en 1904. Dans un poste d'employé, il ne tient pas plus de quelques mois, et son mariage sombre au bout de deux ans. Mais il fait bon vivre dans le Prague de la Belle Époque, ses beaux quartiers et ses bas-fonds, narguer le bourgeois et la police, même si, au sortir du cabaret, on se retrouve au poste.
D'année en année, Hašek parfait son métier d'écrivain : cent quatre vingt-cinq nouvelles publiées entre 1901 et 1908, soixante-quinze pour la seule année 1910. Le grand roman en sera l'aboutissement.
Pour faire mûrir cette œuvre, il fallait la guerre. Affecté au 91e régiment d'infanterie – le régiment de Švejk –, l'écrivain arrive au front le 5 avril 1915 et passe chez les Russes le 24 septembre ! Dès lors, c'est tout à coup le brave soldat Hašek se prenant au sérieux. Responsable politique et rédacteur des journaux de la légion tchèque à Kiev, il se joint à l'Armée rouge en février 1918, entre au parti bolchevique en mars et milite à Moscou. À la fin de 1920, le révolutionnaire rentre au pays. À la désillusion politique se joignent l'hostilité générale, la misère, la maladie. Il meurt à Lipnice, à moins de quarante ans, sans avoir pu achever le quatrième volume des Aventures du brave soldat Švejk dans la Grande Guerre (Osudy dobrého vojáka Švejka za Světové války, 1921-1923
Sa vie
Jaroslav Hašek est né en 1883 à Prague. Il était le fils de Josef Hašek, un professeur de mathématiques enseignant au collège, et de sa femme Katerina.
La pauvreté força la famille, avec ses trois enfants (Bohuslav, de trois ans plus jeune que Jaroslav, et Maria, une cousine orpheline à déménager plus d'une dizaine de fois. Jaroslav ne connut jamais de foyer fixe, une absence de racine qui influença sa vie errante de manière décisive.
Dépressif, son père fut emporté en 1896 par ses excès d'alcool, alors que le jeune Jaroslav n'avait que treize ans.
Jaroslav entraîna bien vite le désespoir de sa mère Katerina, qui voulait faire de lui un citoyen respectable mais n'arrivait pas à l'éduquer convenablement. Il abandonna le collège dès l'âge de quinze ans et un pharmacien du nom de Kokoska en fit son assistant un certain temps. Toutefois il finit par obtenir une formation à l'académie commerciale de Prague, où il obtint un diplôme à dix-neuf ans. Il trouva un emploi à la Slava Bank, mais fut vite renvoyé, car il semblait déjà très porté sur la boisson.
L'anarchiste impétueux
Très vite dans sa carrière, Hašek s'affirma activement en tant qu'anarchiste et publia de très nombreux textes dans la presse politique de langue tchèque. En 1907 il devint rédacteur en chef du périodique anarchiste Komuna. Il est ensuite journaliste aux périodiques Ženský obzor L'Horizon de la femme, à partir de 1908, Svět zvířat Le Monde des animaux, un journal satirique, České slovo Le Mot tchèque, à partir de 1911, mais aussi et de manière irrégulière aux: Čechoslovan, Pochodně, Humoristicky listy.
Il fonde en 1911 le Parti du lent progrès dans les limites de la loi Stranu mírného pokroku v mezích zákona et se présente comme son candidat tout en caricaturant les autres partis et le mode de scrutin.
Désireux à un moment de retrouver une existence moins mouvementée, il épousa Jarmila Mayerová, elle-même une écrivaine, mais sans grand succès. Il se fit une spécialité du vol et du trafic de chiens, allant jusqu'à inventer de faux pedigrees pour revendre des bâtards à un meilleur prix, comme le fera Chvéïk dans son roman.
Les pulsions suicidaires ne lui étaient pas étrangères et on l'empêcha un jour de justesse de se jeter du pont Cech à Prague. À la suite de cet incident, il passa une courte période en établissement psychiatrique, ce qui là aussi constituera plus tard pour lui une source d'inspiration.
Hašek eut un enfant de Jarmila, Richard. Mais sa femme le quitta peu après pour retourner chez ses parents, emportant Richard avec elle. Jaroslav en fut réduit à louer une chambre dans un bordel, le U Valsu.
Hašek chez les Soviets
En 1915, Jaroslav Hašek, qui avait acquis une solide réputation de noceur, fut enrôlé dans l'armée autrichienne. Il fut incorporé au 91e régiment autrichien sur le front de Galicie en 1915 et n'hésitera pas plus tard à ridiculiser ses supérieurs, dans Le Brave Soldat Chvéïk, sous leurs véritables noms.
Hašek servit également en Bohême du sud avant de gagner la Hongrie. En septembre 1915, son unité fut isolée à la suite d'une percée des troupes russes et Hašek se rendit aux Russes. Il fut emprisonné dans un camp en Ukraine, puis dans l'Oural.
En 1917, la Révolution russe mit fin à la guerre sur le front de l'Est. Hašek, libéré, s'engagea volontairement au service des bolcheviks en 1918, qui en firent un commissaire politique dans la 5e armée russe. Il s'engagea parallèlement dans la Légion tchèque, une organisation nationaliste visant à émanciper les Tchèques de la tutelle austro-hongroise.
Le retour à Prague et les années Chveïk
Monument à Jaroslav Hašek dans le quartier pragois de Žižkov.
Jaroslav Hašek fut de retour à Prague en 1920, capitale de la nouvelle Tchécoslovaquie et s'engagea plus que jamais dans la politique, guidé par ses idéaux communistes et nationalistes. De Russie il ramenait, entre autres, une nouvelle "épouse", bien que n'ayant jamais divorcé d'avec Jarmila.
Tout en continuant à boire énormément, Hašek entama l'écriture rapide des aventures du brave soldat Chvéïk, un personnage qu'il avait déjà créé dans d'autres histoires, aujourd'hui perdues. La verve noire et comique de Jaroslav Hašek s'adressait directement au petit peuple.
Hašek avait l'intention d'en écrire six volumes, mais il ne put en terminer que trois, car il mourut le 3 janvier 1923 à Lipnice nad Sázavou.
Ces trois volumes furent publiés, suivis par un quatrième volume, posthume et inachevé, mais terminé par son ami Karel Vaněk.
En 1991, les quelques écrits de jeunesse non perdus de Hašek furent rassemblés sous le titre Le Scandale de Bachura et autres nouvelles.
Un monument équestre à sa mémoire a été érigé en 2005 dans le quartier pragois de Žižkov où Hašek vécu. C'est la dernière œuvre de son auteur, le sculpteur tchèque Karel Nepraš.
Le petit monde du brave soldat Švejk
Historiquement, l'univers de Švejk est le monde cruel et burlesque d'une des autocraties du XIXe siècle finissant. Contemporain du monde de Kafka, il en est le revers : comme si les « messieurs » tombaient en poussière au contact du rire de Joseph K. Ce sain optimisme, Hašek le doit à ses principes, à l'entrain aussi du petit peuple des faubourgs pragois, au folklore tchèque que domine la figure de Honza, le niais rusé, et encore à l'influence de Gorki et d'un prédécesseur fameux, le poète satirique Karel Havlíček Borovský (1821-1856). Enfin Hašek a derrière lui trois siècles de résistance sournoise au despotisme. Il se sent fort.
Entre 1900 et la guerre, dans ses nouvelles, ce sont donc des personnages de cirque qu'il collectionne. Les clowns d'abord : ils sont là, les bureaucrates et les généraux, les curés et les mouchards, les bourgeois et les politiciens, tous les gratte-papier, les manches lustrées et les cervelles d'oison sur qui s'appuie le système branlant de la monarchie austro-hongroise ! En face, le peuple ; dans le peuple, Švejk (qui apparaît dans cinq nouvelles en 1911). Ici, de grinçante, la plume de Hašek se fait amusée. Le peuple a sa médiocrité, mais, en contrepoint aux fantoches inquisiteurs, il représente la vie.
Les clowns viennent faire leur numéro et repartent. C'est la guerre qui va créer le spectacle géant et permanent avec Švejk au centre (première version du roman : Le Brave Soldat Švejk en captivité [Dobrý voják Švejk v zajetí], Kiev, 1917). En effet la guerre est la fin logique du système. À une machine bureaucratique qui tournait à vide elle apporte une matière, la chair à canon ; elle lui apporte aussi la mort, car pour la première fois le cabotage par l'intérieur devient efficace. Deux images : Švejk partant au service dans la petite voiture d'infirme et agitant ses béquilles au cri de « À Belgrade ! » ; aux psychiatres qui lui demandent « combien fait douze mille huit cent quatre-vingt-dix-sept multiplié par treize mille huit cent soixante-trois », Švejk répondant : « Sept cent vingt-neuf ». Švejk ou comment désorganiser le monde de la folie organisée... À l'entreprise de destruction de Hašek, la guerre a apporté le nécessaire cadre épique. Une œuvre jusque-là émiettée acquiert sa vraie dimension.
La fortune d'une œuvre
On comprend que Piscator et Brecht aient été les premiers sensibles à cette puissante portée subversive. Si la première adaptation dramatique de Švejk (par Longen) eut lieu à Prague dès 1921, celle d'Erwin Piscator, avec la collaboration de Bertolt Brecht à Berlin en 1928, ouvrit sa carrière à l'étranger. À partir de là, traductions, pièces, films prolifèrent, en un nombre impressionnant de langues (allemand, 1929 ; anglais, 1930 ; français, 1932). Quant à Brecht, il composa en 1943 son Schweyk dans la deuxième guerre mondiale (Schwejk im zweiten Weltkrieg) qui montre son admiration pour un livre qu'il considérait comme l'un des trois meilleurs du XXe siècle. Ouvrage immoral, vulgaire, démoralisant, comme le prétendait le public tchèque bien-pensant, ou livre universel ? C'est certainement un livre universel. Parce qu'il est contre la guerre et ceux à qui elle profite ? Il faut dépasser l'antimilitarisme de Švejk. Plus qu'un manuel de la résistance passive (la Švejkovina), le document d'une époque ou une galerie de types pittoresques, c'est, avant tout, le livre de la destruction radicale du Système, grâce surtout à la Parole. Pour Švejk, l'irrépressible bavard, celle-ci est l'arme favorite avec laquelle il paralyse et achève l'ennemi. « Švejk, je vous ai déjà dit de la fermer, vous entendez ? – Je vous déclare avec obéissance que j'ai entendu que je devais la fermer. » La parole, son flot ininterrompu sous forme d'histoires, dont chacune est remplaçable mais qui sont indissociables les unes des autres, fascine aussi le lecteur. Švejk ne serait-il pas une sorte d'artiste populaire reconstruisant sa vie avec le verbe ? Comme chacun, il subit les événements : raconter est sa résistance active à un destin imposé. En associant à chaque événement un autre tiré de son expérience (réelle ou imaginaire), il l'apprivoise, le domine, l'incorpore à un ensemble cohérent, sa vie « revue et corrigée », son œuvre d'art. De même Hašek le conteur, en faisant de ses nouvelles un roman, trouva peut-être la satisfaction et l'équilibre pour le peu de temps qui lui restait à vivre. Jeanne Bem
Œuvres traduites en français
Le Brave Soldat ChvéÏk, Gallimard, 1932, Folio no 676, 1975
Nouvelles aventures du brave soldat Chvéïk , Gallimard, Folio no 1663, 1985
Dernières Aventures du brave soldat Chvéïk, Gallimard, 1980
De Prague à Budapest, Ibolya Virag, 1996
Les Aventures dans l'Armée rouge, Ibolya Virag, 2000
Histoire du Parti pour un progrès modéré dans les limites de la loi, Fayard, 2008
  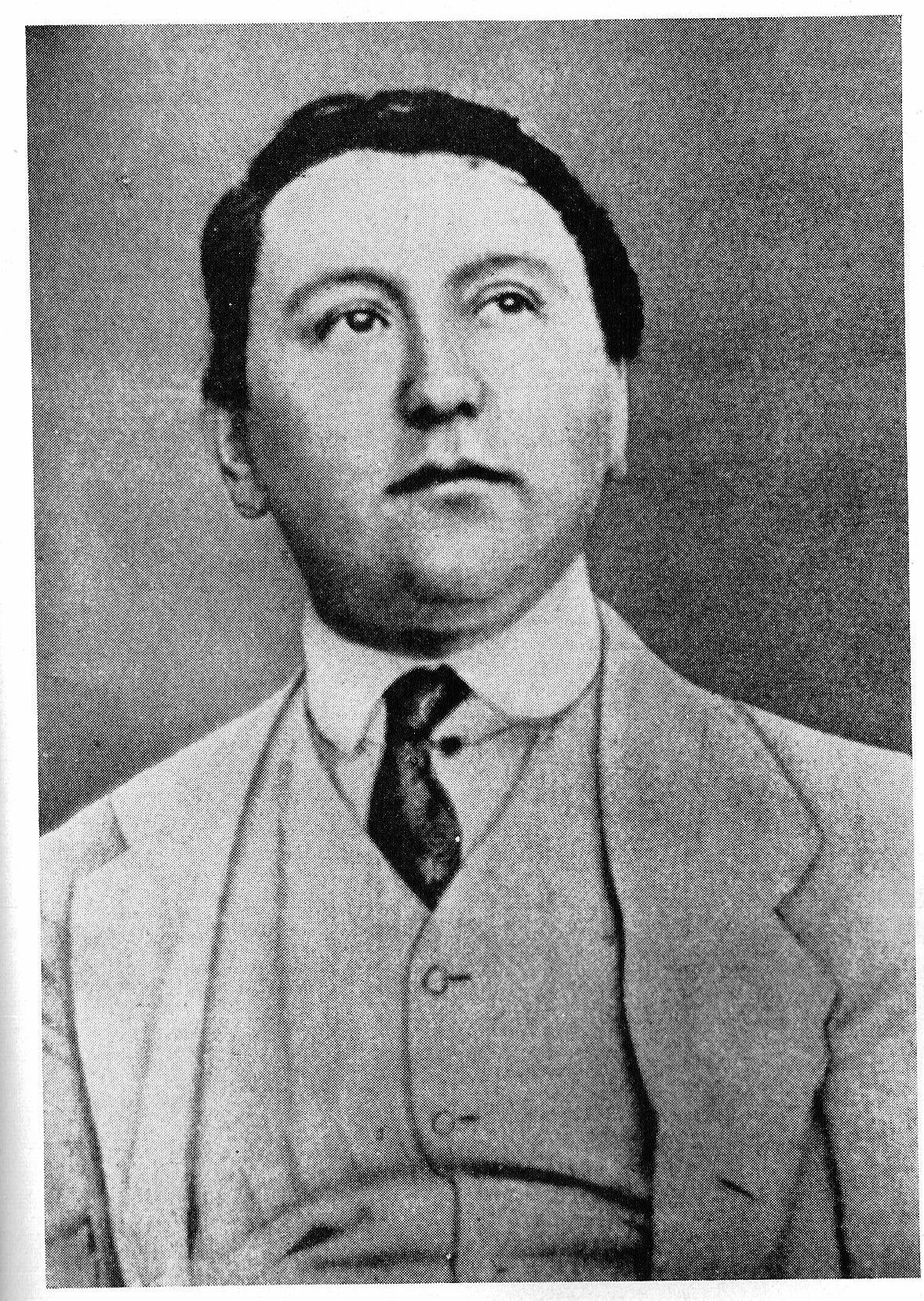  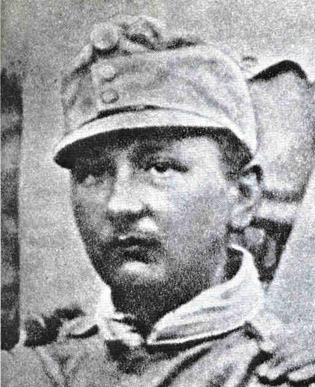     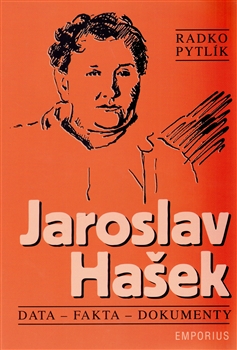
Posté le : 04/01/2016 23:23
Edité par Loriane sur 05-01-2016 17:29:39
Edité par Loriane sur 05-01-2016 17:30:25
|
|
|
|
|
Baldassare Galuppi |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 3 janvier 1785 à 78 ans meurt Baldassare Galuppi
à Venise, né le 18 octobre 1706 sur l'île de Burano près de Venise, compositeur vénitien de musique baroque, il a pour surnom " Il Buranello "
En bref
Les ouvrages lyriques du compositeur italien Baldassare Galuppi lui ont valu le titre de père de l'opéra bouffe.
Né le 18 octobre 1706, sur l'île de Burano, près de Venise, Baldassare Galuppi, qui sera surnommé Il Buranello en raison de son lieu de naissance, se forme auprès de son père, barbier et violoniste, compose dès l'âge de seize ans la favola pastorale La Fede nell'inconstanza créée à Vicence en 1722 puis étudie à Venise sous la férule d'Antonio Lotti. Après avoir composé, en collaboration avec Giovanni Battista Pescetti, un « dramma per musica », Gl'odi delusi dal sangue 1728, son premier grand succès, et une pastorale, Dorinda 1729, il compose de nombreux autres ouvrages lyriques pour les théâtres de la Vénétie, d'abord dans le genre « seria », comme Alessandro nell'Indie 1738 ou Adriano in Siria 1740, tous deux sur des livrets de Métastase. En 1741, Galuppi se rend à Londres et arrange un « pasticcio », Alexander in Persia. Plusieurs de ses ouvrages sont montés en Angleterre, parmi lesquels le « melodramma » Penelope (1741) et le « dramma per musica » Enrico (1743) ; Charles Burney évoque l'influence considérable de cet Italien sur les compositeurs anglais. En 1748, Galuppi devient vice-maître de chapelle à la basilique Saint-Marc de Venise, avant d'y devenir maître de chapelle en 1762. De 1765 à 1768, il officie comme maître de chapelle de Catherine II à la cour de Saint-Pétersbourg, où il fait représenter en 1768 un dramma per musica, Ifigenia in Tauride, et où il est le maître de Dmytro Bortnianski. De retour à Venise en 1768, il reprend ses fonctions à Saint-Marc. Baldassare Galuppi meurt dans la cité vénitienne, le 3 janvier 1785.
Baldassare Galuppi est l'un des compositeurs d'opéras les plus prolifiques et les plus joués de son temps : il signera plus d'une centaine d'ouvrages lyriques entre 1722 et 1773, aussi bien comiques (« dramma comico », « dramma giocoso ») que sérieux (« dramma per musica »). Nombre d'entre eux (composés après 1749) sont le fruit d'une collaboration avec le dramaturge vénitien Carlo Goldoni : L'Arcadia in Brenta (1749, qui lui confère le titre de « padre dell'opera buffa »), Arcifanfano re dei matti (1750), Il paese della cuccagna (1750), Il mondo alla roversa (1750), Il mondo della luna (1750), Il conte Caramella (1751), Le virtuose ridicole (1752, d'après Les Précieuses ridicules de Molière), La calamita de' cuori (1752), I bagni d'Abano (1753), Il filosofo di campagna (1754, son opéra bouffe le plus populaire de son vivant), La diavolessa (1755), Le nozze (1755), La cantarina (1756), La cameriera spiritosa (1766)... Doté d'un sens aigu de l'harmonie, du rythme et de l'orchestration, choisissant fort habilement ses sujets, Galuppi est l'un des premiers compositeurs d'opéra à avoir pris conscience de l'importance dramaturgique des finales intermédiaires, dans lesquels tous les personnages apparaissent dans un ensemble musical qui mène l'action jusqu'au terme d'un acte. Galuppi est également l'auteur de pièces sacrées – il a notamment composé une trentaine d'oratorios – et de musique instrumentale, dont se détachent sept Concerti a quattro, pour deux violons, alto et violoncelle, et de nombreuses sonates, toccatas et divertimentos pour clavecin qui préfigurent le style classique.
Sa vie
Surnommé Il Buranello d'après son lieu de naissance, il apprend d'abord la musique avec son père, barbier de profession, mais aussi violoniste amateur. À 16 ans, il se rend à Venise où il vit des salaires perçus comme organiste dans différentes églises, puis étudie, sur la recommandation de Benedetto Marcello, le clavecin et la composition avec Antonio Lotti, premier organiste de l'église des Doges de San Marco. Son premier opéra, composé à 16 ans, La fede nell'incostanza, donné en 1722, est un échec, mais il connaîtra son premier succès important dès 1729 avec son opéra Dorinda.
Le parcours dans la vie musicale vénitienne
De 1740 à 1751, il est maître de musique à l'Ospedale dei Mendicanti, institution vénitienne de bienfaisance réservée aux jeunes filles orphelines et souffrantes. Le 24 mai 1748, il obtient le poste de maître adjoint de la Cappella Marciana de Saint-Marc, dont il devient le maître en 1762. Quatre ans plus tard, sous son impulsion ou, plus probablement, sous celle de Gaetano Katilla, maître de chapelle assistant, l'orchestre du doge est l'objet d'une restructuration importante, faisant passer l'effectif à 35 instrumentistes et 24 choristes. La même année, il prend la direction du chœur de l'Ospedale degli Incurabili qu'il conservera jusqu'en 1777.
Les voyages
À partir de 1740, il fait de nombreux voyages, à Vienne, à Berlin où il rencontre Carl Philipp Emanuel Bach. Deux longs séjours à l'étranger sont particulièrement importants : en 1741, il est appelé en Angleterre par Lord Middlesex, où il est engagé pendant deux ans comme compositore serio dell' opera italiana, composant trois opéras pendant son séjour londonien. Approché par le tsar Pierre III en 1761, ce n'est cependant qu'en 1765 qu'il est nommé par Catherine II de Russie compositeur de cour à Saint-Pétersbourg, les autorités vénitiennes lui ayant assuré la conservation de son poste de maître de chapelle et des émoluments correspondants, pourvu qu'il compose chaque année un Gloria et un Credo pour la messe de Noël donnée en la basilique de San Marco, tâche à laquelle il ne faillit pas comme en témoignent les manuscrits des années 1766 et 1767 conservés à Gênes. À Saint-Pétersbourg, il compose quinze œuvres vocales pour l'Église russe orthodoxe.
Retour à Venise
De retour à Venise, il consacre la fin de sa vie à la musique pour clavecin et aux œuvres religieuses. Il dirige notamment en mai 1782 plusieurs concerts pour la visite à Venise du pape Pie VI. Il meurt le 3 janvier 1785 ; à ses funérailles solennelles en l'église San Vidal, chante notamment le grand castrat Gasparo Pacchiarotti.
Un maître de l'opéra
C'est dans les années 1740 que débuta la collaboration fructueuse avec Goldoni, à l'occasion de l'écriture de l'opéra Gustavo primo, re di Svezia, qui allait donner naissance en moins de sept ans aux 17 œuvres comiques communes qui assurèrent la célébrité de Galuppi. Il filosofo di campagna fut ainsi monté plus de 70 fois au xviiie.
Postérité
Au faîte de sa gloire, Galuppi était plus célèbre que Vivaldi. C'est ainsi qu'un prêtre vénitien, Giuseppe Baldan, envoya à la cour de Saxe quatre œuvres de Vivaldi en les faisant passer pour des compositions du Buranello. Admiré dans toute l'Europe, il fut un modèle pour nombre de ses contemporains, notamment Joseph Haydn et Carl Philipp Emanuel Bach et fut défendu, entre autres, par Giacomo Casanova et par Jean-Jacques Rousseau. Ce dernier écrit notamment dans sa Lettre sur la musique française :
« J'ai vu à Venise un Arménien, homme d'esprit, qui n'avait jamais entendu de musique, et devant lequel on exécuta, dans un même concert, un monologue français qui commence par ce vers Temple sacré, séjour tranquille et un air de Galuppi, qui commence par che, Voi che languite senza speranza... . L'un et l'autre furent chantés, médiocrement pour le français et mal pour l'italien, par un homme accoutumé seulement à la musique française, et alors très-enthousiaste de celle de M. Rameau. Je remarquai dans l'Arménien, durant tout le chant français, plus de surprise que de plaisir; mais tout le monde observa, dès les premières mesures de l'air italien, que son visage et ses yeux s'adoucissaient ; il était enchanté, il prêtait son âme aux impressions de la musique; et, quoiqu'il entendît peu la langue, les simples sons lui causaient un ravissement sensible. Dès ce moment on ne put plus lui faire écouter aucun air français.
Le poète anglais Robert Browning lui a consacré un célèbre monologue dramatique, A Toccata of Galuppi's, publié en 1855, et dont voici les deux premiers tercets :
Oh Galuppi, Baldassaro, this is very sad to find!
I can hardly misconceive you; it would prove me deaf and blind;
But although I take your meaning, 'tis with such a heavy mind!
Here you come with your old music, and here's all the good it brings.
What, they lived once thus at Venice where the merchants were the kings,
Where Saint Mark's is, where the Doges used to wed the sea with rings?
En honneur de Galuppi, une statue a été érigée sur la seule place de l'île de Burano, la piazza Galuppi. L'Associazione Festival Galuppi organise tous les ans un festival qui lui est en partie dédié.
Principales œuvres
Opéras
Dorinda, 1729
Gustavo Primo, re di Svezia Gustave premier, roi de Suède, dramma per musica en 3 actes, livret de Carlo Goldoni, créé le 25 mai 1740, à Venise au Teatro San Samuele.
Aronte, re de' Sciiti Oronte, roi des Scythes, livret de Carlo Goldoni, 1740
Scipione in Cartagine Scipion à Carthagène, 1741
Demetrio, livret de Pietro Metastasio, 1748
Artaserse, dramma per musica en 3 actes, livret de Pietro Metastasio, créé le 27 janvier 1749, à Vienne au Theater nächst der Burg.
Arcadia in Brenta, livret de Carlo Goldoni, 1749
Il conte Caramella, livret de Carlo Goldoni, 1749
Il mondo della luna, dramma giocoso en 3 actes, livret de Carlo Goldoni, créé le 29 janvier 1750, à Venise, au Teatro San Moisè.
Il mondo alla roversa osia Le donne che comandano, drame burlesque en 3 actes, livret de Carlo Goldoni, créé au Teatro Tron di San Cassiano, Venise à l'automne 1750
Il Filosofo di campagna Le Philosophe de campagne, opéra-bouffe en 3 actes, livret de Carlo Goldoni, 1754
L'amante di tutte, 1760
Il marchese villano, 1762
L'inimico delle donne, opéra bouffe en 3 actes, livret de Giovanni Bertati d'après Zon-zon, principe di Kibin-kan-ka de Giovanni Gazzaninga, créé au printemps 1771, à Venise, au Teatro San Samuele.
Œuvres religieuses
Environ cent cantates
27 oratorios
Motets
Divers
6 sonates pour clavecin, op. 1 1756, Londres
6 sonates pour clavecin, op. 2 1759, Londres
Ouverture pour clavecin Londres
3 sonates pour clavier
11 mouvements pour clavecin
environ 130 sonates, toccatas, divertissements et lessons pour clavecin
Symphonie a 4
Plusieurs symphonies et ouvertures
Plusieurs concertos
Plusieurs trios
       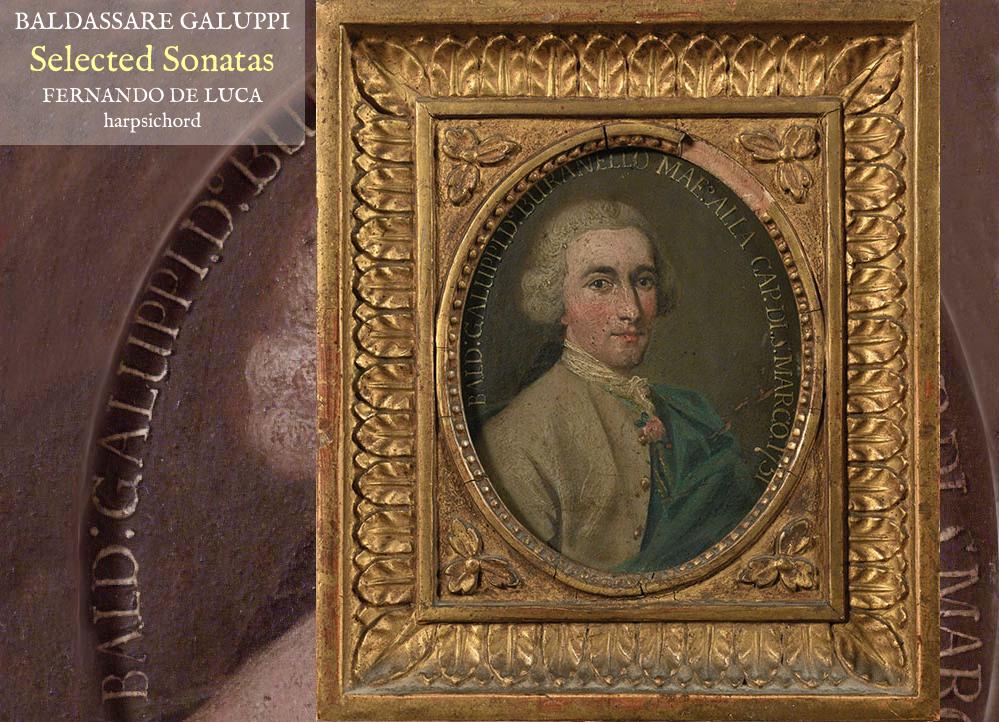  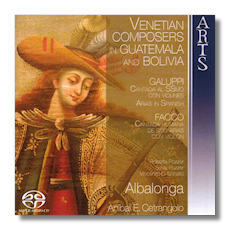
Posté le : 04/01/2016 23:07
Edité par Loriane sur 05-01-2016 23:58:43
Edité par Loriane sur 05-01-2016 23:59:37
|
|
|
|
|
Ferdinand-Antoine Ossendowski |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 3 janvier 1945 meurt à 68 ans, Ferdinand-Antoine Ossendowski
à Milanówek en Pologne, né Ferdynand Antoni Ossendowski le 27 mai 1876 dans l’Empire russe près de Ludza aujourd'hui en Lettonie, écrivain aventurier polonais, auteur de récits de voyage, Roman d'aventures, Écrits politiques. Ses Œuvres principales sont Bêtes, Hommes et Dieux en 1923, Lénine en 1931, géologue, universitaire, militant politique connu pour ses témoignages sur la Révolution russe de 1905 à laquelle il a pris part, et un aventurier et explorateur connu pour ses récits de voyage. Appelé le Robinson Crusoé du vingtième siècle, il a été lauréat de l'Académie française.
Sa vie
Enfant, il s'installe avec son père médecin à Saint-Pétersbourg (Russie) où il suit sa scolarité en russe. Il s'inscrit à l'université et entame des études de mathématiques, de physique et de chimie. Il commence alors à mener des voyages d'étude puis parcourt les mers d'Asie à bord d'un bateau qui assure la liaison maritime entre Odessa et Vladivostok. Il publie ses récits consacrés à la Crimée, à Constantinople et à l'Inde.
En 1899, il fuit la Russie à la suite d'émeutes étudiantes, et se rend à Paris où il poursuit ses études à la Sorbonne, ayant notamment le chimiste et académicien Marcellin Berthelot comme professeur ; il y a également rencontré sa compatriote Marie Curie. Il retourne en Russie en 1901 et enseigne la physique et la chimie à l'Institut de Technologie de l'Université de Tomsk, en Sibérie occidentale. Il donne aussi des cours à l'Académie d'Agriculture et publie des articles consacrés à l'hydrologie, à la géologie, à la physique et à la géographie.
En 1905, il est nommé au laboratoire de recherches techniques de Mandchourie, chargé de la prospection minière, et dirige le département de la Société russe de géographie à Vladivostok. Il visite à ce titre les îles de la mer du Japon et le détroit de Béring. Il est alors un membre influent de la communauté polonaise de Mandchourie et publie, en polonais, son premier roman, Noc litt., La Nuit.
Impliqué dans les mouvements révolutionnaires, il est arrêté et condamné à mort. Sa peine sera commuée en travaux forcés. Mais il est relâché en 1907 avec l'interdiction de travailler et de quitter la Russie. Il se consacre alors à l'écriture de romans, en partie autobiographiques, qui lui permettent de regagner la grâce des dirigeants. En février 1917, il est nommé professeur à l'Institut polytechnique d'Omsk, en Sibérie. Lorsqu'éclate la Révolution d'Octobre, il se rallie aux groupes contre-révolutionnaires, et accomplit différentes missions pour Alexandre Vassilievitch Koltchak, qui fait de lui son ministre des finances.
L'aventurier
Condamné à fuir avec d'autres compagnons, il raconte son épopée dans Bêtes, Hommes et Dieux, qui sera publié en 1923. Le récit, qui se présente comme un livre d'aventures vécues, commence au moment où Ossendowski vient d'apprendre qu'on l'a dénoncé aux Bolcheviks et que le peloton d'exécution l'attend. Il emporte un fusil et quelques cartouches et gagne la forêt dans le froid glacial. Commence ainsi une course-poursuite dont il ne sortira vivant, pense-t-il, que s'il réussit à gagner à pied l'Inde britannique, par les passes de Mongolie, puis le désert de Gobi, puis le plateau tibétain, ensuite l'Himalaya. En réalité, il ne pourra pas atteindre le Tibet et il devra revenir en Mongolie en proie aux troubles de la Révolution mongole de 1921.
Au cours de son périple, Ossendowski rencontre le baron von Ungern-Sternberg avec qui il passe dix jours à Ourga. Avec l'aide de ce dernier, il arrive finalement à joindre la côte pacifique Pékin et les États-Unis. C'est là qu'il s'arrête finalement. Refusant de retourner en Asie, il décide de s'installer à New York. Il travaille alors pour les services secrets polonais et publie son récit Bêtes, Hommes et Dieux. Le livre sera traduit dans vingt langues et sera publié 77 fois. Ossendowski est alors l'un des cinq écrivains les plus populaires dans le monde, et ses livres sont comparés avec les œuvres de Rudyard Kipling, d'Albert Londres ou de Karl May.
Retour en Pologne.
En 1922, il retourne en Pologne et s'installe à Varsovie. Il enseigne alors à l'université, à l'École supérieure de guerre et à l'Institut d'études politiques de la capitale. Dans le même temps, il est fréquemment consulté par le gouvernement sur les questions liées à la politique soviétique.
Tout en continuant de voyager, il publie différents ouvrages qui le feront considérer comme l'un des auteurs polonais les plus populaires, y compris à l'étranger. Il réédite le succès de son premier récit avec un livre consacré à Lénine, dans lequel il critique sévèrement les méthodes des dirigeants communistes en Russie.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ossendowski reste à Varsovie où il participe au gouvernement clandestin de Pologne sur les questions d'éducation. De confession luthérienne, il se convertit au catholicisme en 1942. Malade, il s'installe en 1944 dans le village de Żółwin, près de Milanówek où il meurt le 3 janvier 1945. Les militaires soviétiques qui avaient réussi à s'emparer de la région le cherchaient pour l'arrêter en tant qu'ennemi du peuple à la suite de ses écrits anticommunistes. Il a fallu déterrer son corps pour apporter la preuve de sa mort. Ses ouvrages ont été, par la suite, interdits par le gouvernement communiste de Pologne jusqu'à la chute du régime en 1989.
Œuvre parue en France
1913 : Le Brig « Le Terreur », nouvelle de science-fiction
Première publication en France en 2015 dans un recueil de deux nouvelles : Le Brig « Le Terreur » suivi de La Lutte à venir 1914. Traduit du russe par Viktoriya et Patrice Lajoye, Lingva; Lisieux, coll. Classiques populaires, 123 p.
1914 : La Lutte à venir, nouvelle d'anticipation
Première publication en France en 2015 dans un recueil de deux nouvelles : Le Brig Le Terreur 1913 suivi de La Lutte à venir 1914. Traduit du russe par Viktoriya et Patrice Lajoye, Lingva ; Lisieux, coll. Classiques populaires, 123 p.
1923 : Bêtes, Hommes et Dieux Zwierzęta, ludzie, bogowie lub Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną
Première publication en France en 19244 ; introduction par Lewis Stanton Palen, traduit de l'anglais par Robert Renard, Paris : Plon-Nourrit, 275 p. Dernière réédition en 20115 sous le titre Bêtes, Hommes et Dieux. À travers la Mongolie interdite 1920-1921, traduit par Robert Renard, Paris : Phébus-Libella, collection : Libretto no 56, 311 p.
1923 : L'Ombre du sombre Orient, les Russes et la Russie d'aujourd'hui et de toujours Cień ponurego Wschodu: za kulisami życia rosyjskiego
Première publication en France en 19266, traduction de Robert Renard, Paris : E. Flammarion, 249 p.
1923 : L'Homme et le mystère en Asie (avec Lewis Stanton Palen
Première publication en France en 19257, traduit de l'anglais par Robert Renard, Paris : Plon-Nourrit, 307 p. Dernière réédition en 1995 sous le titre Asie fantôme : à travers la Sibérie sauvage 1898-1905, trad. de Robert Renard, Paris : Phébus, collection : D'ailleurs », 267 p. Réédition en 2008, trad. par Robert Renard, Paris : Éd. de la Loupe, 205 p.
1924 : Derrière la muraille chinoise Za Chińskim Murem
Première publication en France en 1927, traduction de Robert Renard, Paris : E. Flammarion, 249 p.
1925 : De la Présidence à la Prison Od szczytu do otchłani: wspomnienia i szkice
Première publication en France en 19268, traduit de l'anglais par Robert Renard, avec une introduction de Lewis Stanton Palen, Paris : Plon et Nourrit, 312 p. Dernière réédition en 2009, trad. de Robert Renard ; Paris : Phébus, collection : « Libretto » no 299, 266 p. .
1926 : Sous le fouet du Simoun (Pod smaganiem samumu. Podróż po Afryce Północnej. Algierja i Tunisja
Première publication en France en 1928, traduction de Robert Renard, Paris : E. Flammarion, 295 p.
1926 : Le Maroc enflammé
Première en France en 1927, traduction de Robert Renard, Paris : E. Flammarion, 284 p.
1927 : Tchar Aziza, Roman Marocain
Première publication en France en 1929, traduit de l'anglais par Robert Renard, Paris : Ernest Flammarion, 247 p.
1928 : Esclaves du soleil Niewolnicy słońca: podróż przez zachodnią połać Afryki podzwrotnikowej w l. 1925/26 r.
Première publication en France en 1931, traduction de Robert Renard, Paris : A. Michel, collection : Maîtres de la littérature étrangère. Nouvelle série, 315 p.
1928 : Le Faucon du désert Sokół pustyni
Première publication en France en 1931, traduction de Caroline Bobrowska et Robert Renard, Paris : A. Michel, collection des maîtres de la littérature étrangère. Nouvelle série, 251 p.
1928 Le Premier Coup de minuit ięć minut po północy
Première publication en France en 1934, traduction de Robert Renard, Paris : A. Michel, collection : Maîtres de la littérature étrangère. Nouvelle série, 318 p.
1930 : Kett, journal d'un chimpanzé
Première publication en France en 1931, traduction de Paul Kleczkowski et Robert Renard, Paris : A. Michel, 284 p.
1931 : Lénine
Première publication en France en 1932, traduction de Paul Kleczkowski et Robert Renard, Paris : A. Michel, 446 p.
1931 : La Ménagerie Zwierzyniec
Première traduction en France en 1933, traduction du polonais par Caroline Bobrowska et Robert Renard, Paris : A. Michel, collection Les Belles Aventures, no 4, 254 p.
1932 : Le Fils de Bélira Syn Beliry
Première publication en France en 1934, traduction de Boguslaw Szybek et Robert Renard, Paris : A. Michel, Collection : Maîtres de la littérature étrangère. Nouvelle série, 317 p.
1932 : Les Navires égarés Okręty zbłąkane
Première publication en France en 1936 : Les Navires égarés suivi de Le Capitaine blanc (Biały kapitan, 1939); traduction de Caroline Bobrowska et Robert Renard, Paris : A. Michel, Collection : « Les Belles Aventures », 319 p.
1939 : Le Capitaine blanc Biały kapitan
Première publication en France en 1936 : Le Capitaine blanc précédé de Les Navires égarés ; traduction de Caroline Bobrowska et Robert Renard, Paris : A. Michel, Collection : Les Belles Aventures , 319 p.
Œuvre inédite en France
liste non exhaustive. Le titre original est suivi de sa traduction littérale française
1905 : Noc La Nuit
1923 : Najwyższy lot Le Plus Haut Vol.
1924 : Cud bogini Kwan-Non: z życia Japonji Le Miracle de la Déesse Kwan-Non : la vie du Japon
1925 : Po szerokim świecie De par le vaste monde
1927 : Huragan litt., Ouraga)
1927 : Wśród Czarnych Chez les noirs
1928 : : Karpaty i Podkarpacie Les Carpates et les Basses Carpates
1929 : Męczeńska włóczęga Męczeńska le clochard
1930 : Mali zwycięzcy: przygody dzieci w pustyni Szamo Vainqueurs du Mali : aventure pour enfants dans le désert Szamo
1930 : Nieznanym szlakiem Un sentier inconnu
1931 : Gasnące ognie: podróż po Palestynie, Syrji, Mezopotamji Feux incessants : voyage à travers la Palestine, la Syrie, la Mesopotamie
1932 : Przygody Jurka w Afryce Nouvelles aventures en Afrique
1932 : Słoń Birara L'Éléphant Birara
1932 : W krainie niedźwiedzi Au pays des ours
1932 : Narodziny Lalki La Naissance des poupées
1934 : Afryka, kraj i ludzie Afrique, terres et gens
1934 : Polesie litt., Polésie
1935 : Skarb Wysp Andamańskich Trésor des Îles Andaman
1935 : W polskiej dżungli Dans la jungle
1936 : Puszcze polskie Forêts polonaises
1936 : Miś i Chicha L'Ours en peluche et Chicha
1937 : Szanchaj Shanghai
1937 : Młode wino Vin nouveau
1937 : Postrach gór La Terreur des montagnes
1938 : Biesy Les Possédés
1938 : Zygzaki Zigzag
1939 : Cztery cuda Polski Quatre merveilles de la Pologne
1946 : Jasnooki łowca
1947 : Wacek i jego Pies
1992 : Cadyk ben Beroki Cadyk ben Beroki
Chmura nad Gangesem Un nuage au-dessus du Gange
W ludzkim pyle Dans la poussière humaine
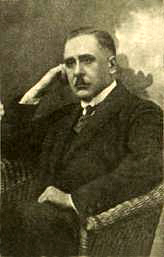 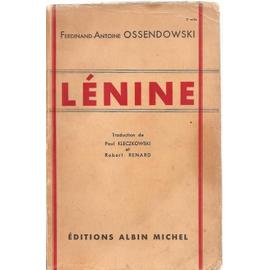   [img width=600]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Antoni_Ferdynand_Ossendowski_commemorative_plaque_(27,_Gr%C3%B3jecka_Street).JPG/220px-Antoni_Ferdynand_Ossendowski_commemorative_plaque_(27,_Gr%C3%B3jecka_Street).JPG[/img] 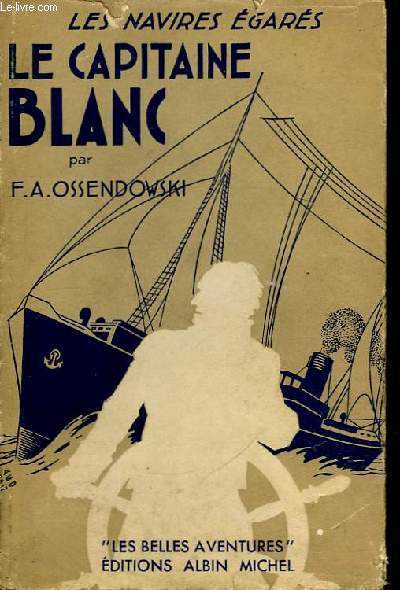 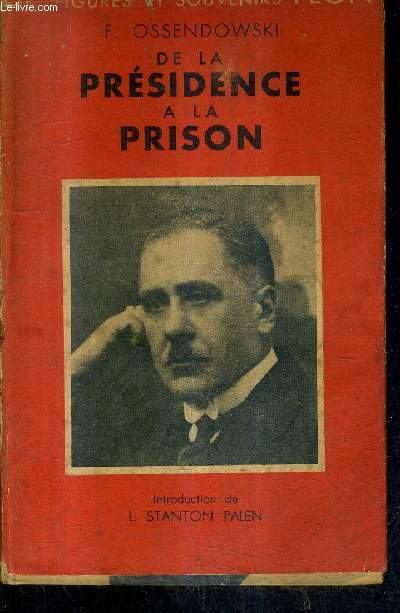 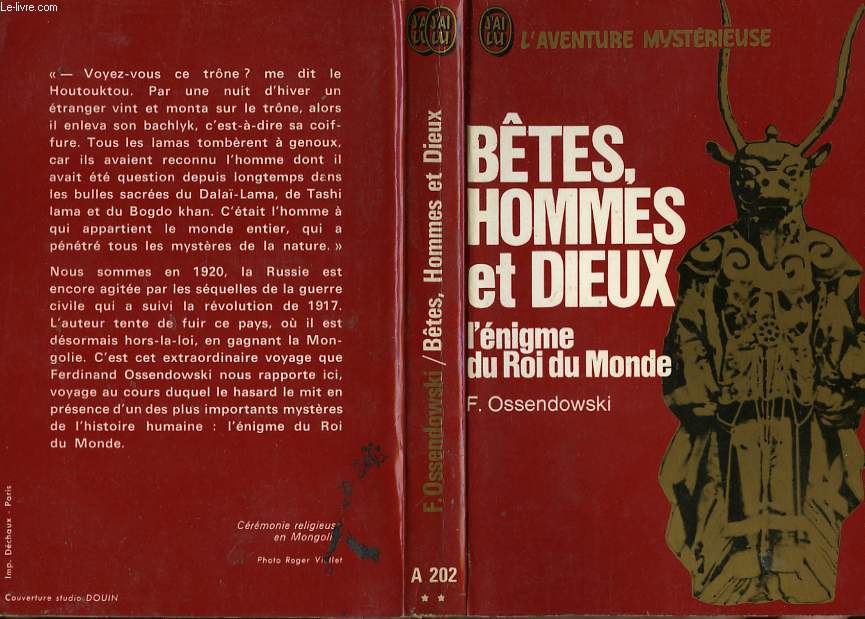 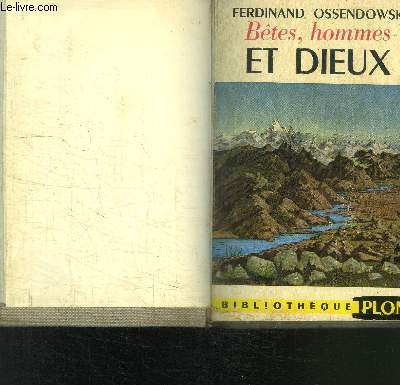 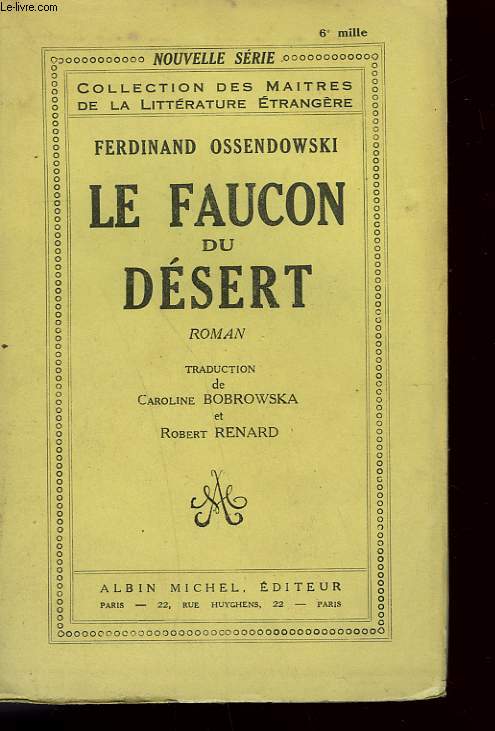  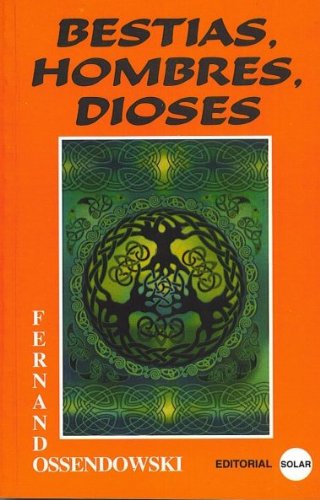
Posté le : 04/01/2016 19:24
Edité par Loriane sur 05-01-2016 17:44:14
|
|
|
|
|
27/12/15lescalendriers,A.Boëly,J.Mabillon,P.Ronsart,S.Essenine,Jourdel'an,M.Beckmann,Tuwin,J.Simon |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Posté le : 04/01/2016 19:10
|
|
|
|
|
Yves Gibeau |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 3 janvier 1916 naît Yves Gibeau
à Bouzy Marne et mort le 14 octobre 1994 à Roucy Aisne, est un écrivain français.
Sa vie
Fils de militaire, Yves Gibeau passe une partie de sa jeunesse sous l'uniforme de 1929 à 1939. D'abord enfant de troupe aux Andelys 1929-1934, puis à Tulle 1934-1939, il est mobilisé en 1939 et, en 1940, prisonnier de guerre. Il est rapatrié d'Allemagne en décembre 1941 et gagne ensuite sa vie à l'aide de petits boulots.
Il exerce quelque temps le métier de chansonnier, il est alors très proche de Boris Vian, devient à la Libération journaliste à Combat, puis rédacteur en chef du journal Constellation où il publie régulièrement des mots croisés sous le pseudonyme d'A. Sylvestre nom du héros principal de Le Grand Monôme.
Il conserve de son expérience sous les drapeaux des convictions résolument pacifistes et une haine tenace de la chose militaire. Dans son ouvrage le plus connu, Allons z'enfants..., paru en 1952, il revient sur son passé d'enfant de troupe en décrivant un milieu caractérisé par la bêtise et la brutalité.
Il réside à partir de 1981 dans un ancien presbytère à Roucy.
Fervent amateur de bicyclette et cruciverbiste, il tient pendant plusieurs années et jusqu'à sa mort la rubrique mots croisés du magazine L'Express.
Le prix Yves Gibeau, décerné par un jury composé de collégiens et lycéens volontaires, récompense une œuvre littéraire choisie parmi cinq ouvrages d'auteurs contemporains parus en édition de poche.
Décédé le 14 octobre 1994, Yves Gibeau a tenu à être enterré dans le cimetière de l'Ancien Craonne, sur le Chemin des Dames, village qui a été totalement détruit pendant la Première Guerre mondiale et inspiré la Chanson de Craonne .
Œuvres
Tombe de l'écrivain Yves Gibeau dans l'ancien cimetière de Craonne Aisne.
1946: Cinq ans de prison, éditions Malesherbes ouvrage collectif. Contributions de : Yves Gibeau, Maurice Blézot, Maurice Bruezière, Maurice Gabé, Jean Darlac. Illustrations de Gustave Gautier
1947 : Le Grand Monôme, Calmann-Lévy les premiers chapitres proposent des versions très réécrites des textes parus dans Cinq ans de prison
1950 : ... Et la fête continue, Calmann-Lévy
1952 : Allons z'enfants, Calmann-Lévy adaptation cinématographique : Allons z'enfants par Yves Boisset, film sorti en 1981
1953 : Les Gros Sous, Calmann-Lévy Prix du roman populiste 1953
1956 : La Ligne droite, Calmann-Lévy Grand Prix de Littérature sportive 1957, adapté au cinéma en 1961 par Jacques Gaillard
1961 : La guerre, c'est la guerre, Calmann-Lévy
1984 : Chemin des Dames, Albedo
1988 : Mourir idiot, Calmann-Lévy
2005 : Les Dingues, éditions des Équateurs
Bibliographie
Raymond Queneau, Anthologie des jeunes auteurs, JAR, 1957, p. 141 et suiv.
 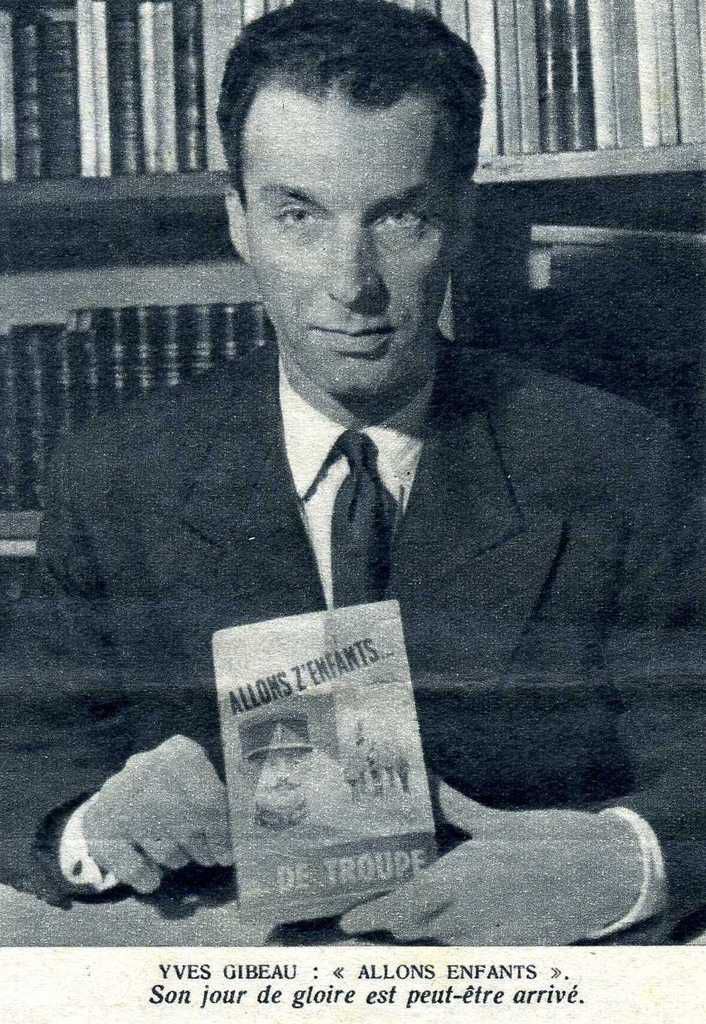      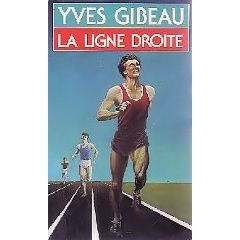  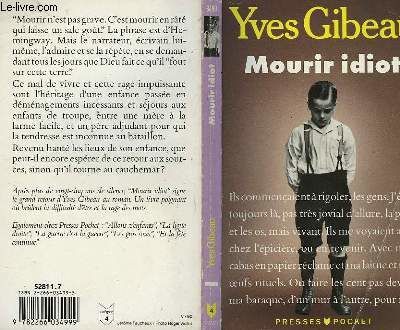  
Posté le : 04/01/2016 18:17
Edité par Loriane sur 05-01-2016 18:12:04
|
|
|
|
|
Pierre Drieu La Rochelle |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 3 janvier 1893 naît Pierre Drieu la Rochelle
dans le Xe arrondissement de Paris et mort par suicide dans la même ville le 15 mars 1945, écrivain français de roman, essai, journal. Ses Œuvres principales sont Le Feu follet en 1931, La Comédie de Charleroi en 1934, Gilles en 1939.
Ancien combattant de la Grande guerre, romancier, essayiste et journaliste, dandy et séducteur, européiste avant la lettre, socialisant puis fascisant, il fut de toutes les aventures littéraires et politiques de la première moitié du XXe siècle et s'engagea en faveur de la Collaboration durant l'Occupation de la France par l'Allemagne nazie. Directeur de La Nouvelle Revue française à la demande de Gaston Gallimard, en remplacement de Jean Paulhan qui devient son assistant et son ami, Drieu sauve la vie de plusieurs écrivains prisonniers parmi lesquels Jean-Paul Sartre, dont il aurait facilité la libération selon Gilles et Jean-Robert Ragache, et Jean Paulhan, qu'il aide à s'enfuir. Très séduisant, Drieu connaît auprès des femmes un mal-être qui se manifeste par une sorte d'impuissance à trouver du plaisir. Louis Aragon n'est pas insensible à son charme, malgré leurs opinons politiques qui deviendront opposées par la suite. Il crée même un personnage ayant les caractéristiques de Drieu : Aurélien, qui a la même ambiguïté et qui incarne d'une certaine manière le mal du siècle romantique. Il est, comme le dit Maurizio Serra dans Les Frères séparés, Drieu la Rochelle, Aragon, Malraux, face à l'Histoire, un égaré. Les œuvres de Drieu ont pour thèmes la décadence d'une certaine bourgeoisie, l'expérience de la séduction et l'engagement dans le siècle, tout en alternant l'illusion lyrique avec une lucidité désespérée, portée aux comportements suicidaires. Le Feu Follet 1931, La Comédie de Charleroi 1934 et surtout Gilles 1939 sont généralement considérés comme ses œuvres majeures.
En bref
De l'entre-deux-guerres français, des fastes et misères de sa bourgeoisie, aucun témoin plus intéressant que cet écrivain admirablement intelligent et doué, mais rongé, dès sa naissance, d'une sorte de maladie de vivre incurable qui lui fit entreprendre une série d'expériences promises invariablement à l'échec et le conduisit au suicide.
Né à Paris en 1893 de parents qui ne s'étaient jamais aimés et qui se déchirèrent sans avoir le courage de divorcer, Drieu a raconté dans Rêveuse bourgeoisie (1937), un de ses romans les plus accomplis, tout ce qu'il avait vu de ses yeux d'enfant, l'horreur du spectacle quotidien de l'adultère, de la jalousie, des disputes et des tracas d'argent – et sans doute faut-il voir dans cette traumatisante initiation l'origine de son désenchantement. Drieu, dans son Récit secret, fait remonter à l'âge de sept ans sa première tentative de suicide. Décollé pour ainsi dire de lui-même et cherchant à combler cette béance dans toutes les aventures que lui présentait son siècle, le voilà, sous les apparences viriles qu'il se voulait donner, en réalité la proie des moindres vents, illusions et duperies en cours (y compris les voitures, les comtesses, l'argent, les boîtes).
Il partit pour la guerre de 1914 – où il fut blessé deux fois – avec l'élan du faible qui cherche à se prouver qu'il existe, mais découvrit bientôt l'immense duperie de ce massacre. « Quelle ressemblance entre mes rêves d'enfance où j'étais un chef, un homme libre qui commande et qui ne risque son sang que dans une grande action, et cette réalité de mon état civil qui m'appelait, veau marqué entre dix millions de veaux et de bœufs ? » Dans cette phrase, tirée de La Comédie de Charleroi (1934), tenue en général pour son chef-d'œuvre, on trouve tout Drieu : un homme à la fois trop lucide pour ne pas découvrir ses erreurs et trop inconsistant, ou trop blessé, pour ne pas éprouver le besoin de se travestir en chef, en héros.
Outre la littérature, Drieu s'est donné à deux passions : les femmes, la politique. Marié deux fois, deux fois démarié, nouant et dénouant d'incessantes liaisons, « homme couvert de femmes » selon un de ses titres, il savait à quoi s'en tenir sur sa réputation de don Juan, et il est probable qu'elle ne lui a servi qu'à se désoler davantage sur sa fondamentale impuissance à s'attacher un être, quel qu'il soit. « Pas d'argent, pas d'amis, pas de femme, pas d'enfants, pas de dieu, pas de métier », notait-il dans Le Jeune Européen (1927), un de ses textes où il est le plus difficile de faire la part de l'autobiographie et de l'invention. Peu de livres comme ceux de Drieu reflètent aussi étroitement la destinée de leur auteur : encore doit-on se souvenir que, suivant la pente où l'entraînait son masochisme, il ne prêtait à ses héros que les traits les moins fameux, les plus déplaisants de lui-même.
Cette remarque vaut particulièrement pour Gilles (1939), le grand roman autobiographique où Drieu a raconté, avec le minimum de transposition, plusieurs de ses aventures féminines. Gilles, amateur de prostituées comme tous les hommes marqués précocement par une dissociation entre l'amour et la sexualité, fuit les femmes de son milieu, à moins qu'elles ne satisfassent aux deux conditions suivantes : qu'elles aient de l'argent, beaucoup d'argent, et qu'elles appartiennent à un autre homme. Tant il est vrai que la femme riche mariée est la maîtresse idéale pour un amant faible, doutant de soi et ennemi secret du sexe antagoniste. Certes, il faut faire la part, dans le programme de Gilles, de la provocation cynique. Mais il ne s'agit pas seulement d'un programme : Gilles revendique comme un choix le destin que sa nature lui impose. Hochet aux mains des femmes de luxe, il ne se délecte que plus amèrement de sa radicale insuffisance.
Sa vie
Son père, avocat, est issu d'une vieille famille normande, sa mère Eugénie-Marie Lefèvre est la fille d'un architecte. Installée dans la Cité Malesherbes, la famille est déchirée par les problèmes conjugaux et les questions financières. Il est le neveu de l'artiste et poète Maurice Dumont.
Le père est retourné chez sa vieille maîtresse après avoir dilapidé la dot de sa femme. Le père de madame est le seul refuge affectif de l'enfant.
Nourri par la lecture de Stendhal et de Barrès notamment, il a très tôt le goût de l'écriture. Il entre à l'École libre des sciences politiques et se destine à une carrière dans la diplomatie. Contre toute attente, il échoue à l'examen de sortie et songe à se suicider.
Le garçon a beaucoup de mal à comprendre les dreyfusards et antidreyfusards, et l'antisémitisme virulent de sa grand-mère Lefèvre le fait douter. Il a douze ans lorsqu'éclate le scandale des fiches du général André : le conservatisme de sa famille s'exprime alors très ouvertement.
Le combattant de la Grande guerre
Il est mobilisé dès le début de la Première Guerre mondiale et vit son expérience au front sur un mode nietzschéen il a emporté le Zarathoustra avec lui. Blessé à trois reprises, il s'inspirera de cette expérience pour ses premiers textes comme Fond de cantine et, plus tard, La Comédie de Charleroi, recueil de nouvelles publié en 1934.
Il épouse en 1917 la sœur d'un condisciple d'origine juive, Colette Jéramec 1896-1970, dont il divorcera en 1925. Dans ses carnets d’étudiant, il avait écrit : Deux êtres que je passerai ma vie à découvrir : la femme et le Juif.
D'abord attiré par le pacifisme, il se mêle aux surréalistes dans les années 1920 lorsque sa femme Colette lui présente Louis Aragon avec lequel il se brouillera en 1925 pour une femme. Il inspirera plus tard à Aragon le personnage d'Aurélien. Son admiration pour Aragon le tient à l'écart de toute tentation d'adhésion à l'Action française. Selon Dominique Desanti, ce n'est que beaucoup plus tard que Drieu sera tenté par les théories nationalistes.
L'ami des dadaïstes et des surréalistes
L'épisode de son adhésion au mouvement Dada en compagnie de Louis Aragon, compagnon de route, avec qui il est alors ami, est très mal connu du grand public7. Il assiste aux réunions chaque fois que ses conquêtes féminines lui en laissent l'occasion. En juin 1921, Maurice Martin du Gard brosse un portrait de Drieu qui sait faire une grâce de sa muflerie, dont la tendresse sérieuse est gênante, et qui a une allure de somnambule extralucide. Martin du Gard est fasciné par ce garçon qu'il emmène dans les bars et les boîtes de nuit. Mais Drieu prouve qu'il n'est pas le dilettante que l'on croit.
Lors du procès de Maurice Barrès, il est présent le vendredi 13 mai 1921 dans la salle des Sociétés savantes louée par les Dadas rue Serpente. Une sorte de procès de Barrès est organisé avec André Breton déguisé en président du tribunal, tandis qu'Aragon joue les avocats et Georges Ribemont-Dessaignes le procureur. Très vite, la pagaille éclate dans la salle où Tristan Tzara chante en roumain, le futuriste Giuseppe Ungaretti proteste en vain. Lorsque André Breton lui demande s'il a été voir Barrès, Drieu répond que oui ; pourtant, il refuse la condamnation demandée par Breton. Après les premières réponses évasives de Drieu, un jeu de questions-réponses s'instaure entre Drieu et Breton. Celui qui régnait déjà sur les dadas surréalistes lui dédicace son livre Clair de terre avec cette phrase : À Pierre Drieu la Rochelle. Mais où est Pierre Drieu la Rochelle ?.
Drieu assiste aussi aux réunions du groupe Littérature, une revue à laquelle le jeune auteur collabore. Il est encore au théâtre de l'Œuvre lorsque Breton apparaît sur scène en homme-sandwich avec le Manifeste DaDa et des vers de Picabia. Toutes ces pantalonnades à but littéraire laissent Drieu amer. Il écrit dans son journal que le statut d'écrivain qu'on lui prête est une imposture puisqu'il n'a publié aucun livre.
Le jeune Européen
Pour se connaître et se décrire, Drieu confie à Mauriac son projet d'écrire un livre intitulé Histoire de mon corps. Le projet n'aboutira pas, mais l'aspect autobiographique se retrouvera dans État civil en 1921. Il se fait connaître, en 1922, par un essai remarqué sur l'affaiblissement de la France après la Grande guerre, Mesure de la France. Sans se départir complètement d'un nationalisme classique, il y apparaît comme occidentaliste et philosémite : Je te vois tirant et mourant derrière le tas de briques ; jeune Juif, comme tu donnes bien ton sang à notre patrie.
Il publie en 1925 son premier roman, L'Homme couvert de femmes, qui comporte une forte part d'autobiographie. Sur le plan politique, il esquisse l'année suivante dans La Revue hebdomadaire le programme pour une Jeune Droite qui se veut au-dessus des partis, républicaine et démocratique, Car les hommes ne doivent pas compter sur un homme pour se tirer d'affaire, … il faut que l'élite en France se sauve d'elle-même. Elle se veut aussi anti-militariste, déiste mais anticléricale, unie, mais ennemie de l'intolérance. Ce programme et le mot droite ne choquent pas son ami André Malraux.
Malraux et Drieu se retrouvent souvent chez leur ami commun Daniel Halévy, auquel Drieu avait consacré en 1923 un éloge de son livre sur Vauban. Malraux a déjà publié dans la NRF La Tentation de l'Occident qui semble répondre au jeune européen et à l'ensemble des textes publiés sous le titre Genève ou Moscou, que Drieu publie en 1927 dans les Cahiers verts Grasset dirigés depuis 1921 par Daniel Halévy. En gros, Malraux et Drieu ont une profonde communauté de dessein, même si les divergences politiques restent sous-jacentes. Ce n'est qu'à partir de 1934 que Drieu saura que l'esprit de Genève est perdu. Il croira alors que le socialisme européen ne peut arriver que par le fascisme. Cependant, il mettra un certain temps à abandonner l'idée de regrouper les jeunes gauches qu'il a conçue avec Gaston Bergery, mais qui ne débouche sur rien de concret.
Malgré les avances des membres de l'Action française qui invitent Drieu à se joindre à eux, le jeune écrivain reste en retrait, d'autant qu'Aragon, avec lequel il va bientôt se brouiller pour une question de femme, le prévient : Tu sais que je tiens les gens de l'action française pour des crapules.
Drieu est dans une position impossible, contradictoire, entre l'Action française dont les idées l'attirent d'une certaine manière, le socialisme de Léon Blum, et le conservatisme moderniste de Joseph Caillaux.
En 1924, Drieu est encore très lié avec les surréalistes. À Guéthary où il a loué une maison, séjournent ensemble, ou successivement : Philippe Soupault, Paul Éluard, Aragon, Jacques Rigaut, André Breton, Roger Vitrac, René Crevel, Robert Desnos, Max Ernst. Bien que Drieu ne partage pas leurs opinions, il accueille tout le monde.
L'homme couvert de femmes
Dès 1925, Drieu mène une vie mondaine sans répit. Il fréquente les salons avec sa maîtresse, la comtesse Isabel Datonote 4 et il multiplie les conquêtes féminines. Il assiste d'abord aux dîners NRF auxquels il se rend avec sa maîtresse. Mais en février 1929, il rencontre chez elle la femme de lettres argentine Victoria Ocampo, avec laquelle il a une courte liaison. Ils entretiendront par la suite une longue correspondance en dépit de leurs divergences idéologiques.
Marié deux fois, il divorce aussi deux fois : son mariage d'intérêt contracté en 1917 avec Colette Jéramec, qu'il n'appréciait déjà plus, prend fin en 1925 il la fera néanmoins libérer du camp de Drancy en 1943 ainsi que le fils et le frère de celle-ci, et sa seconde union en 1927 avec la fille d'un banquier Polonais ruiné, Olesia Sienkiewicz 1904-2002, se solde par une séparation dès 1929 et un second divorce en 1933. Au milieu des années 1930, il deviendra l'amant de Christiane Renault, l'épouse de l'industriel Louis Renault, et évoquera cette liaison de manière romancée dans Béloukia. Mais cette soif de séduction cache un problème sexuel et psychologique dont on a peu parlé18, et sur lequel Pierre Assouline donne quelques pistes de réflexion à la lecture des Notes pour un roman sur la sexualité publié chez Gallimard L’homme que l’on disait couvert de femmes était hanté par l’impuissance, le contact charnel, la souillure féminine, les dangers des débordements sensuels, les caresses, la fellation et une homosexualité difficilement refoulée. Agité de tourments du même ordre, Cesare Pavese se donna la mort, lui aussi, mais non sans laisser, lui, un chef d’œuvre intitulé Le Métier de vivre. Parmi ses conquêtes se trouve Suzanne Tezenas qui eut une liaison avec Nicolas de Staël.
Entre 1929 et 1931, toujours en compagnie d'une de ses maîtresses, Drieu assiste aux dîners de la NRF tantôt chez Paulhan, tantôt chez Arland, et il se retrouve avec le gratin du monde littéraire, notamment André Malraux, Jean Guéhenno, François Mauriac, Georges Bernanos et bien d'autres dont les idées ne vont pas développer le fascisme de Drieu, qui n'est d'ailleurs toujours pas très évident.
L'intellectuel qui se cherche
Avant le tournant de 1934, il cultive encore des idées républicaines et progressistes. En 1931, il se moque vigoureusement des théories racistes. La même année, il expose une appréciation positive d'André Gide, plus discrètement, plus profondément, plus raisonnablement français que nos francophiles de France, un philosophe au sens socratique du mot, ou un honnête homme. En juin 1933, Bernard Lecache le salue parmi les personnalités qui, au côté de la LICA, mènent le combat contre l’antisémitisme et le fascisme.
Après un voyage en Argentine, le 6 janvier 1934, où il est accueilli chaleureusement par Jorge Luis Borges, Drieu peut mesurer l'importance de sa réputation littéraire, notamment celle du Feu follet. Tandis qu'en France la critique est mesurée, à Buenos Aires les articles abondent. Avec son ami Emmanuel Berl et Gaston Bergery, il a l'idée d'un parti qui unirait les jeunes gauches, plus toniques que les socialistes, moins inféodés que les communistes. Drieu mettra longtemps à abandonner tous ces groupes. Il participe à des rassemblements du Mouvement pour l'antifascisme, rassemblement dit Amsterdam-Pleyel auquel assistent également des membres de l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires dont Aragon et Malraux sont des membres assidus. À cette époque les hommes de sa génération cherchaient de droite et de gauche un apaisement à leur mauvaise conscience. Bernanos venait de prendre position ouvertement en faveur de l'Espagne républicainenote 5. Ceux du groupe de Drieu et de Bertrand de Jouvenel cherchent à construire une mythologie complexe et irréaliste noblesse, chevalerie, amour courtois…. Il développera plus tard 1941 ces idées dans Notes pour comprendre le siècle, les conversations avec Emmanuel Berl, Bertrand de Jouvenel, Gaston Bergery, Emmanuel d'Astier de La Vigerie.
En 1933, ses amis, Malraux surtout, tentent d'intéresser Drieu au combat contre Hitler qui vient de prendre le pouvoir. L'incendie du Reichstag alimente la légende des terroristes communistes alors que ce sont les SA sections d'assaut qui ont propagé l'incendie allumé par van der Lubbe. Drieu, déjà fasciné par les démonstrations de force hitlériennes, ne s'intéresse pas à ces manipulations de l'opinion.
Le socialiste fasciste
Dans les semaines qui suivent les manifestations du 6 février 1934, il va à Berlin avec son ami Bertrand de Jouvenel, lequel est très engagé dans une amitié franco-allemande, et il souhaite une renaissance nationale et sociale. Drieu est invité par le cercle du Sohlberg ; l'homme qui l'accueille, Otto Abetz, admire ses écrits et lui demande une conférence. À la suite de son voyage à Berlin, Drieu cherche à faire admettre le fascisme à ses amis de la gauche, mais il est violemment rejeté. Une succession de scandales ont contribué à rendre l'atmosphère étouffante : l'affaire Marthe Hanau la banquière des années folles 1928, suivie de l'affaire Stavisky. Les manifestations se sont succédé jusqu'au 6 février 1934. Les jeunes rêveurs Gilles et Aurélien qui faisaient partie de la personnalité de Drieu disparaissent. Drieu se tourne vers les mouvements d'anciens combattants et il se déclare à la fois socialiste et fasciste, voyant dans ce syncrétisme idéologique une solution à ses propres contradictions et un remède à ce qu'il regarde comme la décadence occidentale.
En octobre 1934, il publie l'essai Socialisme fasciste, et se place dans la lignée du premier socialisme français, celui de Saint-Simon, Proudhon et Charles Fourier. Ces textes sont échelonnés de 1933 à 1934. Tout cela le conduit à adhérer en 1936 au Parti populaire français, fondé par Jacques Doriot, et à devenir, jusqu'à sa rupture avec le PPF au début de 1939, éditorialiste de la publication du mouvement, L'Émancipation nationale. Parallèlement, il écrit ses deux romans les plus importants, Rêveuse bourgeoisie et Gilles. Il est membre du Comité de direction de l'Association du Foyer de l’Abbaye de Royaumont. Mais au moment même où les totalitarismes s'affermissent, Drieu imagine que peu à peu, l'État totalitaire se disloque32. Il ne voit plus aucune différence entre mussolinisme, hitlérisme, et stalinisme. Selon Dominique Desanti :
« tout le Drieu de la défaite et de l'Occupation se trouve inclus dans Socialisme fasciste.
Dès 1934, Drieu sait qu'il n'y a pas de salut pour ceux de son espèce :
Nous autres, les conciliateurs, les faiseurs de nœuds, il y a des balles pour nous aussi, et tant d'injures que c'en est une plénitude.
Julien Benda, auteur de La Trahison des clercs, applaudit la noblesse d'âme de Drieu, contredisant ainsi les idées qu'il expose dans son livre.
Le directeur de la NRF
De 1925 à juin 1940, Jean Paulhan dirige la NRF, principale revue littéraire d'Europe, signant un certain nombre d'articles sous le pseudonyme de Jean Guérin. Mais en 1940, les éditons Gallimard sont mises sous scellés, des livres à l'index : il y a trop de juifs, trop de communistes, trop de francs-maçons selon les autorités allemandes. Otto Abetz, ambassadeur allemand ami de Pierre Drieu La Rochelle, propose à Jean Paulhan de continuer à diriger la revue, ce que Paulhan refuse, vu le nombre d'écrivains écartés. Cependant il accepte de collaborer avec Drieu qui sera directeur à sa place. Drieu voit dans la NRF un pis aller. Il prend la direction de la revue avec un contrat confortable et l'assurance de l'appui de Paulhan. Le dandy aux idées nationales socialistes » dresse la liste des écrivains prisonniers, dont Sartre fait partie, et obtient leur libération. Paul Léautaud découvre avec effarement que Paulhan éprouve une vive sympathie pour Drieu qu'il décrit à Gaston Gallimard comme un garçon plutôt timide, très droit, très franc. Il était déjà antisémite avant la guerre. Il n'y aura plus aucun juif dans la revue dit Paulhan. Paulhan se dit anti-pacifiste, anti-démocrate, anti-républicain et il n'a aucun goût pour le libéralisme. Curieusement en ces premiers mois, Paulhan futur fondateur de Lettres Françaises revue clandestine, avec Aragon, semble plus proche de Drieu que des communistes. Le goût du paradoxe chez Paulhan va loin, Drieu le trouve surréaliste.
En attendant, les deux hommes doivent se battre pour former un comité d'écrivains : Louis Aragon refuse de participer, Paul Claudel demande que soit d'abord évincé ce putois de Montherlant… Et pour couronner le tout, Paulhan est dénoncé à la Gestapo : il devra s'enfuir avec l'aide de Drieu. Toutefois, sa réflexion sur le fascisme de Drieu est assez nuancée. Il lui écrit :
J'en conclus que s'il se révélait, du jour au lendemain, une France, - jusqu'ici secrète par force- mais spartiate, mais militaire, mais disciplinée, vous cesseriez aussitôt d'être collaborationniste. Puisque vous ne le restez que faute de cette France-là. Si cette France se prépare, à vrai dire, je n'en sais trop rien. Amicalement
L'égaré désabusé
À partir de 1943, Drieu la Rochelle, revenu de ses illusions qu'il expose d'abord dans L'Homme à cheval - une fable sur les rapports entre l'artiste et le pouvoir - puis dans Les Chiens de paille - où il se représente sous les traits d'un ancien anarchiste nommé Constant -, tourne ses préoccupations vers l'histoire des religions, en particulier les spiritualités orientales. Dans un ultime geste de provocation, il adhère pourtant de nouveau au PPF, tout en confiant à son journal secret son admiration pour le stalinisme qu'il compare au catholicisme. Dans ce même journal, il n'évoque pas certains aspects de sa vie privée comme le fait qu'il soit devenu, à la demande de Josette Clotis, la compagne d'André Malraux, le parrain d'un de leurs deux enfants.
À la Libération, il refuse l'exil ainsi que les cachettes que certains de ses amis, parmi lesquels André Malraux, lui proposent. Il tente de se suicider le 11 août 1944 avec du luminal, puis fait une seconde tentative quatre jours plus tard en s'ouvrant les veines. Après deux suicides manqués, il se donne la mort rue Saint-Ferdinand à Paris le 15 mars 1945 en avalant du gardénal qui est à l'instar du luminal une forme de phénobarbital. Lucien Combelle a été l'un des derniers témoins de son suicide. Drieu est enterré dans le vieux cimetière de Neuilly-sur-Seine.
Drieu et la politique
Raté sexuel, Drieu, s'en étonnera-t-on ? a cherché dans la politique l'ordinaire consolation des mous. Incapable de s'attacher virilement une femme, il se donna fémininement à un parti, le parti qui lui paraissait le plus fort, le plus mâle. C'est après le 6 février 1934 qu'il passa définitivement au fascisme, après avoir hésité longtemps entre le fascisme et le communisme. Le fascisme, il le pratiqua comme un sport, comme un alcool, comme une sorte de remède magique à ses propres contradictions. Il ne souhaita le triomphe de l'homme totalitaire que parce qu'il se sentait lui-même mortellement divisé. Après la défaite de 1940, il se rallia, comme on sait, à la collaboration franco-allemande, mais ce qu'on sait moins, c'est la déception, le dégoût que lui inspirèrent bientôt Hitler, la politique pétainiste, son propre rôle. Directeur de la Nouvelle Revue française sous l'Occupation, il usa de son crédit pour sauver de la mort plusieurs résistants de ses amis. Trop lucide pour ne pas voir la catastrophe vers laquelle il courait, mais dédaignant par élégance de virer de bord quand il eût été encore temps, épris désormais de son seul désastre, il s'empoisonna, au lendemain de la Libération, moins pour échapper à la honte d'un procès que parce que, depuis toujours, le suicide était la seule manière de coïncider avec lui-même.
Décevant et fascinant, fascinant malgré lui et décevant par sa faute, ployant comme une tige trop frêle sous l'abondance même de ses dons, Drieu laisse des livres qui ne sont qu'à moitié réussis. Son chef-d'œuvre, avec La Comédie de Charleroi, est sans doute L'Intermède romain, longue nouvelle (publiée à titre posthume dans les Histoires déplaisantes, 1964) qui tient des mémoires, de l'essai et de la fiction, et place Drieu dans la lignée de Constant, de Baudelaire, des anxieux sauvés par l'analyse, beaucoup plus que dans celle des « chefs », Nietzsche ou Malraux. Indolent, relâché, comme dédaigneux de se parfaire, le style n'en est pas moins d'un grand écrivain. C'est dans cette nouvelle, récit d'une liaison où il se donne, bien entendu, le vilain rôle, qu'il se définit, pour marquer sa froideur, son dandysme en amour, non pas « cœur de pierre » mais « cœur de lièvre ». Un beau lièvre, qui aura vécu et qui sera mort pour rien, sinon pour la volupté de se surprendre en mal, de s'humilier. On réédite ses livres et on continue de publier ses ouvrages posthumes : nul doute que le personnage et son œuvre n'attirent sans cesse de nouveaux fidèles, séduits par le mystère d'un homme qui s'est si mal aimé. Dominique Fernandez
Postérité
Ses œuvres ont été éditées dans la bibliothèque de la Pléiade en avril 2012. Malgré sa réputation sulfureuse qui alimentait les clichés faciles et qui a suscité dans la presse des articles outrés Un collabo au Panthéon, titre un article de Marianne, tandis que d'autres sont plus nuancés, Philippe Sollers se demande s'il faut craindre une réhabilitation de Drieu la Rochelle avec cette édition : ... Faut-il craindre, avec cette Pléiade, on ne sait quelle réhabilitation qui favoriserait le fascisme en France ? Des imbéciles automatiques ne manqueront pas de le dire, mais, à s’en tenir là, on est dans Pavlov, et on sait bien que le silence et la censure ne font qu’aggraver les fantasmes.
Œuvres
Pierre Drieu la Rochelle
Sauf précision contraire, les œuvres de Drieu la Rochelle ont été publiées par Gallimard, à Paris
Interrogation, 1917. recueil de 17 poèmes ; réédition à La Finestra éditrice, Lavis.
Fond de cantine, 1920. recueil de 25 poèmes
État civil, 1921. récit autobiographique
La Valise vide 1921; nouvelle, contenue dans Plainte contre inconnu
Mesure de la France, préface de Daniel Halevy ; Grasset, coll. Les Cahiers verts, 1922. essai
Plainte contre inconnu, 1924. recueil de 4 nouvelles
L'Homme couvert de femmes, 1925. roman
La Suite dans les idées, 1927. essai
Le Jeune Européen, 1927. essai
Genève ou Moscou, 1928. essai
Blèche, 1928. roman
Une femme à sa fenêtre, 1929. roman
L'Europe contre les patries 1931. essa ; réédition à La Finestra éditrice, Lavis
Le Feu follet 1931, réédité en 1964 avec un court texte inédit retrouvé après sa mort : Adieu à Gonzague. roman
Drôle de voyage, 1933. roman
Journal d'un homme trompé 1934. recueil de 12 nouvelles
La Comédie de Charleroi 1934. recueil de 6 nouvelles
Socialisme fasciste, 1934. essai
Béloukia, 1936. roman
Doriot ou la Vie d'un ouvrier français, Éditions du PPF, Saint-Denis, 1936. essai
Avec Doriot, 1937. essai
Rêveuse bourgeoisie, 1937. roman
Gilles, 1939 roman, censuré, la version intégrale paraît en 1942.
Ne plus attendre, Grasset, Paris, 1941. essai
Notes pour comprendre le siècle, 1941. essai
L'Homme à cheval, 1943. roman
Chroniques politiques 1934-1943, 1943. essai, chroniques
Charlotte Corday. Le chef., 1944 théâtre
Les Chiens de paille, 1944 roman, pilonné, reparaît en 1964.
Réédition sous coffret de Une femme à sa fenêtre, Le Feu Follet, suivi de Adieu à Gonzague et de la Valise vide , et Drôle de voyage suivi de La Voix, édité par le Grand Livre du mois 1999
Publications posthumes
Mémoires de Dirk Raspe, 1944
roman inachevé, publié en 1966
Le Français d'Europe, Balzac, 1944
essai, pilonné, réimprimé en 1994
Récit secret, suivi de Journal 1944-1945, et d'Exorde, 1951.
Histoires déplaisantes, 1963
recueil de cinq nouvelles
Sur les écrivains, 1964
essais critiques réunis, préfacés et annotés par Frédéric Grover
Journal. 1939-1945. Publié en 1992 chez Gallimard.
Texte fourni par son frère Jean, mort en 1986
Révolution nationale, Éditions de l'Homme libre, 2004.
articles parus dans Révolution nationale, faisant suite à ceux publiés dans Le Français d'Europe
Notes pour un roman sur la sexualité, suivi de Parc Monceau, Gallimard, 2008.
Textes Politiques 1919-1945, Éditions Krisis, 2009
présentation par Julien Hervier, édition établie et annotée par Jean-Baptiste Bruneau
Lettres d'un amour défunt : Correspondance 1929-1945, Bartillat, 2009,
correspondance avec Victoria Ocampo. Prix Sévigné 201045
Romans, récits, nouvelles, édité par Jean-François Louette, Hélène Baty-Delalande, Julien Hervier et Nathalie Piégay-Gros, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 2012, 1936 pages
Le Jeune Européen et autres textes de jeunesse 1917-1927, Bartillat, 2016,
À paraître le 7 janvier 2016
ouvrages biographiques
Pierre Andreu, Drieu, témoin et visionnaire, Grasset, coll. Les Cahiers verts, Paris, 1952.
Pierre Andreu et Frédéric Grover, Drieu la Rochelle, Hachette, Paris, 1979 ; réédition à la Table ronde, Paris, 1989.
René Ballet, Deux hommes dans le tournant : Roger Vailland et Drieu La Rochelle, Les Cahiers Roger Vailland, 1994.
Marie Balvet, Itinéraire d'un intellectuel vers le fascisme : Drieu La Rochelle, PUF, coll. Perspectives critiques, Paris, 1984.
Jean-Baptiste Bruneau, Le cas Drieu. Drieu la Rochelle entre écriture et engagements. Débats, représentations et interprétations de 1917 à nos jours, Paris, Eurédit, 2011
Cahier de l'Herne spécial Drieu la Rochelle, collectif, Éditions de l'Herne, Paris, 1982.
Dominique Desanti, Drieu La Rochelle ou le séducteur mystifié, Paris, Groupe Flammarion, 1978, 476 p. réédition 1992 sous le titre Drieu La Rochelle, du dandy au nazi.
Pierre du Bois de Dunilac, Drieu La Rochelle. Une vie, Cahiers d'histoire contemporaine, Lausanne, 1978.
Pierre du Bois de Dunilac, « Des causes et de la nature de l'engagement politique de l'écrivain Pierre Drieu La Rochelle », Cadmos cahiers trimestriels de l'Institut universitaire d'études européennes de Genève et du Centre européen de la culture, 1978, p. 39-63.
Dominique Fernandez, Ramon : mon père ce collabo, Paris, Le Livre de poche, 2010, 768
Bernard Frank, La Panoplie littéraire, Julliard, 1958 ; Flammarion, 1980.
Frédéric Grover, Drieu la Rochelle, Gallimard, coll. « Idées », Paris, 1979.
(en) Frédéric J. Grover, Drieu la Rochelle and the fiction of testimony, Berkeley, University of California Press, 1958, 275
Jean Bastier, Pierre Drieu la Rochelle, Soldat de la Grande Guerre 1914-1918, Albatros, 1989.
Arnaud Guyot-Jeannin, Drieu la Rochelle, antimoderne et européen, éd. Remi Perrin, Paris, 1999.
Julien Hervier, Deux individus contre l'histoire : Drieu la Rochelle et Ernst Jünger, Klincksieck, Paris, 1990.
Solange Lebovici, Le Sang et l'Encre : Pierre Drieu la Rochelle, une psychobiographie, Rodopi, Amsterdam, 1994.
Jacques Lecarme, Drieu la Rochelle ou le bal des maudits, PUF, "Perspectives critiques", 2001.
Bernard-Henri Lévy, Les Aventures de la liberté, Grasset, 1991 (deuxième partie : Le temps du mépris.
Jean-Louis Loubet Del Bayle, L'illusion politique au XXe siècle. Des écrivains témoins de leur temps, Economica, Paris, 1999.
Victoria Ocampo, Drieu, préface de Julien Hervier, Paris, Bartillat, Paris, 2
Reck (rima D.), Drieu La Rochelle and the picture gallery novel. French modernism in the interwar years ; Baton rouge, Louisiana State U.P., 1990.
Jacques Cantier, Pierre Drieu la Rochelle, éditions Perrin, collection Biographies, 2011, 315 pages.
Dictionnaires de référence
Dictionnaire des littératures de langues française, vol. 3, t. I, Paris, Bordas, 1984
Dictionnaire des auteurs, vol. 4, t. II, Paris, Laffont-Bompiani, 1000
Dictionnaire des œuvres, vol. 6, t. II, Paris, Laffont-Bompiani, 1990
Dictionnaire des œuvres, vol. 6, t. II, Paris, Laffont-Bompiani,1990
Dictionnaire des œuvres, vol. 6, t. I, Paris, Laffont-Bompiani, 1990
Dictionnaire des œuvres, vol. 6, t. II, Paris, Laffont-Bompiani, 1990
Dictionnaire des œuvres, vol. 6, t. III, Paris, Laffont-Bompiani, 1990
Dictionnaire des œuvres, vol. 6, t. V, Paris, Laffont-Bompiani, 1990
Adaptations cinématographiques
Le Feu follet de Louis Malle, 1963.
Une femme à sa fenêtre de Pierre Granier-Deferre, 1976.
La Voix de Pierre Granier-Deferre, 1992.
Oslo, 31 août de Joachim Trier, 2012 inspiré du Feu follet
      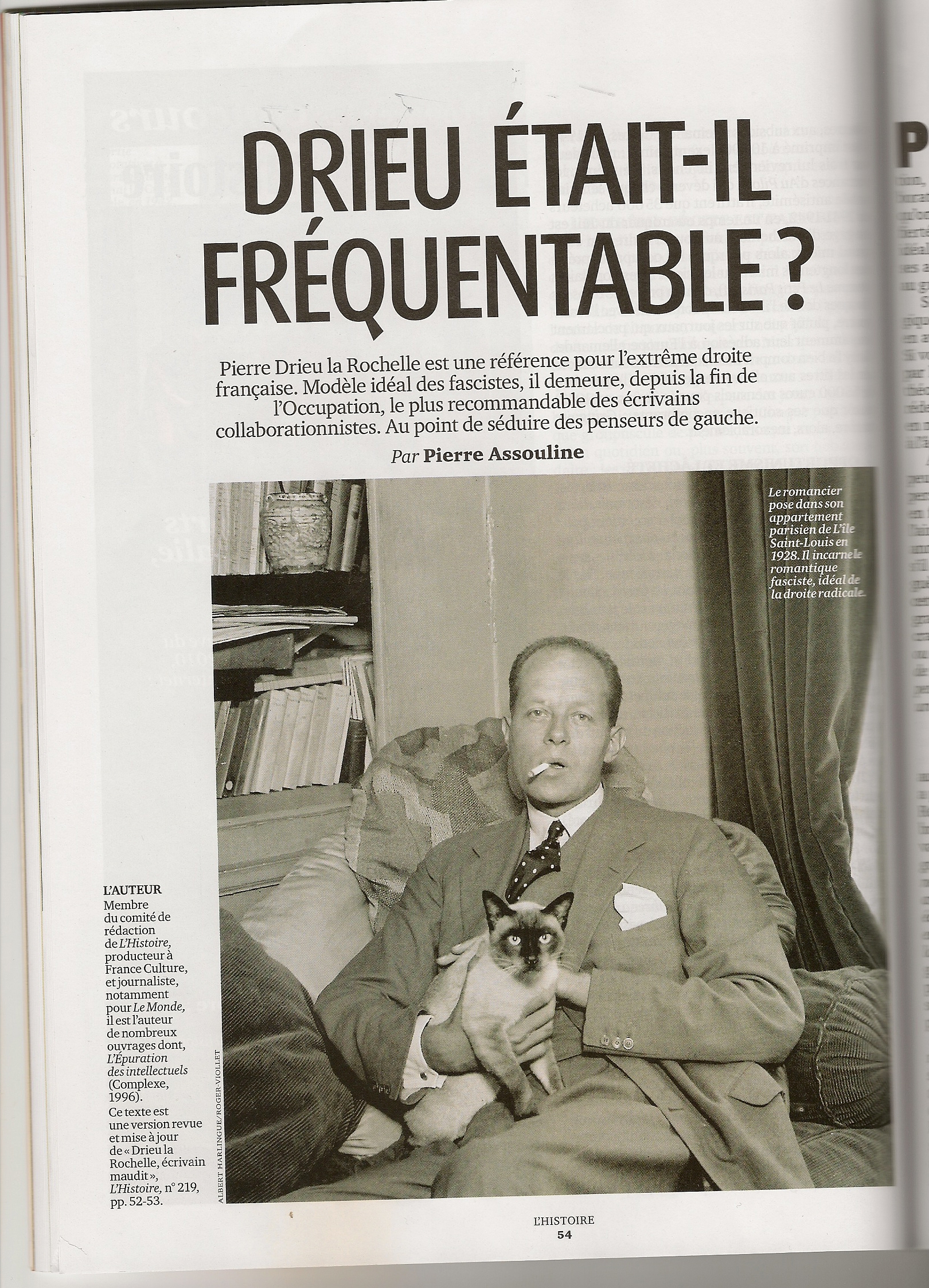 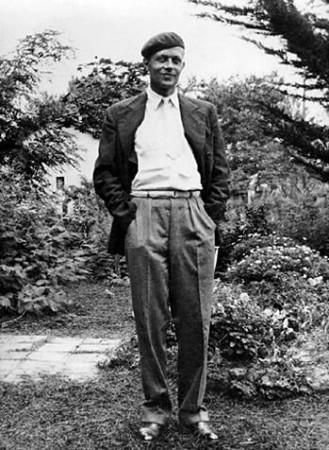  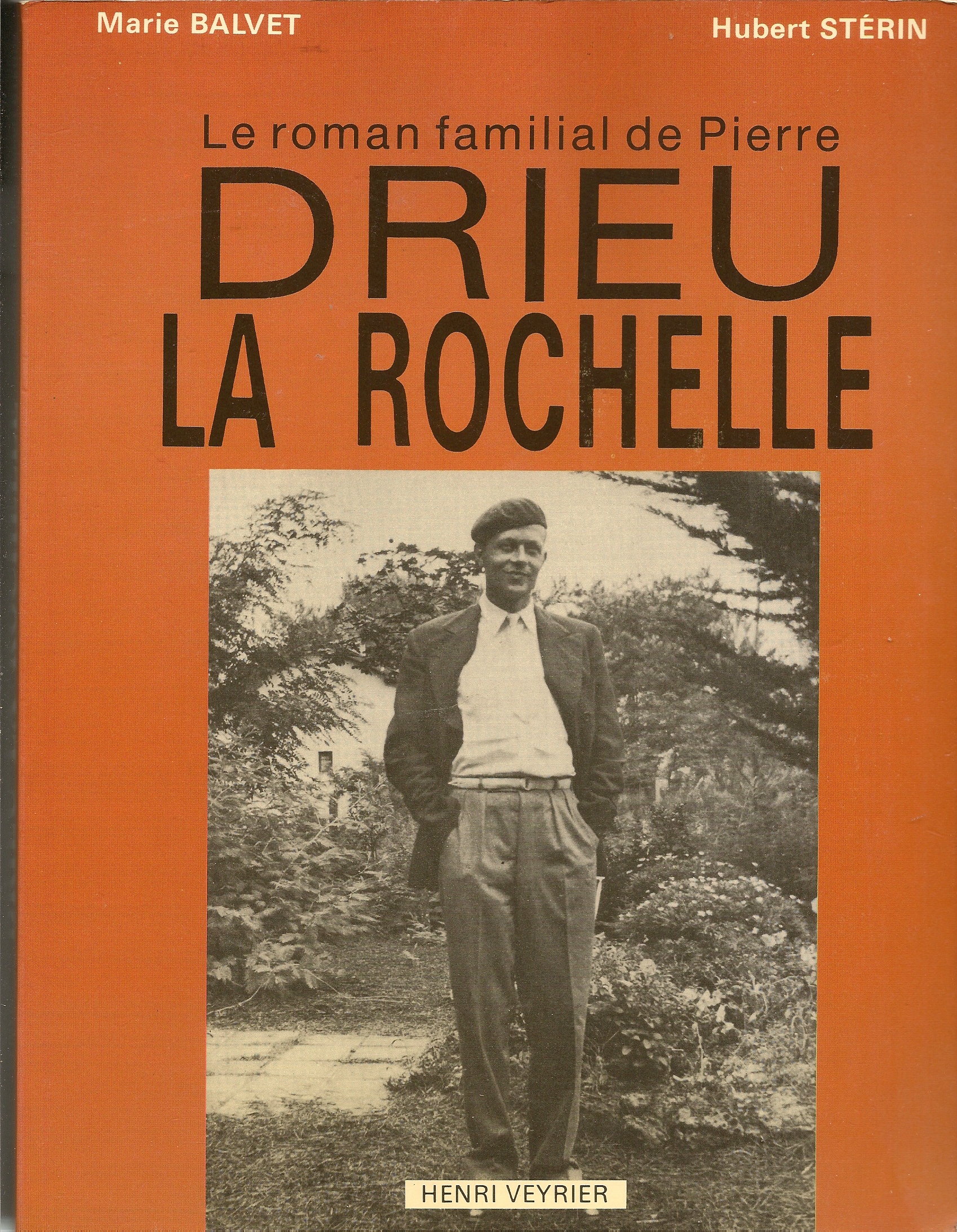    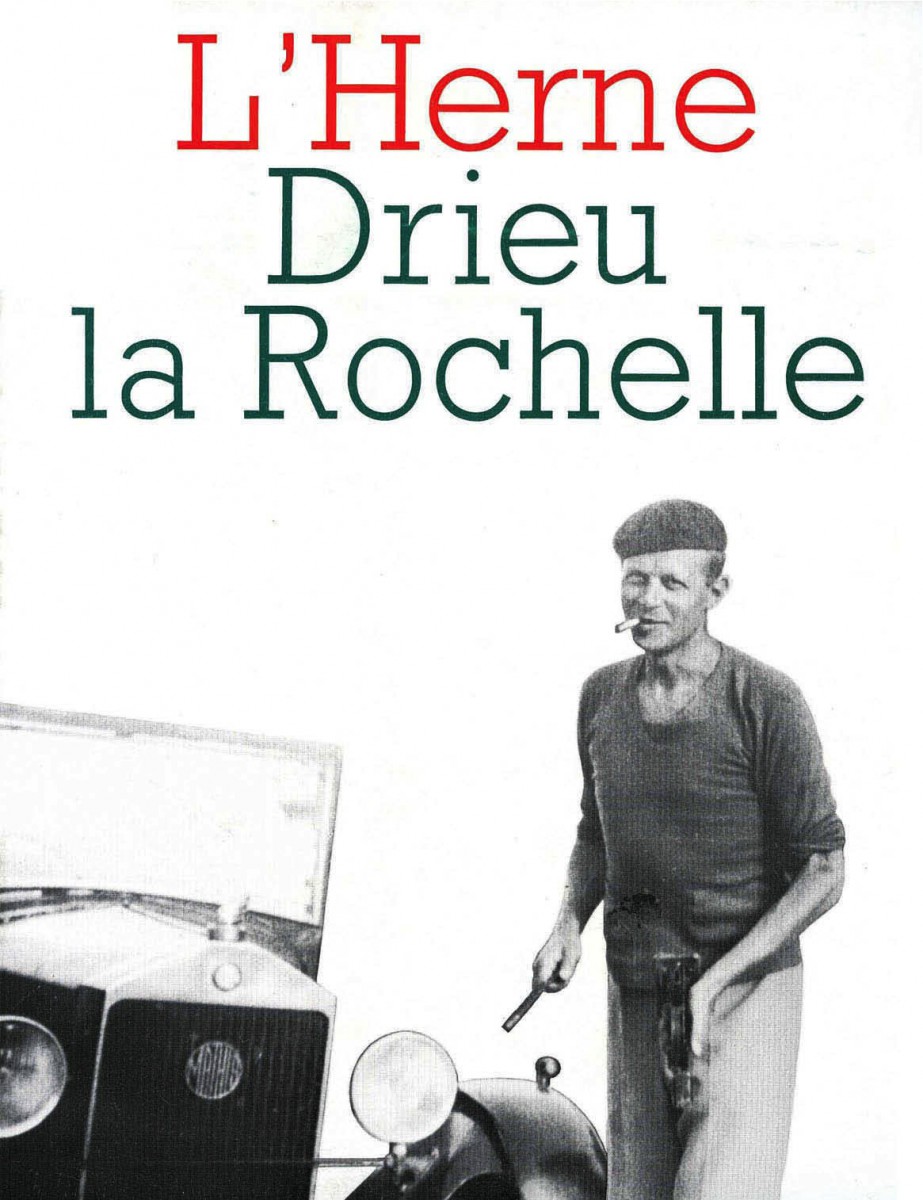
Posté le : 04/01/2016 18:10
Edité par Loriane sur 05-01-2016 18:47:11
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
56 Personne(s) en ligne ( 37 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 56
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages