|
|
Marguerite Audoux |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 31 janvier 1937 meurt Marguerite Audoux
née Marguerite Donquichote, à 73 ans, à Saint-Raphaël Var, romancière française née le 7 juillet 1863 à Sancoins Cher, connue pour le succès et l'influence de son roman Marie-Claire.
Sa vie
Marguerite Donquichote naît à Sancoins, dans le Cher, le 7 juillet 1863. À l’âge de trois ans, elle perd sa mère, et son père abandonne ses filles. Marguerite et Madeleine, l’aînée, d’abord confiées à une tante, passent neuf années à l’orphelinat de l’Hôpital général de Bourges.
De 1877 à 1881, Marguerite est placée, en tant que bergère d’agneaux et servante de ferme, en Sologne à Sainte-Montaine, près d'Aubigny-sur-Nère. Les deux dernières années de cette période sont marquées par la rencontre d’Henri Dejoulx, avec qui la jeune fille vit un amour payé de retour, mais auquel la famille d’Henri, par peur d’une mésalliance, met un terme.
L’orpheline s'établit alors à Paris, où elle vit des années noires en exerçant le métier de couturière. Le chômage la contraint de faire d’autres travaux pénibles, à la Cartoucherie de Vincennes et dans la buanderie de l’Hôpital Laennec. Pendant ces années de misère, en 1883, elle a un enfant qui ne survit pas, et dont l'accouchement pénible lui vaut une stérilité définitive.
À la même époque, sa sœur Madeleine lui laisse sa fille Yvonne, que la future romancière élève, en dépit des difficultés financières auxquelles elle est confrontée.
C’est précisément cette nièce qui, sans bien sûr en avoir conscience, va favoriser la carrière littéraire de sa mère adoptive : la jeune fille volage, à seize ans, se prostitue, à l’insu de sa tante, dans le quartier des Halles de Paris ; or, un jeune homme, qui ignore également le commerce auquel elle s’adonne, s’éprend d’elle.
C’est Jules Iehl, alias Michel Yell en littérature, un ami d'André Gide. Quand il prend conscience de la situation, il va voir la tante, avec qui il se console si bien que leur relation ne prendra fin qu’en 1912. Yell fait rencontrer à son amie un groupe d’intellectuels, écrivains et artistes, parmi lesquels figurent Charles-Louis Philippe, Léon-Paul Fargue, Léon Werth et Francis Jourdain.
Michel Yell découvre que celle avec qui il partage ses jours et qui, dès 1895, a définitivement adopté le nom de sa mère : Audoux a écrit ses souvenirs, et d’une fort jolie façon. Il trahit le secret auprès de ses compagnons de route, qui constituent le groupe de Carnetin, du nom du village à l’est de Paris où ils se réunissent chaque dimanche de 1904 à 1907. Francis Jourdain, dont le père, l'architecte Frantz Jourdain, est un ami d’Octave Mirbeau, va trouver l’auteur du Journal d’une femme de chambre.
Celui qui règne en maître dans la République des Lettres est alors dépressif, et fait comprendre au jeune peintre qu’il n’est, pour l’heure, plus prêt à défendre quiconque. Il prend cependant le manuscrit, commence à le lire, et ne le termine avec enthousiasme que pour aller l’imposer aux éditeurs.
C’est donc à Octave Mirbeau que la couturière des lettres doit ce véritable coup d’État du 2 décembre 1910 : le Prix Femina que l’on décerne à l’ancienne bergère pour son roman intitulé Marie-Claire, dont les ventes dépassent les cent mille exemplaires. Il est traduit en allemand et en anglais, ainsi qu'en esperanto, en russe, en catalan, en suédois, en espagnol, en danois, en slovène.
Le second livre ne paraît que dix ans plus tard, après le départ de Michel Yell et la mort d’Alain-Fournier, le fils spirituel de la romancière, puis celle d'Octave Mirbeau, et au moment de l’adoption des trois fils d’Yvonne.
L’Atelier de Marie-Claire, paru en 1920, rencontre un certain succès, mais le tirage à douze mille exemplaires le place cependant loin derrière le best-seller dont il constitue la suite. C’est le début d’un lent decrescendo. Elle publie néanmoins De la ville au moulin en 1926, puis La Fiancée, un recueil de contes digne d’intérêt que Flammarion édite en 1932, et enfin Douce Lumière, roman posthume qui sort fin 1937. La romancière, décédée le 31 janvier de cette même année, est inhumée à Saint-Raphaël, où l’amoureuse de la mer a terminé son existence.
Les quatre romans
Marie-Claire 1910, Eugène Fasquelle, éditeur, 1910.
L’Atelier de Marie-Claire, Grasset, 1920 ; Les Cahiers Rouges, 1987. L'atelier de couture où Marie-Claire a trouvé du travail est dépeint comme une grande famille.
Les patrons, M. et Mme Dalignac, et les ouvrières, obligées de s'embaucher en usine lors des périodes de chômage, dépendent de la même façon des clientes, exigeantes et souvent mauvaises payeuses.
Ainsi ce roman est à la fois la peinture d'un milieu social et une suite d'anecdotes variées qui, tout en campant avec précision les personnages des ouvrières, permettent au récit de progresser.
Après la mort des patrons, on ne sait si Marie-Claire épousera Clément, le neveu de Mme Dalignac, qu'au demeurant elle n'aime pas.
De la ville au moulin, Fasquelle, 1926. En voulant s'interposer lors d'une dispute qui oppose ses parents, Annette Beaubois est blessée à la hanche et demeure boiteuse.
Elle part pour le moulin de son oncle, bientôt suivie par ses frères et sœurs que ses parents, en train de se séparer, lui confient.
À vingt ans, elle consent à vivre avec un ami de son frère, Valère, qui sombre dans l'alcoolisme, et la trompe.
Enceinte de ses œuvres, elle le quitte néanmoins pour aller accoucher, à Paris, d'un enfant qui ne survit pas. Dans la capitale, elle retrouve sa famille, puis, la guerre terminée, elle reconnaît Valère dans un grand blessé. Elle est prête à lui redonner sa chance.
Douce Lumière, Grasset, 1937 posthume. Douce est le surnom d'Églantine Lumière. Sa mère est morte en couches, le père s'est suicidé de désespoir, et le grand-père maternel voue à la fillette une injuste rancune.
Douce trouve du réconfort auprès de son jeune voisin, Noël, et, au fil des années, l'amitié se transforme en amour.
Mais Églantine est victime d'une campagne de calomnie de la part de la famille du jeune homme qui, hostile à leur union, réussit à les séparer.
L'héroïne, à jamais marquée par son expérience et fidèle au souvenir de Noël, se retrouve à Paris, où elle sympathise avec Jacques, son voisin, malheureux en amour, puis veuf.
Une tentative de relation amoureuse échoue. Jacques part pour la guerre et revient peu après handicapé. À la mort de sa fille, il perd la raison
Mémoire
Il existe un prix Marguerite-Audoux, ainsi qu'un prix Marguerite-Audoux des collèges que décernent les collégiens du Cher, à l'instar des membres du jury du prix national, à un ouvrage de littérature de jeunesse récemment publié et dont le thème ou l'univers rejoignent ceux de Marguerite Audoux.
La ville d'Aubigny-sur-Nère a consacré à Marguerite Audoux un musée qui rassemble plusieurs objets familiers de l'écrivain, légués par ses héritiers.
Sur la façade de la mairie de Sainte-Montaine est apposée une plaque rappelant que Marguerite Audoux fut bergère dans une ferme située sur la commune, qui lui inspira bien des personnages et lieux évoqués dans ses romans.
Une bibliothèque municipale parisienne porte le nom de Marguerite Audoux. En mai 2007, après un vote des habitants du 3e arrondissement de Paris, auxquels étaient également proposés les noms de Hannah Arendt, Robert Desnos et André Schwarz-Bart, ce nom a été choisi pour la nouvelle bibliothèque du quartier, qui a ouvert ses portes au 10 rue Portefoin le 17 janvier 2008.
Article
Prix Marguerite Audoux
       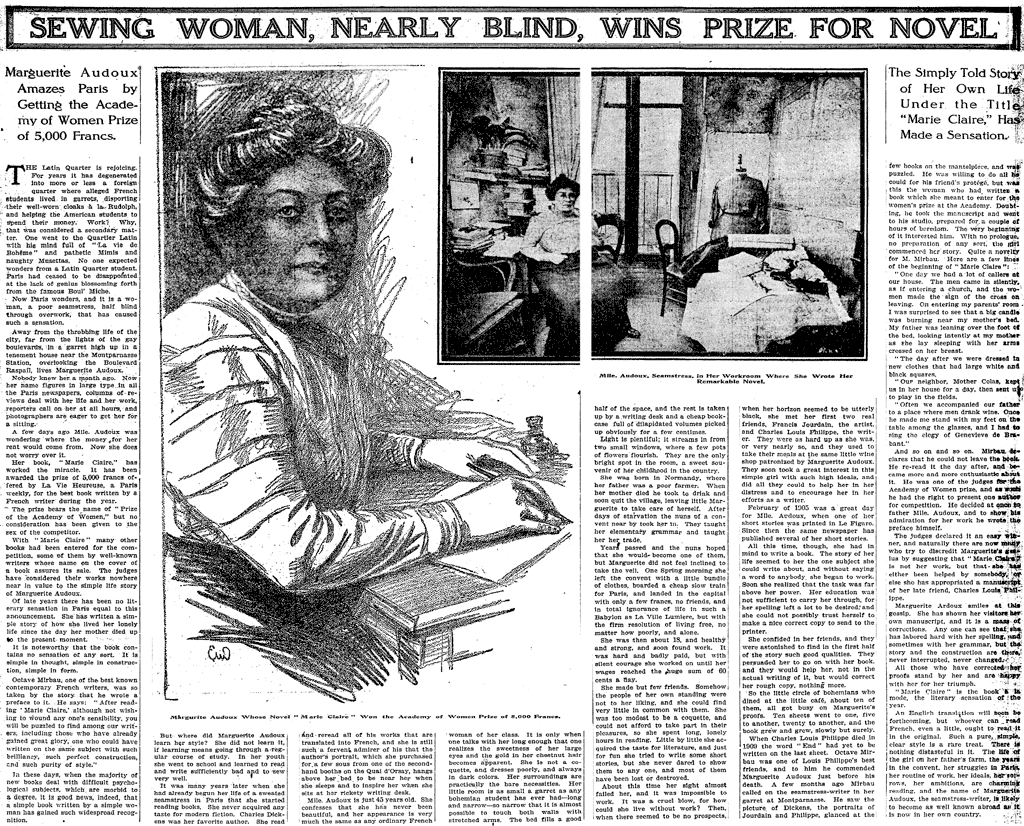  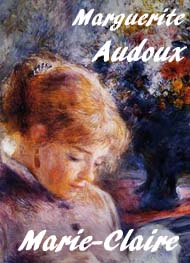   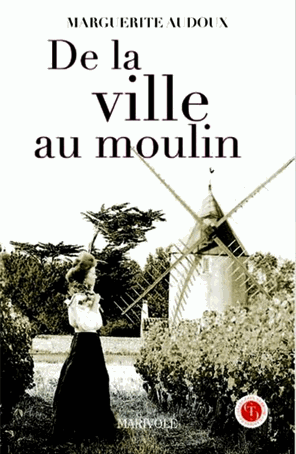
Posté le : 29/01/2016 18:39
Edité par Loriane sur 30-01-2016 16:48:20
|
|
|
|
|
Jean Giraudoux |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 31 janvier 1944 meurt Hippolyte Jean Giraudoux
à 61 ans, à Paris, écrivain, Dramaturge, romancier, essayiste, diplomate, Auteur de langue français et un diplomate français, né le 29 octobre 1882 à Bellac dans la Haute-Vienne.
Brillant étudiant et soldat décoré pendant la Première Guerre mondiale, il occupe des fonctions diplomatiques et administratives tout en écrivant des romans Suzanne et le Pacifique en 1921, Siegfried et le Limousin en 1922 avant de se diriger vers le théâtre après sa rencontre avec le comédien Louis Jouvet qui mettra en scène et interprétera ses œuvres principales. Ses Œuvres principales sont La guerre de Troie n'aura pas lieu, Électre.
Il est aujourd'hui surtout connu pour son théâtre qui compte des pièces célèbres comme Amphitryon 1928, La guerre de Troie n'aura pas lieu 1935, Électre 1937, Ondine 1939, ou encore La Folle de Chaillot jouée en 1945 après sa mort. Jean Giraudoux a participé comme d'autres dramaturges des années 1930-1940, Cocteau, Anouilh, Sartre, Camus par exemple à la réécriture des mythes antiques éclairés par les mentalités modernes. Il a su allier fantaisie poétique et goût pour les images insolites, et également associer le tragique et le léger dans une langue élégante et fine, parfois même poétique comme dans Intermezzo ou Ondine.
Germanophile et diplomate de carrière, il est Commissaire général à l'information en 1939-1940 et pendant l'Occupation sa situation est complexe et son rôle contrasté.
Jean Giraudoux meurt à Paris le 31 janvier 1944, à l'âge de soixante et un ans, à la suite d'une intoxication alimentaire ou d'une inflammation du pancréas.
En bref
Un romantique du XXe siècle, qui finit par prendre rang dans la lignée des classiques, à la suite de Marivaux et Musset, et pas tellement loin de ce Racine dont il a parlé comme d'un double ; un La Fontaine, rêveur et distrait, qui laisse une œuvre de quarante volumes ; l'« enchanteur » de son temps, comme fut nommé Chateaubriand, et comme lui caressant l'idée d'une mission politique, qui se résorbe en littérature : les paradoxes qu'inspire le cas Giraudoux ne peuvent se résoudre que dans une réflexion sur les pouvoirs de l'écriture.
L'homme Giraudoux fut pleinement un homme, comme son Holopherne ; « Un homme enfin de ce monde, du monde, l'ami des jardins à parterres, des maisons bien tenues, de la vaisselle éclatante sur les nappes, de l'esprit et du silence... Le pire ennemi de Dieu. »
L'écrivain Giraudoux est tout entier écrivain, comme son Racine, en qui « il n'est pas un sentiment qui ne soit un sentiment littéraire : sa méthode, son unique méthode, consiste à prendre de l'extérieur, par le style et la poétique comme par un filet, une pêche de vérités ».
Pour l'homme Giraudoux, attentif à ses plaisirs, à ses amours, à ses amitiés, à sa forme physique, à son équilibre moral, à son élégance et à sa jeunesse d'allure, l'écriture fut le plus équilibrant des plaisirs. Il écrivait d'un jet, sans ratures, laissant parfois un mot en blanc parce qu'il savait que les difficultés se franchissent dans la foulée, comme les haies de 400 mètres, dont il était champion universitaire. Il écrivait un roman en trois semaines, pendant ses vacances, en guise de vacances. Le miracle, c'est que tant d'humanité soit passée dans l'écriture.
L'indifférent pathétique. La première carrière de Jean Giraudoux est l'histoire d'une jeunesse, la plus longue et la plus vagabonde, prolongée par la guerre jusqu'au seuil de la quarantaine. Un adolescent très doué et très sensible tarde à entrer dans la vie et se protège des blessures de l'existence par des boucliers de papier doré. Son écriture fantasque enchaîne les figures de style dans un réseau précieux de descriptions et de métaphores. Aimant Jules Laforgue et Claude Debussy, fréquentant Paul-Jean Toulet et Charles-Louis Philippe, il introduit dans la nouvelle, alors naturaliste, une sensibilité post-symboliste et l'art des instantanés autobiographiques. Car le jeune Giraudoux n'a qu'à se souvenir pour écrire de délicates nouvelles, pour la plupart recueillies dans Provinciales (1909), L'École des indifférents (1911), Lectures pour une ombre (1917), Adorable Clio (1920). Ces précieux petits volumes ne touchent qu'une poignée de fins lettrés, au nombre desquels André Gide et Marcel Proust.
Ils y lisent en filigrane, et à travers un double voile de pudeur et d'ironie, l'histoire d'un enfant trop adoré par une mère délicate et distinguée et trop rudoyé par un père simple et sévère, petit fonctionnaire accablé par ses travaux d'écriture. De Bellac (Haute-Vienne) où il naquit, de Pellevoisin (Indre) où il fréquente l'école publique et la miraculée locale, sainte Estelle, de Cérilly (Allier) où il passe ses vacances de lycéen, un même paysage se compose, limousin ou berrichon, sans éclat et tout en nuances, et la même société villageoise tient à l'étroit les grands élans du cœur. On y rêve d'évasion, de la ville, de Paris. Mais, pour le gamin de onze ans, la ville c'est le lycée de Châteauroux, puis le lycée Lakanal, puis l'École normale supérieure, la vie d'interne jusqu'à la fin du service militaire, avec pour seule échappée la lucarne magique des livres et pour seule liberté celle du travail scolaire. La culture sera à jamais vouée, dans la pensée de Giraudoux, au destin le plus ambigu : elle est l'envol loin des mesquineries quotidiennes, et elle est l'aberration qui arrache l'homme à la vie simple et tranquille des champs.
Le lycéen modèle, lauréat du concours général en version grecque, une fois reçu à l'École normale supérieure, fait l'école buissonnière à la terrasse du café Vachette, se découvre une vocation de germaniste pour obtenir une bourse de voyage, part deux fois pour Munich et Berlin, revient prématurément dans sa famille, échoue à l'agrégation, séjourne à Harvard et passe sur le tard le « petit concours » des Affaires étrangères : il entre par la petite porte dans une carrière qui ne sera pas très brillante pour lui, mais qui lui donne l'illusion de satisfaire par sa vie professionnelle une hantise de sa vie morale, l'évasion, le dépaysement. En fait, il refusera toute affectation hors de France, préférera de rapides missions dans les cinq continents, et gardera son port d'attache au Quai d'Orsay. Car l'étranger, pour lui, n'est qu'un mythe.
Les chimismes de l'amour lui ont fait découvrir les intermittences du cœur et de l'esprit. Il suffit en effet d'être mal aimé, comme Simon, ou au contraire trop aimé, comme Jacques l'Égoïste, pour être pathétique ou indifférent. D'ailleurs, Simon le Pathétique (1918) fréquente aussi l'« école des indifférents », appliqué qu'il est à « oublier sa vie » et à « s'épargner la tâche vile de se connaître ». Giraudoux pense comme la Nausicaa qu'il a évoquée dans Elpénor (1919) : « Pour lui-même, cet étranger n'est plus un étranger ! J'aimerais tant aimer quelqu'un qui fût étranger même à soi-même ! » De là, tout au long de son œuvre, le thème pirandellien du double, du reflet, du sosie, et l'idée de l'amnésie illustrée en 1922 par le roman de Siegfried et le Limousin.
Sa vie
Fils cadet de Léger Giraudoux, employé des Ponts et chaussées, et d'Anne Lacoste, Jean Giraudoux naît à Bellac, un an avant la nomination de son père à Bessines. Ce dernier quitte le corps des Ponts et chaussées en 1890 pour devenir percepteur à Pellevoisin. Reçu premier du canton au certificat d'études en 1892, Jean Giraudoux entre en octobre 1893 comme boursier au lycée de Châteauroux, qui porte aujourd'hui son nom lycée Jean-Giraudoux, où il fait sa première communion en juin 1894, et est interne jusqu'à son baccalauréat en 1900.
Bachelier de philosophie, il poursuit ses brillantes études en classes préparatoires au lycée Lakanal de Sceaux pour tenter le concours littéraire de l'École normale supérieure; il termine sa seconde année de khâgne avec le prix d'excellence et obtient le premier prix de version grecque au concours général en 1902. Reçu 13e sur 21 à l'École normale supérieure de Paris, il accomplit son service militaire au 98e régiment d'infanterie à Roanne, Clermont-Ferrand et Lyon, dont il sort en 1903 avec le grade de caporal. Entré à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, dans la section lettres, il est passionné par la culture allemande. Après l'obtention, avec la mention « bien », de sa licence de lettres à la Sorbonne en juillet 1904, avec un mémoire sur les Odes pindariques de Ronsard, il passe, sur les conseils de son maître Charles Andler, dans la section d'allemand en novembre.
Ayant obtenu une bourse d'études, il s'inscrit alors à l'université de Munich. Durant l'été 1905, il est le répétiteur du fils du prince de Saxe et de Paul Morand à Munich, et il rencontre Frank Wedekind. Puis il part en voyage pour la Serbie, l'Autriche-Hongrie Trieste entre autres et Venise en Italie. En 1906, il obtient sa maîtrise et fait, durant l'été, un séjour linguistique en Allemagne. Après un échec à l'agrégation d'allemand, il se rend aux États-Unis, de septembre 1907 à mars 1908, avec une bourse pour l'Université Harvard. À son retour, il entre à la rédaction du Matin et prépare le concours des Affaires étrangères, auquel il échoue en 1909. La même année, il publie son premier livre, Provinciales, remarqué par André Gide. En juin 1910, reçu premier au concours des chancelleries, il est nommé élève vice-consul à la direction politique et commerciale du ministère des Affaires étrangères ; il assure le convoiement de la valise diplomatique à Constantinople, Moscou, puis Vienne. Par ailleurs, il fait la connaissance de Rosalia Abreu 1886-1955, sœur de son ami Pierre, une jeune héritière cubaine, pour laquelle il éprouve une passion non partagée.
Promu attaché au bureau d'étude de la presse étrangère en septembre 1912, il devient vice-consul de 3e classe en 1913. La même année, il fait paraître chez Grasset L'École des indifférents et entame une liaison avec Suzanne Boland 1881-1969, mariée au commandant Paul Pineau, mais séparée de son mari.
Mobilisé comme sergent au 298e régiment d'infanterie en 1914, puis nommé sous-lieutenant, il est blessé à deux reprises, à la bataille de la Marne en 1914, aux Dardanelles en 1915, et nommé chevalier de la Légion d'honneur. Convalescent, il entre au bureau de la propagande du ministère des Affaires étrangères grâce à Philippe Berthelot, avant de participer à une mission militaire et diplomatique à Lisbonne en août-novembre 1916. Il prend part ensuite à la « mission Harvard », qui le conduit aux États-Unis en avril-août 1917.
Ce faisant, il continue d'écrire, faisant paraître Retour d'Alsace. Août 1914 en 1916, Lectures pour une ombre en 1917, Amica America et Simon le pathétique en 1918.
Le sourcier de l'Éden
La victoire de 1918 ouvre la seconde carrière de Giraudoux. La guerre l'a obligé à « se rendre compte du monde et de son mouvement » et l'a détourné de son dandysme, de son égotisme, de son apolitisme, de son indifférence. Il accède au grand cadre des Affaires étrangères en 1919. Il se marie, il a un fils, un cercle d'amis très parisiens, la direction du service de presse du Quai d'Orsay, et son talent s'épanouit : au lieu d'une nouvelle, c'est un roman qu'il publie tous les deux ans, avec un succès croissant.
La plupart de ces romans racontent une fugue. De l'Allemagne au Pacifique, de la Gartempe au Niagara, Giraudoux promène ses héros dans l'exotisme et, à ce titre il est le chef de file, suivi de son ami Paul Morand, du roman nouveau des années vingt : roman descriptif, roman déambulatoire, roman du regard mobile. L'enchantement de Suzanne en son île (Suzanne et le Pacifique, 1921) n'est pas près de se dissiper : il est si merveilleux de renier le laborieux Robinson, au lieu de peiner puritainement comme lui à reconstituer la civilisation européenne, et de boire le lait à même l'arbre à lait, de cueillir son pain dans l'arbre à pain ! Ce désir de liberté exotique emporte Juliette au pays des hommes (1924), tue Bella (1926) dans son effort pour attirer l'un vers l'autre Rebendart et Dubardeau (lisez Poincaré et Berthelot) comme deux continents, provoque les Aventures de Jérôme Bardini (1930) et l'amour de Jacques pour Maléna (Combat avec l'ange, 1934). Mais ces fugues ne sont pas des fuites. Le grand départ s'achève par un heureux retour.
Car malgré la déchirure secrète, les romans de Giraudoux ne respirent pas la nostalgie. L'émerveillement d'abord, la sagesse ensuite font que ses héros trouvent le bonheur sur cette terre, et ses jeunes filles s'arrachent aux embrassements des fantômes, des génies et des bêtes pour épouser, dans leur village, un homme. La vie est belle et jeune pour ceux qui savent marier la modernité et la sensualité, pour ceux qui surprennent le monde à des heures où il n'a pas l'habitude d'être contemplé, dans la fraîcheur de la première heure et comme du premier jour. C'est l'Éden retrouvé, ou, comme il est dit dans la « Prière sur la tour Eiffel » (Juliette au pays des hommes), « l'intervalle qui sépara la création et le péché originel ».
Giraudoux dramaturge ou l'illusionniste engagé
Sa troisième carrière est la plus brillante, et s'ouvre par un coup d'éclat : la générale de Siegfried (pièce tirée en 1928 du roman de 1922) marque la restauration en France de ce théâtre littéraire si vainement souhaité par Copeau. Chaque soir, pendant plus de dix ans, Giraudoux, interprété par Jouvet, régnera sur les théâtres parisiens.
Reprenant de vieux thèmes pimentés d'anachronismes (Amphitryon 38 en 1929 ; Judith, 1931 ; Électre, 1937 ; Ondine, 1939) ou créant de nouveaux mythes (Siegfried, 1928, Intermezzo, 1933), Giraudoux rétablit le théâtre dans sa dignité d'assemblée générale des peuples, et invite ses spectateurs à de souriantes méditations sur les problèmes éternels de l'amour, de la condition humaine, de la guerre. Dans son travesti mythologique, l'actualité est bien reconnaissable (La guerre de Troie n'aura pas lieu, 1935), et Giraudoux peut se prendre pour le penseur politique de son temps (Pleins Pouvoirs, 1939).
La guerre rend caduc son programme d'urbanisme et de salubrité (programme qui retrouve sa valeur aujourd'hui). Sa nomination au poste de commissaire à l'Information (août 1939) perd tout sens du fait de la censure. L'Occupation marque pour lui la fin d'un monde qu'il décrit d'abord comme la fin du monde : Sodome et Gomorrhe (1943) dit l'échec du couple et la défaite de la patrie. Mais il se ressaisit. En écrivant La Folle de Chaillot, il semble pressentir le temps où elle sera créée (1945) : dans un Paris qui n'a pas oublié sa belle époque, une vieille folle inspirée entraîne un petit peuple d'égoutiers et de chanteurs des rues dans une révolution gentiment anarchiste. Il n'a pas été donné à Giraudoux, mort en janvier 1944, de voir la libération de Paris. Mais Sartre nota aussitôt : « Les vieilles valeurs de mesure, d'ordre, de raison, d'humanisme qu'il a redécouvertes demeurent, après sa mort, « proposées ». Toutes nos violences n'empêcheront pas qu'elles existent... Elles resteront, quel que soit le chemin que nous choisissions demain, comme une chance possible ou comme un beau regret ou peut-être comme un remords. » Jacques Body
Maturité 1919-1940
Après la guerre, il s'éloigne de l'Allemagne. Démobilisé en 1919, il devient secrétaire d'ambassade de troisième classe et dirige le Service des œuvres françaises à l'étranger 1920 puis le service d'information et de presse au Quai d'Orsay (fin octobre 1924). Au Quai d'Orsay il rejoint un de ses amis d'enfance le diplomate Philippe Berthelot.
Suzanne Boland lui donne un fils, Jean-Pierre, le 29 décembre 1919. Ils se marieront en 1921, Suzanne ayant divorcé l'année précédente. La même année paraît Suzanne et le Pacifique, roman suivi en 1922 par Siegfried et le Limousin, qui se voit décerner le prix Balzac, et en 1924 par Juliette au pays des hommes. En 1926, il est promu officier de la Légion d'honneur.
En 1927, il se fait placer hors cadre à la disposition de la Commission d'évaluation des dommages alliés en Turquie, commission où il reste sept ans. Ce poste lui laissant beaucoup de temps libre, il en profite pour écrire ses premières pièces de théâtre. La rencontre avec Louis Jouvet en 1928 stimule en effet sa création théâtrale avec le succès de Siegfried 1928, adaptation théâtrale de son roman Siegfried et le Limousin, d’Amphitryon 1929 et d’Intermezzo 1933, malgré l'échec de Judith 1931.
À la fin de 1931, il entame avec Anita de Madero une liaison qui s'achève en 1936 par le départ de la jeune héritière argentine qui part se marier en Amérique du Sud.
En juin 1932, il est chargé de mission au cabinet d'Édouard Herriot, président du Conseil5, qu'il accompagne lors de la conférence de Lausanne. La même année, il écrit la préface de la traduction du livre de l'écrivaine germanophone d'origine messine Adrienne Thomas, Catherine Soldat.
En 1934, il est nommé inspecteur général des postes diplomatiques et consulaires. Devant la montée des périls en Europe, il écrit La guerre de Troie n'aura pas lieu, pièce pessimiste (bien que non dénuée d'humour grinçant) ayant pour thème le cynisme des politiciens et la différence entre l'histoire telle que les dirigeants la montrent au peuple et telle qu'elle se passe réellement. En 1936, Jean Zay lui propose la direction de la Comédie-Française, mais il la refuse. La même année, il devient commandeur de la Légion d'honneur.
Le 28 avril 1939, il rencontre dans un studio de la radio, lors d'un entretien sur Ondine, Isabelle Montérou, jeune journaliste avec laquelle il entame une liaison qui dure jusqu'en novembre 1943. A la veille de la guerre, Giraudoux publie un important essai politique, recueil d'articles et de conférences : Pleins pouvoirs Gallimard, 1939, dans lequel, prenant modèle sur les États-Unis, il demande notamment l'adoption d'une politique d'immigration, afin, non « d’obtenir dans son intégrité, par l’épuration, un type physique primitif, mais de constituer, au besoin avec des apports étrangers, un type moral et culturel ». Sa préférence va vers « une immigration scandinave éminemment souhaitable », à l'exclusion de « ces races primitives ou imperméables dont les civilisations, par leur médiocrité ou leur caractère exclusif, ne peuvent donner que des amalgames lamentables », symbolisées selon lui par les Arabes
Devant la montée des périls, Giraudoux s'engage en politique. Lors du remaniement ministériel du 29 juillet 1939, il est nommé par Édouard Daladier Commissaire général à l'information et prononce ses Messages du Continental, contre la guerre hitlérienne.
Le 21 mars 1940, lors de la formation de son gouvernement, Paul Reynaud le remplace par Ludovic-Oscar Frossard, nommé ministre de l'Information, et il devient président d'un « Conseil supérieur de l'information ».
Seconde guerre mondiale et mort 1940-1944
Durant la débâcle de juin 1940, il suit le gouvernement à Bordeaux, avant de s'installer auprès de sa mère à Vichy. Nommé directeur des Monuments historiques à l'automne 1940, il fait valoir ses droits à la retraite en janvier 19419 et commence deux écrits inspirés par la défaite, qui ne paraîtront qu'après sa mort, le second étant resté inachevé : Armistice à Bordeaux 1945, et Sans Pouvoirs 1946, édités l'un et l'autre à Monaco.
Commissaire général à l'information sous Daladier, sa situation pendant l'Occupation est complexe et son rôle contrasté
Sa passion pour la culture allemande existe de longue date : Tous ceux qui aiment le travail, la musique, l'étude sont exilés d'Allemagne. Nous qui aimons Dürer, Goethe, nous sommes exilés d’Allemagne; mais il l'a délaissée depuis quelques années, à l'époque, et Ondine 1939 constitue un « adieu » à l'« âme franco-allemande ».
Dans Armistice à Bordeaux, il s’oppose, phrase par phrase, au second discours de Pétain, refusant l'expiation nationale
Il a refusé le poste de ministre de France à Athènes proposé par Vichy après l'armistice du 22 juin 1940 mais entretient des relations personnelles avec plusieurs membres du nouveau gouvernement.
Son fils Jean-Pierre a rejoint Londres dès juillet 1940 et s'est engagé dans les Forces navales françaises libres.
D'après le témoignage de Gérard Heller, qui l'a rencontré en juillet 1941, « Giraudoux perdit vite confiance dans les bonnes intentions du maréchal Pétain » et « avait très tôt communiqué à Londres des informations sur l'activité intellectuelle clandestine en France ».
En 1942, alors qu'il loge à Paris, il affirme « l'impossibilité d'une véritable rencontre entre les deux cultures tant que durerait la guerre ».
La même année, un journaliste collaborationniste lui reproche d'avoir, dans ses fonctions de commissaire général à l'information, accepté de « seconder les Juifs dans « leur » guerre ».
On lui propose de quitter la France. Il refuse, arguant de la nécessité de livrer en France une « lutte d’influence avec l’Allemagne ».
Sa participation à la lutte contre l'occupation allemande au sein de la Résistance reste encore débattue. En décembre 1943, il aurait projeté de participer à sa façon à la Résistance.
Il poursuit ses travaux littéraires avec L'Apollon de Bellac, Sodome et Gomorrhe et La Folle de Chaillot et, devenu directeur littéraire chez Gaumont, participe à des adaptations cinématographiques, qu'il s'agisse de La Duchesse de Langeais de Balzac pour le film éponyme de Jacques de Baroncelli ou des Anges du péché pour Robert Bresson.
Après la mort de sa mère en 1943, sa santé se dégrade. Jean Giraudoux meurt le 31 janvier 1944, à l'âge de soixante et un ans, selon la version officielle, à la suite d’une intoxication alimentaire, mais, plus probablement, d’une pancréatite.
Quelques jours après son inhumation, qui a lieu le 3 février 1944 dans un caveau provisoire du cimetière de Montmartre, Claude Roy fait courir le bruit, au café de Flore, qu'il a été empoisonné par la Gestapo. Louis Aragon le reprend à son compte dans Ce soir le 20 septembre 1944 : « Pourquoi ? Pas seulement parce que c’est le plus français de nos écrivains, mais certainement aussi pour son activité résistante gardée très secrète et que, pour ma part, j’avais devinée durant le dernier entretien que je devais avoir avec lui cinq jours avant sa mort ». Une biographie explorant la question lui est consacrée par Jacques Body en 2004.
Il est inhumé au cimetière de Passy à Paris.
Giraudoux antisémite et raciste ?
Se fondant sur plusieurs citations tirées du chapitre « La France peuplée » de Pleins pouvoirsN 6, voire, dans certains cas, sur des extraits de répliques d'Holopherne dans Judith, plusieurs auteurs considèrent que Giraudoux était antisémite et raciste. Spécialiste de Sartre, Jean-François Louette juge ainsi que Giraudoux « évoque maints problèmes » dans Pleins pouvoirs, mais que « l'essentiel aujourd'hui semble le chapitre intitulé La France peuplée », dont il stigmatise la « violence raciste ». Pour Jean-Claude Milner, « le Giraudoux raciste et le Giraudoux républicain ne parviennent pas à se détacher ». Daniel Salvatore Schiffer juge, quant à lui, que, dans Pleins pouvoirs, Giraudoux est « non loin [...] de l'antisémitisme de Fichte ou Hegel ». Aux yeux de Claude Liauzu, Giraudoux a donné des connotations positives au mot « raciste », dans le cadre d'une banalisation du racisme, dans les années trente. Selon Pierre Vidal-Naquet, de même, le racisme de Giraudoux, en 1939, est prodigieusement banal.
Pour André Job, « l'antisémitisme, c'est d'abord, à n'en pas douter, une façon de ne pas résister au plaisir d'un "bon mot", si malveillant soit-il », usage auquel il est arrivé à Giraudoux de sacrifier, « sans que les exemples soient en assez grand nombre pour qu'on puisse les juger vraiment significatifs ».
Alain Duneau parle de « défaillances », considérant que « deux pages de Pleins pouvoirs lui ont été à juste titre reprochées, mais sans lucidité particulière, par des professeurs de vertu qui ne s'interrogent peut-être pas assez sur eux-mêmes ou sur les illusions rassurantes mais criminelles dont d'autres se sont bercés ». À ses yeux, « ces deux pages trop connues pourraient bien être le fruit de l'appréhension d'un retour de la guerre », et il signale que « tout mot "raciste" a disparu chez lui dès que la guerre — réelle — a été déclarée ». Toujours selon lui, la répulsion de Giraudoux à l'égard de toute forme de laideur, « sans doute ressentie comme une forme du mal » peut également « expliquer en partie certaines de ses faiblesses [...] qui lui ont été abondamment reprochées accusations injustifiées de racisme ».
Pour son biographe Jacques Body, « Giraudoux antisémite, Giraudoux vichyste, c’est devenu l’antienne des ignorants. » Selon lui, de Pleins pouvoirs, « son plaidoyer pour une politique d’immigration et pour le droit d’asile », on a fait, « cinquante ans plus tard, un bréviaire xénophobe et raciste, à coup de citations tronquées. » Il considère que, chez Giraudoux, « l'appartenance à une patrie marque un homme, mais par la culture, non par des contraintes naturelles ou sociologiques. Giraudoux croit à la patrie, pas à la race. »
Pierre Charreton, de son côté, relève que, si Giraudoux défend l'avènement d'une « politique raciale » et d'un « ministère de la race », pour lui, le terme de « race », « aujourd'hui empoisonné, voire tabou », mais « employé sans précaution jusqu'au milieu du siècle, parfois certes dans un sens proprement raciste, mais aussi dans une acception proche du terme "peuple" », renvoie à un « habitus », un ensemble de valeurs et de comportements partagés sur un territoire, et non à une référence ethnique. Giraudoux, rappelle-t-il, défend l'idée que « la race française est une race composée. (...) Il n'y a pas que le Français qui naît. Il y a le Français qu'on fait. » Le but d'une « politique raciale », selon lui, n'est pas de retrouver un « type physique primitif », mais de « constituer, au besoin avec des apports étrangers, un type moral et culturel »49. De même, il relève que l'auteur éprouve un « choc désagréable » en découvrant sur une pancarte ou une affiche l'inscription : « La France aux Français », jugeant que cette phrase, au lieu de « l'enrichir le dépossède ».
Œuvres Romans et nouvelles
Provinciales, 1909
L'École des indifférents comprenant Jacques, l'égoïste ; Don Manuel, le paresseux ; Bernard, le faible Bernard, 1911
Lectures pour une ombre, 1917
Simon le Pathétique, 1918
Amica America, 1918
L'Adieu à la guerre, 1919, Grasset
Elpénor, 1919
Adorable Clio, 1920
Suzanne et le Pacifique, 1921
Siegfried et le Limousin, 1922 qui lui apporta le succès. éditions Grasset
Juliette au pays des hommes, 1924
Bella, 1926
Églantine, 1927
Aventures de Jérôme Bardini, 1930
La France sentimentale, 1932
Combat avec l'ange, 1934
Choix des élues, 1939
La Menteuse, publié à titre posthume en 1958
Œuvres diverses
Les Cinq Tentations de La Fontaine, 1938
Pleins pouvoirs, 1939
Littérature, 1941
Sans pouvoirs
Hommage à Marivaux, 1943
Visitations, 1947
Or dans la nuit, recueil posthume en 1969
Les Contes d'un matin
De pleins pouvoirs à sans pouvoirs, 1950
Pour une politique urbaine, 1947
Théâtre
Siegfried, 1928
Amphitryon 38, 1929
Judith, 1931
Intermezzo, 1933
Tessa, la nymphe au cœur fidèle adaptation Jean Giraudoux d'après Basil Dean et Margaret Kennedy, 1934
La guerre de Troie n'aura pas lieu, 1935
Supplément au voyage de Cook, 1935
L'Impromptu de Paris, 1937
Électre, 1937
Cantique des cantiques, 1938
Ondine, 1939
L'Apollon de Bellac, 1942
Sodome et Gomorrhe, 1943
La Folle de Chaillot, 1945
Pour Lucrèce, 1953
Les Gracques, pièce inachevée publiée en 1958
Les Siamoises, pièce ébauchée publiée en 1982
Cinéma
Scénariste
1942 : La Duchesse de Langeais, de Jacques de Baroncelli d'après Honoré de Balzac adaptation et dialogue
1943 : Les Anges du péché de Robert Bresson scénario, avec Robert Bresson et Raymond Léopold Bruckberger, et dialogue
Bibliographie Monographies
Jacques Body, Jean Giraudoux : la légende et le secret, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Écrivains », novembre 1986, 174 p.
Étienne Brunet, Le Vocabulaire de Jean Giraudoux, structure et évolution : Statistique et informatique appliquées à l’étude des textes à partir du Trésor de la langue française, Genève, éditions Slatkine, 1978, 688 p., (ouvrage issu d’une thèse de doctorat d’État soutenue à Nice le 6 janvier 1976, ouvrage distingué par le CNRS qui a accordé à l'auteur la médaille de bronze de l’année 1976 au titre de la 36e section, Études linguistiques et littéraires françaises.
Philippe Dufay, Jean Giraudoux : biographie, Paris, Julliard, 8 octobre 1993, 532 p.
Natacha Michel, Giraudoux : le roman essentiel, Paris, Hachette littératures, coll. « Coup double », 6 juillet 1998, 215 p.
Jacques Body, Jean Giraudoux, Paris, Gallimard, 29 avril 2004, 950 p.
Guy Teissier et Mauricette Berne, Les Multiples Vies de Jean Giraudoux, Paris, Grasset, 10 novembre 2010, 490 p.
          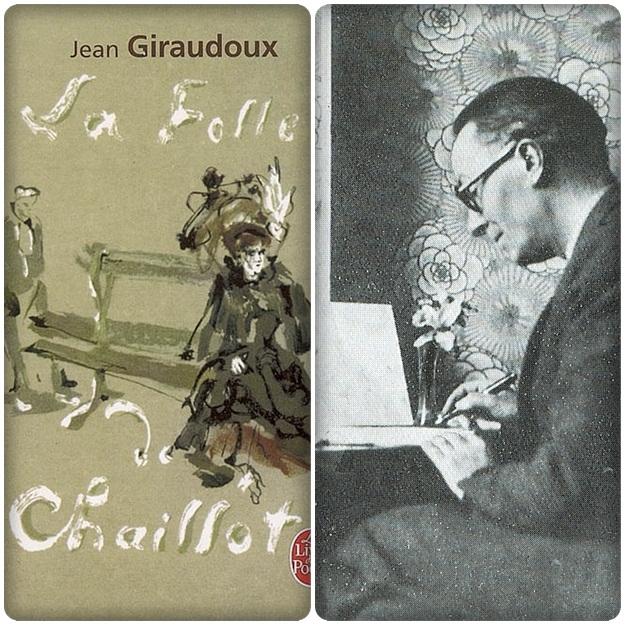
Posté le : 29/01/2016 18:14
Edité par Loriane sur 30-01-2016 16:59:52
Edité par Loriane sur 30-01-2016 16:59:55
|
|
|
|
|
Re: Défi du 23-01-2016 |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
18/02/2015 13:39
De Dijon
Niveau : 39; EXP : 1
HP : 190 / 950
MP : 767 / 25999
|
Cher Donald,
Dans une histoire imaginaire, il y a toujours un peu de vécu, un peu d'imagination, du regret aussi et de la folie tout autant, sûrement.
J'ai voulu aussi me rapprocher de ton style que j'admire beaucoup. J'aime toujours les ambiances que tu sais créer dans tes textes dans lesquels je suis aspiré au point de vouloir y vivre.
Merci pour ton commentaire et au plaisir de te lire encore et toujours.
Amitiés de Bourgogne.
Jacques
Posté le : 29/01/2016 12:36
|
|
|
|
|
Re: Aux encres du soleil couchant |
|
Accro  
Inscrit:
13/01/2016 19:13
De France
Niveau : 11; EXP : 34
HP : 0 / 258
MP : 50 / 6395
|
Merci Jacques pour ce commentaire...
lu et relu
Amitiés de Bretagne
Posté le : 29/01/2016 12:24
|
|
_________________
Fabricando fit faber est un proverbe de vérité, car il est plutôt rare qu'en poétisant dru on en devienne petit télégraphiste, voire même mannequin de haute couture...
|
|
|
Re: Défi du 23-01-2016 |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
14/03/2014 18:40
De Paris
Niveau : 29; EXP : 25
HP : 0 / 706
MP : 370 / 21252
|
OOlala, Jacques, j'ai mal aux neurones tellement elle est gothique ton histoire ! J'espère que ce n'est pas du vécu. Moi, jamais je n'aurais vécu ça !  Je suis trop bien élevé. Bon, allons nous en jeter un petit en souvenir de nos frasques d'antan, quand nous étions de petits polissons plus enclins à courir derrière nos petites camarades à couettes qu'à réciter notre latin.  Amitiés de l'Ile de France, terre de tous les excès (de vitesse, pas en ce moment, avec tous les taxis qui se la jouent escargots) Donald
Posté le : 28/01/2016 20:56
|
|
|
|
|
Re: Défi du 23-01-2016 |
|
Accro  
Inscrit:
13/01/2016 19:13
De France
Niveau : 11; EXP : 34
HP : 0 / 258
MP : 50 / 6395
|
Barrières
Je semble être assise ici
Loin de mes amitiés brisées
La vie se poursuit
Je vous cherche autour de moi
Vous mes amies disparues
Qu’êtes vous devenues ?
Le fil de ma vie s’assombrit
La gomme bloque les branches du cerisier
Que me conte leur floraison ?
Les iris flamboient
Autour de la barrière
À l’abri du banc de bois
Et tous les oiseaux sont partis
Où se sont enfuis mes doux verdiers ?
Je ne vois plus les fleurs des champs
Je ne vois plus le soleil
Les nuages et la pluie m’indiffèrent
Tout passe. Me lasse.
Au fond du jardin
Je me suis terrée
Les cartouches de la vie ont éclaté
Sur mon destin
Aucune tristesse ne m’a contournée...
L’amitié de la jeunesse s’est éparpillée
Sur les notes d’un violon
Son coffre s’est fissuré
Personne ne connaît plus notre joie
Notre insouciance, nos rires
Qu’est-il advenu des princesses ?
Maladroite majesté par ces mots retrouvés
Tu m’aperçois ma douce
Je suis l’étrangère
Mes cadeaux d’amitiés partout écartelés.
Cavalier
Posté le : 26/01/2016 15:16
|
|
_________________
Fabricando fit faber est un proverbe de vérité, car il est plutôt rare qu'en poétisant dru on en devienne petit télégraphiste, voire même mannequin de haute couture...
|
|
|
Re: Défi du 23-01-2016 |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
18/02/2015 13:39
De Dijon
Niveau : 39; EXP : 1
HP : 190 / 950
MP : 767 / 25999
|
Cher Donald,
Chères Loréennes et chers Loréens,
J'ai pris un peu plus mon temps cette fois-ci.
Je vous propose ma modeste contribution au défi de notre ami. J'ai voulu un peu l'imiter dans un style qu'il maîtrise si bien.
J'appelle ce texte "la réunion macabre des anciens de mon école".
Je vous en souhaite bonne lecture.
- Jacques, tu n’oublies pas notre soirée de ce soir.
- Comment cela notre soirée de ce soir !
- Eh bien oui, voyons. Tu ne te souviens pas. Nous sommes invités à la réunion des anciens de ton école, chez ton ami qui a un nom à tiroirs. Tu sais bien : Georges Alexandre Artus de la Farandole.
- Il porte bien son nom celui-là.
- Cesse de vouloir plaisanter. Tu te souviens ou tu ne souviens pas ?
- Je préférerais ne pas vouloir m’en souvenir.
- J’ai répondu favorablement pour nous deux, par simple curiosité de découvrir son château familial dont on parle tant. Il y aurait reçu tant de ses conquêtes, dit-on. N’est-ce pas toi qui m’a dit qu’on l’appelait le jardinier des grâces de ces dames.
- Effectivement, c’est bien comme cela que nous l’appelions quand nous étions jeunes. C’était pour lui un art de vivre qu’il tenait de ses aïeux.
- Alors, on y va ou on n’y va pas.
- Allons-y. Allons nous préparer avant que je ne change d’avis.
Après nous être habillé comme il convient en pareille circonstance, ma femme avec une robe de cocktail et, pour ma part, avec un costume clair, mais sans cravate, nous prenons la route pour le château de la Farandole, situé à vingt kilomètres de Dijon.
Après vingt minutes de route, le château nous apparaît alors au milieu d’un jardin à la française. Sur sa gauche repose un parc aux nombreuses essences d’arbres, les unes communes, les autres rares. Il fait planer sur cette demeure un calme impavide. Sur sa droite, quelques dépendances visiblement aménagées prolongent la majesté du logis principal.
Nous laissons notre voiture dans le parking prévu à cet effet, puis nous rejoignons l’escalier monumental, sis au centre de la façade du château, où nous attendent quelques anciens.
S’approche de moi un grand escogriffe, plus grand que moi encore, en qui je crois reconnaître mon vieux camarade Rémi, qui faisait partie de notre bande, à laquelle nous appartenions avec Georges Alexandre :
- Mon Dieu, Rémi, c’est toi. Comme tu n’as pas changé !
- Jacques, c’est bien toi.
- Aux dernières nouvelles, oui… Je te présente ma femme, Josiane.
- Bonjour. Alors vous êtes l’heureuse élue de notre cher Jacques.
- Cher Jacques, cher Jacques. Dis voir Rémi, vous saviez bien profiter de moi quand il le fallait, Artus et toi, et vous saviez vous faire oublier quand on pouvait avoir besoin de vous. Mais où est donc Georges Alexandre ?
- Jacques, dit Rémi d’une voix sépulcrale, je dois t’apprendre un grand malheur qui nous affecte toutes et tous. Notre ami Georges Alexandre n’est plus.
Un sourire contenu se lit sur mon visage. J’ai beaucoup de peine à ne pas éclater de rire.
- Comment cela, Georges Alexandre n’est plus. Il nous invite et il n’est plus. C’est tout lui ça. Il était sans être. Il voulait être sans devoir l’être. Et surtout avec les femmes !
- Je vois que tu as toujours de l’esprit, me dit Rémi.
- Reconnaissons, l’un et l’autre, que cela n’était pas la qualité première d’Artus, dont l’intelligence était vagabonde du haut vers le bas de son corps, vive et versa et réciproquement. Dis-moi Rémi, qui nous a invités s’il n’est plus ?
- C’est bien lui qui nous a invités dans son château mais c’est moi qui ai lancé les invitations. Et je n’ai pas voulu annuler notre réunion d’anciennes et d’anciens, en souvenir de lui. Je te propose que nous allions nous recueillir sur sa tombe.
- Ah parce qu’il s’est fait enterré chez lui ; disais-je avec un rictus enjoué sur les lèvres !
- C’est une tradition familiale dans son clan !
- Finalement il a toujours eu de bons plans. Ne pas être là quand on avait besoin de lui. Avant d’y aller, on peut boire un coup, lui répondis-je !
Dans le salon d’apparat du château était dressée, sur toute la longueur de la pièce, une table monumentale qui devait faire vingt-cinq mètres de long. Trois trophées de chasse ornaient ce long buffet. Une forêt dense de deux centaines de coupes de champagne noblement remplies y reposait, parsemée, ici et là, d’une belle collection de grand cru de ce nectar champenois.
Plutôt satisfait d’avoir abandonné Rémi que j’avais toujours trouvé obséquieux, je me retrouve au buffet avec ma femme. Une femme s’approche de moi.
- Jacques, c’est bien toi, me dit cette femme que j’ai bien de la peine à reconnaître.
- Eh bien oui, qui veux-tu que cela soit d’autre ?
- Tu as gardé les mêmes traits qu’à l’époque de nos frasques, me dit-elle en posant délicatement sa main gauche dans le bas de mon dos.
Ma femme ne voit pas là de la délicatesse mais plutôt un début de sensualité. Et l’émission du mot frasque déclenche le feu de son tempérament méditerranéen :
- Puis-je savoir à qui ai-je l’honneur, lance-t-elle à la belle inconnue ?
- Nous étions dans la même classe de la troisième à la terminale. Nous avons connus ensemble nos premiers émois amoureux, lui lance cette femme en qui je finis par reconnaître Eléonore.
- Eléonore, qu’es-tu donc devenu depuis tout ce temps ?
En prenant ainsi la parole, j’espérais que ma femme ne s’emporte pas. Elle seule compte aujourd’hui. Et ce n’est pas cette coureuse de dots qui allait nuire à tant d’années d’épousailles heureuses.
- Aujourd’hui, je suis la femme de Georges Alexandre.
- Tu étais la femme de Georges Alexandre, lui répondis-je du tac au tac… Tu n’as pas l’air d’en être très affectée.
- C’était un coureur de jupons. Et puis nous étions très libres l’un et l’autre.
- Je me souviens. Au lycée déjà, un grand nombre parmi nous avait goûté à tes indulgences sensuelles... Et elles pouvaient même être plénières, disais-je en souriant.
- Oui, mais un seul n’y avait pas goûté. Toi !
Que n’avait-elle dit là ? C’était la phrase de trop ! Eléonore ne connaissait pas le tempérament de feu de ma femme. Dans les minutes qui suivent, j’eus une pensée émue pour elle. Tout en lui disant qu’elle pouvait rejoindre son époux là où il se trouve, ma femme lui met une claque sur le visage qui eut l’effet radical de la conduire au silence absolu. Et cette claque fit un bien fou à ma femme. Je lui donne raison. Sa jalousie maîtrisée m’émoustille.
Finalement cette soirée allait devenir très prometteuse.
Ma femme m’embrasse sur la bouche et m’invite à nous éloigner.
Un serveur nous propose deux coupes de champagne et quelques toasts délicieux. Nous nous éloignons du buffet de peur de voir revenir Rémi qui nous fait un signe de la main droite.
Nous sommes pris l’un et l’autre par le désir de rejoindre un autre groupe d’anciens avec la volonté réelle de visiter le château. Nous sommes aussi curieux l’un et l’autre des belles choses.
Alors que nous approchons du grand escalier classique qui monte au premier étage, nous sommes interpellés par mon vieux camarade Philippe, que rejoint Eléonore.
Nous sommes convaincus que nous n’échapperons pas à l’hommage à rendre à l’obsédé sexuel de la bande.
- Bonjour Jacques, je suis heureux de te voir. Nous avions pris le pari que tu ne viendrais pas.
- Et qu’avez-vous parié ? Encore de vous livrer à l’une de vos beuveries de carabins ?
- Non, pas cette fois-ci. Juste le pari de se retrouver très vite une seconde fois !
- Deviendriez raisonnable, lançais-je à Philippe.
- Tu n’as pas encore rendu hommage à notre ami Georges Alexandre ?
- Si je comprends bien, tant que je ne l’aurai pas fait, vous allez me tanner jusqu’à je le fasse. Au fait, connais-tu ma femme ? Josiane, je te présente Philippe, mon voisin de bureau, dans l’école où nous étions… Bon allons rendre hommage à notre hôte !
Nous sortons du château et nous nous enfonçons pendant une minute dans le parc et au pied d’un chêne apparaît une tombe sur laquelle est inscrit l’épitaphe suivante :
Ci-git Georges Alexandre Artus de la Farandole.
Il fit le bonheur de ses nombreuses maîtresses
C’est qu’il les aima toutes, ces bougresses,
Mais la mort eut raison de sa hardiesse.
- Le bon vieux Artus ! Mort ! Mais ce n’est pas possible ! Je n’arrive pas à m’y faire.
- Tu te souviens bien de lui, me lance Philippe.
- Bien sûr. Des bons et des mauvais souvenirs. Je me souviens de lui quand il en faisait voir de toutes les couleurs au Père Ripoche, dans la cour de notre école.
- Aux couleurs de la mort.
- Ce n’est pas drôle !
- Rappelles toi, il avait un humour pendable. Après avoir fait une plaisanterie, il disait toujours : c’est à mourir de rire.
- Au moins, il aura fini par avoir satisfaction, lançai-je à Philippe, avec une pointe d’humour.
- Ah, tu vois, tu en ris toi-même.
- Comment est-il mort ?
- Les uns disent qu’il serait mort dans les bras d’une femme, ce qui expliquerait son épitaphe. Les autres affirment qu’une femme a eu raison de lui, sans savoir de quelle raison il s’agit.
- Tu es devenu bien mystérieux. Tu n étais pas ainsi autrefois. Nous connaissons la belle ?
- Oui, je te le confirme. Nous la connaissons. C’est l’une de nos anciennes camarades.
- Quelle est cette femme mystérieuse qui a eu raison de lui ?
- Je peux juste te dire qu’elle a eut autant raison de lui que lui d’elle! A en faire des syncopes !
- S’il en eu une, elle lui aura été fatale, lui répondis-je !
- Tu le connaissais bien, vous étiez très proche. Tu pourrais aisément le deviner.
- - Je t’arrête tout de suite. Nous n’étions pas si proches. C’était un bringueur de première. Il excellait dans ce domaine, à toujours vouloir honorer un défi de conquête. En revanche, quand il s’agissait de produire un travail en commun, alors là, il demandait le temps de la réflexion et de « l’intériorisation réflexive », aimait-il dire.
- Mais au fond de toi-même, tu l’aimais bien pour cela.
- Tu as raison. Malgré tous ses travers, je l’aimais bien. Je l’enviais même un peu. Tout lui était facile. Une conquête féminine ! Il était le travailleur des dernières minutes qui finissait toujours par réussir. Il n’était pas si mauvais le bougre. Il avait quelques talents comme celui de bien aimer faire des vers. Il disait qu’il aurait aimé en vivre.
- Eh bien maintenant ils se nourrissent mutuellement.
- Tu es méchant.
- Alors tu l’aimais donc bien !
Philippe s’éloigne alors de moi et rejoint Eléonore sur le perron du château.
De loin, je vois un homme sortir du château qui ressemble à s’y méprendre à Georges Alexandre.
Je dis à ma femme :
- Mais c’est Georges Alexandre. Le voilà revenu de l’au-delà. Je vais finir par croire à la résurrection.
Georges Alexandre s’approche de moi et me dit :
- Salut, Jacques, je suis heureux que tu sois présent. Il était important pour moi que tu sois présent à cette fête.
- Alors tu n’es pas mort. Laisse moi te toucher.
- Non je ne suis pas mort. Ce serait un manque de savoir vivre.
- Je vois que tu es toujours le même, lui disais-je !
- Je voulais voir qui étaient mes véritables amis avant ma véritable mort.
La fête dura jusque tard dans la nuit. Le repas fut pantagruélique et les vins coulèrent à flots. Cette fête fut l’une des plus belles à mes yeux.
Un mois après cette fête, je reçus une très gentille lettre d’Eléonore qui m’avouait son amour tendre pour Georges Alexandre et la fidélité qui avait été la leur entre deux depuis leur mariage, voilà bientôt douze ans. Elle m’annonçait également la mort de notre très sincère ami Georges Alexandre Artus de la Farandole…
Amitiés de Dijon.
Jacques
Posté le : 25/01/2016 21:26
|
|
|
|
|
Re: Défi du 23-01-2016 |
|
Modérateur  
Inscrit:
21/03/2013 20:08
De Belgique
Niveau : 44; EXP : 15
HP : 215 / 1078
MP : 1072 / 35550
|
Cher Donald,
Il s'agit bien d'un fantôme. Finir dans un home, je trouve cela si triste. J'espère m'envoler avant...
Bises
Posté le : 25/01/2016 06:10
|
|
|
|
|
Re: Défi du 23-01-2016 |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
14/03/2014 18:40
De Paris
Niveau : 29; EXP : 25
HP : 0 / 706
MP : 370 / 21252
|
Chère Delphine,
J'ai cru à une histoire de fantômes et je ne sais toujours pas si j'ai tort ou raison. En tout cas, tu as bien détourné le défi, dans un sens que je n'attendais pas. Comme quoi, tu me surprendras toujours, ô toi reine des Hurlus.
Bises
Donald
PS: Tu vas être une grand-mère difficile à caser dans une maison de retraite.
Posté le : 24/01/2016 19:38
|
|
|
|
|
Re: Aux encres du soleil couchant |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
18/02/2015 13:39
De Dijon
Niveau : 39; EXP : 1
HP : 190 / 950
MP : 767 / 25999
|
Bonsoir Cavalier,
Je suis un autre cavalier qui a surgi du fond de la nuit et qui s'est ressourcé dans la poésie.
Ah un autre cartésien qui ne l'est plus!
Descartes s'est trompé. La neurophysiologie nous l'a bien révélé. ET la vie tout simplement aussi.
Ton texte me fait penser à ces vers de Théophile Gautier :
"Le poète est ainsi dans les landes du monde
Lorsqu'il est sans blessure, il garde son trésor.
Il faut qu'il ait au coeur une entaille profonde
pour épancher ses vers, divines larmes d'or".
Continue à t'épancher auprès de nous, au milieu de nous.
Et sois le bienvenu parmi nous.
Vive L'Orée.
Vive Loriane.
Vive nous, en toute humilité, mais surtout avec le désir de bien écrire et de bien s'amuser.
Amitiés de Bourgogne.
Jacques
Posté le : 24/01/2016 19:29
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
137 Personne(s) en ligne ( 87 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 137
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages